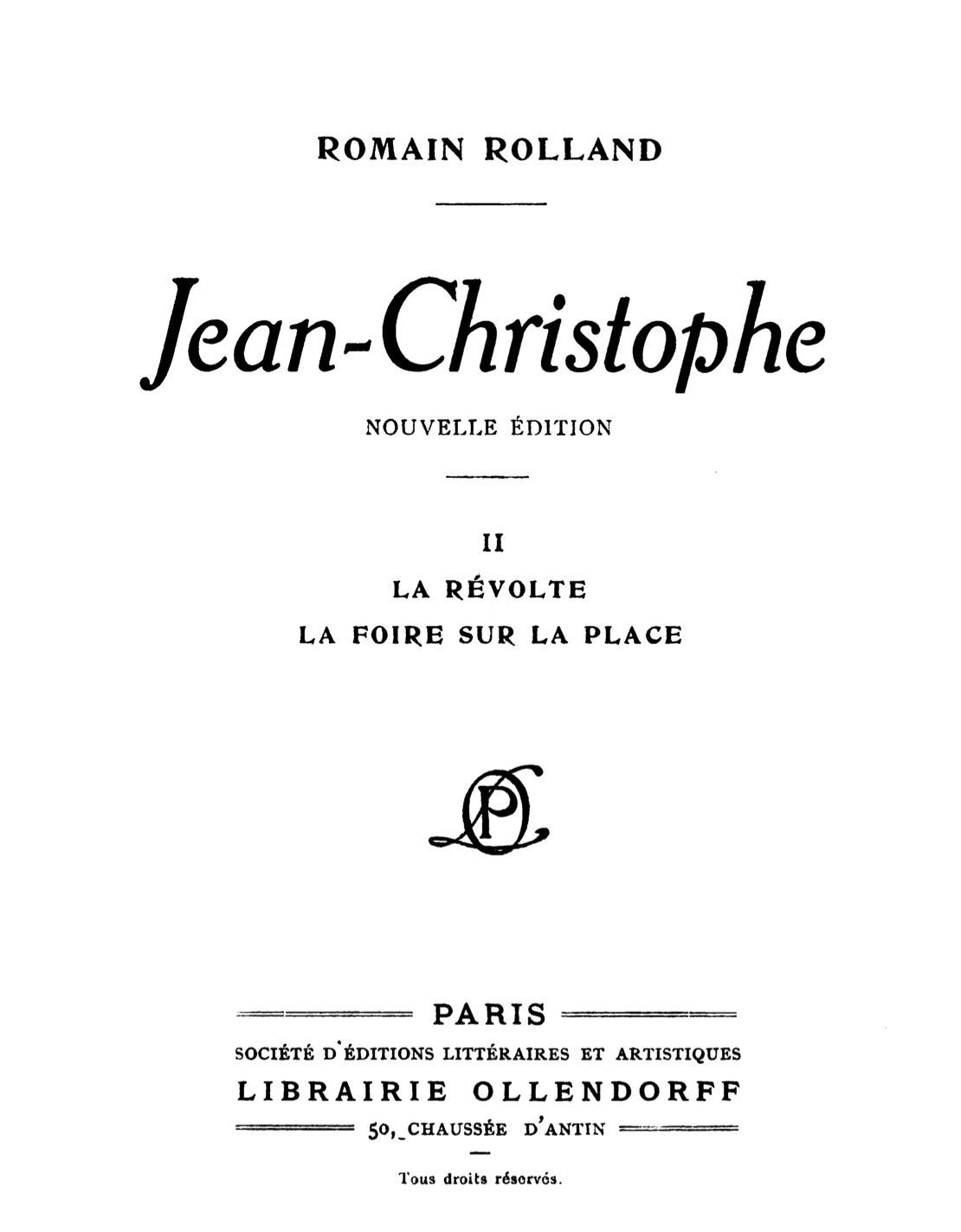
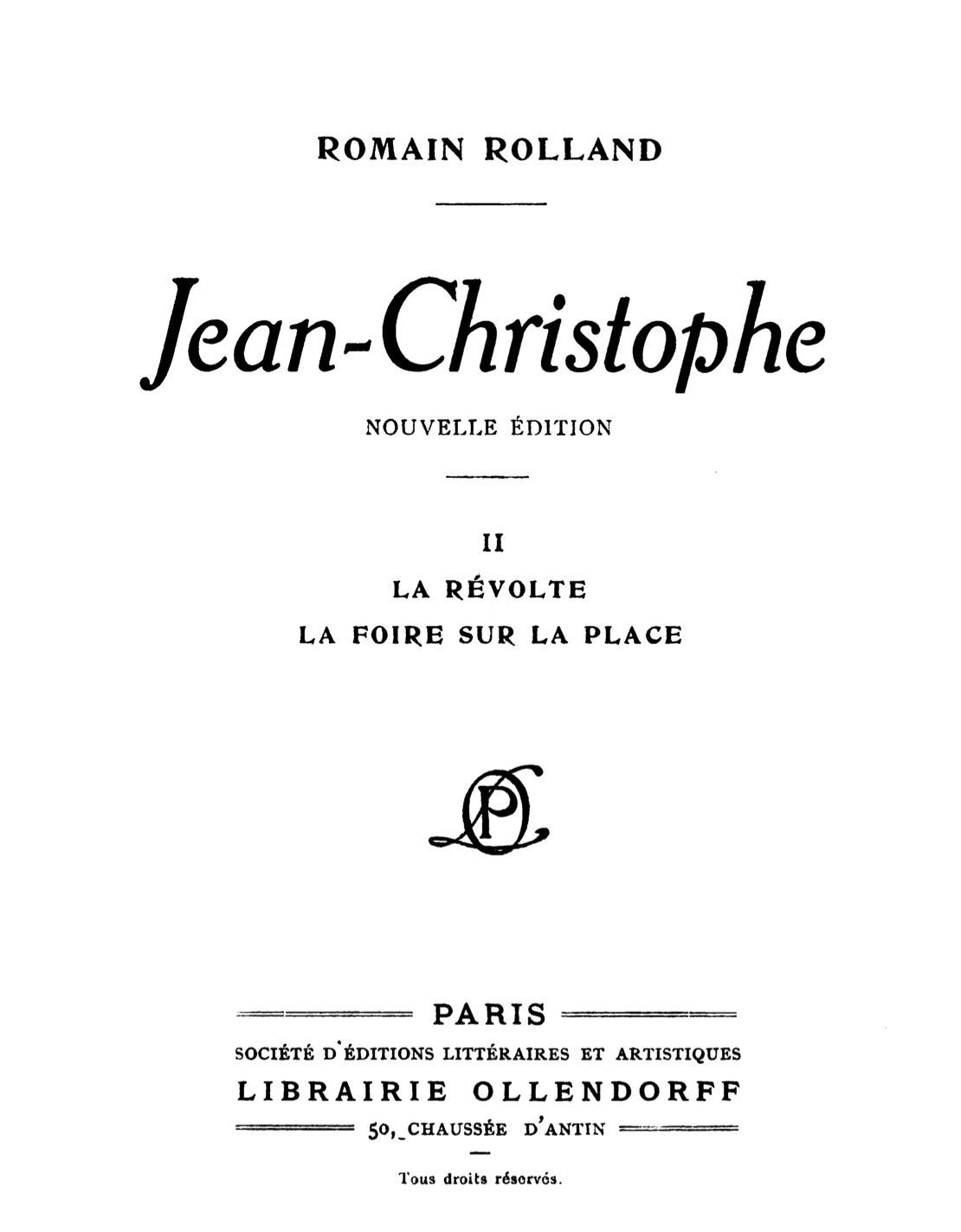
Au seuil d'une période nouvelle de Jean-Christophe, dont le caractère de critique un peu vive risquera de blesser tour à tour les lecteurs de tous les partis, je prie mes amis et ceux de Jean-Christophe de ne jamais prendre nos jugements comme définitifs. Chacune de nos pensées n'est qu'un moment de notre vie. À quoi nous servirait de vivre, si ce n'était pour corriger nos erreurs, vaincre nos préjugés, élargir notre pensée et notre cœur? Patience! Faites-nous crédit, si nous nous trompons. Nous savons que nous nous trompons. Quand nous reconnaîtrons nos erreurs, nous les condamnerons plus durement que vous. Chaque jour, nous nous efforçons d'atteindre un peu plus de vérité. Lorsque nous serons au terme, vous jugerez ce que valait notre effort. Comme dit un vieux proverbe: «LA FIN LOUE LA VIE, ET LE SOIR LE JOUR».
R. R.
Novembre 1906.
Libre!... Libre des autres et de soi!... Le réseau de passions, qui le liaient depuis un an, venait brusquement de se rompre. Comment? Il n'en savait rien. Les mailles avaient cédé à la poussée de son être. C'était une de ces crises de croissance, où les natures robustes déchirent violemment l'enveloppe morte d'hier, l'âme ancienne où elles étouffent.
Christophe respirait à pleins poumons, sans bien comprendre ce qui était arrivé. Un tourbillon de bise glacée s'engouffrait sous la grande porte de la ville, quand il rentra, venant d'accompagner Gottfried. Les gens baissaient la tête contre l'ouragan. Les filles allant à l'ouvrage luttaient avec dépit contre le vent qui se jetait dans leurs jupes; elles s'arrêtaient pour souffler, le nez et les joues rouges, l'air rageur; elles avaient envie de pleurer. Christophe riait de joie. Il ne pensait pas à la tourmente. Il pensait à l'autre tourmente, dont il venait de sortir. Il regardait le ciel d'hiver, la ville enveloppée de neige, les gens qui passaient en luttant; il regardait autour de lui, en lui: rien ne le liait plus à rien. Il était seul... Seul! Quel bonheur d'être seul, d'être à soi! Quel bonheur d'avoir échappé à ses chaînes, à la torture de ses souvenirs, à l'hallucination des figures aimées et détestées! Quel bonheur de vivre enfin, sans être la proie de la vie, d'être devenu son maître!...
Il rentra dans sa maison, blanc de neige. Il se secoua gaiement, comme un chien. En passant près de sa mère, qui balayait le corridor, il l'enleva de terre, avec des cris inarticulés et affectueux, comme on en dit aux petits enfants. La vieille Louisa se débattait dans les bras de son fils, mouillé de neige qui fondait; et elle l'appela: «gros bête!» en riant d'un bon rire enfantin.
Il monta dans sa chambre, quatre à quatre. Il pouvait à peine se voir dans sa petite glace, tant le jour était sombre. Mais son cœur jubilait. Sa chambre étroite et basse, où il avait peine à remuer, lui semblait un royaume. Il ferma la porte à clef, et rit de contentement. Enfin, il allait se retrouver! Depuis combien de temps s'était-il perdu! Il avait hâte de se plonger dans sa pensée. Elle lui apparaissait comme un grand lac qui se fondait au loin dans la brume dorée. Après une nuit de fièvre, il se tenait au bord, les jambes baignées par la fraîcheur de l'eau, le corps caressé par la brise d'un matin d'été. Il se jeta à la nage; il ne savait où il allait, et peu lui importait: c'était la joie de nager au hasard. Il se taisait, riant, écoutant les mille bruits de son âme: elle fourmillait d'êtres. Il n'y distinguait rien, la tête lui tournait; il n'éprouvait qu'un bonheur éblouissant. Il jouit de sentir ces forces inconnues; et, remettant paresseusement à plus tard de faire l'essai de son pouvoir, il s'engourdit dans l'orgueilleuse ivresse de cette oraison intérieure qui, comprimée depuis des mois, éclatait comme un printemps soudain.
Sa mère l'appelait à déjeuner. Il descendit, la tête étourdie, ainsi qu'après une journée au grand air; une telle joie rayonnait en lui que Louisa lui demanda ce qu'il avait. Il ne répondit pas; il la prit par la taille et la força à faire un tour de danse autour de la table, où la soupière fumait. Louisa, essoufflée, cria qu'il était fou; puis elle frappa des mains:
—Mon Dieu! fit-elle, inquiète. Je parie qu'il est de nouveau amoureux!
Christophe éclata de rire. Il lança sa serviette en l'air:
—Amoureux!... s'écria-t-il. Ah! bon Dieu!... Non, non! c'est assez! Tu peux être tranquille. C'est fini, fini, pour toute la vie fini!... Ouf!
Il but un grand verre d'eau.
Louisa le regardait rassurée, hochait la tête, souriait:
—Beau serment d'ivrogne! dit-elle. Il y en a pour jusqu'au soir.
—C'est toujours cela de gagné, répondit-il, de bonne humeur.
—Bien sûr! fit-elle. Alors, qu'est-ce que tu as qui te rend si content?
—Je suis content. Voilà!
Les coudes sur la table, assis en face d'elle, il voulut lui conter tout ce qu'il ferait plus tard. Elle l'écoutait avec un affectueux scepticisme, et lui faisait remarquer doucement que la soupe refroidissait. Il savait qu'elle n'entendait pas ce qu'il disait; mais il n'en avait cure: c'était pour lui-même qu'il parlait.
Ils se regardaient en souriant: lui, parlant; elle, n'écoutant guère. Bien qu'elle fût fière de son fils, elle n'attachait pas grande importance à ses projets artistiques; elle pensait: «Il est heureux: c'est l'essentiel.»—Tout en se grisant de ses discours, il regardait la chère figure de sa mère, avec son fichu noir sévèrement serré autour de la tête, ses cheveux blancs, ses yeux jeunes qui le couvaient d'amour, son beau calme indulgent. Il lisait toutes ses pensées en elle. Il lui dit, en plaisantant:
—Cela t'est bien égal, hein? tout ce que je te raconte?
Elle protesta faiblement:
—Mais non, mais non!
Il l'embrassa:
—Mais si, mais si! Va, ne t'en défends pas. Tu as raison. Aime-moi seulement. Je n'ai pas besoin qu'on me comprenne,—ni toi, ni personne. Je n'ai plus besoin de personne, ni de rien, maintenant: j'ai tout en moi...
—Allons, fit Louisa, le voilà avec une autre folie, à présent!... Enfin, puisqu'il lui en faut une, j'aime encore mieux celle-là.
Bonheur délicieux de se laisser flotter sur le lac de sa pensée!... Couché au fond d'une barque, le corps baigné de soleil, le visage baisé par le petit air frais qui court à la surface de l'eau, il s'endort, suspendu sur le ciel. Sous son corps étendu, sous la barque balancée, il sent l'onde profonde; sa main nonchalamment y plonge. Il se soulève; et, le menton appuyé sur le rebord du bateau, comme quand il était enfant, il regarde passer l'eau. Il voit des miroitements d'êtres étranges, qui filent comme des éclairs... D'autres, d'autres encore... Jamais ils ne sont les mêmes. Il rit au spectacle fantastique qui se déroule en lui; il rit à sa pensée; il n'a pas le besoin de la fixer. Choisir, pourquoi choisir dans ces milliers de rêves? Il a bien le temps!... Plus tard!... Quand il voudra, il n'aura qu'à jeter ses filets, pour retirer les monstres qu'il voit luire dans l'eau. Il les laisse passer... Plus tard!...
La barque flotte au gré du vent tiède et du courant insensible. Il fait doux, soleil, et silence.
Languissamment enfin, il laisse tomber les filets. Penché sur l'eau qui grésille, il les suit du regard, jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Après quelques minutes de torpeur, il les ramène sans hâte; à mesure qu'il les tire, ils deviennent plus lourds; au moment de les sortir, il s'arrête pour prendre haleine. Il sait qu'il tient sa proie, il ne sait quelle est sa proie; il prolonge le plaisir de l'attente.
Enfin, il se décide: les poissons aux cuirasses irisées apparaissent hors de l'eau; ils se tordent comme un nid de serpents. Il les regarde curieusement, il les remue du doigt, il veut prendre les plus beaux, un instant, dans sa main; mais à peine les a-t-il sortis de l'eau que leurs nuances pâlissent, ils se fondent entre ses doigts. Il les rejette dans l'eau, et recommence à pêcher. Il est plus avide devoir, l'un après l'autre, tous les rêves qui s'agitent en lui, que d'en garder aucun: ils lui semblent plus beaux, quand ils flottent librement dans le lac transparent...
Il en pêchait de toutes sortes, tous plus extravagants les uns que les autres. Depuis des mois que les idées s'amassaient, sans qu'il en tirât parti, il crevait de richesses à dépenser. Mais tout était pêle-mêle: sa pensée était un capharnaüm, un bric-à-brac de juif, où étaient empilés dans la même chambre des objets rares, des étoffes précieuses, des ferrailles, des guenilles. Il ne savait pas distinguer ce qui avait le plus de prix: tout l'amusait également. C'étaient des frôlements d'accords, des couleurs qui sonnaient comme des cloches, des harmonies qui bourdonnaient comme des abeilles, des mélodies souriantes comme des lèvres amoureuses. C'étaient des visions de paysages, des figures, des passions, des âmes, des caractères, des idées littéraires, des idées métaphysiques. C'étaient de grands projets, énormes et impossibles, des tétralogies, des décalogies, ayant la prétention de tout peindre en musique et embrassant des mondes. Et c'étaient, le plus souvent, des sensations obscures et fulgurantes, évoquées subitement par un rien, un son de voix, une personne qui passait dans la rue, le clapotement de la pluie, un rythme intérieur.—Beaucoup de ces projets n'avaient d'autre existence que le titre; la plupart se réduisaient à un ou deux traits, pas plus: c'était assez. Comme les très jeunes gens, il croyait avoir créé ce qu'il rêvait de créer.
Mais il était trop vivant pour se satisfaire longtemps de ces fumées. Il se lassa d'une possession illusoire, il voulut saisir ses rêves.—Par lequel commencer? Ils lui paraissaient tous aussi importants l'un que l'autre. Il les tournait et les retournait; il les rejetait, il les reprenait... Non, il ne les reprenait plus: ce n'étaient plus les mêmes, ils ne se laissaient pas attraper deux fois; constamment, ils changeaient; ils changeaient dans ses mains, sous ses yeux, tandis qu'il les regardait. Il fallait se hâter; et il ne le pouvait point: il était confondu par sa lenteur au travail. Il eût voulu tout faire en un jour, et il avait une difficulté terrible à exécuter le moindre ouvrage. Le pire était qu'il s'en dégoûtait, quand il était encore au commencement. Ses rêves passaient, et il passait lui-même; tandis qu'il faisait une chose, il regrettait de n'en pas faire une autre. Il semblait qu'il lui suffit d'avoir fait choix d'un de ses beaux sujets, pour que le beau sujet ne l'intéressât plus. Ainsi, toutes ses richesses lui étaient inutiles. Ses pensées n'étaient vivantes qu'à la condition qu'il n'y touchât point: tout ce qu'il réussissait à atteindre était déjà mort. Le supplice de Tantale: à portée de sa main, des fruits qui devenaient pierre, aussitôt qu'il les prenait; près de ses lèvres, une eau fraîche, qui fuyait quand il se baissait vers elle.
Pour apaiser sa soif, il voulut se désaltérer aux sources qu'il avait conquises, à ses œuvres anciennes... La dégoûtante boisson! À la première gorgée, il la recracha en jurant. Quoi! cette eau tiède, cette musique insipide, c'était là sa musique?—Il relut la suite de ses compositions. Cette lecture l'atterra: il n'y comprenait plus rien, il ne comprenait même plus comment il avait pu les écrire. Il rougissait. Une fois, il lui arriva, après une page plus niaise que les autres, de se retourner pour voir s'il n'y avait personne dans la chambre, et d'aller se cacher la figure dans son oreiller, comme un enfant qui a honte. D'autres fois, le ridicule de ses œuvres lui semblait si bouffon qu'il oubliait qu'elles étaient de lui...
—Ah! l'idiot! criait-il, en se tordant de rire.
Mais rien ne l'affectait plus que les compositions où il avait prétendu exprimer des sentiments passionnés: chagrins ou joies d'amour. Il bondissait sur sa chaise, comme si une mouche l'avait piqué; il martelait sa table à coups de poing, et se frappait la tête, en hurlant de colère; il s'apostrophait grossièrement, il se traitait de cochon, de triple gueux, de foutue bête et de paillasse. Il en avait pour quelque temps à égrener son chapelet. À la fin, il allait se planter devant sa glace, tout rouge d'avoir crié; il s'empoignait le menton, et il disait:
—Regarde, regarde, crétin, ta gueule d'âne! Je t'apprendrai à mentir, chenapan! À l'eau, monsieur, à l'eau!
Il s'enfonçait la figure dans sa cuvette, et il la maintenait sous l'eau, jusqu'à ce qu'il étouffât. Quand il sortait de là, écarlate, les yeux hors de la tête, et soufflant comme un phoque, il allait précipitamment à sa table, sans prendre la peine d'éponger l'eau qui ruisselait autour de lui; il saisissait les compositions maudites, et il les déchirait avec rage, en grognant:
—Tiens, canaille!... Tiens, tiens, tiens!...
Alors, il était soulagé.
Ce qui l'exaspérait surtout dans ces œuvres, c'était leur mensonge. Rien de senti. Une phraséologie apprise par cœur, une rhétorique d'écolier: il parlait de l'amour, comme un aveugle des couleurs; il en parlait par ouï-dire, en répétant les niaiseries courantes. Et non seulement l'amour, mais toutes les passions lui avaient servi de thèmes à des déclamations.—Pourtant, il s'était toujours efforcé d'être sincère. Mais il ne suffit pas de vouloir être sincère: il faut pouvoir l'être; et comment le serait-on, quand on ne connaît encore rien de la vie? Ce qui venait de lui dévoiler la fausseté de ces œuvres, ce qui avait creusé brusquement un fossé entre lui et son passé, c'était l'épreuve des six derniers mois. Il était sorti des fantômes; il possédait maintenant une mesure réelle, à laquelle il pouvait rapporter ses pensées, pour en juger le degré de vérité ou de mensonge.
Le dégoût que lui inspirèrent ses compositions anciennes, produites sans passion, fit qu'avec son exagération coutumière il décida de ne plus rien écrire qu'il ne fût contraint d'écrire par une nécessité passionnée; et, laissant là sa poursuite aux idées, il jura de renoncer pour toujours à la musique, si la création ne s'imposait, à coups de tonnerre.
Il parlait ainsi, parce qu'il savait bien que l'orage venait.
Le tonnerre tombe où il veut, et quand il veut. Mais les sommets l'attirent. Certains lieux—certaines âmes—sont des nids d'orages: ils les créent ou les aspirent de tous les points del horizon; et, de même que certains mois de l'année, certains âges de la vie sont si saturés d'électricité que les coups de foudre s'y produisent—sinon à volonté—du moins à l'heure attendue.
L'être tout entier se tend. Pendant des jours, des jours, l'orage se prépare. Une ouate brûlante tapisse le ciel blanc. Pas un souffle. L'air immobile fermente, semble bouillir. La terre se tait, écrasée de torpeur. Le cerveau bourdonne de fièvre: toute la nature attend l'explosion de la force qui s'amasse, le choc du marteau qui se lève pesamment, pour retomber d'un coup sur l'enclume des nuées. De grandes ombres sombres et chaudes passent: un vent de feu se lève; les nerfs frémissent comme des feuilles... Puis, le silence retombe. Le ciel continue de couver la foudre.
Il y a à cette attente une angoisse voluptueuse. Malgré le malaise qui vous oppresse, on sent passer dans ses veines le feu qui brûle l'univers. L'âme soûle bouillonne dans la fournaise, comme le raisin dans la cuve. Des milliers de germes de vie et de mort la travaillent. Qu'en sortira-t-il?... Comme la femme enceinte, elle se tait, le regard perdu en elle; anxieuse, elle écoute le tressaillement de ses entrailles, et elle pense: «Que naîtra-t-il de moi?»...
Quelquefois, l'attente est vaine. L'orage se dissipe, sans avoir éclaté; et l'on se réveille, la tête lourde, déçu, énervé, écœuré. Mais c'est partie remise: il éclatera; si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain; plus il aura tardé, plus il sera violent...
Le voici!... Les nuages ont surgi de toutes les retraites de l'être. Masses épaisses d'un-bleu noir, que déchirent les saccades frénétiques des éclairs, ils s'avancent d'un vol vertigineux et lourd, cernant l'horizon de l'âme, et brusquement rabattant leurs deux ailes sur le ciel étouffé, éteignant la lumière. Heure de folie!... Les Eléments exaspérés, déchaînés de la cage où les tiennent enfermés les Lois qui assurent l'équilibre de l'esprit et l'existence des choses, règnent, informes et colossaux, dans la nuit de la conscience. On sent qu'on agonise. On n'aspire plus à vivre. On n'aspire plus qu'à la fin, à la mort qui délivre...
Et soudain, c'est l'éclair!
Christophe hurlait de joie.
Joie, fureur de joie, soleil qui illumine tout ce qui est et sera, joie divine de créer! Il n'y a de joie que de créer. Il n'y a d'êtres que ceux qui créent. Tous les autres sont des ombres, qui flottent sur la terre, étrangers à la vie. Toutes les joies de la vie sont des joies de créer: amour, génie, action,—flambées de force sorties de l'unique brasier. Ceux même qui ne peuvent trouver place autour du grand foyer:—ambitieux, égoïstes et débauchés stériles,—tâchent de se réchauffer à ses reflets décolorés.
Créer, dans l'ordre de la chair, ou dans l'ordre de l'esprit, c'est sortir de la prison du corps, c'est se ruer dans l'ouragan de la vie, c'est être Celui qui Est. Créer, c'est tuer la mort.
Malheur à l'être stérile, qui reste seul et perdu sur la terre, contemplant son corps desséché et la nuit qui est en lui, dont nulle flamme de vie ne sortira jamais! Malheur à l'âme qui ne se sent point féconde, lourde de vie et d'amour, comme un arbre en fleurs, au printemps! Le monde peut la combler d'honneurs et de bonheurs; il couronne un cadavre.
Quand Christophe était frappé par le jet de lumière, une décharge électrique lui parcourait le corps; il tremblait de saisissement. C'était comme si, en pleine mer, en pleine nuit, la terre apparaissait. Ou comme si, passant au milieu d'une foule, il recevait le choc de deux profonds yeux. Souvent, cela survenait après des heures de prostration où son esprit s'agitait dans le vide. Plus souvent encore, à des moments où il pensait à autre chose, causant ou se promenant. S'il était dans la rue, un respect humain l'empêchait de manifester trop bruyamment sa joie. Mais, à la maison, rien ne le retenait plus. Il trépignait; il sonnait une fanfare de triomphe. Sa mère la connaissait bien, et elle avait fini par savoir ce que cela signifiait. Elle disait à Christophe qu'il était comme une poule qui vient de pondre.
Il était transpercé par l'idée musicale. Tantôt, elle avait la forme d'une phrase isolée et complète; plus fréquemment, d'une grande nébuleuse enveloppant toute une œuvre: la structure du morceau, ses lignes générales se laissaient deviner au travers d'un voile, que lacéraient par places des phrases éblouissantes, se détachant de l'ombre avec une netteté sculpturale. Ce n'était qu'un éclair; parfois, il en venait d'autres, coup sur coup: chacun illuminait d'autres coins de la nuit. Mais d'ordinaire, la force capricieuse, après s'être manifestée une fois, à l'improviste, disparaissait pour plusieurs jours dans ses retraites mystérieuses, en laissant derrière elle un sillon lumineux.
Cette jouissance de l'inspiration était si vive que Christophe prit le dégoût du reste. L'artiste d'expérience sait bien que l'inspiration est rare, et que c'est à l'intelligence d'achever l'œuvre de l'intuition; il met ses idées sous le pressoir; il leur fait rendre jusqu'à la dernière goutte du suc divin qui les gonfle;—(et même, trop souvent, il les trempe d'eau claire.)—Christophe était trop jeune et trop sûr de lui pour ne pas mépriser ces moyens. Il faisait le rêve impossible de ne rien produire qui ne fût entièrement spontané. S'il ne s'était aveuglé à plaisir, il n'aurait pas eu de peine à reconnaître l'absurdité de son dessein. Sans doute, il était alors dans une période d'abondance intérieure où il n'y avait nul interstice, par où le néant pût se glisser. Tout lui était un prétexte à cette fécondité intarissable: tout ce que voyaient ses yeux, tout ce qu'il entendait, tout ce que heurtait son être dans sa vie quotidienne, chaque regard, chaque mot, faisait lever dans l'âme des moissons de rêves. Dans le ciel sans bornes de sa pensée, coulaient des millions d'étoiles.—Et pourtant, même alors, il y avait des moments où tout s'éteignait d'un coup. Et bien que la nuit ne durât point, bien qu'il n'eût guère le temps de souffrir des silences prolongés de l'esprit, il n'était pas sans effroi de cette puissance inconnue, qui venait le visiter, le quittait, revenait, disparaissait... pour combien de temps, cette fois? Reviendrait-elle jamais?—Son orgueil repoussait cette pensée, et disait: «Cette force, c'est moi. Du jour où elle ne sera plus, je ne serai plus: je me tuerai.»—Il ne laissait pas de trembler; mais c'était une jouissance de plus.
Toutefois, s'il n'y avait aucun danger, pour l'instant, que la source tarit, Christophe pouvait se rendre compte déjà que jamais elle ne suffisait à alimenter une œuvre tout entière. Les idées s'offraient presque toujours à l'état brut: il fallait les dégager péniblement de la gangue. Et toujours elles se présentaient sans suite, par saccades; pour les relier entre elles, il fallait y mêler un élément d'intelligence réfléchie et de volonté froide, qui forgeaient avec elles un être nouveau. Christophe était trop artiste pour ne point le faire; mais il n'en voulait pas convenir; il mettait de la mauvaise foi à se persuader qu'il se bornait à transcrire son modèle intérieur, quand il était forcé de le transformer plus ou moins pour le rendre intelligible.—Bien plus: il arrivait qu'il en faussât entièrement le sens. Avec quelque violence que le frappât l'idée musicale, il lui eût été impossible souvent de dire ce qu'elle signifiait. Elle faisait irruption des souterrains de l'Être, bien au delà des frontières où commence la conscience; et, dans cette Force toute pure, échappant aux mesures communes, la conscience ne parvenait à reconnaître aucune des préoccupations qui l'agitaient, aucun des sentiments humains qu'elle définit et qu'elle classe: joies, douleurs, ils étaient tous mêlés en une passion unique, et inintelligible, parce qu'elle était au-dessus de l'intelligence. Cependant, qu'elle la comprit ou non, l'intelligence avait besoin de donner un nom à cette force, de la rattacher à une des constructions logiques que l'homme maçonne infatigablement dans la ruche de son cerveau.
Ainsi, Christophe se convainquait—il voulait se convaincre—que l'obscure puissance qui l'agitait avait un sens précis, et que ce sens s'accordait avec sa volonté. Le libre instinct, jailli de l'inconscience profonde, était, bon gré, mal gré, contraint à s'accoupler, sous le joug de la raison, avec des idées claires qui n'avaient aucun rapport avec lui. Telle œuvre n'était ainsi qu'une juxtaposition mensongère d'un de ces grands sujets que l'esprit de Christophe s'était tracés, et de ces forces sauvages qui avaient un tout autre sens, que lui-même ignorait.
Il allait à tâtons, tête baissée, emporté par les forces contradictoires qui s'entrechoquaient en lui, et jetant au hasard dans des œuvres incohérentes une vie fumeuse et puissante, qu'il ne savait pas exprimer, mais qui le pénétrait d'une joie orgueilleuse.
La conscience de sa vigueur nouvelle fit qu'il osa regarder en face pour la première fois tout ce qui l'entourait, tout ce qu'on lui avait appris à honorer, tout ce qu'il respectait sans l'avoir discuté;—et il le jugea aussitôt avec une liberté insolente. Le voile se déchira: il vit le mensonge allemand.
Toute race, tout art a son hypocrisie. Le monde se nourrit d'un peu de vérité et de beaucoup de mensonge. L'esprit humain est débile; il s'accommode mal de la vérité pure; il faut que sa religion, sa morale, sa politique, ses poètes, ses artistes, la lui présentent enveloppée de mensonges. Ces mensonges s'accommodent à l'esprit de chaque race; ils varient de l'une à l'autre: ce sont eux qui rendent si difficile aux peuples de se comprendre, et qui leur rendent si facile de se mépriser mutuellement. La vérité est la même chez tous; mais chaque peuple a son mensonge, qu'il nomme son idéalisme; tout être l'y respire, de sa naissance à sa mort: c'est devenu pour lui une condition de vie; il n'y a que quelques génies qui peuvent s'en dégager, à la suite de crises héroïques, où ils se trouvent seuls, dans le libre univers de leur pensée.
Une occasion insignifiante révéla brusquement à Christophe le mensonge de l'art allemand. S'il ne l'avait point vu jusque-là, ce n'était pas faute de l'avoir toujours eu sous les yeux; mais il en était trop près, il manquait de recul. Maintenant, la montagne lui apparaissait, parce qu'il s'en était éloigné.
Il était à un concert de la Städtische Tonhalle. Le concert avait lieu dans une vaste halle, occupée par dix ou douze rangées de tables de café, — environ deux ou trois cents. Au fond, la scène, où se tenait l'orchestre. Autour de Christophe, des officiers sanglés dans leurs longues redingotes sombres,—larges faces rasées, rouges, sérieuses et bourgeoises; des dames qui causaient et riaient avec fracas, étalant un naturel exagéré; de braves petites filles, qui souriaient en montrant toutes leurs dents; et de gros hommes enfoncés dans leurs barbes et leurs lunettes, qui ressemblaient à de bonnes araignées aux yeux ronds. Ils se soulevaient à chaque verre pour porter une santé; ils mettaient à cet acte un respect religieux; leur visage et leur ton changeaient à ce moment: ils semblaient dire la messe, ils s'offraient des libations, ils buvaient le calice, avec un mélange de solennité et de bouffonnerie. La musique se perdait au milieu des conversations et des bruits de vaisselle. Cependant, tout le monde s'efforçait à parler et à manger bas. Le Herr Konzertmeister, grand vieux homme voûté, avec une barbe blanche qui lui pendait comme une queue au menton, et un long nez recourbé, muni de lunettes, avait l'air d'un philologue.—Tous ces types étaient depuis longtemps familiers à Christophe. Mais il avail une tendance, ce jour-là, aies voir en caricatures. Il y a comme cela des jours où, sans raison apparente, le grotesque des êtres, qui, dans la vie ordinaire, passe inaperçu, nous saute aux yeux.
Le programme d'orchestre comprenait l'ouverture d'Egmont, une valse de Waldteufel, le Pèlerinage de Tannhäuser à Rome, l'ouverture des Joyeuses Commères de Nicolaï, la marche religieuse d'Athalie, et une fantaisie sur l'Étoile du Nord. L'orchestre joua avec correction l'ouverture de Beethoven, et la valse avec furie. Pendant le Pèlerinage de Tannhäuser, on entendait déboucher des bouteilles. Un gros homme, assis à la table voisine de Christophe, marquait la mesure des Joyeuses Commères, en mimant Falstaff. Une dame âgée et corpulente, en robe bleu de ciel, avec une ceinture blanche, un pince-nez en or sur son nez écrasé, des bras rouges, et une vaste taille, chanta d'une voix puissante des Lieder de Schumann et de Brahms. Elle levait les sourcils, faisait les yeux en coulisse, battait des paupières, hochait la tête à droite, à gauche, souriait d'un large sourire figé dans sa face de lune, dépensait une mimique exagérée et qui eût risqué par moments d'évoquer le café-concert, sans la majestueuse honnêteté qui resplendissait en elle; cette mère de famille jouait la petite folle, la jeunesse, la passion; et la poésie de Schumann prenait vaguement ainsi une odeur fade de nursery. Le public était dans l'extase.—Mais l'attention devint solennelle, quand parut la Société chorale «des hommes allemands du Sud» (Suddeutschen Männer Liedertafel), qui tour à tour susurrèrent et mugirent des morceaux d'orphéons, pleins de sensibilité. Ils étaient quarante qui chantaient comme quatre; on eût dit qu'ils se fussent appliqués à effacer de leur exécution toute trace de style proprement choral: c'était une recherche de petits effets mélodiques, de petites nuances timides et pleurardes, de pianissimo expirants, avec de brusques sursauts tonitruants, comme des coups de grosse caisse; un manque de plénitude et d'équilibre, un style doucereux; on pensait à Bottom:
«Laissez-moi faire le lion. Je rugirai aussi doucement qu'une colombe à la becquée. Je rugirai à faire croire que c'est un rossignol.»
Christophe écoutait, depuis le commencement, avec une stupeur croissante. Rien de tout cela n'était nouveau pour lui. Il connaissait ces concerts, cet orchestre, ce public. Mais tout lui paraissait faux, brusquement. Tout: jusqu'à ce qu'il aimait le mieux, cette ouverture d'Egmont, dont le désordre pompeux et la correcte agitation le blessait, en cet instant, comme un manque de franchise. Sans doute, ce n'était pas Beethoven ni Schumann qu'il entendait, c'étaient leurs ridicules interprètes, c'était leur public ruminant, dont l'épaisse sottise se répandait autour des œuvres, comme une lourde buée.—N'importe, il y avait dans les œuvres, même dans les plus belles, quelque chose d'inquiétant que Christophe n'y avait encore jamais senti... Quoi donc? Il n'osait l'analyser, estimant sacrilège de discuter ses maîtres bien-aimés. Mais il avait beau ne pas vouloir voir: il avait vu. Et, malgré lui, il continuait de voir; comme la Vergognosa de Pise, il regardait entre ses doigts.
Il voyait l'art allemand tout nu. Tous,—les grands et les sots,—étalaient leurs âmes avec une complaisance attendrie. L'émotion débordait, la noblesse morale ruisselait, le cœur se fondait en effusions éperdues; les écluses étaient lâchées à la redoutable sensibilité germanique; elle diluait l'énergie des plus forts, elle noyait les faibles sous ses nappes grisâtres: c'était une inondation; la pensée allemande dormait au fond. Et quelle pensée, parfois, que celle d'un Mendelssohn, d'un Brahms, d'un Schumann, et, à leur suite, de cette légion de petits auteurs de Lieder emphatiques et pleurnicheurs! Tout en sable. Point de roc. Une glaise humide et informe... Tout cela était si niais et si enfantin que Christophe ne pouvait croire que le public n'en fût pas frappé. Il regardait autour de lui; mais il ne vit que des figures béates, convaincues à l'avance de la beauté de ce qu'ils entendaient et du plaisir qu'ils devaient y prendre. Comment se fussent-ils permis de juger par eux-mêmes? Ils étaient pleins de respect pour ces noms consacrés. Que ne respectaient-ils point? Ils étaient respectueux devant leur programme, devant leur verre à boire, devant eux-mêmes. On sentait que, mentalement, ils donnaient de «l'Excellence» à tout ce qui, de près ou de loin, se rapportait à eux.
Christophe considérait alternativement le public et les œuvres: les œuvres reflétaient le public, le public reflétait les œuvres, comme une boule de jardin. Christophe sentait le rire le gagner, et il faisait des grimaces. Il se contenait pourtant. Mais quand «les hommes du Sud» vinrent chanter avec solennité l'Aveu rougissant d'une jeune fille amoureuse, Christophe n'y tint plus. Il éclata de rire. Des «chut!» indignés s'élevèrent. Ses voisins le regardèrent avec effarement; ces bonnes figures scandalisées le mirent en joie: il rit de plus belle, il rit, il pleurait de rire. Pour le coup, on se fâcha. On cria: «À la porte!» Il se leva, et partit, en haussant les épaules, le dos secoué par un accès de fou rire. Cette sortie fit scandale. Ce fut le début des hostilités entre Christophe et sa ville.
À la suite de cette épreuve, Christophe, rentré chez lui, s'avisa de relire les œuvres des musiciens «consacrés». Il fut consterné, en s'apercevant que certains des maîtres qu'il aimait le mieux avaient menti. Il s'efforça d'en douter, de croire qu'il se trompait.—Mais non, il n'y avait pas moyen... Il était saisi de la somme de médiocrité et de mensonge qui constitue le trésor artistique d'un grand peuple. Combien peu de pages résistaient à l'examen!
Dès lors, ce ne fut plus qu'avec un battement de cœur qu'il aborda la lecture d'autres œuvres, qui lui étaient chères... Hélas! Il était comme ensorcelé: partout, la même déconvenue! À l'égard de certains maîtres, ce fut un déchirement de cœur; c'était comme s'il perdait un ami bien-aimé, comme s'il s'apercevait soudain que cet ami, en qui il avait mis sa confiance, le trompait depuis des années. Il en pleurait. La nuit, il ne dormait plus; il continuait de se tourmenter. Il s'accusait lui-même: est-ce qu'il ne savait plus juger? Est-ce qu'il était devenu tout à fait idiot?... Non, non, plus que jamais, il voyait la beauté rayonnante du jour, il sentait l'abondance généreuse de la vie: son cœur ne le trompait point...
Longtemps encore, il n'osa pas toucher à ceux qui étaient pour lui les meilleurs, les plus purs, le Saint des Saints. Il tremblait de porter atteinte à la foi qu'il avait en eux. Mais comment résister à l'impitoyable instinct d'une âme véridique, qui veut aller jusqu'au bout et voir les choses comme elles sont, quoi qu'on doive en souffrir?—Il ouvrit donc les œuvres sacrées, il fit donner la dernière réserve, la garde impériale... Dès les premiers regards, il vit qu'elles n'étaient pas plus immaculées que les autres. Il n'eut pas le courage de continuer. À certains moments, il s'arrêtait, il fermait le livre; comme le fils de Noé, il jetait le manteau sur la nudité de son père...
Après, il restait abattu, au milieu de ces ruines. Il eût mieux aimé perdre un bras que ses saintes illusions. Son cœur était en deuil. Mais une telle sève était en lui que sa confiance dans l'art n'en fut pas ébranlée. Avec la présomption naïve du jeune homme, il recommençait la vie, comme si personne ne l'avait vécue avant lui. Dans la griserie de sa force neuve, il sentait—non sans raison, peut-être—qu'à peu d'exceptions près, il n'y a aucun rapport entre les passions vivantes et l'expression que l'art en a donnée. Mais il se trompait en pensant que lui-même était plus heureux ou plus vrai, quand il les exprimait. Comme il était plein de ses passions, il lui était aisé de les retrouver au travers de ce qu'il écrivait; mais personne autre que lui ne les eût reconnues, sous le vocabulaire imparfait dont il les désignait. Beaucoup des artistes qu'il condamnait, étaient dans le même cas. Ils avaient eu et traduit des sentiments profonds; mais le secret de leur langue était mort avec eux.
Christophe n'était pas psychologue, il ne s'embarrassait pas de toutes ces raisons: ce qui était mort pour lui l'avait toujours été. Il révisait ses jugements sur le passé avec l'injustice féroce et assurée de la jeunesse. Il mettait à nu les plus nobles âmes, sans pitié pour leurs ridicules. C'était la mélancolie cossue, la fantaisie distinguée, le néant bien pensant de Mendelssohn. C'était la verroterie et le clinquant de Weber, sa sécheresse de cœur, son émotion cérébrale. C'était Liszt, père noble, écuyer de cirque, néo classique et forain, mélange à doses égales de noblesse réelle et de noblesse fausse, d'idéalisme serein et de virtuosité dégoûtante. C'était Schubert, englouti sous sa sensibilité, comme sous des kilomètres d'eau transparente et fade. Les vieux des âges héroïques, les demi-dieux, les Prophètes, les Pères de l'Église, n'étaient pas épargnés. Même le grand Sébastien, l'homme trois fois séculaire, qui portait en lui le passé et l'avenir,—Bach,—n'était pas pur de tout mensonge, de toute niaiserie de la mode, de tout bavardage d'école. Cet homme qui avait vu Dieu semblait parfois à Christophe d'une religion insipide et sucrée, style jésuite, rococo. On trouvait dans ses Cantates des airs de langueur amoureuse et dévote—(des dialogues de l'Ame qui coquette avec Jésus).—Christophe en était écœuré: il croyait voir des chérubins joufflus, faisant des ronds de jambe. Puis, il avait le sentiment que le génial Cantor écrivait dans sa chambre close: cela sentait le renfermé; il n'y avait pas dans sa musique cet air fort du dehors qui souffle chez d'autres, moins grands musiciens peut-être, mais plus grands hommes,—plus hommes—tels Beethoven, ou Hændel. Ce qui le blessait aussi chez les classiques, c'était leur manque de liberté: presque tout dans leurs œuvres était «construit». Tantôt une émotion était amplifiée par tous les lieux communs de la rhétorique musicale, tantôt c'était un simple rythme, un dessin ornemental, répété, retourné, combiné en tous sens, d'une façon mécanique. Ces constructions symétriques et rabâcheuses—sonates et symphonies—exaspéraient Christophe, peu sensible, en ce moment, à la beauté de l'ordre, des plans vastes et bien conçus. Elles lui semblaient l'œuvre de maçons plutôt que de musiciens.
Il ne faudrait pas croire qu'il en fût moins sévère pour les romantiques. Chose curieuse, il n'y avait pas de musiciens qui l'irritassent davantage que ceux qui avaient prétendu être le plus libres, le plus spontanés, le moins constructeurs,—ceux qui, comme Schumann, avaient versé, goutte à goutte, dans leurs innombrables petites œuvres, leur vie tout entière. Il s'acharnait contre eux avec d'autant plus de colère qu'il reconnaissait en eux son âme adolescente et toutes les niaiseries qu'il s'était juré d'en arracher. Certes, le candide Schumann ne pouvait être taxé de fausseté: il ne disait presque jamais rien qu'il n'eût vraiment senti. Mais, justement, son exemple amenait Christophe à comprendre que la pire fausseté de l'art allemand n'était pas quand ses artistes voulaient exprimer des sentiments qu'ils ne sentaient point, mais bien plutôt quand ils voulaient exprimer des sentiments qu'ils sentaient—et qui étaient faux. La musique est un miroir implacable de l'âme. Plus un musicien allemand est naïf et de bonne foi, plus il montre les faiblesses de l'âme allemande, son fond incertain, sa sensibilité molle, son manque de franchise, son idéalisme un peu sournois, son incapacité à se voir soi-même, à oser se voir en face. Ce faux idéalisme était la plaie, même des plus grands,—de Wagner. En relisant ses œuvres, Christophe grinçait des dents. Lohengrin lui paraissait d'un mensonge à hurler. Il haïssait cette chevalerie de pacotille, cette bondieuserie hypocrite, ce héros sans peur et sans cœur, incarnation d'une vertu égoïste et froide qui s'admire et qui s'aime avec prédilection. Il le connaissait trop, il l'avait vu dans la réalité, ce type de pharisien allemand, bellâtre, impeccable et dur, en adoration devant sa propre image, à la divinité de laquelle il n'a point de peine à sacrifier les autres. Le Hollandais Volant l'accablait de sa sentimentalité massive et de son morne ennui. Les barbares décadents de la Tétralogie étaient, en amour, d'une fadeur écœurante. Siegmund, enlevant sa sœur, ténorisait une romance de salon. Siegfried et Brünnhilde, en bons mariés allemands, dans la Gœtterdæmmerung, étalaient aux yeux l'un de l'autre, et surtout du public, leur passion conjugale, pompeuse et bavarde. Tous les genres de mensonge s'étaient donné rendez-vous dans ces œuvres: faux idéalisme, faux christianisme, faux gothisme, faux légendaire, faux divin, faux humain. Jamais convention plus énorme ne s'était affichée que dans ce théâtre qui prétendait renverser toutes les conventions. Ni les yeux, ni l'esprit, ni le cœur n'en pouvaient être dupes, un instant; pour qu'ils le fussent, il fallait qu'ils voulussent l'être.—Ils le voulaient. L'Allemagne se délectait de cet art vieillot et enfantin, art de brutes déchaînées et de petites filles mystiques et gnangnan.
Et Christophe avait beau faire: dès qu'il entendait cette musique, il était repris, comme les autres, plus que les autres, par le torrent et par la volonté diabolique de l'homme qui l'avait déchaîné. Il riait et il tremblait, et il avait les joues allumées; il sentait passer en lui des chevauchées d'armées; et il pensait que tout était permis à ceux qui portaient ces ouragans. Quels cris de joie il poussait lorsque, dans les œuvres sacrées qu'il ne feuilletait plus qu'en tremblant, il retrouvait son émotion d'autrefois, toujours aussi ardente, sans que rien vînt ternir la pureté de ce qu'il aimait! C'étaient de glorieuses épaves qu'il sauvait du naufrage. Quel bonheur! Il lui semblait qu'il sauvait une partie de lui-même. Et n'était-ce point lui? Ces grands Allemands, contre lesquels il s'acharnait, n'étaient-ils pas son sang, sa chair, son être le plus précieux? Il n'était si sévère pour eux que parce qu'il l'était pour lui. Qui les aimait mieux que lui? Qui sentait plus que lui la bonté de Schubert, l'innocence de Haydn, la tendresse de Mozart, le grand cœur héroïque de Beethoven? Qui s'était réfugié plus religieusement dans le bruissement des forêts de Weber, et dans les grandes ombres des cathédrales de Jean-Sébastien, dressant sur le ciel gris du Nord, au-dessus de la plaine allemande, leur montagne de pierre et leurs tours gigantesques aux flèches ajourées?—Mais il souffrait de leurs mensonges, et il ne pouvait les oublier. Il les attribuait à la race, et leur grandeur à eux-mêmes. Il avait tort. Grandeur et faiblesses appartiennent également à la race dont la pensée puissante et trouble roule comme le plus large fleuve de musique et de poésie, où l'Europe vienne boire... Et chez quel autre peuple eût-il trouvé la pureté naïve, qui lui permettait en ce moment de le condamner si durement?
Il ne s'en doutait point. Avec l'ingratitude d'un enfant gâté, il retournait contre sa mère les armes qu'il en avait reçues. Plus tard, plus tard, il devait sentir tout ce qu'il lui devait, et combien elle lui était chère...
Mais il était dans une période de réaction aveugle contre les idoles de son enfance. Il s'en voulait et il leur en voulait d'avoir cru en elles avec un abandon passionné.—Et il était bien qu'il en fût ainsi. Il y a un âge de la vie, où il faut oser être injuste, où il faut oser faire table rase de toutes les admirations et de tous les respects appris, et tout nier—mensonges et vérités—tout ce que l'on n'a pas reconnu vrai par soi-même. Par toute son éducation, par tout ce qu'il voit et entend autour de lui, l'enfant absorbe une telle somme de mensonges et de sottises mélangées aux vérités essentielles de la vie que le premier devoir de l'adolescent qui veut être un homme sain est de tout dégorger.
Christophe passait par cette crise de robuste dégoût. Son instinct le poussait à éliminer de son être les éléments indigestes qui l'encombraient.
Avant tout, cette écœurante sensibilité, qui dégouttait de l'âme allemande comme d'un souterrain humide et sentant le moisi. De la lumière! De la lumière! Un air rude et sec, qui balayât les miasmes du marais, les fades relents de ces Lieder, de ces Liedchen, de ces Liedlein, aussi nombreux que les gouttes de pluie, où se déverse intarissablement le Gemüt germanique: ces innombrables Sehnsucht (Désir), Heimweh (Nostalgie), Aufschwung (Essor), Frage (Demande), Warum? (Pourquoi?), an den Mond (À la lune), an die Sterne (Aux étoiles), an die Nachtigall (Au rossignol), an den Frühling (Au printemps), an den Sonnenschein (À la clarté du soleil); ces Frühlingslied (Chant du printemps), Frühlingslust (Plaisir du printemps), Frühlingsgruss (Salut du printemps), Frühlingsfahrt (Voyage de printemps), Frühlingsnacht (Nuit de printemps), Frühlingsbotschaft (Message de printemps); ces Stimme der Liebe (Voix de l'amour), Sprache der Liebe (Parole de l'amour), Trauer der Liebe (Tristesse de l'amour), Geist der Liebe (Esprit de l'amour), Fülle der Liebe (Plénitude de l'amour); ces Blumenlied (Chant des fleurs), Blumenbrief (Lettre des fleurs), Blumengruss (Salut des fleurs); ces Herzeleid (Peine de cœur), mein Herz ist schwer (Mon cœur est lourd), mein Herz ist betrübt (Mon cœur est trouble), mein Aug ist trüb (Mon œil est trouble); ces dialogues candides et nigauds avec la Röselein (petite rose), avec le ruisseau, avec la tourterelle, avec l'hirondelle; ces questions saugrenues:—«Si l'églantier devrait être sans épines»,—«Si c'est avec un vieil époux que l'hirondelle a fait son nid, ou si elle vient de se fiancer depuis un peu de temps»:—tout ce déluge de tendresse fade, d'émotion fade, de mélancolie fade, de poésie fade... Que de belles choses profanées, de hauts sentiments, usés à tout propos, et sans propos! Car le pire était l'inutilité de tout cela: c'était une habitude de déshabiller son cœur en public, une propension affectueuse et niaise à se confier bruyamment. Rien à dire, et toujours parler! Ce bavardage ne finirait-il jamais?—Holà! Silence aux grenouilles du marais!
Nulle part Christophe ne sentait plus crûment le mensonge que dans l'expression de l'amour: car il était ici plus à même de le comparer avec la vérité. Cette convention des chants d'amour, larmoyants et corrects, ne répondait à rien ni des désirs de l'homme, ni du cœur féminin. Cependant, les gens qui avaient écrit cela avaient dû aimer, au moins une fois dans leur vie! Était-il possible qu'ils eussent aimé ainsi? Non, non, ils avaient menti, menti comme toujours, ils s'étaient menti à eux-mêmes; ils avaient voulu s'idéaliser... Idéaliser! c'est-à-dire: avoir peur de regarder la vie en face, être incapable de voir les choses, comme elles sont.—Partout, la même timidité, le manque de franchise virile. Partout, le même enthousiasme à froid, la solennité pompeuse et théâtrale, dans le patriotisme, dans la boisson, dans la religion. Les Trinklieder (chants à boire) étaient des prosopopées au vin ou à la coupe: «Du herrlich Glas...» («Toi, noble verre...»). La foi, qui devrait jaillir de l'âme comme un flot imprévu, était un article de fabrique, une denrée. Les chants patriotiques semblaient faits pour des troupeaux de moutons, bêlant en mesure...—Hurlez donc!... Quoi! Est-ce que vous continuerez à mentir—à «idéaliser»—jusque dans la soûlerie, jusque dans la tuerie, jusque dans la folie!...
Christophe en était arrivé à prendre en haine l'idéalisme. Il préférait à ce mensonge la brutalité franche.—Au fond, il était plus idéaliste que les autres, et il ne devait pas avoir de pires ennemis que ces réalistes brutaux, qu'il croyait préférer.
Sa passion l'aveuglait. Il se sentait glacé parle brouillard, le mensonge anémique, «les Idées-fantômes sans soleil». De toutes les forces de son être, il aspirait au soleil. Dans son mépris juvénile pour l'hypocrisie qui l'entourait, ou pour ce qu'il nommait tel, il ne voyait pas la haute sagesse pratique de la race, qui s'était bâti peu à peu son grandiose idéalisme, pour dompter ses instincts sauvages, ou pour en tirer parti. Ce ne sont pas des raisons arbitraires, des règles morales et religieuses, ce ne sont pas des législateurs et des hommes d'État, des prêtres et des philosophes, qui transforment les âmes des races et leur imposent une nouvelle nature: c'est l'œuvre des siècles de malheurs et d'épreuves: ils forgent pour la vie les peuples qui veulent vivre.
Cependant, Christophe composait; et ses compositions n'étaient pas exemptes des défauts qu'il reprochait aux autres. Car la création était chez lui un besoin irrésistible, qui ne se soumettait pas aux règles que son intelligence édictait. On ne crée pas par raison. On crée par nécessité.—Puis, il ne suffit pas d'avoir reconnu le mensonge et l'emphase inhérents à la plupart des sentiments, pour n'y plus retomber: il y faut de longs et pénibles efforts; rien de plus difficile que d'être tout à fait vrai dans la société moderne, avec l'héritage écrasant d'habitudes paresseuses transmis par les générations. Cela est surtout malaisé aux gens, ou aux peuples, qui ont la manie indiscrète de laisser parler leur cœur sans repos, quand il n'aurait rien de mieux à faire, le plus souvent, que de se taire.
Le cœur de Christophe était bien allemand, en cela: il n'avait pas encore appris la vertu de se taire; d'ailleurs, elle n'était pas de son âge. Il tenait de son père le besoin de parler, et de parler bruyamment. Il en avait conscience, et il luttait contre; mais cette lutte paralysait une partie de ses forces.—Il en soutenait une autre contre l'hérédité non moins fâcheuse qu'il tenait de son grand-père: une difficulté extrême à s'exprimer exactement.—Il était fils de virtuose. Il sentait le dangereux attrait de la virtuosité:—plaisir physique, plaisir d'adresse, d'agilité, d'activité musculaire, plaisir de vaincre, d'éblouir, de subjuguer par sa personne le public aux mille têtes; plaisir bien excusable, presque innocent chez un jeune homme, mais néanmoins mortel pour l'art et pour l'âme:—Christophe le connaissait: il l'avait dans le sang; il le méprisait, mais tout de même il y cédait.
Ainsi, tiraillé entre les instincts de sa race et ceux de son génie, alourdi par le fardeau d'un passé parasite qui s'incrustait à lui et dont il ne parvenait pas à se défaire, il avançait en trébuchant, et il était beaucoup plus près qu'il ne pensait de ce qu'il proscrivait. Toutes ses œuvres d'alors étaient un mélange de vérité et de boursouflure, de vigueur lucide et de bêtise bredouillante. Ce n'était que par instants que sa personnalité arrivait à percer l'enveloppe de ces personnalités mortes qui ligotaient ses mouvements.
Il était seul. Il n'avait aucun guide qui l'aidât à sortir du bourbier. Quand il se croyait dehors, il s'y enfonçait de plus belle. Il allait à l'aveuglette, gaspillant son temps et ses forces en essais malheureux. Nulle expérience ne lui était épargnée; et, dans le désordre de cette agitation créatrice, il ne se rendait pas compte de ce qui valait le mieux parmi ce qu'il créait. Il s'empêtrait dans des projets absurdes, des poèmes symphoniques, qui avaient des prétentions philosophiques et des dimensions monstrueuses. Son esprit était trop sincère pour pouvoir s'y lier longtemps; et il les abandonnait avec dégoût, avant d'en avoir esquissé une seule partie. Ou bien, il prétendait traduire dans des ouvertures les œuvres de poésie les plus inaccessibles. Alors il pataugeait dans un domaine qui n'était pas le sien. Quand il se traçait lui-même ses scénarios,—(car il ne doutait de rien),—c'étaient de pures âneries; et quand il s'attaquait aux grandes œuvres de Gœthe, de Kleist, de Hebbel, ou de Shakespeare, il les comprenait tout de travers. Non par manque d'intelligence, mais d'esprit critique; il ne savait pas comprendre les autres, il était trop préoccupé de lui-même: il se retrouvait partout, avec son âme naïve et boursouflée.
À côté de ces monstres qui n'étaient point faits pour vivre, il écrivait une quantité de petites œuvres, qui étaient l'expression immédiate d'émotions passagères,—les plus éternelles de toutes: des pensées musicales, des Lieder. Ici, comme ailleurs, il était en réaction passionnée contre les habitudes courantes. Il reprenait les poésies célèbres, déjà traitées en musique, et il avait l'impertinence de vouloir faire autrement et plus vrai que Schumann et Schubert. Tantôt il tâchait de rendre aux figures poétiques de Gœthe: à Mignon, au Harpiste de Wilhelm Meister, leur caractère individuel, précis et trouble. Tantôt il s'attaquait à des Lieder amoureux, que la faiblesse des artistes et la fadeur du public, tacitement d'accord, s'étaient habituées à revêtir de sentimentalité doucereuse; et il les déshabillait: il leur soufflait une âpreté fauve et sensuelle. En un mot, il prétendait faire vivre des passions et des êtres pour eux-mêmes, et non pour servir de jouets à des familles allemandes en quête d'attendrissements faciles, le dimanche, attablées à quelque Biergarten.
Mais d'ordinaire, il trouvait les poètes, trop littéraires; et il cherchait de préférence les textes les plus simples: de vieux Lieder, de vieilles chansons spirituelles, qu'il avait lues dans un manuel d'édification: il se gardait bien de leur conserver leur caractère de choral: il les traitait de façon audacieusement laïque et vivante. Ou bien c'étaient des proverbes, parfois même des mots entendus en passant, des bribes de dialogues populaires, des réflexions d'enfants:—des paroles gauches et prosaïques, où transparaissait le sentiment tout pur. Là il était à l'aise, et il atteignait à une profondeur, dont il ne se doutait pas.
Bonnes ou mauvaises, le plus souvent mauvaises, l'ensemble de ces œuvres débordaient de vie. Tout n'en était pas neuf: tant s'en fallait. Christophe était maintes fois banal, par sincérité même; il lui arrivait de répéter des formes déjà employées, parce qu'elles rendaient exactement sa pensée, parce qu'il sentait ainsi, et non pas autrement. Pour rien au monde, il n'eût cherché à être original: il lui semblait qu'il fallait être bien médiocre pour s'embarrasser d'un pareil souci. Il cherchait à dire ce qu'il sentait, sans se préoccuper si cela avait été, ou non, dit avant lui. Il avait l'orgueil de croire que c'était encore la meilleure façon d'être original, et que Jean-Christophe n'avait été et ne serait jamais qu'une fois. Avec la magnifique impudence de la jeunesse, rien ne lui semblait fait encore; et tout lui semblait à faire—ou à refaire. Le sentiment de cette plénitude intérieure, d'une vie illimitée, le jetait dans un état de bonheur exubérant et indiscret. Jubilation de tous les instants. Elle n'avait pas besoin de la joie, elle pouvait s'accommoder de la tristesse: sa source était dans sa force, mère de tout bonheur et de toute vertu. Vivre, vivre trop!... Qui ne sent point en lui cette ivresse delà force, cette jubilation de vivre,—fût-ce au fond du malheur,—n'est pas un artiste. C'est la pierre de touche. La vraie grandeur se reconnaît au pouvoir de jubiler, dans la joie et la peine. Un Mendelssohn ou un Brahms, dieux des brouillards d'octobre et de la petite pluie, n'ont jamais connu ce pouvoir divin.
Christophe le possédait; et il faisait montre de sa joie, avec une naïveté imprudente. Il n'y voyait point malice, il ne demandait qu'à la partager avec les autres. Il ne s'apercevait pas que cette joie est blessante pour la plupart des gens, qui ne la possèdent pas. Au reste, il ne s'inquiétait point de plaire ou de déplaire; il était sûr de lui, et rien ne lui paraissait plus simple que de communiquer aux autres sa conviction. Il comparait ses richesses à la pauvreté générale des fabricants de notes; et il pensait qu'il lui serait bien facile de faire reconnaître sa supériorité. Trop facile. Il n'avait qu'à se montrer.
Il se montra.
On l'attendait.
Christophe n'avait pas fait mystère de ses sentiments. Depuis qu'il avait pris conscience du pharisaïsme allemand qui ne veut pas voir les choses comme elles sont, il s'était fait une loi de manifester une sincérité absolue, incessante, intransigeante, sans égards à aucune considération d'œuvre ou de personne. Et comme il ne pouvait rien faire sans le pousser à l'extrême, il disait des énormités, et scandalisait les gens. Il était d'une prodigieuse naïveté. Il confiait à tout venant ce qu'il pensait de l'art allemand, avec la satisfaction d'un homme qui ne veut pas garder pour lui des découvertes inappréciables. Il n'imaginait pas qu'on pût lui en savoir mauvais gré. Quand il venait de reconnaître l'ânerie d'une œuvre consacrée, tout plein de son sujet, il se hâtait d'en faire part à ceux qu'il rencontrait: musiciens, ou amateurs. Il énonçait les jugements les plus saugrenus, avec une figure rayonnante. D'abord, on ne le prit pas au sérieux; on rit de ses boutades. Mais on ne tarda pas à trouver qu'il y revenait trop souvent, avec une insistance de mauvais goût. Il devint évident que Christophe croyait à ses paradoxes; ils parurent moins plaisants. Il était compromettant; il manifestait en plein concert sa bruyante ironie, ou il exprimait son dédain pour les maîtres glorieux.
Tout se colportait dans la petite ville: aucun mot de Christophe n'était perdu. On lui en voulait déjà de sa conduite de l'an passé. On n'avait pas oublié la façon scandaleuse dont il s'était affiché avec Ada. Lui-même ne s'en souvenait plus; les jours effaçaient les jours, il était loin maintenant de ce qu'il avait été. Mais d'autres s'en souvenaient pour lui: ceux dont la fonction sociale, dans toutes les petites villes, est de prendre scrupuleusement note de toutes les fautes, de toutes les tares, de tous les événements tristes, laids, désobligeants, qui concernent leurs voisins, afin que rien n'en soit perdu. Les nouvelles extravagances de Christophe vinrent trouver place a côté des anciennes, dans le registre à son nom. Les unes éclairaient les autres. Aux ressentiments de la morale offensée s'ajoutèrent ceux du bon goût scandalisé. Les plus indulgents disaient de lui:
—Il cherche à se singulariser.
La plupart affirmaient:
—Total verrückt! (Absolument fou.)
Une opinion plus dangereuse encore commençait à se répandre;—son illustre origine en assurait le succès:—on se contait qu'au château, où Christophe continuait de remplir ses fonctions officielles, il avait eu le mauvais goût, parlant au grand-duc en personne, de s'exprimer avec une indécence révoltante sur le compte de maîtres vénérés; il avait, disait-on, appelé l'Elias de Mendelssohn «des patenôtres de clergyman hypocrite», et traité certains Lieder de Schumann de «musique de Backfisch»:—et cela, quand les augustes princes venaient d'affirmer leurs préférences pour ces œuvres! Le grand-duc avait mis fin à ces impertinences, en disant sèchement:
—On douterait parfois, Monsieur, à vous entendre, que vous soyez Allemand.
Ce mot vengeur, tombé de si haut, ne manqua point de rouler très bas; et tous ceux qui croyaient avoir des sujets de ressentiment contre Christophe, soit à cause de ses succès, soit pour quelque autre raison plus personnelle, ne manquèrent point de rappeler qu'en effet il n'était pas un pur Allemand. Sa famille paternelle était—on s'en souvient—originaire des Flandres. Rien de surprenant à ce que cet immigré dénigrât les gloires nationales! Cette constatation expliquait tout; et l'amour-propre germanique y trouvait des raisons de s'estimer davantage, en même temps que de mépriser son adversaire.
À cette vengeance, toute platonique, Christophe vint fournir des aliments plus substantiels. Il est bien imprudent de critiquer les autres, quand on est sur le point de s'exposer à la critique. Un artiste plus habile eût montré plus de respect pour ses devanciers. Mais Christophe ne voyait aucune raison pour cacher son mépris de la médiocrité et son bonheur de sa propre force. Ce bonheur se manifestait d'une façon immodérée. Christophe était pris, dans ces derniers temps, d'un besoin d'expansion. C'était trop de joie pour lui seul; il eût éclaté, s'il n'avait partagé son allégresse. À défaut d'ami, il prit pour confident son collègue à l'orchestre, le deuxième Kapellmeister, Siegmund Ochs, un jeune Wurtembergeois, bon enfant et sournois, qui lui témoignait une déférence débordante. Il ne se défiait pas de lui; comment aurait-il pu penser qu'il y avait quelque inconvénient à confier sa joie à un indifférent, à un ennemi même? Ne devaient-ils pas plutôt lui en être reconnaissants? Il apportait du bonheur pour tous, amis et ennemis.—Il ne se doutait pas qu'il n'y a rien de plus difficile à faire accepter aux hommes qu'un bonheur nouveau; ils préféreraient presque un malheur ancien: il leur faut un aliment remâché depuis des siècles. Mais ce qui leur est surtout intolérable, c'est la pensée de devoir ce bonheur à un autre. Ils ne pardonnent cette offense que quand ils n'ont plus aucun moyen d'y échapper; et ils s'arrangent, pour le faire payer.
Il y avait donc mille raisons pour que les confidences de Christophe ne fussent pas accueillies de très bon cœur par qui que ce fût. Mais il y en avait mille et une pour qu'elles ne le fussent pas par Siegmund Ochs. Le premier Kapellmeister, Tobias Pfeiffer, ne devait plus tarder à se retirer; et Christophe, malgré sa jeunesse, avait toutes chances de lui succéder. Ochs était trop bon Allemand pour ne pas reconnaître que Christophe méritait cette place, puisque la cour était pour lui. Mais il avait trop bonne opinion de lui-même pour ne pas croire qu'il l'eût méritée davantage, si la cour l'eût mieux connu. Aussi accueillait-il d'un singulier sourire les effusions de Christophe, quand celui-ci arrivait au théâtre, le matin, avec une figure qui s'efforçait d'être grave, mais qui rayonnait malgré lui.
—Eh bien, lui disait-il, narquois, encore quelque nouveau chef-d'œuvre?
Christophe lui prenait le bras:
—Ah! mon ami! celui-ci surpasse tout... Si tu l'entendais!... Le diable m'emporte! c'est trop beau! Dieu assiste les pauvres gens qui l'entendront! On ne peut plus avoir qu'un désir, après: mourir.
Ces paroles ne tombaient point dans l'oreille d'un sourd. Au lieu d'en sourire, ou même de plaisanter amicalement cet enthousiasme enfantin, avec Christophe qui eût été le premier à en rire, si on lui en avait fait sentir le ridicule, Ochs s'extasiait ironiquement; il excitait Christophe à lâcher d'autres énormités; et il se hâtait, après l'avoir quitté, de les colporter partout, en les rendant plus grotesques encore. On en faisait des gorges chaudes dans le petit cercle des musiciens; et chacun attendait impatiemment l'occasion de juger les malheureuses œuvres.—Elles étaient jugées d'avance.
Enfin elles apparurent.
Christophe avait fait choix, dans le fatras de ses œuvres, d'une ouverture pour la Judith de Hebbel, dont la sauvage énergie l'avait attiré, par réaction contre l'atonie allemande (il commençait déjà à s'en dégoûter, trouvant guindé Hebbel dans son parti-pris d'avoir du génie, toujours et à tout prix). Il y avait joint une symphonie, qui portait le titre emphatique du Bœcklin de Bâle: «Le Songe de la vie», et l'épigraphe: «Vita somnium breve». Une suite de ses Lieder complétaient le programme, avec quelques œuvres classiques, et une Festmarsch de Ochs, que Christophe, par camaraderie, avait ajoutée à son concert, quoiqu'il en sentît la médiocrité.
Peu de chose avait transpiré des répétitions. Bien que l'orchestre ne comprît absolument rien aux œuvres qu'il exécutait, et que chacun, à part soi, fût interloqué par les bizarreries de cette nouvelle musique, ils n'avaient pas eu le temps de se former une opinion; surtout, ils n'étaient pas capables de le faire, avant que le public eût prononcé. L'assurance de Christophe en imposait aux artistes, dociles et disciplinés, comme tout bon orchestre allemand. Les seules difficultés lui vinrent de la chanteuse. C'était la dame en bleu du concert de la Tonhalle. Elle était une célébrité en Allemagne: cette mère de famille interprétait Brünnhilde et Kundry, à Dresde et à Bayreuth, avec une ampleur de poumons indiscutable. Mais si elle avait appris, à l'école wagnérienne, l'art dont cette école est fière à bon droit, de bien articuler, en projetant les consonnes à travers l'espace, et assénant les voyelles, comme des coups de massue, sur le public béant, elle n'y avait pas appris—et pour cause—l'art d'être naturelle. Elle faisait un sort à chaque mot: tout était accentué; les syllabes cheminaient avec des semelles de plomb, et il y avait une tragédie dans chaque phrase. Christophe la pria de modérer un peu sa puissance dramatique. Elle s'y appliqua d'abord, d'assez bonne grâce; mais sa lourdeur naturelle et le besoin de donner de la voix l'emportaient. Christophe devint nerveux. Il fit remarquer à la respectable dame qu'il avait voulu faire parler des humains, et non le serpent Fafner, avec son porte-voix. Elle prit—comme l'on pense—fort mal cette insolence. Elle dit qu'elle savait, Dieu merci! ce que c'était que chanter, qu'elle avait eu l'honneur d'interpréter les Lieder de Maître Brahms, en la présence de ce grand homme, et qu'il ne se lassait point de les lui entendre dire.
—Tant pis! Tant pis! cria Christophe.
Elle lui demanda, avec un sourire hautain, de vouloir bien lui expliquer le sens de cette exclamation énigmatique. Il répondit que Brahms n'ayant jamais su, de sa vie, ce qu'était le naturel, ses éloges étaient les pires des blâmes, et que bien que lui—Christophe—fût peu poli parfois, ainsi qu'elle l'avait fait justement remarquer, jamais il ne se fût permis de lui dire quelque chose d'aussi désobligeant.
La discussion continua sur ce ton; et la dame s'obstina à chanter à sa façon, avec un pathétique écrasant,—jusqu'au jour où Christophe déclara froidement qu'il le voyait bien: telle était sa nature, on n'y pouvait rien changer; mais puisque les Lieder ne pouvaient être chantés comme ils devaient l'être, ils ne seraient pas chantés du tout: il les retirait du programme.—On était à la veille du concert, on comptait sur ces Lieder: elle-même en avait parlé; elle était assez musicienne pour en avoir apprécié certaines qualités; Christophe lui faisait un affront; et comme elle n'était pas sûre que le concert du lendemain ne consacrerait point la renommée du jeune homme, elle ne voulut pas se brouiller avec un astre naissant. Elle plia donc soudain; et, pendant la dernière répétition, elle se soumit docilement à tout ce que Christophe exigea d'elle. Mais elle était décidée,—le lendemain, au concert,—à n'en faire qu'à sa tête.
Le jour était venu. Christophe n'avait aucune inquiétude. Il était trop plein de sa musique pour pouvoir la juger. Il se rendait compte que ses œuvres, par endroits, prêtaient au ridicule. Mais qu'importe? On ne peut rien écrire de grand sans risquer le ridicule. Pour aller au fond des choses, il faut braver le respect humain, la politesse, la pudeur, les mensonges sociaux, sous qui le cœur gît étouffé. Si l'on veut n'effaroucher personne, il faut se résigner, toute sa vie, à ne donner aux médiocres qu'une vérité médiocre, qu'ils sont capables d'assimiler; il faut demeurer en deçà de la vie. On n'est grand que quand on a mis ces scrupules sous ses pieds. Christophe marchait dessus. On pouvait bien le siffler: il était sûr de ne pas laisser indifférent. Il s'amusait de la tête que feraient des gens qu'il connaissait, en entendant telle page un peu risquée. Il s'attendait à des critiques aigres: il en souriait d'avance. En tout cas, il faudrait être sourd, pour nier qu'il y eût là une force—aimable ou non, qu'importe?... Aimable! Aimable!... La force! cela suffit. Qu'elle emporte tout, comme le Rhin!...
Il eut une première déconvenue. Le grand-duc ne vint pas. La loge princière ne fut occupée que par des comparses: quelques dames d'honneur. Christophe en ressentit une irritation. Il pensa: «Cet imbécile me boude. Il ne sait que penser de mes œuvres: il a peur de se compromettre.» Il haussa les épaules, feignant de ne passe soucier d'une pareille niaiserie. D'autres y prirent garde: c'était une première leçon donnée, et une menace pour l'avenir.
Le public ne s'était pas montré beaucoup plus empressé que le maître: un tiers de la salle était vide. Christophe ne pouvait s'empêcher de songer avec amertume aux salles combles de ses concerts d'enfant. S'il avait eu plus d'expérience, il eût trouvé naturel qu'il y eût moins de monde pour venir l'entendre, quand il faisait de bonne musique, que quand il en faisait de mauvaise: car ce n'est pas la musique, c'est le musicien qui intéresse la majeure partie du public; et il est de toute évidence qu'un musicien qui ressemble à tout le monde offre bien moins d'intérêt qu'un musicien en jupe d'enfant, qui touche la sentimentalité et amuse la badauderie.
Christophe, après avoir attendu vainement que la salle se remplît, se décida à commencer. Il tâchait de se prouver que c'était mieux, ainsi: «Peu d'amis, mais bons.»—Son optimisme ne tint pas longtemps.
Les morceaux se déroulaient au milieu du silence.—Il y a un silence du public, que l'on sent gros d'amour et prêt à déborder. Mais dans celui ci, il n'y avait rien. Rien. Sommeil complet. On sentait que chaque phrase s'enfonçait dans des gouffres d'indifférence. Christophe, le dos tourné au public, occupé de son orchestre, n'en percevait pas moins tout ce qui se passait dans la salle, avec ces antennes intérieures, dont tout vrai musicien est doué, et qui lui font savoir si ce qu'il joue trouve de l'écho au fond des cœurs qui l'entourent. Il continuait de battre la mesure et de s'exciter lui-même, glacé par le brouillard d'ennui qui montait du parterre et des loges derrière lui.
Enfin, l'ouverture finit; et la salle applaudit. Elle applaudit poliment, froidement, et se tut. Christophe eût mieux aimé qu'elle le huât... Un sifflet! Quelque chose qui fût un signe de vie, de réaction au moins contre son œuvre!...—Rien.—Il regarda le public. Le public se regardait. Ils cherchaient une opinion dans les yeux les uns des autres. Ils ne la trouvèrent pas, et retombèrent dans leur indifférence.
La musique reprit. C'était au tour de la symphonie.—Christophe eut peine à aller jusqu'au bout. Plusieurs fois, il fut sur le point de jeter son bâton et de se sauver. Cette apathie le gagnait; il finissait par ne plus comprendre ce qu'il dirigeait; il avait l'impression nette de la chute dans l'insondable ennui. Il n'y eut même point les chuchotements ironiques qu'il attendait, à certains passages: le public était plongé dans la lecture du programme. Christophe entendit les pages se tourner toutes à la fois, avec un froissement sec; et ce fut de nouveau le silence jusqu'au dernier accord, où les mêmes applaudissements polis attestèrent que l'on avait compris que l'œuvre était finie.—Cependant, trois ou quatre applaudissements isolés reprirent, quand les autres avaient cessé: mais ils n'éveillèrent aucun écho, et se turent honteux: le vide en parut plus vide, et ce petit incident servit à éclairer faiblement le public sur l'ennui qu'il avait éprouvé.
Christophe s'était assis au milieu de son orchestre, il n'osait regarder ni à droite, ni à gauche. Il avait envie de pleurer; et il frémissait de colère. Il eût voulu se lever et leur crier à tous: «Vous m'ennuyez! Ah! comme vous m'ennuyez!... Foutez-moi le camp, tous!...»
Le public se réveillait un peu: il attendait la chanteuse,—il était accoutumé à l'applaudir. Dans cet océan d'œuvres nouvelles, où il errait sans boussole, elle lui était une certitude, une terre connue et solide, où il ne risquait pas de se perdre. Christophe discerna leur pensée; et il eut un mauvais rire. La chanteuse n'eut pas moins conscience de l'attente du public: Christophe le vit à ses airs de reine, quand il vint l'avertir que c'était son tour. Ils se dévisagèrent avec hostilité. Au lieu de lui offrir le bras, Christophe enfonça ses mains dans ses poches, et la laissa entrer seule. Elle passa, furieuse. Il la suivait, d'un air ennuyé. Aussitôt qu'elle parut, la salle lui fit une ovation: c'était un soulagement; les visages s'éclairaient, le public s'animait, toutes les lorgnettes étaient en joue. Sure de son pouvoir, elle attaqua les Lieder, à sa manière, bien entendu, et sans tenir aucun compte des observations que Christophe lui avait faites la veille. Christophe, qui l'accompagnait, blêmit. Il prévoyait cette rébellion. Au premier changement qu'elle fît, il tapa sur le piano, et dit avec colère:
—Non!
Elle continua. Il lui soufflait dans le dos, d'une voix sourde et furieuse:
—Non! Non! Ce n'est pas cela!... Pas cela!...
Énervée par ces grognements furibonds, que le public ne pouvait entendre, mais dont l'orchestre ne perdait rien, elle s'obstinait, ralentissant à outrance, faisant des pauses, des points d'orgue. Lui, n'en tenait pas compte et allait de l'avant: ils finirent par avoir une mesure d'écart. Le public ne s'en apercevait pas: depuis longtemps, il avait admis que la musique de Christophe n'était pas faite pour paraître agréable ni juste; mais Christophe, qui n'était pas de cet avis, faisait des grimaces de possédé; il finit par éclater. Il s'arrêta net, au milieu d'une phrase:
—Assez! cria-t-il à pleins poumons.
Emportée par son élan, elle continua, une demi-mesure, et s'arrêta, à son tour.
—Assez! répéta-t-il sèchement.
Il y eut un moment de stupeur dans la salle. Après quelques secondes, il dit, d'un ton glacial:
—Recommençons!
Elle le regardait, stupéfaite; ses mains tremblaient; elle songea à lui jeter son cahier à la tête; elle ne comprit jamais, plus tard, comment elle ne l'avait point fait. Mais elle était écrasée par l'autorité de Christophe:—elle recommença. Elle chanta tout le cycle de Lieder, sans changer une nuance, ni un mouvement: car elle sentait qu'il ne lui ferait grâce de rien; et elle frémissait, à l'idée d'un nouvel affront.
Quand elle eut fini, le public la rappela avec frénésie. Ce n'étaient pas les Lieder qu'il applaudissait;—(elle en eût chanté d'autres qu'il eût applaudi de même)—c'était la chanteuse célèbre et vieillie sous le harnois: il savait qu'il pouvait admirer, en toute sécurité. Il tenait d'ailleurs à réparer l'effet de l'algarade. Il avait vaguement compris que la chanteuse s'était trompée; mais il trouvait indécent que Christophe l'eût fait remarquer. On bissa les morceaux. Mais Christophe résolument ferma le piano.
Elle ne s'aperçut pas de cette nouvelle insolence; elle était trop troublée pour penser à recommencer. Elle sortit précipitamment, s'enferma dans sa loge; et là, pendant un quart d'heure, elle se soulagea le cœur du flot de rancune et de rage qui s'y était accumulé: crise de nerfs, déluge de larmes, invectives indignées, imprécations contre Christophe... On entendait ses cris de fureur à travers la porte fermée. Ceux de ses amis qui réussirent à entrer racontèrent, en sortant, que Christophe s'était conduit comme un goujat. L'opinion se répand vite dans une salle de spectacle. Aussi, lorsque Christophe remonta au pupitre pour le dernier morceau, le public était houleux. Mais ce morceau n'était pas de lui: c'était la Festmarsch de Ochs. Le public, qui se trouvait à son aise dans cette plate musique, eut un moyen tout simple de manifester sa désapprobation pour Christophe, sans aller jusqu'à l'audace de le siffler: il acclama Ochs avec ostentation, redemandant deux ou trois fois l'auteur, qui ne manqua point de paraître. Et ce fut la fin du concert.
On se doute bien que le grand-duc et le monde de la cour,—cette petite ville de province, cancanière et ennuyée,—ne perdirent aucun détail de ce qui s'était passé. Les journaux amis de la cantatrice ne firent pas d'allusion à l'incident; mais ils furent d'accord pour exalter l'art de la chanteuse, en se contentant de mentionner, à titre de renseignement, les Lieder qu'elle avait chantés. Sur les autres œuvres de Christophe, quelques lignes à peine, les mêmes à peu de chose près dans tous les journaux: «... Science du contrepoint. Écriture compliquée. Manque d'inspiration. Pas de mélodie. Écrit avec sa tête et non avec son cœur. Absence de sincérité. Veut être original...»—Suivait un paragraphe sur la véritable originalité, celle des maîtres qui sont enterrés, de Mozart, de Beethoven, de Lœwe, de Schubert, de Brahms, «ceux qui sont originaux sans avoir pensé à l'être».—Puis on passait par une transition naturelle à la nouvelle reprise par le théâtre grand-ducal du Nachtlager von Granada de Konradin Kreutzer; on rendait compte longuement de «cette délicieuse musique, fraîche et pimpante comme au premier jour».
En résumé, les œuvres de Christophe rencontrèrent, chez les critiques le mieux disposés, une incompréhension totale;—chez ceux qui ne l'aimaient point, une hostilité sournoise;—enfin, dans le grand public, qu'aucun critique ami ou ennemi ne guidait, le silence. Laissé à ses propres pensées, le grand public ne pense rien.
Christophe fut atterré.
Son échec n'avait cependant rien de surprenant. Il y avait trois raisons pour une, pour que ses œuvres déplussent. Elles étaient insuffisamment mûries. Elles étaient trop neuves pour être comprises, du premier coup. Et l'on était trop heureux de donner une leçon à l'impertinent jeune homme.—Mais Christophe n'avait pas l'esprit assez rassis pour admettre la légitimité de sa défaite. Il lui manquait la sérénité que donne au vrai artiste l'expérience d'une longue incompréhension des hommes et de leur bêtise incurable. Sa naïve confiance dans le public et dans le succès, qu'il croyait bonnement atteindre parce qu'il le méritait, s'écroula. Il eût trouvé naturel d'avoir des ennemis. Mais ce qui le stupéfiait, c'était de n'avoir plus un ami. Ceux sur qui il comptait, ceux qui jusqu'à présent avaient paru s'intéresser à sa musique, n'avaient pas, depuis le concert, un mot d'encouragement pour lui. Il essaya de les sonder: ils se retranchaient derrière des paroles vagues. Il insista, il voulut savoir leur véritable pensée: les plus sincères lui opposèrent ses œuvres précédentes, ses sottises des débuts.—Plus d'une fois par la suite, il devait entendre condamner ses œuvres nouvelles au nom de ses œuvres anciennes,—et cela, par les mêmes gens qui, quelques années avant, condamnaient ses œuvres anciennes, quand elles étaient nouvelles: c'est la règle ordinaire. Christophe n'y était pas fait; il poussa les hauts cris. Qu'on ne l'aimât point, très bien! il l'admettait; cela lui plaisait même, il ne tenait pas à être l'ami de tout le monde. Mais qu'on prétendît l'aimer et qu'on ne lui permît pas de grandir, qu'on voulût l'obliger à rester, toute sa vie, un enfant, cela passait les bornes! Ce qui était bon à douze ans ne l'était plus à vingt; et il espérait bien n'en pas rester là, changer encore, changer toujours... Les imbéciles qui voudraient arrêter la vie!... L'intéressant, dans ses compositions d'enfance, n'était pas ces niaiseries d'enfant, mais la force qui couvait pour l'avenir. Et cet avenir, ils voulaient le tuer!... Non, ils n'avaient rien compris jamais à ce qu'il était, jamais ils ne l'avaient aimé; ils n'aimaient que ce qu'il avait de vulgaire, ce qui lui était commun avec les médiocres, non ce qui était lui, vraiment: leur amitié n'était qu'un malentendu...
Il l'exagérait peut-être. Le cas est fréquent de braves gens, incapables d'aimer une œuvre neuve, qui l'aiment sincèrement quand elle a vingt ans de date. La vie nouvelle a un fumet trop fort pour leur tête débile: il faut que l'odeur s'évapore au souffle du temps. L'œuvre d'art ne commence à leur être intelligible que quand elle est recouverte de la crasse des ans.
Mais Christophe ne pouvait admettre qu'on ne le comprît pas quand il était présent, et qu'on le comprît quand il était passé. Il préférait croire qu'on ne le comprenait pas du tout, en aucun cas, jamais. Et il enrageait. Il eut le ridicule de vouloir se faire comprendre, de s'expliquer, de discuter; c'était peine perdue: il eût fallu réformer le goût du temps. Mais il ne doutait de rien. Il était résolu à faire, de gré ou de force, une lessive complète du goût allemand. Toute possibilité lui en manquait: ce n'était pas en quelques conversations, où il avait peine à trouver ses mots et s'exprimait avec une absurde violence sur le compte des grands musiciens, et même de ses interlocuteurs, qu'il pouvait convaincre personne; il ne réussissait qu'à se faire quelques ennemis de plus. Il lui eût fallu pouvoir préparer sa pensée à loisir, et forcer ensuite le public à l'entendre...
Et juste, à point nommé, son étoile—sa mauvaise étoile—vint lui en offrir les moyens.
Il était attablé au restaurant du théâtre, dans un cercle de musiciens de l'orchestre, qu'il scandalisait par ses jugements artistiques. Ils n'étaient pas tous du même avis; mais tous étaient froissés par cette liberté de langage. Le vieux Krause, l'alto, brave homme et bon musicien, qui aimait sincèrement Christophe, eût voulu détourner l'entretien; il toussait, et guettait l'occasion pour lâcher un calembour. Mais Christophe n'entendait pas; il continuait de plus belle; et Krause se désolait:
—Qu'a-t-il besoin de dire tout cela? Que le bon Dieu le bénisse! On peut penser ces choses; mais on ne les dit pas, que diable!
Le plus curieux, c'est que «ces choses», lui aussi, les pensait; du moins, il en avait le soupçon, et les paroles de Christophe réveillaient en lui bien des doutes; mais il n'avait pas le courage d'en convenir,—moitié par peur de se compromettre, moitié par modestie, par défiance de soi.
Weigl, le corniste, ne voulait rien savoir; il voulait admirer, qui que ce fût, quoi que ce fût, bon ou mauvais, étoile ou bec de gaz: tout était sur le même plan; il n'y avait pas de plus et de moins dans son admiration: il admirait, admirait, admirait. C'était pour lui un besoin vital; il souffrait, quand on voulait le limiter.
Le violoncelliste Kuh souffrait bien davantage. Il aimait de tout son cœur la mauvaise musique. Tout ce que Christophe poursuivait de ses sarcasmes et de ses invectives lui était infiniment cher: d'instinct, c'était aux œuvres les plus conventionnelles qu'allait son choix; son âme était un réservoir d'émotion larmoyante et pompeuse. Certes, il ne mentait pas dans son culte attendri pour tous les faux grands hommes. C'est quand il se persuadait qu'il admirait les vrais, qu'il se mentait,—en parfaite innocence. Il y a des «Brahmines» qui croient retrouver en leur dieu le souffle des génies passés: ils aiment Beethoven en Brahms. Kuh faisait mieux: c'était Brahms qu'il aimait en Beethoven.
Mais le plus indigné des paradoxes de Christophe était le basson Spitz. Son instinct musical n'était pas tant blessé, que sa servilité naturelle. Un des empereurs romains voulait mourir debout. Spitz voulait mourir à plat ventre, comme il avait vécu: c'était sa position naturelle; il goûtait des délices à se rouler aux pieds de tout ce qui était officiel, consacré, «arrivé»; et il était hors de lui qu'on voulut l'empêcher de lécher la poussière.
Ainsi, Kuh gémissait, Weigl faisait des gestes désespérés, Krause disait des coq-à-l'âne, et Spitz criait d'une voix aigre. Mais Christophe, imperturbable, criait plus fort que les autres; et il disait des choses énormes sur l'Allemagne et les Allemands.
À une table voisine, un jeune homme l'écoutait, en se tordant de rire. Il avait les cheveux noirs et bouclés, de beaux yeux intelligents, un nez assez volumineux, qui, arrivé près du bout, ne pouvait se décider à aller ni à droite ni à gauche, et plutôt que d'aller tout droit, allait des deux côtés à la fois, les lèvres grosses, et une physionomie spirituelle et mobile, qui suivait ce que disait Christophe, attachée à ses lèvres, reflétant chaque mot avec une attention sympathique et gouailleuse, se plissant de petites rides au front, aux tempes, aux coins des yeux, le long des narines et des joues, grimaçant de rire, le corps tout entier secoué, par moments, d'un accès convulsif. Il ne se mêla point à la conversation, mais il n'en perdit rien. Il manifestait une joie particulière, quand il voyait Christophe, embourbé dans une démonstration et harcelé par Spitz, patauger, bredouiller, bégayer de fureur, jusqu'à ce qu'il eût trouvé le mot qu'il cherchait,—un roc, pour écraser l'adversaire. Et son plaisir était sans bornes, quand Christophe, emporté par la passion bien au delà de sa pensée, énonçait des paradoxes monstrueux, qui faisaient barrir l'auditoire.
Enfin, ils se séparèrent, lassés de sentir et d'affirmer chacun sa supériorité. Au moment où Christophe, resté le dernier dans la salle, allait passer le seuil, in fut abordé par le jeune homme qui avait pris tant de plaisir à l'écouter. Il ne l'avait pas encore remarqué. L'autre, poliment découvert, souriait, demandait la permission de se présenter:
—Franz Mannheim.
Il s'excusa d'avoir été assez indiscret pour suivre la conversation, et il le félicita de la maestria avec laquelle il avait pulvérisé ses adversaires. Il riait encore, en y pensant. Christophe le regarda, heureux, un peu méfiant:
—C'est sérieux? demanda-t-il, vous ne vous moquez pas de moi?
L'autre jura ses grands dieux. La figure de Christophe s'illuminait:
—Alors, vous trouvez que j'ai raison, n'est-ce pas? Vous êtes de mon avis?
—Écoutez, fit Mannheim, pour dire la vérité, je ne suis pas musicien, je ne connais rien à la musique. La seule musique qui me plaise,—(ce n'est pas trop flatteur, ce que je vais vous dire),—c'est la vôtre... Enfin, c'est pour vous montrer que je n'ai pourtant pas trop mauvais goût...
—Hé! hé!—fit Christophe, sceptique, flatté tout de même,—ce n'est pas là une preuve.
—Vous êtes difficile... Bon!... Je pense comme vous: ce n'est pas là une preuve. Aussi, je ne me risque pas à juger ce que vous dites des musiciens allemands. Mais, c'est si vrai, en tout cas, des Allemands en général, des vieux Allemands, de tous ces idiots romantiques, avec leur pensée rance, leur émotion lacrymatoire, ces rabâchages séniles qu'on veut que nous admirions, «cet éternel Hier, qui a toujours été, et qui sera toujours, et qui fera loi demain parce qu'il a fait loi aujourd'hui...!»
Il récita quelques vers du passage fameux de Schiller:
«. . . . . . . . . . . . . . Das ewig Gestrige
Das immer war und immer wiederkehrt...»
—Et lui, tout le premier!—s'interrompit-il au milieu de sa récitation.
—Qui? demanda Christophe.
—Le pompier qui a écrit cela!
Christophe ne comprenait pas. Mais Mannheim continuait:
—Moi d'abord, je voudrais que, tous les cinquante ans, on procédât a un nettoyage général de l'art et de la pensée, qu'on ne laissât rien subsister de tout ce qui était avant.
—C'est un peu radical, dit Christophe, souriant.
—Mais non, je vous assure. Cinquante ans, c'est déjà trop; il faudrait dire: trente... Et encore!... Mesure d'hygiène. On ne garde pas dans sa maison la collection de ses grands-pères. On les envoie, quand ils sont morts, poliment pourrir ailleurs, et on met des pierres dessus, pour être bien sûrs qu'ils ne reviendront pas. Les âmes délicates mettent aussi des fleurs. Je veux bien, cela m'est égal. Tout ce que je demande, c'est qu'ils me laissent tranquille. Je les laisse bien tranquilles, moi! Chacun de son côté: côté des vivants; côté des morts.
—Il y a des morts qui sont plus vivants que les vivants.
—Mais non, mais non! cela serait plus vrai, si vous disiez qu'il y a des vivants qui sont plus morts que les morts.
—Peut-être bien. En tout cas, il y a du vieux qui est encore jeune.
—Eh bien, s'il est encore jeune, nous le retrouverons de nous-mêmes... Mais je n'en crois rien. Ce qui a été bon une fois, ne l'est jamais une seconde fois. Il n'y a de bon que le changement. Ce qu'il faut avant tout, c'est se débarrasser des vieux. Il y a trop de vieux en Allemagne. Mort aux vieux!
Christophe écoutait ces boutades avec une grande attention, et se donnait beaucoup de mal pour les discuter; il sympathisait en partie avec elles, il y reconnaissait certaines de ses pensées; et, en même temps, il éprouvait une gêne de les entendre outrer d'une façon caricaturesque. Mais, comme il prêtait aux autres son propre sérieux, il se disait que peut-être son interlocuteur qui semblait plus instruit que lui et parlait plus facilement, tirait les conséquences logiques de ses principes. L'orgueilleux Christophe, à qui tant de gens ne pardonnaient pas sa foi en lui-même, était souvent d'une modestie naïve, qui le rendait dupe de ceux qui avaient reçu une meilleure éducation,—quand toutefois ils consentaient à ne pas s'en targuer pour éviter une discussion gênante. Mannheim, qui s'amusait de ses propres paradoxes, et qui, de riposte en riposte, en arrivait à des cocasseries extravagantes dont il riait sous cape, n'était pas habitué à se voir pris au sérieux; il fut mis en joie par la peine que prenait Christophe pour discuter ses bourdes, ou même pour les comprendre; et tout en s'en moquant, il était reconnaissant de l'importance que Christophe lui attribuait: il le trouvait ridicule et charmant.
Ils se quittèrent fort bons amis; et Christophe ne fut pas peu surpris de voir, trois heures plus tard, à la répétition du théâtre, surgir de la petite porte qui donnait accès à l'orchestre la tête de Mannheim, radieuse et grimaçante, qui lui faisait des signes mystérieux. Quand la répétition fut finie, Christophe alla à lui. Mannheim le prit familièrement par le bras:
—Vous avez un moment?... Écoutez. Il m'est venu une idée. Peut-être que vous la trouverez absurde... Est-ce que vous ne voudriez pas, une fois, écrire ce que vous pensez de la musique et des musicos? Au lieu d'user votre salive à haranguer quatre crétins de votre bande, qui ne sont bons qu'à souffler et racler sur des morceaux de bois, ne feriez-vous pas mieux de vous adresser au grand public?
—Si je ne ferais pas mieux? Si je voudrais?... Parbleu! Et où voulez-vous que j'écrive? Vous êtes bon, vous!...
—Voilà: j'ai à vous proposer...Nous avons, quelques amis et moi:—Adalbert von Waldhaus, Raphael Goldenring, Adolf Mai, et Lucien Ehrenfeld,—nous avons fondé une Revue, la seule Revue intelligente de la ville: le Dionysos. ... (Vous connaissez certainement?)... Nous vous admirons tous, et nous serions heureux que vous fussiez des nôtres. Voulez-vous vous charger de la critique musicale?
Christophe était confus d'un tel honneur: il mourait d'envie d'accepter; il craignait seulement de n'en être pas digne: il ne savait pas écrire.
—Laissez donc, dit Mannheim, je suis sûr que vous savez très bien. Et puis, du moment que vous serez critique, vous aurez tous les droits. Il n'y a pas à se gêner avec le public. Il est bête comme pas un. Ce n'est rien d'être un artiste: un artiste, c'est celui qu'on peut siffler. Mais un critique, c'est celui qui a le droit de dire: «Sifflez-moi cet homme-là!» Toute la salle se décharge sur lui de l'ennui de penser. Pensez tout ce que vous voudrez. Ayez l'air au moins de penser quelque chose. Pourvu que vous donniez à ces oies leur pâtée, peu importe laquelle! Elles avaleront tout.
Christophe finit par consentir, en remerciant avec effusion. Il mit seulement comme condition qu'il aurait le droit de tout dire:
—Naturellement, naturellement, fit Mannheim. Liberté absolue! Chacun de nous est libre.
Il vint le relancer au théâtre, une troisième fois, le soir, après le spectacle, pour le présenter à Adalbert von Waldhaus et à ses amis. Ils l'accueillirent avec cordialité.
À l'exception de Waldhaus, qui appartenait à une des vieilles familles nobles du pays, tous étaient Juifs, et tous étaient fort riches: Mannheim, fils d'un banquier; Goldenring, d'un propriétaire de vignobles renommés; Mai, d'un directeur d'établissement métallurgique; et Ehrenfeld, d'un grand bijoutier. Leurs pères étaient de la vieille génération israélite, laborieuse et tenace, attachés à l'esprit de leur race, élevant leur fortune avec une âpre énergie, et jouissant de celle-ci bien plus que de celle-là. Les fils semblaient faits pour détruire ce que les pères avaient édifié: ils persiflaient les préjugés familiaux et cette manie de fourmis économes et fouisseuses; ils jouaient aux artistes, ils affectaient de mépriser la fortune et de la jeter par les fenêtres. Mais, en réalité, il ne s'en perdait guère hors de leurs mains; et ils avaient beau faire des folies: ils n'arrivaient jamais à égarer tout à fait leur lucidité d'esprit et leur sens pratique. Au reste, les pères y veillaient, et leur serraient la bride. Le plus prodigue, Mannheim, eût fait sincèrement largesse de tout ce qu'il possédait: mais il ne possédait rien; et quoiqu'il pestât bruyamment contre la ladrerie de son père, en lui-même il en riait et trouvait que le père avait raison. Au bout du compte, il n'y avait guère que Waldhaus, maître de sa fortune, qui y allât bon jeu, bon argent, et qui soutînt de ses fonds la Revue. Il était poète. Il écrivait des «Polymètres», dans le genre de Arno Holz et de Walt Whitman, des vers alternativement très longs et très courts, où les points, les doubles et triples points, les tirets, les silences, les majuscules, les italiques, et les mots soulignés, jouaient un très grand rôle, non moins que les allitérations et que les répétitions—d'un mot, d'une ligne, d'une phrase entière. Il y intercalait des mots, des bruits, dans toutes les langues. Il prétendait faire en vers—(on n'avait jamais su pourquoi)—du Cézanne. À vrai dire, il avait une âme assez poétique, qui sentait avec distinction des choses fades. Il était sentimental et sec, naïf et dandy; ses vers laborieux affectaient une négligence cavalière. Il eût été un bon poète pour gens du monde. Mais ils sont trop de cette espèce, dans les revues et dans les salons; et il voulait être seul. Il s'était mis en tête de jouer le grand seigneur qui est au-dessus des préjugés de sa caste. Il en avait plus que personne. Il ne se les avouait pas. Il avait pris plaisir à ne s'entourer que de Juifs, à la Revue qu'il dirigeait, pour faire crier les siens, antisémites, et pour se prouver à lui-même sa liberté d'esprit. Il affectait avec ses collègues un ton d'égalité courtoise. Mais au fond, il avait pour eux un mépris tranquille et sans bornes. Il n'ignorait pas qu'ils étaient bien aises de se servir de son nom et de son argent; et il les laissait faire, pour avoir la douceur de les mépriser.
Et ils le méprisaient de les laisser faire; car ils savaient très bien qu'il y trouvait son profit. Donnant, donnant. Waldhaus leur apportait son nom et sa fortune; et eux lui apportaient leur talent, leur esprit d'affaires, et une clientèle. Ils étaient beaucoup plus intelligents que lui. Non pas qu'ils eussent plus de personnalité. Ils en avaient peut-être moins encore. Mais, dans cette petite ville, ils étaient, comme partout et toujours,—par le fait de la différence de leur race, qui depuis des siècles les isole et aiguise leur faculté d'observation railleuse,—ils étaient les esprits les plus avancés, les plus sensibles au ridicule des institutions vermoulues et des pensées décrépites. Seulement, comme leur caractère était moins libre que leur intelligence, cela ne les empêchait point, en raillant, de chercher beaucoup plus à profiter de ces institutions et de ces pensées, qu'à les réformer. En dépit de leurs professions de foi indépendantes, ils étaient, aussi bien que le gentilhomme Adalbert, de petits snobs de province, des fils de famille riches et désœuvrés, qui faisaient de la littérature par sport et par flirt. Ils étaient bien aises de se donner des allures de pourfendeurs; mais ils étaient bons diables, et ne pourfendaient que quelques gens inoffensifs, ou qu'ils pensaient hors d'état de leur nuire jamais. Ils n'avaient garde de se brouiller avec une société, où ils savaient qu'ils rentreraient un jour, pour y vivre de la vie de tout le monde, en épousant les préjugés qu'ils avaient combattus. Et quand ils se risquaient à faire un coup d'État, ou dé réclame, à partir bruyamment en guerre contre une idole du jour,—qui commençait à branler,—ils avaient soin de ne pas brûler leurs vaisseaux: en cas de danger, ils se rembarquaient. Quelle que fût d'ailleurs l'issue de la campagne,—quand elle était finie, il y en avait pour longtemps avant qu'on recommençât; les Philistins pouvaient dormir tranquilles. Tout ce que cherchaient les nouveaux Davidsbündler, c'était à faire croire qu'ils auraient pu être terribles, s'ils avaient voulu:—mais ils ne voulaient pas. Ils préféraient tutoyer les artistes et souper avec les actrices.
Christophe se trouva mal à l'aise dans ce milieu. Ils parlaient surtout de femmes et de chevaux; et ils en parlaient sans grâce. Ils étaient compassés. Adalbert s'exprimait d'une voix blanche et lente, avec une politesse raffinée, ennuyée, ennuyeuse. Adolf Mai, le secrétaire de la rédaction, lourd, trapu, la tête enfoncée dans les épaules, l'air brutal, voulait toujours avoir raison; il tranchait surtout, n'écoutait jamais ce qu'on lui répondait, semblait mépriser l'opinion de l'interlocuteur et, encore plus, l'interlocuteur. Goldenring, le critique d'art, qui avait des tics nerveux et des yeux perpétuellement clignotants derrière de larges lunettes,—pour imiter sans doute les peintres qu'il fréquentait, portait les cheveux longs, fumait silencieusement, mâchonnait des lambeaux de phrases qu'il n'achevait jamais, et faisait des gestes vagues dans l'air avec son pouce. Ehrenfeld, petit, chauve, souriant, avec une barbe blonde, une figure fine et fatiguée, au nez busqué, écrivait dans la Revue les modes et la chronique mondaine. Il disait des choses très crues, d'une voix caressante; il avait de l'esprit, méchant, souvent ignoble.—Tous ces jeunes millionnaires étaient anarchistes, comme il convient: c'est le suprême luxe, quand on possède tout, de nier la société; car on se dégage ainsi de ce qu'on lui doit. Tel, un voleur qui, après avoir détroussé un passant, lui dirait: «Que fais-tu encore ici? Va-t'en! Je n'ai plus besoin de toi.»
Christophe, dans ce groupe, n'éprouvait de sympathie que pour Mannheim. C'était assurément le plus vivant des cinq; il s'amusait de tout ce qu'il disait et de tout ce qu'on disait; bégayant, bredouillant, ânonnant, ricanant, disant des coq-à-l'âne, il n'était pas capable de suivre un raisonnement, ni de savoir au juste ce qu'il pensait lui-même; mais il était bon garçon, sans fiel contre qui que ce fût, et sans l'ombre d'ambition. À la vérité, il n'était pas très franc: il jouait toujours un rôle; mais c'était innocemment, et cela ne faisait de tort à personne. Il s'emballait pour toutes les utopies baroques—généreuses, le plus souvent. Il était trop fin et trop moqueur pour y croire tout à fait; il savait garder son sang-froid, même dans ses emballements, et il ne se compromettait jamais dans l'application de ses théories. Mais il lui fallait une marotte: c'était un jeu pour lui, et il en changeait fréquemment. Pour l'instant, il avait la marotte de la bonté. Il ne lui suffisait pas d'être bon, naturellement; il voulait paraître bon; il professait la bonté, il la mimait. Par esprit de contradiction contre l'activité sèche et dure des siens et contre le rigorisme, le militarisme, le philistinisme allemand, il était Tolstoyen, Nirvânien, évangéliste, bouddhiste,—il ne savait trop lui-même,—apôtre d'une morale molle et désossée, indulgente, bénisseuse, facile à vivre, qui pardonnait avec effusion à tous les péchés, surtout aux péchés voluptueux, qui ne cachait point sa prédilection pour eux, qui pardonnait beaucoup moins aux vertus,—une morale qui n'était qu'un traité du plaisir, une association libertine de complaisances mutuelles, qui s'amusait à ceindre l'auréole de la sainteté. Il y avait là une petite hypocrisie qui ne sentait pas très bon pour les odorats délicats, et qui aurait pu même être franchement écœurante, si elle s'était prise au sérieux. Mais elle n'y prétendait pas; elle s'amusait d'elle-même. Ce christianisme polisson n'attendait qu'une occasion pour céder le pas à quelque autre marotte,—n'importe laquelle: celle de la force brutale, de l'impérialisme, des «lions qui rient».—Mannheim se donnait la comédie; il se la donnait de tout son cœur; il endossait tour à tour tous les sentiments qu'il n'avait pas, avant de redevenir un bon vieux Juif comme les autres, avec tout l'esprit de sa race. Il était très sympathique et extrêmement agaçant.
Christophe fut, quelque temps, une de ses marottes. Mannheim ne jurait que par lui. Il cornait son nom partout. Il rebattait les oreilles des siens avec ses dithyrambes. À l'en croire, Christophe était un génie, un homme extraordinaire, qui faisait de la musique cocasse, qui surtout en parlait d'une façon étonnante, qui était plein d'esprit,—et beau, avec cela: une jolie bouche, des dents magnifiques. Il ajoutait que Christophe l'admirait.—Il finit par l'amener dîner, un soir, chez lui. Christophe se trouva en tête à tête avec le père de son nouvel ami, le banquier Lothar Mannheim, et avec la sœur de Franz, Judith.
C'était la première fois qu'il pénétrait dans un intérieur israélite. Bien qu'assez nombreuse dans la petite ville, et y tenant une place importante par sa richesse, sa cohésion, et son intelligence, la société juive vivait un peu à part de l'autre. Il existait toujours dans le peuple, à son égard, des préjugés tenaces et une secrète hostilité, bonasse, mais injurieuse. Ces sentiments étaient ceux de la famille de Christophe. Son grand-père n'aimait pas les Juifs; mais l'ironie du sort avait fait que ses deux meilleurs élèves pour la musique—(l'un, devenu compositeur, l'autre, virtuose illustre)—étaient israélites; et le brave homme était malheureux: car il y avait des moments où il eût voulu embrasser ces deux bons musiciens; et puis, il se souvenait avec tristesse qu'ils avaient mis Dieu en croix; et il ne savait comment concilier l'inconciliable. En fin de compte, il les embrassait. Il inclinait à croire que Dieu leur pardonnerait, parce qu'ils avaient beaucoup aimé la musique.—Le père de Christophe, Melchior, qui faisait l'esprit fort, avait moins de scrupules à prendre l'argent des Juifs; et il trouvait même cela très bien: mais il faisait d'eux des gorges chaudes, et il les méprisait.—Quant à sa mère, elle n'était pas sûre de ne pas commettre un péché, lorsqu'elle allait servir chez eux, comme cuisinière. Ceux à qui elle avait affaire étaient d'ailleurs assez rogues avec elle: pourtant, elle ne leur en voulait pas, elle n'en voulait à personne, elle était pleine de pitié pour ces malheureux, que Dieu avait damnés; elle s'attendrissait, en voyant passer la fille de la maison, ou en entendant les rires joyeux des enfants:
—Une si belle personne!... De si jolis petits!... Quel malheur!... pensait-elle.
Elle n'osa rien dire à Christophe, quand il lui annonça qu'il dînerait, le soir, chez les Mannheim; mais elle eut le cœur un peu serré. Elle pensait qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on disait de méchant contre les Juifs—(on dit du mal de tout le monde)—et qu'il y a de braves gens partout, mais qu'il était mieux pourtant et plus convenable que chacun restât chez soi, les Juifs de leur côté, et les chrétiens d'un autre.
Christophe n'avait aucun de ces préjugés. Avec son esprit de réaction perpétuelle contre son milieu, il était plutôt attiré par cette race différente. Mais il ne la connaissait guère. Il n'avait eu quelques rapports qu'avec les éléments les plus vulgaires de la population juive: les petits marchands, la populace qui grouillait dans les rues entre le Rhin et la cathédrale, continuant à former, avec l'instinct de troupeau qui est chez tous les hommes, une sorte de petit ghetto. Il lui arrivait de flâner dans ce quartier, épiant au passage d'un œil curieux et assez sympathique des types de femmes aux joues creusées, aux lèvres et aux pommettes saillantes, au sourire à la Vinci, un peu avili, et dont le parler grossier et le rire saccadé venaient malheureusement détruire l'harmonie de la figure au repos. Même dans la lie de la populace, dans ces êtres aux grosses têtes, aux yeux vitreux, aux faces souvent bestiales, trapus et bas sur pattes, ces descendants dégénérés de la plus noble des races, on voyait, jusque dans cette fange fétide, d'étranges phosphorescences qui s'allumaient, comme des feux follets dansant sur les marais: des regards merveilleux, des intelligences lumineuses, une électricité subtile qui se dégageait de la vase, et qui fascinait et inquiétait Christophe. Il pensait qu'il y avait là dedans de belles âmes qui se débattaient, de grands cœurs qui cherchaient à sortir du bourbier; et il eût voulu les rencontrer, leur venir en aide; il les aimait sans les connaître, en les redoutant un peu. Mais jamais il n'avait eu d'intimité avec aucun d'entre eux. Jamais surtout il n'avait eu l'occasion d'approcher l'élite de la société juive.
Le dîner chez les Mannheim avait donc pour lui l'attrait de la nouveauté, et, même du fruit défendu. L'Ève qui lui présentait ce fruit le rendait plus savoureux. Depuis l'instant qu'il était entré, Christophe n'avait plus d'yeux que pour Judith Mannheim. Elle appartenait à une espèce différente de toutes les femmes qu'il connaissait jusque-là. Grande et svelte, un peu maigre, bien que solidement charpentée, la figure encadrée de cheveux noirs, peu abondants, mais épais, et plantés bas, qui couvraient les tempes et le front osseux et doré, un peu myope, les paupières grosses, l'œil légèrement bombé, le nez assez fort aux narines dilatées, les joues d'une maigreur intelligente, le menton lourd, le teint assez coloré, elle avait un beau profil, énergique et net; de face, l'expression était plus trouble, incertaine, composite; les yeux et les joues étaient inégaux. On sentait en elle une forte race, et, dans le moule de cette race, jetés confusément, des éléments multiples, disparates, de très beaux et de très vulgaires. Sa beauté résidait surtout dans sa bouche silencieuse, et dans ses yeux qui semblaient plus profonds à cause de leur myopie, et plus sombres, par l'effet de leur cernure bleuâtre.
Il eût fallu être plus habitué que Christophe à ces yeux, qui sont ceux d'une race plus que d'un individu, pour lire sous leur voile humide et ardent l'âme réelle de la femme qui était devant lui. C'était l'âme du peuple d'Israël qu'il découvrait dans ces yeux brûlants et mornes, qui la portaient en eux, sans le savoir eux-mêmes. Il y était perdu. Beaucoup plus tard seulement, après s'être souvent égaré dans de telles prunelles, il apprit à retrouver sa route sur cette mer orientale.
Elle, le regardait; et rien ne venait gêner la lucidité de son regard; rien ne semblait lui échapper, de cette âme chrétienne. Il le sentait. Il sentait sous la séduction de ce regard féminin une volonté virile, claire et froide, qui fouillait en lui avec une sorte de brutalité indiscrète. Cette brutalité n'avait rien de malveillant. Elle prenait possession de lui. Non pas à la façon d'une coquette qui veut séduire sans s'inquiéter de savoir qui. Coquette, elle l'était plus que personne; mais elle savait sa force, et elle s'en remettait à son instinct de l'exercer,—surtout quand elle avait affaire à une proie aussi facile que Christophe.—Ce qui l'intéressait davantage, c'était de connaître son adversaire: (tout homme, tout inconnu était pour elle un adversaire,—avec qui l'on pouvait plus tard, s'il y avait lieu, signer un pacte d'alliance). La vie étant un jeu, où le plus intelligent gagnait, il s'agissait de lire dans les cartes de son adversaire et de ne pas montrer les siennes. À y réussir, elle goûtait la volupté d'une victoire. Peu lui importait qu'elle pût ou non en tirer parti. C'était pour le plaisir. Elle avait la passion de l'intelligence. Non de l'intelligence abstraite, encore qu'elle eût le cerveau assez solide pour réussir, si elle eût voulu, en n'importe quelles sciences, et que, mieux que son frère, elle eût été le vrai successeur du banquier Lothar Mannheim. Mais elle préférait l'intelligence vivante, celle qui s'applique aux hommes. Elle jouissait de pénétrer une âme, d'en peser la valeur—(elle y mettait autant d'attention scrupuleuse que la Juive de Matsys à peser ses écus);—elle savait, avec une divination merveilleuse, trouver en moins de rien le défaut de la cuirasse, les tares et les faiblesses qui sont la clef de l'âme, s'emparer des secrets: c'était sa façon de s'en rendre maîtresse. Mais elle ne s'attardait point à sa victoire; et de sa prise elle ne faisait rien. Une fois sa curiosité et son orgueil satisfaits, elle ne s'y intéressait plus, et passait à un autre objet. Toute cette force restait stérile. Dans cette âme si vivante, il y avait la mort. Judith portait en elle le génie de la curiosité et de l'ennui.
Ainsi, elle regardait Christophe, qui la regardait. Elle parlait à peine. Il lui suffisait d'un sourire imperceptible, au coin de la bouche: Christophe était hypnotisé. Ce sourire s'effaçait, la figure devenait froide, les yeux indifférents; elle s'occupait du service et parlait au domestique, d'un ton glacial; il semblait qu'elle n'écoutât plus. Puis, les yeux s'éclairaient de nouveau; et trois ou quatre mots précis montraient qu'elle avait tout entendu et compris.
Elle révisait froidement le jugement de son frère sur Christophe: elle connaissait les hâbleries de Franz; son ironie eut beau jeu, quand elle vit paraître Christophe, dont son frère lui avait vanté la beauté et la distinction—(il semblait que Franz eût un don pour voir le contraire de l'évidence; ou peut-être prenait-il à le croire un amusement paradoxal).—Mais, en étudiant mieux Christophe, elle reconnut que pourtant tout n'était pas faux dans ce que Franz avait dit; et, à mesure qu'elle avançait à la découverte, elle trouvait en Christophe une force encore incertaine et mal équilibrée, mais robuste et hardie: elle y prenait plaisir, sachant, mieux que personne, la rareté de la force. Elle sut faire parler Christophe, dévoiler sa pensée, montrer lui-même ses limites et ses manques; elle lui fit jouer du piano: elle n'aimait pas la musique, mais elle la comprenait; et elle reconnut l'originalité musicale de Christophe, bien que sa musique ne lui inspirât aucune sorte d'émotion. Sans rien changer à sa froideur courtoise, quelques remarques brèves, justes, nullement louangeuses, montrèrent l'intérêt qu'elle prenait à Christophe.
Christophe s'en aperçut; et il en fut fier; car il sentait le prix d'un tel jugement et la rareté de son approbation. Il ne cachait pas le désir qu'il avait de la conquérir; et il y mettait une naïveté, qui faisait sourire ses trois hôtes: il ne parlait plus qu'à Judith, et pour Judith; des deux autres, il ne s'occupait pas plus que s'ils n'avaient pas existé.
Franz le regardait parler; il suivait ses paroles, des lèvres et des yeux, avec un mélange d'admiration et de blague; et il pouffait, en échangeant des coups d'œil moqueurs avec son père et avec sa sœur, qui, impassible, feignait de ne pas les remarquer.
Lothar Mannheim,—un grand vieillard, solide, un peu voûté, le teint rouge, les cheveux gris taillés en brosse, la moustache et les sourcils très noirs, une figure lourde, mais énergique et goguenarde, qui donnait l'impression d'une vitalité puissante,—avait, lui aussi, étudié Christophe, avec une bonhomie narquoise; et, lui aussi, avait reconnu sur-le-champ qu'il y avait «quelque chose» en ce garçon. Mais il ne s'intéressait pas à la musique, ni aux musiciens: ce n'était pas sa partie, il n'y connaissait rien, et il ne le cachait point; il s'en vantait même:—(quand un homme de sa sorte avoue une ignorance, c'est pour en tirer vanité.)—Comme Christophe, de son côté, manifestait clairement, avec une impolitesse dénuée de malice, qu'il pouvait sans regret se passer de la société de Monsieur le banquier, et que la conversation de Mademoiselle Judith Mannheim suffisait à occuper sa soirée, le vieux Lothar, amusé, s'était installé au coin de son feu; et il lisait son journal, écoutant vaguement, d'une oreille ironique, les billevesées de Christophe et sa musique bizarre, qui le faisait rire parfois d'un rire silencieux, à la pensée qu'il pouvait y avoir des gens qui comprenaient cela et qui y trouvaient plaisir. Il ne se donnait même plus la peine de suivre la conversation; il s'en remettait à l'intelligence de sa fille de lui dire ce que valait au juste le nouveau venu. Elle s'acquittait de sa tâche, en conscience.
Quand Christophe fut parti, Lothar demanda à Judith:
—Eh bien, tu l'as confessé: qu'est-ce que tu en dis, de l'artiste?
Elle rit, réfléchit un moment, fit son total, et dit:
—Il est un peu braque; mais il n'est pas bête.
—Bon, fit Lothar: c'est aussi ce qu'il m'a semblé. Alors, il peut réussir?
—Oui, je crois. Il est fort.
—Très bien,—dit Lothar, avec la logique magnifique des forts, qui ne s'intéressent qu'aux forts,—il faudra donc l'aider.
Christophe emportait, de son côté, l'admiration pour Judith Mannheim. Il n'était pourtant pas épris, comme le croyait Judith. Tous deux,—elle avec sa finesse, lui avec son instinct qui lui tenait lieu d'esprit,—se méprenaient également l'un sur l'autre. Christophe était fasciné par l'énigme de cette figure et par l'intensité de sa vie cérébrale; mais il ne l'aimait pas. Ses yeux et son intelligence étaient pris: son cœur ne l'était point.—Pourquoi?—Il eût été assez difficile de le dire. Parce qu'il entrevoyait en elle quelque chose de douteux et d'inquiétant? En d'autres circonstances, c'eût été là pour lui une raison de plus d'aimer: l'amour n'est jamais plus fort que quand il sent qu'il va à ce qui le fera souffrir.—Si Christophe n'aimait pas Judith, ce n'était la faute ni de l'un, ni de l'autre. La vraie raison, assez humiliante pour tous deux, c'est qu'il était trop près encore de son dernier amour. L'expérience ne l'avait pas rendu plus sage. Mais il avait tant aimé Ada, il avait dans cette passion tant dévoré de foi, de force, et d'illusions qu'il ne lui en restait plus assez, en ce moment, pour une nouvelle passion. Avant qu'une autre flamme s'allumât, il fallait qu'il se refît dans son cœur un autre bûcher: d'ici là, ce ne pouvaient être que des feux passagers, des restes de l'incendie, échappés par hasard, qui jetaient une lueur éclatante et brève, et s'éteignaient, faute d'aliment. Six mois plus tard, il eût peut-être aimé Judith aveuglément. Aujourd'hui, il ne voyait en elle rien de plus qu'un ami,—certes un peu troublant;—mais il s'efforçait de chasser ce trouble: ce trouble lui rappelait Ada; c'était là un souvenir sans attrait. Ce qui l'attirait en Judith, c'était ce qu'elle avait de différent des autres femmes, et non ce qu'elle avait de commun avec elles. Elle était la première femme intelligente qu'il eût vue. Intelligente, elle l'était des pieds à la tête. Sa beauté même—ses gestes, ses mouvements, ses traits, les plis de ses lèvres, ses yeux, ses mains, sa maigreur élégante,—était le reflet de son intelligence; son corps était modelé par son intelligence; sans son intelligence, elle eût paru laide. Cette intelligence ravissait Christophe. Il la croyait plus large et plus libre qu'elle n'était; il ne pouvait encore savoir ce qu'elle avait de décevant. Il éprouvait l'ardent désir de se confier à Judith, de partager sa pensée avec elle. Il n'avait jamais trouvé personne qui s'y intéressât: quelle joie c'eût été de rencontrer une amie! Le manque d'une sœur avait été un des regrets de son enfance: il lui semblait qu'une sœur l'aurait compris, mieux que ne pouvait un frère. Après avoir vu Judith, il sentait renaître cet espoir illusoire d'une amitié fraternelle. Il ne pensait pas à l'amour. N'étant pas amoureux, l'amour lui semblait médiocre, au prix de l'amitié.
Judith ne tarda pas à sentir la nuance, et elle en fut blessée. Elle n'aimait pas Christophe, et elle excitait assez d'autres passions parmi les jeunes gens de la ville, riches et d'un meilleur rang, pour qu'elle ne pût éprouver une grande satisfaction à savoir Christophe amoureux. Mais de savoir qu'il ne l'était pas, elle avait du dépit. C'était un peu mortifiant de voir qu'elle ne pouvait exercer sur lui qu'une influence de raison: (une influence de déraison a un bien autre prix pour une âme féminine!) Elle ne l'exerçait même pas: Christophe n'en faisait qu'à sa tête. Judith avait l'esprit impérieux. Elle était habituée à pétrir à sa guise les pensées assez molles des jeunes gens qu'elle connaissait. Comme elle les jugeait médiocres, elle trouvait peu de plaisir à les dominer. Avec Christophe, il y avait plus d'intérêt, parce qu'il y avait plus de difficulté. Ses projets la laissaient indifférente; mais il lui eût plu de diriger cette pensée neuve, cette force mal dégrossie, et de les mettre en valeur,—à sa façon bien entendu, et non à celle de Christophe, qu'elle ne se souciait pas de comprendre. Elle avait tout de suite vu que ce ne serait pas sans lutte; elle avait noté dans Christophe toutes sortes de partis pris, d'idées qui lui semblaient extravagantes et enfantines: c'étaient de mauvaises herbes; elle se faisait fort de les arracher. Elle n'en arracha pas une. Elle n'obtint même pas la plus petite satisfaction d'amour-propre. Christophe était intraitable. N'étant pas épris, il n'avait aucune raison de lui rien céder de sa pensée.
Elle se piqua au jeu, et, pendant quelque temps, elle tenta de le conquérir. Il s'en fallut de peu que Christophe, malgré la lucidité d'esprit qu'il possédait alors, se laissât prendre de nouveau. Les hommes sont facilement dupes de ce qui flatte leur orgueil et leurs désirs; et un artiste est deux fois plus dupe qu'un autre homme, parce qu'il a plus d'imagination. Il ne tint qu'à Judith d'entraîner Christophe dans un flirt dangereux, qui l'eût une fois de plus démoli, et plus complètement peut-être. Mais, comme d'habitude, elle se lassa vite; elle trouva que cette conquête n'en valait pas la peine: Christophe l'ennuyait déjà; elle ne le comprenait plus.
Elle ne le comprenait plus, passé certaines limites. Jusque-là, elle comprenait tout. Pour aller plus loin, son admirable intelligence ne suffisait plus: il eût fallu du cœur, ou, à défaut, ce qui en donne, pour un temps, l'illusion: l'amour. Elle comprenait bien les critiques de Christophe contre les gens et les choses: elle s'en amusait, et elle les trouvait assez vraies; elle n'était pas sans les avoir pensées. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que ces pensées pussent avoir une influence sur sa vie pratique, quand leur application était dangereuse ou gênante. L'attitude de révolte, que Christophe prenait contre tous, ne conduisait à rien: il ne pouvait s'imaginer qu'il allait réformer le monde... Alors?... C'était battre de sa tête contre un mur. Un homme intelligent juge les hommes, les raille secrètement, les méprise un peu; mais il fait comme eux, un peu mieux seulement: c'est le seul moyen de s'en rendre maître. La pensée est un monde, l'action en est un autre. Quelle nécessité de se rendre victime de ce qu'on pense? Penser vrai: certes! Mais à quoi bon dire vrai? Puisque les hommes sont assez bêtes pour ne pouvoir supporter la vérité, faut-il les y forcer? Accepter leur faiblesse, paraître s'y plier, et se sentir libre dans son cœur méprisant, n'y a-t-il pas à cela une jouissance secrète? Jouissance d'esclave intelligent? Soit. Mais esclave pour esclave, puisqu'il faut toujours en venir là, il vaut mieux l'être par sa propre volonté, et éviter des luttes ridicules et inutiles. Le pire des esclavages, c'est d'être esclave de sa pensée et de lui sacrifier tout. Il ne faut pas être dupe de soi.—Elle voyait nettement que si Christophe s'obstinait, comme il y semblait résolu, dans sa voie d'intransigeance agressive contre les préjugés de l'art et de l'esprit allemands, il tournerait contre lui tout le monde, et ses protecteurs mêmes: il allait fatalement à la défaite. Elle ne comprenait pas pourquoi il semblait s'acharner contre lui-même, se ruiner à plaisir.
Pour le comprendre, il eût fallu qu'elle pût comprendre aussi que le succès n'était pas son but, que son but était sa foi. Il croyait dans l'art, il croyait dans son art, il croyait en soi, comme en des réalités supérieures non seulement à toute raison d'intérêt, mais à sa vie. Quand, un peu impatienté par ses observations, il le lui dit, avec une emphase naïve, elle commença par hausser les épaules: elle ne le prit pas au sérieux. Elle voyait là de grands mots, comme ceux qu'elle était habituée à entendre dire à son frère, qui, périodiquement, annonçait des résolutions absurdes et sublimes, qu'il se gardait bien de mettre à exécution. Puis, quand elle vit que Christophe était vraiment dupe de ces mots, elle jugea qu'il était fou, et elle ne s'intéressa plus à lui.
Dès lors, elle ne se donna plus de peine pour paraître à son avantage; elle se montra ce qu'elle était: beaucoup plus Allemande, et Allemande banale qu'elle ne semblait d'abord, et que peut être elle ne pensait.—On reproche, à tort, aux Israélites de n'être d'aucune nation et de former d'un bout à l'autre de l'Europe un seul peuple homogène, imperméable aux influences des peuples différents chez qui ils sont campés. En réalité, il n'est pas de race qui prenne plus facilement l'empreinte des pays où elle passe; et s'il y a bien des caractères communs entre un Israélite français et un Israélite allemand, il y a bien plus encore de caractères différents, qui tiennent à leur nouvelle patrie; ils en épousent, avec une rapidité incroyable, les habitudes d'esprit; plus encore, à vrai dire, les habitudes que l'esprit. Mais l'habitude qui est, chez tous les hommes, une seconde nature, étant chez la plupart la seule et unique nature, il en résulte que la majorité des citoyens autochtones d'un pays seraient fort mal venus à reprocher aux Israélites le manque d'un esprit national, profond et raisonné, qu'ils n'ont eux-mêmes à aucun degré.
Les femmes, toujours plus sensibles aux influences extérieures, plus promptes à s'adapter aux conditions de la vie et à varier avec elles,—les femmes d'Israël prennent par toute l'Europe, souvent avec exagération, les modes physiques et morales du pays où elles vivent,—sans perdre toutefois la silhouette et la saveur trouble, lourde, obsédante, de leur race. Christophe en était frappé. Il rencontrait chez les Mannheim des tantes, des cousines, des amies de Judith. Si peu Allemandes que fussent certaines de ces figures aux yeux ardents et rapprochés du nez, au nez rapproché de la bouche, aux traits forts, au sang rouge sous la peau épaisse et brune, si peu faites qu'elles semblassent pour être Allemandes,—toutes étaient plus Allemandes que de raison: c'était la même façon de parler, de s'habiller, parfois jusqu'à l'outrance. Judith leur était supérieure à toutes; et la comparaison faisait ressortir ce qu'il y avait d'exceptionnel dans son intelligence, ce qui dans sa personne était son œuvre. Elle n'en avait pas moins la plupart des travers des autres. Beaucoup plus libre qu'elles—presque absolument libre—sur le terrain moral, elle ne l'était pas plus sur le terrain social; ou du moins, son intérêt pratique venait se substituer ici à sa raison libre. Elle croyait au monde, aux classes, aux préjugés, parce que, tout compte fait, elle y trouvait son avantage. Elle avait beau railler l'esprit allemand: elle était attachée à la mode allemande. Elle sentait intelligemment la médiocrité de tel artiste reconnu; mais elle ne laissait pas de le respecter, parce qu'il était reconnu; et si, personnellement, elle était en relations avec lui, elle l'admirait: car sa vanité en était flattée. Elle aimait peu les œuvres de Brahms, et elle le soupçonnait en secret d'être un artiste de second ordre; mais sa gloire lui en imposait; et, comme elle avait reçu cinq ou six lettres de lui, il en résultait pour elle avec évidence qu'il était le plus grand musicien du temps. Elle n'avait aucun doute sur la valeur réelle de Christophe et sur la stupidité du premier lieutenant Detlev von Fleischer; mais elle était plus flattée par la cour que celui-ci daignait faire à ses millions, que par l'amitié de Christophe: car un sot officier n'en est pas moins un homme d'une autre caste; et il est plus difficile à une Juive allemande qu'à une autre femme d'entrer dans cette caste. Quoiqu'elle ne fût pas dupe de ces niaiseries féodales et qu'elle sût fort bien que si elle épousait le premier lieutenant Detlev von Fleischer, c'était elle qui lui ferait un grand honneur, elle s'évertuait à le conquérir; elle s'humiliait à faire les yeux doux à ce crétin et à flatter son amour-propre. La Juive orgueilleuse, et qui avait mille raisons de l'être, la fille intelligente et dédaigneuse du banquier Mannheim, aspirait à descendre, à faire comme la première venue de ces petites bourgeoises allemandes, qu'elle méprisait.
L'expérience fut courte. Christophe perdit ses illusions sur Judith presque aussi vite qu'il les avait prises. Il faut rendre cette justice à Judith qu'elle ne fit rien pour qu'il les gardât. Du jour où une femme de cette trempe vous a jugé, où elle s'est détachée de vous, vous n'existez plus pour elle: elle ne vous voit plus, et elle ne se gêne pas davantage pour dévêtir devant vous son âme, avec une tranquille impudeur, que pour se mettre toute nue devant son chien ou son chat. Christophe vit l'égoïsme de Judith, sa froideur, sa médiocrité de caractère. Il n'avait pas eu le temps d'être pris à fond. Ce fut assez déjà pour le faire souffrir, pour lui donner une sorte de fièvre. Sans aimer Judith, il aimait ce qu'elle aurait pu être—ce qu'elle aurait dû être. Ses beaux yeux exerçaient sur lui une fascination douloureuse: il ne pouvait les oublier; quoiqu'il sût maintenant l'âme morne, qui dormait au fond, il continuait de les voir, comme il voulait les voir, comme il les avait vus d'abord. C'était là une de ces hallucinations d'amour sans amour, qui tiennent tant de place dans les cœurs d'artistes, quand ils ne sont pas entièrement absorbés par leur œuvre. Une figure qui passe suffit à la leur donner; ils voient en elle toute la beauté qui est en elle et qu'elle ignore, dont elle ne se soucie pas. Et ils l'aiment d'autant plus qu'ils savent qu'elle ne s'en soucie pas. Ils l'aiment comme une belle chose qui va mourir, sans que personne ait su son prix.
Peut-être s'abusait-il, et Judith Mannheim n'aurait-elle pu être rien de plus que ce qu'elle était. Mais Christophe, un instant, avait eu foi en elle; et le charme durait: il ne pouvait la juger d'une façon impartiale. Tout ce qu'elle avait de beau lui semblait n'être qu'à elle, être elle tout entière. Tout ce qu'elle avait de vulgaire, il le rejetait sur sa double race: la juive et l'allemande; et peut-être, en voulait-il plus à celle-ci qu'à celle-là, car il avait eu à en souffrir davantage. Comme il ne connaissait encore aucune autre nation, l'esprit allemand était pour lui le bouc émissaire: il le chargeait de tous les péchés du monde. La déception que lui causait Judith lui fut une raison de plus de le combattre: il ne lui pardonnait pas d'avoir brisé l'élan d'une pareille âme.
Telle fut sa première rencontre avec Israël. Il avait espéré trouver dans cette race forte et à part un allié dans sa lutte. Il perdit cet espoir. Avec la mobilité d'intuition passionnée, qui le faisait sauter d'un extrême à l'autre, il se persuada aussitôt que cette race était beaucoup plus faible qu'on ne disait, et beaucoup plus accessible—beaucoup trop—aux influences du dehors. Elle était faible de sa propre faiblesse et de toutes celles du monde, ramassées sur son chemin. Ce n'était pas encore là qu'il pouvait trouver le point d'appui pour poser le levier de son art. Il risquait bien plutôt de s'engloutir avec elle dans le sable du désert.
Ayant vu le danger et ne se sentant pas assez sûr de lui-même pour le braver, il cessa brusquement d'aller chez les Mannheim. Il fut invité plusieurs fois, et s'excusa, sans donner de raisons. Comme il avait montré jusque-là un empressement excessif, ce changement soudain fut remarqué: on le mit sur le compte de son «originalité»; mais aucun des trois Mannheim ne douta que les beaux yeux de Judith n'y fussent pour quelque chose; ce fut un sujet de plaisanterie, à table, de la part de Lothar et de Franz. Judith haussa les épaules, en disant que c'était une belle conquête; et elle pria sèchement son frère «de ne pas lui monter de bateau». Mais elle ne négligea rien pour que Christophe revînt. Elle lui écrivit, sous prétexte d'un renseignement musical que nul autre ne pouvait lui fournir; et, à la fin de la lettre, elle faisait une allusion amicale à la rareté de ses visites et au plaisir qu'on aurait à le voir. Christophe répondit, donna le renseignement, prétexta ses occupations, et ne parut pas. Ils se rencontraient parfois au théâtre. Christophe détournait obstinément les yeux de la loge des Mannheim; et il feignait de ne pas voir Judith, qui tenait prêt pour lui son plus charmant sourire. Elle n'insista point. Ne tenant pas à lui, elle trouva inconvenant que ce petit artiste lui laissât faire tous les frais, en pure perte. S'il voulait revenir, il reviendrait. Sinon,—eh bien! on s'en passerait...
On s'en passa; et, en effet, son absence ne fit pas un grand vide aux soirées des Mannheim. Mais Judith, en dépit d'elle, garda rancune à Christophe. Elle trouvait naturel de ne pas se soucier de lui, quand il était là; et elle lui permettait d'en témoigner du déplaisir; mais que ce déplaisir allât jusqu'à rompre toutes relations lui semblait d'un orgueil stupide et d'un cœur plus égoïste qu'épris.—Judith ne tolérait point chez les autres ses défauts.
Elle n'en suivit qu'avec plus d'attention ce que Christophe faisait et ce qu'il écrivait. Sans en avoir l'air, elle mettait volontiers son frère sur ce sujet; elle lui faisait raconter ses conversations de la journée avec Christophe; et elle ponctuait le récit d'observations ironiques, qui ne laissaient passer aucun trait ridicule et ruinaient peu à peu l'enthousiasme de Franz, sans qu'il s'en aperçût.
D'abord, tout fut pour le mieux, à la Revue. Christophe n'avait pas encore pénétré la médiocrité de ses confrères; et eux, puisqu'il était des leurs, lui reconnaissaient du génie. Mannheim, qui l'avait découvert, répétait de tous côtés, sans avoir rien lu de lui, que Christophe était un critique admirable, qui s'était jusque-là trompé sur sa vocation, et que lui, Mannheim, la lui avait révélée. Ils annoncèrent ses articles à l'avance, en termes mystérieux, qui piquaient la curiosité; et sa première chronique fut, dans l'atonie de la petite ville, comme une pierre qui tombe dans une mare aux canards. Elle était intitulée: Trop de musique!
«Trop de musique, trop de boisson, trop de mangeaille!—écrivait Christophe.—On mange, on boit, on ouït, sans faim, sans soif, sans besoin, par habitude de goinfrerie. C'est un régime d'oie de Strasbourg. Ce peuple est malade de boulimie. Peu lui importe ce qu'on lui donne: Tristan ou le Trompeter von Säckingen, Beethoven ou Mascagni, une fugue ou un pas redoublé, Adam, Bach, Puccini, Mozart, ou Marschner: il ne sait pas ce qu'il mange; l'important, c'est qu'il mange. Il n'y trouve même plus de plaisir. Voyez-le au concert. On parle de la gaieté allemande! Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la gaieté: ils sont toujours gais! Leur gaieté, comme leur tristesse, se répand en pluie: c'est de la joie en poussière; elle est atone et sans force. Us resteraient pendant des heures à absorber, en souriant béatement, des sons, des sons, des sons. Ils ne pensent à rien, ils ne sentent rien: ce sont des éponges. La vraie joie, la vraie douleur,—la force,—ne se distribue pas pendant des heures, comme la bière d'un tonneau. Elle vous prend à la gorge et vous terrasse; et on n'a plus envie, après, de rien autre: on a son compte...!
«Trop de musique! Vous vous tuez et vous la tuez. Pour ce qui est de vous, cela vous regarde. Mais pour la musique, halte-là! Je ne permets pas que vous avilissiez la beauté du monde, en mettant dans le même panier les saintes harmonies et les ignominies, en donnant, comme vous faites couramment, le prélude de Parsifal entre une fantaisie sur la Fille du Régiment et un quartett de saxophones, ou un adagio de Beethoven flanqué d'un air de cake walk et d'une ordure de Leoncavallo. Vous vous vantez d'être le grand peuple musical. Vous prétendez aimer la musique. Quelle musique aimez-vous? Est-ce la bonne ou la mauvaise? Vous les applaudissez de même. À la fin, faites un choix! Que voulez-vous au juste? Vous ne le savez pas. Vous ne voulez pas le savoir: vous avez trop peur de prendre parti, de vous compromettre... Au diable votre prudence!—Vous êtes au-dessus des partis, dites-vous?—Au-dessus: cela veut dire au-dessous...»
Et il leur citait les vers du vieux Gottfried Keller, le rude bourgeois de Zurich,—un des écrivains qui lui étaient chers par sa loyauté batailleuse et son âpre saveur du terroir:
Wer über den Partein sich wähnt mit stolzen Mienen,
Der steht zumeist vielmehr beträchtlich unter ihnen.
(« Qui fièrement se flatte d'être au-dessus des partis,
celui-là bien plutôt reste considérablement au-dessous.»)
—«Ayez le courage d'être vrais, continuait-il. Ayez le courage d'être laids! Si vous aimez la mauvaise musique, dites-le carrément. Montrez-vous tels que vous êtes. Débarbouillez-vous l'âme du fard dégoûtant de toutes vos équivoques. Lavez-la à grande eau. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu votre mufle dans un miroir? Je m'en vais vous le montrer. Compositeurs, virtuoses, chefs d'orchestre, chanteurs, et toi, cher public, vous saurez une bonne fois qui vous êtes... Soyez tout ce que vous voudrez; mais par tous les diables! soyez vrais! Soyez vrais, dussent en souffrir les artistes et l'art! Si l'art et la vérité ne peuvent vivre ensemble, que l'art crève! La vérité, c'est la vie. La mort, c'est le mensonge.»
Cette déclamation juvénile, outrée, et d'assez mauvais goût, fit naturellement crier. Pourtant, comme tout le monde était visé, mais comme aucun ne l'était d'une façon précise, personne n'eut garde de se reconnaître. Chacun est, se croit, ou se dit le meilleur ami de la vérité: il n'y avait donc pas de risques qu'on attaquât les conclusions de l'article. On fut seulement choqué du ton général; on s'accordait à le trouver peu convenable, surtout de la part d'un artiste quasi officiel. Quelques musiciens commencèrent à s'agiter et protestèrent avec aigreur: ils prévoyaient que Christophe n'en resterait pas là. D'autres se crurent plus habiles, en félicitant Christophe de son acte de courage: ils n'étaient pas les moins inquiets sur les prochains articles.
L'une et l'autre tactique eurent même résultat. Christophe était lancé: rien ne pouvait l'arrêter; et, comme il l'avait promis, tout y passa: les auteurs et les interprètes.
Les premiers sabrés furent les Kapellmeister. Christophe ne s'en tenait point à des considérations générales sur l'art de diriger l'orchestre. Il nommait par leurs noms ses confrères de la ville ou des villes voisines; ou s'il ne les nommait point, les allusions étaient si claires que nul ne s'y trompait. Chacun reconnaissait l'apathique chef d'orchestre de la cour, Aloïs von Werner, vieillard prudent, chargé d'honneurs, qui craignait tout, qui ménageait tout, qui avait peur de faire une observation à ses musiciens et suivait docilement les mouvements qu'ils prenaient, qui ne hasardait rien sur ses programmes qui ne fût consacré par vingt ans de succès, ou, pour le moins, couvert par l'estampille officielle de quelque dignité académique. Christophe applaudissait ironiquement à ses hardiesses; il le félicitait d'avoir découvert Gade, Dvorak, ou Tschaikowsky; il s'extasiait sur l'immuable correction, l'égalité métronomique, le jeu éternellement fein-nuanciert (finement nuancé) de son orchestre; il proposait de lui orchestrer pour son prochain concert l'École de la Vélocité de Czerny; et il le conjurait de ne pas tant se fatiguer, de ne pas tant se passionner, de ménager sa précieuse santé.—Ou c'étaient des cris d'indignation à propos de la façon dont il avait conduit l'Héroïque de Beethoven:
—«Un canon! Un canon! Mitraillez-moi ces gens-là! ... Mais vous n'avez donc aucune idée de ce que c'est qu'un combat, la lutte contre la bêtise et la férocité humaines,—et la force qui les foule aux pieds, avec un rire de joie?... Comment le sauriez-vous? C'est vous qu'elle combat! Tout l'héroïsme qui est en vous, vous le dépensez à écouter, ou à jouer sans bâiller l'Héroïque de Beethoven,—(car cela vous ennuie... Avouez donc que cela vous ennuie, que vous en crevez d'ennui!)—ou à braver un courant d'air, tête nue et dos courbé, sur le passage de quelque Sérénissime.»
Il n'avait pas assez de sarcasmes pour ces pontifes de Conservatoires, interprétant les grands hommes du passé en «classiques».
—«Classique! ce mot dit tout. La libre passion, arrangée, expurgée à l'usage des écoles! La vie, cette plaine immense que balayent les vents,—renfermée entre les quatre murs d'une cour de gymnase! Le rythme sauvage et fier d'un cœur frémissant, réduit au tic-tac de pendule d'une mesure à quatre temps, qui va tranquillement son petit bonhomme de chemin, clochant du pied et béquillant sur le temps fort!... Pour jouir de l'Océan, vous auriez besoin de le mettre dans un bocal, avec des poissons rouges. Vous ne comprenez la vie que quand vous l'avez tuée.»
S'il n'était pas tendre pour les «empailleurs», ainsi qu'il les nommait, il l'était moins encore pour les «écuyers de cirque», pour les Kapellmeister illustres qui venaient en tournée faire admirer leurs ronds de bras et leurs mains fardées, ceux qui exerçaient leur virtuosité sur le dos des grands maîtres, s'évertuaient à rendre méconnaissables les œuvres les plus connues, et faisaient des cabrioles à travers le cerceau de la Symphonie en ut mineur. Il les traitait de vieilles coquettes, de tziganes, et de danseurs de cordes.
Les virtuoses lui fournissaient une riche matière. Il se récusait quand il avait à juger leurs séances de prestidigitation. Il disait que ces exercices de mécanique étaient du ressort du Conservatoire des Arts et Métiers, et que, seuls, des graphiques enregistrant la durée, le nombre des notes, et l'énergie dépensée, pouvaient évaluer le mérite de pareils travaux. Parfois il mettait au défi un pianiste célèbre, qui venait de surmonter, dans un concert de deux heures, les difficultés les plus formidables, le sourire sur les lèvres, et la mèche sur les yeux,—d'exécuter un andante enfantin de Mozart.—Certes, il ne méconnaissait point le plaisir de la difficulté vaincue. Lui aussi l'avait goûté: c'était une des joies de la vie. Mais n'en voir que le côté le plus matériel, et finir par y réduire tout l'héroïsme de l'art, lui paraissait grotesque et dégradant. Il ne pardonnait pas aux «lions», ou aux «panthères du piano».—Il n'était pas non plus très indulgent pour les braves pédants, célèbres en Allemagne, qui, justement soucieux de ne point altérer le texte des maîtres, répriment avec soin tout élan de la pensée, et, comme Hans de Bülow, quand ils disent une sonate passionnée, semblent donner une leçon de diction.
Les chanteurs eurent leur tour. Christophe en avait gros sur le cœur à leur dire de leur lourdeur barbare et de leur emphase de province. Ce n'était pas seulement le souvenir de ses démêlés avec la dame en bleu. C'était la rancune de tant de représentations qui lui avaient été un supplice. Il ne savait ce qui avait le plus à y souffrir, des oreilles, ou des yeux. Encore Christophe manquait-il de termes de comparaison pour bien juger de la laideur de la mise en scène, des costumes disgracieux, des couleurs qui hurlaient. Il était surtout choqué par la vulgarité des types, des gestes et des attitudes, par le jeu sans naturel, par l'inaptitude des acteurs à revêtir des âmes étrangères, par l'indifférence stupéfiante avec laquelle ils passaient d'un rôle à un autre, pourvu qu'il fût écrit à peu près dans le même registre de voix. D'opulentes matrones, réjouies et rebondies, s'exhibaient tour à tour en Ysolde et en Carmen. Amfortas jouait Figaro!... Mais ce qui, naturellement, était le plus sensible à Christophe, c'était la laideur du chant, surtout dans les œuvres classiques dont la beauté mélodique est un élément essentiel. On ne savait plus chanter en Allemagne la parfaite musique de la fin du dix-huitième siècle: on ne s'en donnait pas la peine. Le style net et pur de Gluck et de Mozart, qui semble, comme celui de Gœthe, tout baigné de lumière italienne,—ce style qui commence à s'altérer déjà, à devenir vibrant et papillotant avec Weber,—ce style ridiculisé par les lourdes caricatures de l'auteur du Crociato,—avait été anéanti paille triomphe de Wagner. Le vol sauvage des Walkyries aux cris stridents avait passé sur le ciel de la Grèce. Les nuées d'Odin étouffaient la lumière. Nul ne songeait plus maintenant à chanter la musique: on chantait les poèmes. On faisait bon marché des négligences de détail, des laideurs, des fausses notes même, sous prétexte que seul, l'ensemble de l'œuvre, la pensée importait...
—«La pensée! Parlons-en. Comme si vous la compreniez!... Mais que vous la compreniez ou non, respectez, s'il vous plaît, la forme qu'elle s'est choisie. Avant tout, que la musique soit et reste de la musique!»
D'ailleurs, ce grand souci que les artistes allemands prétendaient avoir de l'expression et de la pensée profonde était, selon Christophe, une bonne plaisanterie. De l'expression? De la pensée? Oui, ils en mettaient partout,—partout, également. Ils eussent trouvé de la pensée dans un chausson de laine, aussi bien—pas plus, pas moins,—que dans une statue de Michel-Ange. Ils jouaient avec la même énergie n'importe qui, n'importe quoi. Au fond, chez la plupart, l'essentiel de la musique était—assurait-il—le volume du son, le bruit musical. Le plaisir de chanter, si puissant en Allemagne, était une satisfaction de gymnastique vocale. Il s'agissait de se gonfler d'air largement et de le rejeter avec vigueur, fort, longtemps, et en mesure.—Et il décernait à telle grande chanteuse, en guise de compliment, un brevet de bonne santé.
Il ne se contentait pas d'étriller les artistes. Il enjambait la rampe, et rossait le public, qui assistait bouche bée à ces exécutions. Le public, ahuri, ne savait pas s'il devait rire ou se fâcher. Il avait tous les droits de crier à l'injustice: il avait pris bien garde de ne se mêler à aucune bataille d'art; il se tenait prudemment en dehors de toute question brûlante; et de peur de se tromper, il applaudissait tout. Et voici que Christophe lui faisait un crime d'applaudir!... D'applaudir les méchantes œuvres?—C'eût été déjà fort! Mais Christophe allait plus loin: ce qu'il lui reprochait le plus d'applaudir, c'étaient les grandes œuvres.
—«Farceurs, leur disait-il, vous voudriez faire croire que vous avez tant d'enthousiasme que cela?... Allons donc! Vous prouvez justement le contraire. Applaudissez, si vous voulez, les œuvres ou les pages, qui appellent l'applaudissement. Applaudissez les conclusions bruyantes, qui ont été faites, comme disait Mozart, «pour les longues oreilles». Là, donnez-vous-en à cœur joie: les braiments sont prévus; ils font partie du concert.—Mais après la Missa Solemnis de Beethoven!... Malheureux!... C'est le Jugement Dernier, vous venez de voir se dérouler le Gloria affolant, comme une tempête sur l'océan, vous avez vu passer la trombe d'une volonté athlétique et forcenée, qui s'arrête, se retient aux nuées, cramponnée des deux poings sur l'abîme, et se lance de nouveau dans l'espace, à toute volée. La rafale hurle. Au plus fort de l'ouragan, une brusque modulation, un miroitement de ton, troue les ténèbres du ciel et tombe sur la mer livide, comme une plaque de lumière. C'est la fin: le vol furieux de l'ange exterminateur s'arrête net, les ailes clouées par trois coups d'éclairs. Tout tremble encore, autour. L'œil ivre a le vertige. Le cœur palpite, le souffle s'arrête, les membres sont paralysés... Et la dernière note n'a pas fini de vibrer que vous êtes déjà gais et réjouis, vous criez, vous riez, vous critiquez, vous applaudissez!... Mais vous n'avez donc rien vu, rien entendu, rien senti, rien compris, rien, rien, absolument rien! Les souffrances d'un artiste sont pour vous un spectacle. Vous jugez finement peintes les larmes d'agonie d'un Beethoven. Vous crieriez: «Bis!» à la Crucifixion. Un demi-dieu se débat, toute une vie, dans la douleur, pour divertir, pendant une heure, votre badauderie!...»
Ainsi, il commentait, sans le savoir, la grande parole de Gœthe; mais il n'avait pas encore atteint à sa hautaine sérénité:
«Le peuple se fait un jeu du sublime. S'il le voyait tel qu'il est, il n'aurait pas la force d'en soutenir l'aspect.»
S'il en fût resté là! ... Mais, emporté par son élan, il dépassa le public et s'en alla tomber, comme un boulet de canon, dans le sanctuaire, le tabernacle, le refuge inviolable de la médiocrité:—la Critique. Il bombarda ses confrères. L'un d'eux s'était permis d'attaquer le mieux doué des compositeurs vivants, le représentant le plus avancé de la nouvelle école, Hassler, auteur de symphonies à programme, à vrai dire assez extravagantes, mais pleines de génie. Christophe, qui lui avait été présenté, quand il était enfant, gardait pour lui une tendresse secrète, en reconnaissance de l'émotion qu'il avait eue jadis. Voir un critique stupide, dont il savait l'ignorance, faire la leçon à un homme de cette taille, le rappeler à l'ordre et aux principes, le mit hors de lui:
—«L'ordre! L'ordre!—s'écria-t-il—vous ne connaissez pas d'autre ordre que celui de la police. Le génie ne se laisse pas mener dans les chemins battus. Il crée l'ordre, et érige sa volonté en loi.»
Après cette orgueilleuse déclaration, il saisit le malencontreux critique, et, relevant les âneries qu'il avait écrites depuis un certain temps, il lui administra une correction magistrale.
La critique tout entière sentit l'affront. Jusque-là, elle s'était tenue à l'écart du combat. Ils ne se souciaient point de risquer des rebuffades: ils connaissaient Christophe, ils savaient sa compétence, et ils savaient aussi qu'il n'était point patient. Tout au plus, certains d'entre eux avaient-ils exprimé discrètement le regret qu'un compositeur aussi bien doué se fourvoyât dans un métier, qui n'était pas le sien. Quelle que fût leur opinion (quand ils en avaient une), ils respectaient en lui leur propre privilège de pouvoir tout critiquer sans être eux-mêmes critiqués. Mais quand ils virent Christophe rompre brutalement la convention tacite qui les liait, aussitôt ils reconnurent en lui un ennemi de l'ordre public. D'un commun accord, il leur sembla révoltant qu'un jeune homme se permît de manquer de respect aux gloires nationales; et ils commencèrent contre lui une campagne acharnée. Ce ne furent pas de longs articles, des discussions suivies;—(ils ne s'aventuraient pas volontiers sur ce terrain avec un adversaire mieux armé: encore qu'un journaliste ait la faculté spéciale de pouvoir discuter, sans tenir compte des arguments de son adversaire, et même sans les avoir lus);—mais une longue expérience leur avait démontré que, le lecteur d'un journal étant toujours de l'avis de son journal, c'était affaiblir son crédit auprès de lui que faire même semblant de discuter: il fallait affirmer, ou mieux encore, nier. (La négation a une force double de l'affirmation. Conséquence directe de la loi de la pesanteur: il est plus facile de faire tomber une pierre que de la lancer en l'air.) Ils s'en tinrent donc, de préférence, à un système de petites notes perfides, ironiques, injurieuses, se répétant, chaque jour, en bonne place, avec une obstination inlassable. Elles livraient au ridicule l'insolent Christophe, sans le nommer toujours, mais en le désignant d'une façon transparente. Elles déformaient ses paroles, de manière à les rendre absurdes; elles racontaient de lui des anecdotes, dont le point de départ était vrai, parfois, mais dont le reste était un tissu de mensonges, habilement calculés pour le brouiller avec toute la ville, et, plus encore, avec la cour. Elles s'attaquaient à sa personne physique, à ses traits, à sa mise, dont elles traçaient une caricature, qui finissait par paraître ressemblante, à force d'être répétée.
Tout cela eût été indifférent aux amis de Christophe, si leur Revue n'avait aussi reçu des horions dans la bataille. À la vérité, c'était en guise d'avertissement; on ne cherchait pas à l'engager à fond dans la querelle, on visait bien plutôt à la séparer de Christophe: on s'étonnait qu'elle compromît son bon renom, et on laissait entendre que, si elle n'y avisait point, on serait contraint, quelque regret qu'on en eût, de s'en prendre également au reste de la rédaction. Un commencement d'attaques, assez anodines, contre Adolf Mai et Mannheim, mit l'émoi dans le guêpier. Mannheim ne fit qu'en rire: il pensait que cela ferait enrager son père, ses oncles, ses cousins, et son innombrable famille, qui s'arrogeaient le droit de surveiller ses faits et gestes et de s'en scandaliser. Mais Adolf Mai le prit fort au sérieux, et il reprocha a Christophe de compromettre la Revue. Christophe l'envoya promener. Les autres, n'ayant pas été atteints, trouvaient plutôt plaisant que Mai, qui pontifiait avec eux, écopât à leur place. Waldhaus en ressentit une jouissance secrète: il dit qu'il n'y avait pas de combat sans quelques têtes cassées. Naturellement, il entendait bien que ce ne serait point la sienne; il se croyait à l'abri des coups, par sa situation de famille et par ses relations; et il ne voyait pas de mal à ce que les Juifs, ses alliés, fussent un peu houspillés. Ehrenfeld et Goldenring, indemnes jusque-là, ne se fussent pas troublés de quelques attaques: ils étaient capables de répondre. Ce qui leur était plus sensible, c'était l'obstination avec laquelle Christophe s'acharnait à les mettre mal avec tous leurs amis, et surtout avec leurs amies. Aux premiers articles, ils avaient beaucoup ri et trouvé la farce bonne: ils admiraient la vigueur de Christophe à casser les carreaux; ils croyaient qu'il suffirait d'un mot pour tempérer son ardeur combative, pour détourner au moins ses coups de ceux et de celles qu'ils lui désigneraient.—Point. Christophe n'écoutait rien: il n'avait égard à aucune recommandation, et il continuait, comme un enragé. Si on le laissait faire, il n'y aurait plus moyen de vivre dans le pays. Déjà, leurs petites amies, éplorées et furieuses, étaient venues leur faire des scènes, à la Revue. Ils usèrent toute leur diplomatie à persuader Christophe d'atténuer au moins certaines appréciations: Christophe ne changea rien. Ils se fâchèrent: Christophe se fâcha, mais il ne changea rien. Waldhaus, diverti par l'émoi de ses amis, qui ne le touchait point, prit le parti de Christophe, pour les faire enrager. Peut-être était-il plus capable qu'eux d'apprécier la généreuse extravagance de Christophe, se jetant tête baissée contre tous, sans se réserver aucun chemin de retraite, aucun refuge pour l'avenir. Quant à Mannheim, il s'amusait royalement du charivari: ce lui semblait une bonne farce d'avoir introduit ce fou parmi ces gens rangés, et il se tordait de rire, aussi bien des coups que Christophe assénait, que de ceux qu'il recevait. Bien qu'il commençât à croire, sous l'influence de sa sœur, que Christophe était décidément un peu timbré, il ne l'en aimait que mieux:—(il avait besoin de trouver ridicules ceux qui lui étaient sympathiques.)—Il continua donc, avec Waldhaus, à soutenir Christophe contre les autres.
Comme il ne manquait pas de sens pratique, malgré tous ses efforts pour se donner l'illusion du contraire, il eut très justement l'idée qu'il serait avantageux à son ami d'allier sa cause avec celle du parti musical le plus avancé du pays.
Il y avait dans la ville, comme dans la plupart des villes allemandes, un Wagner-Verein, qui représentait les idées neuves contre le clan conservateur.—Et certes, on ne courait plus grand risque à défendre Wagner, quand sa gloire était partout reconnue et ses œuvres inscrites au répertoire de tous les Opéras d'Allemagne. Cependant, sa victoire était plutôt imposée par la force que consentie librement; et, au fond du cœur, la majorité restait obstinément conservatrice, surtout dans les petites villes, comme celle-ci, demeurée un peu à l'écart des grands courants modernes et fière d'un antique renom. Plus que partout ailleurs, régnait là cette méfiance, innée au peuple allemand, contre toute nouveauté, cette paresse à sentir quelque chose de vrai et de fort qui n'eût pas été ruminé déjà par plusieurs générations. On s'en apercevait, à la mauvaise grâce avec laquelle étaient accueillies,—sinon les œuvres de Wagner, qu'on n'osait plus discuter,—toutes les œuvres nouvelles inspirées de l'esprit wagnérien. Aussi, les Wagner-Vereine auraient-ils eu une tâche utile à remplir, s'ils avaient pris à cœur de défendre les forces jeunes et originales de l'art. Ils le firent parfois, et Bruckner, ou Hugo Wolf, trouvèrent en certains d'entre eux leurs meilleurs alliés. Mais trop souvent l'égoïsme du maître pesait sur ses disciples; et, de même que Bayreuth ne servait qu'à la glorification monstrueuse d'un seul, les filiales de Bayreuth étaient de petites églises, où l'on disait éternellement la messe en l'honneur du seul Dieu. Tout au plus, admettait-on dans les chapelles latérales les disciples fidèles, qui appliquaient à la lettre les doctrines sacrées, et adoraient, la face dans la poussière, la Divinité unique, aux multiples visages: musique, poésie, drame et métaphysique.
C'était précisément le cas du Wagner-Verein de la ville.—Cependant, il y mettait des formes; il cherchait volontiers à enrôler les jeunes gens de talent, qui semblaient pouvoir lui être utiles; et, depuis longtemps, il guettait Christophe. Il lui avait fait faire discrètement des avances, auxquelles Christophe n'avait pas pris garde, parce qu'il n'éprouvait aucunement le besoin de s'associer avec qui que ce fût; il ne comprenait pas quelle nécessité poussait ses compatriotes à se grouper toujours en troupeaux, comme s'ils ne pouvaient rien faire seuls: ni chanter, ni se promener, ni boire. Il avait l'aversion de tout Vereinswesen. Mais, à tout prendre, il était mieux disposé pour un Wagner-Verein que pour les autres Vereine: c'était au moins un prétexte à de beaux concerts; et bien qu'il ne partageât pas toutes les idées des Wagnériens sur l'art, il en était plus près que des autres groupements musicaux. Il pouvait, semblait-il, trouver un terrain d'entente avec un parti, qui se montrait aussi injuste que lui pour Brahms et les «Brahmines». Il se laissa donc présenter. Mannheim fut l'intermédiaire: il connaissait tout le monde. Sans être musicien, il faisait partie du Wagner-Verein.—Le comité de direction avait suivi la campagne que Christophe menait dans la Revue. Certaines exécutions qu'il avait faites dans le camp opposé lui paraissaient témoigner d'une poigne vigoureuse, qu'il serait bon d'avoir à son service. Christophe avait bien aussi décoché quelques pointes irrespectueuses contre l'idole sainte; mais on avait préféré fermer les yeux là-dessus;—et, peut-être, ces premières attaques, assez inoffensives, n'avaient-elles pas été étrangères, sans que l'on en convînt, à la hâte que l'on avait d'accaparer Christophe, avant qu'il eût le temps de se prononcer davantage. On vint très aimablement lui demander la permission d'exécuter quelques-unes de ses mélodies à un des prochains concerts de l'Association. Christophe, flatté, accepta: il vint au Wagner-Verein; et, poussé par Mannheim, il s'y laissa inscrire.
À la tête du Wagner-Verein étaient alors deux hommes, dont l'un jouissait d'une notoriété comme écrivain, et l'autre comme chef d'orchestre. Tous deux avaient en Wagner une foi mahométane. Le premier, Josias Kling, avait fait un Dictionnaire de Wagner,—Wagner-Lexikon,—permettant de savoir, à la minute, la pensée du maître de omni re scibili: ç'avait été la grande œuvre de sa vie. Il eût été capable d'en réciter des chapitres entiers à table, comme les bourgeois de province française récitaient des chants de la Pucelle. Il publiait aussi dans les Bayreuther Blätter des articles sur Wagner et l'esprit Aryen. Il va de soi que Wagner était pour lui le type du pur Aryen, dont la race allemande était restée le refuge inviolable contre les influences corruptrices du Sémitisme latin, et spécialement français. Il proclamait la défaite définitive de l'impur esprit gaulois. Il n'en continuait pas moins, chaque jour, âprement le combat, comme si l'éternel ennemi était toujours menaçant. Il ne reconnaissait qu'un seul grand homme en France: le comte de Gobineau. Kling était un petit vieillard, tout petit, très poli, et rougissant comme une demoiselle.—L'autre pilier du Wagner-Verein, Erich Lauber, avait été directeur d'une fabrique de produits chimiques, jusqu'à quarante ans; puis il avait tout planté là, pour se faire chef d'orchestre. Il y était parvenu à force de volonté, et parce qu'il était très riche. Il était un fanatique de Bayreuth: on contait qu'il s'y était rendu à pied, de Munich, en sandales de pèlerin. Chose curieuse que cet homme qui avait beaucoup lu, beaucoup voyagé, fait différents métiers, et montré partout une personnalité énergique, fût devenu en musique un mouton de Panurge; toute son originalité s'était dépensée là à être un peu plus stupide que les autres. Trop peu sur de lui-même en musique pour se fier à son sentiment personnel, il suivait servilement les interprétations que donnaient de Wagner les Kapellmeister et les artistes patentés par Bayreuth. Il eût voulu faire reproduire jusqu'aux moindres détails de la mise en scène et des costumes multicolores, qui ravissaient le goût puéril et barbare de la petite cour de Wahnfried. Il était de l'espèce de ce fanatique de Michel-Ange, qui reproduisait dans ses copies jusqu'aux moisissures, qui, s'étant introduites dans l'œuvre sacrée, étaient devenues, de ce fait, elles-mêmes sacrées.
Christophe ne devait pas goûter beaucoup ces deux personnages. Mais ils étaient hommes du monde, affables, assez instruits; et la conversation de Lauber ne laissait pas d'être intéressante, quand on le mettait sur un autre sujet que la musique. C'était d'ailleurs un braque: et les braques ne déplaisaient pas trop à Christophe: ils le changeaient de l'assommante banalité des gens raisonnables. Il ne savait pas encore que rien n'est plus assommant qu'un homme qui déraisonne, et que l'originalité est encore plus rare chez ceux qu'on nomme, bien à tort, des «originaux», que dans le reste du troupeau. Car ces «originaux» sont de simples maniaques, dont la pensée est réduite à des mouvements d'horlogerie.
Josias Kling et Lauber, désireux de gagner Christophe, se montrèrent d'abord pleins d'égards pour lui. Kling lui consacra un article élogieux, et Lauber s'appliqua à suivre toutes ses indications pour ses œuvres qu'il dirigea à un concert de la Société. Christophe en fut touché. Malheureusement, l'effet de ces prévenances lui fut gâté par l'inintelligence de ceux qui les lui faisaient. Il n'avait pas la faculté de s'illusionner sur les gens, parce qu'ils l'admiraient. Il était exigeant. Il avait la prétention qu'on ne l'admirât point pour le contraire de ce qu'il était; et il n'était pas loin de regarder comme des ennemis ceux qui étaient ses amis, par erreur. Aussi, il ne sut aucun gré à Kling de voir en lui un disciple de Wagner, et de chercher des rapprochements entre des phrases de ses Lieder et des passages de la Tétralogie, qui n'avaient rien de commun que certaines notes de la gamme. Et il n'eut aucun plaisir à entendre une de ses œuvres encastrée—côte à côte avec un pastiche sans valeur d'un scholar wagnérien—entre deux blocs énormes de l'éternel Richard.
Il ne tarda pas à étouffer dans cette petite chapelle. C'était un autre Conservatoire, aussi étroit que les vieux Conservatoires, et plus intolérant, parce qu'il était nouveau venu dans l'art. Christophe commença à perdre ses illusions sur la valeur absolue d'une forme d'art ou de pensée. Jusque-là, il avait cru que les grandes idées portent partout avec elles leur lumière. Il s'apercevait à présent que les idées avaient beau changer, les hommes restaient les mêmes; et, en définitive, rien ne comptait que les hommes: les idées étaient ce qu'ils étaient. S'ils étaient nés médiocres et serviles, le génie même se faisait médiocre, en passant par leurs âmes, et le cri d'affranchissement du héros brisant ses fers devenait le contrat de servitude des générations à venir.—Christophe ne put se tenir d'exprimer ses sentiments. Il dauba sur le fétichisme en art. Il déclarait qu'il ne fallait plus d'idoles, plus de classiques, d'aucune sorte, et que seul avait le droit de s'appeler l'héritier de l'esprit de Wagner celui qui était capable de fouler aux pieds Wagner pour marcher droit devant lui, en regardant toujours en avant et jamais en arrière,—celui qui avait le courage de laisser mourir ce qui doit mourir, et de se maintenir en communion ardente avec la vie. La sottise de Kling rendait Christophe agressif. Il releva les fautes ou les ridicules qu'il trouvait chez Wagner. Les Wagnériens ne manquèrent pas de lui attribuer une jalousie grotesque à l'égard de leur dieu. Christophe, de son côté, ne doutait point que ces mêmes gens qui exaltaient Wagner depuis qu'il était mort, n'eussent été des premiers à l'étrangler quand il était vivant:—en quoi il leur faisait tort. Un Kling et un Lauber avaient eu, eux aussi, leur heure d'illumination; ils avaient été de l'avant, il y avait quelque vingt ans; puis, comme la plupart, ils avaient campé là. L'homme a si peu de force qu'à la première montée il s'arrête époumonné; bien peu ont assez de souffle pour continuer leur route.
L'attitude de Christophe lui aliéna promptement ses nouveaux amis. Leur sympathie était un marché: pour qu'ils fussent avec lui, il fallait qu'il fût avec eux; et il était trop évident que Christophe ne céderait rien de lui-même: il ne se laissait pas enrôler. On lui battit froid. Les éloges qu'il se refusait à décerner aux dieux et petits dieux, estampillés par le clan, lui furent refusés. On montra moins d'empressement à accueillir ses œuvres; et certains commencèrent à protester de voir son nom trop souvent sur les programmes. On se moquait de lui derrière son dos, et la critique allait son train; Kling et Lauber, en laissant dire, semblaient s'y associer. On se fût bien gardé pourtant de rompre avec Christophe: d'abord parce que les cerveaux rhénans se plaisent aux solutions mixtes, aux solutions qui n'en sont point et qui ont le privilège de prolonger indéfiniment une situation ambiguë; ensuite parce qu'on espérait bien, malgré tout, finir par faire de lui ce qu'on voulait, sinon par persuasion, du moins par lassitude.
Christophe ne leur en laissa pas le temps. Quand il croyait sentir qu'un homme avait de l'antipathie pour lui, mais n'en voulait pas convenir et cherchait à se faire illusion, afin de rester en bons termes avec lui, il n'avait pas de cesse qu'il n'eût réussi à lui prouver qu'il était son ennemi. Après une soirée au Wagner-Verein, où il s'était heurté à un mur d'hostilité hypocrite, il envoya à Lauber sa démission sans phrases. Lauber n'y comprit rien; et Mannheim accourut chez Christophe, pour tâcher de tout arranger. Dès les premiers mots, Christophe éclata:
—Non, non, non, et non! Ne me parle plus de ces êtres. Je ne veux plus les voir... Je ne peux plus, je ne peux plus... J'ai un dégoût effroyable des hommes; il m'est presque impossible d'en regarder un en face.
Mannheim riait de tout son cœur. Il pensait moins à calmer l'exaltation de Christophe qu'à s'en donner le spectacle:
—Je sais bien qu'ils ne sont pas beaux, dit-il; mais ce n'est pas d'aujourd'hui: que s'est-il donc passé de nouveau?
—Rien du tout. C'est moi qui en ai assez... Oui, ris, moque-toi de moi: c'est entendu, je suis fou. Les gens prudents agissent d'après les lois de la saine raison. Je ne suis pas ainsi; je suis un homme qui agit d'après ses impulsions. Quand une certaine quantité d'électricité s'est accumulée en moi, il faut qu'elle se décharge, coûte que coûte; et tant pis pour les autres, s'il leur en cuit! Et tant pis pour moi! Je ne suis pas fait pour vivre en société. Désormais, je ne veux plus appartenir qu'à moi.
—Tu n'as pourtant pas la prétention de te passer de tout le monde? dit Mannheim. Tu ne peux pas faire jouer ta musique, à toi tout seul. Tu as besoin de chanteurs, de chanteuses, d'un orchestre, d'un chef d'orchestre, d'un public, d'une claque...
Christophe criait:
—Non! non! non!...
Mais le dernier mot le fit bondir:
—Une claque! Tu n'as pas honte?
—Ne parlons pas de claque payée—(quoique ce soit, à vrai dire, le seul moyen qu'on ait encore trouvé pour révéler au public le mérite d'une œuvre).—Mais il faut toujours une claque, une petite coterie dûment stylée; chaque auteur a la sienne: c'est à cela que les amis sont bons.
—Je ne veux pas d'amis!
—Alors, tu seras sifflé.
—Je veux être sifflé!
Mannheim était aux anges.
—Tu n'auras même pas ce plaisir longtemps. On ne te jouera pas.
—Et bien, soit! Crois-tu donc que je tienne à devenir un homme célèbre?... Oui, j'étais en train de tendre à toute force vers ce but... Non-sens! Folie! Imbécillité!... Comme si la satisfaction de l'orgueil le plus vulgaire était une compensation aux sacrifices de toute sorte—ennuis, souffrances, infamies, avanies, avilissement, ignobles concessions—qui sont le prix de la gloire! Que dix mille diables m'emportent, si de semblables soucis me travaillent encore le cerveau! Plus rien de tout cela! Je ne veux rien avoir à faire avec le public et la publicité. La publicité est une infâme canaille. Je veux être un homme privé, et vivre pour moi et pour ceux que j'aime...
—C'est cela, dit Mannheim, ironique. Il faut prendre un métier. Pourquoi ne ferais-tu pas aussi des souliers?
—Ah! si j'étais un savetier comme l'incomparable Sachs! s'écria Christophe. Comme ma vie s'arrangerait joyeusement! Savetier, les jours de la semaine,—musicien, le dimanche, et seulement dans l'intimité, pour ma joie et pour celle d'une paire d'amis! Ce serait une existence!...—Suis-je un fou, pour sacrifier mon temps et ma peine au magnifique plaisir d'être en proie aux jugements des imbéciles? Est-ce qu'il n'est pas beaucoup mieux et plus beau d'être aimé et compris de quelques braves gens, qu'entendu, critiquaillé, ou flagorné par des milliers d'idiots?... Le diable de l'orgueil et du désir de la gloire ne me prendra plus aux cheveux: tu peux t'en fier à moi!
—Assurément, dit Mannheim.
Il pensait:
—Dans une heure, il dira le contraire.
Il conclut tranquillement:
—Alors, n'est-ce pas, j'arrange les choses avec le Wagner-Verein?
Christophe leva les bras:
—C'est bien la peine que je m'époumonne, depuis une heure, à te crier le contraire!... Je te dis que je n'y remettrai plus jamais les pieds! J'ai en horreur tous ces Wagner-Vereine, tous ces Vereine, tous ces parcs à moutons, qui ont besoin de se serrer les uns contre les autres, afin de bêler ensemble. Va leur dire de ma part à ces moutons: je suis un loup, j'ai des dents, je ne suis pas fait pour paître!
—C'est bon, c'est bon, on leur dira, fit Mannheim, s'en allant, enchanté de sa matinée. Il pensait:
—Il est fou, fou à lier...
Sa sœur, à qui il s'empressa de raconter l'entretien, haussa les épaules, et dit:
—Fou? Il voudrait bien le faire croire!... Il est stupide, et d'un orgueil ridicule...
Cependant, Christophe continuait sa campagne enragée dans la revue de Waldhaus. Ce n'était pas qu'il y trouvât plaisir: la critique l'assommait, et il était sur le point d'envoyer tout au diable. Mais il s'entêtait, parce qu'on s'évertuait à lui fermer la bouche: il ne voulait pas avoir l'air de céder.
Waldhaus commençait à s'inquiéter. Aussi longtemps qu'il était resté indemne au milieu des coups, il avait assisté à la mêlée avec le flegme d'un dieu de l'Olympe. Mais, depuis quelques semaines, les autres journaux semblaient perdre conscience du caractère inviolable de sa personne; ils s'étaient mis à l'attaquer dans son amour-propre d'auteur, avec une rare méchanceté, où Waldhaus eût pu reconnaître, s'il avait été plus fin, la griffe d'un ami. C'était en effet à l'instigation sournoise de Ehrenfeld et de Goldenring que ces attaques avaient lieu: ils ne voyaient plus que ce moyen pour le décider à mettre fin aux polémiques de Christophe. Ils voyaient juste. Waldhaus, sur-le-champ, déclara que Christophe commençait à l'agacer; et il cessa de le soutenir. Toute la Revue s'ingénia dès lors à le faire taire. Mais allez donc museler un chien en train de dévorer sa proie! Tout ce qu'on lui disait ne faisait que l'exciter davantage. Il les appelait capons, et il déclarait qu'il dirait tout—tout ce qu'il avait le devoir de dire. S'ils voulaient le mettre à la porte, libre à eux! Toute la ville saurait qu'ils étaient aussi couards que les autres; mais lui, ne s'en irait pas, de lui-même.
Ils se regardaient, consternés, reprochant aigrement à Mannheim le cadeau qu'il leur avait fait, en leur amenant ce fou. Mannheim, toujours riant, se fit fort de mater Christophe; et il paria que, dès son prochain article, Christophe mettrait de l'eau dans son vin. Ils restèrent incrédules; mais l'événement prouva que Mannheim ne s'était pas trop vanté. L'article suivant de Christophe, sans être un modèle de courtoisie, ne contenait plus aucune remarque désobligeante pour qui que ce fût. Le moyen de Mannheim était bien simple; tous s'étonnèrent ensuite de n'y avoir pas songé plus tôt: Christophe ne relisait jamais ce qu'il écrivait dans la Revue; et c'est à peine s'il lisait les épreuves de ses articles, très vite et fort mal. Adolf Mai lui avait fait plus d'une fois des observations aigres-douces à ce sujet: il disait qu'une faute d'impression déshonore une Revue; et Christophe, qui ne regardait pas la critique comme un art, répondait que celui dont il disait du mal le comprendrait toujours assez. Mannheim profita de l'occasion: il dit que Christophe avait raison, que la correction d'épreuves était un métier de prote; et il offrit de l'en décharger. Christophe fut près de se confondre en remerciements; mais tous lui assurèrent, d'un commun accord, que cet arrangement leur rendait service, en évitant à la Revue une perte de temps. Christophe abandonna donc ses épreuves à Mannheim, en le priant de les bien corriger. Mannheim n'y manqua point: ce fut un jeu pour lui. D'abord, il ne se risqua prudemment qu'à atténuer quelques termes, à laisser tomber çà et là quelques épithètes malgracieuses. Enhardi par le succès, il poussa plus loin ses expériences: il commença à remanier les phrases et le sens; il déployait à cet exercice une réelle virtuosité. Tout l'art consistait, en conservant le gros de la phrase et son allure caractéristique, à lui faire dire exactement le contraire de ce que Christophe avait voulu. Mannheim se donnait plus de mal pour défigurer les articles de Christophe qu'il n'en aurait eu à en écrire lui-même; jamais il n'avait tant travaillé, de sa vie. Mais il jouissait du résultat: certains musiciens, que Christophe poursuivait de ses sarcasmes, étaient stupéfaits de le voir s'adoucir peu à peu et finir par célébrer leurs louanges. La Revue était dans la joie. Mannheim lui donnait lecture de ses élucubrations. C'étaient des éclats de rire. Ehrenfeld et Goldenring disaient parfois à Mannheim:
—Attention! tu vas trop loin!
—Il n'y a pas de danger, répondait Mannheim.
Et il continuait de plus belle.
Christophe ne s'apercevait de rien. Il venait à la Revue, déposait sa copie et ne s'en inquiétait plus. Quelquefois, il lui arrivait de prendre Mannheim à part:
—Cette fois, je leur ai dit leur fait, à ces canailles. Lis un peu...
Mannheim lisait.
—Eh bien, qu'est-ce que tu en penses?
—Terrible! mon cher, il n'en reste plus rien!
—Qu'est-ce que tu crois qu'ils diront?
—Ah! ce sera un beau vacarme!
Mais il n'y avait pas de vacarme du tout. Au contraire, les visages s'éclairaient autour de Christophe; des gens qu'il exécrait le saluaient dans la rue. Une fois, il arriva à la Revue, inquiet et renfrogné; et, jetant sur la table une carte de visite, il demanda:
—Qu'est-ce que cela veut dire?
C'était la carte d'un musicien qu'il venait d'éreinter: «Avec tous ses remerciements.»
Mannheim répondit, en riant:
—Il fait de l'ironie.
Christophe fut soulagé:
—Ouf! dit-il, j'avais peur que mon article ne lui eût fait plaisir.
—Il est furieux, dit Ehrenfeld; mais il ne veut pas en avoir l'air: il fait l'homme supérieur, il raille.
—Il raille?... Cochon! fit Christophe, de nouveau indigné. Je vais lui faire un autre article. Rira bien qui rira le dernier!
—Non, non, dit Waldhaus, inquiet. Je ne crois point qu'il se moque. C'est de l'humilité, il est bon chrétien: on le frappe sur une joue, il tend l'autre.
—Encore mieux! dit Christophe. Ah! le lâche! Il la veut, il aura sa fessée!
Waldhaus voulait s'interposer. Mais les autres riaient.
—Laisse donc... disait Mannheim.
—Après tout... faisait Waldhaus, subitement rassuré. Un peu plus, un peu moins!...
Christophe s'en allait. Les compères se livraient à des gambades et des rires de démence. Quand ils étaient un peu apaisés, Waldhaus disait à Mannheim:
—Tout de même, il s'en est fallu de peu... Fais attention, je te prie. Tu vas nous faire pincer.
—Bah! disait Mannheim. Nous avons encore de beaux jours... Et puis, je lui fais des amis.
Christophe en était là de ses expériences pour réformer l'art allemand, quand vint à passer dans la ville une troupe de comédiens français. Il serait plus juste de dire: un troupeau; car, suivant l'habitude, c'était un ramassis de pauvres diables, pêchés on ne savait où, et de jeunes acteurs inconnus, trop heureux de se laisser exploiter, pourvu qu'on les fît jouer. Tous ensemble étaient attelés au chariot d'une comédienne illustre et antique. Elle faisait une tournée en Allemagne, et, de passage dans la petite capitale, y venait donner trois représentations.
À la Revue de Waldhaus, on en faisait grand bruit. Mannheim et ses amis étaient au courant de la vie littéraire et mondaine de Paris, ou ils prétendaient l'être; ils s'en répétaient les potins, cueillis dans les journaux des boulevards, et plus ou moins bien compris: ils représentaient l'esprit français en Allemagne. C'était enlever à Christophe le désir de le connaître davantage. Mannheim l'assommait avec ses éloges de Paris. Il y était allé plusieurs fois; il avait là une partie de sa famille:—il avait de la famille dans tous les pays d'Europe; et, partout, elle avait pris la nationalité et les dignités du pays; cette tribu d'Abraham comptait un baronnet anglais, un sénateur de Belgique, un ministre français, un député au Reichstag, et un comte du pape; et tous, bien qu'unis et respectueux de la souche commune dont ils étaient sortis, étaient sincèrement Anglais, Belges, Français, Allemands, ou papalins: car leur orgueil ne doutait point que le pays qu'ils avaient adopté ne fût le premier de tous. Mannheim était le seul, par paradoxe, qui s'amusât à préférer tous les pays dont il n'était point. Il parlait donc souvent de Paris, avec enthousiasme; mais, pour faire l'éloge des Parisiens, il les représentait comme des espèces de toqués, paillards et braillards, qui passaient leur temps à faire la noce et des révolutions, sans jamais se prendre au sérieux; aussi, Christophe était-il peu attiré par «la byzantine et décadente république d'outre-Vosges». De bonne foi, il imaginait un peu Paris, comme le représentait une gravure naïve, en tête d'un livre récemment publié dans une collection d'art allemande: au premier plan, le Diable de Notre-Dame, accroupi au-dessus des toits de la ville, avec cette légende:
«Insatiable vampire l'éternelle Luxure
Sur la grande Cité convoite sa pâture.»
En bon Allemand, il avait le mépris des Velches débauchés et de leur littérature, dont il ne connaissait guère que quelques bouffonneries égrillardes, l'Aiglon, Madame Sans-Gêne, et des chansons de café-concert. Le snobisme de la petite ville, où les gens le plus notoirement incapables de s'intéresser à l'art s'empressèrent bruyamment de s'inscrire au bureau de location, le jeta dans une affectation d'indifférence dédaigneuse pour la grande cabotine. Il protesta qu'il ne ferait pas un pas pour aller l'entendre. Il lui était d'autant plus facile de tenir sa promesse que les places étaient h un prix excessif, qu'il n'avait pas les moyens de payer.
Le répertoire que la troupe française transportait en Allemagne, comprenait deux ou trois pièces classiques; mais il était composé, en majeure partie, de ces niaiseries, qui sont par excellence l'article parisien pour l'exportation: car rien n'est plus international que la médiocrité. Christophe connaissait la Tosca, qui devait être le premier spectacle de la comédienne en tournées; il l'avait entendue en traduction, parée des grâces légères que peut donner une troupe de petit théâtre rhénan à une œuvre française; et il se disait bien aise, avec un rire goguenard, en voyant ses amis partir pour le théâtre, de n'être pas forcé d'aller la réentendre. Il n'en suivit pas moins, le lendemain, d'une oreille attentive, les récits enthousiastes qu'ils firent de la soirée: il enrageait de s'être enlevé jusqu'au droit de contredire, en ayant refusé de voir ce dont tout le monde parlait.
Le second spectacle annoncé devait être une traduction française d'Hamlet. Christophe n'avait jamais négligé une occasion de voir une pièce de Shakespeare. Shakespeare était pour lui, au même titre que Beethoven, une source inépuisable de vie. Hamlet lui avait été particulièrement cher dans la période de troubles et de doutes tumultueux qu'il venait de traverser. Malgré la crainte de se revoir dans ce miroir magique, il était fasciné; et il tournait autour des affiches du théâtre, sans s'avouer qu'il brûlait d'envie d'aller prendre une place. Mais il était si entêté qu'après ce qu'il avait dit à ses amis, il n'en voulait pas démordre; et il fût resté chez lui, ce soir-là, comme le précédent, si, au moment où il rentrait, le hasard ne l'avait mis en présence de Mannheim.
Mannheim l'attrapa par le bras, et lui raconta d'un air furieux, mais sans cesser de gouailler, qu'une vieille bête de parente, une sœur de son père, venait de tomber inopinément chez eux avec toute sa smala, et qu'ils étaient forcés de rester à la maison, pour les recevoir. Il avait essayé de s'esquiver; mais son père n'entendait pas raillerie sur les questions d'étiquette familiale et d'égards que l'on doit aux ancêtres; et comme il devait ménager son père, en ce moment, à cause d'une carotte qu'il se proposait de lui tirer, il avait fallu céder, et renoncer à la représentation.
—Vous aviez vos billets? demanda Christophe.
—Parbleu! une loge excellente; et, pour comble, il faut que je l'aille porter—(et j'y vais, de ce pas)—à ce crétin de Grünebaum, l'associé de papa, pour qu'il s'y pavane avec la femme Grünebaum et leur dinde de fille. C'est gai!... Je cherche au moins quelque chose à leur dire de très désagréable. Mais cela leur est bien égal, pourvu que je leur apporte des billets,—quoiqu'ils aimeraient encore mieux que ces billets fussent de banque.
Il s'arrêta brusquement, la bouche ouverte, regardant Christophe:
—Oh!... Mais voilà... Voilà ce qu'il me faut!...
Il gloussa:
—Christophe, tu vas au théâtre?
—Non.
—Si fait. Tu vas au théâtre. C'est un service que je te demande. Tu ne peux pas refuser.
Christophe ne comprenait pas.
—Mais je n'ai pas de place.
—En voilà! fit Mannheim, triomphant, en lui fourrant de force le billet dans la main.
—Tu es fou, dit Christophe. Et la commission de ton père?
Mannheim se tordait:
—Il sera dans une colère! fit-il.
Il s'essuya les yeux, et conclut:
—Je le taperai demain matin, au saut du lit, avant qu'il sache encore rien.
—Je ne peux pas accepter, dit Christophe, sachant que cela lui serait désagréable.
—Tu n'as rien à savoir, tu ne sais rien, cela ne te regarde pas.
Christophe avait déplié le billet:
—Et que veux-tu que je fasse d'une loge de quatre places?
—Tout ce que tu voudras. Tu dormiras au fond, tu danseras, si tu veux. Amènes-y des femmes. Tu en as bien quelques-unes? On peut t'en prêter.
Christophe tendit le billet à Mannheim:
—Non, décidément. Reprends-le.
—Jamais de la vie, fit Mannheim, reculant de quelques pas. Je ne peux pas te forcer à y aller, si cela t'ennuie; mais je ne le reprendrai pas. Tu es libre de le jeter au feu, ou même, homme vertueux, de le porter aux Grünebaum. Cela ne me regarde plus. Bonsoir!
Il se sauva, plantant là Christophe, au milieu de la rue, son billet à la main.
Christophe était embarrassé. Il se disait bien qu'il serait convenable de porter les places aux Grünebaum; mais cette idée ne l'enthousiasmait point. Il rentra, indécis; et, quand il s'avisa de regarder l'heure, il vit qu'il n'avait plus que le temps de s'habiller pour aller au théâtre. Il eût été tout de même trop sot de laisser perdre le billet. Il proposa à sa mère de l'emmener. Mais Louisa déclara qu'elle aimait bien mieux aller se coucher. Il partit. Au fond, il avait un plaisir d'enfant. Une seule chose l'ennuyait: d'avoir ce plaisir, seul. Il n'éprouvait aucun remords, à l'égard du père Mannheim, ou des Grünebaum, dont il prenait la loge; mais il en avait vis-à-vis de ceux qui auraient pu la partager avec lui. Il pensait combien cela aurait fait de joie à des jeunes gens, comme lui; et il lui était pénible de ne pas la leur faire. Il cherchait dans sa tête, il ne voyait pas à qui offrir son billet. D'ailleurs, il était tard, il fallait se hâter.
Comme il entrait au théâtre, il passa près du guichet fermé, où un écriteau marquait qu'il ne restait plus une seule place au bureau. Parmi les gens qui s'en retournaient, dépités, il remarqua une jeune fille, qui ne pouvait se décider à sortir et regardait ceux qui entraient, d'un air d'envie. Elle était mise très simplement, en noir, pas très grande, la figure amincie, l'air délicat; et il ne remarqua pas si elle était laide ou jolie. Il avait passé devant elle; il s'arrêta un moment, se retourna, et sans prendre le temps de réfléchir:
—Vous n'avez pas trouvé de place, mademoiselle? demanda-t-il, à brûle-pourpoint.
Elle rougit, et dit, avec un accent étranger:
—Non, monsieur.
—J'ai une loge, dont je ne sais que faire. Voulez-vous en profiter avec moi?
Elle rougit plus fort, et remercia, en s'excusant de ne pouvoir accepter. Christophe, gêné par son refus, s'excusa de son côté et essaya d'insister; mais il ne réussit pas à la persuader, bien qu'il fût évident qu'elle en mourait d'envie. Il était perplexe. Il se décida brusquement.
—Écoutez, il y a un moyen de tout arranger, dit-il: prenez le billet. Moi, je n'y tiens pas, j'ai déjà vu cela.—(Il se vantait.)—Cela vous fera plus plaisir qu'à moi. Prenez, c'est de bon cœur.
La jeune fille fut si touchée de l'offre et de la façon cordiale que les larmes lui en montèrent presque aux yeux. Elle balbutia, avec reconnaissance, que jamais elle ne voudrait l'en priver.
—Eh bien, alors, venez, dit-il en souriant.
Il avait l'air si bon et si franc qu'elle se sentit honteuse de lui avoir refusé; et elle dit, un peu confuse:
—Je viens .. Merci.
Ils entrèrent. La loge des Mannheim était une loge de face, largement ouverte: impossible de s'y dissimuler. Leur entrée ne passa pas inaperçue. Christophe fit placer la jeune fille au premier rang, et resta un peu en arrière, pour ne pas la gêner. Elle se tenait droite, raide, n'osant tourner la tête, horriblement intimidée; elle eût donné beaucoup pour ne pas avoir accepté. Afin de lui laisser le temps de se remettre, et ne sachant de quoi causer, Christophe affectait de regarder d'un autre côté. Où qu'il regardât, il lui était facile de constater que sa présence, avec cette compagne inconnue, au milieu de la brillante clientèle des loges, excitait la curiosité et les commentaires de la petite ville. Il lança à droite et à gauche des regards furieux; il rageait qu'on s'obstinât à s'occuper de lui, quand il ne s'occupait pas des autres. Il ne pensait pas que cette curiosité indiscrète s'adressât à sa compagne encore plus qu'à lui, et d'une façon plus blessante. Pour montrer sa parfaite indifférence à tout ce qu'ils pourraient dire ou penser, il se pencha vers sa voisine et se mit à causer. Elle eut l'air si effarouchée de ce qu'il lui parlât, et si malheureuse d'avoir à lui répondre, elle eut tant de peine à s'arracher un: oui, ou un: non, sans oser le regarder, qu'il eut pitié de sa sauvagerie et se renfonça dans son coin. Heureusement, le spectacle commençait.
Christophe n'avait pas lu l'affiche, et il ne s'était guère soucié de savoir quel rôle jouait la grande actrice: il était de ces naïfs qui viennent au théâtre pour voir la pièce, et non pas les acteurs. Il ne s'était pas demandé si l'illustre comédienne serait Ophélie, ou la Reine; s'il se l'était demandé, il eût opiné pour la Reine, vu l'âge des deux matrones. Mais ce qui n'aurait jamais pu lui venir à l'idée, c'est qu'elle jouât Hamlet. Quand il le vit, quand il entendit ce timbre de poupée mécanique, il fut un bon moment avant d'y croire...
—Mais qui? Mais qui est-ce? se disait-il à mi-voix. Ce n'est pourtant pas...
Et quand il lui fallut constater que «c'était pourtant» Hamlet, il poussa un juron, qu'heureusement sa voisine ne comprit pas, parce qu'elle était étrangère, mais que l'on comprit parfaitement dans la loge à côté: car il lui en vint sur-le-champ l'ordre indigné de se taire. Il se retira au fond de la loge, pour pester à son aise. Il ne décolérait pas. S'il eût été juste, il eût rendu hommage à l'élégance du travesti et au tour de force de l'art, qui permettait à cette femme sexagénaire de se montrer dans le costume d'un adolescent, et même d'y paraître belle,—du moins à des yeux complaisants. Mais il haïssait les tours de force, et tout ce qui fausse la nature. Il aimait qu'une femme fût une femme, et un homme un homme. (La chose n'est pas commune, aujourd'hui.) Le travesti enfantin et un peu ridicule de la Léonore de Beethoven ne lui était déjà pas agréable. Mais celui d'Hamlet dépassait la limite permise à l'absurdité. Faire du robuste Danois, gras et blême, colérique, rusé, raisonneur, halluciné, une femme,—même pas une femme: car une femme qui joue l'homme ne sera jamais qu'un monstre,—faire d'Hamlet un eunuque, ou un louche androgyne..., il fallait toute la veulerie du temps et la niaiserie de la critique, pour que cette dégoûtante sottise pût être tolérée, un seul jour, sans sifflets!... La voix de l'actrice achevait de mettre Christophe hors de lui. Elle avait cette diction chantante et martelée, cette mélopée monotone, qui, depuis la Champmeslé, semble avoir toujours été chère au peuple le moins poétique du monde. Christophe en était si exaspéré qu'il avait envie de marcher à quatre pattes. Il avait tourné le dos à la scène, et il faisait des grimaces de colère, le nez contre le mur de la loge, comme un enfant mis au piquet. Fort heureusement, sa compagne n'osait pas regarder de son côté; car si elle l'avait vu, elle l'eût pris pour un fou.
Soudain, les grimaces de Christophe s'arrêtèrent. Il resta immobile et se tut. Une belle voix musicale, une jeune voix féminine, grave et douce, venait de se faire entendre. Christophe dressa l'oreille. À mesure qu'elle parlait, il se retournait, intrigué, sur sa chaise, pour voir l'oiseau qui avait ce ramage. Il vit Ophélie. Certes, elle n'avait rien de l'Ophélie de Shakespeare. C'était une belle fille, grande, robuste, élancée, comme une jeune statue grecque: Électre ou Cassandra. Elle débordait de vie. Malgré tous ses efforts pour s'enfermer dans son rôle, une force de jeunesse et de joie rayonnait de sa chair, de ses gestes, de ses yeux bruns qui riaient. Tel est le pouvoir d'un beau corps que Christophe, impitoyable l'instant d'avant pour l'interprétation d'Hamlet, ne songea pas un moment à regretter que l'Ophélie ne ressemblât guère à l'image qu'il s'en faisait; et il sacrifia sans remords celle-ci à celle-là. Avec l'inconsciente mauvaise foi des passionnés, il trouva même une vérité profonde à cette ardeur juvénile qui brûlait au fond de ce cœur de vierge chaste et trouble. Ce qui achevait le charme, c'était la magie de la voix, pure, chaude et veloutée: chaque mot sonnait comme un bel accord; autour des syllabes dansait, comme une odeur de thym ou de menthe sauvage, l'accent riant du Midi, aux rythmes rebondissants. Étrange vision d'une Ophélie du pays d'Arles! Elle apportait avec elle un peu de son soleil d'or et de son mistral fou.
Oubliant sa voisine, Christophe s'était assis à côté d'elle, sur le devant de la loge; et il ne quittait pas des yeux la belle actrice, dont il ignorait le nom. Mais le public, qui ne venait point pour entendre une inconnue, ne lui prêtait aucune attention; et il ne se décidait à applaudir que quand l'Hamlet femelle parlait. Ce qui faisait que Christophe grondait, et les appelait: «Ânes!»—d'une voix basse qui s'entendait à dix pas.
Ce ne fut que lorsque le rideau fut tombé pour l'entr'acte, qu'il se rappela l'existence de sa compagne de loge; et, la voyant toujours intimidée, il songea en souriant qu'il avait dû l'effarer par ses extravagances.—Il ne se trompait pas: cette âme de jeune fille, que le hasard avait rapprochée de lui pour quelques heures, était d'une réserve presque maladive: il avait fallu qu'elle fût dans un état d'exaltation anormal pour oser accepter l'invitation de Christophe. Et à peine avait-elle accepté, qu'elle eût souhaité, pour tout au monde, de pouvoir se dégager, trouver un prétexte, s'enfuir. C'avait été bien pis, quand elle s'était vue l'objet de la curiosité générale; et son malaise n'avait fait que croître à mesure qu'elle entendait derrière son dos—(elle n'osait se retourner)—les sourdes imprécations et les grognements de son compagnon. Elle s'attendait à tout de sa part; et, quand il vint s'asseoir à côté d'elle, elle fut glacée d'effroi: quelle excentricité n'allait-il pas encore faire? Elle eût voulu être à cent pieds sous terre. Elle se reculait instinctivement; elle avait peur de l'effleurer.
Mais toutes ses craintes tombèrent, lorsque, l'entr'acte venu, elle l'entendit lui dire avec bonhomie:
—Je suis un voisin bien désagréable, n'est-ce pas? Je vous demande pardon.
Alors elle le regarda, et elle lui vit son bon sourire, qui l'avait tout à l'heure décidée à venir.
Il continua:
—Je ne sais pas cacher ce que je pense... Mais aussi, c'était trop fort!... Cette femme, cette vieille femme!...
Il fit de nouveau une grimace de dégoût.
Elle sourit, et dit tout bas:
—Malgré tout, c'est beau.
Il remarqua son accent, et demanda:
—Vous êtes étrangère?
—Oui, fit-elle.
Il regarda sa modeste petite robe:
—Institutrice? dit-il.
Elle rougit, et dit:
—Oui.
—Quel pays?
Elle dit:
—Je suis Française.
Il fit un geste d'étonnement:
—Française? Je ne l'aurais jamais cru.
—Pourquoi? demanda-t-elle timidement.
—Vous êtes si... sérieuse! dit-il.
(Elle pensa que ce n'était pas tout à fait un compliment dans sa bouche.)
—Il y en a aussi comme cela en France, dit-elle, toute confuse.
Il regardait son honnête petite figure, au front bombé, au petit nez droit, au menton fin, ses joues maigres qu'encadraient ses cheveux châtains. Il ne la voyait pas: il pensait à la belle actrice. Il répéta:
—C'est curieux que vous soyez Française!... Vraiment, vous êtes du même pays qu'Ophélie? On ne le croirait jamais.
Il ajouta, après un instant de silence:
—Comme elle est belle!
Sans s'apercevoir qu'il avait l'air d'établir entre elle et sa voisine une comparaison désobligeante pour celle-ci. Elle la sentit très bien; mais elle n'en voulut pas à Christophe: car elle pensait comme lui. Il essaya d'avoir d'elle quelques détails sur l'actrice; mais elle ne savait rien: on voyait qu'elle était très peu au courant des choses de théâtre.
—Cela doit vous faire plaisir d'entendre parler français? demanda-t-il.
Il croyait plaisanter: il avait touché juste.
—Ah! fit-elle avec un accent de sincérité qui le frappa, cela me fait tant de bien! J'étouffe ici.
Il la regarda mieux, cette fois: elle crispait légèrement les mains et semblait oppressée. Mais aussitôt, elle songea à ce qu'il pouvait y avoir de blessant pour lui dans cette parole:
—Oh! pardon, dit-elle, je ne sais pas ce que je dis.
Il rit franchement:
—Ne vous excusez donc pas! Vous avez joliment raison. Il n'y a pas besoin d'être Français pour étouffer ici. Ouf!
Il leva les épaules, en aspirant l'air.
Mais elle avait honte de s'être ainsi livrée, et elle se tut désormais. D'ailleurs, elle venait de s'apercevoir que, des loges voisines, on épiait leur conversation; et il le remarqua aussi avec colère. Ils s'interrompirent donc; et, en attendant la fin de l'entr'acte, il sortit dans le couloir du théâtre. Les paroles de la jeune fille résonnaient à son oreille; mais il était distrait: l'image d'Ophélie occupait sa pensée. Elle acheva de s'emparer de lui, dans les actes suivants; et lorsque la belle actrice arriva à la scène de la folie, aux mélancoliques chansons d'amour et de mort, sa voix sut y trouver des accents si touchants qu'il en fut bouleversé; il sentit qu'il allait se mettre à pleurer comme un veau. Furieux contre lui-même de ce qui lui semblait une marque de faiblesse—(car il n'admettait point qu'un vrai artiste pleurât),—et ne voulant pas se donner en spectacle, il sortit brusquement de la loge. Les couloirs, le foyer, étaient vides. Dans son agitation, il descendit les escaliers du théâtre et sortit, sans s'en apercevoir. Il avait besoin de respirer l'air frais de la nuit, de marcher à grands pas dans les rues sombres et à demi désertes. Il se retrouva au bord d'un canal, accoudé sur le parapet de la berge, et contemplant l'eau silencieuse, où dansaient dans l'ombre les reflets des réverbères. Son âme était pareille: obscure et trépidante; il n'y pouvait rien voir qu'une grande joie qui dansait à la surface. Les horloges tintèrent. Il lui eût été impossible de retourner au théâtre et d'entendre la fin de la pièce. Voir le triomphe de Fortinbras? Non, cela ne le tentait pas... Beau triomphe! Qui pense à envier le vainqueur? Qui voudrait être lui, après qu'on est gorgé de toutes les sauvageries de la vie féroce et ridicule? L'œuvre est un réquisitoire formidable contre la vie. Mais une telle puissance de vie bout en elle que la tristesse devient joie; et l'amertume enivre...
Christophe revint chez lui, sans plus se soucier de la jeune fille inconnue, qu'il avait laissée dans sa loge, et dont il ne savait même pas le nom.
Le lendemain matin, il alla voir l'actrice, dans l'hôtellerie de troisième ordre où l'impresario l'avait reléguée avec ses camarades, tandis que la grande comédienne était descendue au premier hôtel de la ville. On le fit entrer dans un petit salon mal tenu, où les restes du déjeuner traînaient sur un piano ouvert, avec des épingles à cheveux et des feuilles de musique déchirées et malpropres. Dans la chambre à côté, Ophélie chantait à tue-tête, comme un enfant, pour Le plaisir de faire du bruit. Elle s'interrompit un instant, quand on lui annonça la visite et demanda d'une voix joyeuse qui ne prenait nul souci de n'être pas entendue de l'autre côté du mur:
—Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Comment est-ce qu'il se nomme?... Christophe... Christophe quoi?... Christophe Krafft?... Quel nom!
(Elle le répéta deux ou trois fois, en faisant terriblement rouler les r.)
—On dirait un juron...
(Elle en dit un.)
—Est-ce qu'il est jeune ou vieux?... Gentil?...—C'est bon, j'y vais.
Elle se remit à chanter:
«Rien n'est plus doux que mon amour...»
en furetant à travers la chambre, et pestant contre une épingle d'écaille qui se faisait chercher au milieu du fouillis. Elle s'impatienta, elle se mit à gronder, elle fit le lion. Bien qu'il ne la vît pas, Christophe suivait par la pensée tous ses gestes derrière le mur, et il riait tout seul. Enfin, il entendit les pas se rapprocher, la porte s'ouvrit impétueusement; et Ophélie parut.
Elle était à demi vêtue, dans un peignoir qu'elle serrait autour de sa taille, les bras nus dans les larges manches, les cheveux mal peignés, des boucles tombant sur les yeux et les joues. Ses beaux yeux bruns riaient, sa bouche riait, ses joues riaient, une aimable fossette riait au milieu de son menton. De sa belle voix grave et chantante, elle s'excusa à peine de se montrer ainsi. Elle savait qu'il n'y avait pas de quoi s'excuser, et qu'il ne pouvait lui en être que très reconnaissant. Elle croyait qu'il était un journaliste, qui venait l'interviewer. Au lieu d'être déçue, quand il dit qu'il venait uniquement pour son compte et parce qu'il l'admirait, elle en fut ravie. Elle était bonne fille, affectueuse, enchantée de plaire, et ne cherchait pas à le cacher: la visite de Christophe et son enthousiasme la rendaient heureuse:—(elle n'était pas encore gâtée par les compliments).—Elle était si naturelle dans tous ses mouvements et dans toutes ses façons, même dans ses petites vanités et dans le plaisir naïf qu'elle avait à plaire, qu'il n'éprouva pas le moindre instant de gêne. Ils furent tout de suite de vieux amis. Il baragouinait un peu de français, elle baragouinait quelques mots d'allemand; au bout d'une heure, ils se racontaient tous leurs secrets. Elle ne pensait aucunement à le renvoyer. Cette Méridionale robuste et gaie, intelligente et expansive, qui eût crevé d'ennui, au milieu de ses stupides compagnons et d'un pays dont elle ne savait pas la langue, sans la joie naturelle qui était en elle, était contente de trouver à qui parler. Quant à Christophe, c'était un bien inexprimable pour lui de rencontrer, dans sa ville de petits bourgeois étriqués et peu sincères, cette libre fille du Midi, pleine de sève populaire. Il ne savait pas encore le factice de ces natures, qui, à la différence de ses Allemands, n'ont rien de plus dans le cœur que ce qu'elles montrent,—et souvent, ne l'ont pas. Au moins, elle était jeune, elle vivait, elle disait franchement, crûment, ce qu'elle pensait; elle jugeait tout, librement, d'un regard frais et neuf; on respirait en elle un peu de son mistral balayeur de brouillards. Elle était bien douée: sans culture et sans réflexion, elle sentait sur-le-champ, et de tout son cœur, jusqu'à en être sincèrement émue, les choses qui étaient belles et bonnes; et puis, l'instant d'après, elle riait aux éclats. Certes, elle était coquette, elle jouait des prunelles; il ne lui déplaisait point de montrer sa gorge nue, sous le peignoir entr'ouvert: elle eût aimé tourner la tête à Christophe; mais c'était pur instinct. Nul calcul, elle aimait encore mieux rire, causer gaiement, être bon camarade, bon garçon, sans gêne et sans façons. Elle lui raconta les dessous de la vie de théâtre, ses petites misères, les susceptibilités niaises de ses camarades, les tracasseries de Jézabel,—(elle appelait ainsi la grande comédienne)—qui était attentive à ne pas la laisser briller. Il lui confia ses doléances sur les Allemands: elle battit des mains et fit chorus avec lui. Elle était bonne, d'ailleurs, et ne voulait dire du mal de personne; mais cela ne l'empêchait pas d'en dire; et, tout en s'accusant de malignité, quand elle plaisantait quelqu'un, elle avait ce don d'observation réaliste et bouffonne, propre aux gens du Midi: elle n'y pouvait résister, et faisait des portraits à l'emporte-pièce. Elle riait joyeusement de ses lèvres pâles, qui découvraient ses dents de jeune chien; et ses yeux cernés brillaient dans sa figure un peu blême, que le fard avait décolorée.
Ils s'aperçurent tout à coup qu'il y avait plus d'une heure qu'ils causaient. Christophe proposa à Corinne—(c'était son nom de théâtre)—de venir la reprendre dans l'après-midi, pour la piloter à travers la ville. Elle fut enchantée de l'idée; et ils se donnèrent rendez-vous, aussitôt après le dîner.
À l'heure dite, il fut là. Corinne était assise dans le petit salon de l'hôtel et tenait un cahier, qu'elle lisait tout haut. Elle l'accueillit avec ses yeux riants, sans s'interrompre de lire, jusqu'à ce qu'elle eût fini sa phrase. Puis, elle lui fit signe de s'asseoir sur le canapé, auprès d'elle:
—Mettez-vous là, et ne causez pas, dit-elle, je repasse mon rôle. J'en ai pour un quart d'heure.
Elle suivait sur le manuscrit, du bout de l'ongle, en lisant très vite et au hasard, comme une petite fille pressée. Il s'offrit à lui faire réciter sa leçon. Elle lui donna le cahier, et se leva pour répéter. Elle ânonnait, ou recommençait quatre fois une fin de phrase, avant de se lancer dans la phrase suivante. Elle secouait la tête en récitant son rôle; ses épingles à cheveux tombaient, tout le long de la chambre. Quand un mot obstiné refusait d'entrer dans sa mémoire, elle avait des impatiences d'enfant mal élevée: il lui échappait un juron drôlatique, ou même d'assez gros mots,—un très gros et très court, dont elle s'apostrophait elle-même.—Christophe était surpris de son mélange de talent et d'enfantillage. Elle trouvait des intonations justes et émouvantes; mais, au beau milieu de la tirade où elle semblait mettre tout son cœur, il lui arrivait de dire des mots qui n'avaient aucun sens. Elle récitait sa leçon, comme un petit perroquet, sans s'inquiéter de ce que cela signifiait: et c'étaient alors des coq-à-l'âne burlesques. Elle ne s'en affectait point; quand elle s'en apercevait, elle riait à se tordre. À la fin, elle dit: «Zut!», elle lui arracha le cahier des mains, le lança à la volée dans un coin de la chambre, et dit:
—Vacances! L'heure est sonnée!... Allons nous promener!
Un peu inquiet au sujet de son rôle, il demanda, par scrupule:
—Vous croyez que vous saurez?
Elle répondit avec assurance:
—Bien sûr. Et le souffleur, pour quoi est-ce qu'il serait fait alors?
Elle passa dans sa chambre, pour mettre son chapeau. Christophe, en l'attendant, s'assit devant le piano et tapota quelques suites d'accords. De l'autre pièce, elle cria:
—Oh! qu'est-ce que c'est que cela? Jouez encore! Que c'est joli!
Elle accourut, en se piquant son chapeau sur la tête. Il continua. Quand il eut fini, elle voulut qu'il continuât encore. Elle s'extasiait, avec ces petites exclamations mièvres et menues, dont les Françaises sont coutumières et qu'elles prodiguent aussi bien à propos de Tristan que d'une tasse de chocolat. Christophe riait: cela le changeait des exclamations énormes et emphatiques de ses Allemands. Deux exagérations contraires: l'une tendait à faire d'un bibelot une montagne, l'autre faisait d'une montagne un bibelot; celle-ci n'était pas moins ridicule que celle-là; mais elle lui semblait, pour l'instant, plus aimable, parce qu'il aimait la bouche d'où elle sortait.—Corinne voulut savoir de qui était ce qu'il jouait; et quand elle sut que c'était de lui, elle poussa des cris. Il lui avait bien dit, dans leur conversation du matin, qu'il était compositeur; mais elle n'y avait fait aucune attention. Elle s'assit auprès de lui et exigea qu'il jouât tout ce qu'il avait composé. La promenade fut oubliée. Ce n'était pas simple politesse de sa part: elle adorait la musique, et elle avait un instinct admirable, qui suppléait à l'insuffisance de son instruction. D'abord, il ne la prit pas au sérieux, et lui joua ses mélodies les plus faciles. Mais quand, par hasard, ayant été amené à jouer une page à laquelle il tenait davantage, il vit, sans qu'il lui en eût rien dit, que c'était celle aussi qu'elle préférait, il eut une joyeuse surprise. Avec le naïf étonnement des Allemands, quand ils rencontrent un Français qui est bon musicien, il lui dit:
—C'est curieux. Comme vous avez le goût bon! Je n'aurais jamais cru...
Corinne lui rit au nez.
Il s'amusa dès lors à faire choix d'œuvres de plus en plus difficiles à comprendre, pour voir jusqu'où elle le suivrait. Mais elle ne semblait pas déroutée par les hardiesses expressives; et, après une mélodie particulièrement neuve, dont Christophe avait presque fini par douter, parce qu'il n'avait jamais réussi à la faire goûter en Allemagne, quel fut son étonnement, quand Corinne le supplia de recommencer, et, se levant, se mit à chanter les notes, de mémoire, sans presque se tromper! Il se retourna vers elle et lui saisit les mains, avec effusion:
—Mais vous êtes musicienne! cria-t-il.
Elle se mit à rire, et expliqua qu'elle avait débuté comme chanteuse dans un Opéra de province, mais qu'un impresario en tournées avait reconnu ses dispositions pour le théâtre poétique et l'avait poussée de ce côté. Il s'exclamait:
—Quel dommage!
—Pourquoi? fit-elle. La poésie est aussi une musique. Elle se fit expliquer le sens de ses Lieder; il lui disait les mots allemands, et elle les répétait avec une facilité simiesque, copiant jusqu'aux plissements de sa bouche et de ses yeux. Quand il s'agissait ensuite de chanter de mémoire, elle faisait des erreurs bouffonnes; et, quand elle ne savait plus, elle inventait des mots, aux sonorités gutturales et barbares, qui les faisaient rire tous deux. Elle ne se lassait pas de le faire jouer, ni lui de jouer pour elle et d'entendre sa jolie voix, qui ne connaissait pas les roueries du métier et chantait un peu de la gorge, à la façon d'une petite fille, mais qui avait un je ne sais quoi de fragile et de touchant. Elle disait franchement ce qu'elle pensait. Bien qu'elle ne sût pas expliquer pourquoi elle aimait ou n'aimait pas, il y avait toujours dans ses jugements une raison cachée. Chose curieuse, c'était dans les pages les plus classiques et les plus appréciées en Allemagne qu'elle se trouvait le moins à l'aise: elle faisait quelques compliments, par politesse; mais on voyait que cela ne lui disait rien. Comme elle n'avait pas de culture musicale, elle n'avait pas ce plaisir, que procure inconsciemment aux amateurs et même aux artistes le déjà entendu, et qui leur fait reproduire à leur insu, ou aimer dans une œuvre nouvelle, des formes ou des formules qu'ils ont aimées déjà dans des œuvres anciennes. Elle n'avait pas non plus le goût allemand pour la sentimentalité mélodieuse; (ou, du moins, sa sentimentalité était autre: il n'en connaissait pas encore les défauts); elle ne s'extasiait point sur les passages d'une fadeur un peu molle, qu'on préférait en Allemagne; elle n'apprécia point le plus médiocre de ses Lieder,—une mélodie qu'il eût voulu pouvoir détruire, parce que ses amis ne lui parlaient que de cela, trop heureux de pouvoir le complimenter pour quelque chose. L'instinct dramatique de Corinne lui faisait préférer les mélodies qui retraçaient avec franchise une passion précise: c'était aussi à celles-là qu'il attachait le plus de prix. Toutefois, elle manifestait son peu de sympathie pour certaines rudesses d'harmonies qui semblaient naturelles à Christophe: elle éprouvait un heurt; elle s'arrêtait devant, et demandait «si vraiment c'était comme ça». Quand il disait que oui, alors elle se décidait à sauter le pas difficile; mais ensuite, elle faisait une petite grimace de la bouche, qui n'échappait point à Christophe. Souvent, elle aimait mieux passer la mesure. Alors, il la refaisait au piano.
—Vous n'aimez pas cela? demandait-il.
Elle fronçait le nez.
—C'est faux, disait-elle.
—Non pas, faisait-il en riant, c'est vrai. Réfléchissez à ce qu'il dit. Est-ce que ce n'est pas juste, ici?
(Il montrait son cœur.)
Mais elle secouait la tête:
—Peut-être bien; mais c'est faux, là.
(Elle se tirait l'oreille.)
Elle se montrait aussi choquée par les grands sauts de voix de la déclamation allemande:
—Pourquoi est-ce qu'il parle si fort? demandait-elle. Il est tout seul. Est ce qu'il ne craint pas que ses voisins ne l'entendent? Il a l'air... (Pardon! vous ne vous fâcherez pas?)... il a l'air de héler un bateau.
Il ne se lâchait pas; il riait de bon cœur, et reconnaissait qu'il y avait là du vrai. Ces observations l'amusaient; personne ne les lui avait encore faites. Ils convinrent que la déclamation chantée déforme le plus souvent la parole naturelle, à la façon d'un verre grossissant. Corinne demanda à Christophe d'écrire pour elle la musique d'une pièce, où elle parlerait sur l'accompagnement de l'orchestre, avec quelques phrases chantées de temps en temps. Il s'enflamma pour cette idée, malgré les difficultés de réalisation scénique, que la voix musicale de Corinne lui semblait propre à surmonter; et ils firent des projets pour l'avenir.
Il n'était pas loin de cinq heures, quand ils pensèrent à sortir. À cette saison, la nuit tombait tôt. Il ne pouvait plus être question de se promener. Le soir, Corinne avait répétition au théâtre; personne n'y pouvait assister. Elle lui fit promettre de revenir la prendre dans l'après-midi du lendemain, pour faire la promenade projetée.
Le lendemain, la même scène faillit se renouveler. Il trouva Corinne devant son miroir, juchée sur un haut tabouret, les jambes pendantes: elle essayait une perruque. Il y avait là son habilleuse et un coiffeur à qui elle faisait des recommandations au sujet d'une boucle qu'elle voulait plus relevée. Tout en se regardant dans la glace, elle y regardait Christophe, qui souriait derrière son dos: elle lui tira la langue. Le coiffeur partit avec la perruque, et elle se retourna gaiement vers Christophe:
—Bonjour, ami! dit-elle.
Elle lui tendait la joue, pour qu'il l'embrassât. Il ne s'attendait pas à être si intime; mais il n'eut garde de n'en pas profiter. Elle n'attachait pas tant d'importance à cette faveur: c'était pour elle un bonjour comme un autre.
—Oh! je suis contente! dit-elle, ça ira, ça ira, ce soir.—(Elle parlait de sa perruque.)—J'étais si désolée! Si vous étiez venu, ce matin, vous m'auriez trouvée malheureuse comme les pierres.
Il demanda pourquoi.
C'était parce que le coiffeur parisien s'était trompé dans ses emballages, et qu'il lui avait mis une perruque qui ne convenait pas au rôle.
—Toute plate, disait-elle, et tombant tout droit, bêtement. Quand j'ai vu cela, j'ai pleuré, pleuré comme une Madeleine. N'est-ce pas, madame Désirée?
—Quand je suis entrée, dit celle-ci, Madame m'a fait peur. Madame était toute blanche. Madame était comme morte.
Christophe rit. Corinne le vit dans la glace:
—Cela vous fait rire, sans cœur? dit-elle, indignée.
Elle rit aussi.
Il lui demanda comment avait été la répétition de la veille.—Tout avait très bien marché. Elle eût voulu seulement qu'on fît plus de coupures dans les rôles des autres, et qu'on n'en fît pas dans le sien... Ils causèrent si bien qu'une partie de l'après-midi y passa. Elle s'habilla, longuement; elle s'amusait à demander l'avis de Christophe sur ses toilettes. Christophe loua son élégance, et lui dit naïvement, dans son jargon franco-allemand, qu'il n'avait jamais vu personne d'aussi «luxurieux».—Elle le regarda d'abord, interloquée, puis poussa de grands éclats de rire.
—Qu'est-ce que j'ai dit? demanda-t-il. Ce n'est pas comme cela qu'il faut dire?
—Si! Si! cria-t-elle, en se tordant de rire. C'est justement cela.
Ils sortirent enfin. Sa toilette tapageuse et sa parole exubérante attiraient l'attention. Elle regardait tout avec ses yeux de Française railleuse, et ne se préoccupait pas de cacher ses impressions. Elle pouffait devant les étalages de modes, ou devant les magasins de cartes postales illustrées, où l'on voyait pêle-mêle des scènes sentimentales, des scènes bouffes et grivoises, les cocottes de la ville, la famille impériale, l'empereur en habit rouge, l'empereur en habit vert, l'empereur en loup de mer, tenant le gouvernail du navire Germania et défiant le ciel. Elle s'esclaffait devant un service de table orné de la tête revêche de Wagner, ou devant une devanture de coiffeur où trônait une tête d'homme en cire. Elle manifestait une hilarité peu décente devant le monument patriotique, qui représentait le vieil empereur, en pardessus de voyage et casque à pointe, en compagnie de la Prusse, des États allemands, et du génie de la Guerre tout nu. Elle happait au passage tout ce qui, dans la physionomie des gens, leur démarche, ou leur façon de parler, prêtait à la raillerie. Ses victimes ne pouvaient s'y tromper, au coup d'œil malicieux qui cueillait leurs ridicules. Son instinct simiesque lui faisait même parfois, sans qu'elle y réfléchît, imiter des lèvres et du nez leurs grimaces épanouies ou renfrognées; elle gonflait les joues pour répéter des fragments de phrases ou de mots, qu'elle avait saisis au vol, et dont la sonorité lui paraissait burlesque. Il en riait de tout son cœur, nullement gêné par ses impertinences; car il ne se gênait pas davantage. Heureusement, sa réputation n'avait plus grand'chose à perdre; car une telle promenade était faite pour la couler à jamais.
Ils visitèrent la cathédrale. Corinne voulut grimper jusqu'au faîte de la flèche, malgré ses talons hauts et sa robe trop longue, qui balayait les marches et finit par se prendre à un angle de l'escalier; elle ne s'en émut pas, tira bravement sur l'étoffe qui craqua, et continua de grimper, en se retroussant gaillardement. Peu s'en fallut qu'elle ne sonnât les cloches. Du haut des tours, elle déclama du Victor Hugo, auquel il ne comprit rien, et chanta une chanson populaire française. Après quoi, elle fit le muezzin.—Le crépuscule tombait. Ils redescendirent dans l'église, d'où l'ombre épaisse montait le long des murs gigantesques, au front desquels luisaient les prunelles magiques des vitraux. Christophe vit, agenouillée dans une des chapelles latérales, la jeune fille qui avait été sa compagne délogé, à la représentation d'Hamlet. Elle était si absorbée dans sa prière qu'elle ne le vit point; elle avait une expression douloureuse et tendue, qui le frappa. Il eût voulu lui dire quelques mots, la saluer au moins; mais Corinne l'entraîna dans son tourbillon.
Ils se quittèrent peu après. Elle devait se préparer pour la représentation, qui commençait de bonne heure, suivant l'usage d'Allemagne. Il venait à peine de rentrer, qu'on sonnait à sa porte, pour lui remettre ce billet de Corinne:
«Veine! Jézabel malade! Relâche! Vive la classe!... Ami! Venez! Ferons la dînette ensemble!
«Amie!
«Corinette.
«P.-S.—Portez beaucoup de musique!...»
Il eut quelque peine à comprendre. Quand il eut compris, il fut aussi content que Corinne, et se rendit aussitôt à l'hôtel. Il craignait, de trouver toute la troupe réunie au dîner; mais il ne vit personne. Corinne même avait disparu. À la fin, il entendit sa voix bruyante et riante, tout au fond de la maison; il se mit à sa recherche, et parvint à la découvrir dans la cuisine. Elle s'était mis en tête d'exécuter un plat de sa façon, un de ces plats méridionaux, dont l'arome indiscret remplit tout un quartier et réveillerait les pierres. Elle était au mieux avec la grosse patronne de l'hôtel, et elles baragouinaient ensemble un jargon effroyable, mêlé d'allemand, de français et de nègre, qui n'avait de nom en aucune langue. Elles riaient aux éclats, en se faisant goûter mutuellement leurs œuvres. L'apparition de Christophe augmenta le tapage. On voulut le mettre à la porte; mais il se défendit, et il réussit à goûter aussi du fameux plat. Il fit un peu la grimace: sur quoi elle le traita de barbare Teuton, et dit que ce n'était pas la peine de se donner du mal pour lui.
Ils remontèrent ensemble au petit salon, où la table était prête: il n'y avait que son couvert et celui de Corinne. Il ne put s'empêcher de demander où étaient les camarades. Corinne eut un geste indifférent:
—Je ne sais pas.
—Vous ne soupez pas ensemble?
—Jamais! C'est déjà bien assez de se voir au théâtre!... Ah bien! s'il fallait encore se retrouver à table!...
Cela était si différent des habitudes allemandes qu'il en fut étonné et charmé:
—Je croyais, dit-il, que vous étiez un peuple sociable!
—Eh bien, fit-elle, est-ce que je ne suis pas sociable?
—Sociable, cela veut dire: vivre en Société. Il faut nous voir, nous autres! Hommes, femmes, enfants, chacun fait partie de Sociétés, du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Tout se fait en Société: on mange, on chante, on pense avec la Société. Quand la Société éternue, on éternue avec elle; on ne boit pas une chope, sans boire avec la Société.
—Ce doit être gai, dit-elle. Pourquoi pas dans le même verre?
—N'est-ce pas fraternel?
—Zut pour la fraternité! Je veux bien être «frère» de ceux qui me plaisent; je ne le suis pas des autres... Pouah! Ce n'est pas une société, cela, c'est une fourmilière!
—Jugez donc comme je dois être à mon aise ici, moi qui pense comme vous!
—Venez chez nous alors!
Il ne demandait pas mieux. Il l'interrogea sur Paris et sur les Français. Elle lui donna des renseignements, qui n'étaient pas d'une exactitude parfaite. À sa hâblerie de Méridionale se joignait le désir instinctif d'éblouir son interlocuteur. À l'en croire, à Paris, tout le monde était libre; et comme tout le monde, à Paris, était intelligent, chacun usait de la liberté, personne n'en abusait; chacun faisait ce qui lui plaisait, pensait, croyait, aimait ou n'aimait point ce qu'il voulait: personne n'avait rien à y redire. Ce n'était point là qu'on pouvait voir les gens se mêler des croyances des autres, espionner les consciences, régenter les pensées. Ce n'était point là que les hommes politiques s'immisçaient aux affaires des lettres et des arts, et distribuaient les croix, les places, et l'argent à leurs amis et à leurs clients. Ce n'était point là que des cénacles disposaient de la réputation et du succès, que les journalistes s'achetaient, que les hommes de lettres se cassaient des encensoirs sur la tête, quand ils ne pouvaient pas se casser la tête avec. Ce n'était point là que la critique étouffait les talents inconnus, et s'épuisait en adulations devant les talents reconnus. Ce n'était point là que le succès, le succès à tout prix justifiait tous les moyens et commandait l'adoration publique. Des mœurs douces, affectueuses, obligeantes. Nulle aigreur dans les rapports. Jamais de médisance. Chacun venait en aide aux autres. Tout nouveau venu de valeur était sûr de voir les mains tendues vers lui, la route aplanie sous ses pas. Le pur amour du beau remplissait ces âmes de Français chevaleresques et désintéressés; et leur seul ridicule était leur idéalisme, qui, malgré leur esprit bien connu, faisait d'eux la dupe des autres peuples.
Christophe écoutait, bouche bée; et il y avait bien de quoi s'émerveiller. Corinne s'émerveillait elle-même, en s'écoutant parler. Elle en avait oublié ce qu'elle avait dit à Christophe, le jour d'avant, sur les difficultés de sa vie passée; et il n'y songeait pas plus qu'elle.
Cependant, Corinne n'était pas uniquement préoccupée de faire aimer sa patrie aux Allemands: elle ne tenait pas moins à se faire aimer elle-même. Toute une soirée sans flirt lui eût paru austère et un peu ridicule. Elle n'épargnait pas les agaceries à Christophe; mais c'était peine perdue: il ne s'en apercevait pas. Christophe ne savait pas ce que c'était que flirter. Il aimait, ou n'aimait point. Lorsqu'il n'aimait point, il était à mille lieues de songer à l'amour. Il avait une vive amitié pour Corinne, il subissait l'attrait de cette nature méridionale si nouvelle pour lui, de sa bonne grâce, de sa belle humeur, de son intelligence vive et libre: c'étaient là sans doute plus de raisons qu'il n'en fallait pour aimer; mais «l'esprit souffle où il veut»; il ne soufflait point là; et, quant à jouer l'amour, en l'absence de l'amour, c'était là une idée qui ne lui serait jamais venue.
Corinne s'amusait de sa froideur. Assise auprès de lui, devant le piano, tandis qu'il jouait les morceaux qu'il avait apportés, elle avait passé son bras nu autour du cou de Christophe, et pour suivre la musique, elle se penchait vers le clavier, appuyant presque sa joue contre celle de son ami. Il sentait le frôlement de ses cils et voyait, tout contre lui, le coin de sa prunelle moqueuse, son aimable museau, et le petit duvet de sa lèvre retroussée, qui, souriante, attendait.—Elle attendit. Christophe ne comprit pas l'invite; Corinne le gênait pour jouer: c'était tout ce qu'il pensait. Machinalement, il se dégagea et écarta sa chaise. Comme, un moment après, il se retournait vers Corinne pour lui parler, il vit qu'elle mourait d'envie de rire; la fossette de sa joue riait; elle serrait les lèvres et semblait se tenir à quatre pour ne pas éclater.
—Qu'est-ce que vous avez? dit-il, étonné.
Elle le regarda, et partit d'un bruyant éclat de rire.
Il n'y comprenait rien:
—Pourquoi riez-vous? demandait-il, est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle?
Plus il insistait, plus elle riait. Quand elle était près de finir, il suffisait qu'elle jetât un regard sur son air ahuri, pour qu'elle repartît de plus belle. Elle se leva, courut vers le canapé à l'autre bout de la chambre, et s'enfonça la figure dans les coussins, pour rire à son aise: son corps riait tout entier. Il fut gagné par son rire, il vint vers elle, et lui donna de petites tapes dans le dos. Quand elle eut ri tout son soûl, elle releva la tête, essuya ses yeux qui pleuraient, et lui tendit les deux mains.
—Quel bon garçon vous faites! dit-elle.
—Pas plus mauvais qu'un autre.
Elle continuait d'être secouée de petits accès de rire, en lui tenant toujours les mains.
—Pas sérieuse, la Françoise? fit-elle.
(Elle prononçait: «Françouèse».)
—Vous vous moquez de moi, dit-il, avec bonne humeur.
Elle le regarda d'un air attendri, lui secoua vigoureusement les mains, et dit:
—Amis?
—Amis! fit-il, en répondant à sa poignée de main.
—Il pensera à Corinnette, quand elle ne sera plus là? Il n'en voudra pas à la Françoise de n'être pas sérieuse?
—Et elle, elle n'en voudra pas au barbare Teuton d'être si bête?
—C'est pour ça qu'on l'aime... Il viendra la voir à Paris?
—C'est promis... Et elle, elle m'écrira?
—C'est juré... Dites aussi: Je le jure.
—Je le jure.
—Non, ce n'est pas comme cela. Il faut tendre la main.
Elle imita le serment des Horaces. Elle lui fit promettre qu'il écrirait pour elle une pièce, un mélodrame, qu'on traduirait en français, et qu'elle jouerait à Paris. Elle partait, le lendemain, avec sa troupe. Il s'engagea à aller la retrouver, le surlendemain, à Francfort, où avait lieu une représentation. Ils restèrent encore quelque temps à bavarder. Elle fit cadeau à Christophe d'une photographie qui la représentait nue presque jusqu'à mi-corps. Ils se quittèrent gaiement, en s'embrassant comme frère et sœur. Et vraiment, depuis que Corinne avait vu que Christophe l'aimait bien, mais que décidément il n'était pas amoureux, elle s'était mise à l'aimer bien aussi, sans amour, en bonne camarade.
Leur sommeil n'en fut pas troublé, ni à l'un ni à l'autre. Il ne put lui dire au revoir, le lendemain; car il était pris par une répétition. Mais, le jour suivant, il s'arrangea, comme il l'avait promis, pour aller à Francfort. C'était à deux ou trois heures en chemin de fer. Corinne ne croyait guère à la promesse de Christophe; mais il l'avait prise très au sérieux; et, à l'heure de la représentation, il était là. Quand il vint, pendant l'entr'acte, frapper à la loge où elle s'habillait, elle poussa des exclamations de joyeuse surprise et se jeta à son cou. Elle lui était sincèrement reconnaissante d'être venu. Malheureusement pour Christophe, elle était beaucoup plus entourée dans cette ville de Juifs riches et intelligents, qui savaient apprécier sa beauté présente et son succès futur. À tout instant, on heurtait à la porte de la loge; et la porte s'entrebâillait pour laisser passage à de lourdes figures aux yeux vifs, qui disaient des fadeurs avec un âpre accent. Corinne naturellement coquetait avec eux; et elle gardait ensuite le même ton affecté et provocant pour causer avec Christophe, qui en était irrité. Il n'éprouvait d'ailleurs aucun plaisir de l'impudeur tranquille avec laquelle elle procédait devant lui à sa toilette; et le fard et le gras, dont elle enduisait ses bras, sa gorge et son visage, lui inspiraient un profond dégoût. Il fut sur le point de partir sans la revoir, aussitôt après la représentation; mais, quand il lui dit adieu, en s'excusant de ne pouvoir assister au souper qui devait lui être offert au sortir du spectacle, elle manifesta une peine si gentiment affectueuse que ses résolutions ne tinrent pas. Elle se fit apporter un horaire des chemins de fer, pour lui prouver qu'il pouvait—qu'il devait rester encore une bonne heure avec elle. Il ne demandait qu'à être convaincu, et il vint au souper; il sut même ne pas trop montrer son ennui des niaiseries qu'on y débita, et son irritation des agaceries que Corinne prodiguait au premier singe venu. Impossible de lui en vouloir. C'était une brave fille, sans principe moral, paresseuse, sensuelle, amoureuse du plaisir, d'une coquetterie enfantine, mais en même temps si loyale, si bonne, et dont tous les défauts étaient si spontanés et si sains qu'on ne pouvait qu'en sourire, et presque les aimer. Assis en face d'elle, tandis qu'elle parlait, Christophe regardait son visage animé, ses beaux yeux rayonnants, sa mâchoire un peu empâtée, au sourire italien,—ce sourire où il y a de la bonté, de la finesse, une lourdeur gourmande: il la voyait plus clairement qu'il n'avait fait jusque-là. Certains traits lui rappelaient Ada: des gestes, des regards, des roueries sensuelles, un peu grossières:—l'éternel féminin. Mais ce qu'il aimait en elle, c'était la nature du Midi, la généreuse mère, qui ne lésine point avec ses dons, qui ne s'amuse point à fabriquer des beautés de salon et des intelligences de livres, mais des êtres harmonieux, dont le corps et l'esprit sont faits pour s'épanouir au soleil.—Quand il partit, elle quitta la table pour lui faire ses adieux, à part des autres. Ils s'embrassèrent encore et renouvelèrent leurs promesses de s'écrire et de se revoir.
Il reprit le dernier train, pour rentrer chez lui. À une station intermédiaire, le train qui venait en sens inverse attendait. Juste dans le wagon arrêté en face du sien,—dans un compartiment de troisième, Christophe vit la jeune Française, qui était avec lui à la représentation d'Hamlet. Elle vit aussi Christophe, et elle le reconnut. Ils furent saisis. Ils se saluèrent silencieusement, et restèrent immobiles, n'osant plus se regarder. Cependant il avait vu d'un coup d'œil qu'elle avait une petite toque de voyage, et une vieille valise auprès d'elle. L'idée ne lui vint pas qu'elle quittât le pays; il pensa qu'elle partait pour quelques jours. Il ne savait s'il devait lui parler: il hésita, il prépara dans sa tête ce qu'il voulait lui dire, et il allait baisser la glace du wagon, pour lui adresser quelques mots, quand on donna le signal du départ: il renonça à parler. Quelques secondes passèrent avant que train ne bougeât. Ils se regardèrent en face. Seuls dans leur compartiment, le visage appuyé contre la vitre du wagon, à travers la nuit qui les entourait, ils plongeaient leurs regards dans les yeux l'un de l'autre. Une double fenêtre les séparait. S'ils avaient étendu le bras au dehors, leurs mains auraient pu se toucher. Si près. Si loin. Les wagons s'ébranlèrent lourdement. Elle le regardait toujours, n'ayant plus de timidité, maintenant qu'ils se quittaient. Ils étaient si absorbés dans la contemplation l'un de l'autre qu'ils ne pensèrent même plus à se saluer une dernière fois. Elle s'éloignait lentement: il la vit disparaître; et le train qui la portait s'enfonça dans la nuit. Comme deux mondes errants, ils étaient passés, un instant, l'un près de l'autre, et ils s'éloignaient dans l'espace infini, pour l'éternité peut-être.
Quand elle eut disparu, il sentit le vide que ce regard inconnu venait de creuser en lui; et il ne comprit pas pourquoi: mais le vide était là. Les paupières à demi-closes, somnolent, adossé à un angle du wagon, il sentait sur ses yeux le contact de ces yeux; et ses autres pensées se taisaient pour le mieux sentir. L'image de Corinne papillotait au dehors de son cœur, comme un insecte qui bat des ailes de l'autre côté des carreaux; mais il ne la laissait pas entrer.
Il la retrouva, au sortir du wagon, quand l'air frais de la nuit et la marche dans les rues de la ville endormie eurent secoué sa torpeur. Il souriait au souvenir de la gentille actrice, avec un mélange de plaisir et d'irritation, selon qu'il se rappelait ses manières affectueuses ou ses coquetteries vulgaires.
—Diables de Français, grommelait-il, riant tout bas, tandis qu'il se déshabillait sans bruit, pour ne pas réveiller sa mère, qui dormait à côté.
Un mot qu'il avait entendu, l'autre soir, dans la loge, lui revint à l'esprit:
—Il y en a d'autres, aussi.
Dès sa première rencontre avec la France, elle lui posait l'énigme de sa double nature. Mais, comme tous les Allemands, il ne s'inquiétait point de la résoudre; et il répétait tranquillement, en songeant à la jeune fille du wagon:
—Elle n'a pas l'air Française.
Comme s'il appartenait à un Allemand de dire ce qui est Français et ce qui ne l'est point.
Française ou non, elle le préoccupait; car, dans le milieu de la nuit, il se réveilla, avec un serrement de cœur: il venait de se rappeler la valise placée sur la banquette, auprès de la jeune fille; et brusquement, l'idée que la voyageuse était partie tout à fait lui traversa l'esprit. À vrai dire, cette idée aurait dû lui venir, dès le premier instant; mais il n'y avait pas songé. Il en ressentait une sourde tristesse. Il haussa les épaules, dans son lit:
—Qu'est-ce que cela peut bien me faire? se dit-il. Cela ne me regarde pas.
Il se rendormit.
Mais, le lendemain, la première personne qu'il rencontra en sortant fut Mannheim, qui l'appela «Blücher», et lui demanda s'il avait décidé de conquérir toute la France. Par cette gazette vivante, il apprit que l'histoire de la loge avait eu un succès qui dépassait tout ce que Mannheim en attendait:
—Tu es un grand homme, criait Mannheim. Je ne suis rien auprès de toi.
—Qu'est-ce que j'ai fait? dit Christophe.
—Tu es admirable! reprit Mannheim. Je suis jaloux de toi. Souffler la loge au nez des Grünebaum, et y inviter à leur place leur institutrice française, non, cela, c'est le bouquet, je n'aurais pas trouvé cela!
—C'était l'institutrice des Grünebaum? dit Christophe, stupéfait.
—Oui, fais semblant de ne pas savoir, fais l'innocent, je te le conseille!... Papa ne décolère plus. Les Grünebaum sont dans une rage!... Cela n'a pas été long: ils ont flanqué la petite à la porte.
—Comment! cria Christophe, ils l'ont renvoyée!... Renvoyée à cause de moi?
—Tu ne le savais pas? dit Mannheim. Elle ne te l'a pas dit?
Christophe se désolait.
—Il ne faut pas te faire de bile, mon bon, dit Mannheim, cela n'a pas d'importance. Et puis, il fallait bien s'y attendre, le jour où les Grünebaum viendraient à apprendre...
—Quoi? criait Christophe, apprendre quoi?
—Qu'elle était ta maîtresse, parbleu!
—Je ne la connais même pas, je ne sais pas qui elle est.
Mannheim eut un sourire, qui voulait dire:
—Tu me crois trop bête.
Christophe se fâcha, somma Mannheim de lui faire l'honneur de croire à ce qu'il affirmait. Mannheim dit:
—Alors c'est encore plus drôle.
Christophe s'agitait, parlait d'aller trouver les Grünebaum, de leur dire leur fait, de justifier la jeune fille. Mannheim l'en dissuada:
—Mon cher, dit-il, tout ce que tu leur diras ne fera que les convaincre davantage du contraire. Et puis, il est trop tard. La fille est loin, maintenant.
Christophe, la mort dans l'âme, tâcha de retrouver la piste de la jeune Française. Il voulait lui écrire, lui demander pardon. Mais nul ne savait rien d'elle. Les Grünebaum, à qui il s'adressa, l'envoyèrent promener; ils ignoraient où elle était allée, et ils ne s'en inquiétaient pas. L'idée du mal qu'il avait fait torturait Christophe: c'était un remords continuel. Il s'y joignait une mystérieuse attirance qui, des yeux disparus, rayonnait silencieusement sur lui. Attirance et remords parurent s'effacer, recouverts par le flot des jours et des pensées nouvelles; mais ils persistèrent obscurément au fond. Christophe n'oubliait point celle qu'il appelait sa victime. Il s'était juré de la rejoindre. Il savait combien il avait peu de chances de la revoir; et il était sûr qu'il la reverrait.
Quant à Corinne, jamais elle ne répondit aux lettres qu'il lui écrivit. Mais, trois mois plus tard, quand il n'attendait plus rien, il reçut d'elle un télégramme de quarante mots, où elle bêtifiait à cœur-joie, lui donnait de petits noms familiers, et demandait «si on s'aimait toujour». Puis, après un nouveau silence de près d'une année, vint un bout de lettre griffonnée de son énorme écriture enfantine et zigzaguante, qui cherchait à paraître grande dame,—quelques mots affectueux et drolatiques.—Et puis, elle en resta là. Elle ne l'oubliait pas; mais elle n'avait pas le temps de penser à lui.
Encore sous le charme de Corinne, et tout plein des idées qu'ils avaient échangées, Christophe rêva d'écrire de la musique pour une pièce où Corinne jouerait et chanterait quelques airs,—une sorte de mélodrame poétique. Ce genre d'art, jadis en faveur en Allemagne, passionnément goûté par Mozart, pratiqué par Beethoven, par Weber, par Mendelssohn, par Schumann, par tous les grands classiques, était tombé en discrédit depuis le triomphe du wagnérisme, qui prétendait avoir réalisé la formule définitive du théâtre et de la musique. Les braves pédants wagnériens, non contents de proscrire tout mélodrame nouveau, s'appliquaient à faire la toilette des mélodrames anciens; ils effaçaient avec soin dans les opéras toute trace des dialogues parlés, et écrivaient pour Mozart, pour Beethoven, ou pour Weber, des récitatifs de leur façon; ils étaient convaincus de compléter la pensée des maîtres, en déposant pieusement sur les chefs-d'œuvre leurs petites ordures.
Christophe, à qui les critiques de Corinne avaient rendu plus sensible la lourdeur et, souvent, la laideur de la déclamation wagnérienne, se demandait si ce n'était pas un non-sens, une œuvre contre nature, d'accoupler au théâtre et de ligoter ensemble dans le récitatif la parole et le chant: c'était comme si l'on voulait attacher au même char un cheval et un oiseau. La parole et le chant avaient chacun leurs rythmes. On pouvait comprendre qu'un artiste sacrifiât l'un des deux arts au triomphe de celui qu'il préférait. Mais chercher un compromis entre eux, c'était les sacrifier tous deux: c'était vouloir que la parole ne fût plus la parole, et que le chant ne fût plus le chant, que celui-ci laissât encaisser son large cours entre deux berges de canal monotones, que celui-là chargeât ses beaux membres nus d'étoffes riches et lourdes, qui paralysaient ses gestes et ses pas. Pourquoi ne pas leur laisser à tous deux leurs libres mouvements? Telle, une belle fille, qui va d'un pas alerte le long d'un ruisseau, et qui rêve en marchant: le murmure de l'eau berce sa rêverie; sans qu'elle en ait conscience, elle rythme ses pas sur le chant du ruisseau. Ainsi, libres toutes deux, musique et poésie s'en iraient côte à côte, en mélangeant leurs rêves.—Assurément, à cette union toute musique n'était point bonne, ni toute poésie. Les adversaires du mélodrame avaient beau jeu contre la grossièreté des essais qui en avaient été faits, et de leurs interprètes. Longtemps, Christophe avait partagé leurs répugnances: la sottise des acteurs qui se chargeaient de ces récitations parlées sur un accompagnement instrumental, sans se soucier de l'accompagnement, sans chercher à y fondre leur voix, mais tâchant au contraire qu'on n'entendît rien qu'eux, avait de quoi révolter toute oreille musicale. Mais, depuis qu'il avait goûté l'harmonieuse voix de Corinne,—cette voix liquide et pure, qui se mouvait dans la musique, comme un rayon dans l'eau, qui épousait tous les contours d'une phrase mélodique, qui était comme un chant plus fluide et plus libre,—il avait entrevu la beauté d'un art nouveau.
Peut-être avait-il raison; mais il était encore bien inexpérimenté pour se hasarder sans danger dans un genre, qui, si l'on veut qu'il soit vraiment artistique, est le plus difficile de tous. Surtout, cet art réclame une condition essentielle: la parfaite harmonie des efforts combinés du poète, du musicien et des interprètes.—Christophe ne s'en inquiétait point: il se lançait à l'étourdie dans un art inconnu, dont lui seul pressentait les lois.
Sa première idée fut de revêtir de musique une féerie de Shakespeare, ou un acte du Second Faust. Mais les théâtres se montraient peu disposés à tenter l'expérience; elle devait être coûteuse et paraissait absurde. On admettait bien la compétence de Christophe en musique; mais qu'il se permît d'avoir des idées sur le théâtre faisait sourire les gens: on ne le prenait pas au sérieux. Le monde de la musique et celui de la poésie semblaient deux États étrangers l'un à l'autre, et secrètement hostiles. Pour pénétrer dans l'État poétique, il fallut que Christophe acceptât la collaboration d'un poète; et ce poète, il ne lui fut pas permis de le choisir. Il ne se le fût pas permis lui-même: il se défiait de son goût littéraire; on lui avait persuadé qu'il n'entendait rien à la poésie; et, de fait, il n'entendait rien aux poésies qu'on admirait autour de lui. Avec son honnêteté et son opiniâtreté ordinaires, il s'était donné bien du mal, pour tâcher de sentir la beauté de tel ou tel poème; il était toujours sorti de là bredouille, et un peu honteux: non, décidément, il n'était pas poète. À la vérité, il aimait passionnément certains poètes d'autrefois; et cela le consolait un peu. Mais sans doute ne les aimait-il pas comme il fallait les aimer. N'avait-il pas, une fois, exprimé l'idée saugrenue qu'il n'est de grands poètes que ceux qui restent grands, même traduits en prose, même traduits en une prose étrangère, et que les mots n'ont de prix que par l'âme qu'ils expriment? Ses amis s'étaient moqués de lui. Mannheim le traita d'épicier. Il n'avait pas essayé de se défendre. Comme il voyait journellement, par l'exemple des littérateurs qui parlent de musique, le ridicule des artistes qui prétendent juger d'un autre art que le leur, il se résignait, (un peu incrédule au fond), à son incompétence poétique; et il acceptait, les yeux fermés, les jugements de ceux qu'il croyait mieux informés. Aussi se laissa-t-il imposer par ses amis de la Revue un grand homme de cénacle décadent, Stephan von Hellmuth, qui lui apporta une Iphigénie de sa façon. C'était alors le temps où les poètes allemands—(comme leurs confrères de France)—étaient en train de refaire les tragédies grecques. L'œuvre de Stephan von Hellmuth était une de ces étonnantes pièces gréco-allemandes, où se mêlent Ibsen, Homère, et Oscar Wilde,—sans oublier, bien entendu, quelques manuels d'archéologie. Agamemnon était neurasthénique, et Achille impuissant: ils se désolaient longuement de leur état; et naturellement, leurs plaintes n'y changeaient rien. Toute l'énergie du drame était concentrée dans le rôle d'Iphigénie,—une Iphigénie névrosée, hystérique, et pédante, qui faisait la leçon aux héros, déclamait furieusement, exposait au public son pessimisme Nietzschéen, et, ivre de mourir, s'égorgeait elle-même, avec des éclats de rire.
Rien de plus contraire à l'esprit de Christophe que cette littérature prétentieuse d'Ostrogoth dégénéré, qui se costume à la grecque. Autour de lui, on criait au chef-d'œuvre. Il fut lâche, il se laissa persuader. À vrai dire, il crevait de musique, et bien plus qu'au texte il songeait à sa musique. Le texte lui était un lit où épancher le flot de ses passions. Il était aussi loin que possible de l'état d'abnégation et d'impersonnalité intelligente, qui convient au traducteur musical d'une œuvre poétique. Il ne pensait qu'à lui, et pas du tout à l'œuvre. Il se gardait d'en convenir. D'ailleurs, il se faisait illusion: il voyait dans le poème tout autre chose que ce qui s'y trouvait. Comme lorsqu'il était enfant, il était arrivé à se bâtir dans sa tête une pièce entièrement différente de celle qu'il avait sous les yeux.
Au cours des répétitions, il aperçut l'œuvre réelle. Un jour qu'il écoutait une scène, elle lui parut si bête qu'il crut que les acteurs la défiguraient; et il eut la prétention non seulement de la leur expliquer, en présence du poète, mais de l'expliquer à celui-ci, qui prenait la défense de ses interprètes. L'auteur se rebiffa, et dit, d'un ton piqué, qu'il pensait savoir ce qu'il avait voulu écrire. Christophe n'en démordait point, et soutenait que Hellmuth n'y comprenait rien. L'hilarité générale l'avertit qu'il se rendait ridicule. Il se tut, convenant qu'après tout ce n'était pas lui qui avait écrit les vers. Alors il vit l'écrasante nullité de la pièce, et il en fut accablé; il se demandait comment il avait pu s'y tromper. Il s'appelait imbécile, et s'arrachait les cheveux. Il avait beau tâcher de se rassurer, en se répétant: «Tu n'y comprends rien: ce n'est pas ton affaire. Occupe-toi de ta musique!»—il se sentait si honteux—de la niaiserie, du pathos prétentieux, de la fausseté criante des mots, des gestes, des attitudes, que par moments, tandis qu'il conduisait l'orchestre, il n'avait plus la force de lever son bâton: il avait envie d'aller se cacher dans le trou du souffleur. Il était trop franc et trop mauvais politique pour déguiser ce qu'il pensait. Chacun s'en apercevait: ses amis, les acteurs, et l'auteur. Hellmuth lui disait, avec un sourire pincé:
—Est-ce que ceci n'a pas encore l'heur de vous plaire?
Christophe répondait bravement:
—Pour dire la vérité, non. Je ne comprends pas.
—Vous ne l'aviez donc pas lu, pour faire votre musique?
—Si, disait naïvement Christophe, mais je me trompais, je comprenais autre chose.
—C'est dommage alors que vous n'ayez pas écrit vous-même ce que vous compreniez.
—Ah! si je l'avais pu! disait Christophe.
Le poète, vexé, critiquait, pour se venger, la musique. Il se plaignait qu'elle fût encombrante, et qu'elle empêchât d'entendre les vers.
Si le poète ne comprenait pas le musicien, ni le musicien le poète, les acteurs ne comprenaient ni l'un ni l'autre, et ne s'en inquiétaient point. Ils cherchaient seulement dans leurs rôles des phrases, de place en place, où accrocher leurs effets habituels. Il n'était pas question d'adapter leur déclamation à la tonalité du morceau et au rythme musical: ils allaient d'un côté, et la musique de l'autre; on eût dit qu'ils chantaient constamment hors du ton. Christophe en grinçait des dents et s'épuisait à leur crier la note: ils le laissaient crier, et continuaient imperturbablement, ne comprenant même pas ce qu'il voulait d'eux.
Christophe eût tout lâché, si les répétitions n'avaient été avancées, et s'il n'eût été lié par la crainte d'un procès. Mannheim, à qui il fit part de son découragement, se moqua de lui:
—Qu'est-ce qu'il y a? demanda-t-il. Tout va très bien. Vous ne vous comprenez pas l'un l'autre? Eh! qu'est-ce que cela fait? Qui a jamais compris une œuvre, en dehors de l'auteur? Il a encore bien de la chance, quand il se comprend lui-même!
Christophe se tourmentait de la niaiserie du poème, qui, disait-il, ferait tomber sa musique. Mannheim ne faisait pas de difficulté pour reconnaître que le poème n'avait pas le sens commun, et que Hellmuth était «un daim»; mais il n'avait aucune inquiétude à son égard: Hellmuth donnait de bons dîners, et il avait une jolie femme: qu'est-ce qu'il faut de plus a la critique?—Christophe haussait les épaules, disant qu'il n'avait pas le temps d'écouter des balivernes.
—Mais ce ne sont pas des balivernes! disait Mannheim, en riant. Voilà bien les gens graves! Ils n'ont aucune idée de ce qui compte dans la vie.
Et il conseillait à Christophe de ne pas tant se préoccuper des affaires de Hellmuth, et de songer aux siennes. Il rengageait à faire un peu de réclame. Christophe refusait avec indignation. À un reporter, qui cherchait à l'interviewer sur sa vie, il répondait, furieux:
—Cela ne vous regarde pas!
Et quand on lui demandait sa photographie pour une Revue, il sautait de colère, en criant qu'il n'était pas, Dieu merci! le Kaiser pour étaler sa tête aux passants.—Impossible de le mettre en relations avec les salons influents. Il ne répondait pas aux invitations; et quand, par hasard, il avait été forcé d'accepter, il oubliait de s'y rendre, ou venait de si mauvaise grâce qu'il semblait avoir pris à tâche d'être désagréable à tout le monde.
Mais le comble fut qu'il se brouilla avec sa Revue, deux jours avant la représentation.
Ce qui devait arriver arriva. Mannheim avait continué sa révision des articles de Christophe; il ne se gênait plus pour biffer des lignes entières de critique et les remplacer par des compliments.
Un jour, dans un salon, Christophe se trouva en présence d'un virtuose,—un pianiste bellâtre, qu'il avait éreinté, et qui vint le remercier, en souriant de toutes ses dents blanches. Il répondit brutalement qu'il n'y avait pas de quoi. L'autre insistait, se confondant en protestations de reconnaissance. Christophe y coupa court, en lui disant que s'il était satisfait de l'article, c'était son affaire, mais que l'article n'avait certainement pas été écrit pour le satisfaire. Et il lui tourna le dos. Le virtuose le prit pour un bourru bienfaisant, et s'en alla en riant. Mais Christophe, qui se souvint d'avoir reçu, peu avant, une carte de remerciements d'une autre de ses victimes, fut brusquement traversé d'un soupçon. Il sortit, il alla acheter à un kiosque de journaux le dernier numéro de la Revue, il chercha son article, il lut... Sur le moment, il se demanda s'il devenait fou. Puis, il comprit; et, dans une rage folle, il courut aux bureaux du Dionysos.
Waldhaus et Mannheim s'y trouvaient, en conversation avec une actrice de leurs amies. Ils n'eurent pas besoin de demander à Christophe pourquoi il venait. Jetant le numéro de la Revue sur la table, Christophe, sans prendre le temps de respirer, les apostropha avec une violence inouïe, criant, les traitant de drôles, de gredins, de faussaires, et tapant le plancher à tour de bras avec une chaise. Mannheim essayait de rire. Christophe voulut lui flanquer son pied au derrière. Mannheim se réfugia derrière la table, en se tordant. Mais Waldhaus le prit de très haut. Digne et gourmé, il s'évertuait à faire entendre, au milieu du vacarme, qu'il ne permettrait pas qu'on lui parlât sur ce ton, que Christophe aurait de ses nouvelles; et il lui tendait sa carte. Christophe la lui jeta au nez:
—Faiseur d'embarras!... Je n'ai pas besoin de votre carte pour savoir qui vous êtes... Vous êtes un polisson et un faussaire!... Et vous croyez que je vais me battre avec vous?... Une correction, c'est tout ce que vous méritez!...
De la rue, on entendait sa voix. Les gens s'arrêtaient pour écouter. Mannheim ferma les fenêtres. La visiteuse, effrayée, cherchait à s'enfuir; mais Christophe bloquait la porte. Waldhaus blême et suffoqué, Mannheim bredouillant, ricanant, essayaient de répondre. Christophe ne les laissa point parler. Il déchargea sur eux tout ce qu'il put imaginer de plus blessant, et ne s'en alla que quand il fut à bout de souffle et d'injures. Waldhaus et Mannheim ne retrouvèrent la voix que quand il fut parti. Mannheim reprit vite son aplomb: les injures glissaient sur lui, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais Waldhaus restait ulcéré: sa dignité avait été outragée; et, ce qui rendait l'affront plus mortifiant, c'est qu'il avait eu des témoins: il ne pardonnerait jamais. Ses collègues firent chorus. De toute la Revue, Mannheim continua, seul, à n'en pas vouloir à Christophe: il s'était amusé de lui, tout son soûl; il ne trouvait pas que ce fût payer trop cher, au prix de quelques gros mots, la pinte de bon sang qu'il s'était faite à ses dépens. C'avait été une bonne farce: s'il en eût été l'objet, il en eût ri tout le premier. Aussi, était-il prêt à serrer la main de Christophe, comme si rien ne s'était passé. Mais Christophe était plus rancunier; il repoussa toute avance. Mannheim ne s'en affecta point: Christophe était un jouet, dont il avait tiré tout l'amusement possible; il commençait à s'enflammer pour un autre pantin. Du jour au lendemain, tout fut fini entre eux. Cela n'empêcha point Mannheim de continuer à dire, quand on parlait devant lui de Christophe, qu'ils étaient amis intimes. Et peut-être qu'il le croyait.
Deux jours après la brouille, eut lieu la première d'Iphigénie. Four complet. La Revue de Waldhaus loua le poème, et ne dit rien de la musique. Les autres journaux s'en donnèrent à cœur-joie. On rit et on siffla. La pièce fut retirée, après la troisième représentation; mais les railleries ne cessèrent point si vite. On était trop heureux de trouver cette occasion de dauber sur Christophe; et l'Iphigénie resta, pendant plusieurs semaines, un sujet d'inépuisables plaisanteries. On savait que Christophe n'avait plus d'arme pour se défendre; et l'on en profitait. La seule chose qui retînt encore un peu, c'était sa situation à la cour. Bien que ses rapports fussent devenus assez froids avec le grand-duc, qui lui avait fait, à maintes reprises, des observations dont il n'avait tenu aucun compte, il continuait de se rendre de temps en temps au château et de bénéficier, dans l'esprit du public, d'une sorte de protection officielle, plus illusoire que réelle.—Il se chargea lui-même de détruire ce dernier appui.
Il souffrait des critiques. Elles ne s'adressaient pas seulement à sa musique, mais à son idée d'une forme d'art nouvelle, qu'on ne se donnait pas la peine de comprendre: (il était plus facile de la travestir, pour la ridiculiser). Christophe n'avait pas encore la sagesse de se dire que la meilleure réponse qu'on puisse faire à des critiques de mauvaise foi, est de ne leur en faire aucune, et de continuer à créer. Il avait pris, depuis quelques mois, la mauvaise habitude de ne laisser passer aucune attaque injuste, sans y répondre. Il écrivit un article, où il n'épargnait point ses adversaires. Les deux journaux bien pensants, auxquels il le porta, le lui rendirent, en s'excusant avec une politesse ironique de ne pouvoir le publier. Christophe s'entêta. Il se souvint du journal socialiste de la ville, qui lui avait fait des avances. Il connaissait un des rédacteurs; ils discutaient parfois ensemble. Christophe avait plaisir à trouver quelqu'un qui parlât librement du pouvoir, de l'armée, des préjugés oppressifs et archaïques. Mais la conversation ne pouvait aller bien loin; car, avec le socialiste, elle revenait toujours à Karl Marx, qui était absolument indifférent à Christophe. D'ailleurs, Christophe retrouvait dans ces discours d'homme libre,—en outre d'un matérialisme qui ne lui plaisait pas beaucoup,—une rigueur pédante et un despotisme de pensée, un culte secret de la force, un militarisme à rebours, qui ne sonnaient pas très différemment de ce qu'il entendait, chaque jour, en Allemagne.
Néanmoins, ce fut à lui et à son journal qu'il songea, quand il se vit fermer la porte des autres rédactions. Il se dit bien que sa démarche ferait scandale: le journal était violent, haineux, constamment condamné; mais comme Christophe ne le lisait pas, il ne pensait qu'à la hardiesse des idées, qui ne l'effrayait point, et non à la bassesse du ton, qui lui eût répugné. Au reste, il était si enragé de voir l'entente sournoise des autres journaux afin de l'étouffer, que peut-être eût-il passé outre, même s'il avait été mieux averti. Il voulait montrer aux gens qu'on ne se débarrassait pas si facilement de lui.—Il porta donc l'article à la rédaction socialiste, où il fut reçu à bras ouverts. Le lendemain, l'article parut; et le journal annonçait, en termes emphatiques, qu'il s'était assuré le concours du jeune et talentueux maître, le camarade Krafft, dont étaient bien connues les ardentes sympathies pour les revendications de la classe ouvrière.
Christophe ne lut ni la note, ni l'article; car, ce matin-là, qui était un dimanche, il était parti avant l'aube, pour une promenade à travers champs. Il était admirablement disposé. En voyant lever le soleil, il cria, rit, iodla, sauta et dansa. Plus de Revue, plus de critiques à faire! C'était le printemps, et le retour de la musique du ciel et de la terre, la plus belle de toutes. Fini des sombres salles de concerts, étouffantes et puantes, des voisins désagréables, des virtuoses insipides! On entendait s'élever la merveilleuse chanson des forêts murmurantes; et sur les champs passaient les effluves enivrants de la Vie qui brisait l'écorce de la terre.
Il revenait de promenade, la tête bourdonnante de lumière, quand sa mère lui remit une lettre apportée du palais en son absence. La lettre, écrite sous une forme impersonnelle, avisait monsieur Krafft qu'il eût à se rendre, ce matin, au château.—Le matin était passé: il était près d'une heure. Christophe ne s'en émut guère.
—Il est trop tard maintenant, dit-il. Ce sera pour demain.
Mais sa mère s'inquiéta:
—Non, non, on ne peut pas remettre ainsi un rendez-vous de Son Altesse; il faut y aller, tout de suite. Peut-être s'agit-il d'une affaire importante.
Christophe haussa les épaules:
—Importante? Comme si ces individus pouvaient avoir quelque chose d'important à vous dire!... Il va m'exposer ses idées sur la musique. Ce sera gai!... Pourvu qu'il ne lui ait pas pris fantaisie de rivaliser avec Siegfried Meyer[1], et qu'il n'ait pas, lui aussi, à montrer un Hymne à Ægir! Je ne l'épargnerai pas. Je lui dirai: «Faites donc de la politique. Là, vous êtes le maître: vous aurez toujours raison. Mais dans l'art, prenez garde! Dans l'art, on vous voit sans casque, sans panache, sans uniforme, sans argent, sans titres, sans aïeux, sans gendarmes;... et dame! pensez un peu: qu'est-ce qui restera de vous?
La bonne Louisa, qui prenait tout au sérieux, leva les bras au ciel:
—Tu ne diras pas cela!... Tu es fou! Tu es fou!...
Il s'amusait à l'inquiéter, en abusant de sa crédulité, jusqu'à ce que la dose de l'extravagance fût si forte que Louisa finît par comprendre qu'il se moquait d'elle. Elle lui tournait le dos:
—Tu es trop bête, mon pauvre garçon!
Il l'embrassa en riant. Il était de magnifique humeur: il avait trouvé, dans sa promenade, un beau thème musical; et il le sentait s'ébattre en lui, comme un poisson dans l'eau. Il ne voulut point partir pour le château, avant d'avoir mangé: il avait un appétit d'ogre. Louisa veilla ensuite à sa toilette; car il recommençait à la tourmenter: il prétendait qu'il était bien comme il était, avec ses vêtements usés et ses souliers poudreux. Cela ne l'empêcha point d'en changer et de cirer ses chaussures, en sifflant comme un merle et en imitant tous les instruments de l'orchestre. Quand il eut fini, sa mère passa l'inspection et refit gravement son nœud de cravate. Il était très patient, par extraordinaire, parce qu'il était content de lui,—ce qui n'était pas non plus très ordinaire. Il partit, en disant qu'il allait enlever la princesse Adélaïde,—la fille du grand-duc, une assez jolie femme, mariée à un petit prince allemand, qui était venue passer quelques semaines auprès de ses parents. Elle avait témoigné jadis quelque sympathie à Christophe, quand il était enfant; et il avait un faible pour elle. Louisa prétendait qu'il en était amoureux; et, pour s'amuser, il feignait de l'être.
Il ne se pressait pas d'arriver, flânant devant les boutiques, s'arrêtant dans la rue, pour caresser un chien, qui flânait comme lui, étendu sur le flanc et bâillant au soleil. Il sauta les grilles inoffensives, qui ceignaient la place du château,—un grand carré désert, entouré de maisons, avec deux jets d'eau assoupis, deux parterres symétriques et sans ombre, séparés, comme par une raie sur le front, par une allée sablée, ratissée, bordée d'orangers en caisse; au milieu, la statue en bronze d'un grand-duc inconnu, costume Louis-Philippe, sur un socle décoré aux quatre angles par des allégories de Vertus. Sur un banc, un promeneur unique dormait sur son journal. A la grille du château, un poste de soldats inutiles dormait. Derrière les fossés pour rire de la terrasse du château, deux canons endormis bâillaient sur la ville endormie. Christophe leur rit au nez à tous.
Il entra au château sans se préoccuper de prendre une attitude officielle: tout au plus s'il cessa de chantonner; ses pensées continuaient de danser. Il jeta son chapeau sur la table du vestibule, en interpellant familièrement le vieil huissier, qu'il connaissait depuis l'enfance:—(le bonhomme était déjà là, lors de la première visite que Christophe avait faite au château avec son grand-père, le soir où il vit Hassler);—mais le vieux qui toujours répondait avec bonhomie aux boutades peu respectueuses de Christophe, prit, cette fois, un air rogue. Christophe n'y fit pas attention. Un peu plus loin, dans l'antichambre, il rencontra un employé de la chancellerie, fort bavard et prodigue avec lui, d'ordinaire, en démonstrations d'amitié; il fut surpris de la hâte que ce personnage mita passer, en esquivant un entretien. Il ne s'arrêta pas à ces impressions, et, continuant son chemin, il demanda à être introduit.
Il entra. Le dîner venait de finir. Son Altesse se tenait dans un des salons. Adossé à la cheminée, il fumait en causant avec ses hôtes, parmi lesquels Christophe distingua sa princesse, qui fumait aussi; négligemment renversée dans un fauteuil, elle parlait très haut à quelques officiers, qui faisaient cercle autour d'elle. La réunion était animée. Tous étaient fort gais; et Christophe, en entrant, entendit le rire épais du grand-duc. Mais ce rire s'arrêta net, quand le prince vit Christophe. Il poussa un grognement, et, fonçant droit sur lui:
—Ah! vous voilà, vous! cria-t-il. Vous daignez venir enfin? Est-ce que vous croyez que vous allez vous moquer de moi plus longtemps? Vous êtes un drôle, Monsieur!
Christophe fut si stupéfait par ce boulet reçu en pleine poitrine qu'il fut un moment avant de pouvoir articuler un mot. Il ne pensait qu'à son retard, qui ne pouvait légitimer une telle violence. Il balbutia:
—Altesse, qu'ai-je fait?
L'Altesse n'écoutait pas, et poursuivait avec emportement:
—Taisez-vous! Je ne me laisserai pas insulter par un drôle.
Christophe, blêmissant, luttait contre sa gorge contractée, qui refusait de parler. Il fit un effort, et cria:
—Altesse, vous n'avez pas le droit... vous n'avez pas le droit vous-même de m'insulter, sans me dire ce que j'ai fait.
Le grand-duc se tourna vers son secrétaire, qui sortit un journal de sa poche et qui le lui tendit. Il était dans un état d'exaspération, que son humeur colérique ne suffisait pas à expliquer: les fumées de vins trop généreux y avaient aussi leur part. Il vint se planter devant Christophe, et, comme un toréador avec sa cape, il lui agita furieusement devant la figure le journal déplié et froissé, en criant:
—Vos ordures, Monsieur!... Vous mériteriez qu'on vous y mît le nez!
Christophe reconnut le journal socialiste:
—Je ne vois pas ce qu'il y a de mal, dit-il.
—Quoi! quoi! glapit le grand-duc. Vous êtes d'une impudence!... Ce journal de gredins, qui m'insultent journellement, qui vomissent contre moi des injures immondes!...
—Monseigneur, dit Christophe, je ne l'avais pas lu.
—Vous mentez! cria le grand-duc.
—Je ne veux pas que vous disiez que je mens, fit Christophe. Je ne l'avais pas lu, je ne m'occupe que de musique. Et d'ailleurs, j'ai le droit d'écrire où je veux.
—Vous n'avez aucun droit, sauf celui de vous taire. J'ai été trop bon pour vous. Je vous ai comblé de mes bienfaits, vous et les vôtres, malgré toutes les raisons que votre inconduite et celle de votre père m'auraient données de me séparer de vous. Je vous défends de continuer à écrire dans un journal qui m'est ennemi. Et de plus, d'une façon générale, je vous défends d'écrire quoi que ce soit, à l'avenir, sans mon autorisation. J'ai assez de vos polémiques musicales. Je n'admets pas que quelqu'un qui jouit de ma protection passe son temps à attaquer tout ce qui est cher aux gens de goût et de cœur, aux véritables Allemands. Vous ferez mieux d'écrire de meilleure musique, ou, si cela ne vous est pas possible, de travailler vos gammes et vos exercices. Je ne yeux pas d'un Bebel musical, qui s'amuse à diffamer toutes les gloires nationales, à jeter le désarroi dans les esprits. Nous savons ce qui est bon, Dieu merci! Nous n'avons pas attendu que vous nous le disiez, pour le savoir. Donc, à votre piano, Monsieur, et fichez-nous la paix!
Le gros homme, face à face avec Christophe, le dévisageait avec des yeux insultants. Christophe, livide, essayait de parler; ses lèvres remuaient; il bégaya:
—Je ne suis pas votre esclave, je dirai ce que je veux, j'écrirai ce que je veux...
Il suffoquait, il était près de pleurer de honte et de rage; ses jambes tremblaient. En faisant un brusque mouvement du coude, il renversa un objet sur le meuble près de lui. Il se rendait compte qu'il était ridicule; et, en effet, il entendit rire: en regardant au fond du salon, il vit, au travers d'un brouillard, la princesse qui suivait la scène, en échangeant avec ses voisins des réflexions d'une commisération ironique. Dès lors, il perdit l'exacte conscience de ce qui se passait. Le grand-duc criait. Christophe criait plus fort que lui, sans savoir ce qu'il disait. Le secrétaire du prince et un autre fonctionnaire vinrent vers lui, et tâchèrent de le faire taire: il les repoussa; il agitait en parlant un cendrier qu'il avait saisi machinalement sur le meuble auquel il était adossé. Il entendait que le secrétaire lui disait:
—Allons, lâchez cela, lâchez cela!...
Et il s'entendait lui-même crier des*mots sans suite, et frapper avec le cendrier le rebord de la table.
—Sortez! hurla le grand-duc, au comble de la fureur. Sortez! Sortez! Je vous chasse!
Les officiers s'étaient approchés du prince, et essayaient de le calmer. Le grand-duc, apoplectique, les yeux hors de la tête, criait qu'on jetât ce chenapan à la porte. Christophe vit rouge: il fut tout près d'appliquer son poing sur le mufle du grand-duc; mais il était écrasé par un chaos de sentiments contradictoires: la honte, la fureur, un reste de timidité, de loyalisme germanique, de respect traditionnel, d'habitudes humiliées devant le prince. Il voulait parler, il ne pouvait parler; il voulait agir, il ne pouvait agir; il ne voyait plus, il n'entendait plus: il se laissa pousser, et sortit.
Il passa au milieu des domestiques, impassibles, qui, venus près de la porte, n'avaient rien perdu du bruit de la dispute. Les trente pas qu'il eut à faire pour sortir de l'antichambre lui semblèrent durer toute une vie. La galerie s'allongeait, à mesure qu'il avançait. Il ne sortirait jamais!... La lumière du dehors, qu'il voyait luire là-bas, par la porte vitrée, était le salut... Il descendit l'escalier en trébuchant; il oubliait qu'il était nu-tête: le vieil huissier le rappela pour prendre son chapeau. Il lui fallut ramasser toutes ses forces pour sortir du château, traverser la cour, regagner sa maison. Il claquait des dents. Quand il ouvrit la porte de chez lui, sa mère fut épouvantée par sa mine et par son tremblement. Il l'écarta, il refusa de répondre à ses questions. Il monta dans sa chambre, s'enferma, et se coucha. Il avait un tel frisson qu'il n'arrivait pas à se déshabiller: la respiration coupée; les membres brisés... Ah! ne plus voir, ne plus sentir, n'avoir plus à soutenir ce misérable corps, à lutter contre l'ignoble vie, tomber, tomber sans souffle, sans pensée, n'être plus, nulle part!...—Ses habits arrachés avec une peine mortelle et épars autour de lui, par terre, il se jeta dans son lit et s'y enfonça jusqu'aux yeux. Tout bruit cessa dans la chambre: on n'entendit plus que le petit lit de fer, qui tremblait sur le carreau.
Louisa écoutait à-la porte; elle frappa en vain, appela doucement: rien ne répondit; elle attendit, épiant anxieusement le silence; puis elle s'éloigna. Une ou deux fois dans le jour, elle revint écouter; et le soir, encore, avant de se coucher. Le jour passa, la nuit passa: la maison était muette. Christophe tremblait de fièvre; par moments, il pleurait; et, dans la nuit, il se soulevait pour montrer le poing au mur. Vers deux heures du matin, dans un accès de folie, il sortit du lit, en nage et à moitié nu: il voulait aller tuer le grand-duc. Il était dévoré de haine et de honte; son corps et son cœur se tordaient dans la flamme.—De cette tempête, rien ne s'entendait au dehors: pas un mot, pas un son. Les dents serrées, il renfermait tout en lui.
Le lendemain matin, il redescendit, comme d'habitude. Il était ravagé. Il ne dit rien, et sa mère n'osa rien lui demander: elle savait déjà, par les rapports du voisinage. Tout le jour, il resta sur une chaise, au coin du feu, muet, fiévreux, le dos courbé, comme un vieux; et, quand il était seul, il pleurait en silence.
Vers le soir, le rédacteur du journal socialiste vint le voir. Naturellement, il était au courant et voulait des détails. Christophe, touché de sa visite, l'interpréta naïvement comme une démarche de sympathie et d'excuses de la part de ceux qui l'avaient compromis; il mit son amour-propre à ne rien regretter, et il se laissa aller à dire tout ce qu'il avait sur le cœur: ce lui était un soulagement de parler librement à un homme qui eût comme lui la haine de l'oppression. L'autre l'excitait à parler: il voyait dans l'événement une bonne affaire pour son journal, l'occasion d'un article scandaleux, dont il attendait que Christophe lui fournît les éléments, à moins que Christophe ne l'écrivît lui-même; car il comptait qu'après cet éclat, le musicien de la cour mettrait au service de «la cause» son talent de polémiste, qui était appréciable, et ses petits documents secrets sur la cour, qui l'étaient encore plus. Comme il ne se piquait pas d'une délicatesse exagérée, il présenta la chose sans artifice. Christophe en eut un haut-le-corps; il déclara qu'il n'écrirait rien, alléguant que toute attaque de sa part contre le grand-duc serait interprétée comme un acte de vengeance personnelle, et qu'il était tenu à plus de réserve, maintenant qu'il était libre, que lorsque, ne l'étant pas, il courait des risques en disant sa pensée. Le journaliste ne comprit rien à ces scrupules; il jugea Christophe un peu borné et clérical au fond; il pensa surtout que Christophe avait peur. Il dit:
—Eh bien, laissez-nous faire: c'est moi qui écrirai. Vous n'aurez à vous occuper de rien.
Christophe le supplia de se taire; mais il n'avait aucun moyen de l'y contraindre. D'ailleurs, le journaliste lui représenta que l'affaire ne le concernait pas seul: l'insulte atteignait le journal, qui avait le droit de se venger. À cela, rien à répondre; tout ce que put faire Christophe, ce fut de lui demander sa parole qu'il n'abuserait point de certaines confidences faites à l'ami, et non au journaliste. L'autre la lui donna sans difficulté. Christophe n'en fut pas rassuré: il se rendait compte trop tard de l'imprudence qu'il avait commise.—Quand il fut seul, il repassa dans sa tête tout ce qu'il avait dit, et il frémit. Sans réfléchir une minute, il écrivit au journaliste, le conjurant de ne point répéter ce qu'il lui avait confié:—(le malheureux le répétait lui-même, en partie, dans sa lettre.)
Le lendemain, la première chose qu'il lut, en ouvrant le journal avec une hâte fiévreuse, ce fut, en première page, tout au long son histoire. Tout ce qu'il avait dit, la veille, s'y retrouvait démesurément grossi, ayant subi cette déformation spéciale à laquelle sont soumis tous les objets qui passent par un cerveau de journaliste. L'article attaquait avec de basses invectives le grand-duc et la cour. Certains détails qu'il donnait étaient trop personnels à Christophe, trop évidemment connus de lui seul, pour qu'on ne lui attribuât point l'article entier.
Ce nouveau coup écrasa Christophe. À mesure qu'il lisait, une sueur froide lui montait au visage. Quand il eut fini, il resta affolé. Il voulut courir au journal; mais sa mère l'en empêcha, redoutant, non sans raison, sa violence. Il la redoutait lui-même; il sentait que s'il y allait, il ferait quelque sottise; et il resta,—pour en faire une autre. Il adressa au journaliste une lettre indignée, où il lui reprochait sa conduite en termes blessants, désavouait l'article, et rompait avec le parti. Le désaveu ne parut pas. Christophe récrivit au journal, le sommant de publier sa lettre. On lui envoya copie de sa première lettre, écrite le soir de l'entretien, et qui en était la confirmation: on lui demandait s'il fallait la publier aussi. Il se sentit dans leurs mains. Là-dessus, il eut le malheur de rencontrer dans la rue l'interviewer indiscret; il ne put s'empêcher de lui dire le mépris qu'il avait pour lui. Le lendemain, le journal publia un entrefilet insultant, où l'on parlait de ces domestiques de cour, qui, même quand on les a flanqués à la porte, restent toujours des domestiques. Quelques allusions à l'événement récent ne permettaient point de douter qu'il ne s'agît de Christophe.
Quand il fut bien évident pour tous que Christophe n'avait plus aucun appui, il se trouva soudain d'une richesse en ennemis qu'il n'eût jamais soupçonnée. Tous ceux qu'il avait blessés, directement ou indirectement, soit par des critiques personnelles, soit en combattant leurs idées et leur goût, prirent aussitôt l'offensive et se vengèrent avec usure. Le gros public, dont Christophe avait essayé de secouer l'apathie, contemplait, satisfait, la correction administrée à l'insolent jeune homme, qui avait prétendu réformer l'opinion et troubler le sommeil des gens de bien. Christophe était à l'eau. Chacun fit de son mieux pour lui tenir la tête dessous.
Ils ne fondirent pas tous ensemble sur lui. L'un commença d'abord, pour tâter le terrain. Christophe ne répondant pas, il redoubla ses coups. Alors d'autres suivirent; et puis, toute la bande. Les uns étaient de la fête par simple divertissement, comme de jeunes chiens qui s'amusent à déposer leurs incongruités en belle place: c'était l'escadron volant des journalistes incompétents, qui, ne sachant rien, tâchent de le faire oublier, à force d'adulations aux vainqueurs et d'injures aux vaincus. Les autres apportaient le poids de leurs principes, ils tapaient comme des sourds; où ils avaient passé, il ne restait rien de rien: c'était la grande critique,—la critique qui tue.
Par bonheur pour Christophe, il ne lisait pas les journaux. Quelques amis dévoués avaient l'attention de lui envoyer les plus injurieux. Mais il les laissait s'empiler sur sa table, sans penser à les ouvrir. Ce ne fut qu'à la fin que ses yeux furent attirés par une grande marque rouge qui encadrait un article: il lut que ses Lieder ressemblaient aux grognements d'un animal sauvage, que ses symphonies sortaient d'une maison de fous, que son art était hystérique, que ses spasmes d'harmonies voulaient donner le change sur sa sécheresse de cœur et sa nullité de pensée. Le critique, fort connu, terminait ainsi:
«M. Krafft a naguère donné, comme reporter, quelques preuves étonnantes de son style et de son goût, qui excitèrent dans les cercles musicaux une gaieté irrésistible. Il lui fut alors conseillé amicalement de se livrer plutôt a la composition. Les derniers produits de sa muse ont montré que ce conseil, bien intentionné, était mauvais. M. Krafft devrait décidément faire du reportage.»
Après cette lecture, qui empêcha Christophe de travailler pendant toute une matinée, il se mit à la recherche des autres journaux hostiles, pour achever de se démoraliser. Mais Louisa, qui avait la manie de faire disparaître tout ce qui traînait, sous prétexte de «faire de l'ordre», les avait déjà brûlés. Il en fut irrité d'abord, puis soulagé; et, tendant à sa mère le journal qui restait, il lui dit qu'elle aurait bien dû en faire autant de celui-là.
D'autres affronts lui furent plus sensibles. Un quatuor, dont il avait envoyé le manuscrit à une société réputée de Francfort, fut refusé à l'unanimité, et sans explications. Une ouverture, qu'un orchestre de Cologne semblait disposé à jouer, lui fut retournée, après des mois d'attente, comme injouable. La pire épreuve lui fut infligée par une société orchestrale de la ville. Le Kapellmeister H. Euphrat, qui la dirigeait, était assez bon musicien: mais, comme beaucoup de chefs d'orchestre, il n'avait aucune curiosité d'esprit; il souffrait—(ou plutôt il se portait à merveille)—de cette paresse spéciale à sa corporation, qui consiste à ressasser indéfiniment les œuvres déjà connues et à fuir comme le feu toute œuvre vraiment nouvelle. Il n'était jamais las d'organiser des Festivals Beethoven, Mozart, ou Schumann: il n'avait, dans ces œuvres, qu'à se laisser porter par le ronron des rythmes familiers. En revanche, la musique de son temps lui était insupportable. Il n'osait pas l'avouer et se disait accueillant pour les jeunes talents: de vrai, quand on lui apportait une œuvre bâtie sur un patron ancien,—un décalque d'œuvres qui avaient été nouvelles, il y avait cinquante ans,—il la recevait fort bien; il mettait même de l'ostentation à l'imposer au public. Cela ne dérangeait ni l'ordre de ses effets, ni l'ordre d'après lequel le public avait coutume d'être ému. En revanche, il éprouvait un mélange de mépris et de haine pour tout ce qui menaçait de déranger ce bel ordre et de lui causer une fatigue nouvelle. Le mépris dominait, si le novateur n'avait aucune chance de sortir de son ombre. S'il menaçait de réussir, c'était alors la haine,—bien entendu, jusqu'au moment où il avait réussi tout à fait.
Christophe n'en était pas encore là: tant s'en fallait. Aussi, fut-il surpris, quand on lui fit savoir, par des ouvertures indirectes, que Herr H. Euphrat eût été bien aise de jouer quelque chose de lui. Il avait d'autant moins de raisons de s'y attendre que le Kapellmeister était un ami intime de Brahms et de quelques autres qu'il avait malmenés dans ses chroniques. Comme il était bon garçon, il prêta à ses adversaires des sentiments généreux, qu'il eût été capable d'avoir. Il supposa que, le voyant accablé, ils voulaient lui prouver qu'ils étaient au-dessus des rancunes mesquines: il en fut touché, il écrivit un mot plein d'effusion à H. Euphrat, en lui envoyant un poème symphonique. L'autre lui fit répondre, par son secrétaire, une lettre froide, mais polie, lui accusant réception de son envoi et ajoutant que, suivant la règle de la société, la symphonie serait prochainement distribuée à l'orchestre et soumise à l'épreuve d'une répétition d'ensemble, avant d'être reçue pour l'audition publique. La règle était la règle: Christophe n'avait qu'à s'incliner. Aussi bien, c'était là une pure formalité, qui servait à écarter les élucubrations des amateurs encombrants.
Deux ou trois semaines après, Christophe reçut avis que son œuvre allait être répétée. En principe, tout se passait à huis clos, et l'auteur même ne pouvait assister à la répétition. Mais une tolérance universellement admise faisait qu'il était toujours là; seulement, il ne se montrait pas. Chacun le savait, et chacun feignait de ne le point savoir. Au jour dit, un ami vint chercher Christophe et l'introduisit dans la salle, où il prit place au fond d'une loge. Il fut surpris de voir qu'a cette répétition fermée, la salle—du moins, les places du bas—était presque entièrement remplie: une foule de dilettantes, d'oisifs et de critiques s'agitait en caquetant. L'orchestre était censé ignorer leur présence.
On commença par la Rhapsodie de Brahms pour voix d'alto, chœur d'hommes, et orchestre, sur un fragment du Harzreise im Winter de Gœthe. Christophe, qui détestait la sentimentalité majestueuse de cette œuvre, se dit que c'était peut-être, de la part des «Brahmines», une façon courtoise de se venger, en le forçant à entendre une composition qu'il avait critiquée irrévérencieusement. Cette idée le fit rire, et sa bonne humeur augmenta, quand, après la Rhapsodie, vinrent deux autres productions de musiciens connus, qu'il avait pris à partie: l'intention ne lui sembla pas douteuse. Sans pouvoir dissimuler quelques grimaces, il pensa que c'était, après tout, de bonne guerre; et, à défaut de la musique, il apprécia la farce. Il s'amusa même à mêler ses applaudissements ironiques à ceux du public, qui fit pour Brahms et ses congénères une manifestation enthousiaste.
Enfin, ce fut le tour de la symphonie de Christophe. Quelques regards jetés de l'orchestre et de la salle dans la direction de sa loge lui firent voir qu'on était averti de sa présence. Il sedissimula, il attendait, avec ce serrement de cœur que tout musicien éprouve, au moment où la baguette du chef se lève et où le fleuve de musique se ramasse en silence, prêt à briser sa digue. Jamais il n'avait encore entendu son œuvre à l'orchestre. Comment les êtres qu'il avait rêvés allaient-ils vivre? Quelle serait leur voix? Il les sentait gronder en lui; et, penché sur le gouffre de sons, il attendait en frémissant ce qui allait sortir.
Ce qui sortit, ce fut une chose sans nom, une bouillie informe. Au lieu des robustes colonnes qui devaient soutenir le fronton de l'édifice, les accords s'écroulaient les uns à côté des autres, comme une bâtisse en ruines; on n'y distinguait rien qu'une poussière de plâtras. Christophe hésita avant d'être bien sûr que c'était lui qu'on jouait. Il recherchait la ligne, le rythme de sa pensée: il ne la reconnaissait plus; elle allait, bredouillante et titubante, comme un ivrogne qui s'accroche aux murs; et il était écrasé de honte, comme si on le voyait lui-même en cet état. Il avait beau savoir que ce n'était pas là ce qu'il avait écrit: quand un interprète imbécile dénature vos paroles, on a un moment de doute, on se demande avec consternation si l'on est responsable de cette stupidité. Le public, lui, ne se le demande jamais: il croit à l'interprète, aux chanteurs, à l'orchestre qu'il est accoutumé d'entendre, comme il croit à son journal: ils ne peuvent pas se tromper; s'ils disent des absurdités, c'est que l'auteur est absurde. Il en doutait d'autant moins, en cette occasion, qu'il avait plaisir à le croire.—Christophe essayait de se persuader que le Kapellmeister se rendait compte du gâchis, qu'il allait arrêter l'orchestre, et faire tout reprendre. Les instruments ne jouaient même plus ensemble. Le cor avait manqué son entrée et pris une mesure trop tard; il continua quelques minutes, puis s'arrêta tranquillement pour vider son instrument. Certains traits des hautbois avaient totalement disparu. Il était impossible à l'oreille la plus exercée de retrouver le fil de la pensée musicale, ni même d'imaginer qu'il y en eût une. Des fantaisies d'instrumentation, des saillies humoristiques, devinrent grotesques, par le fait de la grossièreté de l'exécution. C'était bête à pleurer, c'était l'œuvre d'un idiot, d'un farceur, qui ne savait pas la musique. Christophe s'arrachait les cheveux. Il voulut interrompre; mais l'ami qui était avec lui l'en empêcha, l'assurant que Herr Kapellmeister saurait bien de lui-même discerner les fautes de l'exécution et tout remettre au point,—qu'au reste Christophe ne devait pas se montrer et qu'une observation de lui ferait le plus mauvais effet. Il obligea Christophe à se retirer au fond de la loge. Christophe se laissa faire; mais il se cognait la tête avec ses poings; et chaque monstruosité nouvelle lui arrachait un râle d'indignation et de douleur:
—Les misérables! Les misérables!... gémissait-il; et il se mordait les mains pour ne pas crier.
Maintenant, montait vers lui, avec les fausses notes, la rumeur du public, qui commençait à s'agiter. Ce ne fut d'abord qu'un frémissement; mais bientôt, Christophe n'eut plus de doute: ils riaient. Les musiciens de l'orchestre avaient donné le signal; certains ne cachaient point leur hilarité. Le public, assuré dès lors que l'œuvre était risible, se tordit de rire. La joie fut générale; elle redoublait au retour d'un motif très rythmé, que les contrebasses accentuaient d'une façon burlesque. Seul, le Kapellmeister, imperturbable, continuait à marquer la mesure, au milieu du charivari.
Enfin, l'on arriva au bout:—(les meilleures choses ont une fin.)—La parole était au public. Il éclata. Ce fut une explosion d'allégresse, qui dura plusieurs minutes. Les uns sifflaient, les autres applaudissaient ironiquement; les plus spirituels criaient: bis! Une voix de basse, venue du fond d'une avant-scène, se mit à imiter le motif grotesque. D'autres farceurs furent pris d'émulation et l'imitèrent, à leur tour. Quelqu'un cria: «L'auteur!»—Il y avait longtemps que ces gens d'esprit ne s'étaient autant amusés.
Après que le tumulte fut un peu calmé, le Kapellmeister, impassible, le visage tourné de trois quarts vers le public, mais affectant de ne pas le voir,—(le public était toujours censé ne pas exister)—fit à l'orchestre un signe, pour marquer qu'il voulait parler. On cria: «Chut!»; et chacun fit silence. Il attendit encore un moment; puis,—(sa voix était nette, froide et tranchante):
—Messieurs, dit-il, je n'aurais certainement pas laissé jouer cette chose jusqu'au bout, si je n'avais voulu me donner une fois en spectacle le monsieur qui a osé écrire des turpitudes sur maître Brahms.
Il dit; et, sautant de son estrade, il sortit au milieu des ovations de la salle en délire. On voulut le rappeler; les acclamations se prolongèrent pendant une ou deux minutes encore. Mais il ne revint pas. L'orchestre s'en allait. Le public se décida à s'en aller aussi. Le concert était fini.
C'était une bonne journée.
Christophe était déjà sorti. À peine avait-il vu le misérable chef d'orchestre quitter son pupitre, qu'il s'était élancé hors de la loge; il dégringolait les marches du premier étage, pour le rejoindre et le souffleter. L'ami qui l'avait amené courut après lui et essaya de le retenir; mais Christophe le bouscula et faillit le jeter en bas de l'escalier:—(il avait des raisons de croire que le personnage était complice dans le traquenard).—Heureusement pour H. Euphrat et pour lui-même, la porte qui menait à la scène était fermée; et ses coups de poing furieux ne purent la faire ouvrir. Cependant, le public commençait à sortir de la salle. Christophe ne pouvait rester là. Il se sauva.
Il était dans un état indescriptible. Il marchait au hasard, agitant les bras, roulant les yeux, parlant tout haut, comme un fou; il renfonçait ses cris d'indignation et de rage. La rue était à peu près déserte. La salle de concert avait été construite; l'année précédente, dans un quartier nouveau, un peu hors de la ville; et Christophe, d'instinct, fuyait vers la campagne, à travers les terrains vagues, où s'élevaient des baraques isolées et: quelques échafaudages de maisons, entourés de palissades. Il avait des pensées meurtrières, il eût voulu tuer l'homme qui lui avait fait cet affront... Hélas! Et quand il l'eût tué, y aurait-il eu rien de changé à l'animosité de tous ces gens, dont les rires injurieux retentissaient encore à son oreille? Ils étaient trop, il ne pouvait rien contre eux; ils étaient tous d'accord—eux qui étaient divisés sur tant de choses—pour l'outrager et l'écraser. C'était plus que de l'incompréhension: il y avait de la haine. Que leur avait-il donc fait à tous? Il avait en lui de belles choses, des choses qui fout du bien et qui dilatent le cœur; il avait voulu les dire, en faire jouir les autres; il croyait qu'ils allaient en être heureux comme lui. Si même ils ne les goûtaient pas, ils devaient au moins lui être reconnaissants de l'intention; ils pouvaient, à la rigueur, lui remontrer amicalement en quoi il s'était trompé; mais de là à cette joie méchante qu'ils mettaient à insulter ses pensées odieusement travesties, à les fouler aux pieds, à le tuer sous le ridicule, comment était-ce possible? Dans son exaltation, il s'exagérait encore leur haine; il lui prêtait un sérieux, que ces êtres médiocres étaient bien incapables d'avoir. Il sanglotait: «Qu'est-ce que je leur ai fait?» Il étouffait, il se sentait perdu, ainsi que lorsqu'il était enfant et qu'il fit, connaissance pour la première fois avec la méchanceté humaine.
Et comme il regardait près de lui, à ses pieds, il s'aperçut qu'il était arrivé au bord du ruisseau du moulin, à l'endroit où, quelques années avant, son père s'était noyé. Et l'idée lui vint sur-le-champ de se noyer. Sans attendre une minute, il se disposa à sauter.
Mais comme il se penchait sur la berge, fasciné par le calme et clair regard de l'eau, un tout petit oiseau, sur un arbre voisin, se mit à chanter—chanter éperdument. Il se tut pour l'écouter. L'eau murmurait. On entendait les frémissements des blés en fleur, ondoyant sous la molle caresse de l'air; les peupliers frissonnaient. Derrière la haie du chemin, dans un jardin, des paniers d'abeilles invisibles emplissaient l'air de leur musique parfumée. De l'autre côté du ruisseau, une vache aux beaux yeux bordés d'agate, rêvait. Une fillette blonde, assise sur le rebord d'un mur, une hotte légère à claires-voies sur les épaules, comme un petit ange avec ses ailes, rêvait aussi, en balançant ses jambes nues et chantonnant un air qui n'avait aucun sens. Au loin, dans la prairie, un chien blanc bondissait, décrivant de grands ronds...
Christophe, appuyé à un arbre, écoutait, regardait la terre printanière; il était repris par la paix et la joie de ces êtres: il oubliait, il oubliait... Brusquement, il serra dans ses bras le bel arbre, contre lequel il appuyait sa joue. Il se jeta par terre; il s'enfonça la tête dans l'herbe; il riait nerveusement, il riait de bonheur. Toute la beauté, la grâce, le charme de la*vie l'enveloppait, le pénétrait. Il pensait:
—Pourquoi es-tu si belle, et eux—les hommes—si laids?
N'importe! Il l'aimait, il l'aimait, il sentait qu'il l'aimerait toujours, que rien ne pourrait l'en déprendre. Il embrassa la terre avec ivresse. Il embrassait la vie:
—Je t'ai! Tu es à moi. Ils ne peuvent pas t'enlever à moi. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent! Qu'ils me fassent souffrir!... Souffrir, c'est encore vivre!
Christophe se remit courageusement au travail. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec les «hommes de lettres» les bien nommés, les phraseurs, les bavards stériles, les journalistes, les critiques, les exploiteurs et les trafiquants de l'art. Quant aux musiciens, il ne perdrait pas son temps davantage à combattre leurs préjugés et leurs jalousies. Ils ne voulaient pas de lui?—Soit! il ne voulait pas d'eux. Il avait son œuvre à faire: il la ferait. La cour lui rendait sa liberté: il l'en remerciait. Il remerciait les gens de leur hostilité: il allait pouvoir travailler en paix.
Louisa l'approuvait de tout son cœur. Elle n'avait point d'ambition; elle n'était pas une Krafft; elle ne ressemblait ni au père, ni au grand-père. Elle ne tenait aucunement pour son fils aux honneurs et à la réputation. Certes, elle se fût réjouie qu'il fût riche et célèbre; mais si ces avantages devaient s'acheter au prix de trop de désagréments, elle aimait beaucoup mieux qu'il n'en fût pas question. Elle avait été plus affectée du chagrin de Christophe, à la suite de sa rupture avec le château, que de l'événement même; et, au fond, elle était ravie qu'il se fût brouillé avec les gens des revues et des journaux. Elle avait pour le papier noirci une méfiance de paysan: tout cela n'était bon qu'à vous faire perdre votre temps et à vous attirer des ennuis. Elle avait entendu quelquefois causer avec Christophe les petits jeunes gens de la Revue, avec qui il collaborait: elle avait été épouvantée de leur méchanceté; ils déchiraient tout à belles dents, ils disaient des horreurs de tout; et plus ils en disaient, plus ils étaient contents. Elle ne les aimait pas. Ils étaient sans doute très intelligents et très savants; mais ils n'étaient pas bons: elle se réjouissait que son Christophe ne les vît plus. Elle abondait dans son sens: qu'avait-il besoin d'eux?
—Ils peuvent dire, écrire et penser de moi ce qu'ils voudront, disait Christophe: ils ne peuvent pas m'empêcher d'être moi-même. Leur art, leur pensée, que m'importe? Je les nie!
Il est très beau de nier le monde. Mais le monde ne se laisse pas si facilement nier par une forfanterie de jeune homme. Christophe était sincère; mais il se faisait illusion, il ne se connaissait pas bien. Il notait pas un moine, il n'avait pas un tempérament à renoncer au monde; surtout, il n'en avait pas l'âge. Les premiers temps, il ne souffrit pas trop: il était enfoncé dans la composition; et, tant que ce travail dura, il ne sentit le manque de rien. Mais quand il fut dans la période de dépression qui suit l'achèvement de l'œuvre et qui dure jusqu'à ce qu'une nouvelle œuvre s'empare de l'esprit, il regarda autour de lui, et il fut glacé de son abandon. Il se demanda pourquoi il écrivait. Tandis que l'on écrit, la question ne se pose pas: il faut écrire, cela ne se discute point. Ensuite, on se trouve en présence de l'œuvre enfantée; l'instinct puissant qui l'a fait jaillir des entrailles s'est tu: on ne comprend plus pourquoi elle est née; à peine s'y reconnaît-on soi-même, elle est presque une étrangère, on aspire à l'oublier. Et cela n'est pas possible, tant qu'elle n'est ni publiée, ni jouée, tant qu'elle ne vit pas de sa vie propre dans le monde. Jusque-là, elle est le nouveau-né attaché à la mère, une chose vivante rivée à la chair vivante: il faut l'amputer pour vivre. Plus Christophe composait, plus grandissait en lui l'oppression de ces êtres sortis de lui, qui ne pouvaient ni vivre, ni mourir. Qui l'en délivrerait? Une poussée obscure remuait ces enfants de sa pensée; ils aspiraient désespérément à se détacher de lui, à se répandre dans d'autres âmes comme les semences vivaces, que lèvent charrie dans l'univers. Resterait-il muré dans sa stérilité? Il en deviendrait enragé.
Puisque tout débouché:—théâtres, concerts,—lui était fermé, et que pour rien au monde il ne se fût abaissé à une démarche nouvelle auprès des directeurs qui l'avaient une fois éconduit, il ne lui restait d'autre moyen que de publier ce qu'il avait écrit; mais il ne pouvait se flatter qu'il trouverait plus facilement un éditeur pour le lancer qu'un orchestre pour le jouer. Les deux ou trois essais qu'il fit, aussi maladroitement que possible, lui suffirent; plutôt que de s'exposer à un nouveau refus, ou de discuter avec un de ces négociants et de supporter leurs airs protecteurs, il préféra faire tous les frais de l'édition. C'était une folie: il avait une petite réserve, qui lui venait de son traitement à la cour et de quelques concerts; mais la source de cet argent était tarie, et il se passerait longtemps avant qu'il en trouvât une autre; il eût fallu être assez sage pour ménager ce petit avoir, qui devait l'aider à passer la période difficile où il s'engageait. Non seulement il ne le fit pas; mais, cette réserve étant insuffisante à couvrir les dépenses de l'édition, il ne craignit pas de s'endetter. Louisa n'osait rien dire; elle le trouvait déraisonnable, et ne comprenait pas bien qu'on dépensât de l'argent pour voir son nom sur un livre; mais puisque c'était un moyen de lui faire prendre patience et de le garder auprès d'elle, elle était trop heureuse qu'il s'en contentât.
Au lieu d'offrir au public des compositions d'un genre connu, de tout repos, Christophe fit choix, parmi ses manuscrits, d'une série d'œuvres, très personnelles, et auxquelles il tenait beaucoup. C'étaient des pièces pour piano, où s'entremêlaient des Lieder, quelques-uns très courts et d'allure populaire, d'autres très développés et presque dramatiques. Le tout formait une suite d'impressions joyeuses ou tristes, qui s'enchaînaient d'une façon naturelle et que traduisait tour à tour le piano seul, et le chant, seul ou accompagné. «Car, disait Christophe, quand je rêve, je ne me formule pas toujours ce que je sens: je souffre, je suis heureux, sans paroles pour le dire; mais il vient un moment où il faut que je le dise, je chante sans y penser: parfois, ce ne sont que des mots vagues, quelques phrases décousues, parfois des poèmes entiers; puis, je me remets à rêver. Ainsi, le jour s'écoule: et c'est en effet un jour que j'ai voulu représenter. Pourquoi des recueils composés uniquement de chants, ou de préludes? Il n'est rien de plus factice et de moins harmonieux. Tâchons de rendre le libre jeu de l'âme!»—Il avait donc nommé la Suite: Une Journée. Les diverses parties de l'œuvre portaient des sous-titres, indiquant brièvement la succession des rêves intérieurs. Christophe y avait écrit des dédicaces mystérieuses, des initiales, des dates, que lui seul pouvait comprendre et qui lui rappelaient le souvenir d'heures poétiques, ou de figures aimées: la rieuse Corinne, la languissante Sabine, et la petite Française inconnue.
En outre de cette œuvre, il choisit une trentaine de ses Lieder,—de ceux qui lui plaisaient le plus, et, par conséquent, qui plaisaient le moins au public. Il s'était bien gardé de prendre ses mélodies les plus «mélodieuses»; il prit les plus caractéristiques.—(On sait que les braves gens ont toujours une grande peur de ce qui est «caractéristique». Ce qui est sans caractère leur ressemble beaucoup mieux.)
Ces Lieder étaient écrits sur des vers de vieux poètes silésiens du dix-septième siècle, que Christophe avait lus dans une collection populaire, et dont il aimait la loyauté. Deux surtout lui étaient chers, comme des frères, deux êtres pleins de génie, tous deux morts à trente ans: le charmant Paul Fleming, le libre voyageur au Caucase et à Ispahan, qui garda une âme pure, aimante et sereine, parmi les sauvageries de la guerre, les tristesses de la vie, et la corruption de son temps,—et Jean-Christian Günther, le génie déréglé, qui se brûla dans l'orgie et le désespoir, jetant sa vie à tous les vents. De Günther, il avait traduit les cris de provocation et d'ironie vengeresse contre le Dieu ennemi qui l'écrase, ces malédictions furieuses du Titan terrassé, qui retourne la foudre contre le ciel. De Fleming, il avait pris des chants d'amour à Anemone et à Basilene, suaves et doux comme des fleurs,—la ronde des étoiles, le Tanzlied (chant de danse) des cœurs limpides et joyeux,—et le sonnet héroïque et tranquille: À soi-même (An Sich), que Christophe se récitait, comme prière du matin.
L'optimisme souriant du pieux Paul Gerhardt charmait aussi Christophe. C'était pour lui un repos, au sortir de ses tristesses. Il aimait cette vision innocente de la nature en Dieu, les prairies fraîches, où les cigognes se promènent gravement au milieu des tulipes et des narcisses blancs, au bord des ruisselets qui chantent sur le sable, l'air transparent où passent les hirondelles aux grandes ailes et le vol des colombes, la gaieté d'un rayon de soleil qui déchire la pluie, et le ciel lumineux qui rit entre les nuées, et la sérénité majestueuse du soir, le repos des forêts, des troupeaux, des villes et des champs. Il avait eu l'impertinence de remettre en musique plusieurs de ces cantiques spirituels, qui étaient encore chantés dans les communautés protestantes. Et il s'était bien gardé de leur conserver leur caractère de choral. Loin de là: il l'avait en horreur; il leur avait donné une expression libre et vivante. Le vieux Gerhardt eût frémi de l'orgueil diabolique que respiraient maintenant certaines strophes de son Lied du Voyageur chrétien, ou de l'allégresse païenne qui faisait déborder comme un torrent le flot paisible de son Chant d'été.
La publication fut faite, et naturellement en dépit du bon sens. L'éditeur, que Christophe payait pour faire l'impression de ses Lieder et les garder en dépôt, n'avait d'autre titre à son choix que d'être son voisin. Il n'était pas outillé pour un travail de cette importance; l'ouvrage traîna, des mois; il y eut des bévues, des corrections coûteuses. Christophe, qui n'y connaissait rien, se laissait tout compter un tiers plus cher qu'il ne fallait; les dépenses s'élevèrent bien au-dessus de ce qui avait été prévu. Puis, quand ce fut fini, Christophe se trouva avoir sur les bras une édition énorme, dont il ne savait que faire. L'éditeur était sans clientèle; il ne fit pas une démarche pour répandre l'œuvre. Son apathie s'accordait d'ailleurs avec l'attitude de Christophe. Comme il lui avait demandé, pour l'acquit de sa conscience, de lui écrire quelques lignes de réclame, Christophe répliqua «qu'il ne voulait pas de réclame: si sa musique était bonne, elle parlerait pour elle-même». L'autre respecta religieusement sa volonté: il enferma l'édition au fond de son magasin. Elle était bien gardée; car, en six mois, il ne s'en vendit pas un exemplaire.
En attendant que le public se décidât à venir, Christophe dut trouver un moyen pour réparer la brèche qu'il avait faite à son petit pécule; et il n'avait pas à être difficile: car il fallait vivre et payer ses dettes. Non seulement celles-ci étaient plus fortes qu'il ne l'avait prévu; mais il s'aperçut que la réserve sur laquelle il comptait était moins forte qu'il n'avait calculé. Avait-il perdu de l'argent sans s'en douter, ou—ce qui était infiniment plus probable,—avait-il mal fait ses comptes? (Jamais il n'avait su faire une addition exacte.) Peu importait pourquoi l'argent manquait: il manquait, la chose était sûre. Louisa dut se saigner pour venir en aide à son fils. Il en eut un remords cuisant, et il chercha à s'acquitter, au plus tôt, à tout prix. Il se mit en quête de leçons à donner, si pénible qu'il lui fût de se proposer et d'essuyer parfois des refus. Sa faveur était bien tombée: il eut grand mal à retrouver quelques élèves. Aussi, quand on lui parla d'une place dans une école, il fut trop heureux d'accepter.
C'était une institution à demi religieuse. Le directeur, homme fin, avait su voir, sans être musicien, tout le parti qu'on pouvait tirer de Christophe, à très bon compte, dans la situation actuelle. Il était affable, et payait peu. Christophe ayant risqué une timide observation, le directeur laissa entendre, avec un sourire bienveillant, que Christophe, n'ayant plus de titre officiel, ne pouvait prétendre à plus.
Triste besogne! Il s'agissait moins d'apprendre la musique aux élèves que de donner l'illusion aux parents et à eux-mêmes qu'ils la savaient. La grande affaire était de les mettre en état de chanter pour les cérémonies où le public était admis. Peu importait le moyen. Christophe en était écœuré; il n'avait même pas la consolation de se dire, en accomplissant sa tâche, qu'il faisait œuvre utile: sa conscience se la reprochait, comme une hypocrisie. Il essaya de donner aux enfants une instruction plus solide, de leur faire connaître et aimer la sérieuse musique; mais les élèves ne s'en souciaient point. Christophe ne réussissait pas à se faire écouter; il manquait d'autorité; et, en vérité, il n'était pas fait pour enseigner à des enfants. Il ne s'intéressait pas à leurs ânonnements; il voulait leur expliquer tout de suite la théorie musicale. Quand il avait une leçon de piano à donner, il mettait l'élève à une symphonie de Beethoven, qu'il jouait avec lui à quatre mains. Naturellement, cela ne pouvait marcher; il éclatait de colère, chassait l'élève du piano, et jouait seul, longuement, à sa place.—Il n'en usait pas autrement avec ses élèves particuliers, en dehors de l'école. Il n'avait pas une once de patience: il disait, par exemple, à une gentille jeune fille, qui se piquait de distinction aristocratique, qu'elle jouait comme une cuisinière; ou même, il écrivait à la mère qu'il y renonçait, qu'il finirait par en mourir, s'il devait continuer plus longtemps à s'occuper d'un être aussi dénué de talent.—Tout cela n'arrangeait pas ses affaires. Ses rares élèves le quittaient; il ne parvenait pas à en garder un, plus de deux mois. Sa mère le raisonnait. Elle lui fit promettre qu'il ne se brouillerait pas au moins avec l'institution où il était entré; car, s'il venait à perdre cette place, il ne savait plus comment il ferait pour vivre. Aussi se contraignait-il, malgré son dégoût: il était d'une ponctualité exemplaire. Mais le moyen de cacher ce qu'il pensait, quand un âne d'élève estropiait pour la dixième fois un passage, ou quand il lui fallait seriner à sa classe, pour le prochain concert, un chœur insipide! (Car on ne lui laissait même pas le choix de son programme: on se défiait de son goût). On peut croire qu'il y mettait peu de zèle. Il s'obstinait pourtant, silencieux, renfrogné, ne trahissant sa fureur intime que par quelque coup de poing sur la table, qui faisait ressauter les élèves. Mais parfois, la pilule était trop amère: il ne pouvait l'avaler. Au milieu du morceau, il interrompait ses chanteurs:
—Ah! laissez cela! laissez cela! Je vais vous jouer plutôt du Wagner.
Ils ne demandaient pas mieux. Ils jouaient aux cartes derrière son dos. Il s'en trouvait toujours un pour rapporter la chose au directeur; et Christophe s'entendait rappeler qu'il n'était pas là pour faire aimer la musique à ses élèves, mais pour la leur faire chanter. Il recevait les semonces en frémissant; mais il les acceptait: il ne voulait pas rompre.—Qui lui eût dit, il y avait quelques années, quand sa carrière s'annonçait brillante et assurée, (alors qu'il n'avait rien fait), qu'il en serait réduit à ces humiliations, dès l'instant qu'il commencerait à valoir quelque chose?
Parmi les souffrances d'amour-propre que lui causa sa charge à l'institution, une des moins pénibles pour lui ne fut pas la corvée des visites obligatoires à ses collègues. Il en fit deux, au hasard; et cela l'ennuya tellement qu'il n'eut pas le courage de continuer. Les deux privilégiés ne lui en surent aucun gré; mais les autres se jugèrent personnellement offensés. Tous regardaient Christophe comme leur inférieur, en situation et en intelligence; et ils prenaient avec lui des manières protectrices. Ils avaient l'air si sûrs d'eux-mêmes et de l'opinion qu'ils avaient de lui, qu'il lui arrivait de la partager; il se sentait stupide auprès d'eux: qu'eut-il pu trouver à leur dire? Ils étaient pleins de leur métier et ne voyaient rien au delà. Ils n'étaient pas des hommes. Si, du moins, ils avaient été des livres! Mais ils étaient des notes à des livres, des commentaires philologiques.
Christophe fuyait les occasions de se trouver avec eux. Mais elles lui étaient quelquefois imposées. Le directeur recevait, un jour par mois, dans l'après-midi; et il tenait à ce que tout son monde fût là. Christophe, qui avait esquivé la première invitation, sans même s'excuser, faisant le mort, dans l'espoir fallacieux que son absence ne serait pas remarquée, fut l'objet, dès le lendemain, d'une observation aigre-douce. La fois suivante, chapitré par sa mère, il se décida à venir; il y mit autant d'entrain que s'il allait à un enterrement.
Il se trouva dans une réunion de professeurs de l'institution et d'autres écoles delà ville, avec leurs femmes et leurs filles. Entassés dans un salon trop petit, ils étaient hiérarchiquement groupés, et ne firent nulle attention à lui. Le groupe le plus voisin parlait de pédagogie et de cuisine. Toutes ces femmes de professeurs avaient des recettes culinaires, qu'elles professaient avec un pédantisme exubérant et revêche. Les hommes n'étaient pas moins intéressés par ces questions, et à peine moins compétents. Ils étaient aussi fiers des talents domestiques de leurs femmes que celles-ci du savoir de leurs époux. Debout, près d'une fenêtre, adossé au mur, ne sachant quelle contenance faire, tantôt tâchant de sourire bêtement, tantôt sombre, l'œil fixe, les traits contractés, Christophe crevait d'ennui. À quelques pas, assise dans l'embrasure de la fenêtre, une jeune femme, à qui personne ne parlait, s'ennuyait comme lui. Tous deux regardaient la salle, et ne se regardaient pas. Après un certain temps, ils se remarquèrent, au moment où, n'en pouvant plus, ils se détournaient pour bâiller. Juste à cette minute, leurs yeux se rencontrèrent. Ils échangèrent un regard de complicité amicale. Il fit un pas vers elle. Elle lui dit, à mi-voix:
—On s'amuse?
Il tourna le dos à la salle, et, regardant la fenêtre, il tira la langue. Elle éclata de rire et, subitement réveillée, elle lui fit signe de s'asseoir auprès d'elle. Ils firent connaissance. Elle était femme du professeur Reinhart, chargé du cours d'histoire naturelle à l'école, et nouvellement arrivé dans la ville, où ils ne connaissaient encore personne. Elle était loin d'être belle, le nez gros, de vilaines dents, peu de fraîcheur, mais des yeux vifs, assez spirituels, et un sourire bon enfant. Elle bavardait comme une pie: il lui donna la réplique avec entrain; elle avait une franchise amusante, des boutades drolatiques; ils échangeaient en riant leurs impressions, tout haut, sans se préoccuper de ceux qui les entouraient. Leurs voisins, qui n'avaient pas daigné s'apercevoir de leur existence, quand il eût été charitable de les aider à sortir de leur isolément, leur jetaient maintenant des regards mécontents: il était de mauvais goût de s'amuser autant!... Mais ce qu'on pouvait penser d'eux était indifférent aux deux bavards: ils prenaient leur revanche.
À la fin, madame Reinhart présenta son mari à Christophe, Il était extrêmement laid: une figure blême, glabre, grêlée, un peu macabre, mais un air de grande bonté. Il parlait du fond de la gorge, et articulait les mots d'une manière sentencieuse, ânonnante, en faisant des pauses entre les syllabes.
Ils étaient mariés depuis quelques mois, et ces deux laiderons étaient épris l'un de l'autre: ils avaient une façon affectueuse de se regarder, de se parler, de se prendre la main, au milieu de tout ce monde,—qui était comique et touchante. Ce que l'un voulait, l'autre le voulait aussi. Tout de suite, ils invitèrent Christophe à venir souper chez eux, au sortir de la réception. Christophe commença par se défendre, en plaisantant; il disait que, pour ce soir, ce qu'on avait de mieux à faire, c'était d'aller se coucher: on était moulu d'ennui, comme après une marche de dix lieues. Mais madame Reinhart répliqua que, précisément, il ne fallait pas en rester là: il serait dangereux de passer la nuit sur ces pensées lugubres. Christophe se laissa faire violence. Dans son isolement, il se sentait heureux d'avoir rencontré ces braves gens, pas très distingués, mais simples et gemütlich.
Le petit intérieur des Reinhart était gemütlich, comme eux. C'était un Gemüt un peu bavard, un Gemüt avec inscriptions. Les meubles, les ustensiles, la vaisselle parlaient, répétaient sans se lasser leur joie de recevoir «lecher hôte», s'informaient de sa santé, lui donnaient des conseils affables et vertueux. Sur le sofa,—qui au reste était fort dur,—s'étalait un petit coussin, qui murmurait amicalement:
—Seulement un petit quart d'heure! (Nur ein Viertelstündchen!)
La tasse de café, qu'on offrit à Christophe, insistait pour qu'il en reprît:
—Encore une petite goutte! (Noch ein Schlückchen!).
Les assiettes assaisonnaient de morale la cuisine, d'ailleurs excellente. L'une disait:
—Pense à tout: autrement il ne t'arrivera rien de bon.
L'autre:
—L'affection et la reconnaissance plaisent. L'ingratitude déplaît à tous.
Bien que Christophe ne fumât point, le cendrier sur la cheminée ne put se tenir de se présenter à lui:
—Petite place de repos pour les cigares brûlants. (Ruheplätzchen für brennende Cigarren.)
Il voulut se laver les mains. Le savon sur la table de toilette dit:
—Pour notre cher hôte. (Für unseren lieben Gast.)
Et l'essuie-mains sentencieux, comme quelqu'un de très poli, qui n'a rien à dire, mais qui se croit obligé à dire tout de même quelque chose, lui fit cette réflexion, pleine de bon sens, mais non pas d'à-propos, «qu'il faut se lever de bonne heure, pour jouir de la matinée»:
—Morgenstund hat Gold im Mund.
Christophe finit par ne plus oser se tourner sur sa chaise, de peur de s'entendre interpeller par d'autres voix venues de tous les coins de la chambre. Il avait envie de leur dire:
—Taisez-vous donc, petits monstres! On ne s'entend pas ici.
Et il fut pris d'un fou rire, qu'il tâcha d'expliquer à ses hôtes par le souvenir de la réunion de tout â l'heure, à l'école. Pour rien au monde, il n'eût voulu les blesser. Au reste, il n'était pas très sensible au ridicule. Très vite, il s'habitua à la cordialité loquace des choses et des êtres. Que ne leur eût-il passé! C'étaient de si bonnes gens! Ils n'étaient pas ennuyeux; s'ils manquaient de goût, ils ne manquaient pas d'intelligence.
Ils se trouvaient un peu perdus dans le pays, où ils venaient d'arriver. La susceptibilité insupportable de la petite ville de province n'admettait point qu'on y entrât, comme dans un moulin, sans avoir sollicité, dans les règles, l'honneur d'en faire partie. Les Reinhart n'avaient pas tenu assez de compte du protocole provincial, qui régit les devoirs des nouveaux arrivants dans une ville, à l'égard de ceux qui y sont installés avant eux. À la rigueur, Reinhart s'y fût soumis machinalement. Mais sa femme, que ces corvées assommaient, et qui n'aimait pas à se gêner, les remettait de jour en jour. Elle avait choisi dans la liste des visites celles qui l'ennuyaient le moins, pour les faire d'abord; les autres étaient indéfiniment remises. Les notabilités, qui se trouvaient comprises dans cette dernière catégorie, étaient suffoquées d'un tel manque d'égards. Angelika Reinhart—(son mari la nommait Lili)—avait des manières un peu libres; elle ne parvenait pas à prendre le ton officiel. Elle interpellait ses supérieurs hiérarchiques, qui en rougissaient d'indignation; elle ne craignait pas, au besoin, de leur donner un démenti. Elle avait la langue bien pendue et éprouvait le besoin de dire tout ce qui lui passait par la tête: c'étaient parfois des sottises énormes, dont on se moquait derrière son dos; c'étaient aussi de grosses malices, décochées en pleine poitrine, et qui lui faisaient des ennemis mortels. Elle se mordait la langue, au moment où elle les disait, et elle eût voulu les retenir: mais il était trop tard. Son mari, le plus doux et le plus respectueux des hommes, lui faisait à ce sujet de timides observations. Elle l'embrassait, en lui disant qu'elle était une sotte, et qu'il avait raison. Mais, l'instant d'après, elle recommençait; et c'était surtout quand et où il fallait le moins dire certaines choses, qu'aussitôt elle les disait: elle eût crevé, si elle ne les eût dites.—Elle était bien faite pour s'entendre avec Christophe.
Parmi les nombreuses choses saugrenues, qu'il ne fallait pas dire, et que par conséquent elle disait, revenait à tout propos une comparaison déplacée de ce qui se faisait en Allemagne et de ce qui se faisait en France. Allemande elle-même,—(nulle ne l'était plus qu'elle)—mais élevée en Alsace, et en rapports d'amitié avec des Alsaciens français, elle avait subi cette attraction de la civilisation latine, à laquelle ne résistaient pas, dans les pays annexés, tant d'Allemands, et de ceux qui semblaient les moins faits pour la sentir. Peut-être, pour dire vrai, cette attraction était-elle devenue plus forte, par esprit de contradiction, depuis qu'Angelika avait épousé un Allemand du Nord et se trouvait dans un milieu purement germanique.
Dès la première soirée avec Christophe, elle entama son sujet de discussion habituel. Elle vanta l'aimable liberté des conversations françaises. Christophe lui fit écho. La France, pour lui, était Corinne: de beaux yeux lumineux, une jeune bouche rieuse, des manières franches et libres, une voix bien timbrée: il avait grande envie d'en connaître davantage.
Lili Reinhart tapa des mains de se trouver si bien d'accord avec Christophe.
—C'est dommage, dit-elle, que ma petite amie française ne soit plus ici; mais elle n'a pu y tenir: elle est partie.
L'image de Corinne s'éteignit aussitôt. Comme une fusée qui meurt fait paraître soudain dans le ciel sombre les douces et profondes lueurs des étoiles, une autre image, d'autres yeux apparurent.
—Qui? demanda Christophe, sursautant. La petite institutrice?
—Comment! fit madame Reinhart, vous la connaissiez aussi?
Ils firent sa description: les deux portraits étaient identiques.
—Vous la connaissiez? répétait Christophe. Oh! dites-moi tout ce que vous savez d'elle!...
Madame Reinhart commença par protester qu'elles étaient amies intimes et qu'elles se confiaient tout. Mais quand il fallut entrer dans le détail, ce tout se réduisit à fort peu de chose. Elles s'étaient rencontrées en visite. Madame Reinhart avait fait des avances à la jeune fille; et, avec son habituelle cordialité, elle l'avait invitée à venir la voir. La jeune fille était venue deux ou trois fois, et elles avaient causé. Ce n'avait pas été sans peine que la curieuse Lili avait réussi à savoir quelque chose de la vie de la petite Française: la jeune fille était fort réservée; il fallait lui arracher son histoire, lambeau par lambeau. Madame Reinhart avait tout juste appris qu'elle se nommait Antoinette Jeannin; elle était sans fortune, et avait, pour toute famille, un jeune frère resté à Paris, qu'elle se dévouait à soutenir. Elle parlait de lui sans cesse: c'était le seul sujet sur lequel elle se montrât un peu expansive; et Lili Reinhart avait gagné sa confiance, en témoignant une sympathie apitoyée pour le jeune garçon, seul à Paris, sans parents, sans amis, pensionnaire dans un lycée. C'était pour subvenir aux frais de son éducation qu'Antoinette avait accepté une place à l'étranger. Mais les deux pauvres enfants ne pouvaient vivre l'un sans l'autre; ils s'écrivaient, chaque jour; et le moindre retard à l'arrivée de la lettre attendue les jetait dans une inquiétude maladive. Antoinette ne cessait de se tourmenter pour son frère: l'enfant n'avait pas le courage de lui cacher la tristesse de sa solitude; chacune de ses plaintes résonnait dans le cœur d'Antoinette avec une intensité déchirante; elle se torturait à la pensée qu'il souffrait, et elle s'imaginait souvent qu'il était malade, mais qu'il ne voulait pas le dire. La bonne madame Reinhart avait dû bien des fois la rabrouer amicalement, pour ces craintes sans motif; et elle réussissait, pour un moment, à lui rendre confiance.—Sur la famille d'Antoinette, sur sa condition, sur le fond de son âme, elle n'avait rien pu savoir. À la première question, la jeune fille se repliait sur elle-même, avec une timidité effarouchée. Elle était instruite; elle paraissait avoir une expérience précoce; elle semblait à la fois naïve et désabusée, pieuse et sans illusions. Elle n'avait pas été heureuse ici, dans une famille sans tact et sans bonté.—Comment elle était partie, madame Reinhart ne savait pas au juste. On prétendait qu'elle s'était mal conduite. Angelika n'en croyait rien; elle eût mis sa main au feu que c'étaient de dégoûtantes calomnies, bien dignes de cette ville sotte et malfaisante. Mais il y avait eu des histoires: peu importaient lesquelles, n'est-ce pas?
—Oui, dit Christophe, qui baissait la tête.
—Enfin, elle est partie.
—Et que vous a-t-elle dit, en partant?
—Ah! dit Lili Reinhart, je n'ai pas eu de chance. Justement, j'étais allée à Cologne pour deux jours! Au retour... Zu spät! (Trop tard!)... s'interrompit-elle, pour semoncer sa bonne, qui lui apportait le citron trop tard pour le prendre dans son thé.
Et elle ajouta sentencieusement, avec la solennité naturelle que les vraies âmes allemandes mettent à officier les actes familiers de l'existence quotidienne:
—Comme si souvent dans la vie!...
(On ne savait s'il s'agissait du citron, ou de l'histoire interrompue.)
Elle reprit:
—Au retour, j'ai trouvé un mot d'elle, me remerciant de tout ce que j'avais fait, et me disant qu'elle retournait à Paris. Elle n'a pas laissé d'adresse.
—Et elle n'a plus écrit?
—Plus rien.
Christophe vit de nouveau disparaître dans la nuit la mélancolique figure, dont les yeux lui étaient réapparus, un moment, tels qu'ils le regardaient, pour la dernière fois, à travers la glace du wagon.
L'énigme de la France se posait de nouveau avec plus d'insistance. Christophe ne se lassait pas d'interroger madame Reinhart sur ce pays qu'elle prétendait connaître. Et madame Reinhart, qui n'y était jamais allée, ne manquait point de le renseigner. Reinhart, excellent patriote, plein de préjugés contre la France, qu'il ne connaissait pas mieux que sa femme, risquait parfois des réserves, quand l'enthousiasme de Lili devenait trop excessif; mais elle redoublait ses assertions avec plus d'énergie, et Christophe, sans savoir, de confiance, faisait chorus.
Ce qui lui fut plus précieux encore que les souvenirs de Lili Reinhart, ce furent ses livres. Elle s'était fait une petite bibliothèque de volumes français: des manuels d'école, quelques romans, quelques pièces achetées au hasard. À Christophe, avide de s'instruire et ne connaissant rien de la France, ils parurent un trésor, quand Reinhart les mit obligeamment à sa disposition.
Il prit, pour commencer, des recueils de morceaux choisis, d'anciens livres scolaires, qui avaient servi à Lili Reinhart ou à son mari, quand ils allaient en classe. Reinhart assurait qu'il lui fallait débuter par là, s'il voulait apprendre à se débrouiller au milieu de cette littérature, qui lui était totalement inconnue. Christophe, plein de respect pour ceux qui en savaient plus que lui, obéit religieusement; et, le soir même, il se mit à lire. Il tâcha d'abord de se rendre compte sommairement des richesses qu'il possédait.
Il fit connaissance avec des écrivains français, qui se nommaient: Théodore-Henri Barrau, François Pétis de la Croix, Frédéric Baudry, Emile Delérot, Charles-Auguste-Désiré Filon, Samuel Descombaz, et Prosper Baur. Il lut des poésies de l'abbé Joseph Reyre, de Pierre Lachambaudie, du duc de Nivernois, de André van Hasselt, d'Andrieux, de madame Colet, de Constance-Marie princesse de Salm-Dyck, de Henriette Hollard, de Gabriel-Jean-Baptiste-Ernest-Wilfrid Legouvé, d'Hippolyte Violeau, de Jean Reboul, de Jean Racine, de Jean de Béranger, de Frédéric Béchard, de Gustave Nadaud, d'Édouard Plouvier, d'Eugène Manuel, de Hugo, de Millevoye, de Chênedollé, de James Lacour Delâtre, de Félix Chavannes, de Francis-Edouard-Joachim dit François Coppée, et de Louis Belmontet. Christophe, perdu, noyé, submergé dans ce déluge poétique, passa à la prose. Il y trouva Gustave de Molinari, Fléchier, Ferdinand-Edouard Buisson, Mérimée, Malte-Brun, Voltaire, Lamé-Fleury, Dumas père, J.-J. Rousseau, Mézières, Mirabeau, de Mazade, Claretie, Cortambert, Frédéric II, et monsieur de Voguë. L'historien français le plus souvent cité était Maximilien Samson-Frédéric Schœll. Christophe trouva dans cette anthologie française la Proclamation du nouvel Empire d'Allemagne; et il lut un portrait des Allemands par Frédéric-Constant de Rougemont, où il apprit que «l'Allemand naissait pour vivre dans le monde de l'âme. Il n'a point la gaieté bruyante et légère du Français. Il a beaucoup d'âme; ses affections sont tendres, profondes. Il est infatigable dans ses travaux et persévérant dans ses entreprises. Il n'est pas de peuple qui soit plus moral, et chez qui la durée de la vie soit aussi longue. L'Allemagne compte un nombre extraordinaire d'écrivains. Elle a le génie des beaux-arts. Tandis que les habitants des autres pays mettent leur gloire à être Français, Anglais, Espagnols, l'Allemand au contraire embrasse dans son amour impartial l'humanité entière. Enfin, par sa position au centre même de l'Europe, la nation allemande semble être à la fois le cœur et la raison supérieure de l'humanité.»
Christophe, fatigué, étonné, ferma le livre et pensa:
—Les Français sont de bons garçons; mais ils ne sont pas forts.
Il prit un autre volume. Celui-ci était d'un niveau supérieur; il s'adressait aux grandes Écoles. Musset y tenait trois pages, et Victor Duruy trente. Lamartine sept pages, et Thiers près de quarante. On donnait le Cid tout entier,—presque tout entier:—(on avait supprimé les monologues de don Diègue et de Rodrigue, parce qu'ils faisaient longueur...)—Lanfrey exaltait la Prusse contre Napoléon Ier: aussi, la place ne lui avait pas été mesurée; il en tenait plus, à lui seul, que tous les grands classiques du dix-huitième siècle. De copieux récits des défaites françaises de 1870 avaient été puisés dans la Débâcle de Zola. On ne voyait là ni Montaigne, ni La Rochefoucauld, ni La Bruyère, ni Diderot, ni Stendhal, ni Balzac, ni Flaubert. En revanche, Pascal, absent de l'autre livre, apparaissait dans celui-ci, à titre de curiosité; et Christophe apprit en passant que ce convulsionnaire «faisait partie des pères de Port-Royal, institution de jeunes filles, près de Paris...[2]»
Christophe fut sur le point d'envoyer tout promener: la tête lui tournait; il n'y voyait plus rien. Il se disait: «Jamais je n'en sortirai.» Il était incapable de se formuler un jugement. Il feuilletait au hasard, depuis des heures, sans savoir où il allait. Il ne lisait pas facilement le français; et, quand il s'était donné bien du mal pour comprendre un passage, c'étaient presque toujours des choses insignifiantes et ronflantes.
Cependant, du milieu de ce chaos, des traits de lumière jaillissaient, des coups d'épée, des mots cinglants et sabrants, des rires héroïques. Peu à peu, une impression se dégageait de cette première lecture, peut-être par le fait du plan tendancieux des recueils. Les éditeurs allemands avaient surtout choisi dans ces morceaux tout ce qui pouvait établir, au témoignage des Français eux-mêmes, les défauts des Français et la supériorité allemande. Mais ils ne se doutaient pas que ce qu'ils mettaient ainsi en lumière, aux yeux d'un esprit indépendant, comme Christophe, c'était l'étonnante liberté de ces Français, qui critiquaient tout chez eux et louaient leurs adversaires. Michelet célébrait Frédéric II, Lanfrey les Anglais de Trafalgar, Charras la Prusse de 1813. Nul ennemi de Napoléon n'avait osé en parler d'une façon aussi dure. Les choses les plus respectées n'étaient pas à l'abri de leur esprit frondeur. Jusque sous le grand Roi, les poètes à perruques avaient leur franc-parler. Molière n'épargnait rien. La Fontaine raillait tout. Boileau flétrissait la noblesse. Voltaire insultait la guerre, fessait la religion, bafouait la patrie. Moralistes, satiriques, pamphlétaires, auteurs comiques, rivalisaient d'audace joyeuse ou sombre. C'était un manque de respect universel. Les honnêtes éditeurs allemands en étaient quelquefois effarés; ils éprouvaient le besoin de rassurer leur conscience, en cherchant à excuser Pascal, qui mettait dans le même sac les cuisiniers, les crocheteurs, les soldats et les goujats; ils protestaient, en note, que Pascal n'eût point parlé ainsi, s'il avait connu les nobles armées modernes. Ils ne manquaient pas non plus de rappeler avec quel bonheur Lessing avait corrigé les Fables de la Fontaine, changeant d'après le conseil du Genevois Rousseau, le fromage de maître Corbeau en un morceau de viande empoisonnée, dont meurt le vil renard:
«Puissiez-vous ne jamais obtenir que du poison, maudits flatteurs!»
Ils clignotaient des yeux devant la vérité nue; mais Christophe se réjouissait: il aimait la lumière. De-ci, de-là, il avait bien un petit heurt, lui aussi; il n'était pas habitué à cette indépendance effrénée, qui, aux yeux de l'Allemand le plus libre, malgré tout habitué à la discipline, fait l'effet de l'anarchie. Il était dérouté d'ailleurs par l'ironie française: il prenait certaines choses trop au sérieux; d'autres, qui étaient d'implacables négations, lui semblaient au contraire des paradoxes plaisants. N'importe! Étonné ou choqué, il était attiré, peu à peu. Il avait renoncé à classer ses impressions; il passait d'un sentiment à l'autre: il vivait. La gaieté des récits français:—Chamfort, Ségur, Dumas père, Mérimée, pêle-mêle entassés,—lui dilatait l'esprit; et, de temps en temps, par bouffées, montait de quelque page l'odeur enivrante et farouche des Révolutions.
Il était près du matin, quand Louisa, qui dormait dans la chambre voisine, vit, en se réveillant, la lumière filtrer entre les fentes de la porte de Christophe. Elle frappa au mur et lui demanda s'il était malade. Une chaise grinça sur le plancher; la porte s'ouvrit; et Christophe apparut, en chemise, une bougie et un livre à la main, avec des gestes solennels et burlesques. Louisa, saisie, se dressa sur son lit, pensant qu'il était fou. Il se mita rire, et, agitant sa bougie, il déclamait une scène de Molière. Au milieu d'une phrase, il pouffa; il s'assit au pied du lit de sa mère, pour reprendre haleine; la lumière tremblait dans sa main. Louisa, rassurée, bougonnait affectueusement:
—Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Veux-tu aller te coucher!... Mon pauvre garçon, tu deviens donc tout à fait idiot?
Mais il repartait de plus belle:
—Tu dois écouter cela!
Et, s'installant à son chevet, il se mit à lui lire la pièce, en reprenant depuis le commencement. Il croyait voir Corinne; il entendait son accent hâbleur, Louisa protestait:
—Va-t'en! Va-t'en! Tu vas prendre froid. Tu m'ennuies. Laisse-moi dormir!
Il continuait, inexorable. Il gonflait la voix, il remuait les bras, il s'étranglait de rire; et il demandait à sa mère si ce n'était pas admirable. Louisa lui avait tourné le dos, et, pelotonnée dans ses couvertures, elle se bouchait les oreilles et disait:
—Laisse-moi tranquille!...
Mais elle riait tout bas de l'entendre rire. À la fin, elle cessa de protester. Et comme Christophe, ayant terminé l'acte, la prenait vainement à témoin de l'intérêt de sa lecture, il se pencha sur elle, et vit qu'elle dormait. Alors, il sourit, lui baisa doucement les cheveux, et, sans bruit, rentra chez lui.
Il retourna puiser dans la bibliothèque des Reinhart. Tous les livres y passèrent, pêle-mêle, les uns après les autres. Christophe dévora tout. Il avait un tel désir d'aimer le pays de Corinne et de l'inconnue, tant d'enthousiasme à dépenser qu'il en trouva l'emploi. Même dans des œuvres de second ordre, une page, un mot lui faisait l'effet d'une bouffée d'air libre. Il se l'exagérait, surtout quand il en parlait à madame Reinhart, qui ne manquait pas de surenchérir. Bien qu'elle fût ignorante comme une carpe, elle s'amusait à opposer la culture française à la culture allemande, et elle humiliait celle-ci au profit de celle-là, pour faire enrager son mari et pour se venger des ennuis qu'elle avait à subir de la petite ville.
Reinhart s'indignait. En dehors de sa science, il en était resté aux notions enseignées à l'école. Pour lui, les Français étaient des gens adroits, intelligents dans les choses pratiques, aimables, sachant causer, mais légers, susceptibles, vantards, incapables d'aucun sérieux, d'aucun sentiment fort, d'aucune sincérité,—un peuple sans musique, sans philosophie, sans poésie, (à part l'Art Poétique, Béranger, et François Coppée),—le peuple du pathos, des grands gestes, de la parole exagérée, et de la pornographie. Il n'avait pas assez de mots pour flétrir l'immoralité latine; et, faute de mieux, il revenait toujours à celui de frivolité, qui, dans sa bouche, comme dans celle de ses compatriotes, prenait un sens particulièrement désobligeant. Il terminait par le couplet habituel en l'honneur du noble peuple allemand,—le peuple moral («Par là, dit Herder, il se distingue de tous les autres peuples»,)—le peuple fidèle (treues Volk... Treu) cela veut tout dire: sincère, fidèle, loyal, et droit—le Peuple par excellence, comme dit Fichte,—la Force allemande, symbole de toute justice et de toute vérité,—la Pensée allemande,—le Gemüt allemand,—la langue allemande, seule langue originale, seule conservée pure, comme la race elle-même,—les femmes allemandes, le vin allemand, et le chant allemand... «L'Allemagne, l'Allemagne au-dessus de tout, dans le monde!»
Christophe protestait. Madame Reinhart s'esclaffait. Ils criaient très fort tous les trois. Ils s'entendaient très bien ensemble: ils savaient tous les trois qu'ils étaient de bons Allemands.
Christophe venait souvent causer, dîner, se promener avec ses nouveaux amis. Lili Reinhart le choyait, lui faisait des soupers succulents: elle était enchantée de trouver ce prétexte pour satisfaire sa propre gourmandise. Elle avait toutes sortes d'attentions sentimentales et culinaires. Pour l'anniversaire de Christophe, elle lui fit une tarte sur laquelle étaient plantées vingt bougies, et, au milieu, une petite figure en sucre, vêtue à la grecque, qui avait la prétention, de représenter Iphigénie, et qui tenait un bouquet. Christophe, profondément Allemand, en dépit qu'il en eut, était touché par ces manifestations pas très raffinées d'une affection véritable.
Les excellents Reinhart savaient trouver des moyens plus délicats de prouver leur active amitié. À l'instigation de sa femme, Reinhart, qui lisait à peine les notes de musique, acheta une vingtaine d'exemplaires des Lieder de Christophe,—(les premiers qui fussent sortis de la boutique de l'éditeur);—il les répandit en Allemagne, de différents côtés, parmi ses connaissances universitaires; il en fit envoyer un certain nombre à des libraires de Leipzig et de Berlin, avec qui il était en relations pour ses ouvrages scolaires. Cette initiative touchante et maladroite, dont Christophe ne sut rien, ne donna d'ailleurs aucun fruit, pour le moment. Les Lieder envoyés de côté et d'autre semblèrent avoir fait long feu: personne n'en parla; et les Reinhart, chagrins de cette indifférence, s'applaudissaient d'avoir tenu Christophe en dehors de leurs démarches; car il en aurait eu plus de peine que de réconfort.—Mais, en réalité, rien ne se perd, comme on a tant de fois l'occasion de le constater dans la vie; nul effort ne reste vain. On n'en sait rien, pendant des années; puis, un jour, on s'aperçoit que la pensée a fait son chemin. Les Lieder de Christophe allèrent à petits pas au cœur de quelques braves gens, perdus dans leur province, trop timides, ou trop las, pour le lui dire.
Un seul lui écrivit. Deux ou trois mois après les envois de Reinhart, Christophe reçut une lettre: émue, cérémonieuse, enthousiaste, de formes surannées, elle venait d'une petite ville de Thuringe, et était signée «Universitätsmusikdirektor Professor Dr Peter Schulz ».
Ce fut une grande joie pour Christophe, une plus grande encore pour les Reinhart, quand il ouvrit chez eux la lettre qu'il avait oubliée deux jours dans sa poche. Ils la lurent ensemble. Reinhart échangeait avec sa femme des signes d'intelligence, que ne remarquait pas Christophe. Celui-ci semblait radieux, quand brusquement Reinhart le vit s'assombrir et s'interrompre, au milieu de sa lecture.
—Eh bien, pourquoi t'arrêtes-tu? demanda-t-il.
(Ils se tutoyaient déjà.)
Christophe jeta la lettre sur la table, avec colère.
—Non, c'est trop fort! dit-il.
—Quoi donc?
—Lis!
Il tourna le dos à la table, et s'en alla bouder dans un coin.
Reinhart lut, avec sa femme, et ne trouva que les expressions de l'admiration la plus éperdue.
—Je ne vois pas, dit-il, étonné.
—Tu ne vois pas? Tu ne vois pas?...—cria Christophe, en reprenant la lettre, et en la lui mettant sous les yeux.—Mais tu ne sais donc pas lire? Tu ne vois pas qu'il est aussi un «Brahmine»?
Alors seulement, Reinhart remarqua que le Universitätsmusikdirector, dans une ligne de sa lettre, comparait les Lieder de Christophe à ceux de Brahms... Christophe se lamentait:
—Un ami! Je trouve enfin un ami!... Et à peine je l'ai gagné que je l'ai déjà perdu!...
Il était suffoqué par la comparaison. Si on l'eût laissé faire, sur-le-champ, il eût répondu par une lettre de sottises. Ou, peut-être, à la réflexion, il se fût cru très sage et très généreux, en ne répondant rien du tout. Heureusement, les Reinhart, tout en s'amusant de sa mauvaise humeur, l'empêchèrent de commettre une absurdité de plus. Ils lui firent écrire un mot de remerciements. Mais ce mot, écrit en rechignant, était froid et contraint. L'enthousiasme de Peter Schulz n'en fut pas ébranlé: il envoya encore deux ou trois lettres, débordantes d'affection. Christophe n'était pas un bon épistolier; et, quoiqu'un peu réconcilié avec l'ami inconnu par le ton de sincérité qu'il sentait à travers ses lignes, il laissa tomber la correspondance. Schulz finit par se taire. Christophe n'y pensa plus.
Il voyait maintenant les Reinhart, chaque jour, et souvent plusieurs fois par jour. Ils passaient presque toutes leurs soirées ensemble. Après une journée, seul, concentré en lui-même, il avait un besoin physique de parler, de dire ce qu'il avait en tête, même si on ne le comprenait pas, de rire avec ou sans raison, de se dépenser, de se détendre.
Il leur faisait de la musique. N'ayant pas d'autre moyen de témoigner sa reconnaissance, il se mettait au piano et jouait pendant des heures. Madame Reinhart n'était pas du tout musicienne, et elle avait grand peine à ne pas bâiller; mais, par sympathie pour Christophe, elle feignait de s'intéresser à ce qu'il jouait. Reinhart, sans être beaucoup plus musicien, était touché, d'une façon matérielle, par certaines pages; et alors, il était remué violemment, jusqu'à en avoir les larmes aux yeux: ce qui lui semblait idiot. Le reste du temps, rien: c'était du bruit pour lui. Règle générale, d'ailleurs: il n'était jamais ému que par ce qu'il y avait de moins bon dans l'œuvre,—des passages tout à fait insignifiants.—Ils se persuadaient tous deux qu'ils comprenaient Christophe; et Christophe voulait se le persuader aussi. Il lui prenait bien de temps en temps une envie malicieuse de se moquer d'eux: il leur tendait des pièges, il leur jouait des choses qui n'avaient aucun sens, d'ineptes pots-pourris; et il leur laissait croire qu'il en était l'auteur. Puis, quand ils avaient bien admiré, il leur avouait la farce. Alors, ils se méfiaient; et, depuis, quand Christophe prenait des airs mystérieux pour leur jouer un morceau, ils s'imaginaient qu'il voulait encore les attraper; et ils le critiquaient. Christophe les laissait dire, faisait chorus, convenait que cette musique ne valait pas le diable, puis, brusquement, s'esclaffait:
—Cré coquins! Comme vous avez raison!... C'est de moi!
Il était heureux, comme un roi, de les avoir trompés. Madame Reinhart, un peu vexée, venait lui donner une petite tape; mais il riait de si bon cœur qu'ils riaient avec lui. Ils ne prétendaient pas à l'infaillibilité. Et comme ils ne savaient plus sur quel pied danser, Lili Reinhart avait pris le parti de tout critiquer, et son mari de tout louer: ainsi, ils étaient bien sûrs que l'un des deux serait toujours de l'avis de Christophe.
C'était moins le musicien qui les attirait en Christophe que le bon garçon, un peu toqué, affectueux et vivant. Le mal qu'ils avaient entendu dire de lui les avait disposés en sa faveur: comme lui, ils étaient oppressés par l'atmosphère de la petite ville; comme lui, ils étaient francs, ils jugeaient par eux-mêmes, et ils le regardaient comme un grand enfant, pas très habile dans la vie et victime de sa franchise.
Christophe ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur ses nouveaux amis; et il était un peu mélancolique de se dire qu'ils ne comprenaient pas le plus profond de son être, que jamais ils ne le comprendraient. Mais il était sevré d'amitié, et il en avait tant besoin qu'il leur gardait une gratitude infinie de vouloir bien l'aimer un peu. L'expérience de cette dernière année l'avait instruit: il ne se reconnaissait plus le droit d'être difficile. Deux ans plus tôt, il n'eût pas été si patient: il se rappelait, avec un remords amusé, sa sévérité à l'égard des braves et ennuyeux Euler. Hélas! comme il était devenu sage!... Il en soupirait un peu. Une voix secrète lui soufflait:
—Oui, mais pour combien de temps?
Cela le faisait sourire, et il était consolé.
Que n'eût-il pas donné pour avoir un ami, un seul qui le comprît et partageât son âme!—Mais bien qu'il fût tout jeune encore, il avait assez d'expérience du monde pour savoir que son vœu était de ceux que la vie réalise le plus difficilement, et qu'il ne pouvait prétendre à être plus heureux que la plupart des vrais artistes qui l'avaient précédé. Il avait appris à connaître l'histoire de quelques-uns d'entre eux. Certains livres, empruntés à la bibliothèque de Reinhart, lui avaient fait connaître les terribles épreuves par où avaient passé les musiciens allemands du dix-septième siècle, et la tranquille constance, dont telle de ces grandes âmes,—la plus grande de toutes: l'héroïque Schütz,—avait fait preuve, poursuivant inébranlablement sa route, au milieu des villes incendiées, des provinces englouties par la peste, de la patrie envahie, foulée aux pieds par les bandes de toute l'Europe et—le pire—brisée, lassée, dégradée par le malheur, n'essayant plus de lutter, indifférente à tout, n'aspirant qu'au repos. Il pensait: «Qui aurait le droit de se plaindre devant un pareil exemple? Ils n'avaient point de public, ils n'avaient point d'avenir; ils écrivaient pour eux seuls et pour Dieu; ce qu'ils écrivaient aujourd'hui, le jour qui allait venir peut-être l'anéantirait. Cependant, ils continuaient d'écrire, et ils n'étaient point tristes: rien ne leur faisait perdre leur bonhomie intrépide; ils se satisfaisaient de leur chant, et ils ne demandaient à la vie que de vivre, de gagner tout juste leur pain, de se décharger de leur pensée dans leur art, et de trouver deux ou trois braves gens, simples, vrais, pas artistes, qui sans doute ne les comprenaient pas, mais qui les aimaient bonnement.—Comment eût-il osé être plus exigeant? Il y a un minimum de bonheur, que l'on peut demander. Mais nul n'a droit à davantage: c'est à soi-même de se donner le surplus; les autres ne vous le doivent pas.»
Ces pensées le rassérénaient; et il en aimait mieux ses braves amis Reinhart. Il ne pensait pas qu'on viendrait lui disputer cette dernière affection.
Il comptait sans la méchanceté des petites villes. Leurs rancunes sont tenaces,—d'autant plus qu'elles n'ont aucun but. Une bonne haine, qui sait ce qu'elle veut, s'apaise quand elle l'a obtenu. Mais des êtres malfaisants par ennui ne désarment jamais; car ils s'ennuient toujours. Christophe était une proie offerte à leur désœuvrement. Il était battu, sans doute; mais il avait l'audace de n'en point paraître accablé. Il n'inquiétait plus personne; mais il ne s'inquiétait de personne. Il ne demandait rien: on ne pouvait rien contre lui. Il était heureux avec ses nouveaux amis, et indifférent à tout ce qu'on disait ou pensait de lui. Cela ne pouvait se supporter.—Madame Reinhart irritait encore plus. L'amitié qu'elle affichait pour Christophe, à l'encontre de toute la ville, semblait, comme son attitude, un défi à l'opinion. La bonne Lili Reinhart ne défiait rien, ni personne: elle ne pensait pas à provoquer les autres; elle faisait ce qui lui semblait bon, sans demander l'avis des autres. C'était la pire provocation.
On était à l'affût de leurs gestes. Ils ne se méfiaient point. L'un extravagant et l'autre écervelée, ils manquaient de prudence, quand ils sortaient ensemble, ou même, à la maison, quand, le soir, ils causaient et riaient, accoudés au balcon. Ils se laissaient aller innocemment à une familiarité de manières, qui devait fournir un aliment à la calomnie.
Un matin, Christophe reçut une lettre anonyme. On l'accusait, en termes bassement injurieux, d'être l'amant de madame Reinhart. Les bras lui en tombèrent. Jamais il n'avait eu la moindre pensée, même de flirt, avec elle: il était trop honnête; il avait pour l'adultère une horreur puritaine: la seule idée de ce partage malpropre lui causait une répulsion. Prendre la femme d'un ami lui eût semblé un crime; et Lili Reinhart eût été la dernière personne du monde avec qui il eût été tenté de le commettre: la pauvre femme n'était point belle, il n'aurait même pas eu l'excuse d'une passion.
Il retourna chez ses amis, honteux et gêné. Il trouva la même gêne. Chacun d'eux avait reçu une lettre analogue; mais ils n'osaient pas se le dire; et, tous trois, s'observant l'un l'autre et s'observant soi-même, ils n'osaient plus ni bouger, ni parler, et ne faisaient que des sottises. Si l'insouciance naturelle de Lili Reinhart reprenait le dessus, un moment, si elle se remettait à rire et dire des extravagances, brusquement un regard de son mari, ou de Christophe, l'interloquait; le souvenir de la lettre lui traversait l'esprit; elle se troublait; Christophe et Reinhart se troublaient aussi. Et chacun pensait:
—Les autres ne savent-ils pas?
Cependant, ils ne s'en disaient rien et tâchaient de vivre comme avant.
Mais les lettres anonymes continuèrent, de plus en plus insultantes, ordurières; elles les jetaient dans un état d'énervement et de honte intolérable. Ils se cachaient, quand ils les recevaient, et ils n'avaient pas la force de les brûler sans les lire: ils les ouvraient d'une main tremblante; le cœur leur manquait en dépliant la page; et, quand ils y lisaient ce qu'ils craignaient d'y lire, avec quelque variation nouvelle sur le même thème,—inventions ingénieuses et ignobles d'un esprit appliqué à nuire,—ils en pleuraient tout bas. Ils s'épuisaient à chercher quel pouvait être le misérable, qui s'attachait à les poursuivre.
Un jour, madame Reinhart, à bout de forces, avoua à son mari la persécution dont elle était victime; et il lui avoua, les larmes aux yeux, qu'il la subissait aussi. En parleraient-ils à Christophe? Ils n'osaient. Il fallait l'avertir pourtant, afin qu'il fût prudent.—Dès les premiers mots que madame Reinhart lui dit, en rougissant, elle vit avec consternation que Christophe recevait aussi des lettres. Cet acharnement dans la méchanceté les affola. Madame Reinhart ne douta plus que la ville entière ne fût dans le secret. Au lieu de se soutenir mutuellement, ils achevèrent de se démoraliser. Ils ne savaient que faire. Christophe parlait d'aller casser la tête à quelqu'un.—Mais à qui? Et puis, ce serait alors que les calomnies auraient beau jeu!... Mettre la police au courant des lettres? Ce serait rendre publiques leurs insinuations... Faire semblant de les ignorer? Ce n'était plus possible. Leurs rapports d'amitié étaient maintenant troublés. Reinhart avait beau avoir une foi absolue en l'honnêteté de sa femme et de Christophe: il les soupçonnait malgré lui. Il sentait la dégradante absurdité des ses soupçons; il s'imposait de laisser seuls ensemble Christophe et sa femme. Mais il souffrait; et sa femme le voyait bien.
Pour elle, ce fut encore pis. Jamais elle n'avait pensé à flirter avec Christophe, pas plus que Christophe avec elle. Les calomnies lui insinuèrent la ridicule idée que Christophe, après tout, avait peut-être pour elle un sentiment amoureux; et, bien qu'il fût à cent lieues de lui en rien montrer, elle crut bon de s'en défendre, non par des allusions précises, mais par des précautions maladroites, que Christophe ne comprit pas d'abord, et qui, lorsqu'il comprit, le mirent hors de lui. C'était bête a pleurer! Lui, amoureux de cette brave petite bourgeoise, bonne, laide et commune!... Et qu'elle le crût!... Et qu'il ne pût pas se défendre, lui dire, dire au mari:
—Allons donc! Soyez tranquilles! Il n'y a pas de danger!...
Mais non, il ne pouvait pas offenser ces excellentes gens. Et il se rendait compte, d'ailleurs, que si elle se défendait d'être aimée par lui, c'était qu'elle commençait secrètement à l'aimer: les lettres anonymes avaient eu ce beau résultat de lui en avoir soufflé l'idée sotte et romanesque.
La situation était devenue si pénible et si niaise qu'il n'était plus possible de continuer. Lili Reinhart, qui, en dépit de ses forfanteries de langage, n'avait aucune force de caractère, perdit la tête devant l'hostilité sourde de la ville. Ils se donnèrent des prétextes honteux pour ne plus se voir:
«Madame Reinhart était souffrante... Reinhart avait à travailler... Ils s'absentaient pour quelques jours...»
Mensonges maladroits, que le hasard prenait un malin plaisir à démasquer.
Plus franc, Christophe dit:
—Séparons-nous, mes pauvres amis. Nous ne sommes pas de force.
Les Reinhart pleurèrent.—Mais ce fut un soulagement pour eux, après qu'ils eurent rompu.
La ville pouvait triompher. Cette fois, Christophe était bien seul. Elle lui avait volé jusqu'au dernier souffle d'air:—l'affection, si humble soit-elle, sans laquelle aucun cœur ne peut vivre.
[1]Sobriquet, sous lequel des pamphlétaires allemands désignaient entre eux le Kaiser.
[2]Les anthologies de la littérature française, que Jean-Christophe emprunte à la bibliothèque de ses amis Reinhart, sont:
I.—Choix de lectures françaises à l'usage des écoles secondaires, par HUBERT H. WINGERATH, docteur en philosophie, directeur de l'École réale Saint-Jean à Strasbourg.—Deuxième partie: classes moyennes.—7e édition, 1902. Dumont-Schauberg.
II.—L. HERBIG et G. F. BURGUY: La France littéraire, remaniée par F. TENDERING, directeur du Real-Gymnasium des Johanneums, Hambourg.—1904. Brunswick.
Il n'avait plus personne. Tous ses amis avaient disparu. Le cher Gottfried, qui lui était venu en aide à des heures difficiles et dont il aurait eu tant besoin en ce moment, était parti depuis des mois, et cette fois, pour toujours. Un soir de l'été dernier, une lettre, écrite d'une grosse écriture, et qui portait l'adresse d'un village lointain, avait appris à Louisa que son frère était mort, dans une de ces tournées vagabondes que le petit colporteur s'obstinait à continuer, malgré sa mauvaise santé. On l'avait enterré là-bas, dans le cimetière du pays. La dernière amitié virile et sereine, qui eût été capable de soutenir Christophe, s'était engloutie dans le gouffre. Il restait seul, avec sa mère vieillie et indifférente à sa pensée,—qui ne pouvait que l'aimer, qui ne le comprenait pas. Autour de lui, l'immense plaine allemande, l'océan morne. À chaque effort pour en sortir, il s'enfonçait davantage. La ville ennemie le regardait se noyer...
Comme il se débattait, dans un éclair lui apparut, au milieu de sa nuit, l'image de Hassler, le grand musicien qu'il avait tant aimé, quand il était enfant, et dont la gloire maintenant rayonnait sur tout le pays allemand. Il se souvint des promesses que Hassler lui avait faites autrefois. Et il se raccrocha aussitôt à cette épave avec une vigueur désespérée. Hassler pouvait le sauver! Hassler devait le sauver! Que lui demandait-il? Ni secours, ni argent, ni aide matérielle. Rien, sinon qu'il le comprît. Hassler avait été persécuté comme lui. Hassler était un homme libre. Il comprendrait un homme libre, que la médiocrité allemande poursuivait de ses rancunes et tachait d'écraser. Ils combattaient le même combat.
Aussitôt qu'il eut cette idée, il l'exécuta. Il prévint sa mère qu'il serait absent, huit jours; et il prit, le soir même, le train pour la grande ville du nord de l'Allemagne, où Hassler était Kapellmeister. Il ne pouvait plus attendre. C'était le dernier effort pour respirer.
Hassler était célèbre. Ses ennemis n'avaient pas désarmé; mais ses amis criaient qu'il était le plus grand musicien présent, passé, et futur. Il était entouré de partisans et de dénigrants également absurdes. Comme il n'était pas d'une forte trempe, il avait été aigri par ceux-ci, et amolli par ceux-là. Il mettait toute son énergie à faire ce qui était désagréable à ses critiques et pouvait les faire crier; il était comme un gamin qui joue des niches. Ces niches étaient souvent du goût le plus détestable: non seulement, il employait son talent prodigieux à des excentricités musicales, qui faisaient hérisser les cheveux sur la tête des pontifes; mais il manifestait une prédilection taquine pour des textes baroques, pour des sujets bizarres, pour des situations équivoques et scabreuses, en un mot, pour tout ce qui pouvait blesser le bon sens et la décence ordinaires. Il était content, quand le bourgeois hurlait; et le bourgeois ne s'en faisait pas faute. L'empereur même, qui se mêlait d'art, avec l'insolente présomption des parvenus et des princes, regardait comme un scandale public la renommée de Hassler et ne laissait échapper aucune occasion de manifester à ses œuvres effrontées une indifférence méprisante. Hassler, enragé et enchanté de cette auguste opposition, qui, pour les partis avancés de l'art allemand, était presque devenue une consécration, continuait de plus belle à casser les vitres. À chaque nouvelle sottise, les amis s'extasiaient et criaient au génie.
La coterie de Hassler se composait surtout de littérateurs, de peintres, et de critiques décadents, qui avaient assurément le mérite de représenter le parti de la révolte contre la réaction—éternellement menaçante dans l'Allemagne du Nord—de l'esprit piétiste et de la morale d'État; mais leur indépendance s'était exaspérée, dans la lutte, jusqu'au ridicule, dont ils n'avaient pas conscience; car si beaucoup d'entre eux ne manquaient point d'un talent assez âpre, ils avaient peu d'intelligence, et encore moins de goût. Ils ne pouvaient plus sortir de l'atmosphère factice, qu'ils s'étaient fabriquée; et, comme tous les cénacles, ils avaient fini par perdre entièrement le sens de la vie réelle. Ils faisaient loi pour eux-mêmes et pour les centaines de nigauds qui lisaient leurs revues et acceptaient bouche bée tout ce qu'il leur plaisait d'édicter. Leur adulation avait été funeste à Hassler, en le rendant trop complaisant pour lui. Il acceptait sans examen toutes les idées musicales qui lui passaient par la tête; et il était intimement persuadé que, quoi qu'il pût écrire d'inférieur à lui-même, c'était supérieur encore au reste des musiciens. De ce que cette pensée fût malheureusement trop vraie dans la plupart des cas, il ne s'ensuivait pas qu'elle fût très saine et propre à faire naître les grandes œuvres. Hassler avait au fond un parfait mépris pour tous, amis et ennemis; et ce mépris amer et goguenard s'étendait à lui-même et à toute la vie. Il s'enfonçait d'autant plus dans son scepticisme ironique qu'il avait cru autrefois a une quantité de choses généreuses et naïves. N'ayant pas eu la force de les défendre contre la lente destruction des jours, ni l'hypocrisie de se persuader qu'il croyait à ce qu'il ne croyait plus, il s'acharnait à en persifler le souvenir. Il avait une nature d'Allemand du Sud, indolente et molle, peu faite pour résister à l'excès de la fortune ou de l'infortune, du chaud ou du froid, et qui a besoin, pour conserver son équilibre, d'une température modérée. Il s'était laissé aller, d'une façon insensible, à jouir paresseusement de la vie: il aimait la bonne chère, les lourdes boissons, les flâneries oisives, et les molles pensées. Son art s'en ressentait, quoiqu'il fût trop bien doué pour que des étincelles de génie n'éclatassent pas encore au milieu de sa musique lâchée, qui s'abandonnait au goût de la mode. Nul ne sentait mieux que lui sa déchéance. À vrai dire, il était le seul qui la sentît,—à de rares moments, que, naturellement, il évitait. Alors, il était misanthrope, absorbé par ses humeurs noires, ses préoccupations égoïstes, ses soucis de santé,—indifférent à tout ce qui avait excité autrefois son enthousiasme ou sa haine.
Tel était l'homme auprès de qui Jean-Christophe venait chercher un réconfort. Avec quel espoir il arriva, par un matin froid et pluvieux, dans la ville où vivait celui qui, à ses yeux, symbolisait en art l'esprit d'indépendance! Il attendait de lui la parole d'amitié et de vaillance, dont il avait besoin pour continuer l'ingrate et nécessaire bataille que tout véritable artiste doit livrer au monde, jusqu'à son dernier souffle, sans désarmer un seul jour: car, comme l'a dit Schiller, «la seule relation avec le public, dont on ne se repente jamais,—c'est la guerre.»
Christophe était si impatient qu'il prit à peine le temps de déposer son sac dans le premier hôtel venu, près de la gare, avant de courir au théâtre, pour s'informer de l'adresse de Hassler. Hassler habitait assez loin du centre, dans un faubourg de la ville. Christophe prit un tram électrique, en mordant à belles dents un petit pain. Sou cœur battait, en approchant du but.
Le quartier où Hassler avait élu domicile était bâti dans cette étrange architecture nouvelle, où la jeune Allemagne déverse une barbarie érudite, qui s'épuise en laborieux efforts pour avoir du génie. Au milieu de la ville banale, aux rues droites et sans caractère, s'élevaient brusquement des hypogées d'Égypte, des chalets norvégiens, des cloîtres, des bastions, des pavillons d'Exposition universelle, des maisons ventrues, culs-de-jatte, enfoncées dans la terre, avec une face inerte, un œil unique, énorme, des grilles de cachot, des portes écrasées de sous-marins, des cerceaux de fer, des cryptogrammes d'or dans les barreaux des fenêtres grillées, des monstres vomissants au-dessus de la porte d'entrée, des carreaux de faïence bleue, plaqués par-ci, par-là, partout où on ne les attendait pas, des mosaïques bariolées, représentant Adam et Ève, des toits couverts en tuiles de couleurs disparates; des maisons-châteaux forts, au dernier étage crénelé, avec des animaux difformes sur le faîte, pas de fenêtre d'un côté, puis tout d'un coup, une suite de trous béants, carrés, rectangulaires, des sortes de blessures; de grands pans de murs vides, d'où surgissait soudain,—étayé sur des cariatides nibelungesques,—un balcon massif à une seule fenêtre: perçant sa rampe de pierre, émergeaient deux têtes pointues de vieillards barbus et chevelus, des hommes-poissons de Bœcklin. Sur le fronton d'une de ces prisons, une maison pharaonesque, à un étage bas, avec deux colosses nus à l'entrée, l'architecte avait écrit:
«Que l'artiste montre son univers,
Qui jamais ne fut et jamais ne sera!»
Seine Welt zeige der Künstler
Die niemals war noch jemals sein wird!
Christophe, uniquement absorbé par l'idée de Hassler, regardait avec des yeux ahuris et n'essayait point de comprendre. Il arriva h la maison qu'il cherchait, une des plus simples,—en style carolingien. À l'intérieur, un luxe cossu et banal; dans l'escalier, une atmosphère lourde de calorifère surchauffé; un ascenseur étroit, dont Christophe ne profita point, pour avoir le temps de se préparer à sa visite, en montant les quatre étages, à petits pas, les jambes fléchissantes, le cœur tremblant d'émotion. Durant ce court trajet, son ancienne entrevue avec Hassler, son enthousiasme d'enfant, l'image de grand-père, lui revinrent à l'esprit, comme si c'était hier.
Il était près de onze heures, quand il sonna a la porte. Il fut reçu par une soubrette délurée, aux façons de serva padrona, qui le dévisagea avec impertinence, et commença par déclarer que «Monsieur ne pouvait pas recevoir, parce que Monsieur était fatigué». Puis, le naïf désappointement qui se peignit sur la figure de Christophe l'amusa sans doute; car, après avoir terminé l'examen indiscret qu'elle faisait de toute sa personne, elle s'adoucit brusquement, fit entrer Christophe dans le cabinet de Hassler, et dit qu'elle allait faire en sorte que Monsieur le reçût. Là-dessus, elle lui décocha une petite œillade, et ferma la porte.
Il y avait aux murs quelques peintures impressionnistes et des gravures galantes du dix-huitième siècle français: car Hassler prétendait se connaître à tous les arts; et il associait dans son goût Manet et Watteau, selon les indications qu'il avait reçues du cénacle. Le même mélange de styles se montrait dans l'ameublement, où un fort beau bureau Louis XV était encadré de fauteuils «art nouveau», et d'un divan oriental, avec une montagne de coussins multicolores. Les portes étaient ornées de glaces; et une bibeloterie japonaise couvrait les étagères et le dessus de la cheminée, où trônait le buste de Hassler. Dans une coupe, sur un guéridon, s'étalaient une profusion de photographies de chanteuses, d'admiratrices et d'amis, avec des mots d'esprit et des exclamations enthousiastes. Un désordre incroyable régnait sur le bureau; le piano était ouvert; de la poussière sur les étagères; des cigares à demi brûlés traînaient dans tous les coins...
Christophe entendit, dans la chambre voisine, une voix maussade qui grognait; le verbe tranchant de la petite bonne lui répliquait. Il était clair que Hassler manifestait peu d'enthousiasme à se montrer. Il était clair aussi que la demoiselle avait mis sous son bonnet que Hassler se montrerait; et elle ne se gênait pas pour lui répondre avec une extrême familiarité: sa voix aiguë perçait les murs. Christophe était mal à l'aise d'entendre certaines remarques qu'elle faisait à son maître. Mais celui-ci ne s'en affectait point. Au contraire! on eût dit que ces impertinences l'amusaient; et tout en continuant de grogner, il gouaillait la fille et prenait plaisir à l'exciter. Enfin Christophe entendit une porte s'ouvrir, et, toujours grognant et goguenardant, Hassler qui venait en traînant les pieds.
Il entra. Christophe eut un serrement de cœur. Il le reconnaissait. Plût à Dieu qu'il ne l'eût pas reconnu! C'était bien Hassler, et ce n'était plus lui. Il avait toujours son grand front sans une ride, son visage sans un pli, comme celui d'un enfant; mais il était chauve, empâté, le teint jaune, l'air endormi, la lèvre inférieure un peu pendante, la bouche ennuyée et boudeuse. Il voûtait les épaules, enfonçait ses deux mains dans les poches de son veston débraillé, et traînait des savates aux pieds; sa chemise formait un bourrelet au-dessus de sa culotte, qu'il n'avait même pas achevé de boutonner. Il regarda Christophe de ses yeux somnolents, qui ne s'éclairèrent pas, quand le jeune homme eut balbutié son nom. Il fit un salut automatique, sans parler, indiqua de la tête un siège à Christophe, et s'affaissa, avec un soupir, sur le divan, dont il empila les coussins autour de lui. Christophe répétait:
—J'ai déjà eu l'honneur... Vous aviez eu la bonté.... Je suis Christophe Krafft...
Hassler, enfoncé dans le divan, ses longues jambes croisées, ses mains maigres jointes sur son genou droit, relevé à la hauteur du menton, répliqua:
—Connais pas.
Christophe, la gorge contractée, entreprit de lui rappeler leur ancienne rencontre. En n'importe quelle circonstance, il lui eût été difficile de parler de ces souvenirs intimes; ici, ce lui était une torture: il s'embrouillait dans ses phrases, ne trouvait pas ses mots, disait des choses absurdes, qui le faisaient rougir. Hassler le laissait patauger, sans cesser de le fixer de ses yeux vagues et indifférents. Quand Christophe fut arrivé au bout de son récit, Hassler continua un instant de balancer son genou, en silence, comme s'il attendait que Christophe continuât. Puis, il dit:
—Oui... Cela ne nous rajeunit pas... et s'étira.
Après avoir bâillé, il ajouta:
—... Demande pardon... Pas dormi... Soupé au théâtre, cette nuit... et bâilla de nouveau.
Christophe espérait que Hassler ferait une allusion à ce qu'il venait de lui raconter; mais Hassler, que toute cette histoire n'avait aucunement intéressé, n'en parla plus; et il n'adressa nulle question à Christophe sur sa vie. Quand il eut fini de bâiller, il lui demanda:
—Il y a longtemps que vous êtes à Berlin?
—Je suis arrivé ce matin, dit Christophe.
—Ah! fit Hassler, sans s'étonner autrement. Quel hôtel?
Sans paraître écouter la réponse, il se souleva paresseusement, atteignit un bouton électrique, et sonna.
—Permettez, fit-il.
La petite bonne parut, avec son air impertinent.
—Kitty, dit il, est-ce que tu as la prétention de me faire passer de déjeuner, aujourd'hui?
—Vous ne pensez pourtant pas, dit-elle, que je vais vous apporter votre manger ici, pendant que vous avez quelqu'un?
—Pourquoi donc pas? fit-il en désignant Christophe, d'un clignement d'œil railleur. Il me nourrit l'esprit; je vais nourrir le corps.
—Est-ce que vous n'avez pas honte de faire assister à votre repas, comme une bête dans une ménagerie?
Hassler, au lieu de se fâcher, se mit à rire, et corrigea:
—Comme une bête en ménage...
—Apporte toujours, continua-t-il, je mangerai la honte avec.
Elle se retira, en haussant les épaules.
Christophe, voyant que Hassler ne cherchait toujours pas à s'informer de ce qu'il faisait, tâcha de renouer l'entretien. Il parla de la difficulté de la vie en province, de la médiocrité des gens, de leur étroitesse d'esprit, de l'isolement où on était. Il s'efforçait de l'intéresser à sa détresse morale. Mais Hassler, affalé dans le divan, la tête renversée en arrière sur un coussin et les yeux à demi fermés, le laissait parler, semblant ne pas écouter: ou bien il soulevait un moment ses paupières et lançait quelques mots d'une ironie froide, une saillie bouffonne sur les gens de province, qui coupait net les tentatives de Christophe pour parler plus intimement.—Kitty était revenue avec le plateau du déjeuner: café, beurre, jambon, etc. Elle le déposa, boudeuse, sur le bureau, au milieu des papiers en désordre. Christophe attendit qu'elle fût ressortie, pour reprendre son douloureux récit, qu'il avait tant de peine à suivre.
Hassler avait attiré a lui le plateau; il se versa le café, y trempa les lèvres; puis, familier et bonhomme, un peu méprisant, il interrompit Christophe au milieu d'une phrase, pour lui offrir:
—Une tasse?
Christophe refusa. Il s'évertuait à renouer le fil de sa phrase; mais, de plus en plus démonté, il ne savait plus ce qu'il disait. Il était distrait par le spectacle de Hassler, qui, son assiette sous le menton, se bourrait, comme un enfant, de tartines beurrées et de tranches de jambon, qu'il tenait avec ses doigts. Il réussit pourtant à raconter qu'il composait, qu'il avait fait jouer une ouverture pour la Judith de Hebbel. Hassler écoutait distraitement:
—Was? (Quoi?) demanda-t-il.
Christophe répéta le titre.
—Ach! so, so! (Ah! bon, bon!) fit Hassler, en trempant sa tartine et ses doigts dans sa tasse.
Ce fut tout.
Christophe, découragé, était sur le point de se lever et de partir; mais il pensa à ce long voyage fait en vain; et, ramassant son courage, il proposa à Hassler, en balbutiant, de lui jouer quelques-unes de ses œuvres. Aux premiers mots, Hassler l'arrêta:
—Non, non, je n'y connais rien, dit-il avec son ironie goguenarde et un peu insultante. Et puis, je n'ai pas le temps.
Christophe en eut les larmes aux yeux. Mais il s'était juré de ne pas sortir de là, sans avoir l'avis de Hassler sur ses compositions. Il dit avec un mélange de confusion et de colère:
—Je vous demande pardon; mais vous m'avez promis autrefois de m'entendre; je suis venu uniquement pour cela, du fond de l'Allemagne: vous m'entendrez.
Hassler, qui n'était pas habitué à ces façons, regarda le jeune homme gauche, furieux, rougissant, près de pleurer: cela l'amusa; haussant les épaules avec lassitude, il lui montra le piano du doigt, et dit, d'un air de résignation comique:
—Alors!... Allons-y!...
Là-dessus, il s'enfonça dans son divan, comme un homme qui va faire une somme, bourra les coussins à coups de poing, les disposa sous ses bras étendus, ferma les yeux à demi, les rouvrit un instant pour évaluer les dimensions du rouleau de musique que Christophe avait sorti d'une de ses poches, poussa un petit soupir, et se disposa à écouter avec ennui.
Christophe, intimidé et mortifié, commença à jouer. Hassler ne tarda pas à rouvrir l'œil et l'oreille, avec l'intérêt professionnel de l'artiste qui est repris, malgré lui, par une belle chose. D'abord, il ne dit rien, et resta immobile; mais ses yeux devinrent moins vagues, et ses lèvres boudeuses remuaient. Puis, il se réveilla tout à fait, grognant son étonnement et son assentiment. C'étaient des interjections inarticulées; mais le ton ne laissait aucun doute sur ce qu'il pensait; et Christophe en éprouvait un bien-être inexprimable. Hassler ne songeait plus à calculer le nombre de pages qui étaient jouées et celles qui restaient à jouer. Quand Christophe avait fini un morceau, il disait:
—Après!... Après!...
Il commençait à faire usage du langage humain.
—Bon, cela! Bon!... (s'exclamait-il). Fameux!... Effroyablement fameux! (Schrecklich famos!)... Mais que diable! (grommelait-il, stupéfait), qu'est-ce que c'est que ça?
Il s'était redressé sur son siège, penchait la tête en avant, se faisait un cornet avec sa main, se parlait à lui-même, riait de contentement, et, à certaines curiosités d'harmonies, tirait légèrement la langue, comme pour se lécher les lèvres. Une modulation inattendue eut un tel effet sur lui qu'il se leva brusquement, avec une exclamation, et vint s'asseoir au piano, à côté de Christophe. Il n'avait pas l'air de s'apercevoir que Christophe fût là. Il ne s'occupait que de la musique; et, quand le morceau fut fini, il saisit le cahier, se mit à relire la page, puis lut les pages suivantes, continuant de monologuer son admiration et sa surprise, comme s'il eût été seul dans la chambre:
—Que le diable!... (faisait-il). Où cet animal a-t-il trouvé cela?...
Repoussant Christophe de l'épaule, il joua lui-même certains passages. Il avait au piano de charmants doigts, très doux, caressants et légers. Christophe regarda ses mains fines, longues, bien soignées, d'un aristocratisme un peu maladif, qui ne répondait pas au reste de la personne. Hassler s'arrêtait à certains accords, les répétait, en clignant de l'œil et faisant claquer sa langue; il bourdonnait avec ses lèvres, imitant la sonorité des instruments, et il continuait d'entremêler à cette musique ses apostrophes, où il y avait à la fois du plaisir et du dépit: il ne pouvait se défendre d'une secrète irritation, d'une jalousie inavouée; et, en même temps, il jouissait avidement.
Bien qu'il persistât à se parler à lui seul, comme si Christophe n'existait pas, Christophe, rouge de plaisir, ne pouvait s'empêcher de prendre pour son compte les exclamations de Hassler; et il expliquait ce qu'il avait voulu faire. Hassler sembla d'abord ne faire aucune attention à ce que le jeune homme disait, et poursuivit ses réflexions à voix haute; puis, certains mots de Christophe le frappèrent, et il se tut, les yeux toujours fixés sur le cahier de musique, qu'il feuilletait, en écoutant, sans avoir l'air d'écouter. Christophe, de son côté, s'animait peu à peu; et il finit par se confier tout à fait: il parlait avec une excitation naïve de ses projets et de sa vie.
Hassler, silencieux, était repris par son ironie. Il s'était laissé retirer le cahier des doigts; le coude appuyé sur la tablette du piano et le front dans la main, il regardait Christophe qui lui commentait son œuvre avec une ardeur et un trouble juvéniles. Et il souriait amèrement, en pensant à ses propres débuts, à ses espoirs, aux espoirs de Christophe, et aux déboires qui l'attendaient.
Christophe parlait, les yeux baissés, dans la crainte de ne plus savoir ce qu'il avait à dire. Le silence de Hassler l'encourageait. Il sentait que Hassler l'observait, qu'il ne perdait pas une de ses paroles; il lui semblait avoir brisé la glace qui les séparait, et son cœur rayonnait. Quand il eut fini, il leva la tête avec timidité,—avec confiance aussi,—et regarda Hassler. Toute sa joie naissante gela d'un coup, comme les pousses trop précoces, quand il vit les yeux mornes et railleurs sans bonté qui le fixaient. Il se tut.
Après une pause glaciale, Hassler parla, d'une voix sèche. Il avait de nouveau changé: il affectait une sorte de dureté pour le jeune homme; il persiflait cruellement ses projets, ses espoirs de succès, comme s'il eût voulu se persifler lui-même, puisqu'il se retrouvait en lui. Il s'acharnait froidement à détruire sa foi dans la vie, sa foi dans l'art, sa foi en soi. Il se donna lui-même en exemple, avec amertume, parlant de ses œuvres d'aujourd'hui, d'une façon insultante.
—Des cochonneries! dit-il. C'est ce qu'il faut pour ces cochons. Est-ce que vous croyez qu'il y a dix personnes au monde, qui aiment la musique? Est-ce qu'il y en a une seule?
—Il y a moi! dit Christophe, avec emportement.
Hassler le regarda, haussa les épaules, et dit d'une voix lassée:
—Vous serez comme les autres. Vous ferez comme les autres. Vous penserez à arriver, à vous amuser, comme les autres... Et vous aurez raison...
Christophe essaya de protester; mais Hassler lui coupa la parole, et, reprenant son cahier, se mit à critiquer aigrement les œuvres qu'il louait tout à l'heure. Non seulement il relevait avec une dureté blessante les négligences réelles, les incorrections d'écriture, les fautes de goût ou d'expression, qui avaient échappé au jeune homme; mais il lui faisait des critiques absurdes, des critiques comme en eût pu faire le plus étroit et le plus arriéré des musiciens, dont lui-même, Hassler, avait eu, toute sa vie, à souffrir. Il demandait à quoi tout cela rimait. Il ne critiquait même plus, il niait: on eût dit qu'il s'efforçait d'effacer haineusement l'impression que ces œuvres lui avaient faite, en dépit de lui-même.
Christophe, consterné, n'essayait pas de répondre. Comment répondre à des absurdités, qu'on rougit d'entendre dans la bouche de quelqu'un qu'on estime et qu'on aime? Au reste, Hassler n'écoutait rien. Il restait là, buté, le cahier fermé entre les mains, les yeux sans expression, la bouche amère. À la fin, il dit, comme si de nouveau il avait oublié la présence de Christophe:
—Ah! la pire misère, c'est qu'il n'y a pas un homme, pas un qui soit capable de vous comprendre!
Christophe se sentit transpercé d'émotion; il se retourna brusquement, posa sa main sur la main de Hassler, et, le cœur plein d'amour, il répéta:
—Il y a moi!
Mais la main de Hassler ne bougea point; et si quelque chose dans son cœur tressaillit, une seconde, à ce cri juvénile, aucune lueur ne brilla dans ses yeux éteints, qui regardèrent Christophe. L'ironie et l'égoïsme prirent le dessus. Il esquissa un mouvement du buste, cérémonieux et comique, pour saluer:
—Très honoré! dit-il.
Il pensait:
—Je m'en fiche bien! Crois-tu que ce soit pour toi que j'ai perdu ma vie?
Il se leva, jeta le cahier sur le piano, et, de ses longues jambes qui flageolaient, s'en alla reprendre sa place sur le divan. Christophe, qui avait saisi sa pensée et qui en avait senti l'insultante blessure, essayait fièrement de répondre que l'on n'a pas besoin d'être compris de tous: certaines âmes à elles seules valent un peuple tout entier; elles pensent pour lui; et, ce qu'elles ont pensé, il faudra qu'il le pense.—Mais Hassler n'écoutait plus. Il était retombé dans son apathie, causée par l'affaiblissement de la vie qui s'endormait en lui. Christophe, trop sain pour comprendre ce revirement subit, sentait vaguement que la partie était perdue; mais il ne pouvait s'y résigner, après avoir été si près de la croire gagnée. Il faisait des efforts désespérés pour ranimer l'attention de Hassler; il avait repris son cahier de musique, et cherchait à expliquer la raison des irrégularités, que Hassler avait notées. Hassler, enfoncé dans le sofa, gardait un silence morne; il n'approuvait, ni ne contredisait: il attendait que ce fût fini.
Christophe vit qu'il n'avait plus rien à faire ici. Au milieu d'une phrase, il s'arrêta. Il roula son cahier, et se leva. Hassler se leva aussi. Christophe, honteux et intimidé, s'excusait en balbutiant. Hassler, s'inclinant légèrement, avec une certaine distinction hautaine et ennuyée, lui tendit la main, froidement, poliment, et l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée, sans un mot pour le retenir, ou pour l'inviter à revenir.
Christophe se retrouva dans la rue, anéanti. Il allait au hasard. Après avoir suivi machinalement deux ou trois rues, il se trouva à la station du tram, qui l'avait amené. Il le reprit, sans penser à ce qu'il faisait. Il s'affaissa sur la banquette, les bras, les jambes cassés. Impossible de réfléchir, de rassembler ses idées: il ne pensait à rien. Il avait peur de regarder en lui. C'était le vide. Ce vide était autour de lui, dans cette ville; il ne pouvait plus y respirer: le brouillard, les maisons massives l'étouffaient. Il n'avait plus qu'une idée: fuir, fuir au plus vite,—comme si, en se sauvant de la ville, il devait y laisser l'amère désillusion qu'il y avait trouvée.
Il retourna à son hôtel. Il n'était pas midi et demi. Il y avait deux heures qu'il y était entré,—avec quelle lumière au cœur!—Maintenant, tout était nuit.
Il ne déjeuna point. Il ne monta pas dans sa chambre. À la stupéfaction de l'hôte, il demanda sa note, paya comme s'il avait passé la nuit, et dit qu'il voulait partir. En vain, lui expliquait-on qu'il n'avait pas à se presser, que le train qu'il voulait reprendre ne partait pas avant plusieurs heures, qu'il ferait mieux d'attendre à l'hôtel. Il voulut aller tout de suite à la gare: il voulait prendre le premier train, n'importe lequel, ne plus rester une heure dans ce pays. Après ce long voyage et ses dépenses pour venir,—bien qu'il se fût fait une fête non seulement de voir Hassler, mais de visiter des musées, d'entendre des concerts, de faire des connaissances,—il n'avait plus qu'une idée en tête: partir...
Il revint à la gare. Ainsi qu'on le lui avait dit, son train ne partait pas avant trois heures. Encore ce train, qui n'était pas express,—(car Christophe était forcé de prendre la dernière classe)—s'arrêtait-il en route; Christophe aurait eu avantage à monter dans le train suivant, qui partait deux heures plus tard et qui rejoignait le premier. Mais c'était deux heures de plus à passer ici, et Christophe ne pouvait le supporter. Il ne voulut même plus sortir de la gare, en attendant.—Lugubre attente, dans ces salles vastes et vides, tumultueuses et funèbres, où entrent et sortent, toujours affairées, toujours courant, des ombres étrangères, toutes étrangères, toutes indifférentes, pas une qu'on connaisse, pas un visage ami. Le jour blafard s'éteignait. Les lampes électriques, enveloppées de brouillard, mouchetaient la nuit, semblaient la rendre plus sombre. Christophe, plus oppressé d'heure en heure, attendait avec angoisse le moment de partir. Il allait, dix fois par heure, revoir les affiches des trains pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé. Comme il les relisait d'un bout à l'autre, une fois de plus, pour passer le temps, un nom de pays le frappa: il se dit qu'il le connaissait; après un moment, il se rappela que c'était le pays du vieux Schulz, qui lui avait écrit de si bonnes lettres. L'idée lui vint aussitôt, dans son désarroi, d'aller voir cet ami inconnu. La ville n'était pas sur son chemin direct de retour, mais à une ou deux heures, par un chemin de fer local; c'était un voyage de toute une nuit, avec deux ou trois changements de train, d'interminables attentes: Christophe ne calcula rien. Sur-le-champ, il décida d'y aller: ce lui était un besoin instinctif de se raccrocher à une sympathie. Sans se donner le temps de réfléchir, il rédigea une dépêche et télégraphia à Schulz son arrivée pour le lendemain matin. Il n'avait pas envoyé ce mot, qu'il le regrettait déjà. Il se plaisantait amèrement sur ses illusions éternelles. Pourquoi aller au-devant d'un nouveau chagrin?—Mais c'était fait maintenant. Trop tard pour changer.
Ces pensées occupèrent sa dernière heure d'attente.—Son train était enfin formé. Il y monta le premier; et son enfantillage était tel qu'il ne commença à respirer que lorsque le train s'ébranla et que, par la portière du wagon, il vit derrière lui s'effacer dans le ciel gris, sous les tristes averses, la silhouette de la ville, sur laquelle la nuit tombait. Il lui semblait qu'il serait mort, s'il avait passé la nuit là.
À cette même heure,—vers six heures du soir,—une lettre de Hassler arrivait pour Christophe, à son hôtel. La visite de Christophe avait remué bien des choses en lui. Pendant toute l'après-midi, il y avait songé avec amertume, et non sans sympathie pour le pauvre garçon qui était venu à lui avec une telle ardeur d'affection, et qu'il avait reçu d'une façon glaciale. Il se reprochait son accueil. À vrai dire, ce n'avait été de sa part qu'un de ces accès de bouderie quinteuse, dont il était coutumier. Il pensa le réparer, en envoyant à Christophe, avec un billet pour l'Opéra, un mot qui lui donnait rendez-vous, à l'issue de la représentation.—Christophe n'en sut jamais rien. En ne le voyant pas venir, Hassler pensa:
—Il est fâché. Tant pis pour lui!
Il haussa les épaules, et n'en chercha pas plus long. Le lendemain, il ne pensait plus à lui.
Le lendemain, Christophe était loin de lui,—si loin que toute l'éternité n'eût pas suffi à les rapprocher l'un de l'autre. Et tous deux étaient seuls pour jamais.
Peter Schulz avait soixante-quinze ans. Il était de santé délicate, et l'âge ne l'avait pas épargné. Assez grand, mais voûté, la tête penchée sur la poitrine, il avait les bronches faibles, et respirait avec peine. Asthme, catarrhe, bronchite, s'acharnaient après lui: et la trace des luttes qu'il lui fallait subir,—bien des nuits, assis dans son lit, le corps courbé en avant, et trempé de sueur, pour tâcher de faire entrer un souffle d'air dans sa poitrine qui étouffait,—était gravée dans les plis douloureux de sa longue figure, maigre et rasée. Le nez était long et un peu gonflé au sommet. Des rides profondes, partant du dessous des yeux, coupaient transversalement les joues creusées par les vides de la mâchoire. L'âge et les infirmités n'avaient pas été les seuls sculpteurs de ce pauvre masque délabré; les chagrins de la vie y avaient eu part aussi.—Et malgré tout, il n'était pas triste. La grande bouche tranquille avait une bonté sereine. Mais c'étaient surtout les yeux qui donnaient à ce vieux visage une douceur touchante: ils étaient d'un gris-clair limpide et transparent; ils regardaient bien en face, avec calme et candeur; ils ne cachaient rien de l'âme: on eût pu lire au fond.
Sa vie avait été pauvre en événements. Il était seul depuis des années. Sa femme était morte. Elle n'était pas très bonne, pas très intelligente, pas du tout belle. Mais il en conservait un souvenir attendri. Il y avait vingt-cinq ans qu'il l'avait perdue: et, pas un soir depuis, il ne s'était endormi, sans un petit entretien mental, triste et tendre, avec elle; il l'associait à chacune de ses journées.—Il n'avait pas eu d'enfant: c'était le grand regret de sa vie. Il avait reporté son besoin d'affection sur ses élèves, auxquels il était attaché, comme un père à ses fils. Il avait trouvé peu de retour. Un vieux cœur peut se sentir très près d'un jeune cœur, et presque du même âge: il sait combien sont brèves les années qui l'en séparent. Mais le jeune homme ne s'en doute point: le vieillard est pour lui un homme d'une autre époque: au reste, il est absorbé par trop de soucis immédiats, et il détourne instinctivement les yeux du but mélancolique de ses efforts. Le vieux Schulz avait rencontré parfois quelque reconnaissance chez des élèves, touchés par l'intérêt vif et frais qu'il prenait à tout ce qui leur arrivait d'heureux ou de malheureux: ils venaient le voir de temps en temps; ils lui écrivaient, pour le remercier, quand ils quittaient l'université; certains lui écrivaient encore, une ou deux fois, les années suivantes. Puis, le vieux Schulz n'entendait plus parler d'eux, sinon par les journaux, qui lui faisaient connaître l'avancement de tel ou tel: et il se réjouissait de leurs succès, comme si c'étaient les siens. Il ne leur en voulait pas de leur silence: il y' trouvait mille excuses; il ne doutait point de leur affection, et prêtait aux plus égoïstes les sentiments qu'il avait pour eux.
Mais ses livres étaient pour lui le meilleur des refuges: ils n'étaient point oublieux, ni trompeurs. Les âmes, qu'il chérissait en eux, étaient maintenant sorties du flot du temps: elles étaient immuables, fixées pour l'éternité dans l'amour qu'elles inspiraient et qu'elles semblaient ressentir, qu'elles rayonnaient à leur tour sur ceux qui les aimaient. Professeur d'esthétique et d'histoire de la musique, il était comme un vieux bois, vibrant de chants d'oiseaux. Certains de ces chants résonnaient très loin, ils venaient du fond des siècles: ils n'étaient pas les moins doux et les moins mystérieux. Il en était d'autres qui lui étaient familiers et intimes: c'étaient de chers compagnons; chacune de leurs phrases lui rappelait des joies et des douleurs de sa vie passée, consciente ou inconsciente:—(car sous chacun des jours que la lumière du soleil éclaire, d'autres jours se déroulent, qu'éclaire une lumière inconnue.)—Il y en avait enfin qu'on n'avait jamais entendus encore, et qui disaient des choses qu'on attendait depuis longtemps, dont on avait besoin: le cœur s'ouvrait pour les recevoir, comme la terre sous la pluie. Ainsi, le vieux Schulz écoutait, dans le silence de sa vie solitaire, la forêt pleine d'oiseaux; et, comme le moine de la légende, endormi dans l'extase du chant de l'oiseau magique, les années passaient pour lui, et le soir de la vie était venu; mais il avait toujours son âme de vingt ans.
Il n'était pas seulement riche de musique. Il aimait les poètes,—les anciens et les nouveaux. Il avait une prédilection pour ceux de son pays, surtout pour Gœthe; mais il aimait aussi ceux des autres pays. Il était instruit et lisait plusieurs langues. Il était, d'esprit, un contemporain de Herder et des grands Weltbürger—des «citoyens du monde», de la fin du dix-huitième siècle. Il avait vécu les années d'âpres luttes qui précédèrent et suivirent 70, enveloppé de leur vaste pensée. Et, quoiqu'il adorât l'Allemagne, il n'en était pas «glorieux». Il pensait, avec Herder, qu'«entre tous les glorieux, le glorieux de sa nationalité est un sot accompli», et avec Schiller, que «c'est un bien pauvre idéal de n'écrire que pour une seule nation». Son esprit était parfois timide; mais son cœur était d'une largeur admirable, et prêt à accueillir avec amour tout ce qui était beau dans le monde. Peut-être était-il trop indulgent pour la médiocrité; mais son instinct n'avait point de doute sur ce qui était le meilleur; et s'il n'avait pas la force de condamner les faux artistes que l'opinion publique admirait, il avait toujours celle de défendre les artistes originaux et forts que l'opinion publique méconnaissait. Sa bonté l'abusait souvent: il tremblait de commettre une injustice; et, quand il n'aimait pas ce que d'autres aimaient, il ne doutait point que ce ne fût lui qui se trompât; et il finissait par l'aimer. Il lui était si doux d'aimer! L'amour et l'admiration étaient encore plus nécessaires à sa vie morale que l'air à sa misérable poitrine. Aussi, quelle reconnaissance il avait pour ceux qui lui en offraient une occasion nouvelle!—Christophe ne pouvait se douter de ce que ses Lieder avaient été pour lui. Il était bien loin de les avoir sentis lui-même aussi vivement, quand il les avait créés. C'est que pour lui ces chants n'étaient que quelques étincelles jaillies de la forge intérieure: il en jaillirait bien d'autres! Mais pour le vieux Schulz, c'était tout un monde qui se révélait, d'un seul coup,—tout un monde à aimer. Sa vie en avait été illuminée.
Depuis un an, il avait dû résigner ses fonctions à l'Université: sa santé de plus en plus précaire ne lui permettait plus de professer. Il était malade, et au lit, quand le libraire Wolf lui fit porter, comme il en avait l'habitude, un paquet des dernières nouveautés musicales qu'il avait reçues, et où se trouvaient, cette fois, les Lieder de Christophe. Il était seul. Nul parent auprès de lui; le peu de famille qu'il avait était mort depuis longtemps. Il était livré aux soins d'une vieille bonne, qui abusait de sa faiblesse, pour lui imposer tout ce qu'elle voulait. Deux ou trois amis, guère moins âgés que lui, venaient le voir de temps en temps; mais ils n'étaient pas non plus d'une très bonne santé; et, quand le temps était mauvais, ils se tenaient clos aussi et espaçaient leurs visites. Justement, c'était l'hiver alors, les rues étaient couvertes d'une neige qui fondait: Schulz n'avait vu personne, de tout le jour. Il faisait sombre dans la chambre: un brouillard jaune était tendu contre les vitres, comme un écran, et murait les regards: la chaleur du poêle était lourde et fatigante. De l'église voisine, un vieux carillon du dix-septième siècle chantait, tous les quarts d'heure, d'une voix boiteuse et horriblement fausse, des bribes de chorals monotones, dont la jovialité paraissait un peu grimaçante, quand on n'était pas très gai, soi-même. Le vieux Schulz toussait, le dos appuyé contre une pile d'oreillers. Il essayait de relire Montaigne, qu'il aimait; mais cette lecture ne lui faisait pas aujourd'hui autant de plaisir qu'à l'ordinaire; il avait laissé tomber le livre, il respirait avec peine, et rêvait. Le paquet de musique était là, sur son lit: il n'avait pas le courage de l'ouvrir; il se sentait le cœur triste. Enfin, il soupira, et, après avoir défait très soigneusement la ficelle, il remit ses lunettes, et commença de lire les morceaux de musique. Sa pensée était ailleurs: elle revenait à des souvenirs qu'il voulait écarter.
Ses yeux tombèrent sur un vieux cantique, dont Christophe avait repris les paroles à un naïf et pieux poète du dix-septième siècle, en renouvelant leur expression: le Christliches Wanderlied (chant du voyageur chrétien) de Paul Gerhardt.
Hoff, o du arme Seele,
Hoff und sei unverzagt!
. . . . . . . . . .
Erwarte nur der Zeit,
So wirst du schon erblicken
Die Sonn der schönsten Freud.
«Espère, pauvre âme,
espère, et sois intrépide!
. . . . . . . . . .
Attends seulement, attends:
voici que tu vas voir
le soleil de la belle Joie!»
Le vieux Schulz connaissait bien ces candides paroles; mais jamais elles ne lui avaient parlé ainsi... Ce n'était plus la tranquille piété, qui calme et endort l'âme par sa monotonie. C'était une âme comme la sienne, c'était son âme même, mais plus jeune et plus forte, qui souffrait, qui voulait espérer, qui voulait voir la Joie, qui la voyait. Ses mains tremblaient, de grosses larmes coulaient le long de ses joues. Il continua:
Auf, auflgieb deinem Schmerze
Und Sorgen gute Nacht!
Lass fahren, was das Herze
Betrübt und traurig macht!
«Debout, debout! dis à ta douleur
et à tes soucis bonne nuit!
Laisse partir ce qui trouble
le cœur et qui l'attriste!»
Christophe communiquait à ces pensées une jeune ardeur intrépide, dont le rire héroïque rayonnait dans ces derniers vers confiants et naïfs:
Bist du doch nicht Regente,
Der alles führen soll,
Gott sitzt im Regimente,
Und führet alles wohl.
«Ce n'est pas toi qui règnes
et qui dois tout conduire.
C'est Dieu. Dieu est le roi,
Il mène tout comme il doit!»
Et quand venait cette strophe de superbe défi, qu'il avait, avec son insolence de jeune barbare, arrachée tranquillement de sa place primitive dans l'ensemble du poème, pour en faire la conclusion de son Lied:
Und ob gleich alle Teufel
Hier wollten widerstehn,
So wird doch ohne Zweifel
Gott nicht zurücke gehen:
Was er ihm vor genommen,
Und was er haben will,
Das muss doch endlich kommen
Zu seinem Zweck und Ziel.
«Et quand bien tous les diables
voudraient s'y opposer,
sois calme, ne doute pas!
Dieu ne reculera point.
Ce qu'il a décidé,
ce qu'il veut accomplir,
cela sera, cela se fera,
Il viendra à ses fins!»
... alors, c'était un transport d'allégresse, l'ivresse de la bataille, un triomphe d'Imperator romain.
Le vieillard tremblait de tout son corps. Il suivait, haletant, l'impétueuse musique, comme un enfant qu'un compagnon entraîne dans sa course, en le tenant par la main. Son cœur battait. Ses larmes ruisselaient. Il bégayait:
—Ah! mon Dieu!... Ah! mon Dieu!...
Il se mit à sangloter, et il riait. Il était heureux. Il suffoquait. Il fut pris d'une terrible quinte de toux. Salomé, la vieille servante, accourut, et elle crut que le vieux allait y passer. Il continuait de pleurer, de tousser, et de répéter:
—Ah! mon Dieu!... mon Dieu!... et, dans les courts moments de répit, entre deux accès de toux, il riait d'un petit rire aigu et doux.
Salomé pensa qu'il devenait fou. Quand elle finit par comprendre la cause de cette agitation, elle le gronda rudement:
—S'il est possible de se mettre dans un état pareil pour une sottise!... Donnez-moi cela! Je l'emporte. Vous ne le verrez plus.
Mais le vieux tenait bon, toujours toussant; et il criait à Salomé de le laisser tranquille. Comme elle insistait, il se mit en fureur, il jurait, et il s'étranglait dans ses jurements. Jamais elle ne l'avait vu se fâcher et oser lui tenir tête. Elle en fut ébahie, et elle lâcha prise; mais elle ne lui ménagea pas les paroles sévères: elle le traita de vieux fou, elle dit qu'elle avait cru jusqu'à présent avoir affaire à un homme bien élevé, mais qu'elle voyait maintenant qu'elle s'était trompée, qu'il disait des blasphèmes à faire rougir un charretier, que les yeux lui sortaient de la tête, et que s'ils étaient des pistolets, ils l'auraient tuée... Elle en avait pour longtemps à continuer cette chanson, s'il ne s'était soulevé, furieux, sur ses oreillers, et ne lui avait crié:
—Sortez! d'un ton si péremptoire qu'elle partit en faisant battre la porte. Elle déclara qu'il pourrait bien l'appeler maintenant, qu'elle ne se dérangerait pas, qu'elle le laisserait claquer tout seul.
Alors, le silence retomba de nouveau dans la chambre où la nuit s'étendait. De nouveau, le carillon égrena dans la paix du soir ses sonneries placides et grotesques. Un peu honteux de sa colère, le vieux Schulz, immobile, étendu sur le dos, attendait, haletant, que le tumulte de son cœur s'apaisât: il serrait sur sa poitrine les précieux Lieder, et il riait comme un enfant.
Il passa les journées solitaires qui suivirent dans une sorte d'extase. Il ne pensait plus à son mal, à l'hiver, à la triste lumière, à sa solitude. Tout était lumineux et aimant autour de lui. Près de la mort, il se sentait revivre dans la jeune âme d'un ami inconnu.
Il tâchait de se figurer Christophe. Il ne le voyait pas du tout comme il était. Il l'imaginait tel que lui-même eût voulu être: blond, mince, les yeux bleus, parlant d'une voix un peu faible et voilée, doux, timide et tendre. Mais quel qu'il fût, il était toujours prêt à l'idéaliser. Il idéalisait tout ce qui l'entourait: ses élèves, ses voisins, ses amis, sa vieille bonne. Sa douceur affectueuse et son manque de critique,—en partie volontaire, pour écarter toute pensée troublante,—tissaient autour de lui des images sereines et pures, comme la sienne. C'était un mensonge de bonté, dont il avait besoin pour vivre. Il n'en était pas tout à fait dupe; et souvent, dans son lit, la nuit, il soupirait en songeant à mille petites choses, arrivées dans le jour, qui contredisaient son idéalisme. Il savait bien que la vieille Salomé se moquait de lui, derrière son dos, avec les commères du quartier, et qu'elle le volait régulièrement dans ses comptes de chaque semaine. Il savait bien que ses élèves étaient obséquieux, tant qu'ils avaient besoin de lui, puis, qu'après qu'ils avaient reçu de lui tous les services qu'ils en pouvaient attendre, ils le laissaient de côté. Il savait que ses anciens collègues de l'Université l'avaient tout à fait oublié, depuis qu'il avait pris sa retraite, et que son successeur le pillait dans ses articles, sans le nommer, ou en le nommant d'une façon perfide, pour citer de lui une phrase sans valeur et pour relever ses erreurs:—(le procédé est courant dans le monde de la critique).—Il savait que son vieil ami Kunz lui avait encore fait un gros mensonge, cette après-midi, et qu'il ne reverrait jamais les livres que son autre ami, Pottpetschmidt, lui avait empruntés pour quelques jours,—ce qui était douloureux pour quelqu'un qui, comme lui, était attaché à ses livres ainsi qu'à des personnes vivantes. Beaucoup d'autres choses tristes, anciennes ou récentes, lui revenaient a l'esprit; il ne voulait pas y penser; mais elles étaient la quand même: il les sentait. Leur souvenir le traversait parfois, d'une douleur lancinante.
—Ah! mon Dieu! mon Dieu! gémissait-il, dans le silence de la nuit.—Puis, il écartait les fâcheuses pensées: il les niait; il voulait être confiant, optimiste, croire aux hommes: et il y croyait. Combien de fois ses illusions avaient été brutalement détruites!—Mais il en renaissait d'autres, toujours, toujours... Il ne pouvait s'en passer.
Christophe inconnu devint un foyer lumineux dans sa vie. La première lettre froide et maussade, qu'il reçut de lui, devait lui faire de la peine;—(peut-être, lui en fit-elle);—mais il n'en voulut pas convenir, et il en eut une joie d'enfant. Il était si modeste, il demandait si peu aux hommes que le peu qu'il en recevait suffisait à nourrir son besoin de les aimer et de leur être reconnaissant. Voir Christophe était un bonheur qu'il n'eût jamais osé espérer: car il était maintenant trop vieux pour faire le voyage des bords du Rhin; et, quant à solliciter sa visite, la pensée ne lui en venait même pas.
La dépêche de Christophe lui arriva, le soir, au moment où il se mettait à table. Il ne comprit pas d'abord: la signature lui semblait inconnue, il pensa qu'on s'était trompé, que la dépêche n'était pas pour lui; il la relut trois fois; dans son trouble, ses lunettes ne voulaient pas tenir, la lampe éclairait mal, les lettres dansaient devant ses yeux. Quand il eut compris, il fut si bouleversé qu'il oublia de dîner. Salomé eut beau crier après lui: impossible d'avaler un morceau. Il jeta sa serviette sur la table, sans la plier, comme il ne manquait jamais de faire; il se leva en trébuchant, alla chercher son chapeau et sa canne, et sortit. La première pensée du bon Schulz, en recevant un tel bonheur, avait été de le partager avec d'autres, et d'avertir ses amis de l'arrivée de Christophe.
Il avait deux amis, comme lui mélomanes, à qui il avait réussi à communiquer son enthousiasme pour Christophe: le juge Samuel Kunz, et le dentiste Oscar Pottpetschmidt, qui était un chanteur excellent. Les trois vieux camarades avaient souvent parlé de Christophe, ensemble; et ils avaient joué toute la musique de lui qu'ils avaient pu trouver. Pottpetschmidt chantait, Schulz accompagnait, et Kunz écoutait. Et ils s'extasiaient ensuite pendant des heures. Combien de fois avaient-ils dit, quand ils faisaient de la musique:
—Ah! si Krafft était là!
Schulz riait tout seul, dans la rue, de la joie qu'il avait et de celle qu'il allait faire. La nuit venait; et Kunz habitait dans un petit village, à une demi-heure de la ville. Mais le ciel était clair: c'était un soir d'avril très doux; les rossignols chantaient. Le vieux Schulz avait le cœur inondé de bonheur; il respirait sans oppression, et il avait des jambes de vingt ans. Il marchait allègrement, sans prendre garde aux pierres, contre lesquelles il butait dans l'ombre. Il se rangeait gaillardement sur le côté de la route, à l'arrivée des voitures, et il échangeait un joyeux salut avec le conducteur, qui le considérait avec étonnement, quand la lanterne éclairait en passant le vieillard grimpé sur le talus du chemin.
La nuit était complète, lorsqu'il arriva à la maison de Kunz, à l'entrée du village, dans un petit jardin. Il tambourina à sa porte, et l'appela à tue-tête. Une fenêtre s'ouvrit, et Kunz, effaré, parut. Il essayait de voir dans l'obscurité, et demanda:
—Qui est là? Qu'est-ce qu'on me veut?
Schulz, essoufflé et joyeux, criait:
—Krafft... Krafft vient demain...
Kunz n'y comprenait rien; mais il reconnut la voix:
—Schulz!... Comment! À cette heure? Qu'y a-t-il?
Schulz répéta:
—Il vient demain, demain matin!...
—Quoi? demandait toujours Kunz, ahuri.
—Krafft! cria Schulz.
Kunz resta un moment à méditer le sens de cette parole; puis une exclamation retentissante témoigna qu'il avait compris.
—Je descends! cria-t-il.
La fenêtre se referma. Il parut sur le perron de l'escalier, une lampe à la main, et descendit dans le jardin. C'était un petit vieux bedonnant, avec une grosse tête grise, une barbe rouge, des taches de rousseur sur le visage et sur les mains. Il venait à petits pas, en fumant sa pipe de porcelaine. Cet homme débonnaire et un peu endormi ne s'était jamais fait grands soucis dans sa vie. La nouvelle que lui apportait Schulz n'en était pas moins capable de le faire sortir de son calme; et il agitait ses bras courts et sa lampe, en demandant:
—Quoi? c'est vrai? Il vient?
—Demain matin! répéta Schulz, triomphant, en agitant la dépêche.
Les deux vieux amis allèrent s'asseoir sur un banc, sous la tonnelle. Schulz prit la lampe. Kunz déplia soigneusement la dépêche, lut lentement, à mi-voix: Schulz relisait tout haut, par-dessus son épaule. Kunz regarda encore les indications qui encadraient le télégramme, l'heure de l'envoi, l'heure de l'arrivée, le nombre des mots. Puis, il rendit le précieux papier à Schulz, qui riait d'aise, le regarda en hochant la tête, en répétant:
—Ah! bien!... ah! bien!
Après avoir réfléchi un instant, aspiré et expiré une grosse bouffée de tabac, il posa sa main sur le genou de Schulz, et dit:
—Il faut avertir Pottpetschmidt.
—J'y allais, dit Schulz.
—Je viens avec toi, dit Kunz.
Il rentra pour déposer la lampe, et revint aussitôt. Les deux vieux s'en allèrent, bras dessus bras dessous. Pottpetschmidt habitait à l'autre bout du village. Schulz et Kunz échangeaient des mots distraits, en ruminant la nouvelle. Tout à coup, Kunz s'arrêta, et tapa le sol, de sa canne:
—Ah! tonnerre! fit-il... IL n'est pas ici!...
Il se rappelait maintenant que Pottpetschmidt avait dû partir dans l'après-midi pour une opération, dans une ville voisine, où il devait passer la nuit et séjourner un jour ou deux. Schulz était consterné. Kunz ne l'était pas moins. Ils étaient fiers de Pottpetschmidt; ils eussent voulu s'en faire honneur. Ils restaient au milieu de la route, ne sachant que décider.
—Comment faire? Comment faire? demandait Kunz.
—Il faut absolument que Krafft entende Pottpetschmidt, disait Schulz.
Il réfléchit, et dit:
—Il faut lui envoyer une dépêche.
Ils allèrent au télégraphe, et composèrent ensemble une dépêche longue et émue, à laquelle il était difficile de rien comprendre. Puis, ils revinrent. Schulz calculait:
—Il pourra être encore ici demain matin, en prenant le premier train.
Mais Kunz fit remarquer qu'il était trop tard, et que la dépêche ne lui serait remise sans doute que le lendemain. Schulz hocha la tête; et ils se répétaient:
—Quel malheur!
Ils se séparèrent à la porte de Kunz; car, quelle que fût l'amitié de celui-ci pour Schulz, elle n'allait pas jusqu'à lui faire commettre l'imprudence d'accompagner Schulz hors du village, ne fût-ce qu'un bout de chemin, qu'il lui eût fallu refaire seul, dans la nuit. Il fut convenu que Kunz viendrait dîner, le lendemain, chez Schulz. Schulz regardait le ciel, avec anxiété:
—Pourvu qu'il fasse beau, demain!
Et il eut un poids de moins sur le cœur, quand Kunz, qui passait pour se connaître admirablement en météorologie, dit, après avoir gravement examiné le ciel—(car il n'avait pas moins que Schulz le souci que Christophe vît leur petit pays en beauté):
—Il fera beau, demain.
Schulz reprit le chemin de la ville, où il parvint, non sans avoir trébuché plus d'une fois dans les ornières, ou contre les tas de pierres élevés le long de la route. Il ne rentra point chez lui, avant d'être passé chez le pâtissier, pour lui commander une certaine tarte, qui était la gloire de la ville. Puis, il revint à sa maison; mais, au moment d'y rentrer, il rebroussa chemin, pour s'informer à la gare de l'heure exacte de l'arrivée des trains. Enfin, il rentra, appela Salomé, et discuta longuement avec elle le dîner du lendemain. Alors seulement, il se coucha, harassé; mais il était aussi surexcité qu'un enfant, dans la veillée de Noël, et il se retourna toute la nuit dans ses draps, sans trouver un instant de sommeil. Vers une heure du matin, il eut l'idée de se lever, pour dire à Salomé de faire plutôt, pour le dîner, une carpe à l'étuvée; car elle réussissait merveilleusement ce plat. Il ne le lui dit pas: et il fit bien, sans doute. Il ne s'en leva pas moins pour arranger diverses choses dans la chambre qu'il destinait à Christophe; il prenait mille précautions, pour que Salomé ne l'entendît pas: car il craignait d'être grondé. Il tremblait de manquer l'heure du train, bien que Christophe ne dût pas arriver avant huit heures. Il fut debout de grand matin. Son premier regard fut pour le ciel: Kunz ne s'était pas trompé, il faisait un temps magnifique. Sur la pointe des pieds, Schulz descendit à sa cave, où il n'allait plus depuis longtemps, de peur du froid et des escaliers raides; il y fit un choix de ses meilleures bouteilles, se heurta rudement la tête contre la voûte, en remontant, et crut qu'il allait étouffer, quand il parvint au haut de l'escalier avec son panier chargé. Ensuite, il alla au jardin, armé de son sécateur: il coupa impitoyablement ses plus belles roses et les premières branches de ses lilas en fleurs. Puis, il remonta dans sa chambre, fit fiévreusement sa barbe, se coupa une ou deux fois, s'habilla avec soin, et partit pour la gare. Il était sept heures. Salomé ne réussit pas à lui faire prendre une goutte de lait; car il prétendit que Christophe n'aurait pas déjeuné non plus, quand il arriverait, et qu'ils mangeraient ensemble, au retour de la gare.
Il se trouva au chemin de fer, trois quarts d'heure en avance. Il se morfondit à attendre Christophe, et finalement le manqua. Au lieu d'avoir la patience de rester à la porte de sortie, il alla sur le quai, et perdit la tête au milieu du tourbillon des arrivées et des départs. Malgré les indications précises de la dépêche, il s'était imaginé, Dieu sait pourquoi! que Christophe arriverait par un autre train que celui qui l'amena; et d'ailleurs, il ne lui serait pas venu à l'idée que Christophe pût descendre d'un wagon de quatrième classe. Il resta plus d'une demi-heure encore à l'attendre à la gare, quand Christophe, arrivé depuis longtemps, était allé tout droit frapper à sa maison. Pour comble de malheur, Salomé venait d'en sortir, pour se rendre au marché: Christophe trouva porte close. La voisine, que Salomé avait chargée de dire, au cas où quelqu'un sonnerait, qu'elle serait bientôt de retour, fit la commission, sans rien ajouter de plus. Christophe, qui n'était pas venu pour voir Salomé et qui ne savait même pas qui elle était, trouva la plaisanterie mauvaise; il demanda si le Herr Universitätsmusikdirektor Schulz n'était donc pas au pays. On lui répondit que si; mais on ne put lui dire où. Furieux, il s'en alla.
Quand le vieux Schulz rentra, la figure longue d'une aune, et quand il apprit de Salomé, qui venait aussi de rentrer, ce qui s'était passé, il fut dans la désolation: il faillit pleurer. Il se mit en rage contre la sottise de la domestique, qui était sortie en son absence et qui n'avait même pas été capable de donner des instructions pour qu'on fit attendre Christophe. Salomé lui répondit, sur le même ton, qu'elle ne pouvait non plus s'imaginer qu'il serait assez sot pour manquer celui qu'il attendait. Mais le vieux ne s'attarda pas à discuter avec elle; sans perdre un instant, il dégringola de nouveau son escalier, et repartit à la recherche de Christophe, sur la piste très vague que les voisins lui indiquèrent.
Christophe avait été froissé de ne trouver personne, ni même un mot d'excuses. Ne sachant que faire avant le prochain train, il était allé se promener dans les champs qui lui paraissaient jolis. C'était une petite ville tranquille, reposante, abritée entre des collines molles; des jardins autour des maisons, des cerisiers en fleurs, des pelouses vertes, de beaux ombrages, des ruines pseudo-antiques, des bustes blancs de princesses d'autrefois sur des colonnes de marbre au milieu de la verdure, des visages doux et gentils. Tout autour de la ville, des prairies, des collines. Dans les buissons fleuris, les merles sifflaient a cœur-joie, formant de petits concerts de flûtes rieuses et sonores. La mauvaise humeur de Christophe ne tarda pas à tomber: il oublia Peter Schulz.
Le vieillard parcourait en vain les rues, interrogeant les passants; il monta jusqu'au vieux château, sur la colline, au-dessus de la ville, et il revenait, navré, quand, de ses yeux perçants qui voyaient de très loin, il aperçut à quelque distance un homme couché dans un pré, à l'ombre d'un buisson. Il ne connaissait pas Christophe: il ne pouvait savoir si c'était lui. L'homme lui tournait le dos, la tête à moitié enfouie dans l'herbe. Schulz rôdait sur la route, tournait autour du pré, le cœur battant:
—C'est lui... Non, ce n'est pas lui...
Il n'osait pas l'appeler. Une idée lui vint: il se mit à chanter la première phrase du Lied de Christophe:
Auf! Auf!... (Debout! Debout!...)
Christophe ressauta, comme un poisson hors de l'eau, et il cria la suite à tue-tête. Il se retourna, joyeux. Il avait la figure rouge et des herbes dans les cheveux. Ils s'interpellèrent tous deux par leurs noms, et coururent l'un à l'autre. Schulz enjamba le fossé de la route, Christophe sauta par dessus la barrière. Ils se serrèrent la main avec effusion, et revinrent ensemble à la maison, riant et parlant très fort. Le vieux contait sa mésaventure. Christophe, qui, un moment avant, était bien décidé à continuer sa route sans faire une nouvelle tentative pour voir Schulz, sentit immédiatement la candide bonté de cette âme, et se prit à l'aimer. Avant d'être arrivés, ils s'étaient déjà confié une multitude de choses.
En entrant, ils trouvèrent Kunz, qui, ayant appris que Schulz était parti à la recherche de Christophe, attendait tranquillement. On servit le café au lait. Mais Christophe dit qu'il avait déjeuné dans une auberge de la ville. Le vieux fut désolé: ce lui était un vrai chagrin que le premier repas que Christophe avait pris dans le pays n'eût pas été chez lui; ces petites choses avaient une importance énorme pour son cœur affectueux. Christophe, qui le comprit, s'en amusa en secret, et il l'en aima davantage. Afin de le consoler, il lui certifia qu'il avait assez bon appétit pour déjeuner deux fois: et il le lui prouva.
Tous ses ennuis lui étaient sortis de la tête: il se sentait au milieu de vrais amis, il ressuscitait. Il racontait son voyage, ses déboires, d'une façon humoristique: il avait l'air d'un écolier en vacances. Schulz, rayonnant, le couvait des yeux, et il riait de tout son cœur.
L'entretien ne tarda pas à rouler sur ce qui les unissait tous trois d'un lien secret: la musique de Christophe. Schulz mourait d'envie d'entendre Christophe jouer quelques-unes de ses œuvres; mais il n'osait le lui demander. Tout en causant, Christophe arpentait la chambre. Schulz guettait ses pas, quand il passait près du piano ouvert; et il faisait des vœux pour qu'il s'y arrêtât. Kunz avait la même pensée. Ils eurent un battement de cœur, lorsqu'ils le virent s'asseoir machinalement sur le tabouret du piano, sans cesser de parler, puis, sans regarder l'instrument, promener ses mains au hasard sur les touches. Comme Schulz s'y attendait, à peine Christophe eut-il fait deux ou trois arpèges, que le son s'empara de lui: il continua d'enchaîner des accords, en causant; puis, ce furent des phrases entières; et alors, il se tut, et commença à jouer. Les vieux échangèrent un coup d'œil d'intelligence, malicieux et heureux.
—Connaissez-vous cela? demanda Christophe, en jouant un de ses Lieder.
—Si je le connais! dit Schulz, ravi.
Christophe, sans s'interrompre, dit, en tournant à demi la tête:
—Hé! Il n'est pas très bon, votre piano!
Le vieux fut très contrit. Il s'excusa:
—Il est vieux, dit-il humblement, il est comme moi.
Christophe se retourna tout à fait, regarda le vieillard qui semblait demander pardon de sa vieillesse, et lui prit les deux mains, en riant. Il contemplait ses yeux candides:
—Oh! vous, dit-il, vous êtes plus jeune que moi.
Schulz riait d'un bon rire, et parlait de son vieux corps, de ses infirmités.
—Ta ta ta! dit Christophe, il ne s'agit pas de cela; je sais ce que je dis. Est-ce que ce n'est pas vrai, Kunz?
(Il avait déjà supprimé le: «Monsieur».)
Kunz approuvait, de toutes ses forces.
Schulz essayait d'associer à sa cause celle de son vieux piano.
—Il a encore de très jolies notes, dit-il timidement.
Et il les toucha:—quatre ou cinq notes assez fraîches, une demi-octave, dans le registre moyen de l'instrument. Christophe comprit que c'était un vieil ami pour lui, et il dit gentiment,—pensant aux yeux de Schulz:
—Oui, il a encore de jolis yeux.
La figure de Schulz s'éclaira. Il s'embarqua dans un éloge embrouillé de son vieux piano, mais se tut aussitôt: car Christophe s'était remis à jouer. Les Lieder succédaient aux Lieder; Christophe chantait à mi-voix. Schulz, les yeux humides, suivait chacun de ses mouvements. Kunz, les mains croisées sur son ventre, fermait les yeux pour mieux jouir. De temps en temps, Christophe se retournait, radieux, vers les deux vieilles gens, qui étaient dans le ravissement; et il disait, avec un enthousiasme naïf, dont ils ne pensaient pas à rire:
—Hein! Est-ce beau!... Et cela! Qu'est-ce que vous en dites?... Et celui-là!... Celui-là est le plus beau de tous...—Maintenant je vais vous jouer quelque chose, qui va vous ravir au septième ciel...
Comme il terminait un morceau rêveur, le coucou de la pendule se mit à sonner. Christophe bondit, et cria de colère. Kunz, réveillé en sursaut, roulait de gros yeux effarés. Schulz ne comprenait pas d'abord. Puis, quand il vit Christophe montrer le poing à l'oiseau qui saluait, et crier qu'au nom du ciel on emportât de là cet idiot, ce spectre ventriloque, il trouva pour la première fois de sa vie, que ce bruit était en effet intolérable; et, prenant une chaise, il voulut grimper dessus, pour décrocher le trouble-fête. Mais il faillit tomber, et Kunz l'empêcha de remonter; il appela Salomé. Elle arriva sans se presser, suivant son habitude, et fut stupéfaite de se voir mettre sur les bras l'horloge, que Christophe impatient avait décrochée lui-même.
—Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? demandait-elle.
—Ce que tu voudras. Emporte! Qu'on ne le revoie plus ici! disait Schulz, non moins impatient que Christophe.
Il se demandait comment il avait pu supporter si longtemps cette horreur.
Salomé pensa que décidément ils étaient tous toqués.
La musique reprit. Les heures passaient. Salomé vint annoncer que le dîner était servi. Schulz lui fit faire silence. Elle revint dix minutes après, puis, de nouveau encore, dix minutes après: cette fois, elle était hors d'elle, et, bouillant de colère, en tâchant d'avoir l'air impassible, elle se planta au milieu de la chambre, et, malgré les gestes désespérés de Schulz, elle demanda, d'une voix de trompette:
—«Si ces messieurs aimaient mieux manger leur dîner froid ou brûlé; que, pour elle, cela lui était égal; elle attendait leurs ordres.»
Schulz, confus de l'algarade, voulut faire une scène à sa servante; mais Christophe éclata de rire, Kunz l'imita, et Schulz finit par faire comme eux. Salomé, satisfaite de l'effet produit, tourna les talons, de l'air d'une reine qui veut bien pardonner à ses sujets repentants.
—Voilà une gaillarde! disait Christophe, se levant du piano. Elle a raison. Rien d'insupportable comme un public qui arrive au milieu du concert.
Ils se mirent à table. C'était un repas énorme et succulent. Schulz avait stimulé l'amour-propre de Salomé, qui ne demandait qu'un prétexte pour étaler son art. Elle ne manquait pas d'occasions de le produire. Les vieux amis étaient prodigieusement gourmands. Kunz était un autre homme à table; il s'épanouissait comme un soleil: il eût pu servir d'enseigne pour un restaurateur. Schulz n'était pas moins sensible à la bonne chère; mais sa mauvaise santé l'obligeait à plus de retenue. Il est vrai qu'il n'en tenait pas compte, le plus souvent; et il le payait. Dans ce cas, il ne se plaignait pas: s'il était malade, au moins il savait pourquoi. Il avait, comme Kunz, des recettes culinaires, héritées, de père en fils, depuis des générations. Salomé avait donc l'habitude d'opérer pour des connaisseurs. Mais, cette fois, elle s'était ingéniée pour rassembler en un seul programme tous ses chefs-d'œuvre à la fois: c'était comme une exposition de cette inoubliable cuisine rhénane, honnête, point frelatée, avec tous, ses parfums de toutes herbes, et ses épaisses sauces, ses potages substantiels, ses pot-au-feu modèles, ses carpes monumentales, ses choucroutes, ses oies, ses gâteaux de ménage, ses pains à l'anis et au cumin. Christophe s'extasiait, la bouche pleine, et mangeait comme un ogre; il avait la capacité formidable de son père et de son grand-père, qui eussent englouti une oie entière. D'ailleurs, il pouvait aussi bien vivre, pendant une semaine, de pain et de fromage, que manger à crever, si l'occasion s'en offrait. Schulz, cordial et cérémonieux, le considérait avec des yeux attendris, et l'arrosait de vins du Rhin. Kunz, rutilant, reconnaissait en lui un frère. La large face de Salomé riait de contentement.—Au premier instant, elle avait été déçue, quand Christophe était entré. Schulz lui en avait tellement parlé, à l'avance, qu'elle se l'était figuré sous les traits d'une Excellence, chargée de titres et d'honneurs. En le voyant, elle s'était exclamée:
—Ça n'est que ça?
Mais, à table, Christophe conquit ses bonnes grâces; elle n'avait vu personne qui rendît aussi brillamment justice à ses talents. Au lieu de retourner dans sa cuisine, elle restait sur le seuil de la porte à regarder Christophe, qui disait des folies, sans perdre un coup de dent; et, les poings sur les hanches, elle riait aux éclats. Tous étaient dans la joie. Il n'y avait qu'un point noir dans leur bonheur: Pottpetschmidt n'était pas là. Ils y revenaient souvent:
—Ah! s'il était ici! C'était lui qui mangeait! C'était lui qui buvait! C'était lui qui chantait!
Ils ne tarissaient pas d'éloges.
—«Si Christophe pouvait l'entendre!... Mais peut-être pourrait-il. Pottpetschmidt serait revenu, ce soir, cette nuit au plus tard...»
—Oh! cette nuit, je serai loin, dit Christophe.
La figure radieuse de Schulz s'assombrit.
—Comment, loin! fit-il, d'une voix tremblante. Mais vous ne partez pas?
—Mais si! dit gaiement Christophe, je reprends le train, ce soir.
Schulz fut désolé. Il avait compté que Christophe passerait plusieurs nuits, dans sa maison. Il balbutiait:
—Non, non, ce n'est pas possible!...
Kunz répétait:
—Et Pottpetschmidt!...
Christophe les regarda tous deux: la déception, qui se peignait sur leurs bonnes faces amies, le toucha; il dit:
—Comme vous êtes gentils!... Je partirai demain matin. Voulez-vous?
Schulz lui saisit la main.
—Ah! fit-il, quel bonheur! Merci! Merci!
Il était comme un enfant, à qui demain semble si loin, si loin qu'il n'y a pas à y penser. Christophe ne partait pas aujourd'hui, tout le jour leur appartenait, ils passeraient toute la soirée ensemble, il dormirait sous son toit: voilà tout ce que voyait Schulz; il ne voulait pas regarder plus loin.
La gaieté reprit. Schulz se leva tout à coup, prit un air solennel, et porta un toast ému et emphatique à son hôte, qui lui avait fait l'immense joie et l'honneur de visiter sa petite ville et son humble maison; il but à son heureux retour, à ses succès, à sa gloire, à tout le bonheur de la terre, qu'il lui souhaitait de toute son âme. Ensuite, il porta un autre toast à «la noble musique»,—un autre à son vieil ami Kunz,—un autre au printemps;—et il n'oublia pas non plus Pottpetschmidt. Kunz but à son tour à Schulz et à quelques autres; et Christophe, pour mettre fin aux toasts, but à dame Salomé, qui en devint cramoisie. Après quoi, sans laisser aux orateurs le temps de riposter, il entama une chanson connue, que les deux vieux reprirent avec lui, puis après celle-là une autre, et encore une autre à trois voix, où il était question d'amitié, de musique et de vin: le tout accompagné de rires retentissants et du tintement des verres qui trinquaient constamment.
Il était trois heures et demie, quand ils se levèrent de table. Ils étaient un peu lourds. Kunz s'affala dans un fauteuil; il eût volontiers fait une somme. Schulz avait les jambes cassées de ses émotions du matin, non moins que de ses toasts. Tous deux espéraient que Christophe se remettrait au piano et jouerait pendant des heures. Mais le terrible garçon, tout gaillard et dispos, après avoir frappé trois ou quatre accords sur le piano, le ferma brusquement, regarda par la fenêtre, et demanda si on ne pourrait pas faire un tour jusqu'au souper. La campagne l'attirait. Kunz montra peu d'enthousiasme; mais Schulz trouva sur-le-champ que l'idée était excellente, et qu'il fallait faire voir à leur hôte la promenade des Schönbuchwälder. Kunz fit un peu la grimace; mais il ne protesta point, et se leva avec les autres: il était aussi désireux que Schulz de montrera Christophe les beautés du pays.
Ils sortirent. Christophe avait pris le bras de Schulz, et le faisait marcher plus vite que le vieux n'eût voulu. Kunz suivait, en s'épongeant. Ils péroraient gaiement. Les gens, sur le seuil de leurs portes, les regardaient passer, et trouvaient que Herr Professor Schulz avait l'air d'un jeune homme. Au sortir de la ville, ils prirent à travers prés. Kunz se plaignait de la chaleur. Christophe, sans pitié, trouvait que l'air était exquis. Par bonheur pour les deux vieilles gens, on s'arrêtait à tout instant pour discuter, et la conversation faisait oublier la longueur du chemin. On entra dans les bois. Schulz récita des vers de Gœthe et de Mœrike. Christophe aimait beaucoup les vers; mais il n'en pouvait retenir aucun: il s'abandonnait, en les écoutant, à une rêverie vague, où des musiques se substituaient aux mots et les faisaient oublier. Il admirait la mémoire de Schulz. Quelle différence entre la vivacité d'esprit de ce vieillard malade, presque impotent, enfermé dans sa chambre une partie de l'année, enfermé dans sa ville de province sa vie presque tout entière,—et Hassler, qui, jeune, célèbre, au cœur du mouvement artistique, et parcourant l'Europe pour ses tournées de concerts, ne s'intéressait à rien et ne voulait rien connaître! Non seulement Schulz était au courant de toutes les manifestations de l'art présent, que connaissait Christophe; mais il savait une quantité de choses sur des musiciens passés ou étrangers, dont Christophe n'avait jamais entendu parler. Sa mémoire était une citerne profonde, où toutes les belles eaux du ciel avaient été recueillies. Christophe ne se lassait pas d'y puiser; et Schulz était heureux de l'intérêt de Christophe. Il avait rencontré parfois des auditeurs complaisants, ou des élèves dociles; mais il avait toujours manqué d'un cœur jeune et ardent, avec qui il pût partager les enthousiasmes, dont il était gonflé jusqu'à en étouffer.
Ils étaient les meilleurs amis du monde, quand le vieux eut la maladresse de dire son admiration pour Brahms. Christophe se mit dans une colère froide: il lâcha le bras de Schulz, et dit d'un ton cassant que qui aimait Brahms ne pouvait être son ami. Cela jeta une douche sur leur joie. Schulz, trop timide pour discuter, trop honnête pour mentir, balbutiait, tâchait de s'expliquer. Mais Christophe l'arrêta par un:
—Assez! tranchant qui n'admettait pas de réplique. Il y eut un silence glacial. Ils continuèrent de marcher. Les deux vieillards n'osaient passe regarder. Kunz, après avoir toussoté, essaya de renouer la conversation et de parler des bois et du beau temps; mais Christophe, boudeur, laissait tomber l'entretien et ne répondait que par monosyllabes. Kunz, ne trouvant pas d'écho de ce côté, tâcha, pour rompre le silence, de causer avec Schulz; mais Schulz avait la gorge serrée, il ne pouvait parler. Christophe le regardait du coin de l'œil, et il avait envie de rire: il lui avait déjà pardonné. Il ne lui en avait jamais voulu sérieusement; il trouvait même qu'il était un animal de contrister ce pauvre vieux; mais il abusait de son pouvoir et il ne voulait pas avoir l'air de revenir sur ce qu'il avait dit. Ils restèrent ainsi jusqu'à la sortie du bois: on n'entendait plus que les pas traînants des deux vieux déconfits; Christophe sifflotait et semblait ne pas les voir. Soudain, il n'y tint plus. Il éclata de rire, se retourna vers Schulz, et lui empoigna les bras dans ses solides mains:
—Mon bon cher vieux Schulz! fit-il, en le regardant affectueusement, est-ce beau! est-ce beau!...
Il parlait de la campagne et de la belle journée; mais ses yeux qui riaient semblaient dire:
—Tu es bon. Je suis une brute. Pardonne-moi! Je t'aime bien.
Le cœur du vieux se fondit. C'était comme si le soleil était revenu après une éclipse. Il fut, un moment encore, avant de pouvoir articuler un mot. Christophe lui avait repris le bras et causait plus amicalement que jamais: dans son entrain, il avait doublé le pas, sans faire attention qu'il exténuait ses deux compagnons. Schulz ne se plaignait pas; il ne s'apercevait même pas de la fatigue, tant il était content. Il savait qu'il paierait toutes ses imprudences de la journée; mais il se disait:
—Tant pis pour demain! Quand il sera parti, j'aurai bien le temps de me reposer.
Mais Kunz, moins exalté, suivait à quinze pas, en faisant une mine piteuse. Christophe s'en aperçut enfin. Il s'excusa, tout confus, et il offrit de s'étendre dans une prairie, à l'ombre des peupliers. Schulz, naturellement, acquiesçait, sans se demander si sa bronchite y trouverait son compte. Heureusement, Kunz y songea pour lui; ou, du moins, il donna ce prétexte pour ne pas s'exposer, en nage comme il était, à la fraîcheur des prés. Il proposa d'aller reprendre à une station voisine le train qui ramenait en ville. Ainsi fut fait. Malgré leur fatigue, ils durent hâter le pas, pour n'être pas en retard, et ils arrivèrent en gare, juste au moment où le train y entrait.
À leur vue, un gros homme s'élança à la portière d'un wagon, et mugit les noms de Schulz et de Kunz, en les accompagnant de la liste de tous leurs titres et qualités, et en agitant les bras comme un fou. Schulz et Kunz répondirent en criant et remuant aussi les bras; ils se précipitèrent vers le compartiment du gros homme, qui accourait à leur rencontre, en bousculant ses compagnons de route. Christophe, ahuri, suivait en courant, et il demandait:
—Quoi donc?
Et les autres, exultants, criaient:
—C'est Pottpetschmidt!
Ce nom ne lui disait pas grand'chose. Il avait oublié les toasts du dîner. Pottpetschmidt sur la plate-forme du wagon, Schulz et Kunz sur le marchepied, faisaient un vacarme assourdissant; ils s'émerveillaient de leur chance. Ils se hissèrent dans le train qui partait. Schulz fit les présentations. Pottpetschmidt, après avoir salué, les traits brusquement pétrifiés, et raide comme un piquet, se jeta, aussitôt après les formalités accomplies, sur la main de Christophe, qu'il secoua cinq ou six fois, comme s'il voulait la démancher, et se remit à vociférer. Christophe distingua dans ses cris qu'il remerciait Dieu et son étoile de cette extraordinaire rencontre. Cela ne l'empêcha point, un moment après, en se frappant les cuisses, d'accuser sa mauvaise chance de l'avoir fait partir de la ville,—lui qui n'en sortait jamais,—juste pour l'arrivée de Monsieur le Kapellmeister. La dépêche de Schulz ne lui avait été remise que le matin, une heure après le départ du train; il dormait quand elle était arrivée, et on avait jugé bon de ne pas le réveiller. Il en avait tempêté, toute la matinée, contre les gens de l'hôtel. Il en tempêtait encore. Il avait envoyé promener ses clients, ses rendez-vous d'affaires, et pris le premier train, dans sa hâte de revenir; mais ce train du diable avait manqué la correspondance de la grande ligne: Pottpetschmidt avait du attendre trois heures, dans une gare; il y avait épuisé toutes les exclamations de son vocabulaire, et vingt fois raconté sa mésaventure aux voyageurs qui attendaient comme lui et au portier de la gare. Enfin, on était reparti. Il tremblait d'arriver trop tard... Mais, Dieu soit loué! Dieu soit loué!...
Il avait repris les mains de Christophe, et les pétrissait dans ses vastes pattes aux doigts poilus. Il était fabuleusement gros, et grand en proportion: la tête carrée, les cheveux roux, taillés ras, la figure rasée, grêlée, gros yeux, gros nez, grosses lèvres, double menton, le cou court, le dos d'une largeur monstrueuse, le ventre comme un tonneau, les bras écartés du corps, les pieds et les mains énormes, un gigantesque amas de chair, déformé par l'abus de la mangeaille et de la bière, un de ces pots-à-tabac, à face humaine, comme on en voit rouler parfois dans les rues des villes de Bavière, qui gardent le secret de cette race d'hommes, obtenue par un système de gavage analogue à celui des volailles mises dans une épinette. De joie et de chaleur, il luisait comme une motte de beurre: et, les deux mains posées sur ses deux genoux écartés, ou sur ceux de ses voisins, il ne se lassait point de parler, faisant rouler les consonnes dans l'air, avec une vigueur de catapulte. Par instants, il était pris d'un rire qui le secouait tout entier: il rejetait la tête en arrière, ouvrant la bouche, ronflant, râlant et s'étranglant. Son rire se communiquait à Schulz et à Kunz, qui, quand l'accès était passé, regardaient Christophe, en s'essuyant les yeux. Ils avaient l'air de lui demander:
—Hein!... Et qu'est-ce que vous en dites?
Christophe n'en disait rien; il pensait avec effroi:
—C'est ce monstre qui chante ma musique?
Ils rentrèrent chez Schulz. Christophe espérait éviter le chant de Pottpetschmidt, et ne lui faisait aucune avance, malgré les allusions de Pottpetschmidt, qui grillait de se faire entendre. Mais Schulz et Kunz avaient à cœur de se faire honneur de leur ami: il fallut en passer par là. Christophe se mit au piano, d'assez mauvaise grâce; il pensait:
—Mon bonhomme, mon bonhomme, tu ne sais pas ce qui t'attend: gare à toi! Je ne te passerai rien.
Il se disait qu'il allait faire de la peine à Schulz, et il en était fâché; mais il n'en était pas moins résolu à lui faire de la peine, plutôt que de tolérer que ce sir John Falstaff égorgeât sa musique. Le remords de chagriner son vieil ami lui fut épargné: le gros homme chanta d'une voix admirable. Dès les premières mesures, Christophe fit un mouvement de surprise. Schulz, qui ne le quittait pas des yeux, trembla: il pensa que Christophe n'était pas content et il ne se rassura qu'en voyant sa figure s'éclairer, à mesure qu'il jouait. Lui-même s'illuminait du reflet de sa joie; et, le morceau fini, quand Christophe se retourna, en criant que jamais il n'avait entendu chanter ainsi un de ses Lieder, ce fut pour Schulz un ravissement plus doux et plus profond que celui de Christophe satisfait et de Pottpetschmidt triomphant: car chacun des deux n'avait que son propre plaisir, et Schulz avait celui de ses deux amis. Le concert continua. Christophe s'exclamait: il ne pouvait comprendre comment cet être lourd et commun parvenait à rendre la pensée de ses Lieder. Sans doute, ce n'en étaient pas toutes les nuances exactes; mais c'en était l'élan, la passion, qu'il n'avait jamais réussi à souffler complètement à des chanteurs de profession. Il regardait Pottpetschmidt, et il se demandait:
—Est-ce qu'il sent cela, vraiment?
Mais il ne voyait dans ses yeux d'autre flamme que celle de la vanité satisfaite. Une force inconsciente remuait cette lourde masse. Celte force aveugle et passive était comme une armée, qui se bat, sans savoir contre qui, ni pourquoi. L'esprit des Lieder s'emparait d'elle, et elle obéissait en jubilant: car elle avait besoin d'agir; et, livrée à elle-même, elle n'eût jamais su comment.
Christophe se disait qu'au jour de la Création, le grand sculpteur ne s'était pas donné beaucoup de peine pour mettre en ordre les membres épars de ses créatures ébauchées, et qu'il les avait ajustés, tant bien que mal, sans s'inquiéter s'ils étaient faits pour aller ensemble: ainsi, chacun se trouvait fabriqué avec des morceaux de toute provenance; et le même homme était épars en cinq ou six hommes différents: le cerveau était chez l'un, chez un autre le cœur, chez un troisième le corps qui convenait à cette âme; l'instrument était d'un côté, et l'instrumentiste de l'autre. Certains êtres restaient comme d'admirables violons, éternellement enfermés dans leur boîte, faute de quelqu'un qui sût en jouer. Et ceux qui étaient faits pour en jouer étaient, toute leur vie, obligés de se contenter de misérables crincrins. Il avait d'autant plus de raisons de penser ainsi qu'il était furieux contre lui-même de n'avoir jamais été capable de chanter proprement une page de musique. Il avait la voix fausse, et ne pouvait s'écouter sans horreur.
Cependant, Pottpetschmidt, grisé par son succès, commençait à «mettre de l'expression» dans les Lieder de Christophe: c'est-à-dire qu'il substituait la sienne à celle de Christophe. Celui-ci, naturellement, ne trouvait pas que sa musique gagnât au change; et il s'assombrissait. Schulz s'en aperçut. Son manque de critique et l'admiration qu'il avait pour ses amis ne lui eussent pas permis de se rendre compte, par lui-même, du mauvais goût de Pottpetschmidt. Mais son affection pour Christophe lui faisait percevoir les nuances les plus furtives de la pensée du jeune homme: il n'était plus en lui, il était en Christophe; et il souffrit aussi de l'emphase de Pottpeschmidt. Il s'ingénia à l'arrêter sur cette pente dangereuse. Il n'était pas facile de faire taire Pottpetschmidt. Schulz eut toutes les peines du monde, quand le chanteur eut épuisé le répertoire de Christophe, à l'empêcher de se faire entendre dans les élucubrations de compositeurs médiocres, au seul nom desquels Christophe se hérissait en boule, comme un porc-épic.
Heureusement, l'annonce du souper vint museler Pottpetschmidt. Un autre terrain s'offrait à lui, pour déployer sa valeur: il y était sans rival; et Christophe, que ses exploits de la matinée avaient un peu lassé, n'essaya point de lutter.
La soirée s'avançait. Assis autour de la table, les trois vieux amis contemplaient Christophe; ils buvaient ses paroles. Il semblait bien étrange à Christophe de se trouver dans cette petite ville perdue, au milieu de ces vieilles gens, qu'il n'avait jamais vus avant ce jour, et d'être plus intime avec eux que s'ils avaient été de sa famille. Il pensait quel bienfait ce serait pour un artiste, s'il pouvait se douter des amis inconnus que sa pensée rencontre dans le monde,—combien son cœur en serait réchauffé et ses forces grandies... Mais il n'en est rien, le plus souvent: chacun reste seul et meurt seul, craignant d'autant plus de dire ce qu'il sent, qu'il sent davantage et qu'il aurait plus besoin de le dire. Les complimenteurs vulgaires n'ont point de peine à parler. Ceux qui aiment le mieux doivent se faire violence pour desserrer les dents et pour dire qu'ils aiment. Aussi, faut-il être reconnaissant à ceux qui osent parler: ils sont, sans s'en douter, les collaborateurs de celui qui crée.—Christophe était pénétré de gratitude pour le vieux Schulz. Il ne le confondait pas avec ses deux compagnons; il sentait qu'il était l'âme de ce petit groupe d'amis: les autres n'étaient que les reflets de ce Foyer vivant d'amour et de bonté. L'amitié que Kunz et Pottpetschmidt avaient pour lui était bien différente. Kunz était égoïste: la musique lui procurait une satisfaction de bien-être, comme à un gros chat qu'on caresse. Pottpetschmidt y trouvait un plaisir de vanité et d'exercice physique. Ni l'un ni l'autre ne s'inquiétait de le comprendre. Mais Schulz s'oubliait tout entier: il aimait.
Il était tard. Les deux amis invités repartirent, dans la nuit. Christophe resta seul avec Schulz. Il lui dit:
—Maintenant, je vais jouer, pour vous seul.
Il se mit au piano et joua,—comme il savait le faire, quand il avait près de lui quelqu'un qui lui était cher. Il joua de ses œuvres nouvelles. Le vieillard était en extase. Assis auprès de Christophe, il ne le quittait pas des yeux et retenait son souffle. Dans la bonté de son cœur, incapable de garder le moindre bonheur pour lui seul, il répétait, malgré lui:
—Ah! quel malheur que Kunz ne soit plus là! (ce qui impatientait un peu Christophe).
Une heure passa: Christophe jouait toujours; ils n'avaient pas échangé une parole. Quand Christophe eut fini, ils ne dirent mot. Tout était silencieux: la maison, la rue dormaient. Christophe se retourna, et vit le vieil homme, qui pleurait: il se leva et alla l'embrasser. Ils causèrent tout bas, dans le calme de la nuit. Le tic-tac de l'horloge, amorti, battait dans une chambre voisine. Schulz parlait à mi-voix, les mains jointes, le corps penché en avant; il racontait à Christophe, qui l'interrogeait, sa vie, ses tristesses; à tout instant, il avait des scrupules de se plaindre, il éprouvait le besoin de dire:
—J'ai tort... je n'ai pas le droit de me plaindre... tout le monde a été très bon pour moi...
Et il ne se plaignait pas, en effet: c'était seulement une mélancolie involontaire qui se dégageait du sobre récit de sa vie solitaire. Il y mêlait, aux moments les plus douloureux, des professions de foi d'un idéalisme très vague et très sentimental, qui agaçaient Christophe, mais qu'il eût été cruel de contredire. Au fond, c'était, chez Schulz, bien moins une croyance ferme qu'un désir passionné de croire,—un espoir incertain, auquel il se cramponnait, comme à une bouée. Il en cherchait confirmation dans les yeux de Christophe. Christophe entendait l'appel des yeux de son ami, qui s'attachaient à lui avec une confiance touchante, qui imploraient de lui—qui lui dictaient sa réponse. Alors il dit les paroles de foi tranquille et de force que le vieux attendait, et qui lui firent du bien. Le vieux et le jeune avaient oublié les années qui les séparaient: ils étaient l'un près de l'autre, comme deux frères du même âge, qui s'aiment et qui s'entr'aident; le plus faible cherchait un appui auprès du plus fort: le vieillard se réfugiait dans l'âme du jeune homme.
Ils se quittèrent, après minuit. Christophe devait se lever de bonne heure pour reprendre le même train qui l'avait amené. Aussi ne flâna-t-il point en se déshabillant. Le vieux avait préparé la chambre de son hôte, comme s'il devait y passer plusieurs mois. Il avait mis sur la table des roses dans un vase, et une branche de laurier. Il avait installé un buvard tout neuf sur le bureau. Il avait fait porter, dans la matinée, un piano droit. Il avait choisi et placé sur la planchette, ou chevet du lit, quelques-uns de ses livres les plus précieux et les plus aimés. Pas un détail auquel il n'eût pensé avec amour. Ce fut peine perdue: Christophe n'en vit rien. Il se jeta sur son lit, et dormit aussitôt, à poings fermés.
Schulz ne dormit pas. Il ruminait à la fois toute la joie qu'il avait eue, et tout le chagrin qu'il avait déjà du départ de l'ami. Il repassait dans sa tête les paroles qu'ils s'étaient dites. Il songeait que le cher Christophe dormait près de lui, de l'autre côté du mur, contre lequel son lit était appuyé. Il était écrasé de fatigue, courbaturé, oppressé; il sentait qu'il s'était refroidi pendant la promenade et qu'il allait avoir une rechute; mais il n'avait qu'une pensée:
—Pourvu que cela dure jusqu'après son départ!
Et il tremblait d'avoir un accès de toux, qui réveillât Christophe. Il était plein de reconnaissance envers Dieu, et se mit à composer des vers sur le cantique du vieux Siméon: Nunc dimittis... Il se leva, en sueur, pour écrire ces vers, et il resta assis à sa table, jusqu'à ce qu'il les eût recopiés soigneusement, avec une dédicace débordante d'affection, et sa signature au bas, la date et l'heure. Puis, il se recoucha, ayant le frisson, et ne put se réchauffer, de tout le reste de la nuit.
L'aube vint. Schulz songeait, avec regret, à l'aube de la veille. Mais il se blâma de gâter par ces pensées les dernières minutes de bonheur qui lui restaient; il savait bien que, le lendemain, il regretterait l'heure qui s'enfuyait maintenant; il s'appliqua à n'en rien perdre. Il tendait l'oreille au moindre bruit de la chambre à côté. Mais Christophe ne bougeait point. Où il s'était couché, il se trouvait encore; il n'avait pas fait un mouvement. Six heures et demie étaient sonnées, et il dormait toujours. Rien n'eût été plus facile que de lui laisser manquer le train; et, sans doute, eût-il pris la chose en riant. Mais le vieux était trop scrupuleux pour disposer d'un ami, sans son consentement. Il avait beau se répéter:
—Ce ne sera point ma faute. Je n'y serai pour rien. Il suffit de ne rien dire. Et s'il ne se réveille pas à temps, j'aurai encore tout un jour à passer avec lui.
Il se répliqua:
—Non, je n'en ai pas le droit.
Et il se crut obligé d'aller le réveiller. Il frappa à sa porte. Christophe n'entendit pas tout de suite: il fallut insister. Cela faisait gros cœur au vieux, qui pensait:
—Ah! comme il dormait bien! Il serait resté là jusqu'à midi!...
Enfin, la voix joyeuse de Christophe répondit, de l'autre côté de la cloison. Quand il sut l'heure, il s'exclama; et on l'entendit s'agiter dans sa chambre, faire bruyamment sa toilette, chanter des bribes d'airs, tout en interpellant amicalement Schulz à travers la muraille, et disant des drôleries, qui faisaient rire le vieux, malgré son chagrin. La porte s'ouvrit: il parut, frais, reposé, la figure heureuse; il ne pensait pas du tout à la peine qu'il faisait. En réalité, rien ne le pressait de partir; il ne lui en eût rien coûté de rester quelques jours de plus; et cela eût fait tant de plaisir à Schulz! Mais Christophe ne pouvait s'en douter exactement. D'ailleurs, quelque affection qu'il eût pour le vieux, il était bien aise de s'en aller: il était fatigué par cette journée de conversation perpétuelle, par ces âmes qui s'accrochaient à lui, avec une affection désespérée. Et puis, il était jeune, il pensait qu'ils auraient le temps de se revoir: il ne partait pas pour le bout du monde!—Le vieillard savait que lui, serait bientôt plus loin qu'au bout du monde; et il regardait Christophe, pour toute l'éternité.
Il l'accompagna à la gare, malgré son extrême fatigue. Une petite pluie fine, froide, tombait sans bruit. À la station, Christophe s'aperçut, en ouvrant son porte-monnaie, qu'il n'avait plus assez d'argent pour prendre son billet de retour jusqu'à chez lui. Il savait que Schulz lui prêterait, avec joie; mais il ne voulut pas le lui demander... Pourquoi? Pourquoi refuser à celui qui vous aime l'occasion—le bonheur de vous rendre service?... Il ne le voulut pas, par discrétion, par amour-propre peut-être. Il prit un billet jusqu'à une station intermédiaire, se disant qu'il ferait le reste du chemin à pied.
L'heure du départ sonna. Sur le marchepied du wagon, ils s'embrassèrent. Schulz glissa dans la main de Christophe sa poésie écrite pendant la nuit. Il resta sur le quai, au pied du compartiment. Ils n'avaient plus rien à se dire, comme il arrive quand les adieux se prolongent; mais les yeux de Schulz continuaient de parler: ils ne se détachèrent pas du visage de Christophe, jusqu'à ce que le train partît.
Le wagon disparut à un tournant de la voie. Schulz se retrouva seul. Il revint par l'avenue boueuse; il se traînait: il sentait brusquement la fatigue, le froid, la tristesse du jour pluvieux. Il eut grand'peine à regagner sa maison et à monter l'escalier. À peine rentré dans sa chambre, il fut pris d'une crise d'étouffement et de toux. Salomé vint à son secours. Au milieu de ses gémissements involontaires, il répétait:
—Quel bonheur!... Quel bonheur que c'ait attendu!...
Il se sentait très mal. Il se coucha. Salomé alla chercher le médecin. Dans son lit, tout son corps s'abandonnait, comme une loque. Il n'aurait pu faire un mouvement; seule, sa poitrine haletait, comme un soufflet de forge. Sa tête était lourde et fiévreuse. Il passa la journée entière à revivre, minute par minute, toute la journée de la veille: il se torturait ainsi, et il se reprochait ensuite de se plaindre, après un tel bonheur. Les mains jointes, le cœur gonflé d'amour, il remerciait Dieu.
Rasséréné par cette journée, rendu plus confiant en soi par l'affection qu'il laissait derrière lui, Christophe revenait au pays. Arrivé au terme de son billet, il descendit gaiement, et se mit en route, à pied. Il avait une soixantaine de kilomètres à faire. Il n'était pas pressé, et flânait comme un écolier. C'était Avril. La campagne n'était pas très avancée. Les feuilles se dépliaient, comme de petites mains ridées, au bout des branches noires; quelques pommiers étaient en fleurs, et les frêles églantines souriaient, le long des haies. Par-dessus la forêt déplumée, où commençait à pousser un fin duvet vert-tendre, se dressait, au faîte d'une petite colline, tel un trophée au bout d'une lance, un vieux château roman. Dans le ciel bleu très doux, voguaient des nuages très noirs. Les ombres couraient sur la campagne printanière; des giboulées passaient; puis, le clair soleil renaissait, et les oiseaux chantaient.
Christophe s'aperçut que, depuis quelques instants, il songeait à l'oncle Gottfried. Il y avait bien longtemps qu'il n'avait plus pensé au pauvre homme; et il se demandait pourquoi son souvenir lui revenait en ce moment, avec obstination; il en était hanté, tandis qu'il cheminait sur une avenue, bordée de peupliers, le long d'un canal miroitant; cette image le poursuivait de telle sorte qu'au détour d'un grand mur, il lui sembla qu'il allait le voir venir à sa rencontre.
Le ciel s'était assombri. Une violente averse de pluie et de grêle se mit à tomber, et le tonnerre gronda au loin. Christophe était près d'un village, dont il voyait les façades roses et les toits rouges, au milieu des bouquets d'arbres. Il hâta le pas, et se mit à l'abri sous le toit avançant de la première maison. Les grêlons cinglaient dru; ils tintaient sur les tuiles, et rebondissaient dans la rue, comme des grains de plomb. Les ornières coulaient à pleins bords. À travers les vergers en fleurs, un arc-en-ciel tendait son écharpe éclatante et barbare sur les nuées bleu-sombre.
Sur le seuil de la porte, debout, une jeune fille tricotait. Elle dit amicalement à Christophe d'entrer. Il accepta l'invitation. La salle où il pénétra servait à la fois de cuisine, de salle à manger, et de chambre à coucher. Au fond, une marmite était suspendue sur un grand feu. Une paysanne, qui épluchait des légumes, souhaita le bonjour à Christophe, et lui dit de s'approcher du feu, pour se sécher. La jeune fille alla chercher une bouteille et lui servit à boire. Assise de l'autre côté de la table, elle continuait de tricoter, tout en s'occupant de deux enfants, qui jouaient à s'enfoncer dans le cou de ces épis d'herbes, qu'on nomme à la campagne des «voleurs» ou des «ramonas». Elle lia conversation avec Christophe. Il ne s'aperçut qu'après un moment qu'elle était aveugle. Elle n'était point belle. C'était une forte fille, les joues rouges, les dents blanches, les bras solides; mais les traits manquaient de régularité: elle avait l'air souriant et un peu inexpressif de beaucoup d'aveugles, et aussi, leur manie de parler des choses et des gens, comme si elle les voyait. Au premier moment, Christophe, interloqué, se demanda si elle se moquait, quand elle lui dit qu'il avait bonne mine, et que la campagne était très jolie aujourd'hui. Mais après avoir regardé tour à tour l'aveugle et la femme qui épluchait, il vit que cela n'étonnait personne. Les deux femmes interrogèrent amicalement Christophe, s'informant d'où il venait, par où il avait passé. L'aveugle se mêlait à l'entretien, avec une animation un peu exagérée; elle approuvait, ou commentait les observations de Christophe sur le chemin et sur les champs. Naturellement, ses remarques tombaient souvent à faux. Elle semblait vouloir se persuader qu'elle voyait aussi bien que lui.
D'autres gens de la famille étaient rentrés: un robuste paysan, d'une trentaine d'années, et sa jeune femme. Christophe causait avec les uns et avec les autres; et, regardant le ciel qui s'éclaircissait, il attendait le moment de repartir. L'aveugle chantonnait un air, tout en faisant marcher les aiguilles de son tricot. Cet air rappelait à Christophe des choses anciennes.
—Comment! vous connaissez cela? dit-il.
(Gottfried le lui avait autrefois appris.)
Il fredonna la suite. La jeune fille se mit à rire. Elle chantait la première moitié des phrases, et il s'amusait à les terminer. Il venait de se lever, pour aller inspecter l'état du temps et il faisait le tour de la chambre, en furetant machinalement du regard dans tous les coins, quand il aperçut, dans un angle, près du dressoir, un objet, qui le fit tressauter. C'était un long bâton recourbé, dont le manche, grossièrement sculpté, représentait un petit homme courbé qui saluait. Christophe le connaissait bien: il avait joué tout enfant avec. Il sauta sur la canne, et demanda d'une voix étranglée:
—D'où avez-vous... D'où avez-vous cela?
L'homme regarda, et dit:
—C'est un ami qui l'a laissé; un ancien ami, qui est mort.
Christophe cria:
—Gottfried?
Tous se retournèrent, en demandant:
—Comment savez-vous...?
Et quand Christophe eut dit que Gottfried était son oncle, ce fut un émoi général. L'aveugle s'était levée; son peloton de laine avait roulé à travers la chambre; elle marchait sur son ouvrage, et avait pris les mains de Christophe, en répétant:
—Vous êtes son neveu?
Tout le monde parlait à la fois. Christophe demandait, de son côté:
—Mais vous, comment... comment le connaissez-vous?
L'homme répondit:
—C'est ici qu'il est mort.
On se rassit; et quand l'agitation fut un peu calmée, la mère raconta, en reprenant son travail, que Gottfried venait à la maison, depuis des années; toujours il s'y arrêtait, à l'aller et au retour, dans chacune de ses tournées. La dernière fois qu'il était venu—(c'était en juillet dernier),—il semblait très las; et, son ballot déchargé, il avait été un moment avant de pouvoir articuler une parole; mais on n'y avait pas pris garde, parce qu'on était habitué à le voir ainsi, quand il arrivait: on savait qu'il avait le souffle court. Il ne se plaignait pas. Jamais il ne se plaignait: il trouvait toujours un sujet de contentement dans les choses désagréables. Quand il faisait un travail exténuant, il se réjouissait en pensant comme il serait bien dans son lit, le soir; et quand il était souffrant, il disait comme cela serait bon, quand il ne souffrirait plus...
—Et c'est un tort, Monsieur, d'être toujours content, ajoutait la bonne femme; car quand on ne se plaint pas, les autres ne vous plaignent pas. Moi, je me plains toujours...
Donc, on n'avait pas fait attention à lui. On l'avait même plaisanté sur sa bonne mine, et Modesta—(c'était le nom de la jeune fille aveugle),—qui était venue le décharger de son paquet, lui avait demandé s'il ne serait donc jamais las de courir ainsi, comme un jeune homme. Il souriait, pour toute réponse; car il ne pouvait parler. Il s'assit sur le banc devant la porte. Chacun partit à son ouvrage: les hommes, aux champs; la mère, à sa cuisine. Modesta vint près du banc: debout, adossée à la porte, son tricot à la main, elle causait avec Gottfried. Il ne lui répondait pas: elle ne lui demandait pas de réponse, elle lui racontait tout ce qui s'était passé depuis sa dernière visite. Il respirait avec peine; et elle l'entendit faire des efforts pour parler. Au lieu de s'en inquiéter, elle lui dit:
—Ne parle pas. Repose-toi. Tu parleras tout à l'heure... S'il est possible de se fatiguer, comme cela!...
Alors, il ne parla plus. Elle reprit son récit, croyant qu'il écoutait. Il soupira, et se tut. Quand la mère sortit, un peu plus tard, elle trouva Modesta, qui continuait de parler, et, sur le banc, Gottfried, immobile, la tête renversée en arrière et tournée vers le ciel: depuis quelques minutes, Modesta causait avec un mort. Elle comprit alors que le pauvre homme avait essayé de dire quelques mots, avant de mourir, mais qu'il n'avait pas pu; alors, il s'était résigné, avec son sourire triste, et il avait fermé les yeux, dans la paix du soir d'été...
La pluie avait cessé. La bru alla à l'étable; le fils prit sa pioche et déblaya, devant la porte, la rigole que la boue avait obstruée. Modesta avait disparu dès le commencement du récit. Christophe restait seul dans la chambre avec la mère, et se taisait, ému. La vieille, un peu bavarde, ne pouvait supporter un silence prolongé; et elle se mit à lui raconter toute l'histoire de sa connaissance avec Gottfried. Cela datait de très loin. Quand elle était toute jeune, Gottfried l'aimait. Il n'osait pas le lui dire; mais on en plaisantait; elle se moquait de lui, tous se moquaient de lui:—(c'était l'habitude, partout où il passait.)—Gottfried n'en revenait pas moins, fidèlement, chaque année. Il trouvait naturel qu'on se moquât de lui, naturel qu'elle ne l'aimât point, naturel qu'elle se fût mariée et qu'elle fût heureuse avec un autre. Elle avait été trop heureuse, elle s'était trop vantée de son bonheur: le malheur arriva. Son mari mourut subitement. Puis, sa fille,—une belle fille saine, vigoureuse, que tout le monde admirait, et qui allait se marier avec le fils du plus riche paysan de la contrée, perdit la vue, par accident. Un jour qu'elle était montée dans le grand poirier derrière la maison, pour cueillir les fruits, l'échelle glissa: en tombant, une branche cassée la heurta rudement, près de l'œil. On crut qu'elle en serait quitte pour une cicatrice; mais depuis, elle ne cessa de souffrir d'élancements dans le front: un œil s'obscurcit, puis l'autre; et tous les soins furent inutiles. Naturellement, le mariage avait été rompu; le futur s'était éclipsé, sans autre explication; et, de tous les garçons, qui, un mois avant, se seraient assommés mutuellement pour un tour de valse avec elle, pas un n'avait eu le courage—(c'est bien compréhensible)—de se mettre une infirme sur les bras. Alors, Modesta, jusque-là insouciante et rieuse, tomba dans un tel désespoir qu'elle voulait mourir. Elle refusait de manger, elle pleurait, du matin au soir; et, la nuit, on l'entendait encore se lamenter dans son lit. On ne savait plus que faire, on ne pouvait que se désoler avec elle; et elle n'en pleurait que de plus belle. On finit par être excédé de ses plaintes; alors, on la rabrouait, et elle parlait d'aller se jeter dans le canal. Le pasteur venait quelquefois: il l'entretenait du bon Dieu, des choses éternelles, et des mérites qu'elle s'acquérait pour l'autre monde, en supportant ses peines; mais cela ne la consolait pas du tout. Un jour, Gottfried revint. Modesta n'avait jamais été bien bonne pour lui. Non qu'elle fût mauvaise; mais dédaigneuse; et puis, elle ne réfléchissait pas, elle aimait à rire: il n'y avait pas de malices qu'elle ne lui eût faites. Quand il apprit son malheur, il fut bouleversé. Pourtant, il ne lui en montra rien. Il alla s'asseoir auprès d'elle, ne fit aucune allusion à l'accident, et se mit à causer tranquillement, comme il faisait, avant. Il n'eut pas un mot pour la plaindre; il avait l'air de ne pas même s'apercevoir qu'elle était aveugle. Seulement, il ne lui parlait jamais de ce qu'elle ne pouvait voir; il lui parlait de tout ce qu'elle pouvait entendre, ou remarquer, dans son état; et il faisait cela, simplement, comme une chose naturelle: on eût dit qu'il était, lui aussi, aveugle. D'abord, elle n'écoutait pas, et continuait de pleurer. Mais le lendemain, elle écouta mieux, et même elle lui parla un peu...
—Et, continuait la mère, je ne sais pas ce qu'il a bien pu lui dire. Car nous avions les foins à faire, et je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Mais, le soir, quand nous sommes revenus des champs, nous l'avons trouvée qui causait tranquillement. Et depuis, elle a toujours été mieux. Elle semblait oublier son mal. De temps en temps, cela la reprenait encore: elle pleurait, ou bien elle essayait de parler à Gottfried de choses tristes; mais celui-ci ne semblait pas entendre; il continuait de causer posément de choses qui la calmaient et qui l'intéressaient. Il la décida enfin à se promener hors de la maison, d'où elle n'avait plus voulu sortir depuis l'accident. Il lui fit faire quelques pas d'abord autour du jardin, puis des courses plus longues dans les champs. Et elle est arrivée maintenant à se reconnaître partout et à tout distinguer, comme si elle voyait. Elle remarque même des choses, auxquelles nous ne faisons pas attention; et elle s'intéresse à tout, elle qui ne s'intéressait pas, avant, à grand'chose en dehors d'elle. Cette fois-là, Gottfried s'attarda chez nous plus longtemps que d'habitude. Nous n'osions pas lui demander de remettre son départ; mais il resta, de lui-même, jusqu'à ce qu'il l'eût vue plus tranquille. Et un jour,—elle était là, dans la cour,—je l'ai entendue rire. Je ne peux pas vous dire l'effet que cela m'a fait. Gottfried avait l'air bien content aussi. Il était assis près de moi. Nous nous sommes regardés, et je n'ai pas de honte à vous dire, Monsieur, que je l'ai embrassé, et de bien bon cœur. Alors, il m'a dit:
—Maintenant, je crois que je puis m'en aller. On n'a plus besoin de moi.
J'ai essayé de le retenir. Mais il m'a dit:
—Non. Maintenant, il faut que je m'en aille. Je ne peux plus rester.
Tout le monde savait qu'il était comme le Juif errant: il ne pouvait demeurer en place; on n'a pas insisté. Alors, il est parti; mais il faisait en sorte de repasser plus souvent par ici; et c'était, à chaque fois, une joie pour Modesta: après chacun de ses passages, elle était toujours mieux. Elle s'est remise au ménage; son frère s'est marié; elle s'occupe des enfants; et maintenant, elle ne se plaint plus jamais, elle a toujours l'air contente. Je me demande quelquefois si elle serait aussi heureuse, en ayant ses deux yeux. Oui, ma foi, Monsieur, il y a bien des jours où on se dit qu'il vaudrait mieux être comme elle, et ne pas voir certaines vilaines gens et certaines méchantes choses. Le monde devient bien laid; il empire, de jour en jour... Pourtant, j'aurais grand peur que le bon Dieu me prît au mot; et, pour moi, à vrai dire, j'aime encore mieux continuer à voir le monde, tout vilain qu'il est...
Modesta reparut, et l'entretien changea. Christophe voulait repartir, maintenant que le temps était rétabli; mais ils n'y consentirent pas. Il fallut qu'il acceptât de rester souper et de passer la nuit avec eux. Modesta s'assit auprès de Christophe, et ne le quitta pas de la soirée. Il eût voulu causer intimement avec la jeune fille, dont le sort le remplissait de pitié. Mais elle ne lui en offrit aucune occasion. Elle cherchait seulement à l'interroger sur Gottfried. Quand Christophe lui en apprenait des choses qu'elle ignorait, elle était contente et un peu jalouse. Elle-même ne racontait rien de Gottfried qu'à regret: on sentait qu'elle ne disait pas tout; ou, quand elle avait parlé, elle le regrettait ensuite: ses souvenirs étaient sa propriété, elle n'aimait pas à les partager avec un autre; elle mettait à cette affection une âpreté de paysanne attachée à sa terre: il lui eût été désagréable de penser qu'un autre aimât Gottfried, aussi bien qu'elle. Elle n'en voulait rien croire; et Christophe, qui lisait en elle, lui laissa cette satisfaction. En l'écoutant parler, il s'apercevait que, bien qu'elle eût vu jadis Gottfried avec des yeux sans indulgence, elle s'était fait de lui, depuis qu'elle était aveugle, une image différente de la réalité; et elle avait reporté sur ce fantôme le besoin d'amour qui était en elle. Rien n'était venu contrarier ce travail d'illusion. Avec l'intrépide sûreté des aveugles, qui inventent tranquillement ce qu'ils ne savent pas, elle dit à Christophe:
—Vous lui ressemblez.
Il comprit que, depuis des années, elle avait pris l'habitude de vivre dans sa maison aux volets clos, où n'entrait plus la vérité. Et maintenant qu'elle avait appris à voir dans l'ombre qui l'entourait, et même à oublier l'ombre, peut-être qu'elle aurait eu peur d'un rayon de lumière filtrant dans ses ténèbres. Elle évoquait devant Christophe une foule de petits riens un peu niais, dans une conversation décousue et souriante, où Christophe ne trouvait pas son compte. Il était agacé de ce bavardage, il ne pouvait comprendre qu'un être qui avait tant souffert, n'eût pas puisé plus de sérieux dans sa souffrance et se complût à ces futilités; il faisait de temps en temps un essai pour parler de choses plus graves; mais elles ne trouvaient aucun écho: Modesta ne pouvait pas—ou ne voulait pas—l'y suivre.
On alla se coucher. Christophe fut longtemps avant de pouvoir dormir. Il pensait à Gottfried, dont il s'efforçait de dégager l'image des souvenirs puérils de Modesta. Il n'y parvenait pas sans peine, et il s'en irritait. Il avait le cœur serré, en songeant que l'oncle était mort ici, que dans ce lit, sans doute, son corps avait reposé. Il tâchait de revivre l'angoisse de ses derniers instants, lorsque, ne pouvant parler et se faire comprendre de l'aveugle, il avait fermé les yeux, pour mourir. Qu'il eût voulu lever ces paupières et lire les pensées qui se cachaient dessous, le mystère de cette âme, qui s'en était allée, sans se faire connaître, sans se connaître peut-être! Elle ne le cherchait point; et toute sa sagesse était de ne pas vouloir la sagesse, de ne jamais prétendre imposer sa volonté aux choses, mais de s'abandonner à leur cours, de l'accepter et de l'aimer. Ainsi, il s'assimilait leur essence mystérieuse; et s'il avait fait tant de bien à l'aveugle, à Christophe, à tant d'autres sans doute qu'on ignorerait toujours, c'est qu'au lieu d'apporter les paroles habituelles de révolte humaine contre la nature, il apportait la paix de la nature, la réconciliation. Il était bienfaisant, à la façon des champs et des bois... Christophe évoquait le souvenir des soirs passés avec Gottfried dans la campagne, de ses promenades d'enfant, des récits et des chants dans la nuit. Il se rappelait la dernière course qu'il avait faite avec l'oncle, sur la colline, au-dessus de la ville, par un matin désespéré d'hiver; et les larmes lui remontaient aux yeux. Il ne voulait pas dormir; il ne voulait rien perdre de cette veillée sacrée, dans ce petit pays, plein de l'âme de Gottfried, où ses pas l'avaient conduit. Mais tandis qu'il écoutait le bruit de la fontaine, qui coulait par saccades, et le cri aigu des chauves-souris, la robuste fatigue de la jeunesse l'emporta sur sa volonté; et le sommeil le prit.
Quand il se réveilla, le soleil brillait; tout le monde à la ferme était déjà au travail. Il ne trouva dans la salle du bas que la vieille et les petits. Le jeune ménage était aux champs, et Modesta était allée traire; on la chercha en vain. Christophe ne consentit pas à attendre son retour: il tenait peu à la, revoir, et il se dit pressé. Il se remit en route, après avoir chargé la bonne femme de ses saluts pour les autres.
Il sortait du village, quand, au détour du chemin, sur un talus, au pied d'une haie d'aubépine, il vit l'aveugle assise. Elle se leva au bruit de ses pas, vint à lui, en souriant, lui prit la main, et dit:
—Venez!
Ils montèrent à travers prés, jusqu'à un petit champ fleuri, tout parsemé de croix, qui dominait le village. Elle l'emmena près d'une tombe, et elle lui dit:
—C'est là.
Ils s'agenouillèrent. Christophe se souvenait d'une autre tombe, sur laquelle il s'était agenouillé avec Gottfried; et il pensait:
—Bientôt ce sera mon tour.
Mais cette pensée n'avait, en ce moment, rien de triste. La paix montait de la terre. Christophe, penché sur la fosse, criait tout bas à Gottfried:
—Entre en moi!...
Modesta, les doigts joints, priait, remuant les lèvres en silence. Puis elle fit le tour de la tombe, à genoux, tâtant avec ses mains les herbes et les fleurs; elle semblait les caresser; ses doigts intelligents voyaient: ils arrachaient doucement les tiges de lierre mortes et les violettes fanées. Pour se relever, elle appuya sa main sur la dalle: Christophe vit ses doigts passer furtivement sur le nom de Gottfried, effleurant chaque lettre. Elle dit:
—La terre est douce, ce matin.
Elle lui tendit la main; il donna la sienne. Elle lui fit toucher le sol humide et tiède. Il ne lâcha point sa main; leurs doigts entrelacés s'enfonçaient dans la terre. Il embrassa Modesta. Elle lui baisa les lèvres.
Ils se relevèrent. Elle lui tendit quelques violettes fraîches qu'elle avait cueillies, et garda les fanées dans son sein. Après avoir épousseté leurs genoux, ils sortirent du cimetière sans échanger un mot. Dans les champs gazouillaient les alouettes. Des papillons blancs dansaient autour de leur tête. Ils s'assirent dans un pré. Les fumées du village montaient toutes droites dans le ciel lavé par la pluie. Le canal immobile miroitait entre les peupliers. Une buée de lumière bleue duvetait les prairies et les bois.
Après un silence, Modesta parla à mi-voix de la beauté du jour, comme si elle le voyait. Les lèvres entr'ouvertes, elle buvait l'air; elle épiait le bruit des êtres. Christophe savait aussi le prix de cette musique. Il dit les mots qu'elle pensait, qu'elle n'aurait pu dire. Il nomma certains des cris et des frémissements imperceptibles, qu'on entendait sous l'herbe ou dans les profondeurs de l'air. Elle dit:
—Ah! vous voyez cela aussi?
Il répondit que Gottfried lui avait appris à les distinguer.
—Vous aussi? fit-elle, avec un peu de dépit.
Il avait envie de lui dire:
—Ne soyez pas jalouse!
Mais il vit la divine lumière qui souriait autour d'eux, il regarda ses yeux morts, et il fut pénétré de pitié.
—Ainsi, demanda-t-il, c'est Gottfried qui vous a appris?
Elle dit que oui, qu'elle en jouissait maintenant plus qu'avant...—(Elle ne dit pas: «avant quoi»; elle évitait de prononcer le mot d'«aveugle».)
Ils se turent, un moment. Christophe la regardait avec commisération. Elle se sentait regardée. Il eût voulu lui dire qu'il la plaignait, il eût voulu qu'elle se confiât à lui. Il demanda affectueusement:
—Vous avez souffert?
Elle resta muette et raidie. Elle arrachait des brins d'herbe et les mâchait en silence. Après quelques instants,—(le chant de l'alouette s'enfonçait dans le ciel),—Christophe raconta que, lui aussi, avait souffert, et que Gottfried l'avait aidé. Il dit ses chagrins, ses épreuves, comme s'il pensait tout haut. Le visage de l'aveugle s'éclairait à ce récit, qu'elle suivait attentivement. Christophe, qui l'observait, la vit près de parler: elle fit un mouvement pour se rapprocher et lui tendre la main. Il s'avança aussi;—mais déjà, elle était rentrée dans son impassibilité; et, quand il eut fini, elle ne répondit à son récit que quelques mots banals. Derrière son front bombé, sans un pli, on sentait une obstination de paysan, dure comme un caillou. Elle dit qu'il lui fallait revenir à la maison, pour s'occuper des enfants de son frère: elle en parlait avec une tranquillité riante.
Il lui demanda:
—Vous êtes heureuse?
Elle sembla l'être davantage de le lui entendre dire. Elle dit que oui, elle insista sur les raisons qu'elle avait de l'être; elle essayait de le lui persuader; elle parlait des enfants, de la maison...
—Oui, dit-elle, je suis très heureuse!
Elle se leva pour partir; il se leva aussi. Ils se dirent adieu, d'un ton indifférent et gai. La main de Modesta tremblait un peu dans la main de Christophe. Elle dit:
—Vous aurez beau temps aujourd'hui, pour la marche.
Et elle lui fit des recommandations pour un tournant de chemin, où il ne fallait pas se tromper.
Ils se quittèrent. Il descendit la colline. Quand il fut au bas, il se retourna. Elle était sur le sommet, debout, à la même place: elle agitait son mouchoir, et lui faisait des signaux, comme si elle le voyait.
Il y avait dans cette obstination à nier son mal quelque chose d'héroïque et de ridicule, qui touchait Christophe, et qui lui était pénible. Il sentait combien Modesta était digne de pitié et même d'admiration; et il n'aurait pu vivre deux jours avec elle.—Tout en continuant sa route, entre les haies fleuries, il songeait aussi au cher vieux Schulz, à ces yeux de vieillard, clairs et tendres, devant lesquels avaient passé tant de chagrins, et qui ne voulaient pas les voir, qui ne voyaient pas la réalité blessante.
—Comment me voit-il moi-même? se demandait-il. Je suis si différent de l'idée qu'il a de moi! Je suis pour lui, comme il veut que je sois. Tout est à son image, pur et noble comme lui. Il ne pourrait supporter la vie, s'il l'apercevait telle qu'elle est.
Et il songeait à cette fille, enveloppée de ténèbres, qui niait ses ténèbres et voulait se persuader que ce qui était n'était pas, et que ce qui n'était pas était.
Alors, il vit la grandeur de l'idéalisme allemand, qu'il avait tant de fois haï, parce qu'il est chez les âmes médiocres une source d'hypocrite niaiserie. Il vit la beauté de cette foi qui se crée un monde au milieu du monde, et différent du monde, comme un îlot dans l'océan.—Mais il ne pouvait supporter cette foi pour lui-même, il refusait de se réfugier dans cette Ile des Morts... La vie! La vérité! Il ne voulait pas être un héros qui ment. Peut-être ce mensonge optimiste était-il nécessaire aux êtres faibles, pour vivre; et Christophe eût regardé comme un crime d'arracher à ces malheureux l'illusion qui les soutenait. Mais pour lui-même, il n'eût pu recourir à de tels subterfuges: il aimait mieux mourir que vivre d'illusions... L'art n'était-il donc pas une illusion aussi?—Non, il ne devait pas l'être. La vérité! La vérité! Les yeux grands ouverts, aspirer par tous les pores le souffle tout-puissant de la vie, voir les choses comme elles sont, voir l'infortune en face,—et rire!
Plusieurs mois passèrent. Christophe avait perdu l'espoir de sortir de sa ville. Le seul qui eût pu le sauver, Hassler, lui avait refusé son aide. Et l'amitié du vieux Schulz ne lui avait été donnée que pour lui être aussitôt retirée.
Il lui avait écrit, une fois, à son retour; et il en avait reçu deux lettres affectueuses; mais par un sentiment de lassitude, et surtout à cause de la difficulté qu'il avait à s'exprimer par lettre, il tarda à le remercier de ses chères paroles; il remettait de jour en jour sa réponse. Et comme il allait enfin se décider à écrire, il reçut un mot de Kunz, lui annonçant la mort de son vieux compagnon. Schulz avait eu, disait-il, une rechute de bronchite, qui dégénéra en pneumonie; il avait défendu qu'on inquiétât Christophe, dont il parlait sans cesse. En dépit de sa faiblesse extrême et de tant d'années de maladie, une longue et pénible fin ne lui avait pas été épargnée. Il avait chargé Kunz d'apprendre la nouvelle à Christophe, en lui disant que jusqu'à la dernière heure il avait pensé à lui, qu'il le remerciait de tout le bonheur qu'il lui devait, et que sa bénédiction le suivrait, tant que Christophe vivrait.—Ce que Kunz ne disait pas, c'était que la journée passée avec Christophe avait été probablement l'origine de la rechute et la cause de la mort.
Christophe pleura en silence, et il sentit alors tout le prix de l'ami qu'il avait perdu, et combien il l'aimait; il souffrit, comme toujours, de ne le lui avoir pas mieux dit. Maintenant, il était trop tard. Et que lui restait-il? Le bon Schulz n'avait fait que paraître, juste assez pour que le vide semblât plus vide, après qu'il n'était plus.—Quant à Kunz et à Pottpetschmidt, ils n'avaient d'autre prix que l'amitié qu'ils avaient eue pour Schulz, et que Schulz avait eue pour eux. Christophe leur écrivit une fois; et leurs relations en restèrent là.—Il essaya aussi d'écrire à Modesta; mais elle lui fit répondre une lettre banale, où elle ne parlait que de choses indifférentes. Il renonça à poursuivre l'entretien. Il n'écrivit plus à personne, et personne ne lui écrivit.
Silence. Silence. De jour en jour, le lourd manteau du silence s'abattait sur Christophe. C'était comme une pluie de cendres qui tombait sur lui. Le soir semblait venir déjà; et Christophe commençait à peine à vivre: il ne voulait pas se résigner déjà! L'heure de dormir n'était pas venue. Il fallait vivre...
Et il ne pouvait plus vivre en Allemagne. La souffrance de son génie comprimé par l'étroitesse de la petite ville l'exaspérait jusqu'à l'injustice. Ses nerfs étaient à nu: tout le blessait, au sang. Il était comme une de ces misérables bêtes sauvages, qui agonisaient d'ennui dans les trous et les cages où on les avait enfermées, au Stadtgarten (jardin de la ville). Christophe allait les voir, par sympathie; il contemplait leurs admirables yeux, où brûlaient—s'éteignaient de jour en jour—des flammes farouches et désespérées. Ah! comme eût mieux valu le coup de fusil brutal, qui délivre! Tout, plutôt que l'indifférence féroce de ces hommes qui les empêchaient de vivre et de mourir!
Le plus oppressant, pour Christophe, n'était pas l'hostilité des gens: c'était leur nature inconsistante, sans forme et sans fond. Que n'avait-il affaire à l'opposition têtue d'une de ces races au crâne étroit et dur, qui se refusent à comprendre toute pensée nouvelle! Contre la force, on a la force, le pic et la mine qui taillent et font sauter la roche. Mais que peut on contre une masse amorphe; qui cède comme une gelée, s'enfonce sous la moindre pression, et ne garde aucune empreinte? Toutes les pensées, toutes les énergies, tout disparaissait dans la fondrière: à peine si, quand une pierre tombait, quelques rides tressaillaient à la surface du gouffre; la mâchoire s'ouvrait, se refermait: et de ce qui avait été, il ne restait plus aucune trace.
Ils n'étaient pas des ennemis. Plût à Dieu qu'ils fussent des ennemis! Ils étaient des gens qui n'avaient la force ni d'aimer, ni de haïr, ni de croire, ni de ne pas croire,—en religion, en art, en politique, dans la vie journalière:—toute leur vigueur se dépensait à tâcher de concilier l'inconciliable. Surtout depuis les victoires allemandes, ils s'évertuaient à faire un compromis, un mic-mac écœurant de la force nouvelle et des principes anciens. Le vieil idéalisme n'avait pas été renoncé: c'eût été là un effort de franchise, dont on n'était pas capable; on s'était contenté de le fausser, pour le faire servir à l'intérêt allemand. À l'exemple de Hegel, serein et double, qui avait attendu jusqu'après Leipzig et Waterloo pour assimiler la cause de sa philosophie avec l'État prussien,—l'intérêt ayant changé, les principes avaient changé. Quand on était battu, on disait que l'Allemagne avait l'humanité pour idéal. Maintenant qu'on battait les autres, on disait que l'Allemagne était l'idéal de l'humanité. Quand les autres patries étaient les plus puissantes, on disait, avec Lessing, que «l'amour de la patrie était une faiblesse héroïque, dont on se passait fort bien», et l'on s'appelait: un «citoyen du monde». À présent qu'on l'emportait, on n'avait pas assez de mépris pour les utopies «à la française»: paix universelle, fraternité, progrès pacifique, droits de l'homme, égalité naturelle; on disait que le peuple le plus fort avait contre les autres un droit absolu, et que les autres, étant plus faibles, étaient sans droit contre lui. Il était Dieu vivant et l'Idée incarnée, dont le progrès s'accomplit par la guerre, la violence, l'oppression. La Force était devenue sainte, maintenant qu'on l'avait avec soi. La Force était devenue tout idéalisme et toute intelligence.
À vrai dire, l'Allemagne avait tant souffert, pendant des siècles, d'avoir l'idéalisme et de n'avoir pas la force, qu'elle était excusable, après tant d'épreuves, de faire le triste aveu qu'avant tout, il fallait la Force. Mais quelle amertume cachée dans cette confession du peuple de Herder et de Gœthe! Cette victoire allemande était une abdication, une dégradation de l'idéal allemand... Hélas! Il n'y avait que trop de facilités à cette abdication dans la déplorable tendance des meilleurs Allemands à se soumettre.
—«Ce qui caractérise l'Allemand, disait Moser, il y a déjà plus d'un siècle, c'est l'obéissance.»
Et madame de Staël:
—«Ils sont vigoureusement soumis. Ils se servent de raisonnements philosophiques pour expliquer ce qu'il y a de moins philosophique au monde: le respect pour la force, et l'attendrissement de la peur, qui change ce respect, en admiration.»
Christophe retrouvait ce sentiment, du plus grand au plus petit en Allemagne,—depuis le Guillaume Tell de Schiller, ce petit bourgeois compassé, aux muscles de portefaix, qui, comme dit le libre Juif Bœrne, «pour concilier l'honneur et la peur, passe devant le poteau du «cher Monsieur» Gessler, les yeux baissés, afin de pouvoir alléguer qu'il n'a pas vu le chapeau, pas désobéi»,—jusqu'au vieux et respectable professeur Weisse, âgé de soixante-dix ans, un des savants les plus honorés de la ville, qui, lorsqu'il voyait venir un Herr Lieutenant, se hâtait de lui céder le haut du trottoir et de descendre sur la chaussée. Le sang de Christophe bouillait, quand il était témoin d'un de ces menus actes de servilité journalière. Il en souffrait, comme si c'était lui-même qui s'était abaissé. Les manières hautaines des officiers, qu'il croisait dans la rue, leur raideur insolente, lui causaient une sourde colère: il affectait de ne point se déranger pour leur faire place: il leur rendait, en passant, l'arrogance de leurs regards. Peu s'en fallut, plus d'une fois, qu'il ne s'attirât une affaire; on eût dit qu'il la cherchait. Cependant, il était le premier à comprendre l'inutilité dangereuse de pareilles bravades; mais il avait des moments d'aberration: la contrainte perpétuelle qu'il s'imposait et ses robustes forces accumulées, qui ne se dépensaient point, le rendaient enragé. Alors, il était prêt à commettre toutes les sottises; il avait le sentiment que, s'il restait encore un an ici, il était perdu. Il avait la haine du militarisme brutal, qu'il sentait peser sur lui, de ces sabres sonnant sur le pavé, de ces faisceaux d'armes et de ces canons postés devant les casernes, la gueule braquée contre la ville, prêts à tirer. Des romans à scandale, qui faisaient grand bruit alors, dénonçaient la corruption des garnisons; les officiers y étaient représentés comme des êtres malfaisants, qui, en dehors de leur métier d'automates, ne savaient qu'être oisifs, boire, jouer, s'endetter, se faire entretenir, médire les uns des autres, et, du haut en bas de la hiérarchie, abuser de leur autorité contre leurs inférieurs. L'idée qu'il serait un jour forcé de leur obéir serrait Christophe à la gorge. Il ne le pourrait pas, non, il ne pourrait jamais le supporter, se déshonorer à ses yeux, en subissant leurs humiliations et leurs injustices... Il ne savait pas quelle grandeur morale il y avait chez certains d'entre eux, et tout ce qu'ils souffraient eux-mêmes: leurs illusions perdues, tant de force, de jeunesse, d'honneur, de foi, de désir passionné du sacrifice, mal employés, gâchés,—le non-sens d'une carrière, qui, si elle est simplement une carrière, si elle n'a point le sacrifice pour but, n'est plus qu'une agitation morne, une inepte parade, un rituel qu'on récite, sans croire à ce qu'on dit...
La patrie ne suffisait plus à Christophe. Il sentait en lui cette force inconnue, qui s'éveille, soudaine et irrésistible, chez les oiseaux, à des époques précises, comme le flux et le reflux de la mer:—l'instinct des grandes migrations. En lisant les volumes de Herder et de Fichte, que le vieux Schulz lui avait légués, il y retrouvait des âmes comme la sienne,—non «des fils de la terre», servilement attachés à la glèbe, mais «des esprits, fils du soleil», qui se tournent invinciblement vers la lumière.
Où irait-il? Il ne savait. Mais ses yeux regardaient vers le Midi latin. Et d'abord, vers la France. La France, éternel recours de l'Allemagne en désarroi. Que de fois la pensée allemande s'était servie d'elle, sans cesser d'en médire! Même depuis 70, quelle attraction se dégageait de la Ville, qu'on avait tenue fumante et broyée sous les canons allemands! Les formes de la pensée et de l'art les plus révolutionnaires et les plus rétrogrades y avaient trouvé tour à tour, et parfois en même temps, des exemples ou des inspirations. Christophe, comme tant d'autres grands musiciens allemands dans la détresse, se tournait vers Paris... Que connaissait-il des Français?—Deux visages féminins, et quelques lectures au hasard. Cela lui suffisait pour imaginer un pays de lumière, de gaieté, de bravoure, voire d'un peu de jactance gauloise, qui ne messied pas à la jeunesse audacieuse du cœur. Il y croyait, parce qu'il avait besoin d'y croire, parce que, de toute son âme, il voulait que ce fût ainsi.
Il résolut de partir.—Mais il ne pouvait partir, à cause de sa mère.
Louisa vieillissait. Elle adorait son fils, qui était toute sa joie; et elle était tout ce qu'il aimait le plus sur terre. Cependant, ils se faisaient souffrir mutuellement. Elle ne comprenait guère Christophe, et ne s'inquiétait pas de le comprendre: elle ne s'inquiétait que de l'aimer. Elle avait un esprit borné, timide, obscur, et un cœur admirable, un immense besoin d'aimer et d'être aimée, qui avait quelque chose de touchant et d'oppressant. Elle respectait son fils, parce qu'il lui paraissait très savant; mais elle faisait tout ce qu'il fallait pour étouffer son génie. Elle pensait qu'il resterait, toute sa vie, auprès d'elle, dans leur petite ville. Depuis des années, ils vivaient ensemble; et elle ne pouvait plus imaginer qu'il n'en serait pas toujours de même. Elle était heureuse, ainsi: comment ne l'eût-il pas été? Ses rêves n'allaient pas plus loin qu'à lui voir épouser la fille d'un bourgeois aisé de la ville, à l'entendre jouer à l'orgue de son église, le dimanche, et à ne jamais le quitter. Elle voyait son garçon, comme s'il avait toujours douze ans; elle eût voulu qu'il n'eût jamais davantage. Elle torturait innocemment le malheureux homme, qui suffoquait dans cet étroit horizon.
Et pourtant, il y avait beaucoup de vrai,—une grandeur morale—dans cette philosophie inconsciente de la mère, qui ne pouvait comprendre l'ambition et mettait tout le bonheur de la vie dans les affections de famille et l'humble devoir accompli. C'était une âme qui voulait aimer, qui ne voulait qu'aimer. Renoncer plutôt à la vie, à la raison, à la logique, au monde, a tout, plutôt qu'à l'amour! Et cet amour était infini, suppliant, exigeant; il donnait tout, et il voulait tout; il renonçait à vivre pour aimer, et il voulait ce renoncement des autres, des aimés. Puissance de l'amour d'une âme simple! Elle lui fait trouver, du premier coup, ce que les raisonnements tâtonnants d'un génie incertain, comme Tolstoy, ou l'art trop raffiné d'une civilisation qui se meurt, concluent après une vie—des siècles—de luttes forcenées et d'efforts épuisants!... Mais le monde impérieux, qui grondait dans Christophe, avait de bien autres lois et réclamait une autre sagesse.
Depuis longtemps, il voulait annoncer sa résolution à sa mère. Mais il tremblait à l'idée du chagrin qu'il lui ferait: au moment de parler, il était lâche, il remettait à plus tard. Deux ou trois fois, il fit de timides allusions à son départ; Louisa ne les prit pas au sérieux:—peut-être feignit-elle de ne pas les prendre au sérieux, pour lui persuader qu'il parlait ainsi par jeu. Alors, il n'osait poursuivre; mais il restait sombre, préoccupé; et l'on se doutait qu'il avait sur le cœur un secret qui lui pesait. Et la pauvre femme, qui avait l'intuition de ce que pouvait être ce secret, s'efforçait peureusement d'en retarder l'aveu. À des instants de silence, le soir, quand ils étaient l'un près de l'autre, assis, à la lumière de la lampe, brusquement elle sentait qu'il allait parler; alors, prise de terreur, elle se mettait à parler, très vite, et au hasard, n'importe de quoi: à peine si elle savait ce qu'elle disait; mais à tout prix, il fallait l'empêcher de parler. D'ordinaire, son instinct lui faisait trouver le meilleur argument qui l'obligeât au silence: elle se plaignait doucement de sa santé, de ses mains et de ses pieds gonflés, de ses jambes qui s'ankylosaient: elle exagérait son mal, elle se disait une vieille impotente, qui n'est plus bonne à rien. Il n'était pas dupe de ses ruses naïves; il la regardait tristement, avec un muet reproche; et, après un moment, il se levait, prétextant qu'il était fatigué, qu'il allait se coucher.
Mais tous ces expédients ne pouvaient sauver Louisa longtemps. Un soir qu'elle y avait de nouveau recours, Christophe ramassa son courage, et, posant sa main sur celle de la vieille femme, il lui dit:
—Non, mère, j'ai quelque chose à te dire.
Louisa fut saisie; mais elle tâcha de prendre un air riant, pour répondre,—la gorge contractée:
—Et quoi donc, mon petit?
Christophe annonça, en balbutiant, son intention de partir. Elle tenta bien de prendre la chose en plaisanterie et de détourner la conversation, comme à l'ordinaire; mais il ne se déridait pas, et continuait, cette fois, d'un air si volontaire et si sérieux qu'il n'y avait plus moyen de douter. Alors, elle se tut, tout son sang s'arrêta, et elle restait muette et glacée, à le regarder avec des yeux épouvantés. Une telle douleur montait dans ces yeux que la parole lui manqua, à lui aussi; et ils demeurèrent tous deux sans voix. Quand elle put enfin retrouver le souffle, elle dit,—(ses lèvres tremblaient):
—Ce n'est pas possible... Ce n'est pas possible...
Deux grosses larmes coulaient le long de ses joues. Il détourna la tête avec découragement, et se cacha la figure dans ses mains. Ils pleurèrent. Après quelque temps, il s'en alla dans sa chambre et s'y enferma jusqu'au lendemain. Ils ne firent plus allusion à ce qui s'était passé; et comme il n'en parlait plus, elle voulut se convaincre qu'il avait renoncé. Mais elle vivait dans des transes.
Vint un moment où il ne put plus se taire. Il fallait parler, dût-il lui déchirer le cœur: il souffrait trop. L'égoïsme de sa peine l'emportait sur la pensée de celle qu'il ferait. Il parla. Il alla jusqu'au bout, évitant de regarder sa mère, de peur de se laisser troubler. Il fixa même le jour de son départ, pour n'avoir plus à soutenir une seconde discussion:—(il ne savait pas s'il retrouverait, une seconde fois, le triste courage qu'il avait aujourd'hui).—Louisa criait:
—Non, non, tais-toi!...
Il se raidissait, et continuait avec une résolution implacable. Quand il eut fini,—(elle sanglotait),—il lui prit les mains et tâcha de lui faire comprendre comment il était absolument nécessaire à son art, à sa vie, qu'il partît pour quelque temps. Elle se refusait à écouler, elle pleurait, et répétait:
—Non, non!... Je ne veux pas...
Après avoir vainement tenté de raisonner avec elle, il la laissa, pensant que la nuit changerait le cours de ses idées. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent, le lendemain, à table, il recommença sans pitié à reparler de son projet. Elle laissa retomber la bouchée de pain qu'elle portait à ses lèvres, et dit, d'un ton de reproche douloureux:
—Tu veux donc me torturer?
Il fut ému, mais il dit:
—Chère maman, il le faut.
—Mais non, mais non! répétait-elle, il ne le faut pas... C'est pour me faire de la peine... C'est une folie...
Ils voulurent se convaincre l'un l'autre; mais ils ne s'écoutaient pas. Il comprit qu'il était inutile de discuter: cela ne servait qu'à se faire souffrir davantage; et il commença, ostensiblement, ses préparatifs de départ.
Quand elle vit qu'aucune de ses prières ne l'arrêtait, Louisa tomba dans une tristesse morne. Elle passait ses journées, enfermée dans sa chambre, sans lumière, quand le soir venait; elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus; la nuit, il l'entendait pleurer. Il en était crucifié. Il eût crié de douleur dans son lit, où il se retournait, toute la nuit, sans dormir, en proie à ses remords. Il l'aimait tant! Pourquoi fallait-il qu'il la fît souffrir?... Hélas! Elle ne serait pas la seule; il le voyait clairement... Pourquoi le destin avait-il mis en lui le désir et la force d'une mission, qui devait faire souffrir ceux qu'il aimait?
—Ah! pensait-il, si j'étais libre, si je n'étais pas contraint par cette force cruelle d'être ce que je dois être, ou sinon, de mourir dans la honte et le dégoût de moi-même, comme je vous rendrais heureux, vous que j'aime! Laissez-moi vivre d'abord, agir, lutter, souffrir; et puis, je vous reviendrai, plus aimant. Que je voudrais ne faire qu'aimer, aimer, aimer!...
Jamais il n'eût résisté au reproche perpétuel de cette âme désolée, si ce reproche avait eu la force de rester muet. Mais Louisa, faible et un peu bavarde, ne put garder pour elle la peine qui l'étouffait. Elle la dit à ses voisines. Elle la dit à ses deux autres fils. Ils ne pouvaient perdre une si belle occasion de mettre Christophe dans son tort. Surtout Rodolphe, qui n'avait pas cessé de jalouser son frère aîné, quoiqu'il n'en eût guère de raisons pour le moment,—Rodolphe, que le moindre éloge de Christophe blessait au vif, et qui redoutait en secret, sans oser s'avouer cette basse pensée, ses succès à venir,—(car il était assez intelligent pour sentir la force de son frère, et pour craindre que d'autres ne la sentissent, comme lui),—Rodolphe fut trop heureux d'écraser Christophe sous le poids de sa supériorité. Il ne s'était jamais préoccupé de sa mère, dont il savait la gêne; bien qu'il fût largement en situation de lui venir en aide, il en laissait tout le soin à Christophe. Mais, quand il apprit le projet de Christophe, il se découvrit sur-le-champ des trésors d'affection. Il s'indigna contre cette prétention d'abandonner sa mère, et il la qualifia de monstrueux égoïsme. Il eut le front d'aller le répéter à Christophe. Il lui fit la leçon, de très haut, comme à un enfant qui mérite le fouet; il lui rappela, d'un air rogue, ses devoirs envers sa mère, et tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Christophe faillit en crever de rage. Il flanqua Rodolphe à la porte, à coups de pied au cul, en le traitant de polisson et de chien d'hypocrite. Rodolphe se vengea, en montant la tête à sa mère. Louisa, excitée par lui, commença à se persuader que Christophe agissait en mauvais fils. Elle entendait répéter qu'il n'avait pas le droit de partir, et elle ne demandait qu'à le croire. Au lieu de s'en tenir à ses pleurs, qui étaient son arme la plus forte, elle fit à Christophe des reproches injustes, qui le révoltèrent. Ils se dirent l'un à l'autre des choses pénibles; et le résultat fut que Christophe, qui jusque-là hésitait encore, ne pensa plus qu'à presser ses préparatifs de départ. Il sut que les charitables voisins s'apitoyaient sur sa mère, et que l'opinion du quartier la représentait comme une victime, et lui comme un bourreau. Il serra les dents, et ne démordit plus de sa résolution.
Les jours passaient. Christophe et Louisa se parlaient à peine. Au lieu de jouir, jusqu'à la moindre goutte, des derniers jours passés ensemble, ces deux êtres qui s'aimaient perdaient le temps qui leur restait,—comme c'est trop souvent le cas,—en une de ces stériles bouderies, où s'engloutissent tant d'affections. Ils ne se voyaient qu'à table, où ils étaient assis l'un en face de l'autre, ne se regardant pas, ne se parlant pas, se forçant à manger quelques bouchées, moins pour manger que pour se donner une contenance. À grand'peine, Christophe parvenait à extraire quelques mots de sa gorge: mais Louisa ne répondait pas; et quand, à son tour, elle voulait parler, c'était lui qui se taisait. Cet état de choses était intolérable pour tous deux; et plus il se prolongeait, plus il devenait difficile d'en sortir. Allaient-ils donc se séparer ainsi? Louisa se rendait compte maintenant qu'elle avait été injuste et maladroite; mais elle souffrait trop pour savoir comment regagner le cœur de son fils, qu'elle pensait avoir perdu, et empêcher ce départ, dont elle se refusait à envisager l'idée. Christophe regardait à la dérobée le visage blême et gonflé de sa mère, et il était bourrelé de remords; mais décidé à partir, et, sachant qu'il y allait de sa vie, il souhaitait lâchement d'être déjà parti, pour s'enfuir de ses remords.
Son départ était fixé au surlendemain. Un de leurs tristes tête-à-tête venait de finir. Au sortir du souper, où ils ne s'étaient pas dit un mot, Christophe s'était retiré dans sa chambre; et, assis devant sa table, la tête dans ses mains, incapable d'aucun travail, il se rongeait l'esprit. La nuit s'avançait; il était près d'une heure du matin. Tout à coup, il entendit du bruit, une chaise renversée, dans la chambre voisine. La porte s'ouvrit, et sa mère, en chemise, pieds nus, se jeta à son cou, en sanglotant. Elle brûlait de fièvre, elle embrassait son fils, et elle gémissait, au milieu de ses hoquets de désespoir:
—Ne pars pas! ne pars pas! Je t'en supplie! Je t'en supplie! Mon petit, ne pars pas!... J'en mourrai... Je ne peux pas, je ne peux pas le supporter!...
Bouleversé et effrayé, il l'embrassait, répétant:
—Chère maman, calme-toi, calme-toi, je t'en prie!
Mais elle continuait:
—Je ne peux pas le supporter... Je n'ai plus que toi. Si tu pars, qu'est-ce que je deviendrai? Je mourrai si tu pars. Je ne veux pas mourir loin de toi. Je ne veux pas mourir seule. Attends que je sois morte!...
Ses paroles lui déchiraient le cœur. Il ne savait que dire pour la consoler. Quelles raisons pouvaient tenir contre ce déchaînement d'amour et de douleur! Il la prit sur ses genoux, et tâcha de la calmer, avec des baisers et des mots affectueux. La vieille femme se taisait peu à peu, et pleurait doucement. Quand elle fut un peu apaisée, il lui dit:
—Recouche-toi: tu vas prendre froid.
Elle répéta:
—Ne pars pas!
Il dit, tout bas:
—Je ne partirai pas.
Elle tressaillit, et lui saisit la main:
—C'est vrai? dit-elle. C'est vrai?
Il détourna la tête, avec découragement:
—Demain, dit-il, demain, je te dirai... Laisse-moi, je t'en supplie!...
Elle se leva docilement, et regagna sa chambre.
Le lendemain matin, elle avait honte de cette crise de désespoir qui s'était emparée d'elle, comme une folie, au milieu de la nuit; et elle tremblait de ce que son fils allait lui dire. Elle l'attendait, assise, dans un coin de sa chambre; elle avait pris un tricot pour s'occuper; mais ses mains se refusaient à le tenir: elle le laissa tomber. Christophe entra. Ils se dirent bonjour à mi-voix, sans se regarder en face. Il était sombre, il alla se poster devant la fenêtre, le dos tourné à sa mère, et il resta sans parler. Un combat se livrait en lui; il en savait trop le résultat d'avance, et il cherchait à le retarder. Louisa n'osait lui adresser la parole et provoquer la réponse qu'elle attendait et redoutait. Elle se força à reprendre le tricot; mais elle ne voyait pas ce qu'elle faisait, et ses mailles allaient de travers. Dehors, il pleuvait. Après un long silence, Christophe vint près d'elle. Elle ne fit pas un mouvement; mais son cœur battait. Christophe la regardait, immobile; puis, brusquement, il se jeta à genoux, cacha sa figure dans la robe de sa mère; et, sans dire un mot, il pleura. Alors, elle comprit qu'il restait; et son cœur s'allégea d'une angoisse mortelle;—mais aussitôt, le remords y entra: car elle sentit tout ce que son fils lui sacrifiait; et elle commença de souffrir tout ce que Christophe avait souffert, quand c'était elle qu'il sacrifiait. Elle se pencha sur lui et couvrit de baisers son front et ses cheveux. Ils mêlèrent en silence leurs larmes et leur peine. Enfin, il releva la tête; et Louisa, lui prenant la figure dans ses mains, le regardait, les yeux dans les yeux. Elle eût voulu lui dire:
—Pars!
Et elle ne le pouvait pas.
Il eût voulu lui dire:
—Je suis heureux de rester.
Et il ne le pouvait pas.
La situation était inextricable; ni l'un ni l'autre n'y pouvait rien changer. Elle soupira, dans son douloureux amour:
—Ah! si l'on pouvait être nés tous ensemble, pour mourir tous ensemble!
Ce vœu naïf le pénétra de tendresse; il essuya ses larmes, et, s'efforçant de sourire, il dit:
—On mourra tous ensemble.
Elle insistait:
—Bien sûr? Tu ne pars pas?
Il se releva:
—C'est dit. N'en parlons plus. Il n'y a plus à y revenir.
Christophe tint parole: il ne parla plus de départ; mais il ne dépendait pas de lui qu'il n'y pensât plus. Il resta; mais il fit chèrement payer son sacrifice à sa mère, par sa tristesse et sa mauvaise humeur. Et Louisa, maladroite,—d'autant plus maladroite qu'elle savait qu'elle l'était et faisait immanquablement ce qu'il ne fallait pas faire,—Louisa, qui ne connaissait que trop la cause de son chagrin, insistait pour qu'il la dît. Elle le harcelait de sa chère affection, inquiète, vexante, raisonneuse, qui lui rappelait, à tout instant, qu'ils étaient différents l'un de l'autre,—ce qu'il tâchait d'oublier. Combien de fois avait-il voulu s'ouvrir à elle avec confiance! Mais, au moment de parler, la muraille de Chine se relevait entre eux; et il renfonçait ses secrets. Elle le devinait; mais elle n'osait pas provoquer ses confidences, ou elle ne savait pas le faire. Quand elle essayait, elle ne réussissait qu'à refouler encore plus profondément ces secrets qui lui pesaient tant et qu'il brûlait de dire.
Mille petites choses, d'innocentes manies, la séparaient aussi de Christophe, qu'elles irritaient. La bonne vieille radotait un peu. Elle avait un besoin de répéter les commérages du voisinage, ou cette tendresse de nourrice, qui s'obstine à rappeler les niaiseries des premières années, tout ce qui vous rattache au berceau. On a eu tant de peine à en sortir, à devenir un homme! Et il faut que la nourrice de Juliette vienne vous étaler les langes salis, les médiocres pensées, toute cette époque néfaste, où une âme naissante se débat contre l'oppression de la vile matière et du milieu étouffant!
Au milieu de tout cela, elle avait des élans de tendresse touchante,—comme avec un petit enfant,—qui lui prenaient le cœur; et il s'y abandonnait,—comme un petit enfant.
Le pire était de vivre, du matin au soir, comme ils faisaient, ensemble, toujours ensemble, isolés du reste des gens. Lorsqu'on souffre, étant deux, et qu'on ne peut remédier à la souffrance l'un de l'autre, il est fatal qu'on l'exaspère: chacun finit par rendre l'autre responsable de ce qu'il souffre; et chacun finit par le croire. Mieux vaudrait être seul: on est seul à souffrir.
C'était pour tous deux une torture de chaque jour. Ils n'en seraient jamais sortis, si le hasard n'était venu, comme il arrive souvent, trancher, d'une façon malheureuse en apparence,—intelligente au fond,—l'indécision cruelle, où ils se débattaient.
Un dimanche d'octobre. Quatre heures de l'après-midi. Le temps était radieux. Christophe était resté, tout le jour, dans sa chambre, replié sur lui-même, «suçant sa mélancolie».
Il n'y tint plus, il eut un besoin furieux de sortir, de marcher, de dépenser sa force, de s'exténuer de fatigue, afin de ne plus penser.
Il était en froid avec sa mère, depuis la veille. Il fut sur le point de s'en aller, sans lui dire au revoir. Mais, déjà sur le palier, il pensa au chagrin qu'elle en aurait, pour toute la soirée, où elle resterait seule. Il rentra, se donnant le prétexte qu'il avait oublié quelque chose. La porte de la chambre de sa mère était entrebâillée. Il passa la tête par l'ouverture. Il vit sa mère, quelques secondes... Quelle place ces secondes devaient tenir dans le reste de sa vie!...
Louisa venait de rentrer des vêpres. Elle était assise à sa place favorite, dans l'angle de la fenêtre. Le mur de la maison d'en face, d'un blanc sale et crevassé, masquait la vue; mais, de l'encoignure où elle était, on pouvait voir à droite, par delà les deux cours des maisons voisines, un petit coin de pelouse grand comme un mouchoir de poche. Sur le rebord de la fenêtre, un pot de volubilis grimpait le long de ficelles et tendait sur l'échelle aérienne son fin réseau, qu'un rayon de soleil caressait. Louisa, assise sur une chaise basse, le dos rond, sa grosse Bible ouverte sur ses genoux, ne lisait pas. Ses deux mains posées à plat sur le livre,—ses mains aux veines gonflées, aux ongles de travailleuse, carrés et un peu recourbés,—elle couvait des yeux avec amour la petite plante et le lambeau de ciel qu'on voyait au travers. Un reflet du soleil sur les feuilles vert-dorées éclairait son visage fatigué, marbré d'un peu de couperose, ses cheveux blancs très fins et peu épais, et sa bouche entr'ouverte, qui souriait. Elle jouissait de cette heure de repos. C'était son meilleur moment de la semaine. Elle en profitait pour se plonger dans cet état très doux à ceux qui peinent, où l'on ne pense à rien: dans la torpeur de l'être, rien ne parle plus que le cœur, à demi endormi.
—Maman, dit-il, j'ai envie de sortir. Je vais faire un tour du côté de Buir; je rentrerai un peu tard.
Louisa, qui somnolait, tressaillit légèrement. Puis, elle tourna la tête vers lui, et le regarda de ses bons yeux paisibles.
—Va, mon petit, lui dit-elle: tu as raison, profite du beau temps.
Elle lui sourit. Il lui sourit. Ils restèrent un instant à se regarder; puis, ils se firent un petit bonsoir affectueux, de la tête et des yeux.
Il referma doucement la porte. Elle revint lentement à sa rêverie, où le sourire de son fils jetait un reflet lumineux, comme le rayon du soleil sur les feuilles pâles du volubilis.
Ainsi, il la laissa—pour toute sa vie.
Soir d'octobre. Un soleil tiède et pâle. La campagne languissante s'assoupit. De petites cloches de villages tintent sans se presser dans le silence des champs. Au milieu des labours, des colonnes de fumées montent lentement. Une fine brume flotte au loin. Les brouillards blancs, tapis dans la terre humide, attendent pour se lever l'approche de la nuit... Un chien de chasse, le nez rivé au sol, décrivait des circuits dans un champ de betteraves. Des troupes de corneilles tournaient dans le ciel gris.
Christophe, tout en rêvant et sans s'être fixé de but, allait, d'instinct, vers un but. Depuis quelques semaines, ses promenades autour de la ville gravitaient vers un village, où il était sûr de rencontrer une belle fille qui l'attirait. Ce n'était qu'un attrait, mais fort vif et un peu trouble. Christophe ne pouvait guère se passer d'aimer quelqu'un; son cœur restait rarement vide: toujours il était meublé de quelque image qui en était l'idole. Peu lui importait, le plus souvent, que cette idole sût qu'il l'aimait: mais il avait besoin d'aimer; il fallait qu'il ne fît jamais nuit dans son cœur.
L'objet de la flamme nouvelle était la fille d'un paysan, qu'il avait rencontrée, comme Éliézer rencontra Rébecca, auprès d'une fontaine; mais elle ne lui avait pas offert à boire: elle lui avait jeté de l'eau à la figure. Agenouillée au bord d'un ruisseau, dans un creux de la berge, entre deux saules dont les racines formaient autour d'elle comme un nid, elle lavait du linge avec vigueur; et sa langue n'était pas moins active que ses bras: elle causait et riait très fort avec d'autres filles du village, qui lavaient, de l'autre côté du ruisseau. Christophe s'était couché sur l'herbe, à quelques pas; et, le menton appuyé sur ses mains, il les regardait. Cela ne les intimidait guère: elles continuaient leur bavardage, en un style qui ne manquait pas de verdeur. À peine écoutait-il: il entendait seulement le son de leurs voix riantes, mêlé au bruit des battoirs, au lointain meuglement des vaches dans les prés; et il rêvassait, ne quittant pas des yeux la belle lavandière.—Les filles ne tardèrent pas à distinguer l'objet de ses attentions; elles y firent entre elles des allusions malignes; sa préférée ne lançait pas à son adresse les remarques les moins mordantes. Comme il ne bougeait toujours point, elle se leva, prit un paquet de linge lavé et tordu, et se mit à l'étendre sur les buissons, en se rapprochant de lui, afin d'avoir un prétexte pour le dévisager. En passant à côté, elle s'arrangea de façon à l'éclabousser avec ses draps mouillés, et elle le regarda effrontément, en riant. Elle était maigre et robuste, le menton fort, un peu en galoche, le nez court, les sourcils bien arqués, les yeux bleu foncé, hardis, brillants et durs, la bouche belle, aux lèvres grosses, avançant un peu, comme celles d'un masque grec, une masse de cheveux blonds tordus sur la nuque, et le teint halé. Elle portait la tête très droite, ricanait à chaque mot qu'elle disait, et marchait comme un homme, en balançant ses mains ensoleillées. Elle continuait d'étendre son linge, en regardant Christophe, d'un regard provocant,—attendant qu'il parlât. Christophe la fixait aussi; mais il ne désirait aucunement lui parler. À la fin, elle lui éclata de rire au nez, et s'en retourna vers ses compagnes. Il resta à sa place, étendu, jusqu'à ce que le soir tombât, et qu'il la vît partir, sa hotte sur le dos, et ses bras nus croisés, courbant l'échine, toujours causant et riant.
Il la retrouva, deux ou trois jours après, au marché de la ville, au milieu des montagnes de carottes, de tomates, de concombres et de choux. Il flânait, regardant la foule des marchandes, qui se tenaient debout, alignées devant leurs paniers, comme des esclaves à vendre. L'homme de la police passait devant chacune, avec son escarcelle et son rouleau de tickets, recevant une piécette, délivrant un papier. La marchande de café allait de rang en rang, avec une corbeille pleine de petites cafetières. Une vieille religieuse, joviale et rebondie, faisait le tour du marché, deux grands paniers au bras, et, sans humilité, quémandait des légumes, en parlant du bon Dieu. On criait; les antiques balances, aux plateaux peints en vert, cliquetaient et tintaient, avec un bruit de chaînes; les gros chiens, attelés aux petites voitures, aboyaient joyeusement, tout fiers de leur importance. Au milieu de la cohue, Christophe aperçut Rébecca.—De son vrai nom, elle s'appelait Lorchen.—Sur son blond chignon, elle avait mis une feuille de chou, blanche et verte, qui lui faisait un casque dentelé. Assise sur un panier, devant des tas d'oignons dorés, de petites raves roses, de haricots verts, et de pommes rubicondes, elle croquait ses pommes, l'une après l'autre, sans s'occuper de les vendre. Elle ne cessait pas de manger. De temps en temps, elle s'essuyait le menton et le cou avec son tablier, relevait ses cheveux avec son bras, se frottait la joue contre son épaule, ou le nez au dos de sa main. Ou, les mains sur ses genoux, elle faisait passer indéfiniment de l'une à l'autre une poignée de petits pois. Et elle regardait à droite, à gauche, d'un air désœuvré. Mais elle ne perdait rien de ce qui se faisait autour d'elle, et, sans en avoir l'air, elle cueillait tous les regards qui lui étaient destinés. Elle vit parfaitement Christophe. En causant avec les acheteurs, elle fronçait le sourcil pour observer, par-dessus leurs têtes, son admirateur. Elle semblait digne et grave, comme un pape; mais sous cape, elle se moquait de Christophe. Il le méritait bien: il restait là planté, h quelques pas, la dévorant des yeux; et puis, il s'en alla, sans lui avoir parlé.
Il revint plus d'une fois rôder autour du village où elle habitait. Elle allait et venait dans la cour de sa ferme: il s'arrêtait sur la route pour la regarder. Il ne s'avouait pas que c'était pour elle qu'il venait; et, en vérité, c'était presque sans y penser. Quand il était absorbé par la composition d'une œuvre, il se trouvait dans un état de somnambule: tandis que son âme consciente suivait ses pensées musicales, le reste de son être demeurait livré à l'autre âme inconsciente, qui guette la moindre distraction de l'esprit pour prendre la clef des champs. Il était souvent étourdi par le bourdonnement de sa musique, quand il se trouvait en face d'elle; et il continuait de rêvasser, en la regardant. Il n'eût pu dire qu'il l'aimât, il n'y songeait même pas; il avait plaisir à la voir: rien de plus. Il ne se rendait pas compte du désir qui le ramenait vers elle.
Cette insistance faisait jaser. On s'en gaussait à la ferme, où l'on avait fini par savoir qui était Christophe. On le laissait tranquille, d'ailleurs; car il était inoffensif. Pour tout dire, il avait l'air d'un sot: et il ne s'en inquiétait pas.
C'était la fête au village. Des gamins écrasaient des pois fulminants entre deux cailloux, en criant: «Vive l'Empereur!» (Kaiser lebe! Hoch!) On entendait meugler un veau, enfermé dans son étable, et les chants des buveurs au cabaret. Des cerfs-volants aux queues de comètes frétillaient dans l'air, au-dessus des champs. Les poules grattaient avec frénésie le fumier d'or: le vent s'engouffrait dans leurs plumes, comme dans les jupes d'une vieille dame. Un cochon rose dormait voluptueusement sur le flanc, au soleil.
Christophe se dirigea vers le toit rouge de l'auberge des Trois Rois, au-dessus duquel flottait un petit drapeau. Des chapelets d'oignons étaient pendus à la façade, et les fenêtres étaient garnies de fleurs de capucines rouges et jaunes. Il entra dans la salle, pleine de fumée de tabac, où s'étalaient aux murs des chromos jaunies, et, à la place d'honneur, le portrait colorié de l'Empereur-Roi, entouré d'une guirlande de feuilles de chêne. On dansait. Christophe était bien sûr que sa belle amie serait là. Et en effet, ce fut la première figure qu'il aperçut. Il s'établit dans un angle de la pièce, d'où il pouvait suivre en paix les évolutions des danseurs. Mais, quelque soin qu'il eut pris pour ne pas être remarqué, Lorchen sut bien le découvrir dans son coin. Tout en tournant d'interminables valses, elle lui lançait par-dessus l'épaule de son danseur de rapides œillades; et, pour mieux l'exciter, elle coquetait avec les garçons du village, en riant de sa grande bouche bien fendue. Elle parlait fort et disait des niaiseries, ne différant point en cela de ces jeunes filles du monde, qui, lorsqu'on les regarde, se croient obligées de rire, de s'agiter, d'être sottes pour la galerie, au lieu de le rester pour elles seules.—En quoi elles ne sont pas si sottes: car elles savent que la galerie les regarde et ne les écoute pas.—Christophe, les coudes sur la table et le menton sur les poings, suivait le manège de la fille avec des yeux ardents et furieux: il avait l'esprit assez libre pour n'être pas dupe de ses roueries; mais il ne l'avait pas assez pour ne pas s'y laisser prendre; et tour à tour, il grognait de colère, ou bien il riait sous cape, et haussait les épaules, de donner dans le panneau.
Un autre l'observait: c'était le père de Lorchen. Petit et trapu, une grosse tête au nez court, le crâne chauve rissolé par le soleil, avec une couronne de cheveux qui avaient été blonds et frisottaient par boucles épaisses comme un Saint-Jean de Dürer, bien rasé, la figure impassible, sa longue pipe au coin de la bouche, il causait très lentement avec d'autres paysans, tout en suivant du coin de l'œil la mimique de Christophe; et il avait un rire silencieux. À un moment, il toussota; un éclair de malice brillant dans ses petits yeux gris, il vint s'asseoir de côté à la table de Christophe. Christophe, mécontent, tourna vers lui un visage renfrogné: il rencontra le regard narquois du vieux qui, sans extraire sa pipe de sa bouche, lui adressa familièrement la parole. Christophe le connaissait: il le tenait pour une vieille canaille; mais le faible qu'il avait pour la fille le rendait indulgent pour le père, et même lui inspirait un bizarre plaisir à se trouver avec lui: le vieux malin s'en doutait. Après avoir parlé de la pluie et du beau temps, et fait une allusion goguenarde aux belles filles, et à ce qu'il ne dansait pas, il conclut que Christophe avait bien raison de ne pas se donner de mal, et qu'on était mieux à table, les coudes devant son pot; et il se fit inviter sans façon à en vider un. En buvant, le vieux causait, sans se presser. Il parlait de ses petites affaires, de la difficulté qu'on avait à vivre, des mauvais temps, de la cherté de tout. Christophe ne répondait que par quelques grognements: cela ne l'intéressait pas; il regardait Lorchen. Il y avait des moments de silence: le paysan attendait un mot; nulle réponse ne venait: il reprenait tranquillement. Christophe se demandait ce qui lui valait l'honneur de la société du vieux et de ses confidences. Il finit par comprendre. Le vieux, après avoir épuisé ses doléances, passa à un autre chapitre: il vanta l'excellence de ses produits, de ses légumes, de sa volaille, de ses œufs, de son lait; et brusquement, il demanda si Christophe ne pourrait pas lui procurer la clientèle du château. Christophe sursauta:
—Comment diable savait-il?... Il le connaissait donc?
—Oui bien, disait le vieux. Tout se sait...
Il n'ajoutait pas:
—... quand on se donne la peine de faire sa petite police soi-même.
Christophe se fit un malin plaisir de lui apprendre que, bien que «tout se sût», on ne savait pas sans doute qu'il venait de se brouiller avec la petite cour, et que, si jamais il avait pu se flatter de quelque crédit auprès de l'office et des cuisines du château,—(ce dont il doutait fort)—ce crédit, à l'heure présente, était mort et enterré. Le vieux eut un froncement imperceptible de la bouche. Il ne se découragea pourtant pas; et, après un moment, il demanda si Christophe ne pourrait pas du moins le recommander à telle et telle famille. Et il lui nomma toutes celles avec qui Christophe se trouvait en relations: car il s'était renseigné très exactement, au marché. Christophe eût été furieux de cet espionnage, s'il n'avait eu plutôt envie de rire, en pensant que le vieux serait volé, malgré toute sa malice: (car il ne se doutait pas que la recommandation qu'il demandait était plus capable de lui faire perdre sa clientèle, que de lui en procurer de nouvelle). Il le laissa donc dévider en pure perte son écheveau de petites ruses grossières; et il ne répondait ni oui, ni non. Mais le paysan insistait; et, s'attaquant enfin à Christophe lui-même et à Louisa, qu'il avait gardés pour la fin, il voulut à toute force leur colloquer son lait, son beurre, et sa crème. Il ajoutait que, puisque Christophe était musicien, rien ne faisait plus de bien pour la voix qu'un œuf frais avalé cru, matin et soir: et il se faisait fort de lui en fournir de tout chauds sortis du cul de la poule. Cette idée que le vieux le prenait pour un chanteur fit éclater de rire Christophe. Le paysan en profita pour faire venir une autre bouteille. Après quoi, ayant tiré de Christophe tout ce qu'il pouvait pour l'instant, il s'en alla, sans autre cérémonie.
La nuit était venue. Les danses étaient de plus en plus animées. Lorchen ne prêtait aucune attention à Christophe: elle avait trop à faire de tourner la tête a un jeune drôle du village, fils d'un riche fermier, que toutes les filles se disputaient. Christophe s'intéressait à la lutte: ces demoiselles se souriaient, et elles se fussent griffées avec délices. Christophe, bon enfant, s'oubliait, et faisait des vœux pour le triomphe de Lorchen. Mais quand ce triomphe fut obtenu, il se sentit un peu triste. Il se le reprocha. Il n'aimait pas Lorchen: il était bien naturel qu'elle aimât qui elle voulait.
—Sans doute. Mais il n'était pas gai de se sentir si seul. Tous ces gens ne s'intéressaient à lui que pour l'exploiter, et se moquer de lui ensuite. Il soupira, sourit en regardant Lorchen, que la joie de faire enrager ses rivales rendait dix fois plus jolie, et il se disposa à partir. Il était près de neuf heures: il avait deux bonnes lieues à faire pour rentrer en ville.
Il se levait de table, quand la porte s'ouvrit; et une dizaine de soldats firent irruption. Leur entrée jeta un froid dans la salle. Les gens se mirent à chuchoter. Quelques couples qui dansaient s'arrêtèrent, pour jeter des regards inquiets sur les nouveaux arrivants. Les paysans debout près de la porte affectèrent de leur tourner le dos et de causer entre eux; mais, sans en avoir l'air, ils eurent bien soin de se ranger prudemment, pour les laisser passer.
—Depuis quelque temps, tout le pays était en lutte sourde avec la garnison des forts qui entouraient la ville. Les soldats s'ennuyaient à périr, et se vengeaient sur les paysans. Ils se moquaient d'eux grossièrement, ils les malmenaient, ils traitaient les filles comme en pays conquis. La semaine d'avant, quelques-uns d'entre eux, pris de vin, avaient troublé une fête dans un village voisin, et assommé à moitié un fermier. Christophe, au courant des choses, partageait l'état d'esprit des paysans; et, se rasseyant à sa place, il attendit ce qui allait se passer.
Les soldats, sans s'inquiéter de la malveillance qui accueillait leur entrée, allèrent bruyamment s'asseoir aux tables pleines, d'où ils bousculèrent les gens, pour se faire place: ce fut l'affaire d'un moment. La plupart s'écartèrent en grommelant. Un vieux, assis au bout d'un banc, ne se rangea pas assez vite: ils soulevèrent le banc, et le vieux culbuta, au milieu des éclats de rire. Christophe se leva, indigné; mais, comme il était sur le point d'intervenir, il vit le vieux, qui se ramassait péniblement, et, au lieu de se plaindre, se confondait en excuses. Deux des soldats vinrent à la table de Christophe: il les regardait venir, serrant les poings. Mais il n'eut pas à se défendre. C'étaient deux grands diables athlétiques et bonasses, qui suivaient, comme des moutons, un ou deux risque-tout et tâchaient de les imiter. Ils furent intimidés par l'air hautain de Christophe; et, quand il leur dit, d'un ton sec:
—La place est prise...
ils s'excusèrent précipitamment, et se reculèrent au bout du banc, afin de ne pas le gêner. Sa voix avait eu les inflexions du maître: la servilité naturelle reprenait le dessus. Ils voyaient bien que Christophe n'était pas un paysan.
Christophe, un peu apaisé par cette attitude soumise, put observer les choses avec plus de sang-froid. Il n'eut pas de peine à voir que toute la bande était menée par un sous-officier,—un petit boule-dogue, aux yeux durs,—face de larbin hypocrite et méchant: un des héros de la bagarre de l'autre dimanche. Assis à une table voisine de Christophe, et déjà ivre, il dévisageait les gens et lançait des sarcasmes injurieux, qu'ils affectaient de ne pas entendre. Il s'attaquait surtout aux couples qui dansaient, décrivant leurs avantages ou leurs défauts physiques, avec une ignominie d'expressions qui soulevait les rires de ses compagnons. Les filles rougissaient, et les larmes leur venaient aux yeux; les garçons serraient les dents et rageaient en silence. Le regard du bourreau faisait lentement le tour de la salle, en n'épargnant personne: Christophe le vit venir vers lui. Il saisit sa chope, et, le poing sur la table, il attendit, décidé à lui jeter le verre à la tête, à la première insulte. Il se disait:
—Je suis fou. Je ferais mieux de m'en aller. Je vais me faire ouvrir le ventre; et après, si j'en réchappe, on me mettra en prison: le jeu n'en vaut pas la chandelle. Partons, avant qu'il ne m'ait provoqué.
Mais son orgueil s'y refusait: il ne voulait pas avoir l'air de fuir devant ces oiseaux-là.—Le regard sournois et brutal se posa sur lui. Christophe, raidi, le fixa avec colère. Le sous-officier le considéra, un instant: la figure de Christophe le mit en verve; il poussa du coude son voisin, lui désigna le jeune homme, en ricanant; et déjà il ouvrait la bouche pour l'injurier. Christophe, ramassé sur lui-même, allait lancer son verre à toute volée.—Cette fois encore, le hasard le sauva. Au moment où l'ivrogne allait parler, un couple maladroit de danseurs vint buter contre lui et fit tomber son verre. Il se retourna furieux, et déversa sur eux un tombereau d'injures. Son attention était détournée: il ne pensait plus à Christophe. Celui-ci attendit encore quelques minutes; puis, voyant que son ennemi ne cherchait plus à reprendre l'entretien, il se leva, prit lentement son chapeau, et s'achemina sans se presser vers la porte. Il ne quittait pas des yeux le banc où l'autre était assis, pour bien lui faire sentir qu'il ne cédait pas devant lui. Mais le sous-officier l'avait décidément oublié: personne ne s'occupait de lui.
Il tournait la poignée de la porte: quelques secondes encore, et il était dehors. Mais il était dit qu'il n'en sortirait pas indemne. Un brouhaha s'élevait dans le fond de la salle. Les soldats, après avoir bu, avaient décidé de danser. Et comme toutes les filles avaient leurs cavaliers, ils chassèrent les danseurs, qui se laissèrent faire. Mais Lorchen ne l'entendait pas ainsi. Ce n'était pas pour rien qu'elle avait ces yeux hardis et ce menton volontaire, qui plaisaient à Christophe. Elle valsait comme une folle, quand le sous-officier, qui avait jeté son dévolu sur elle, vint lui arracher son danseur. Elle tapa du pied, cria, et, repoussant le soldat, elle déclara que jamais elle ne danserait avec un malotru comme lui. L'autre la poursuivit. Il bourrait de coups de poing les gens derrière lesquels elle cherchait à s'abriter. Enfin, elle se réfugia derrière une table; et là, protégée de lui pendant un moment, elle reprit du souffle pour l'injurier; elle voyait que sa résistance ne servirait à rien et elle trépignait de fureur, cherchait les mots les plus blessants, et comparait sa tête à celle de divers animaux de la basse-cour. Lui, penché vers elle, de l'autre côté de la table, avait un mauvais sourire, et ses yeux luisaient de colère. Brusquement, il prit son élan, et sauta par-dessus la table. Il l'empoigna. Elle se débattit, comme une vachère, à coups de poing et de pied. Il n'était pas trop bien d'aplomb sur ses jambes, et faillit perdre l'équilibre. Furieux, il la poussa contre le mur, et la gifla. Il ne recommença pas: quelqu'un lui avait sauté sur le dos, le giflait à tour de bras, et le lançait d'un coup de pied, au milieu des buveurs. C'était Christophe, qui s'était rué sur lui, bousculant tables et gens. Le sous-officier se retourna, fou de rage, tirant son sabre. Avant qu'il eût pu s'en servir, Christophe l'assomma d'un coup d'escabeau. Le tout avait été si prompt qu'aucun des spectateurs n'eut l'idée d'intervenir. Mais quand on vit le soldat s'abattre sur le carreau, comme un bœuf, un tumulte épouvantable s'éleva. Les autres soldats coururent sur Christophe, le sabre hors du fourreau. Les paysans se jetèrent sur eux. La mêlée fut générale. Les chopes volaient à travers la salle, les tables étaient renversées. Les paysans se réveillaient: il y avait de vieilles rancunes à assouvir. Les gens roulaient par terre, et se mordaient avec fureur. Le danseur évincé de Lorchen, un solide valet de ferme, avait empoigné la tête d'un soldat qui l'avait insulté tout à l'heure, et la martelait contre un mur. Lorchen, armée d'une trique, tapait comme une sourde. Les autres filles se sauvaient en hurlant, sauf deux ou trois gaillardes, qui s'en donnaient à cœur-joie. L'une d'elles, une grosse petite blonde, voyant un soldat gigantesque,—le même qui s'était assis à la table de Christophe,—défoncer à coups de genoux la poitrine de son adversaire renversé, courut au foyer, revint, et tirant en arrière la tête de la brute, elle lui appliqua dans les yeux une poignée de cendres brûlantes. L'homme poussa des mugissements. La fille jubilait, insultant l'ennemi désarmé, que les paysans maintenant assommaient à leur aise. Enfin, les soldats, trop faibles, se replièrent au dehors, laissant deux d'entre eux sur le carreau. La lutte continua dans la rue du village. Ils faisaient irruption dans les maisons, en poussant des cris de mort, et voulaient tout saccager. Les paysans les avaient suivis avec leurs fourches; ils lançaient sur l'ennemi leurs chiens hargneux. Un troisième soldat tomba, le ventre troué d'un coup de trident. Les autres durent s'enfuir, pourchassés jusqu'au delà du village; et, de loin, ils criaient, en se sauvant à travers champs, qu'ils allaient chercher les camarades et qu'ils reviendraient tout à l'heure.
Les paysans, restés maîtres du terrain, retournèrent à l'auberge: ils exultaient; c'était la revanche, depuis longtemps attendue, des avanies qu'ils avaient subies. Ils ne pensaient pas encore aux conséquences de l'échauffourée. Ils parlaient tous à la fois, et chacun vantait ses prouesses. Ils fraternisèrent avec Christophe, tout joyeux de se sentir rapproché d'eux. Lorchen vint lui prendre la main, et resta un instant à la tenir dans sa menotte rude, en lui ricanant au nez. Elle ne le trouvait plus ridicule, à cette heure.
On s'occupa des blessés. Parmi les gens du village, il n'y avait que des dents cassées, quelques côtes enfoncées, des bosses et des bleus, sans grave conséquence. Mais il n'en était pas de même des soldats. Trois étaient sérieusement atteints: le colosse aux yeux brûlés, qui avait eu l'épaule à moitié emportée d'un coup de hache; l'homme éventré, qui râlait, et le sous-officier, assommé par Christophe. On les avait étendus par terre, près du foyer. Le sous-officier, le moins blessé des trois, venait de rouvrir les yeux. Il regarda longuement, d'un regard chargé de haine, le cercle des paysans penchés autour de lui. À peine eut-il repris conscience de ce qui s'était passé qu'il commença à les insulter. Il jurait qu'il se vengerait, qu'il leur ferait leur affaire à tous; il étranglait de rage; on sentait que s'il pouvait, il les exterminerait. Ils essayèrent de rire; mais leur rire était forcé. Un jeune paysan cria au blessé:
—Ferme ta gueule, ou je te tue!
Le sous-officier essaya de se redresser, et, fixant celui qui venait de parler, avec ses yeux injectés de sang:
—Salauds! dit-il, tuez-moi! On vous coupera la tête.
Il continuait à vociférer. L'homme éventré poussait des cris aigus, comme un cochon qu'on saigne. Le troisième était immobile et rigide comme un mort. Une terreur écrasante tomba sur les paysans. Lorchen et quelques femmes emportèrent les blessés dans une autre chambre. Les vociférations du sous-officier et les cris du mourant s'assourdirent. Les paysans se taisaient: ils demeuraient à la même place, faisant le cercle, comme si les trois corps étaient toujours étendus à leurs pieds; ils n'osaient pas bouger et se regardaient, épeurés. À la fin, le père de Lorchen dit:
—Vous avez fait de bel ouvrage!
Il y eut un murmure angoissé: ils avalaient leur salive. Puis, ils se mirent à parler tous à la fois. D'abord, ils chuchotaient, comme s'ils avaient peur qu'on ne les écoutât à la porte; mais bientôt, le ton s'éleva et devint plus âpre: ils s'accusaient l'un l'autre; ils se reprochaient mutuellement les coups qu'ils avaient donnés. La dispute s'envenimait: ils semblaient sur le point d'en venir aux mains. Le père de Lorchen les mit tous d'accord. Les bras croisés, se tournant vers Christophe, il le désigna du menton:
—Et celui-là, dit-il, qu'est-ce qu'il est venu faire ici?
Toute la colère de la foule se retourna contre Christophe:
—C'est vrai! C'est vrai! criait-on, c'est lui qui a commencé! Sans lui, rien ne serait arrivé!
Christophe, abasourdi, essaya de répondre:
—Ce que j'en ai fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, vous le savez bien.
Mais ils lui répliquaient, furieux:
—Est-ce que nous ne sommes pas capables de nous défendre seuls? Est-ce que nous avions besoin qu'un monsieur de la ville vînt nous dire ce qu'il fallait faire? Qui vous a demandé votre avis? Et d'abord, qui vous a prié de venir? Vous ne pouviez pas rester chez vous?
Christophe haussa les épaules, et se dirigea vers la porte. Mais le père de Lorchen lui barra le chemin, en glapissant.
—C'est ça! c'est ça! criait-il, il voudrait filer maintenant, après qu'il nous a tous mis dans le pétrin. Il ne partira pas!
Les paysans hurlèrent:
—Il ne partira pas! C'est lui qui est cause de tout. C'est lui qui doit payer pour tout!
Ils l'entouraient, en lui montrant le poing. Christophe voyait se resserrer le cercle de figures menaçantes: la peur les rendait enragés. Il ne dit pas un mot, fit une grimace de dégoût, et, jetant son chapeau sur une table, il alla s'asseoir au fond de la salle, et leur tourna le dos.
Mais Lorchen, indignée, se jeta au milieu des paysans. Sa jolie figure était rouge et froncée de colère. Elle repoussa rudement ceux qui entouraient Christophe:
—Tas de lâches! Bêtes brutes! cria-t-elle. Vous n'êtes pas honteux? Vous voudriez faire croire que c'est lui qui a tout fait! Comme si on ne vous avait pas vus! Comme s'il y en avait un seul qui n'avait pas cogné de son mieux!... S'il y en avait un seul qui était resté les bras croisés, pendant que les autres se battaient, je lui cracherais à la figure, et je l'appellerais: Lâche! Lâche!...
Les paysans, surpris par cette sortie inattendue, restèrent, un instant, silencieux; puis, ils se remirent à crier:
—C'est lui qui a commencé! Sans lui, il n'y aurait rien eu.
Le père de Lorchen faisait en vain des signes à sa fille. Elle reprit:
—Bien sûr que c'est lui qui a commencé! Il n'y a pas de quoi vous vanter. Sans lui, vous vous laissiez insulter, vous nous laissiez insulter, poltrons! froussards!
Elle apostropha son ami:
—Et toi, tu ne disais rien, tu faisais la bouche en cœur, tu tendais le derrière aux coups de botte; pour un peu, tu aurais remercié! Tu n'as pas honte?... Vous n'avez pas honte, tous? Vous n'êtes pas des hommes! Courage de brebis, toujours le nez en terre! Il a fallu que celui-là vous donnât l'exemple!—Et maintenant, vous voudriez lui faire tout retomber sur le dos?... Eh bien, cela ne sera pas, c'est moi qui vous le dis! Il s'est battu pour nous. Ou bien vous le sauverez, ou bien vous trinquerez avec lui: je vous en donne ma parole!
Le père de Lorchen la tirait par le bras; il était hors de lui et criait:
—Tais-toi! tais-toi!... Te tairas-tu, bougre de chienne!
Mais elle le repoussa, et continua, de plus belle. Les paysans vociféraient. Elle criait plus fort qu'eux, d'une voix aiguë, qui crevait le tympan:
—D'abord, toi, qu'est-ce que tu as à dire? Tu crois que je ne t'ai pas vu tout à l'heure piler à coups de talons celui-là qui est quasi comme mort dans la chambre à côté? Et toi, montre un peu tes mains!... Il y a encore du sang dessus. Tu crois que je ne t'ai pas vu avec ton couteau? Je dirai tout ce que j'ai vu, tout, si vous faites la moindre chose contre lui. Je vous ferai tous condamner.
Les paysans, exaspérés, approchaient leur figure furieuse de la figure de Lorchen, et lui braillaient au nez. Un d'eux fit mine de la calotter; mais le bon ami de Lorchen le saisit au collet, et ils se secouèrent tous deux, prêts à se rouer de coups. Un vieux dit à Lorchen:
—Si nous sommes condamnés, tu le seras aussi.
—Je le serai aussi, fit-elle. Je suis moins lâche que vous.
Et elle reprit sa musique.
Ils ne savaient plus que faire. Ils s'adressaient au père:
—Est-ce que tu ne la feras pas taire?
Le vieux avait compris qu'il n'était pas prudent de pousser à bout Lorchen. Il leur fit signe de se calmer. Le silence tomba. Lorchen seule continua de parler; puis, ne trouvant plus de riposte, comme un feu sans aliment, elle s'arrêta. Après un moment, son père toussota, et dit:
—Eh bien, donc, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pourtant pas nous perdre?
Elle dit:
—Je veux qu'on le sauve.
Ils se mirent à réfléchir. Christophe n'avait pas bougé de place: raidi dans son orgueil, il semblait ne pas entendre qu'il s'agissait de lui; mais il était ému de l'intervention de Lorchen. Lorchen ne paraissait pas davantage savoir qu'il était là: adossée à la table où il était assis, elle fixait d'un air de défi les paysans, qui fumaient, en regardant à terre. Enfin, son père, après avoir mâchonné sa pipe, dit:
—Qu'on dise ou qu'on ne dise pas quelque chose,—s'il reste, son affaire est claire. Le maréchal des logis l'a reconnu: il ne lui fera pas grâce. Il n'y a qu'un parti pour lui, c'est qu'il file tout de suite, de l'autre côté de la frontière.
Il avait réfléchi qu'après tout, il serait plus avantageux pour eux que Christophe se sauvât: il se dénonçait ainsi lui-même; et, quand il ne serait plus là pour se défendre, on n'aurait pas de peine à se décharger sur lui de tout le gros de l'affaire. Les autres approuvèrent. Ils se comprenaient parfaitement.—Maintenant qu'ils étaient décidés, ils avaient hâte que Christophe fut déjà parti. Sans manifester aucune gêne de ce qu'ils avaient dit, un moment avant, ils se rapprochèrent de lui, feignant de s'intéresser vivement à son salut.
—Pas une minute à perdre, monsieur, dit le père de Lorchen. Ils vont revenir. Une demi-heure pour aller au fort. Une demi-heure pour retourner... Il n'y a que le temps de filer.
Christophe s'était levé. Lui aussi avait réfléchi. Il savait que s'il restait, il était perdu. Mais partir, partir sans revoir sa mère?... Non, ce n'était pas possible. Il dit qu'il retournerait d'abord en ville, qu'il aurait encore le temps d'en repartir dans la nuit, et de passer la frontière. Mais ils poussèrent les hauts cris. Tout à l'heure, ils lui avaient barré la porte, pour l'empêcher de fuir: maintenant, ils s'opposaient à ce qu'il ne prit pas la fuite. Rentrer en ville, c'était se faire pincer, à coup sûr: avant qu'il fut seulement arrivé, on serait prévenu là-bas; on l'arrêterait chez lui.—Il s'obstinait. Lorchen l'avait compris:
—C'est votre maman que vous voulez voir?... J'irai à votre place.
—Quand?
—Cette nuit.
—C'est vrai? Vous feriez cela?
—J'y vais.
Elle prit son fichu, et s'en enveloppa.
—Écrivez quelque chose, je lui porterai... Venez par ici, je vais vous donner de l'encre.
Elle l'entraîna dans la pièce du fond. Sur le seuil, elle se retourna; et, apostrophant son galant:
—Et toi, prépare-toi, dit-elle, c'est toi qui le conduiras. Tu ne le quitteras pas, que tu ne l'aies vu de l'autre côté de la frontière.
—C'est bon, c'est bon, fit l'autre.
Il avait aussi hâte que quiconque de savoir Christophe en France, et même plus loin, s'il était possible.
Lorchen entra avec Christophe dans l'autre pièce. Christophe hésitait encore. Il était déchiré de douleur, à la pensée qu'il n'embrasserait plus sa mère. Quand la reverrait-il? Elle était si vieille, si fatiguée, si seule! Ce nouveau coup l'achèverait. Que deviendrait-elle sans lui?... Mais que deviendrait-elle, s'il restait, s'il se faisait condamner, enfermer pendant des années? Ne serait-ce pas plus sûrement encore pour elle l'abandon, la misère? Libre du moins, si loin qu'il fût, il pouvait lui venir en aide, elle pouvait le rejoindre.—Il n'eut pas le temps de voir clair dans ses pensées. Lorchen lui avait pris les mains; debout, près de lui, elle le regardait; leur figure se touchait presque; elle lui jeta les bras autour du cou, et lui baisa la bouche:
—Vite! vite! dit-elle tout bas, en lui montrant la table.
Il ne chercha plus à réfléchir. Il s'assit. Elle arracha à un livre de comptes une feuille de papier quadrillé, avec des barres rouges.
Il écrivit:
«Ma chère maman. Pardon! Je vais te causer une grande peine. Je ne pouvais agir autrement. Je n'ai rien fait d'injuste. Mais maintenant, je dois fuir, et quitter le pays. Celle qui te portera ce mot te racontera tout. Je voulais te dire adieu. On ne veut pas. On prétend que je serais arrêté avant. Je suis si malheureux que je n'ai plus de volonté. Je vais passer la frontière, mais je resterai tout près, jusqu'à ce que tu m'aies écrit; celle qui te remet ma lettre me rapportera ta réponse. Dis-moi ce que je dois faire. Quoi que tu me dises, je le ferai. Veux-tu que je revienne? Dis-moi de revenir! Je ne puis supporter l'idée de te laisser seule. Comment feras-tu pour vivre? Pardonne-moi! Pardonne-moi! Je t'aime et je t'embrasse...»
—Dépêchons-nous, monsieur; sans quoi, il serait trop tard, dit le bon ami de Lorchen, en entr'ouvrant la porte.
Christophe signa hâtivement, et donna la lettre à Lorchen:
—Vous la remettrez vous-même?
—J'y vais, dit-elle.
Elle était déjà prête à partir.
—Demain, continua-t-elle, je vous porterai la réponse: vous m'attendrez à Leiden,—(la première station, au sortir d'Allemagne)—sur le quai de la gare.
(La curieuse avait lu la lettre de Christophe, par-dessus son épaule, tandis qu'il écrivait.)
—Vous me direz bien tout, et comment elle aura supporté ce coup, et tout ce qu'elle aura dit? Vous ne me cacherezrien? disait Christophe, suppliant.
—Je vous dirai tout.
Ils n'étaient plus aussi libres de se parler: sur le seuil de la porte, l'homme les regardait.
—Et puis, monsieur Christophe, dit Lorchen, j'irai la voir quelquefois, je vous enverrai de ses nouvelles: n'ayez point d'inquiétude.
Elle lui donna une poignée de main vigoureuse, comme un homme.
—Allons! fit le paysan.
—Allons! dit Christophe.
Ils sortirent tous trois. Sur la route, ils se séparèrent. Lorchen alla d'un côté, et Christophe avec son guide, de l'autre. Ils ne causaient point. Le croissant de la lune, enveloppée de vapeurs, disparaissait derrière les bois. Une lumière très pâle flottait sur les champs. Dans les creux, les brouillards s'étaient levés, épais et blancs comme du lait. Les arbres grelottants baignaient dans l'air humide... Quelques minutes à peine après la sortie du village, le paysan se rejeta brusquement en arrière, et fit signe à Christophe de s'arrêter. Ils écoutèrent. Sur la route, devant eux, s'approchait le pas cadencé d'une troupe. Le paysan enjamba la haie et entra dans les champs. Christophe fit comme lui. Ils s'éloignèrent à travers les labours. Ils entendirent passer sur le chemin les soldats. Dans la nuit, le paysan leur montra le poing. Christophe avait le cœur serré, comme l'animal traqué. Ils se remirent en route, évitant les villages et les fermes isolées, où les aboiements des chiens les dénonçaient à tout le pays. Au revers d'une colline boisée, ils aperçurent dans le lointain les feux rouges de la ligne du chemin de fer. S'orientant d'après ces phares, ils décidèrent de se diriger vers la première station. Ce ne fut pas aisé. À mesure qu'ils descendaient dans la vallée, ils s'enfonçaient dans les brouillards. Ils eurent à sauter deux ou trois petits ruisseaux. Ils se trouvèrent ensuite dans d'immenses champs de betteraves et de terre labourée; ils crurent qu'ils n'en sortiraient jamais. La plaine était bosselée: c'était une suite de renflements et de creux, où l'on risquait de tomber. Enfin, après avoir erré au hasard, noyés dans la brume, ils aperçurent tout à coup, à quelques pas, les fanaux de la voie ferrée sur le faîte d'un remblais. Ils grimpèrent le talus. Au risque d'être surpris, ils suivirent le long des rails, jusqu'à une centaine de mètres de la station: là, ils reprirent la route. Ils arrivèrent à la gare, vingt minutes avant le passage du train. Malgré les recommandations de Lorchen, le paysan laissa Christophe: il avait hâte d'être revenu, pour voir ce qu'on avait fait des autres et de son bien.
Christophe prit une place pour Leiden, et il attendit seul dans la salle des troisièmes déserte. Un employé, qui somnolait sur une banquette, vint regarder le billet de Christophe et lui ouvrir la porte, à l'arrivée du train. Personne dans le wagon. Dans le train, tout dormait. Tout dormait dans les champs. Seul, Christophe ne dormait point, malgré sa fatigue. À mesure que les lourdes roues de fer le rapprochaient de la frontière, il sentait le désir trépidant d'être hors d'atteinte. Dans une heure, il serait libre. Mais d'ici là, il suffisait d'un mot pour qu'il fût arrêté... Arrêté! Tout son être se révoltait. Être étouffé par la force odieuse!... Il n'en respirait plus. Sa mère, son pays qu'il quittait, avaient disparu de sa pensée. Dans l'égoïsme de sa liberté menacée, il ne pensait qu'à cette liberté qu'il voulait sauver. À quelque prix que ce fût! Oui, même au prix d'un crime... Il se reprochait amèrement d'avoir pris ce train, au lieu d'avoir continué sa route à pied jusqu'à la frontière. Il avait voulu gagner quelques heures. Belle avance! Il allait se jeter dans la gueule du loup. Sûrement, on l'attendait à la gare frontière; des ordres devaient être donnés... Il songea, un moment, à descendre du train en marche, avant la station; il ouvrit même la portière du wagon; mais il était trop tard: on arrivait. Le train s'arrêta. Cinq minutes. Une éternité. Christophe, rejeté dans le fond de son compartiment, abrité derrière le rideau, regardait anxieusement le quai, où se tenait immobile un gendarme. Le chef de gare sortit de son bureau, une dépêche à la main, et se dirigea précipitamment du côté du gendarme. Christophe ne douta point qu'il ne s'agît de lui. Il chercha une arme. Nulle autre qu'un fort couteau à deux lames. Il l'ouvrit dans sa poche. Un employé, avec une lanterne attachée sur la poitrine, avait croisé le chef et courut le long du train. Christophe le vit venir. Le poing crispé dans sa poche, sur le manche du couteau, il pensa:
—Je suis perdu!
Il était dans un tel état de surexcitation qu'il eût été capable de plonger son couteau dans la poitrine de l'homme, si celui-ci avait eu la malencontreuse idée de venir à lui et d'ouvrir son compartiment. Mais l'employé s'arrêta au wagon voisin, pour vérifier le billet d'un voyageur qui venait de monter. Le train se remit en marche. Christophe comprimait les battements de son cœur. Il ne bougeait pas. Il osait à peine se dire qu'il était sauvé. Il ne voulait pas se le dire, tant que la frontière ne serait point passée... Le jour commençait à poindre. Les silhouettes des arbres sortaient de la nuit. L'ombre fantastique d'une voiture passa sur la route, avec un bruit de grelots et un œil clignotant... La figure collée contre la vitre, Christophe tâchait de voir le poteau aux armes impériales, qui marquait les bornes de sa servitude. Il le cherchait encore dans la lumière naissante, quand le train siffla pour annoncer l'arrivée à la première station belge.
Il se leva, il ouvrit toute grande la portière, il but l'air glacé. Libre! Toute sa vie devant lui! Joie de vivre!...—Et aussitôt tomba sur lui, d'un coup, la tristesse de ce qu'il laissait, la tristesse de ce qu'il allait trouver; et la lassitude de cette nuit d'émotions le terrassa. Il s'affaissa sur la banquette. Une minute à peine le séparait de l'arrivée en gare. Quand, une minute plus tard, un employé ouvrit la portière du wagon, il trouva Christophe endormi. Secoué par le bras, Christophe s'éveilla, confus, croyant avoir dormi une heure; il descendit lourdement, se traîna à la douane; et, définitivement accepté sur le territoire étranger, n'ayant plus à se défendre, il se coucha tout de son long sur un banc de la salle d'attente, et se laissa tomber dans le sommeil, comme une masse.
Il se réveilla vers midi. Lorchen ne pouvait guère venir avant deux ou trois heures. En attendant l'arrivée des trains, il faisait les cent pas sur le quai de la petite gare. Il continua tout droit au milieu des prairies. C'était un jour gris et sans joie, qui sentait les approches de l'hiver. La lumière était endormie. Le sifflet plaintif d'un train en manœuvre rompait seul le triste silence. Christophe s'arrêta à quelques pas de la frontière, dans la campagne déserte. Devant lui une toute petite mare, une flaque d'eau très claire, où se reflétait le ciel mélancolique. Elle était close d'une palissade, et bordée de deux arbres. À droite, un peuplier, à la cime dépouillée, qui tremblait. Derrière, un grand noyer, aux branches noires et nues, comme un polype monstrueux. Des grappes de corbeaux s'y balançaient lourdement. Les dernières feuilles exsangues se détachaient d'elles-mêmes, et tombaient une à une sur l'étang immobile...
Il lui semblait qu'il avait déjà vu cela: ces deux arbres, cet étang...—Et brusquement, il eut une de ces minutes de vertige, qui s'ouvrent de loin en loin dans la plaine de la vie. Une trouée dans le Temps. On ne sait plus où on est, qui on est, dans quel siècle l'on vit, depuis combien de siècles on est ainsi. Christophe avait le sentiment que cela avait déjà été, que ce qui était maintenant n'était pas maintenant, mais dans un autre temps. Il n'était plus lui-même. Il se voyait du dehors, de très loin, comme un autre qui déjà s'était tenu debout, ici, à cette place. Il entendait une ruche de souvenirs inconnus; ses artères bruissaient:
«Ainsi... Ainsi... Ainsi...»
Le grondement des siècles...
Bien d'autres Krafft avant lui avaient subi les épreuves qu'il subissait aujourd'hui, et goûté la détresse de cette dernière heure sur la terre natale. Race toujours errante, et de partout bannie par son indépendance et son inquiétude. Race toujours en proie à un démon intérieur, qui ne lui permettait de se fixer nulle part. Race attachée pourtant au sol d'où on l'arrachait, et ne pouvant s'en déprendre...
Christophe repassait à son tour par les mêmes étapes; et ses pas retrouvaient sur le chemin les traces de ceux qui l'avaient précédé. Il regardait, les yeux pleins de larmes, se perdre dans la brume la terre de la patrie, à laquelle il fallait dire adieu... N'avait-il pas désiré ardemment la quitter?—Oui; mais à présent qu'il la quittait vraiment, il se sentait étreint d'angoisse. Il n'y a qu'un cœur de bête qui puisse se séparer sans émotion de la terre maternelle. Heureux ou malheureux, on a vécu ensemble; elle a été la compagne et la mère: on a dormi en elle, on a dormi sur elle, on en est imprégné; elle garde dans son sein le trésor de nos rêves, de notre vie passée, et la poussière sacrée de ceux que nous avons aimés. Christophe revoyait la suite de ses jours et les chères images qu'il laissait sur cette terre, ou dessous. Ses souffrances ne lui étaient pas moins chères que ses joies. Minna, Sabine, Ada, le grand-père, l'oncle Gottfried, le vieux Schulz,—tout reparut à ses yeux, en l'espace de quelques minutes. Il ne pouvait s'arracher à ses morts: (car il comptait aussi Ada parmi les morts). L'idée de sa mère, qu'il laissait, seule vivante de tous ceux qu'il aimait, au milieu de ces fantômes, lui était intolérable. Il fut sur le point de repasser la frontière, tant il se trouvait lâche d'avoir cherché la fuite. Il était décidé, si la réponse que Lorchen devait lui apporter de sa mère trahissait une douleur trop grande, à revenir coûte que coûte. Mais s'il ne recevait rien? Si Lorchen n'avait pu arriver jusqu'à Louisa, ou rapporter la réponse? Eh bien, il reviendrait.
Il retourna à la gare. Après une morne attente, le train parut enfin. Christophe guettait à une portière la figure hardie de Lorchen: car il était certain qu'elle tiendrait sa promesse; mais elle ne se montra pas. Il courut, inquiet, d'un compartiment à l'autre. Comme il se heurtait dans sa course au flot des voyageurs, il remarqua une figure, qui ne lui parut pas inconnue. C'était une petite fille de treize à quatorze ans, joufflue, courtaude, et rouge comme une pomme, avec un gros petit nez retroussé, une grande bouche, et une natte épaisse enroulée autour de la tête. En la regardant mieux, il vit qu'elle tenait à la main une vieille valise qui ressemblait à la sienne. Elle l'observait aussi, de côté, comme un moineau; et quand elle vit qu'il la regardait, elle fit quelques pas vers lui; mais elle resta plantée en face de Christophe, et le dévisagea de ses petits yeux de souris, sans dire un mot. Christophe la reconnut: c'était une petite vachère de la ferme de Lorchen. Montrant la valise, il dit:
—C'est à moi, n'est-ce pas?
La petite ne bougea pas, et répondit d'un air nigaud:
—Savoir. D'où que vous venez, d'abord?
—De Buir.
—Et qui qui vous l'envoie?
—Lorchen. Allons, donne!
La gamine tendit la valise:
—La v'là!
Et elle ajouta:
—Oh! je vous ai bien reconnu tout de suite!
—Alors, qu'est-ce que tu attendais?
—J'attendais que vous me disiez que c'était vous.
—Et Lorchen? demandait Christophe. Pourquoi n'est-elle pas venue?
La petite ne répondait pas. Christophe comprit qu'elle ne voulait rien dire, au milieu de cette foule. Ils durent passer d'abord à la visite des bagages. Quand ce fut fini, Christophe entraîna la fillette à l'extrémité du quai:
—La police est venue, raconta la gamine, à présent très loquace. Ils sont arrivés presque tout de suite après votre départ. Ils sont entrés dans les maisons, ils ont interrogé tout le monde, ils ont arrêté le grand Sami, et Christian, et le père Kaspar. Et aussi, Mélanie et Gertrude, bien qu'elles criaient qu'elles n'avaient rien fait; et elles pleuraient; et Gertrude a griffé les gendarmes. On avait beau leur dire que c'était vous qui aviez tout fait.
—Comment, moi! s'exclama Christophe.
—Bien oui, fit la petite tranquillement, ça ne faisait rien, n'est-ce pas, puisque vous étiez parti? Alors, ils vous ont cherché partout, et on a envoyé après vous, de tous les côtés.
—Et Lorchen?
—Lorchen n'était pas là. Elle est revenue plus tard, après avoir été en ville.
—Est-ce qu'elle a vu ma mère?
—Oui. Voilà la lettre. Et elle voulait venir; mais on l'a arrêtée aussi.
—Alors, comment as-tu pu?
—Voilà: elle est rentrée au village, sans que la police l'ait vue; et elle allait repartir. Mais Irmina, la sœur de Gertrude, l'a dénoncée. On est venu pour la prendre. Alors, quand elle a vu venir les gendarmes, elle est montée dans sa chambre, et elle leur a crié qu'elle descendait tout de suite, qu'elle s'habillait. Moi, j'étais dans la vigne, derrière la maison; elle m'a appelée tout bas par la fenêtre: «Lydia! Lydia!» Je suis venue; elle m'a passé votre valise et la lettre que votre mère lui avait données; et elle m'a expliqué où je vous trouverais; elle m'a dit de courir et de ne pas me laisser prendre. J'ai couru, et me voilà.
—Elle n'a rien dit de plus?
—Si. Elle m'a dit de vous remettre aussi ce fichu, pour vous montrer que je venais de sa part.
Christophe reconnut le fichu blanc, à pois rouges et fleurs brodées, que Lorchen, en le quittant, la veille, avait noué autour de sa tête. L'invraisemblance naïve du prétexte, dont elle s'était servie pour lui envoyer ce souvenir amoureux, ne le fit pas sourire.
—Maintenant, fit la petite, voilà l'autre train qui remonte. Il faut que je rentre chez nous. Bonsoir.
—Attends donc, dit Christophe. Et l'argent pour venir, comment as-tu fait?
—Lorchen me l'a donné.
—Prends tout de même, dit Christophe, lui mettant quelques pièces dans la main.
Il retint par le bras la petite qui voulait se sauver.
—Et puis,... fit-il.
Il se pencha, et l'embrassa sur les deux joues. La fillette faisait mine de protester.
—Ne te défends donc pas, dit Christophe. Ce n'est pas pour toi.
—Oh! je sais bien, fit la gamine, railleuse, c'est pour Lorchen.
Ce n'était pas seulement Lorchen, que Christophe embrassait sur les joues rebondies de la petite vachère: c'était toute son Allemagne.
La petite s'échappa, et courut vers le train qui partait. Elle resta à la portière et lui fit des signaux avec son mouchoir, jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus. Il suivit des yeux la rustique messagère, qui venait de lui apporter, pour la dernière fois, le souffle de son pays et de ceux qu'il aimait.
Quand elle eut disparu, il se trouva tout à fait seul, cette fois, étranger sur une terre étrangère. Il tenait à la main la lettre de sa mère et le fichu amoureux. Il serra celui-ci sur sa poitrine, et il voulut ouvrir la lettre; mais sa main tremblait. Qu'allait-il lire? Quelle souffrance allait-il trouver? ... Non, il ne supporterait pas le reproche douloureux, qu'il croyait déjà entendre: il reviendrait sur ses pas.
Il déplia enfin la lettre et lut:
«Mon pauvre enfant, ne te tourmente pas de moi. Je serai sage. Le bon Dieu m'a punie. Je ne devais pas être égoïste et te garder ici. Va à Paris. Peut-être que ce sera mieux pour toi. Ne t'occupe pas de moi. Je sais me tirer d'affaire. L'essentiel, c'est que tu sois heureux. Je t'embrasse.
Maman.
«Écris-moi, quand tu pourras.»
Christophe s'assit sur sa valise, et pleura.
Le portier de la gare appelait les voyageurs pour Paris. Le train pesant arrivait avec fracas. Christophe essuya ses larmes, se leva, et se dit:
—Il le faut.
Il regarda le ciel, du côté où devait se trouver Paris. Le ciel, sombre partout, était plus sombre là. C'était comme un gouffre d'ombre. Christophe eut le cœur serré; mais il se répéta:
—Il le faut.
Il monta dans le train, et, penché à la fenêtre, il continuait de regarder l'horizon menaçant:
—Ô Paris! pensait-il, Paris! Viens à mon secours! Sauve-moi! Sauve mes pensées!
L'obscur brouillard s'épaississait. Derrière Christophe, au-dessus du pays qu'il quittait, un petit coin de ciel, bleu pâle, large comme deux yeux,—comme les yeux de Sabine,—sourit tristement au milieu des voiles lourds des nuées, et s'éteignit. Le train partit. La pluie tomba.—La nuit tomba.
MOI
Décidément, c'est une gageure, Christophe? Tu as entrepris de me brouiller avec le monde entier?
CHRISTOPHE
Ne fais donc pas l'étonné. Dès le premier instant, tu savais où je te menais.
MOI
Tu critiques trop de choses. Tu irrites tes ennemis, et tu troubles tes amis. Quand quelque chose va mal dans une maison convenable, ne sais-tu pas qu'il est de bon goût de ne pas en parler?
CHRISTOPHE
Qu'y faire? Je n'ai point de goût.
MOI
Je le sais: tu es un Huron. Maladroit! Ils te feront passer pour l'ennemi de tout le monde. Déjà, en Allemagne, tu t'es acquis la réputation d'être un anti-Allemand. Tu te feras, en France, celle d'être un anti-Français, ou—ce qui est plus grave—d'être un antisémite. Prends garde. Ne parle point des Juifs...
Ils t'ont fait trop de bien pour en dire du mal....
CHRISTOPHE
Pourquoi n'en dirais-je pas tout le bien et tout le mal que j'en pense?
MOI
Tu en dis surtout le mal.
CHRISTOPHE
Le bien viendra ensuite. Faut-il les ménager plus que les chrétiens? Si je leur fais bonne mesure, c'est qu'ils en valent la peine. Je leur dois une place d'honneur, puisqu'ils l'ont prise à la tête de notre Occident, où la lumière s'éteint. Certains d'entre eux menacent de mort notre civilisation. Mais je n'ignore pas que d'autres, parmi eux, sont une de nos richesses d'action et de pensée. Je sais ce qu'il y a encore de grandeur dans leur race. Je sais toutes les puissances de dévouement, tout le désintéressement orgueilleux, tout l'amour et le désir du mieux, l'énergie inlassable, le travail opiniâtre et obscur de milliers d'entre eux. Je sais qu'il y a en eux un Dieu. Et c'est pour cela que j'en veux à ceux qui l'ont renié, à ceux qui, pour un succès dégradant et pour un vil bonheur, trahissent les destinées de leur peuple. Les combattre, c'est prendre le parti de leur peuple contre eux, de même qu'en attaquant les Français corrompus, c'est la France que je défends.
MOI
Mon garçon, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Souviens-toi de la femme de Sganarelle, qui veut être rossée. «Entre l'arbre et le doigt...» Les affaires d'Israël ne sont pas les nôtres. Et quant à celles de la France, la France est comme Martine, elle consent à être battue; mais elle n'admet point qu'on lui dise qu'elle l'est.
CHRISTOPHE
Il faut pourtant lui dire la vérité, et d'autant plus qu'on l'aime. Qui la dira, si ce n'est moi?—Ce ne sera pas toi. Vous êtes tous liés entre vous par des relations de société, des égards y des scrupules. Moi, je n'ai pas de liens, je ne suis pas de votre monde. Je n'ai jamais fait partie d'aucune de vos coteries, d'aucune de vos querelles. Je ne suis pas forcé de faire chorus avec vous, ou d'être complice de votre silence.
MOI
Tu es un étranger.
CHRISTOPHE
Oui, l'on dira, n'est-ce pas? qu'un musicien allemand n'a pas le droit de vous juger et ne saurait vous comprendre?—Bon, je me trompe peut-être. Mais du moins, je vous dirai ce que pensent de vous certains grands étrangers, que tu connais comme moi,—des plus grands parmi nos amis morts, et parmi les vivants.—S'ils se trompent, leurs pensées valent pourtant la peine d'être connues; et elles peuvent vous servir. Cela vaudra toujours mieux pour vous que de vous persuader, comme vous le faites, que tout le monde vous admire, et de vous admirer vous-mêmes,—ou de vous dénigrer,—alternativement. À quoi sert de crier, par accès périodiques, comme c'est la mode chez vous, que vous êtes le plus grand peuple du monde,—et puis, que la décadence des races latines est irrémédiable,—que toutes les grandes idées viennent de France,—et puis, que vous n'êtes plus bons qu'à amuser l'Europe? Il s'agit de ne pas vous fermer les yeux sur le mal qui vous ronge, et de ne pas être accablés, mais exaltés au contraire par le sentiment de la bataille à livrer pour la vie et l'honneur de votre race. Qui a senti l'âme chevillée au corps de cette race qui ne veut pas mourir, peut et doit hardiment mettre à nu ses vices et ses ridicules, afin de les combattre,—afin de combattre surtout ceux qui les exploitent et qui en vivent.
MOI
Ne touche pas à la France, même pour la défendre. Tu troubles les braves gens.
CHRISTOPHE
Les braves gens,—sans doute!—les braves gens, à qui cela fait de la peine qu'on ne trouve pas tout très bien, qu'on leur montre tant de choses tristes et laides! Eux-mêmes sont exploités; mais ils n'en veulent pas convenir. Ils ont tant de chagrin de constater le mal chez les autres qu'ils aiment encore mieux être victimes. Ils veulent qu'on leur répète, au moins une fois par jour, que tout est pour le mieux dans la meilleure des nations et que
«...tu resteras, ô France, la première...»
Après quoi, les braves gens rassurés se remettent à dormir,—et les autres à faire leurs affaires... Bonnes et excellentes gens! Je leur ai fait de la peine. Je leur en ferai bien davantage. Je leur demande pardon... Mais s'ils ne veulent pas qu'on les aide contre ceux qui les oppriment, qu'ils pensent que d'autres sont opprimés comme eux et n'ont pas leur résignation, ni leur puissance d'illusion,—d'autres, que cette résignation et cette puissance d'illusion livrent aux oppresseurs. Comme ils souffrent, ceux-là! Souviens-toi! Combien nous avons souffert! Et tant d'autres avec nous, quand nous voyions s'amasser, chaque jour, une atmosphère plus lourde, un art corrompu, une politique immorale et cynique, une pensée veule s'abandonnant au souffle du néant, avec un rire satisfait... Nous étions là, angoissés, nous serrant l'un contre l'autre... Ah! nous avons passé de dures années ensemble. Ils ne s'en doutent pas, nos maîtres, des affres où notre jeunesse s'est débattue sous leur ombre!... Nous avons résisté. Nous nous sommes sauvés... Et nous ne sauverions pas les autres! Nous les laisserions se traîner à leur tour dans les mêmes douleurs, sans leur tendre la main! Non, leur sort et le nôtre sont liés. Nous sommes des milliers d'hommes en France, qui pensons ce que je dis tout haut. J'ai conscience de parler pour eux. Bientôt, je parlerai d'eux. J'ai hâte de montrer la vraie France, la France opprimée, la France profonde;—juifs, chrétiens, âmes libres, de toute foi, de tout sang.—Mais pour arriver à elle, il faut d'abord faire une trouée à travers ceux qui gardent la porte de la maison. Puisse la belle captive secouer son apathie et renverser enfin les murs de sa prison! Elle ne connaît pas sa force et la médiocrité de ses adversaires.
MOI
Tu as raison, mon âme. Mais, quoi que tu fasses, prends garde de haïr.
CHRISTOPHE
Je n'ai aucune haine. Même quand je pense aux plus méchants des hommes, je sais bien qu'ils sont des hommes, qui souffrent comme nous, et qui mourront, un jour. Mais je dois les combattre.
MOI
Lutter, c'est faire le mal, même pour faire le bien. La peine qu'on risque de faire à un seul être vivant vaut-elle le bien qu'on se promet défaire à ces belles idoles: «l'art»—ou «l'humanité»?
CHRISTOPHE
Si tu penses ainsi, renonce à l'art, et renonce à moi-même.
MOI
Non, ne me laisse pas! Que deviendrais-je, sans toi?—Mais quand viendra la paix?
CHRISTOPHE
Quand tu l'auras gagnée. Bientôt... Bientôt... Regarde déjà passer au-dessus de nos têtes l'hirondelle du printemps.
MOI

CHRISTOPHE
Ne rêve point, donne-moi la main, viens.
MOI
Il faut bien que je te suive, mon ombre.
CHRISTOPHE
Lequel de nous deux est l'ombre de l'autre?
MOI
Comme tu as grandi! Je ne te reconnais plus.
CHRISTOPHE
C'est le soleil qui descend.
MOI
Je l'aimais mieux enfant.
CHRISTOPHE
Allons! nous n'avons plus que quelques heures de jour.
R. R.
Mars 1908.
Le désordre dans l'ordre. Des employés de chemin de fer débraillés et familiers. Des voyageurs qui protestaient contre le règlement, tout en s'y soumettant.—Christophe était en France.
Après avoir satisfait aux curiosités de la douane, il reprit le train pour Paris. La nuit couvrait les champs, trempés de pluie. Les lumières brutales des gares faisaient ressortir plus durement la tristesse de l'interminable plaine ensevelie dans l'ombre. Les trains que l'on croisait, de plus en plus nombreux, déchiraient l'air de leurs sifflets, qui secouaient la torpeur des voyageurs assoupis. On approchait de Paris.
Une heure avant l'arrivée, Christophe était prêt à descendre: il avait enfoncé son chapeau sur sa tête; il s'était boutonné jusqu'au cou, par crainte des voleurs, dont on lui avait dit que Paris était plein; il s'était levé et rassis vingt fois; il avait vingt fois déplacé sa valise, du filet à la banquette, et de la banquette au filet, pour l'agacement de ses voisins, qu'avec sa maladresse il heurtait, à chaque fois.
Au moment d'entrer en gare, le train s'arrêta en pleine nuit. Christophe s'écrasait la figure contre les vitres, et tâchait vainement de voir. Il se retournait vers ses compagnons de voyage, quêtant un regard qui lui permît d'engager la conversation, de demander où l'on était. Mais ils sommeillaient, ou ils faisaient semblant, l'air renfrognés et ennuyés; aucun ne faisait un mouvement pour s'expliquer l'arrêt. Christophe était surpris de cette inertie: ces êtres rogues et engourdis ressemblaient si peu aux Français qu'il imaginait! Il finit par s'asseoir, découragé, sur sa valise, culbutant à chaque cahot du train, et il s'assoupissait à son tour, quand il fut réveillé par le bruit des portières qu'on ouvrait... Paris!... Ses voisins descendaient.
Bousculant et bousculé, il se dirigea vers la sortie, repoussant les facteurs qui s'offraient à porter son bagage. Soupçonneux comme un paysan, il pensait que chacun voulait le voler. Il avait chargé sur son épaule sa précieuse valise, et il allait son chemin, sans se soucier des apostrophes des gens, au milieu desquels il se frayait un passage. Enfin il se trouva sur le pavé gluant de Paris.
Il était trop préoccupé de sa charge, du gîte qu'il allait choisir, et de l'embarras de voitures où il se trouvait pris, pour penser à rien regarder. La première chose était de se mettre en quête d'une chambre. Ce n'étaient pas les hôtels qui manquaient: ils bloquaient la gare, de tous côtés; leurs noms flamboyaient en lettres de gaz. Christophe chercha le moins brillant: aucun ne lui semblait assez humble pour sa bourse. Enfin, dans une rue latérale, il vit une sale auberge, avec une gargote au rez-de-chaussée. Elle s'intitulait Hôtel de la Civilisation. Un gros homme, en bras de chemise, fumait la pipe, à une table; il accourut, en voyant entrer Christophe. Il ne comprit rien à son jargon; mais il jugea du premier coup d'œil l'Allemand gauche et enfantin, qui refusait de laisser prendre son paquet et s'évertuait à lui faire un discours, en une langue invraisemblable. Il le conduisit par un escalier mal odorant à une pièce sans air, qui donnait sur une cour intérieure. Il ne manqua pas de vanter la tranquillité d'un lieu, où ne parvenait aucun des bruits du dehors; et il lui en demanda un bon prix. Christophe, comprenant mal, ignorant les conditions de la vie à Paris, l'épaule cassée par sa charge, accepta tout: il avait hâte d'être seul. Mais à peine fut-il seul que la saleté des choses le saisit; et pour ne pas s'abandonner à la tristesse qui montait en lui, il se hâta de ressortir, après s'être trempé la tête dans l'eau poussiéreuse, qui était grasse au toucher. Il s'efforçait de ne pas voir et de ne pas sentir, pour échapper au dégoût.
Il descendit dans la rue. Le brouillard d'octobre était épais et piquant; il avait cette odeur fade de Paris, où se mêlent les exhalaisons des usines de la banlieue et la lourde haleine de la ville. On ne voyait point à dix pas. La lueur des becs de gaz tremblait comme une bougie qui va s'éteindre. Dans les demi-ténèbres, une cohue de gens roulait en flots contraires. Les voitures se croisaient, se heurtaient, obstruant le passage, refoulant la circulation comme une digue. Les chevaux glissaient sur la boue glacée. Les injures des cochers, les trompes et les cloches des tramways faisaient un vacarme assourdissant. Ce bruit, ce grouillement, cette odeur saisirent Christophe. Il s'arrêta un instant, fut aussitôt poussé par ceux qui marchaient derrière lui, emporté par le courant. Il descendit le boulevard de Strasbourg, ne voyant rien, se jetant gauchement contre les passants. Il n'avait pas mangé depuis le matin. Les cafés qu'il rencontrait à chaque pas l'intimidaient et le dégoûtaient, à cause de la foule qui y était entassée. Il s'adressa à un sergent de ville. Mais il était si lent à trouver ses mots que l'autre ne se donna même pas la peine de l'écouter jusqu'au bout, et lui tourna le dos, au milieu de la phrase, en haussant les épaules. Il continua machinalement à marcher. Des gens étaient arrêtés devant une boutique. Il s'arrêta machinalement comme eux. C'était un magasin de photographies et de cartes postales: elles représentaient des filles en chemise, ou sans chemise; des journaux illustrés étalaient des plaisanteries obscènes. Des enfants, de jeunes femmes regardaient tranquillement. Une fille maigre aux cheveux rouges, voyant Christophe absorbé dans sa contemplation, lui fit des offres. Il la regarda sans comprendre. Elle lui prit le bras, avec un sourire stupide. Il secoua son étreinte, et s'éloigna, rougissant de colère. Les cafés-concerts se succédaient; à la porte, des affiches de cabotins grotesques paradaient. La foule était toujours plus dense; Christophe était frappé du nombre de figures vicieuses, de louches rôdeurs, de gueux avilis, de filles plâtrées aux odeurs écœurantes. Il se sentait glacé. La fatigue, la faiblesse, et l'horrible dégoût qui l'étreignait de plus en plus lui donnaient le vertige. Il serra les dents et marcha plus vite. Le brouillard augmentait, à mesure qu'on approchait de la Seine. La cohue des voitures devint inextricable. Un cheval glissa et tomba sur le flanc; le cocher le roua de coups pour le faire relever; la malheureuse bête, étranglée par ses sangles, s'agitait et retombait lamentablement, immobile, comme morte. Ce spectacle banal fut pour Christophe la goutte d'eau qui fait déborder l'âme. Les convulsions de cet être misérable sous les regards indifférents lui firent sentir avec une telle angoisse son propre néant parmi ces milliers d'êtres,—la répulsion que depuis une heure il s'efforçait d'étouffer pour ce bétail humain, pour cette atmosphère souillée, pour ce monde moral ennemi, fit irruption avec une telle violence qu'il suffoqua. Il eut une crise de sanglots. Les passants regardaient, étonnés, ce grand garçon au visage convulsé de douleur. Il marchait, les larmes ruisselant le long de ses joues, sans chercher à les essuyer. On s'arrêtait pour le suivre des yeux, un instant; et, s'il eût été capable de lire dans l'âme de cette foule qui lui semblait hostile, peut-être aurait-il pu voir chez quelques-uns,—mêlée sans doute à un peu d'ironie parisienne—une compassion fraternelle. Mais il ne voyait plus rien: ses pleurs l'aveuglaient.
Il se trouva sur une place, près d'une grande fontaine. Il y baigna ses mains, il y plongea sa figure. Un petit marchand de journaux le regardait faire curieusement, avec des réflexions gouailleuses, mais sans méchanceté; et il lui ramassa son chapeau, que Christophe avait laissé tomber. Le froid glacial de l'eau ranima Christophe. Il se ressaisit. Il revint sur ses pas, évitant de regarder; il ne pensait même plus à manger: il lui eût été impossible de parler à qui que ce fût; un rien eût suffi pour rouvrir la source des larmes. Il était épuisé. Il se trompa de chemin, erra au hasard, se retrouva devant sa maison, au moment où il se croyait définitivement perdu:—il avait oublié jusqu'au nom de la rue où il habitait.
Il rentra dans son infâme logis. À jeun, les yeux brûlants, le cœur et le corps courbaturés, il s'affaissa sur une chaise, dans un coin de sa chambre; il y resta deux heures, incapable de bouger. Enfin il s'arracha à cette apathie, et il se coucha. Il tomba dans une torpeur fiévreuse, d'où il s'éveillait à chaque minute, avec l'illusion d'avoir dormi des heures. La chambre était étouffante; il brûlait des pieds à la tête; il avait une soif horrible; il était en proie à des cauchemars stupides, qui continuaient de s'accrocher à lui, même quand il avait les yeux ouverts; des angoisses aiguës le pénétraient comme des coups de couteau. Au milieu de la nuit, il s'éveilla, pris d'un désespoir si atroce qu'il en aurait hurlé; il s'enfonça les draps dans la bouche, pour qu'on ne l'entendît pas: il se sentait devenir fou. Il s'assit sur son lit, et il alluma. Il était trempé de sueur. Il se leva, il ouvrit sa valise, pour y chercher un mouchoir. Il mit la main sur une vieille Bible, que sa mère avait cachée au milieu de son linge. Christophe n'avait jamais beaucoup lu ce livre; mais ce lui fut un bien inexprimable de le trouver, en cet instant. Cette Bible avait appartenu au grand-père, et au père du grand-père. Les chefs de la famille y avaient inscrit, sur une feuille blanche à la fin, leurs noms et les dates importantes de leur vie: naissances, mariages, morts. Le grand-père avait marqué au crayon, de sa grosse écriture, les dates des jours où il avait lu et relu chaque chapitre; le livre était rempli de bouts de papier jauni, où le vieux avait noté ses naïves réflexions. Cette Bible était placée sur une planche, au-dessus de son lit; il la prenait pendant ses longues insomnies, conversant avec elle, plutôt qu'il ne la lisait. Elle lui avait tenu compagnie jusqu'à l'heure de la mort, comme elle avait tenu déjà compagnie à son père. Un siècle des deuils et des joies de la famille se dégageait de ce livre. Christophe se sentit moins seul, avec lui.
Il l'ouvrit aux plus sombres passages:
La vie de l'homme sur la terre est une guerre continuelle, et ses jours sont comme les jours d'un mercenaire...
Si je me couche, je dis: Quand me lèverai-je? Et, étant levé, j'attends le soir avec impatience, et je suis rempli de douleur jusqu'à la nuit...
Quand je dis: Mon lit me consolera, le repos assoupira ma plainte, alors tu m'épouvantes par des songes, et tu me troubles par des visions...
Jusqu'à quand ne m'épargneras-tu point? Ne me donneras-tu point quelque relâche, pour que je puisse respirer? Ai-je péché? Que t'ai-je fait, ô gardien des hommes?...
Tout revient au même: Dieu afflige le juste aussi bien que le méchant...
Qu'Il me tue! Je ne laisserai pas d'espérer en Lui...
Les cœurs vulgaires ne peuvent comprendre le bienfait, pour un malheureux, de cette tristesse sans bornes. Toute grandeur est bonne, et le comble de la douleur atteint à la délivrance. Ce qui abat, ce qui accable, ce qui détruit irrémédiablement l'âme, c'est la médiocrité de la douleur et de la joie, la souffrance égoïste et mesquine, sans force pour se détacher du plaisir perdu, et prête secrètement à tous les avilissements pour un plaisir nouveau. Christophe était ranimé par l'âpre souffle qui montait du vieux livre: le vent du Sinaï, des vastes solitudes et de la mer puissante, balayait les miasmes. La fièvre de Christophe tomba. Il se recoucha, plus calme, et il dormit d'un trait jusqu'au lendemain. Quand il rouvrit les yeux, le jour était venu. Il vit plus nettement encore l'ignominie de sa chambre; il sentit sa misère et son isolement; mais il les regarda en face. Le découragement était parti; il ne lui restait plus qu'une virile mélancolie. Il redit la parole de Job:
Quand Dieu me tuerait, je ne laisserais pas d'espérer en Lui...
Il se leva, et commença le combat, avec tranquillité.
Il décida, le matin même, de faire les premières démarches. Il connaissait deux seules personnes à Paris, deux jeunes gens de son pays: son ancien ami, Otto Diener, qui était associé à un oncle, marchand de draps, dans le quartier du Mail; et un petit juif de Mayence, Sylvain Kohn, qui devait être employé dans une grande maison de librairie, dont il n'avait pas l'adresse.
Il avait été très intime avec Diener, vers quatorze ou quinze ans[3]. Il avait eu pour lui une de ces amitiés d'enfance, qui devancent l'amour, et qui sont déjà de l'amour. Diener aussi l'avait aimé. Ce gros garçon timide et compassé avait été séduit par la fougueuse indépendance de Christophe; il s'était évertué à l'imiter, d'une façon ridicule: ce qui irritait Christophe et le flattait. Alors ils faisaient des projets qui bouleversaient le monde. Puis Diener avait voyagé, pour son éducation commerciale, et ils ne s'étaient plus revus; mais Christophe avait de ses nouvelles par les gens du pays, avec qui Diener était resté en relations régulières.
Quant à Sylvain Kohn, ses rapports avec Christophe avaient eu un autre caractère. Ils s'étaient connus, tout gamins, à l'école, où le petit singe avait joué des tours à Christophe, qui l'étrillait en échange, quand il voyait le piège où il était tombé. Kohn ne se défendait pas; il se laissait rouler, et frotter la figure dans la poussière, en pleurnichant; mais il recommençait aussitôt après, avec une malice inlassable,—jusqu'au jour où il prit peur, Christophe l'ayant menacé sérieusement de le tuer.
Christophe sortit de bonne heure. Il s'arrêta en route, pour déjeuner à un café. Il s'obligeait, malgré son amour-propre, à ne perdre aucune occasion de parler en français. Puisqu'il devait vivre à Paris, peut-être des années, il lui fallait s'adapter le plus vite possible aux conditions de la vie, et vaincre ses répugnances. Il s'imposa donc de ne pas prendre garde, bien qu'il en souffrît cruellement, à l'air goguenard du garçon, qui écoutait son charabia; et sans se décourager, il bâtissait pesamment des phrases informes, qu'il répétait avec ténacité, jusqu'à ce qu'il fût compris.
Il se mit à la recherche de Diener. Suivant son habitude, quand il avait une idée en tête, il ne voyait rien autour de lui. Paris lui faisait, dans cette première promenade, l'impression d'une ville vieille et mal tenue. Christophe était habitué à ses villes du nouvel Empire allemand, à la fois très vieilles et très jeunes, où l'on sent monter l'orgueil d'une force nouvelle: et il était désagréablement surpris par les rues éventrées, les chaussées boueuses, la bousculade des gens, le désordre des voitures,—des véhicules de toute sorte, de toute forme: de vénérables omnibus à chevaux, des tramways à vapeur, à électricité, et de tous les systèmes,—des baraques sur les trottoirs, des manèges de chevaux de bois (ou plutôt de monstres, de gargouilles), sur les places encombrées de statues en redingote: je ne sais quelle pouillasserie de ville du moyen âge, initiée aux bienfaits du suffrage universel, mais qui ne peut se défaire de son vieux fond truand. Le brouillard de la veille s'était changé en une petite pluie pénétrante. Dans beaucoup de boutiques, le gaz était allumé, bien qu'il fût plus de dix heures.
Christophe arriva, non sans avoir erré dans le dédale de rues qui avoisinent la place des Victoires, au magasin qu'il cherchait, rue de la Banque. En entrant, il crut voir, au fond de la boutique longue et obscure, Diener occupé à ranger des ballots, au milieu d'employés. Mais il était un peu myope et se défiait de ses yeux, bien que leur intuition le trompât rarement. Il y eut un remue-ménage parmi les gens du fond, quand Christophe eut dit son nom au commis qui le recevait; et, après un conciliabule, un jeune homme se détacha du groupe, et dit en allemand:
—Monsieur Diener est sorti.
—Sorti? Pour longtemps?
—Je crois. Il vient de sortir.
Christophe réfléchit un instant; puis il dit:
—Très bien. J'attendrai.
L'employé, surpris, se hâta d'ajouter:
—C'est qu'il ne rentrera peut-être pas avant deux ou trois heures.
—Oh! cela ne fait rien, répondit Christophe avec placidité. Je n'ai rien à faire à Paris. Je puis attendre, tout le jour, s'il le faut.
Le jeune homme le regarda avec stupéfaction, croyant qu'il plaisantait. Mais Christophe ne songeait déjà plus à lui. Il s'était assis tranquillement dans un coin, le dos tourné à la rue; et il semblait prêt à y camper.
Le commis retourna au fond du magasin, et chuchota avec ses collègues; ils cherchaient, avec une consternation comique, un moyen de se débarrasser de l'importun.
Après quelques minutes d'incertitude, la porte du bureau s'ouvrit. Monsieur Diener parut. Il avait une large figure rouge, balafrée sur la joue et le menton d'une cicatrice violette, la moustache blonde, les cheveux aplatis, avec une raie sur le côté, un lorgnon d'or, des boutons d'or à son plastron de chemise, et des bagues à ses gros doigts. Il tenait son chapeau et son parapluie. Il vint à Christophe, d'un air dégagé. Christophe, qui rêvassait sur sa chaise, eut un sursaut d'étonnement. Il saisit les mains de Diener, et s'exclama, avec une cordialité bruyante, qui fit rire sous cape les employés et rougir Diener. Le majestueux personnage avait ses raisons pour ne pas vouloir reprendre avec Christophe ses relations d'autrefois; et il s'était promis de le tenir à distance, dès le premier abord, par ses manières imposantes. Mais à peine retrouvait-il le regard de Christophe, qu'il se sentait de nouveau un petit garçon en sa présence; il en était furieux et honteux. Il bredouilla précipitamment:
—Dans mon cabinet... Nous serons mieux pour causer.
Christophe reconnut sa prudence habituelle.
Mais, dans le cabinet, dont la porte fut soigneusement refermée, Diener ne s'empressait pas de lui offrir une chaise. Il restait debout, expliquant, avec une lourde maladresse:
—Bien content... J'allais sortir... On croyait que j'étais sorti... Mais il faut que je sorte... Je n'ai qu'une minute... Un rendez-vous urgent...
Christophe comprit que l'employé lui avait menti tout à l'heure, et que le mensonge était convenu avec Diener, pour le mettre à la porte. Le sang lui monta à la tête; mais il se contint, et dit sèchement:
—Rien ne presse.
Diener en eut un haut-le-corps. Il était révolté d'un tel sans-gêne.
—Comment! rien ne presse! dit-il. Une affaire...
Christophe le regarda en face:
—Non.
Le gros garçon baissa les yeux. Il haïssait Christophe, de se sentir si lâche devant lui. Il balbutia avec dépit. Christophe l'interrompit:
—Voici, dit-il. Tu sais...
(Ce tutoiement blessait Diener, qui s'était vainement efforcé, dès les premiers mots, d'établir entre Christophe et lui la barrière du: vous.)
—... Tu sais pourquoi je suis ici?
—Oui, je sais, dit Diener.
(Il avait été informé par ses correspondants de l'algarade de Christophe, et des poursuites dirigées contre lui.)
—Alors, reprit Christophe, tu sais que je ne suis pas ici pour mon plaisir. J'ai dû fuir. Je n'ai rien. Il faut que je vive.
Diener attendait la demande. Il la reçut, avec un mélange de satisfaction—(car elle lui permettait de reprendre sa supériorité sur Christophe)—et de gêne—(car il n'osait pas lui faire sentir cette supériorité, comme il l'eût voulu.)
—Ah! fit-il avec importance, c'est bien fâcheux, bien fâcheux. La vie est difficile ici. Tout est cher. Nous avons des frais énormes. Et tous ces employés...
Christophe l'interrompit avec mépris:
—Je ne te demande pas d'argent.
Diener fut décontenancé. Christophe continua:
—Tes affaires vont bien? Tu as une belle clientèle?
—Oui, oui, pas mal, Dieu merci... dit prudemment Diener. (Il se méfiait.)
Christophe lui lança un regard furieux, et reprit:
—Tu connais beaucoup de monde dans la colonie allemande?
—Oui.
—Eh bien, parle de moi. Ils doivent être musiciens. Ils ont des enfants. Je donnerai des leçons.
Diener prit un air embarrassé.
—Qu'est-ce encore? fit Christophe. Est-ce que tu doutes par hasard que j'en sache assez pour un pareil métier?
Il demandait un service, comme si c'était lui qui le rendait. Diener, qui n'eût jamais rien fait pour Christophe que pour avoir le plaisir de le sentir son obligé, était bien résolu à ne pas remuer un doigt pour lui.
—Tu en sais mille fois plus qu'il n'en faut... Seulement...
—Eh bien?
—Eh bien, c'est difficile, très difficile, vois-tu, à cause de ta situation.
—Ma situation?
—Oui... Enfin, cette affaire, ce procès... Si cela venait à se savoir... C'est difficile pour moi. Cela peut me faire beaucoup de tort.
Il s'arrêta, voyant le visage de Christophe se décomposer de colère; et il se hâta d'ajouter:
—Ce n'est pas pour moi... Je n'ai pas peur... Ah! si j'étais seul!... C'est mon oncle... Tu sais, la maison est à lui, je ne peux rien sans lui...
De plus en plus effrayé par la figure de Christophe et par l'explosion qui se préparait, il dit précipitamment—(il n'était pas mauvais an fond; l'avarice et la vanité luttaient en lui: il eût voulu obliger Christophe, mais à bon compte):
—Veux-tu cinquante francs?
Christophe devint cramoisi. Il marcha vers Diener, d'une telle façon que celui-ci recula en toute hâte jusqu'à la porte, qu'il ouvrit, prêt à appeler. Mais Christophe se contenta d'approcher de lui sa tête congestionnée:
—Cochon! dit-il, d'une voix retentissante.
Il le repoussa du chemin, et sortit, au milieu des employés. Sur le seuil, il cracha de dégoût.
Il marchait à grands pas dans la rue. Il était ivre de colère. La pluie le dégrisa. Où allait-il? Il ne savait. Il ne connaissait personne. Il s'arrêta, pour réfléchir, devant une librairie, et il regardait, sans voir, les livres à l'étalage. Sur une couverture, un nom d'éditeur le frappa. Il se demanda pourquoi. Il se rappela, après un instant, que c'était le nom de la maison où était employé Sylvain Kohn. Il prit note de l'adresse... Que lui importait? Il n'irait certainement pas... Pourquoi n'irait-il pas?... Si ce gueux de Diener, qui avait été son ami, le recevait ainsi, qu'avait-il à attendre d'un drôle qu'il avait traité sans ménagement et qui devait le haïr? D'inutiles humiliations? Son sang se révoltait.—Mais un fond de pessimisme natif, qui lui venait peut-être de son éducation chrétienne, le poussait à éprouver jusqu'au bout la vilenie des gens.
—Je n'ai pas le droit de faire des façons. Il faut avoir tout tenté, avant de crever.
Une voix ajoutait en lui:
—Et je ne crèverai pas.
Il s'assura de nouveau de l'adresse, et il alla chez Kohn. Il était décidé à lui casser la figure, à la première impertinence.
La maison d'édition se trouvait dans le quartier de la Madeleine. Christophe monta à un salon du premier étage, et demanda Sylvain Kohn. Un employé à livrée lui répondit «qu'il ne connaissait pas». Christophe, étonné, crut qu'il prononçait mal, et il répéta sa question; mais l'employé, après avoir écouté attentivement, affirma qu'il n'y avait personne de ce nom dans la maison. Tout décontenancé, Christophe s'excusait, et il allait sortir, quand au fond d'un corridor une porte s'ouvrit; et il vit Kohn lui-même, qui reconduisait une dame. Sous le coup de l'affront qu'il venait de subir de Diener, il était disposé à croire en ce moment que tout le monde se moquait de lui. Sa première pensée fut donc que Kohn l'avait vu venir, et qu'il avait donné l'ordre au garçon de dire qu'il n'était pas là. Une telle impudence le suffoqua. Il partait, indigné, lorsqu'il s'entendit appeler. Kohn, de ses yeux perçants, l'avait reconnu de loin; et il courait à lui, le sourire aux lèvres, les mains tendues, avec toutes les marques d'une joie exagérée.
Sylvain Kohn était petit, trapu, la face entièrement rasée, à l'américaine, le teint trop rouge, les cheveux trop noirs, une figure large et massive, aux traits gras, les yeux petits, plissés, fureteurs, la bouche un peu de travers, un sourire lourd et malin. Il était mis avec une élégance, qui cherchait à dissimuler les défectuosités de sa taille, ses épaules hautes et la largeur de ses hanches. C'était là l'unique chose qui chagrinât son amour-propre; il eût accepté de bon cœur quelques coups de pied au derrière pour avoir deux ou trois pouces de plus et la taille mieux prise. Pour le reste, il était fort satisfait de lui; il se croyait irrésistible. Le plus fort est qu'il l'était. Ce petit juif allemand, ce lourdaud, s'était fait le chroniqueur et l'arbitre des élégances parisiennes. Il écrivait de fades courriers mondains, d'un raffinement compliqué. Il était le champion du beau style français, de l'élégance française, de la galanterie française, de l'esprit français,—Régence, talon rouge, Lauzun. On se moquait de lui; mais cela ne l'empêchait point de réussir. Ceux qui disent que le ridicule tue à Paris ne connaissent point Paris: bien loin d'en mourir, il y a des gens qui en vivent; à Paris, le ridicule mène à tout, même à la gloire, même aux bonnes fortunes. Sylvain Kohn n'en était plus à compter les déclarations que lui valaient, chaque jour, ses marivaudages francfortois.
Il parlait, avec un accent lourd et une voix de tête.
—Ah! voilà une surprise! criait-il gaiement, en secouant la main de Christophe dans ses mains boudinées, aux doigts courts, qui semblaient tassés dans une peau trop étroite. Il ne pouvait se décider à lâcher Christophe. On eût dit qu'il retrouvait son meilleur ami. Christophe, interloqué, se demandait si Kohn se moquait de lui. Mais Kohn ne se moquait pas. Ou bien, s'il se moquait, ce n'était pas plus qu'à l'ordinaire. Kohn n'avait pas de rancune: il était trop intelligent pour cela. Il y avait beau temps qu'il avait oublié les mauvais traitements de Christophe; et, s'il s'en était souvenu, il ne s'en fût guère soucié. Il était ravi de cette occasion de se faire voir à un ancien camarade, dans l'importance de ses fonctions nouvelles et l'élégance de ses manières parisiennes. Il ne mentait pas, en disant sa surprise: la dernière chose du monde à laquelle il se fût attendu était bien une visite de Christophe; et s'il était trop avisé pour ne pas savoir d'avance qu'elle avait un but intéressé, il était des mieux disposés à l'accueillir, par ce seul fait qu'elle était un hommage rendu à son pouvoir.
—Et vous venez du pays? Comment va la maman? demandait-il, avec une familiarité qui, en un autre jour, eût choqué Christophe, mais qui lui faisait du bien, maintenant, dans cette ville étrangère.
—Mais comment se fait-il, demanda Christophe, encore un peu soupçonneux, qu'on m'ait répondu tout à l'heure que Monsieur Kohn n'était pas là?
—Monsieur Kohn n'est pas là, dit Sylvain Kohn, en riant. Je ne me nomme plus Kohn. Je m'appelle Hamilton.
Il s'interrompit.
—Pardon, fit-il.
Il alla serrer la main à une dame qui passait, et grimaça des sourires. Puis il revint. Il expliqua que c'était une femme de lettres, célèbre par des romans d'une volupté brûlante. La moderne Sapho avait une décoration violette à son corsage, des formes plantureuses, et des cheveux blond ardent sur une figure réjouie et plâtrée; elle disait des choses prétentieuses, d'une voix mâle, qui avait un accent franc-comtois.
Kohn se remit à questionner Christophe. Il s'informait de tous les gens du pays, demandait ce qu'était devenu celui-ci, celui-là, mettant une coquetterie à montrer qu'il se souvenait de tous. Christophe avait oublié son antipathie; il répondait, avec une cordialité reconnaissante, donnant une foule de détails, qui étaient absolument indifférents à Kohn, et qu'il interrompit de nouveau.
—Pardon, fit-il encore.
Et il alla saluer une autre visiteuse.
—Ah! ça, demanda Christophe, il n'y a donc que les femmes qui écrivent en France?
Kohn se mit à rire, et dit avec fatuité:
—La France est femme, mon cher. Si vous voulez arriver, faites-en votre profit.
Christophe n'écouta point l'explication, et continua les siennes. Kohn, pour y mettre fin, demanda:
—Mais comment diable êtes-vous ici?
Voilà! pensa Christophe. Il ne savait rien. C'est pourquoi il était si aimable. Tout va changer, quand il saura.
Il mit un point d'honneur à conter tout ce qui pouvait le compromettre: la rixe avec les soldats, les poursuites contre lui, sa fuite du pays.
Kohn se tordit de rire:
—Bravo! criait-il, bravo! Ah! la bonne histoire!
Il lui serra la main chaleureusement. Il était enchanté de tout pied de nez à l'autorité; et celui-ci l'amusait d'autant plus qu'il connaissait les héros de l'histoire: le côté comique lui en apparaissait.
—Écoutez, continua-t-il. Il est midi passé. Faites-moi le plaisir... Déjeunez avec moi.
Christophe accepta avec reconnaissance. Il pensait:
—C'est un brave homme, décidément. Je me suis trompé.
Ils sortirent ensemble. Chemin faisant, Christophe hasarda sa requête:
—Vous voyez maintenant quelle est ma situation. Je suis venu ici chercher du travail, des leçons de musique, en attendant que je me sois fait connaître. Pourriez-vous me recommander?
—Comment donc! fit Kohn. À qui vous voudrez. Je connais tout le monde ici. Tout à votre service.
Il était heureux de faire montre de son crédit.
Christophe se confondait en remerciements. Il se sentait le cœur déchargé d'un grand poids.
À table, il dévora, de l'appétit d'un homme qui ne s'était pas repu depuis deux jours. Il s'était noué sa serviette autour du cou, et mangeait avec son couteau. Kohn-Hamilton était horriblement choqué par sa voracité et ses manières paysannes. Il ne fut pas moins blessé du peu d'attention que son convive prêtait à ses vantardises. Il voulait l'éblouir par le récit de ses belles relations et de ses bonnes fortunes; mais c'était peine perdue: Christophe n'écoutait pas, il interrompait sans façons. Sa langue se déliait; il devenait familier. Il avait le cœur gonflé de gratitude, et il assommait Kohn, en lui confiant naïvement ses projets d'avenir. Surtout, il l'exaspérait par son insistance à lui prendre la main par-dessus la table et à la presser avec effusion. Et il mit le comble à son irritation, en voulant à la fin trinquer, à la mode allemande, et boire, avec des paroles sentimentales, à ceux qui étaient là-bas et au Vater Rhein. Kohn vit, avec épouvante, le moment où il allait chanter. Les voisins de table les regardaient ironiquement. Kohn prétexta des occupations urgentes, et se leva. Christophe s'accrochait à lui; il voulait savoir quand il pourrait avoir une recommandation, se présenter chez quelqu'un, commencer ses leçons.
—Je vais m'en occuper. Aujourd'hui. Ce soir même, promettait Kohn. J'en parlerai tout à l'heure. Vous pouvez être tranquille.
Christophe insistait.
—Quand saurai-je?
—Demain... Demain... ou après-demain.
—Très bien. Je reviendrai demain.
—Non, non, se hâta de dire Kohn. Je vous le ferai savoir. Ne vous dérangez pas.
—Oh! cela ne me dérange pas. Au contraire! N'est-ce pas? Je n'ai rien d'autre à faire à Paris, en attendant.
—Diable! pensa Kohn... Non, reprit-il tout haut, j'aime mieux vous écrire. Vous ne me trouveriez pas, ces jours-ci. Donnez-moi votre adresse.
Christophe la lui dicta.
—Parfait. Je vous écrirai demain.
—Demain?
—Demain. Vous pouvez y compter.
Il se dégagea des poignées de main de Christophe, et il se sauva.
—Ouf! pensait-il. Voilà un raseur!
Il avertit, en rentrant, le garçon de bureau qu'il ne serait pas là, quand «l'Allemand» viendrait le voir.—Dix minutes après, il l'avait oublié.
Christophe revint à son taudis. Il était attendri.
—Le bon garçon! pensait-il. Comme j'ai été injuste envers lui! Et il ne m'en veut pas!
Ce remords lui pesait; il fut sur le point d'écrire à Kohn combien il était peiné de l'avoir mal jugé autrefois, et qu'il lui demandait pardon du tort qu'il lui avait fait. Il avait les larmes aux yeux, en y pensant. Mais il lui était moins aisé d'écrire une lettre qu'une partition; et après avoir pesté dix fois contre l'encre et la plume de l'hôtel, qui en effet étaient ignobles, après avoir barbouillé, raturé, déchiré quatre ou cinq feuilles de papier, il s'impatienta et envoya tout promener.
Le reste de la journée fut long à passer; mais Christophe était si fatigué par sa mauvaise nuit et par les courses du matin qu'il finit par s'assoupir sur sa chaise. Il ne sortit de sa torpeur, vers le soir, que pour se coucher; et il dormit douze heures de suite, sans s'arrêter.
Le lendemain, dès huit heures, il commença d'attendre la réponse promise. Il ne doutait pas de l'exactitude de Kohn. Il ne bougea point de chez lui, se disant que Kohn passerait peut-être à l'hôtel, avant de se rendre au bureau. Pour ne pas s'éloigner, vers midi, il se fit monter son déjeuner de la gargote d'en bas. Puis, il attendit de nouveau, sûr que Kohn viendrait, au sortir du restaurant. Il marchait dans sa chambre, s'asseyait, se remettait à marcher, ouvrant sa porte, quand il entendait monter des pas dans l'escalier. Il n'avait aucun désir de se promener dans Paris, pour tromper son attente. Il se mit sur son lit. Sa pensée revenait constamment vers la vieille maman, qui pensait aussi à lui, en ce moment,—qui seule pensait à lui. Il se sentait pour elle une tendresse infinie et un remords de l'avoir quittée. Mais il ne lui écrivit pas. Il attendit de pouvoir lui apprendre quelle situation il avait trouvée. Malgré leur profond amour, il ne leur serait pas venu à l'idée, ni à l'un ni à l'autre, de s'écrire pour se dire simplement qu'ils s'aimaient: une lettre était faite pour dire des choses précises.
—Couché sur le lit, les mains jointes sous sa tête, il rêvassait. Bien que sa chambre fût éloignée de la rue, le grondement de Paris remplissait le silence; la maison trépidait.
—La nuit vint de nouveau, sans avoir apporté de lettre.
Une journée recommença, semblable à la précédente.
Le troisième jour, Christophe, que cette réclusion volontaire commençait à rendre enragé, se décida à sortir. Mais Paris lui causait, depuis le premier soir, une répulsion instinctive. Il n'avait envie de rien voir: nulle curiosité; il était trop préoccupé de sa vie pour prendre plaisir à regarder celle des autres; et les souvenirs du passé, les monuments d'une ville, le laissaient indifférent. À peine dehors, il s'ennuya tellement que, quoiqu'il eût décidé de ne pas retourner chez Kohn avant huit jours, il y alla, tout d'une traite.
Le garçon, qui avait le mot d'ordre, dit que M. Hamilton était parti de Paris pour affaires. Ce fut un coup pour Christophe. Il demanda en bégayant quand M. Hamilton devait revenir. L'employé répondit, au hasard:
—Dans une dizaine de jours.
Christophe s'en retourna, consterné, et se terra chez lui, pendant les jours suivants. Il lui était impossible de se remettre au travail. Il s'aperçut avec terreur que ses petites économies,—le peu d'argent que sa mère lui avait envoyé, soigneusement serré dans un mouchoir, au fond de sa valise,—diminuaient rapidement. Il se soumit à un régime sévère. Il descendait seulement, vers le soir pour dîner, dans le cabaret d'en bas, où il avait été rapidement connu des clients, sous le nom du «Prussien», ou de «Choucroute».—Il écrivit, au prix de pénibles efforts, deux ou trois lettres à des musiciens français, dont le nom lui était vaguement connu. Un d'eux était mort depuis dix ans. Il leur demandait de vouloir bien lui donner audience. L'orthographe était extravagante, et le style agrémenté de ces longues inversions et de ces formules cérémonieuses, qui sont habituelles en allemand. Il adressait l'épître: «Au Palais de l'Académie de France.»—Le seul qui la lut en fit des gorges chaudes avec ses amis.
Après une semaine, Christophe retourna à la librairie. Le hasard le servit, cette fois. Sur le seuil, il croisa Sylvain Kohn, qui sortait. Kohn fit la grimace, en se voyant pincé; mais Christophe était si heureux qu'il ne s'en aperçut pas. Il lui avait ressaisi les mains, suivant son habitude agaçante, et il demandait, joyeux:
—Vous étiez en voyage? Vous avez fait bon voyage?
Kohn acquiesçait, mais ne se déridait pas. Christophe continua:
—Je suis venu, vous savez... On vous a dit, n'est-ce pas?... Eh bien, quoi de nouveau? Vous avez parlé de moi? Qu'est-ce qu'on a répondu?
Kohn se renfrognait de plus en plus. Christophe était surpris de ses manières guindées: ce n'était plus le même homme.
—J'ai parlé de vous, dit Kohn; mais je ne sais rien encore; je n'ai pas eu le temps. J'ai été très pris, depuis que je vous ai vu. Des affaires par-dessus la tête. Je ne sais comment j'en viendrai à bout. C'est écrasant. Je finirai par tomber malade.
—Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? demanda Christophe, d'un ton de sollicitude inquiète.
Kohn lui jeta un coup d'œil narquois, et répondit:
—Pas bien du tout. Je ne sais ce que j'ai, depuis quelques jours. Je me sens très souffrant.
—Ah! mon Dieu! fit Christophe, en lui prenant le bras. Soignez-vous bien! Il faut vous reposer. Comme je suis fâché de vous avoir donné encore cette peine de plus! Il fallait me le dire. Qu'est-ce que vous sentez, au juste?
Il prenait tellement au sérieux les mauvaises raisons de l'autre que Kohn, gagné par une douce hilarité qu'il cachait de son mieux, fut désarmé par cette candeur comique. L'ironie est un plaisir si cher aux Juifs—(et nombre de chrétiens à Paris sont Juifs sur ce point)—qu'ils ont des indulgences spéciales pour les fâcheux et pour les ennemis même, qui leur offrent une occasion de l'exercer à leurs dépens. D'ailleurs, Kohn ne laissait pas d'être touché par l'intérêt que Christophe prenait à sa personne. Il se sentit disposé à lui rendre service.
—Il me vient une idée, dit-il. En attendant les leçons, feriez-vous des travaux d'édition musicale?
Christophe accepta avec empressement.
—J'ai votre affaire, dit Kohn. Je connais intimement un des chefs d'une grande maison d'éditions musicales, Daniel Hecht. Je vais vous présenter; vous verrez ce qu'il y aura à faire. Moi, vous savez, je n'y connais rien. Mais lui est un vrai musicien. Vous n'aurez pas de peine à vous entendre.
Ils prirent rendez-vous pour le jour suivant. Kohn n'était pas fâché de se débarrasser de Christophe, tout en l'obligeant.
Le lendemain, Christophe vint prendre Kohn à son bureau. Il avait, sur son conseil, emporté quelques compositions pour les montrer à Hecht. Ils trouvèrent celui-ci à son magasin de musique, près de l'Opéra. Hecht ne se dérangea pas, à leur entrée; il tendit froidement deux doigts à la poignée de main de Kohn, ne répondit pas au salut cérémonieux de Christophe, et, sur la demande de Kohn, il passa avec eux dans une pièce voisine. Il ne leur offrit pas de s'asseoir. Il resta adossé à la cheminée sans feu, les yeux fixés au mur.
Daniel Hecht était un homme d'une quarantaine d'années, grand, froid, correctement mis, un type phénicien très marqué, l'air intelligent et désagréable, figure renfrognée, poil noir, barbe de roi assyrien, longue et carrée. Il ne regardait presque jamais en face, et il avait une façon de parler glaciale et brutale, qui frappait comme une insulte, même quand il disait bonjour. Cette insolence était plus apparente que réelle. Sans doute, elle répondait à une disposition méprisante de son caractère; mais elle tenait encore plus à ce qu'il y avait en lui d'automatique et de guindé. Les Juifs de cette espèce ne sont point rares; et l'opinion n'est pas tendre pour eux: elle taxe d'arrogance cette raideur cassante, qui est souvent le fait d'une gaucherie incurable de corps et d'âme.
Sylvain Kohn présentait son protégé, sur un ton de prétentieux badinage, avec des éloges exagérés. Christophe, décontenancé par l'accueil, se balançait, son chapeau et ses manuscrits à la main. Lorsque Kohn eut fini, Hecht, qui jusque-là ne semblait pas s'être douté que Christophe fût là, tourna dédaigneusement la tête vers lui, et, sans le regarder, dit:
—Krafft... Christophe Krafft... Je n'ai jamais entendu ce nom.
Christophe reçut cette parole, comme un coup de poing en pleine poitrine. Le rouge lui monta au visage. Il répondit avec colère:
—Vous l'entendrez plus tard.
Hecht ne sourcilla point, et continua imperturbablement, comme si Christophe n'existait pas:
—Krafft... Non. Je ne connais pas.
Il était de ces gens, pour qui c'est déjà une mauvaise note que de n'être pas connu d'eux.
Il continua, en allemand:
—Et vous êtes du Rhein-Land?... C'est étonnant combien il y a de gens là-bas qui se mêlent de musique! Je crois qu'il n'y en a pas un qui ne prétende être musicien.
Il voulait dire une plaisanterie, et non une insolence; mais Christophe le prit autrement. Il eût répliqué, si Kohn ne l'avait devancé.
—Ah! pardon, pardon, disait-il à Hecht, vous me rendrez cette justice que moi, je n'y entends rien.
—Cela fait votre éloge, répondit Hecht.
—S'il faut ne pas être musicien pour vous plaire, dit sèchement Christophe, je suis fâché, je ne fais pas l'affaire.
Hecht, la tête toujours tournée de côté, reprit, avec la même indifférence:
—Vous avez déjà écrit de la musique? Qu'est-ce que vous avez écrit? Des lieder, naturellement?
—Des lieder, deux symphonies, des poèmes symphoniques, des quatuors, des suites pour piano, de la musique de scène, dit Christophe, bouillonnant.
—On écrit beaucoup en Allemagne, fit Hecht, avec une politesse dédaigneuse.
Il était d'autant plus méfiant, à l'égard du nouveau venu, que celui-ci avait écrit tant d'œuvres, et que lui, Daniel Hecht, ne les connaissait pas.
—Eh bien, dit-il, je pourrais peut-être vous occuper, puisque vous m'êtes recommandé par mon ami Hamilton. Nous faisons en ce moment une collection, une Bibliothèque de la jeunesse, où nous publions des morceaux de piano faciles. Sauriez-vous nous «simplifier» le Carnaval de Schumann, et l'arranger à quatre, six et huit mains?
Christophe tressauta:
—Et voilà ce que vous m'offrez, à moi, à moi!...
Ce «moi» naïf fit la joie de Kohn; mais Hecht prit un air offensé:
—Je ne vois pas ce qui peut vous étonner, dit-il. Ce n'est point là un travail si facile! S'il vous paraît trop aisé, tant mieux! Nous verrons ensuite. Vous me dites que vous êtes bon musicien. Je dois vous croire. Mais enfin, je ne vous connais pas.
Il pensait, à part lui:
—Si on croyait tous ces gaillards-là, ils feraient la barbe à Johannes Brahms lui-même.
Christophe, sans répondre,—(car il s'était promis de réprimer ses emportements)—enfonça son chapeau sur sa tête, et se dirigea vers la porte. Kohn l'arrêta, en riant:
—Attendez, attendez donc! dit-il.
Et, se tournant vers Hecht:
—Il a justement apporté quelques-uns de ses morceaux, pour que vous puissiez vous faire une idée.
—Ah! dit Hecht, ennuyé. Eh bien, voyons cela.
Christophe, sans un mot, tendit les manuscrits. Hecht y jeta les yeux, négligemment.
—Qu'est-ce que c'est? Une Suite pour piano... (Lisant:) Une journée... Ah! toujours de la musique à programme!...
Malgré son indifférence apparente, il lisait avec grande attention. Il était excellent musicien, possédait son métier, d'ailleurs ne voyait rien au delà; dès les premières mesures, il sentit parfaitement à qui il avait affaire. Il se tut, feuilletant l'œuvre, d'un air dédaigneux; il était très frappé du talent qu'elle révélait; mais sa morgue naturelle et son amour-propre froissé par les façons de Christophe lui défendaient d'en rien montrer. Il alla jusqu'au bout, en silence, ne perdant pas une note:
—Oui, dit-il enfin, d'un ton protecteur, c'est assez bien écrit.
Une critique violente eût moins blessé Christophe.
—Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, fit-il, exaspéré.
—J'imagine pourtant, dit Hecht, que si vous me montrez ce morceau, c'est pour que je vous dise ce que j'en pense.
—En aucune façon.
—Alors, fit Hecht, piqué, je ne vois pas ce que vous venez me demander.
—Je vous demande du travail, pas autre chose.
—Je n'ai rien autre à vous offrir, pour le moment, que ce que je vous ai dit. Encore n'en suis-je pas sûr. J'ai dit que cela se pourrait.
—Et vous n'avez pas d'autre moyen d'occuper un musicien comme moi?
—Un musicien comme vous? dit Hecht, d'un ton d'ironie blessante. D'aussi bons musiciens que vous, pour le moins, n'ont pas cru cette occupation au-dessous de leur dignité. Certains, que je pourrais nommer, et qui sont maintenant bien connus à Paris, m'en ont été reconnaissants.
—C'est qu'ils sont des jean-foutre, éclata Christophe.—(Il connaissait déjà des finesses de la langue française.)—Vous vous trompez, si vous croyez que vous avez affaire à quelqu'un de leur espèce. Croyez-vous m'en imposer avec vos façons de ne pas me regarder en face et de me parler du bout des dents? Vous n'avez même pas daigné répondre à mon salut, quand je suis entré... Mais qu'est-ce que vous êtes donc, pour en user ainsi avec moi? Êtes-vous seulement musicien? Avez-vous jamais rien écrit?... Et vous prétendez m'apprendre comment on écrit, à moi, dont c'est la vie d'écrire!... Et vous ne trouvez rien de mieux à m'offrir, après avoir lu ma musique, que de châtrer de grands musiciens et de faire des saloperies sur leurs œuvres, pour faire danser les petites filles!... Adressez-vous à vos Parisiens, s'ils sont assez lâches pour se laisser faire la leçon par vous! Pour moi, j'aime mieux crever!
Impossible d'arrêter le torrent.
Hecht dit, glacial:
—Vous êtes libre.
Christophe sortit, en faisant claquer les portes. Hecht haussa les épaules, et dit à Sylvain Kohn, qui riait:
—Il y viendra, comme les autres.
Au fond, il l'estimait. Il était assez intelligent pour sentir la valeur non seulement des œuvres, mais des hommes. Sous l'emportement injurieux de Christophe il avait discerné une force, dont il savait la rareté,—dans le monde artistique plus qu'ailleurs. Mais son amour-propre s'était buté: à aucun prix, il n'eût consenti à reconnaître ses torts. Il avait le besoin loyal de rendre justice à Christophe, et il était incapable de le faire, à moins que Christophe ne s'humiliât devant lui. Il attendit que Christophe lui revînt: son triste scepticisme et son expérience de la vie lui avaient fait connaître l'avilissement inévitable des volontés par la misère.
Christophe rentra chez lui. La colère avait fait place à l'abattement. Il se sentait perdu. Le faible appui sur lequel il comptait s'était écroulé. Il ne doutait pas qu'il ne se fût fait un ennemi mortel, non seulement de Hecht, mais de Kohn qui l'avait présenté. C'était la solitude absolue dans une ville ennemie. En dehors de Diener et de Kohn, il ne connaissait personne. Son amie Corinne, la belle actrice, avec qui il s'était lié en Allemagne, n'était pas à Paris,—elle faisait encore une tournée à l'étranger, en Amérique, et cette fois pour son compte: car elle était devenue célèbre; les journaux publiaient de bruyants échos de son voyage. Quant à la petite institutrice française, qu'il avait, sans le vouloir, fait renvoyer de sa place, et dont la pensée avait été longtemps pour lui un remords, combien de fois s'était-il promis de la retrouver, quand il serait à Paris! Mais maintenant qu'il était à Paris, il s'apercevait qu'il n'avait oublié qu'une chose: son nom. Impossible de se le rappeler. Il ne se souvenait que du prénom: Antoinette. Au reste, quand la mémoire lui serait revenue, le moyen de retrouver une pauvre petite institutrice, dans cette fourmilière humaine!
Il fallait s'assurer au plus tôt de quoi vivre. Il restait à Christophe cinq francs. Il prit sur lui, malgré sa répugnance, de demander à son hôte, le gros cabaretier, s'il ne connaîtrait pas dans le quartier des gens à qui il pourrait donner des leçons de piano. L'homme tenait déjà en médiocre estime un locataire qui ne mangeait qu'une fois par jour, et qui parlait allemand; il perdit tout respect, quand il sut que ce n'était qu'un musicien. Il était un Français de la vieille race, pour qui la musique est un métier de feignant. Il se gaussa:
—Du piano!... Vous tapez de ça? Compliments!... C'est-y curieux tout de même de faire ce métier-là par goût! Moi, toute musique me fait l'effet, comme s'il pleuvait... Après ça, vous pourriez peut-être m'apprendre. Qu'est-ce que vous en diriez, vous autres? cria-t-il, en se tournant vers des ouvriers qui buvaient.
Ils rirent bruyamment.
—C'est un joli métier, fit l'un. Pas salissant. Et puis, ça plaît aux dames.
Christophe comprenait mal le français, et plus mal la moquerie: il cherchait ses mots; il ne savait pas s'il devait se fâcher. La femme du patron eut pitié de lui:
—Allons, allons, Philippe, tu n'es pas sérieux, dit-elle à son mari.—Tout de même, continua-t-elle, en s'adressant à Christophe, il y aurait peut-être bien quelqu'un qui ferait votre affaire.
—Qui donc? demanda le mari.
—La petite Grasset. Tu sais, on lui a acheté un piano.
—Ah! ces poseurs! C'est vrai.
On apprit à Christophe qu'il s'agissait de la fille du boucher: ses parents voulaient en faire une demoiselle; ils consentiraient à ce qu'elle prît des leçons, quand ce ne serait que pour faire jaser. La femme de l'hôtelier promit de s'en occuper.
Le lendemain, elle dit à Christophe que la bouchère voulait le voir. Il alla chez elle. Il la trouva à son comptoir, au milieu des cadavres de bêtes. Cette belle femme, au teint fleuri, au sourire doucereux, prit un air digne, quand elle sut pourquoi il venait. Tout de suite, elle aborda la question de prix, se hâtant d'ajouter qu'elle ne voulait pas y mettre beaucoup, parce que le piano est une chose agréable, mais pas nécessaire: elle lui offrit un franc l'heure. Après quoi, elle demanda à Christophe, d'un air méfiant, si au moins il savait bien la musique. Elle parut se rassurer et devint plus aimable, quand il dit que non seulement il la savait, mais qu'il en écrivait: son amour-propre en fut flatté; elle se promit de répandre dans le quartier la nouvelle que sa fille prenait des leçons avec un compositeur.
Quand Christophe se vit; le lendemain, assis près du piano,—un horrible instrument, acheté d'occasion, et qui sonnait comme une guitare,—avec la petite bouchère, dont les doigts courts et gros trébuchaient sur les touches,—qui était incapable de distinguer un son d'un autre,—qui se tortillait d'ennui,—qui lui bâillait au nez, dès les premières minutes,—quand il eut à subir la surveillance de la mère et sa conversation, ses idées sur la musique et sur l'éducation musicale,—il se sentit si misérable, si misérablement humilié qu'il n'avait même plus la force de s'indigner. Il rentrait dans un état d'accablement; certains soirs, il ne pouvait dîner. S'il en était tombé là au bout de quelques semaines, où ne descendrait-il pas, par la suite? À quoi lui avait-il servi de se révolter contre l'offre de Hecht? Ce qu'il avait accepté était plus dégradant encore.
Un soir, dans sa chambre, les larmes le prirent; il se jeta désespérément à genoux devant son lit, il pria... Qui priait-il? Qui pouvait-il prier? Il ne croyait pas en Dieu, il croyait qu'il n'y avait point de Dieu... Mais il fallait prier, il fallait se prier. Il n'y a que les médiocres qui ne prient jamais. Ils ne savent pas la nécessité où sont les âmes fortes de faire retraite dans leur sanctuaire. Au sortir des humiliations de la journée, Christophe sentit, dans le silence bourdonnant de son cœur, la présence de son Être éternel. Les flots de la misérable vie s'agitaient au-dessous de Lui: qu'y avait-il de commun entre elle et Lui? Toutes les douleurs du monde, acharnées à détruire, venaient se briser contre son roc. Christophe entendait battre ses artères, comme une mer intérieure; et une voix répétait:
—Éternel... Je suis... Je suis...
Il la connaissait bien: si loin qu'il se souvînt, il avait toujours entendu cette voix. Il lui arrivait de l'oublier; pendant des mois, il cessait d'avoir conscience de son rythme puissant et monotone; mais il savait qu'elle était là, qu'elle ne cessait jamais, pareille à l'Océan qui gronde dans la nuit. Il retrouva dans cette musique le calme et l'énergie qu'il y puisait, chaque fois qu'il s'y retrempait. Il se releva, apaisé. Non, la dure vie qu'il menait n'avait rien du moins dont il dût avoir honte; il pouvait manger son pain sans rougir; ceux qui le lui faisaient acheter à ce prix, c'était à eux de rougir. Patience! Le temps viendrait...
Mais le lendemain, la patience recommençait à lui manquer; et malgré ses efforts, il finit par éclater de rage, un jour pendant la leçon, contre la stupide pécore, impertinente par surcroît, qui se moquait de son accent, et mettait une malice de singe à faire le contraire de ce qu'il disait. Aux cris de colère de Christophe répondirent les hurlements de la donzelle, effrayée et indignée qu'un homme qu'elle payait osât lui manquer de respect. Elle cria qu'il l'avait battue:—(Christophe lui avait secoué le bras assez rudement.)—La mère se précipita comme une furie, couvrit sa fille de baisers et Christophe d'invectives. Le boucher parut à son tour, et déclara qu'il n'admettait pas qu'un gueux de Prussien se permît de toucher à sa fille. Christophe, blême de colère, honteux, incertain s'il n'étranglerait pas l'homme, la femme, et la fille, se sauva sous l'averse. Ses hôtes, qui le virent rentrer, bouleversé, n'eurent pas de peine à se faire raconter l'histoire; et leur malveillance pour les voisins en fut réjouie. Mais le soir, tout le quartier répétait que l'Allemand était une brute, qui battait les enfants.
Christophe fit de nouvelles démarches chez des marchands de musique: elles ne servirent à rien. Il trouvait les Français peu accueillants; et leur agitation désordonnée l'ahurissait. Il avait l'impression d'une société anarchique, dirigée par une bureaucratie rogue et despotique.
Un soir qu'il errait sur les boulevards, découragé de l'inutilité de ses efforts, il vit Sylvain Kohn, qui venait en sens inverse. Convaincu qu'ils étaient brouillés, il détourna les yeux, et tâcha de passer inaperçu. Mais Kohn l'appela:
—Et qu'étiez-vous devenu depuis ce fameux jour? demanda-t-il en riant. Je voulais aller chez vous; mais je n'ai plus votre adresse... Tudieu, mon cher, je ne vous connaissais pas. Vous avez été épique.
Christophe le regarda, surpris et un peu honteux:
—Vous ne m'en voulez pas?
—Vous en vouloir? Quelle idée!
Bien loin de lui en vouloir, il avait été réjoui de la façon dont Christophe avait étrillé Hecht: il avait passé un bon moment. Il lui était fort indifférent que Hecht ou que Christophe eût raison; il n'envisageait les gens que d'après le degré d'amusement qu'ils pouvaient avoir pour lui; et il avait entrevu en Christophe une source de haut comique, dont il se promettait bien de profiter.
—Il fallait venir me voir, continuait-il. Je vous attendais. Qu'est-ce que vous faites, ce soir? Vous allez venir diner. Je ne vous lâche plus. Nous serons entre nous: quelques artistes, qui nous réunissons, une fois par quinzaine. Il faut que vous connaissiez ce monde-là. Venez. Je vous présenterai.
Christophe s'excusait en vain sur sa tenue. Sylvain Kohn l'emmena.
Ils entrèrent dans un restaurant des boulevards, et montèrent au premier. Christophe se trouva au milieu d'une trentaine de jeunes gens, de vingt a trente-cinq ans, qui discutaient avec animation. Kohn le présenta, comme venant de s'échapper des prisons d'Allemagne. Ils ne firent aucune attention à lui, et n'interrompirent même pas leur discussion passionnée, où Kohn, à peine arrivé, se jeta à la nage.
Christophe, intimidé par cette société d'élite, se taisait, et il était tout oreilles. Il ne réussissait pas à comprendre—ayant peine à suivre la volubilité de parole française—quels grands intérêts artistiques étaient débattus. Il avait beau écouter, il ne distinguait que des mots comme «trust», «accaparement», «baisse des prix», «chiffres des recettes», mêlés à ceux de «dignité de l'art» et de «droits de l'écrivain». Il finit par s'apercevoir qu'il s'agissait d'affaires commerciales. Un certain nombre d'auteurs, appartenant, semblait-il, à une société financière, s'indignaient contre les tentatives qui étaient faites pour constituer une société rivale, disputant à la leur son monopole d'exploitation. La défection de quelques-uns de leurs associés, qui avaient trouvé avantageux de passer, armes et bagages, dans la maison rivale, les jetait dans des transports de fureur. Ils ne parlaient de guère moins que de couper des têtes. «... Déchéance... Trahison... Flétrissure... Vendus...»
D'autres ne s'en prenaient pas aux vivants: ils en avaient aux morts, dont la copie gratuite obstruait le marché. L'œuvre de Musset venait de tomber dans le domaine public, et, à ce qu'il paraissait, on l'achetait beaucoup trop. Aussi réclamaient-ils de l'État une protection énergique, frappant de lourdes taxes les chefs-d'œuvre du passé, afin de s'opposer à leur diffusion à prix réduits, qu'ils taxaient aigrement de concurrence déloyale pour la marchandise des artistes d'à présent.
Ils s'interrompirent les uns et les autres pour écouter les chiffres des recettes qu'avaient faites telle et telle pièce dans la soirée d'hier. Tous s'extasièrent sur la chance d'un vétéran de l'art dramatique, célèbre dans les deux mondes,—qu'ils méprisaient, mais qu'ils enviaient encore plus.—Des rentes des auteurs ils passèrent à celles des critiques. Ils s'entretinrent de celles que touchait—(pure calomnie, sans doute?)—un de leurs confrères connu, pour chaque première représentation d'un théâtre des boulevards, afin d'en dire du bien. C'était un honnête homme: une fois le marché conclu, il le tenait loyalement; mais son grand art était—(à ce qu'ils prétendaient)—de faire de la pièce des éloges qui la fissent tomber le plus promptement possible, afin qu'il y eût des premières souvent. Le conte—(le compte)—fit rire, mais n'étonna point.
Au travers de tout cela, ils disaient de grands mots; ils parlaient de «poésie», d'«art pour l'art». Dans ce bruit de gros sous, cela sonnait: «l'art pour l'argent»; et ces mœurs de maquignons, nouvellement introduites dans la littérature française, scandalisaient Christophe. Comme il ne comprenait rien aux questions d'argent, il avait renoncé à suivre la discussion, quand ils finirent par parler de littérature,—ou, plutôt, de littérateurs.—Christophe dressa l'oreille, en entendant le nom de Victor Hugo.
Il s'agissait de savoir s'il avait été cocu. Ils discutèrent longuement sur les amours de Sainte-Beuve et de madame Hugo. Après quoi, ils parlèrent des amants de George Sand et de leurs mérites respectifs. C'était la grande occupation de la critique littéraire d'alors: après avoir tout exploré dans la maison des grands hommes, visité les placards, retourné les tiroirs, et vidé les armoires, elle fouillait l'alcôve. La pose de monsieur de Lauzun, à plat ventre sous le lit du roi et de la Montespan, était de celles qu'elle affectionnait, dans son culte pour l'histoire et pour la vérité:—(ils avaient tous, en ce temps, le culte de la vérité).—Les convives de Christophe montrèrent qu'ils en étaient possédés: rien ne les lassait dans cette recherche du vrai. Ils l'étendaient à l'art d'aujourd'hui, comme à l'art du passé; et ils analysèrent la vie privée de certains des plus notoires contemporains, avec la même passion d'exactitude. C'était une chose curieuse qu'ils connussent les moindres détails de scènes, qui d'habitude se passent de tout témoin. C'était à croire que les intéressés avaient été les premiers à fournir le public de renseignements exacts, par dévouement pour la vérité.
Christophe, de plus en plus gêné, essayait de causer d'autre chose avec ses voisins. Mais aucun ne s'occupait de lui. Ils avaient bien commencé par lui poser quelques vagues questions sur l'Allemagne,—questions qui lui avaient révélé, à son grand étonnement, l'ignorance absolue, où étaient ces gens distingués et qui semblaient instruits, des choses les plus élémentaires de leur métier—littérature et art—en dehors de Paris; tout au plus s'ils avaient entendu parler de quelques grands noms: Hauptmann, Sudermann, Liebermann, Strauss (David, Johann, ou Richard?) parmi lesquels ils s'aventuraient prudemment, de peur de faire quelque fâcheuse confusion. Au reste, s'ils avaient questionné Christophe, c'était par politesse, non par curiosité: ils n'en avaient aucune; à peine s'ils prirent garde à ce qu'il répondit; ils se hâtèrent de revenir aux questions parisiennes qui délectaient le reste de la table.
Christophe timidement tenta de parler de musique. Aucun de ces littérateurs n'était musicien. Au fond, ils regardaient la musique comme un art inférieur. Mais soi! succès croissant, depuis quelques années, leur causait un secret dépit; et, puisqu'elle était à la mode, ils feignaient de s'y intéresser. Ils faisaient grand bruit surtout d'un récent opéra, dont ils n'étaient pas loin de faire dater la musique, ou tout au moins l'ère nouvelle de la musique. Leur ignorance et leur snobisme s'accommodaient de cette idée, qui les dispensait de connaître le reste. L'auteur de cet opéra, un Parisien, dont Christophe entendait le nom pour la première fois, avait, disaient certains, fait table rase de tout ce qui était avant lui, renouvelé de toutes pièces, re-créé la musique. Christophe sursauta. Il ne demandait pas mieux que de croire au génie. Mais un génie de cette trempe, qui d'un coup anéantissait le passé!... Nom de nom! C'était un gaillard; comment diable avait-il pu faire?—Il demanda des explications. Les autres, qui eussent été bien embarrassés pour lui en donner, et que Christophe assommait, l'adressèrent au musicien de la bande, le grand critique musical, Théophile Goujart, qui lui parla aussitôt de septièmes et de neuvièmes. Christophe le suivit sur ce terrain. Goujart savait la musique à peu près comme Sganarelle savait le latin...
—... Vous n'entendez point le latin?
—Non.
—(Avec enthousiasme) Cabricias, arci thuram, catalamus, singulariter... bonus, bona, bonum...
Se trouvant en présence d'un homme, qui «entendait le latin», il se replia prudemment dans le maquis de l'esthétique. De ce refuge inexpugnable, il se mit à fusiller Beethoven, Wagner, et l'art classique, qui n'étaient pas en cause: (mais, en France, on ne peut louer un artiste, sans lui offrir en holocauste tous ceux qui ne sont pas comme lui). Il proclamait l'avènement d'un art nouveau, foulant aux pieds les conventions du passé. Il parlait d'une langue musicale, qui venait d'être découverte par le Christophe Colomb de la musique parisienne, et qui supprimait totalement la langue des classiques, en faisait une langue morte.
Christophe, tout en réservant son opinion sur le génie novateur, dont il attendait d'avoir vu les œuvres, se sentait en défiance contre ce Baal musical, à qui l'on sacrifiait la musique tout entière. Il était scandalisé d'entendre parler ainsi des maîtres; et il ne se rappelait pas que naguère, en Allemagne, il en avait dit bien d'autres. Lui qui se croyait là-bas un révolutionnaire en art, lui qui scandalisait par sa hardiesse de jugement et sa verte franchise,—dès les premiers mots en France, il se sentait devenu conservateur. Il voulut discuter, et il eut le mauvais goût de le faire, non pas en homme bien élevé, qui avance des arguments et ne les démontre pas, mais en homme du métier, qui va chercher des faits précis, et qui vous en assomme. Il ne craignit pas d'entrer dans des explications techniques; et sa voix, en discutant, montait à des intonations, bien faites pour blesser les oreilles d'une société d'élite, où ses arguments et la chaleur qu'il mettait à les soutenir paraissaient également ridicules. Le critique se hâta de mettre fin par un mot, dit d'esprit, à une discussion fastidieuse, où Christophe venait de s'apercevoir avec stupéfaction que son interlocuteur ne savait rien de ce dont il parlait. L'opinion était faite désormais sur l'Allemand pédantesque et suranné; et, sans qu'on la connût, sa musique fut jugée détestable. Mais l'attention de cette trentaine de jeunes gens, aux yeux railleurs, prompts à saisir les ridicules, avait été ramenée vers ce personnage bizarre, qui agitait avec des mouvements gauches et violents des bras maigres aux mains énormes, et qui dardait des regards furibonds, en criant d'une voix suraiguë. Sylvain Kohn entreprit d'en donner la comédie à ses amis.
La conversation s'était définitivement écartée de la littérature pour s'attacher aux femmes. À vrai dire, c'étaient les deux faces d'un même sujet: car dans leur littérature il n'était guère question que de femmes, et dans leurs femmes que de littérature, tant elles étaient frottées de choses ou de gens de lettres.
On parlait d'une honnête dame, connue dans le monde parisien, qui venait de faire épouser son amant à sa fille, pour mieux se le réserver. Christophe s'agitait sur sa chaise et faisait une grimace de dégoût. Kohn s'en aperçut; et, poussant du coude son voisin, il fit remarquer que le sujet semblait passionner l'Allemand, qui sans doute brûlait d'envie de connaître la dame. Christophe rougit, balbutia, puis finit par dire avec colère que de telles femmes il fallait les fouetter. Un éclat de rire homérique accueillit sa proposition; et Sylvain Kohn, d'un ton flûté, protesta qu'on ne devait pas toucher une femme, même avec une fleur... etc... etc... (Il était à Paris le chevalier de l'Amour.)—Christophe répondit qu'une femme de cette espèce n'était ni plus ni moins qu'une chienne, et qu'avec les chiens vicieux il n'y avait qu'un remède: le fouet. On se récria bruyamment. Christophe dit que leur galanterie était de l'hypocrisie, que c'étaient toujours ceux qui respectaient le moins les femmes, qui parlaient le plus de les respecter; et il s'indigna contre leurs récits scandaleux. On lui opposa qu'il n'y avait là aucun scandale, rien que de naturel; et tous furent d'accord pour reconnaître en l'héroïne de l'histoire non seulement une femme charmante, mais la Femme, par excellence. L'Allemand s'exclama. Sylvain Kohn lui demanda sournoisement comment était donc la Femme, telle qu'il l'imaginait. Christophe sentit qu'on lui tendait un panneau; mais il y donna en plein, emporté par sa violence et par sa conviction. Il se mit à expliquer à ces Parisiens gouailleurs ses idées sur l'amour. Il ne trouvait pas ses mots, il les cherchait pesamment, finissant par pêcher dans sa mémoire des expressions invraisemblables, disant des énormités qui faisaient la joie de l'auditoire, et ne se troublant pas, avec un sérieux admirable, une insouciance touchante du ridicule: car il ne pouvait pas ne pas voir qu'ils se moquaient de lui effrontément. À la fin, il s'empêtra dans une phrase, n'en put sortir, donna un coup de poing sur la table, et se tut.
On essaya de le relancer dans la discussion; mais il fronça les sourcils, et il ne broncha plus, les coudes sur la table, honteux et irrité. Il ne desserra plus les dents jusqu'à la fin du diner, si ce n'est pour manger et pour boire. Il buvait énormément, au contraire de ces Français, qui touchaient à peine à leurs vins. Son voisin l'y encourageait malignement, et remplissait son verre, qu'il vidait sans y penser. Mais, quoiqu'il ne fût pas habitué à ces excès de table, surtout après les semaines de privations qu'il venait de passer, il tint bon et ne donna pas le spectacle ridicule que les autres espéraient. Il restait absorbé; on ne faisait plus attention à lui: on pensait qu'il était assoupi par le vin. En outre de la fatigue qu'il avait à suivre une conversation française, il était las de n'entendre parler que de littérature,—acteurs, auteurs, éditeurs, bavardages de coulisses ou d'alcôves littéraires: à cela se réduisait le monde! Au milieu de ces figures nouvelles et de ce bruit de paroles, il ne parvenait à fixer en lui ni une physionomie, ni une pensée. Ses yeux de myope, vagues et absorbés, faisaient le tour de la table lentement, se posant sur les gens, et ne semblant pas les voir. Il les voyait pourtant mieux que quiconque; mais il n'en avait pas conscience. Son regard n'était point comme celui de ces Parisiens et de ces Juifs, qui happe à coups de bec des lambeaux d'objets, menus, menus, menus, et les dépèce en un instant. Il s'imprégnait longuement, en silence, des êtres, comme une éponge; et il les emportait. Il lui semblait n'avoir rien vu, et ne se souvenir de rien. Longtemps après,—des heures, souvent des jours,—lorsqu'il était seul et regardait en lui, il s'apercevait qu'il avait tout raflé.
Pour l'instant, il n'avait l'air que d'un lourdaud d'Allemand, qui s'empiffrait de mangeaille, attentif seulement à ne pas perdre une goulée. Et il ne distinguait rien, sinon qu'en écoutant les convives s'interpeller par leurs noms, il se demandait, avec une insistance d'ivrogne, pourquoi tant de ces Français avaient des noms étrangers: flamands, allemands, juifs, levantins, anglo ou hispano-américains...
Il ne s'aperçut pas que l'on se levait de table. Il restait seul assis; et il rêvait des collines rhénanes, des grands bois, des champs labourés, des prairies au bord de l'eau, de la vieille maman. Quelques convives causaient encore, debout, à l'autre bout de la salle. La plupart étaient déjà partis. Enfin il se décida, se leva, à son tour, et, ne regardant personne, il alla chercher son manteau et son chapeau accrochés à l'entrée. Après les avoir mis, il partait sans dire bonsoir, quand, par l'entrebâillement d'une porte, il aperçut dans un cabinet voisin un objet qui le fascina: un piano. Il y avait plusieurs semaines qu'il n'avait touché à un instrument de musique. Il entra, caressa amoureusement les touches, s'assit, et, son chapeau sur la tête, son manteau sur le dos, il commença de jouer. Il avait parfaitement oublié où il était. Il ne remarqua point que deux personnes se glissaient dans la pièce pour l'entendre. L'une était Sylvain Kohn, passionné de musique,—Dieu sait pourquoi! car il n'y comprenait rien, et il aimait autant la mauvaise que la bonne. L'autre était le critique musical, Théophile Goujart. Celui-là—(c'était plus simple)—ne comprenait ni n'aimait la musique; mais cela ne le gênait point pour en parler. Au contraire: il n'y a pas d'esprits plus libres que ceux qui ne savent point ce dont ils parlent: car il leur est indifférent d'en dire une chose plutôt qu'une autre.
Théophile Goujart était un gros homme, râblé et musclé; la barbe noire, de lourds accroche-cœur sur le front, un front qui se fronçait de grosses rides inexpressives, une figure mal équarrie, comme grossièrement sculptée dans du bois, les bras courts, les jambes courtes, une grasse poitrine: une sorte de marchand de bois, ou de portefaix auvergnat. Il avait des manières vulgaires et le verbe arrogant. Il était entré dans la musique par la politique, qui, dans ce temps-là, en France, était le seul moyen d'arriver. Il s'était attaché à la fortune d'un ministre de sa province, dont il s'était découvert vaguement parent ou allié,—quelque fils «du bâtard de son apothicaire».—Les ministres ne sont pas éternels. Quand le sien avait paru près de sombrer, Théophile Goujart avait abandonné le bateau, après en avoir emporté tout ce qu'il pouvait prendre, notamment des décorations: car il aimait la gloire. Las de la politique, où depuis quelque temps il commençait à recevoir, pour le compte de son patron, et même pour le sien, quelques coups assez rudes, il avait cherché, à l'abri des orages, une situation de tout repos, où il pourrait ennuyer les autres, sans être ennuyé lui-même. La critique était tout indiquée. Justement, une place de critique musical était vacante dans un des grands journaux parisiens. Le titulaire, un jeune compositeur de talent, avait été congédié, parce qu'il s'obstinait à dire ce qu'il pensait des œuvres et des auteurs. Goujart ne s'était jamais occupé de musique, et il ne savait rien: on le choisit sans hésiter. On en avait assez des gens compétents; au moins, avec Goujart, on n'avait rien à craindre; il n'attachait pas une importance ridicule à ses opinions; toujours aux ordres de la direction, et prêt à en faire passer les éreintements et les réclames. Qu'il ne fût pas musicien, c'était une considération secondaire. La musique, chacun en sait assez en France. Goujart avait vite acquis la science indispensable. Le moyen était simple: il s'agissait, aux concerts, de prendre pour voisin quelque bon musicien, si possible un compositeur, et de lui faire dire ce qu'il pensait des œuvres qu'on jouait. Au bout de quelques mois de cet apprentissage, on connaissait le métier: l'oison pouvait voler. À la vérité, ce n'était pas comme un aigle; et Dieu sait les sottises que Goujart déposait dans sa feuille, avec autorité! Il écoutait et lisait à tort et à travers, embrouillait tout dans sa lourde cervelle, et faisait arrogamment la leçon aux autres; il écrivait dans un style prétentieux, bariolé de calembours, et lardé de pédantismes agressifs; il avait une mentalité de pion de collège. Parfois, de loin en loin, il s'était attiré de cruelles ripostes: dans ces cas-là, il faisait le mort, et se gardait bien de répondre. Il était à la fois un gros finaud et un grossier personnage, insolent ou plat, selon les circonstances. Il faisait des courbettes aux chers maîtres, pourvus d'une situation ou d'une gloire officielle: (c'était le seul moyen qu'il eût d'évaluer sûrement le mérite musical.) Il traitait dédaigneusement les autres, et exploitait les faméliques.—Ce n'était pas une bête.
Malgré l'autorité acquise et sa réputation, dans son for intérieur il savait qu'il ne savait rien en musique; et il avait conscience que Christophe s'y connaissait très bien. Il se serait gardé de le dire; mais cela lui en imposait.—Et maintenant, il écoutait Christophe, qui jouait; et il s'évertuait à comprendre, l'air absorbé, profond, ne pensant à rien; il ne voyait goutte dans ce brouillard de notes, et il hochait la tête en connaisseur, mesurant ses signes d'approbation sur les clignements d'yeux de Sylvain Kohn, qui avait grand'peine à rester tranquille.
Enfin, Christophe, dont la conscience émergeait peu à peu des fumées du vin et de la musique, se rendit compte vaguement de la pantomime qui avait lieu derrière son dos; et, se tournant, il vit les deux amateurs. Ils se jetèrent aussitôt sur lui, et lui secouèrent les mains avec énergie,—Sylvain Kohn glapissant qu'il avait joué comme un dieu, Goujart affirmant d'un air doctoral qu'il avait la main gauche de Rubinstein et la main droite de Paderewski—(à moins que ce ne fût le contraire).—Ils s'accordaient tous deux pour déclarer qu'un tel talent ne devrait pas rester sous le boisseau, et ils s'engagèrent à le mettre en valeur. Pour commencer, tous deux comptaient bien en tirer pour eux-mêmes tout l'honneur et le profit possibles.
Dès le lendemain, Sylvain Kohn invita Christophe à venir chez lui, mettant aimablement à sa disposition l'excellent piano qu'il avait, et dont il ne faisait rien. Christophe, qui mourait de musique rentrée, accepta, sans se faire prier; et il usa de l'invitation.
Les premiers soirs, tout alla bien. Christophe était tout au bonheur de jouer; et Sylvain Kohn mettait une certaine discrétion à l'en laisser jouir en paix. Lui-même en jouissait sincèrement. Par un de ces phénomènes bizarres, que chacun peut observer, cet homme qui n'était pas musicien, qui n'était pas artiste, qui avait le cœur le plus sec, le plus dénué de toute poésie, de toute bonté profonde, était pris sensuellement par ces musiques, qu'il ne comprenait pas, mais d'où se dégageait pour lui une force de volupté. Malheureusement, il ne pouvait pas se taire. Il fallait qu'il parlât, tout haut, pendant que Christophe jouait. Il soulignait la musique d'exclamations emphatiques, comme un snob au concert, ou bien il faisait des réflexions saugrenues. Alors, Christophe tapait le piano, et déclarait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Kohn s'évertuait à se taire; mais c'était plus fort que lui: il se remettait aussitôt à ricaner, gémir, siffloter, tapoter, fredonner, imiter les instruments. Et quand le morceau était fini, il eût crevé, s'il n'avait fait part à Christophe de ses ineptes réflexions.
Il était un curieux mélange de sentimentalité germanique, de blague parisienne, et de fatuité qui lui appartenait en propre. Tantôt c'étaient des jugements apprêtés et précieux, tantôt des comparaisons extravagantes, tantôt des indécences, des obscénités, des insanités, des coquecigrues. Pour louer Beethoven, il y voyait des polissonneries, une sensualité lubrique. Il trouvait un élégant badinage dans de sombres pensées. Le quatuor en ut dièze mineur lui semblait aimablement crâne. Le sublime adagio de la Neuvième Symphonie lui rappelait Chérubin. Après les trois coups qui ouvrent la Symphonie en ut mineur, il criait: «N'entrez pas! Il y a quelqu'un!» Il admirait la bataille de Heldenleben, parce qu'il prétendait y reconnaître le ronflement d'une automobile. Et partout, des images pour expliquer les morceaux, et des images puériles, incongrues. On se demandait comment il pouvait aimer la musique. Cependant, il l'aimait; à certaines de ces pages, qu'il comprenait de la façon la plus cocasse, les larmes lui venaient aux yeux. Mais, après avoir été ému par une scène de Wagner, il tapotait sur le piano un galop d'Offenbach, ou chantonnait une scie de café-concert, après l'Ode à la joie. Alors Christophe bondissait, et il hurlait de colère.—Mais le pire n'était pas quand Sylvain Kohn était absurde; c'était quand il voulait dire des choses profondes et délicates, quand il voulait poser aux yeux de Christophe, quand c'était Hamilton, et non Sylvain Kohn, qui parlait. Dans ces moments-là, Christophe dardait sur lui un regard chargé de haine, et il l'écrasait sous des paroles froidement injurieuses, qui blessaient l'amour-propre de Hamilton: les séances de piano se terminaient fréquemment par des brouilles. Mais, le lendemain, Kohn avait oublié; et Christophe, qui avait remords de sa violence, s'obligeait à revenir.
Tout cela n'eût encore été rien, si Kohn avait pu se retenir d'inviter des amis à entendre Christophe. Mais il avait besoin de faire montre de son musicien.—La première fois que Christophe trouva chez Kohn trois ou quatre petits Juifs et la maîtresse de Kohn, une grande fille enfarinée, bête comme un panier, qui répétait des calembours ineptes et parlait de ce qu'elle avait mangé, mais qui se croyait musicienne, parce qu'elle étalait ses cuisses, chaque soir, dans une Revue des Variétés,—Christophe fit grise mine. La deuxième fois, il déclara tout net à Sylvain Kohn qu'il ne jouerait plus chez lui. Sylvain Kohn jura ses grands dieux qu'il n'inviterait plus personne. Mais il continua en cachette, installant ses invités dans une pièce voisine. Naturellement, Christophe finit par s'en apercevoir; il s'en alla, furieux, et, cette fois, ne revint plus.
Toutefois, il devait ménager Kohn, qui le présentait dans des familles cosmopolites et lui trouvait des leçons.
De son côté, Théophile Goujart vint, quelques jours après, chercher Christophe dans son taudis. Il ne se montra pas offusqué de le trouver si mal logé. Au contraire: il fut charmant. Il lui dit:
—J'ai pensé que cela vous ferait plaisir d'entendre un peu de musique; et comme j'ai mes entrées partout, je suis venu vous prendre.
Christophe fut ravi. Il trouva l'attention délicate, et remercia avec effusion. Goujart était tout différent de ce qu'il l'avait vu, le premier soir. Seul à seul avec lui, il était sans morgue, bon enfant, timide, cherchant à s'instruire. Ce n'était que lorsqu'il se trouvait avec d'autres qu'il reprenait instantanément son air supérieur et son ton cassant. D'ailleurs, son désir de s'instruire avait toujours un caractère pratique. Il n'était pas curieux de ce qui n'était pas d'actualité. Pour le moment, il voulait savoir ce que Christophe pensait d'une partition qu'il avait reçue, et dont il eut été bien embarrassé pour rendre compte: car il lisait à peine ses notes.
Ils allèrent ensemble à un concert symphonique. L'entrée en était commune avec un music-hall. Par un boyau sinueux, on accédait à une salle sans dégagements: l'atmosphère était étouffante; les sièges, trop étroits, entassés; une partie du public se tenait debout, bloquant toutes les issues:—l'inconfortable français. Un homme, qui semblait rongé d'un incurable ennui, dirigeait au galop une symphonie de Beethoven, comme s'il avait hâte que ce fût fini. Les flonflons d'une danse du ventre venaient, du café-concert voisin, se mêlera la marche funèbre de l'Héroïque. Le public arrivait toujours, s'installait, se lorgnait. Quand il eut fini d'arriver, il commença de partir. Christophe tendait les forces de son cerveau pour suivre le fil de l'œuvre, à travers cette foire; et, au prix d'efforts énergiques, il parvenait à y avoir du plaisir,—(car l'orchestre était habile, et Christophe était sevré depuis longtemps de musique symphonique),—quand Goujart le prit par le bras, et lui dit, au milieu du concert.
—Maintenant, nous partons. Nous allons à un autre concert.
Christophe fronça le sourcil; mais il ne répliqua point, et il suivit son guide. Ils traversèrent la moitié de Paris. Ils arrivèrent dans une autre salle, qui sentait l'écurie, et où, à d'autres heures, on jouait des féeries et des pièces populaires:—(la musique, à Paris, est comme ces ouvriers pauvres qui se mettent à deux pour louer un logement: lorsque l'un sort du lit, l'autre entre dans les draps chauds.)—Point d'air, naturellement: depuis le roi Louis XIV, les Français le jugent malsain; et l'hygiène des théâtres, comme autrefois celle de Versailles, est qu'on n'y respire point. Un noble vieillard, avec des gestes de dompteur, déchaînait un acte de Wagner: la malheureuse bête—l'acte—ressemblait à ces lions de ménagerie, ahuris d'affronter les feux de la rampe, et qu'il faut cravacher pour les faire ressouvenir qu'ils sont pourtant des lions. De grosses pharisiennes et de petites bécasses assistaient à cette exhibition, le sourire sur les lèvres. Après que le lion eut fait le beau, que le dompteur eut salué, et qu'ils eurent été récompensés tous deux par le tapage du public, Goujart eut la prétention d'emmener encore Christophe à un troisième concert. Mais, cette fois, Christophe fixa ses mains aux bras de son fauteuil, et il déclara qu'il ne bougerait plus: il en avait assez de courir d'un concert à l'autre, attrapant au passage, ici des miettes de symphonie, là des bribes de concerto. En vain, Goujart essayait de lui expliquer que la critique musicale à Paris était un métier, où il était plus essentiel de voir que d'écouler. Christophe protesta que la musique n'était pas faite pour être entendue en fiacre, et qu'elle voulait du recueillement. Ce mélange de concerts lui tournait le cœur: un seul lui suffisait, à la fois.
Il était bien surpris de cette incontinence musicale. Il croyait, comme la plupart des Allemands, que la musique tenait en France peu de place; et il s'attendait à ce qu'on la lui servît par petites rations, mais très soignées. On lui offrit, pour commencer, quinze concerts en sept jours. Il y en avait pour tous les soirs de la semaine, et souvent deux ou trois par soir, à la même heure, dans des quartiers différents. Pour le dimanche, il y en avait quatre, à la même heure, toujours. Christophe admirait cet appétit de musique. Il n'était pas moins frappé de l'abondance des programmes. Il pensait jusque-là que ses compatriotes avaient la spécialité de ces goinfreries de sons, qui lui avaient plus d'une fois répugné en Allemagne. Il constata que les Parisiens leur eussent rendu des points à table. On leur faisait bonne mesure: deux symphonies, un concerto, une ou deux ouvertures, un acte de drame lyrique. Et de toute provenance: allemand, russe, scandinave, français,—bière, champagne, orgeat et vin,—ils avalaient tout, sans broncher. Christophe s'émerveillait que les oiselles de Paris eussent un aussi vaste estomac. Cela ne les gênait guère! Le tonneau des Danaïdes... Il ne restait rien au fond.
Christophe ne tarda pas à remarquer que cette quantité de musique se réduisait en somme à fort peu de chose. Il trouvait à tous les concerts les mêmes figures et les mêmes morceaux. Ces programmes copieux ne sortaient jamais du même cercle. Presque rien avant Beethoven. Presque rien après Wagner. Et dans l'intervalle, que de lacunes! Il semblait que la musique se réduisît à cinq ou six noms célèbres en Allemagne, à trois ou quatre en France, et, depuis l'alliance franco-russe, à une demi-douzaine de morceaux moscovites.—Rien des anciens Français. Rien des grands Italiens. Rien des colosses Allemands du XVIIe et du XVIIIe siècles. Rien de la musique allemande contemporaine, à l'exception du seul Richard Strauss, qui, plus avisé que les autres, venait lui-même chaque année imposer ses œuvres nouvelles au public parisien. Rien de la musique belge. Rien de la musique tchèque. Mais le plus étonnant: presque rien de la musique française contemporaine.—Cependant, tout le monde en parlait, en termes mystérieux, comme d'une chose qui révolutionnait le monde. Christophe était à l'affût des occasions d'en entendre; il avait une large curiosité, sans parti pris: il brûlait du désir de connaître du nouveau, d'admirer des œuvres de génie. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à en entendre: car il ne comptait pas trois ou quatre petits morceaux, assez finement écrits, mais froids et sagement compliqués, auxquels il n'avait pas prêté grande attention.
En attendant de se faire une opinion par lui-même, Christophe chercha à se renseigner auprès de la critique musicale.
Ce n'était pas aisé. Elle ressemblait à la cour du roi Pétaud. Non seulement les différentes feuilles musicales se contredisaient l'une l'autre à cœur-joie; mais chacune d'elles se contredisait elle-même, d'un article à l'autre. Il y aurait eu de quoi en perdre la tête, si l'on avait tout lu. Heureusement, chaque rédacteur ne lisait que ses propres articles, et le public n'en lisait aucun. Mais Christophe, qui voulait se faire une idée exacte des musiciens français, s'acharnait à ne rien passer; et il admirait le calme guilleret de ce peuple, qui se mouvait dans la contradiction, comme un poisson dans l'eau.
Au milieu de ces divergences d'opinions, une chose le frappa: l'air doctoral des critiques. Qui donc avait prétendu que les Français étaient d'aimables fantaisistes, qui ne croyaient à rien? Ceux que voyait Christophe étaient enharnachés de plus de science musicale,—même quand ils ne savaient rien,—que toute la critique d'outre-Rhin.
En ce temps-là, les critiques musicaux français s'étaient décidés à apprendre la musique. Il y en avait même quelques-uns qui la savaient: c'étaient des originaux; ils s'étaient donné la peine de réfléchir sur leur art et de penser par eux-mêmes. Ceux-là, naturellement, n'étaient pas très connus: ils restaient cantonnés dans leurs petites revues; à une ou deux exceptions près, les journaux n'étaient pas pour eux. Braves gens, intelligents, intéressants, que leur isolement inclinait parfois au paradoxe, et l'habitude de causer tout seuls, à l'intolérance de jugement et au bavardage.—Les autres avaient appris hâtivement les rudiments de l'harmonie; et ils restaient ébahis devant leur science récente. Ainsi que monsieur Jourdain, lorsqu'il vient d'apprendre les règles de la grammaire, ils étaient dans l'émerveillement:
—D, a, Da, F, a, Fa, R, a, Ra... Ah! que cela est beau!... Ah! la belle chose que de savoir quelque chose!...
Ils ne parlaient plus que de sujet et de contre-sujet, d'harmoniques et de sons résultants, d'enchaînements de neuvièmes et de successions de tierces majeures. Quand ils avaient nommé les suites d'harmonies qui se déroulaient dans une page, ils s'épongeaient le front avec fierté: ils croyaient avoir expliqué le morceau; ils croyaient presque l'avoir écrit. À vrai dire, ils n'avaient fait que le répéter, en termes d'école, comme un collégien qui fait l'analyse grammaticale d'une page de Cicéron. Mais il était si difficile aux meilleurs de concevoir la musique comme une langue naturelle de l'âme que, lorsqu'ils n'en faisaient pas une succursale de la peinture, ils la logeaient dans les faubourgs de la science, et ils la réduisaient à des problèmes de construction harmonique. Des gens aussi savants devaient naturellement en remontrer aux musiciens passés. Ils trouvaient des fautes dans Beethoven, donnaient de la férule à Wagner. Pour Berlioz et pour Gluck, ils en faisaient des gorges chaudes. Rien n'existait pour eux, à cette heure de la mode, que Jean-Sébastien Bach, et Claude Debussy. Encore le premier, dont on avait beaucoup abusé dans ces dernières années, commençait-il à paraître pédant, perruque, et, pour tout dire, un peu coco. Les gens très distingués prônaient mystérieusement Rameau, et Couperin dit le Grand.
Entre ces savants hommes, des luttes épiques s'élevaient. Ils étaient tous musiciens; mais comme ils ne l'étaient pas tous de la même manière, ils prétendaient, chacun, que sa manière seule était la bonne, et ils criaient: raca! sur celles de leurs confrères. Ils se traitaient mutuellement de faux littérateurs et de faux savants; ils se lançaient à la tête les mots d'idéalisme et de matérialisme, de symbolisme et de vérisme, de subjectivisme et d'objectivisme. Christophe se disait que ce n'était pas la peine d'être venu d'Allemagne, pour trouver à Paris des querelles d'Allemands. Au lieu de savoir gré à la bonne musique de leur offrir à tous tant de façons diverses d'en jouir, ils ne toléraient pas d'autre façon que la leur; et un nouveau Lutrin, une guerre acharnée, divisait en ce moment les musiciens en deux armées: celle du contrepoint, et celle de l'harmonie. Comme les Gros-boutiens et les Petits-boutiens, les uns soutenaient âprement que la musique devait se lire horizontalement, et les autres qu'elle devait se lire verticalement. Ceux-ci ne voulaient entendre parler que d'accords savoureux, d'enchaînements fondants, d'harmonies succulentes: ils parlaient de musique, comme d'une boutique de pâtisserie. Ceux-là n'admettaient point qu'on s'occupât de l'oreille, cette guenille: la musique était pour eux un discours, une Assemblée parlementaire, où les orateurs parlaient tous à la fois, sans s'occuper de leurs voisins, jusqu'à ce qu'ils eussent fini; tant pis si on ne les entendait pas! On pourrait lire leurs discours, le lendemain, au Journal officiel: la musique était faite pour être lue, et non pour être entendue. Quand Christophe ouït parler, pour la première fois, de cette querelle entre les Horizontalistes et les Verticalistes, il pensa qu'ils étaient tous fous. Sommé de prendre parti entre l'armée de la Succession et l'armée de la Superposition, il leur répondit par sa devise habituelle, qui n'était pas tout à fait celle de Sosie:
—Messieurs, ennemi de tout le monde!
Et comme ils insistaient, demandant:
—De l'harmonie et du contrepoint, qu'est-ce qui importe le plus en musique?
Il répondit:
—La musique. Montrez-moi donc la vôtre!
Sur leur musique, ils étaient tous d'accord. Ces batailleurs intrépides, qui se gourmaient à qui mieux mieux, quand ils ne gourmaient point quelque vieux mort illustre, dont la célébrité avait trop duré, se trouvaient réconciliés en une passion commune: l'ardeur de leur patriotisme musical. La France était pour eux le grand peuple musical. Ils proclamaient sur tous les tons la déchéance de l'Allemagne.—Christophe n'en était pas blessé. Il l'avait tellement décrétée lui-même qu'il ne pouvait de bonne foi contredire à ce jugement. Mais la suprématie de la musique française l'étonnait un peu: à vrai dire, il en voyait peu de traces dans le passé. Les musiciens français affirmaient cependant que leur art avait été admirable, en des temps très anciens. Pour mieux glorifier la musique française, ils commençaient par ridiculiser toutes les gloires françaises du siècle dernier, à part celle d'un seul maître très bon, très pur, qui était Belge. Cette exécution faite, on en était plus à l'aise pour admirer des maîtres archaïques, qui tous étaient oubliés, et dont certains étaient restés jusqu'à ce jour totalement inconnus. Au rebours des écoles laïques de France, qui font dater le monde de la Révolution française, les musiciens regardaient celle-ci comme une chaîne de montagnes, qu'il fallait gravir pour contempler, derrière, l'âge d'or de la musique, l'Eldorado de l'art. Après une longue éclipse, l'âge d'or allait renaître: la dure muraille s'effondrait; un magicien des sons faisait refleurir un printemps merveilleux; le vieux arbre de musique revêtait un jeune plumage tendre; dans le parterre d'harmonies, mille fleurs ouvraient leurs yeux riants à l'aurore nouvelle; on entendait bruire les sources argentines, le chant frais des ruisseaux: ... C'était une idylle.
Christophe était ravi. Mais quand il regardait les affiches des théâtres parisiens, il y voyait toujours les noms de Meyerbeer, de Gounod, de Massenet, voire de Mascagni et de Leoncavallo, qu'il ne connaissait que trop; et il demandait à ses amis si cette musique impudente, ces pâmoisons de filles, ces fleurs artificielles, cette boutique de parfumeur, étaient les jardins d'Armide, qu'ils lui avaient promis. Ils se récriaient, d'un air offensé: c'étaient, à les en croire, les derniers vestiges d'un âge moribond; personne n'y songeait plus.—À la vérité, Cavalleria Rusticana trônait à l'Opéra-Comique, et Pagliacci à l'Opéra; Massenet et Gounod faisaient le maximum; et la trinité musicale: Mignon, Les Huguenots et Faust, avaient gaillardement passé le cap de la millième représentation.—Mais c'étaient là des accidents sans importance; il n'y avait qu'à ne pas les voir. Quand un fait impertinent dérange une théorie, rien n'est plus simple que de le nier. Les critiques français niaient ces œuvres effrontées, ils niaient le public qui les applaudissait; et il n'aurait pas fallu les pousser beaucoup pour leur faire nier le théâtre musical tout entier. Le théâtre musical était pour eux un genre littéraire, donc impur. (Comme ils étaient tous littérateurs, ils se défendaient tous de l'être.) Toute musique expressive, descriptive, suggestive, en un mot toute musique qui voulait dire quelque chose, était taxée d'impure.—Dans chaque Français, il y a un Robespierre. Il faut toujours qu'il décapite quelqu'un ou quelque chose, afin de le rendre pur.—Les grands critiques français n'admettaient que la musique pure, et laissaient l'autre à la canaille.
Christophe se sentait mortifié, en songeant combien son goût était canaille. Ce qui le consolait un peu, c'était de voir que tous ces musiciens qui méprisaient le théâtre écrivaient pour le théâtre: il n'en était pas un qui ne composât des opéras.—Mais c'était là sans doute encore un accident sans importance. Il fallait les juger, comme ils le voulaient être, d'après leur musique pure. Christophe chercha leur musique pure.
Théophile Goujart le conduisit aux concerts d'une Société qui se consacrait à l'art national. Là, les gloires nouvelles étaient élaborées et couvées longuement. C'était un grand cénacle, une petite église, à plusieurs chapelles. Chaque chapelle avait son saint, chaque saint avait ses clients, qui médisaient volontiers du saint de la chapelle voisine. Entre tous ces saints, Christophe ne fit d'abord pas grande différence. Comme c'était naturel, avec ses habitudes d'un art tout autre, il ne comprenait rien à cette musique nouvelle, et comprenait d'autant moins qu'il croyait la comprendre.
Tout lui semblait baigné dans un demi-jour perpétuel. On eût dit une grisaille, où les lignes s'estompaient, s'enfonçaient, émergeaient par moments, s'effaçaient de nouveau. Parmi ces lignes, il y avait des dessins raides, rêches et secs, tracés comme à l'équerre, qui se repliaient avec des angles pointus, comme le coude d'une femme maigre. Il y en avait d'onduleux, qui se tortillaient comme des fumées de cigares. Mais tous étaient dans le gris. N'y avait-il donc plus de soleil en France? Christophe, qui, depuis son arrivée à Paris, n'avait eu que la pluie et le brouillard, était porté à le croire; mais c'est le rôle de l'artiste de créer le soleil, lorsqu'il n'y en a pas. Ceux-ci allumaient bien leur petite lanterne; seulement, elle était comme celle des vers luisants: elle ne réchauffait rien et éclairait à peine. Les titres des œuvres changeaient: il était parfois question de printemps, de midi, d'amour, de joie de vivre, de course à travers les champs; la musique, elle, ne changeait point; elle était uniformément douce, pâle, engourdie, anémique, étiolée.—C'était alors la mode en France, parmi les délicats, de parler bas en musique. Et l'on avait raison: car dès qu'on parlait haut, c'était pour crier: pas de milieu. On n'avait le choix qu'entre un assoupissement distingué et des déclamations de mélo.
Christophe, secouant la torpeur qui commençait à le gagner, regarda son programme; et il fut surpris de voir que ces petits brouillards qui passaient dans le ciel gris avaient la prétention de représenter des sujets précis. Car, en dépit des théories, cette musique pure était presque toujours de la musique à programme, ou tout au moins à sujets. Ils avaient beau médire de la littérature: il leur fallait une béquille littéraire sur laquelle s'appuyer. Étranges béquilles! Christophe remarqua la puérilité bizarre des sujets qu'ils s'astreignaient à peindre. C'étaient des vergers, des potagers, des poulaillers, des ménageries musicales, de vrais Jardins des Plantes. Certains transposaient pour orchestre ou pour piano les tableaux du Louvre, ou les fresques de l'Opéra; ils mettaient en musique Cuyp, Baudry, et Paul Potter; des notes explicatives aidaient à reconnaître, ici la pomme de Pâris, là l'auberge hollandaise, ou la croupe d'un cheval blanc. Cela semblait à Christophe des jeux de vieux enfants, qui ne s'intéressaient qu'à des images et qui, ne sachant pas dessiner, barbouillaient leurs cahiers de tout ce qui leur passait par la tête, inscrivant naïvement au-dessous, en grosses lettres, que c'était le portrait d'une maison ou d'un arbre.
À côté de ces imagiers aveugles, qui voyaient avec leurs oreilles, il y avait aussi des philosophes: ils traitaient en musique des problèmes métaphysiques; leurs symphonies étaient la lutte de principes abstraits, l'exposé d'un symbole ou d'une religion. Les mêmes, dans leurs opéras, abordaient l'étude des questions juridiques et sociales de leur temps: la Déclaration des Droits de la Femme et du Citoyen. On ne désespérait pas de mettre sur le chantier la question du divorce, la recherche de la paternité, et la séparation de l'Église et de l'État. Ils se divisaient en deux camps: les symbolistes laïques et les symbolistes cléricaux. Ils faisaient chanter des chiffonniers philosophes, des grisettes sociologues, des boulangers prophétiques, des pêcheurs apostoliques. Gœthe parlait déjà des artistes de son époque, «qui reproduisaient les idées de Kant dans des tableaux allégoriques». Ceux du temps de Christophe mettaient la sociologie en doubles croches. Zola, Nietzsche, Maeterlinck, Barrés, Jaurès, Mendès, l'Évangile et le Moulin Rouge, alimentaient la citerne, où les auteurs d'opéras et de symphonies venaient puiser leurs pensées. Nombre d'entre eux, grisés par l'exemple de Wagner, s'étaient écriés: «Et moi aussi, je suis poète!»—et ils alignaient avec confiance sous leurs lignes de musique des bouts-rimés, ou non rimés, en style d'école primaire ou de feuilleton décadent.
Tous ces penseurs et ces poètes étaient des partisans de la musique pure. Mais ils aimaient mieux en parler qu'en écrire.—Il leur arrivait pourtant quelquefois d'en écrire. C'était alors de la musique qui ne voulait rien dire. Le malheur était qu'elle y réussissait souvent: elle ne disait rien du tout—du moins à Christophe.—Il est vrai qu'il n'en avait pas la clef.
Pour comprendre une musique étrangère, on doit se donner la peine d'en apprendre la langue, et ne pas croire qu'on la sait d'avance. Christophe le croyait, comme tout bon Allemand. Il était excusable. Beaucoup de Français eux-mêmes ne la comprenaient pas mieux que lui. Comme ces Allemands du temps du roi Louis XIV, qui s'évertuaient à parler français et qui avaient fini par oublier leur langue, les musiciens français du XIXe siècle avaient si longtemps désappris la leur que leur musique était devenue un idiome étranger. Ce n'était que depuis peu qu'un mouvement avait commencé pour parler français en France. Ils n'y réussissaient pas tous: l'habitude était bien forte; et à part quelques-uns, leur français était belge, ou gardait un fumet germanique. Il était donc naturel qu'un Allemand s'y trompât et déclarât, avec son assurance ordinaire, que c'était là du mauvais allemand, qui ne signifiait rien, puisque lui, n'y comprenait rien.
Christophe ne s'en faisait pas faute. Les symphonies françaises lui semblaient une dialectique abstraite, où les thèmes musicaux s'opposaient ou se superposaient, à la façon d'opérations arithmétiques: pour exprimer leurs combinaisons, on aurait pu aussi bien les remplacer par des chiffres, ou par des lettres de l'alphabet. L'un bâtissait une œuvre sur l'épanouissement progressif d'une formule sonore, qui, n'apparaissant complète que dans la dernière page de la dernière partie, restait â l'état de larve pendant les neuf dixièmes de l'œuvre. L'autre échafaudait des variations sur un thème, qui ne se montrait qu'à la fin, descendant peu à peu du compliqué au simple. C'étaient des joujoux très savants. Il fallait être à la fois très vieux et très enfant pour pouvoir s'en amuser. Cela avait coûté aux inventeurs des efforts inouïs. Ils mettaient des années à écrire une fantaisie. Ils se faisaient des cheveux blancs à chercher de nouvelles combinaisons d'accords,—pour exprimer...? Peu importe! Des expressions nouvelles. Comme l'organe crée le besoin, dit-on, l'expression finit toujours par créer la pensée: l'essentiel est qu'elle soit nouvelle. Du nouveau, à tout prix! Ils avaient la frayeur maladive du «déjà dit». Les meilleurs en étaient paralysés. On sentait qu'ils étaient toujours occupés à se surveiller peureusement, à effacer ce qu'ils avaient écrit, à se demander: «Ah! mon Dieu! où est-ce que j'ai déjà lu cela?»... Il y a des musiciens,—surtout en Allemagne,—qui passent leur temps à coller bout à bout les phrases des autres. Ceux de France contrôlaient, pour chacune de leurs phrases, si elle ne se trouvait pas dans leurs listes de mélodies déjà employées par d'autres, et à gratter, gratter, changer la forme de son nez, jusqu'à ce qu'il ne ressemblât plus à aucun nez connu, ni même à aucun nez.
Avec tout cela, ils ne trompaient pas Christophe: ils avaient beau s'affubler d'un langage compliqué et mimer des emportements surhumains, des convulsions d'orchestre, ou cultiver des harmonies inorganiques, des monotonies obsédantes, des déclamations à la Sarah-Bernhardt, qui partaient à côté du ton, et continuaient, pendant des heures, à marcher, comme des mulets, à demi assoupis, sur le bord de la pente glissante,—Christophe retrouvait, sous le masque, de petites âmes froides et fades, outrageusement parfumées, à la façon de Gounod et de Massenet, mais avec moins de naturel. Et il se redisait le mot injuste de Gluck, à propos des Français:
—Laissez-les faire: ils retourneront toujours à leurs ponts-neufs.
Seulement, ils s'appliquaient à les rendre très savants. Ils prenaient des chansons populaires pour thèmes de symphonies doctorales, comme des thèses de Sorbonne. C'était le grand jeu du jour. Tous les chants populaires et de tous les pays y passaient à tour de rôle.—Ils faisaient avec cela des Neuvième Symphonie et des Quatuor de Franck, mais beaucoup plus difficiles. L'un d'eux pensait-il une petite phrase bien claire? Vite, il se hâtait d'en introduire une seconde au milieu, qui ne signifiait rien, mais qui râpait cruellement contre la première.—Et l'on sentait que ces pauvres gens étaient si calmes, si pondérés!...
Pour conduire ces œuvres, un jeune chef d'orchestre, correct et hagard, se démenait, foudroyait, faisait des gestes à la Michel-Ange, comme s'il s'agissait de soulever des armées de Beethoven ou de Wagner. Le public, composé de mondains qui mouraient d'ennui, mais qui pour rien au monde n'eussent renoncé à l'honneur de payer chèrement un ennui glorieux, et de petits apprentis, heureux de se prouver leur science d'école, en démêlant au passage les ficelles du métier, dépensait un enthousiasme frénétique, comme les gestes du chef d'orchestre et les clameurs de la musique...
—Tu parles!... disait Christophe.
(Car il était devenu un Parisien accompli.)
Mais il est plus facile de pénétrer l'argot de Paris que sa musique. Christophe jugeait, avec la passion qu'il mettait à tout, et avec l'incapacité native des Allemands à comprendre l'art français. Du moins, il était de bonne foi et ne demandait qu'à reconnaître ses erreurs, si on lui prouvait qu'il s'était trompé. Aussi, ne se regardait-il point comme lié par son jugement, et il laissait la porte grande ouverte aux impressions nouvelles, qui pourraient le changer.
Dès à présent, il ne laissait pas de reconnaître dans cette musique beaucoup de talent, un matériel intéressant, de curieuses trouvailles de rythmes et d'harmonies, un assortiment d'étoffes fines, moelleuses et brillantes, un papillotage de couleurs, une dépense continuelle d'invention et d'esprit. Christophe s'en amusait, et il en faisait son profit. Tous ces petits maîtres avaient infiniment plus de liberté d'esprit que les musiciens d'Allemagne; ils quittaient bravement la grande route, et se lançaient à travers bois. Ils cherchaient à se perdre. Mais c'étaient de si sages petits enfants qu'ils n'y parvenaient point. Les uns, au bout de vingt pas, retombaient sur le grand chemin. Les autres se lassaient tout de suite, s'arrêtaient n'importe où. Il y en avait qui étaient presque arrivés à des sentiers nouveaux; mais, au lieu de poursuivre, ils s'asseyaient à la lisière, et musaient sous un arbre. Ce qui leur manquait le plus, c'était la volonté, la force; ils avaient tous les dons,—moins un: la vie puissante. Surtout, il semblait que cette quantité d'efforts fussent utilisés d'une façon confuse et se perdissent en route. Il était rare que ces artistes sussent prendre nettement conscience de leur nature et coordonner leurs forces avec constance en vue d'un but donné. Effet ordinaire de l'anarchie française: elle dépense des ressources énormes de talent et de bonne volonté à s'annihiler par ses incertitudes et ses contradictions. Il était presque sans exemple qu'un de leurs grands musiciens, un Berlioz, un Saint-Saëns,—pour ne pas nommer les plus récents,—ne se fût pas embourbé en soi-même, acharné à se détruire, renié, faute d'énergie, faute de foi, faute surtout de boussole intérieure.
Christophe, avec le dédain insolent des Allemands d'alors, pensait:
—Les Français ne savent que se gaspiller en inventions dont ils ne font rien. Il leur faut toujours un maître d'une autre race, un Gluck ou un Napoléon, qui vienne tirer parti de leurs Révolutions.
Et il souriait a l'idée d'un Dix-huit Brumaire.
Cependant, au milieu de l'anarchie, un groupe s'efforçait de restaurer l'ordre et la discipline dans l'esprit des artistes. Pour commencer, il avait pris un nom latin, évoquant le souvenir d'une institution cléricale, qui avait fleuri, il y avait quelque quatorze cents ans, au temps de la grande Invasion des Goths et des Vandales. Christophe était un peu surpris que l'on remontât si loin. Certes, il est bon de dominer son temps. Mais on pouvait craindre qu'une tour de quatorze siècles de haut ne fut un observatoire incommode, d'où il fût plus aisé de suivre les mouvements des étoiles que ceux des hommes d'aujourd'hui. Christophe se rassura vite, en voyant que les fils de saint Grégoire ne restaient que rarement sur leur tour; ils y montaient seulement, afin de sonneries cloches. Tout le reste du temps, ils le passaient a l'église d'en bas. Christophe, qui assista à quelques-uns des offices, fut un peu de temps avant de s'apercevoir qu'ils étaient du culte catholique; il était convaincu d'abord qu'ils appartenaient au rite de quelque petite secte protestante. Un public prosterné; des disciples peux, intolérants, volontiers agressifs; à leur tête, un homme très pur, très froid, volontaire et un peu enfantin, maintenant l'intégrité de la doctrine religieuse, morale et artistique, expliquant en termes abstraits l'Évangile de la musique au petit peuple des Élus, et damnant avec tranquillité l'Orgueil et l'Hérésie. Il leur attribuait toutes les fautes de l'art et les vices de l'humanité: la Renaissance, la Réforme, et le judaïsme actuel, qu'il mettait dans le même sac. Les juifs de la musique étaient brûlés en effigie, après avoir été affublés de costumes infamants. Le colossal Hændel recevait les étrivières. Seul, Jean-Sébastien Bach obtenait d'être sauvé, par la grâce du Seigneur, qui reconnaissait en lui «un protestant par erreur».
Le temple de la rue Saint-Jacques exerçait un apostolat: on y sauvait les âmes et la musique. On enseignait méthodiquement les règles du génie. De laborieux élèves appliquaient ces recettes, avec beaucoup de peine et une certitude absolue. On eût dit qu'ils voulaient racheter par leurs pieuses fatigues la légèreté coupable de leurs grands-pères: les Auber, les Adam, et cet archidamné, cet âne diabolique, Berlioz, le diable en personne, diabolus in musica. Avec une louable ardeur et une piété sincère, on répandait le culte des maîtres reconnus. En une dizaine d'années, l'œuvre accomplie était considérable; la musique française en était transformée. Ce n'étaient pas seulement les critiques français, c'étaient les musiciens eux-mêmes qui avaient appris la musique. On voyait maintenant des compositeurs, et jusqu'à des virtuoses, qui connaissaient l'œuvre de Bach!—Surtout, on avait fait un grand effort pour combattre l'esprit casanier des Français. Ces gens-là se calfeutrent chez eux; ils ont peine à sortir. Aussi, leur musique manque d'air: musique de chambre close, de chaise longue, musique qui ne marche pas. Tout le contraire d'un Beethoven, composant à travers les champs, dégringolant les pentes, marchant à grandes enjambées, sous le soleil et la pluie, et effrayant les troupeaux par ses gestes et par ses cris! Il n'y avait pas de danger que les musiciens de Paris dérangeassent leurs voisins par le fracas de leur inspiration, comme l'ours de Bonn. Ils mettaient, quand ils composaient, une sourdine à leur pensée; et des tentures empêchaient les bruits du dehors d'arriver jusqu'à eux.
La Schola avait tâché de renouveler l'air; elle avait ouvert les fenêtres sur le passé. Sur le passé seulement. C'était les ouvrir sur la cour, et non pas sur la rue. Cela ne servait pas à grand'chose. À peine la fenêtre ouverte, ils repoussaient le battant, comme de vieilles dames qui ont peur de s'enrhumer. Il entrait par là quelques bouffées du moyen âge, de Bach, de Palestrina, de chansons populaires. Mais qu'était-ce que cela? La chambre n'en continuait pas moins de sentir le renfermé. Au fond, ils s'y trouvaient bien; ils se méfiaient des grands courants modernes. Et s'ils connaissaient plus de choses que les autres, ils niaient aussi plus de choses. La musique prenait dans ce milieu un caractère doctrinal; ce n'était pas un délassement: les concerts devenaient des leçons d'histoire, ou des exemples d'édification. On académisait les pensées avancées. Le grand Bach, torrentueux, était reçu, assagi, dans le giron de l'Église. Sa musique subissait dans le cerveau scholastique une transformation analogue à celle de la Bible furibonde et sensuelle dans des cerveaux d'Anglais. La doctrine qu'on prônait était un éclectisme aristocratique, qui s'efforçait d'unir les caractères distinctifs de trois ou quatre grandes époques musicales, du VIe au XXe siècle. S'il avait été possible de la réaliser, on eût obtenu en musique l'équivalent de ces constructions hybrides, élevées par un vice-roi des Indes, au retour de ses voyages, avec des matériaux précieux, ramassés à tous les coins du globe. Mais le bon sens français les sauvait des excès de cette barbarie érudite; ils se gardaient bien d'appliquer leurs théories; ils agissaient avec elles, comme Molière avec ses médecins: ils prenaient l'ordonnance, et ils ne la suivaient pas. Les plus forts allaient leur chemin. Le reste du troupeau s'en tenait dans la pratique à des exercices savants de contrepoint fort durs: on les nommait sonates, quatuors et symphonies...—«Sonate, que me veux-tu?»—Elle ne voulait rien du tout, qu'être une sonate. La pensée en était abstraite et anonyme, appliquée et sans joie. C'était un art de parfait notaire. Christophe, qui avait d'abord su gré aux Français de ne pas aimer Brahms, se disait à présent qu'il y avait beaucoup de petits Brahms en France. Tous ces bons ouvriers, laborieux, consciencieux, étaient pleins de vertus. Christophe sortit de leur compagnie, extrêmement édifié, mais pénétré d'ennui. C'était très bien, très bien...
Qu'il faisait beau, dehors!
Il y avait pourtant à Paris, parmi les musiciens, quelques indépendants, dégagés de toute école. C'étaient les seuls qui intéressassent Christophe. Seuls, ils peuvent donner la mesure de la vitalité d'un art. Écoles et cénacles n'en expriment qu'une mode superficielle ou des théories fabriquées. Mais les indépendants, qui se retirent en eux-mêmes, ont plus de chances d'y trouver la pensée véritable de leur temps et de leur race. Il est vrai que, par là, ils sont pour un étranger plus difficiles encore à comprendre que les autres.
Ce fut ce qui advint, quand Christophe entendit pour la première fois cette œuvre fameuse, dont les Français disaient mille extravagances, et que certains proclamaient la plus grande révolution musicale accomplie depuis dix siècles.—(Les siècles ne leur coûtent guère! ils sortent peu du leur)...
Théophile Goujart et Sylvain Kohn menèrent Christophe à l'Opéra-Comique, pour entendre Pelléas et Mélisande. Ils étaient tout glorieux de lui montrer cette œuvre: on eût dit qu'ils l'avaient faite. Ils laissaient entendre à Christophe qu'il allait trouver là son chemin de Damas. Le spectacle était commencé qu'ils continuaient encore leurs commentaires. Christophe les fit taire, et écouta de toutes ses oreilles. Après le premier acte, il se pencha vers Sylvain Kohn, qui lui demandait, les yeux brillants:
—Eh bien, mon vieux lapin, qu'est-ce que vous en dites? Et il dit:
—Est-ce que c'est, tout le temps, comme cela?
—Oui.
—Mais il n'y a rien.
Kohn se récria, et le traita de philistin.
—Rien du tout, continuait Christophe. Pas de musique. Pas de développement. Cela ne se suit pas. Cela ne se tient pas. Des harmonies très fines. De petits effets d'orchestre très bons, de très bon goût. Mais ce n'est rien, rien du tout...
Il se remit à écouter. Peu à peu, la lanterne s'éclairait; il commençait a apercevoir quelque chose dans le demi-jour. Oui, il comprenait bien qu'il y avait là un parti pris de sobriété contre l'idéal wagnérien, qui engloutissait le drame sous les flots de la musique; mais il se demandait, avec quelque ironie, si cet idéal de sacrifice ne venait pas de ce que l'on sacrifiait ce que l'on ne possédait pas. Il sentait dans l'œuvre la peur de la peine, la recherche de l'effet produit avec le minimum de fatigue, le renoncement par indolence au rude effort que réclament les puissantes constructions wagnériennes. Il n'était pas sans être frappé par la déclamation unie, simple, modeste, atténuée, bien qu'elle lui parût monotone et qu'en sa qualité d'Allemand il ne la trouvât pas vraie:—(il trouvait que plus elle cherchait à être vraie, plus elle faisait sentir combien la langue française convenait mal à la musique: trop logique, trop dessinée, de contours trop définis, un monde parlait en soi, mais hermétiquement clos.)—Néanmoins, l'essai était curieux, et Christophe en approuvait l'esprit de réaction révolutionnaire contre les violences emphatiques de l'art wagnérien. Le musicien français semblait s'être appliqué, avec une discrétion ironique, à ce que tous les sentiments passionnés se murmurassent à mi-voix. L'amour, la mort sans cris. Ce n'était que par un tressaillement imperceptible de la ligne mélodique, un frisson de l'orchestre comme un pli au coin des lèvres, que l'on avait conscience du drame qui se jouait dans les âmes. On eût dit que l'artiste tremblait de se livrer. Il avait le génie du goût,—sauf à certains instants, où le Massenet qui sommeille dans tous les cœurs français se réveillait pour faire du lyrisme. Alors on retrouvait les cheveux trop blonds, les lèvres trop rouges,—la bourgeoise de la Troisième République qui joue la grande amoureuse. Mais ces instants étaient exceptionnels: c'était une détente à la contrainte que l'auteur s'imposait; dans le reste de l'œuvre régnait une simplicité raffinée, une simplicité qui n'était pas simple, qui était le produit de la volonté, la fleur subtile d'une vieille société. Le jeune Barbare qu'était Christophe ne la goûtait qu'à demi. Surtout, l'ensemble du drame, le poème l'agaçait. Il croyait voir une Parisienne sur le retour, qui jouait l'enfant et se faisait raconter des contes de fées. Ce n'était plus le gnangnan wagnérien, sentimental et lourdaud, comme une grosse fille du Rhin. Mais le gnangnan franco-belge ne valait pas mieux, avec ses minauderies et ses bêtasseries de salon:—«les cheveux», «le petit père», les «colombes»,—et tout ce mystérieux à l'usage des femmes du monde. Les âmes parisiennes se miraient dans cette pièce, qui leur renvoyait, comme un tableau flatteur, l'image de leur fatalisme alangui, de leur nirvana de boudoir, de leur moelleuse mélancolie. De volonté, aucune trace. Nul ne savait ce qu'il voulait. Nul ne savait ce qu'il faisait.
—«Ce n'est pas ma faute! Ce n'est pas ma faute!...» gémissaient ces grands enfants. Tout le long des cinq actes, qui se déroulaient dans un crépuscule perpétuel—forêts, cavernes, souterrains, chambre mortuaire,—de petits oiseaux des îles se débattaient, à peine. Pauvres petits oiseaux! jolis, tièdes et fins... Quelle peur ils avaient de la lumière trop vive, de la brutalité des gestes, des mots, des passions, de la vie!... La vie n'est pas raffinée. La vie ne se prend pas avec des gants...
Christophe entendait venir le roulement des canons, qui allaient broyer cette civilisation épuisée, cette petite Grèce expirante.
Était-ce ce sentiment de pitié orgueilleuse qui lui inspirait malgré tout une sympathie pour cette œuvre? Toujours est-il qu'elle l'intéressait, plus qu'il n'en voulait convenir. Quoiqu'il persistât à répondre à Sylvain Kohn, au sortir du théâtre, que «c'était très fin, très fin, mais que cela manquait de Schwung (d'élan), et qu'il n'y avait pas là assez de musique pour lui», il se gardait bien de confondre Pelléas avec les autres œuvres musicales françaises. Il était attiré par cette lampe qui brûlait au milieu du brouillard. Il apercevait encore d'autres lueurs, vives, fantasques, qui tremblotaient autour. Ces feux-follets l'intriguaient: il eût voulu s'en approcher pour savoir com ment ils brillaient; mais ils n'étaient pas faciles à saisir. Ces libres musiciens, que Christophe ne comprenait pas, et qu'il était d'autant plus curieux d'observer, étaient peu abordables. Ils semblaient manquer du grand besoin de sympathie, qui possédait Christophe. À part un ou deux, ils lisaient peu, connaissaient peu, désiraient peu connaître. Presque tous vivaient à l'écart, isolés, de fait et de volonté, enfermés dans un cercle étroit,—par orgueil, par sauvagerie, par dégoût, par apathie. Si peu nombreux qu'ils fussent, ils étaient divisés en petits groupes rivaux, qui ne pouvaient vivre ensemble. Ils étaient d'une susceptibilité extrême, et ne supportaient ni leurs ennemis, ni leurs rivaux, ni même leurs amis, quand ceux-ci osaient admirer un autre musicien, ou quand ils se permettaient de les admirer d'une façon ou trop froide, ou trop exaltée, ou trop banale, ou trop excentrique. Il devenait excessivement difficile de les satisfaire. Chacun d'eux avait fini par accréditer un critique, muni de sa patente, qui veillait jalousement au pied de la statue. Il n'y fallait point toucher.—Pour n'être compris que d'eux-mêmes, ils n'en étaient pas mieux compris. Adulés, déformés par l'opinion que leurs partisans avaient d'eux et qu'ils s'en faisaient eux-mêmes, ils perdaient pied dans la conscience qu'ils avaient de leur art et de leur génie. D'aimables fantaisistes se croyaient réformateurs. Des artistes Alexandrins se posaient en rivaux de Wagner. Presque tous étaient victimes de la surenchère. Il fallait qu'ils sautassent, chaque jour, plus haut qu'ils n'avaient sauté, la veille, et que leurs rivaux n'avaient sauté. Ces exercices de haute voltige ne leur réussissaient pas toujours; et cela n'avait d'attrait que pour quelques professionnels. Ils ne se souciaient pas du public; le public ne se souciait pas d'eux. Leur art était un art sans peuple, une musique qui ne s'alimentait que dans la musique, dans le métier. Or Christophe avait l'impression, vraie ou fausse, qu'aucune musique, plus que celle de France, n'aurait eu besoin de chercher un appui en dehors d'elle. Cette plante souple et grimpante ne pouvait se passer d'étai: elle ne pouvait se passer de littérature. Elle ne trouvait pas en elle assez de raisons de vivre. Elle avait le souffle court, peu de sang, pas de volonté. Elle était comme une femme alanguie, qui attend un mâle qui la prenne. Mais cette impératrice de Byzance, au corps fluet, exsangue, et chargé de pierreries, était entourée d'eunuques: snobs, esthètes, et critiques. La nation n'était pas musicienne; et tout cet engouement, bruyamment proclamé depuis vingt ans, pour Wagner, Beethoven, ou Bach, ou Debussy, ne dépassait guère une caste. Cette multiplication de concerts, cette marée envahissante de musique à tout prix, ne répondaient pas à un développement réel du goût public. C'était un surmenage de la mode, qui ne touchait que l'élite et qui la détraquait. La musique n'était vraiment aimée que d'une poignée de gens; et ce n'étaient pas toujours ceux qui s'en occupaient le plus: compositeurs et critiques. Il y a si peu de musiciens en France, qui aiment vraiment la musique!
Ainsi pensait Christophe; et il ne se disait pas que c'est partout ainsi, que même en Allemagne il n'y a pas beaucoup plus de vrais musiciens, et que ce qui compte en art, ce ne sont pas les milliers qui n'y comprennent rien, mais la poignée de gens qui l'aiment et qui le servent avec une fière humilité. Les avait-il vus, en France? Créateurs et critiques,—les meilleurs travaillaient en silence, loin du bruit, comme Franck avait fait, comme faisaient les mieux doués des compositeurs d'à présent, tant d'artistes qui vivraient toute leur vie dans l'ombre, pour fournir plus tard à quelque journaliste la gloire de les découvrir et de se dire leur ami,—et cette petite armée de savants laborieux, qui, sans ambition, insoucieux d'eux-mêmes, relevaient pierre à pierre la grandeur de la France passée, ou qui, s'étant voués à l'éducation musicale du pays, préparaient la grandeur de la France à venir. Combien il y avait là d'esprits, dont la richesse, la liberté, la curiosité universelle eût attiré Christophe, s'il avait pu les connaître! Mais à peine avait-il entrevu, en passant, deux ou trois d'entre eux; il ne les connaissait qu'à travers des caricatures de leur pensée. Il ne voyait que leurs défauts, copiés, exagérés par les singes de l'art et les commis voyageurs de la presse.
Cette plèbe musicale l'écœurait surtout par son formalisme. Jamais il n'était question entre eux d'autre chose que de la forme. Du sentiment, du caractère, de la vie, pas un mot! Pas un ne se doutait que tout vrai musicien vit dans un univers sonore, et que ses journées se déroulent en lui, comme un flot de musique. La musique est l'air qu'il respire, le ciel qui l'enveloppe. Même son âme est musique; musique, tout ce qu'elle aime, hait, souffre, craint, espère. Une âme musicale, quand elle aime un beau corps, le voit comme une musique. Les chers yeux qui la charment ne sont ni bleus, ni gris, ni bruns: ils sont musique; elle éprouve, à les voir, l'impression d'un accord délicieux. Cette musique intérieure est mille fois plus riche que celle qui l'exprime, et le clavier est inférieur à celui qui en joue. Le génie se mesure à la puissance de la vie, que tâche d'évoquer Part, cet instrument imparfait.—Mais combien de gens s'en doutent en France? Pour ce peuple de chimistes, la musique semble n'être que l'art de combiner des sons. Ils prennent l'alphabet pour le livre. Christophe haussait les épaules, quand il les entendait dire que, pour comprendre l'art, il faut faire abstraction de l'homme. Ils apportaient à ce paradoxe une grande satisfaction: car ils croyaient ainsi se prouver leur musicalité. Jusqu'à Goujart, ce niais qui n'avait jamais pu comprendre comment on pouvait faire pour se rappeler par cœur une page de musique!—(il avait tâché de se faire expliquer ce mystère par Christophe).—Ne prétendait-il pas maintenant lui enseigner que la grandeur d'âme de Beethoven et la sensualité de Wagner n'avaient pas plus de part à leur musique que le modèle d'un peintre n'en a à ses portraits!
—Cela prouve, finit par lui répondre Christophe impatienté, que pour vous un beau corps n'a pas de prix artistique! Pas plus qu'une grande passion! Pauvre homme!... Vous ne vous doutez pas de tout ce que la beauté d'une figure parfaite ajoute à la beauté de la peinture qui la retrace, comme la beauté d'une grande âme à la beauté de la musique qui la reflète?... Pauvre homme!... Le métier seul vous intéresse? Pourvu que ça soit de l'ouvrage bien fait, cela vous est égal ce que l'ouvrage veut dire?... Pauvre homme!... Vous êtes comme ces gens qui n'écoutent pas ce que dit l'orateur, mais le son de sa voix, qui regardent sans comprendre ses gesticulations, et qui trouvent qu'il parle diablement bien?... Pauvre homme! Pauvre homme!... Bougre de crétin!
Mais ce n'était pas seulement telle ou telle théorie qui irritait Christophe, c'étaient toutes les théories. Il était excédé de ces disputes byzantines, de ces conversations de musiciens éternellement sur la musique, uniquement sur la musique. Il y avait de quoi en dégoûter à jamais le meilleur musicien. Christophe pensait, comme Moussorgski, que les musiciens ne feraient pas mal de laisser de temps en temps leur contrepoint et leurs harmonies, pour la lecture des beaux livres et l'expérience de la vie. La musique ne suffit pas à un musicien: ce n'est pas ainsi qu'il arrivera à dominer le siècle et à s'élever au-dessus du néant... La vie! Toute la vie! Tout voir et tout connaître. Aimer, chercher, étreindre la vérité,—la belle Penthésilée, reine des Amazones, qui mord celui qui la baise!
Assez de parlottes musicales, assez de boutiques à fabriquer des accords! Tous ces ragots de cuisine harmonique étaient bien incapables de lui apprendre à trouver une harmonie nouvelle qui ne fût pas un monstre, mais un être vivant!
Il tourna le dos à ces docteurs Wagner, couvant leurs alambics pour faire éclore quelque Homunculus en bouteille; et, s'évadant de la musique française, il tâcha de connaître le milieu littéraire et la société parisienne.
Ce fut par les journaux quotidiens que Christophe fit d'abord connaissance,—comme des millions de gens en France,—avec la littérature française de son temps. Comme il était désireux de se mettre le plus vite possible au diapason de la pensée parisienne, en même temps que de se perfectionner dans la langue, il s'imposa de lire avec beaucoup de conscience les feuilles qu'on lui disait le plus parisiennes. Le premier jour, il lut parmi des faits-divers horrifiants, dont la narration et les instantanés remplissaient plusieurs colonnes, une nouvelle sur un père qui couchait avec sa fille, âgée de quinze ans: la chose était présentée comme toute naturelle, et même assez touchante. Le second jour, il lut dans le même journal une nouvelle sur un père et son fils, âgé de douze ans, qui couchaient avec la même fille. Le troisième jour, il lut une nouvelle sur un frère, qui couchait avec sa sœur. Le quatrième, sur deux sœurs qui couchaient ensemble. Le cinquième... Le cinquième, il jeta le journal, avec un haut-le-cœur, et dit à Sylvain Kohn:
—Ah! ça, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malades?
Sylvain Kohn se mit à rire, et dit:
—C'est de l'art.
Christophe haussa les épaules:
—Vous vous moquez de moi.
Kohn rit de plus belle:
—En aucune façon. Voyez plutôt.
Il montra à Christophe une enquête récente sur l'Art et la Morale, d'où il résultait que «l'Amour sanctifiait tout», que «la Sensualité était le ferment de l'Art», que «l'Art ne pouvait être immoral», que «la morale était une convention inculquée par une éducation jésuitique», et que seule comptait «l'énormité du Désir».—Une suite de certificats littéraires attestaient dans les journaux la pureté d'un roman qui peignait les mœurs des souteneurs. Certains des répondants étaient des plus grands noms de la littérature, ou d'austères critiques. Un poète des familles, bourgeois et catholique, donnait sa bénédiction d'artiste à une peinture très soignée des mauvaises mœurs grecques. Des réclames lyriques exaltaient des romans, où laborieusement s'étalait la Débauche à travers les âges: Rome, Alexandrie, Byzance, la Renaissance italienne et française, le Grand Siècle... c'était un cours complet. Un autre cycle d'études embrassait les divers pays du globe: des écrivains consciencieux s'étaient consacrés, avec une patience de bénédictins, à l'étude des mauvais lieux des cinq parties du monde. On trouvait, parmi ces géographes et ces historiens du rut, des poètes distingués et de parfaits écrivains. On ne les distinguait des autres qu'à leur érudition. Ils disaient en termes impeccables des polissonneries archaïques.
L'affligeant était de voir de braves gens et de vrais artistes, des hommes qui jouissaient dans les lettres françaises d'une juste notoriété, s'évertuer à ce métier pour lequel ils n'étaient point doués. Certains s'épuisaient à écrire, comme les autres, des ordures que les journaux du matin débitaient par tranches. Ils pondaient cela régulièrement, à dates fixes, une ou deux fois par semaine; et cela durait depuis des années. Ils pondaient, pondaient, pondaient, n'ayant plus rien à dire, se torturant le cerveau pour en faire sortir quelque chose de nouveau, saugrenu, incongru: car le public, gorgé, se lassait de tous les plats et trouvait bientôt fades les imaginations de plaisirs les plus dévergondées: il fallait faire l'éternelle surenchère,—surenchère sur les autres, surenchère sur soi-même;—et ils pondaient leur sang, ils pondaient leurs entrailles: c'était un spectacle lamentable et grotesque.
Christophe ne connaissait pas tous les dessous de ce triste métier; et s'il les eût connus, il n'en eût pas été plus indulgent: car rien au monde n'excusait à ses yeux un artiste de vendre l'art pour trente deniers...
—(Même pas d'assurer le bien-être de ceux qu'il aime?
—Même pas.
—Ce n'est pas humain.
—Il ne s'agit pas d'être humain, il s'agit d'être un homme... Humain!... Dieu bénisse votre humanitarisme au foie blanc!... On n'aime pas vingt choses à la fois, on ne sert pas plusieurs dieux!...)
Dans sa vie de travail, Christophe n'était guère sorti de l'horizon de sa petite ville allemande; il ne pouvait se douter que cette dépravation artistique, qui s'étalait à Paris, était commune à presque toutes les grandes villes; et les préjugés héréditaires de «la chaste Allemagne» contre «l'immoralité latine» se réveillaient en lui. Sylvain Kohn aurait eu beau jeu à lui opposer ce qui se passait sur les bords de la Sprée, et l'effroyable pourriture d'une élite de l'Allemagne impériale, dont la brutalité rendait l'ignominie plus repoussante encore. Mais Sylvain Kohn ne pensait pas à en tirer avantage; il n'en était pas plus choqué que des mœurs parisiennes. Il pensait ironiquement: «Chaque peuple a ses usages»; et il trouvait naturels ceux du monde où il vivait: Christophe pouvait donc croire qu'ils étaient la nature même de la race. Aussi ne se faisait-il pas faute, comme ses compatriotes, de voir dans l'ulcère qui dévore les aristocraties intellectuelles de tous les pays le vice propre de l'art français, la tare des races latines.
Ce premier contact avec la littérature parisienne lui fut pénible, et il lui fallut du temps pour l'oublier, par la suite. Les œuvres ne manquaient pourtant pas qui n'étaient point uniquement occupées de ce que l'un de ces écrivains appelait noblement «le goût des divertissements fondamentaux». Mais des plus belles et des meilleures, rien ne lui arrivait. Elles n'étaient pas de celles qui cherchent les suffrages des Sylvain Kohn; elles ne s'inquiétaient pas d'eux, et ils ne s'inquiétaient pas d'elles: ils s'ignoraient mutuellement. Jamais Sylvain Kohn n'en eût parlé à Christophe. De bonne foi, il était convaincu que ses amis et lui incarnaient l'art français, et qu'en dehors de ceux que leur opinion avait sacrés grands hommes, il n'y avait point de talent, il n'y avait point d'art, il n'y avait point de France. Des poètes qui étaient l'honneur des lettres, la couronne de la France, Christophe ne connut rien. Des romanciers, seuls lui parvinrent, émergeant au-dessus de la marée des médiocres, quelques livres de Barrès et d'Anatole France. Mais il était trop peu familiarisé avec la langue pour pouvoir bien goûter l'ironie érudite de l'un, le sensualisme cérébral de l'autre. Il resta quelque temps à regarder curieusement les orangers en caisse, qui poussaient dans la serre d'Anatole France, et les narcisses grêles, qui émaillaient le cimetière d'âme de Barrès. Il s'arrêta quelques instants devant le génie, un peu sublime, un peu niais, de Maeterlinck: un mysticisme monotone, mondain, s'en exhalait. Il se secoua, tomba dans le torrent épais, le romantisme boueux de Zola, qu'il connaissait déjà, et n'en sortit que pour se noyer tout à fait dans une inondation de littérature.
De ces plaines submergées s'exhalait un odor di femina. La littérature d'alors pullulait de femmes et d'hommes femelles.—Il est bien que les femmes écrivent, si elles ont la sincérité de peindre ce qu'aucun homme n'a su voir tout à fait: le fond de l'âme féminine. Mais bien peu l'osaient faire; la plupart n'écrivaient que pour attirer l'homme: elles étaient aussi menteuses dans leurs livres que dans leurs salons; elles s'embellissaient fadement, et flirtaient avec le lecteur. Depuis qu'elles n'avaient plus de confesseur à qui raconter leurs petites malpropretés, elles les racontaient au public. C'était une pluie de romans, presque toujours scabreux, toujours maniérés, écrits dans une langue qui avait l'air de zézayer, une langue qui sentait la boutique à parfums, et l'obsédante odeur fade, chaude et sucrée. Elle était partout dans cette littérature. Christophe pensait, comme Gœthe: «Que les femmes fassent autant qu'elles veulent des poésies et des écrits! Mais que les hommes n'écrivent pas comme des femmes! Voilà ce qui ne me plaît point.» Il ne pouvait voir sans dégoût cette coquetterie louche, ces minauderies, cette sensiblerie qui se dépensait de préférence au profit des êtres les moins dignes d'intérêt, ce style pétri de mignardise et de brutalité, ces charretiers psychologues.
Mais Christophe se rendait compte qu'il ne pouvait juger. Il était assourdi par le bruit de la foire aux paroles. Impossible d'entendre les jolis airs de flûte, qui se perdaient au milieu. Parmi ces œuvres de volupté, il en était au fond desquelles souriait sur le ciel limpide la ligne harmonieuse des collines de l'Attique,—tant de talent et de grâce, une douceur de vivre, une finesse de style, une pensée pareille aux langoureux adolescents de Pérugin et du jeune Raphaël, qui, les yeux à demi-clos, sourient à leur rêve amoureux. Christophe n'en voyait rien. Rien ne pouvait lui révéler les courants de l'esprit. Un Français aurait eu lui-même grand'peine à s'y reconnaître. Et la seule constatation qu'il lui était permis de faire, c'était de ce débordement d'écriture, qui avait l'air d'une calamité publique. Il semblait que tout le monde écrivît: hommes, femmes et enfants, officiers, comédiens, gens du monde et forbans. Une vraie épidémie.
Christophe renonça, pour l'instant, à se faire une opinion. Il sentait qu'un guide, comme Sylvain Kohn, ne pourrait que l'égarer tout à fait. L'expérience qu'il avait eue en Allemagne d'un cénacle littéraire le mettait justement en défiance; il était sceptique à l'égard des livres et des revues: savait-on s'ils ne représentaient pas simplement l'opinion d'une centaine de désœuvrés, ou même si l'auteur n'était pas tout le public à lui tout seul? Le théâtre donnait une idée plus exacte de la société. Il tenait à Paris, dans la vie quotidienne, une place exorbitante. C'était un restaurant pantagruélique, qui ne suffisait pas à assouvir l'appétit de ces deux millions d'hommes. Une trentaine de grands théâtres, sans parler des scènes de quartier, des cafés-concerts, des spectacles divers,—une centaine de salles, chaque soir, presque toutes pleines. Un peuple d'acteurs et d'employés. Les quatre théâtres subventionnés occupant à eux seuls près de trois mille personnes, et dépensant dix millions. Paris entier rempli de la gloire des cabots. À chaque pas, d'innombrables photos, dessins, caricatures, répétaient leurs grimaces, les gramophones leur nasillement, les journaux leurs jugements sur l'art et sur la politique. Ils avaient leur presse spéciale. Ils publiaient leurs Mémoires héroïques et familiers. Parmi les autres Parisiens, ces grands enfants flâneurs qui passaient leur temps à se singer, ces singes complets tenaient le sceptre; et les auteurs dramatiques étaient leurs chambellans. Christophe pria Sylvain Kohn de l'introduire dans le royaume des reflets et des ombres.
Mais Sylvain Kohn n'était pas un guide plus sûr dans ce pays que dans celui des livres, et la première impression que Christophe eut, grâce à lui, des théâtres parisiens, ne fut pas moins repoussante que celle de ses premières lectures. Il semblait que partout régnât le même esprit de prostitution cérébrale.
Il y avait deux écoles parmi les marchands de plaisir. L'une était a la bonne vieille mode, la façon nationale, le gros plaisir bien sale, à la bonne franquette, la joie de la laideur, des digestions copieuses, des difformités physiques, les gens en caleçon, les plaisanteries de corps de garde, la bisque, le poivre rouge, les viandes faisandées, les cabinets particuliers,—«cette mâle franchise», comme disent ces gens-là, qui prétend concilier la gaillardise et la morale, parce qu'après quatre actes de chienneries, elle ramène le triomphe du Code en jetant, au hasard de quelque imbroglio, la femme légitime dans le lit du mari qu'elle voulait cocufier:—(pourvu que la loi soit sauve, la vertu l'est aussi),—cette honnêteté grivoise, qui défend le mariage, en lui donnant les allures de la débauche:—le genre gaulois.
L'autre école était modern-style. Elle était beaucoup plus raffinée, plus écœurante aussi. Les Juifs parisianisés (et les chrétiens judaïsés), qui foisonnaient au théâtre, y avaient introduit le mic-mac de sentiments, qui est le trait distinctif d'un cosmopolitisme dégénéré. Ces fils qui rougissaient de leur père s'appliquaient à renier la conscience de leur race; ils n'y réussissaient que trop. Après avoir dépouillé leur âme séculaire, il ne leur restait plus de personnalité que pour mêler les valeurs intellectuelles et morales des autres peuples; ils en faisaient une macédoine, une olla podrida: c'était leur façon d'en jouir. Ceux qui étaient les maîtres du théâtre à Paris excellaient à battre ensemble l'ordure et le sentiment, à donner à la vertu un parfum de vice, au vice un parfum de vertu, à intervertir toutes les relations d'âge, de sexe, de famille, d'affections. Leur art avait ainsi une odeur sui generis, qui sentait bon et mauvais à la fois, c'est-à-dire très mauvais: ils nommaient cela «amoralisme».
Un de leurs héros de prédilection était alors le vieillard amoureux. Leur théâtre en offrait une riche galerie de portraits. Ils trouvaient dans la peinture de ce type l'occasion d'étaler mille délicatesses. Tantôt le héros sexagénaire avait sa fille pour confidente; il lui parlait de sa maîtresse; elle lui parlait de ses amants; ils se conseillaient fraternellement; le bon père aidait sa fille dans ses adultères; la bonne fille s'entremettait auprès de la maîtresse infidèle, la suppliait de revenir, la ramenait au bercail. Tantôt le digne vieillard se faisait le confident de sa maîtresse; il causait avec elle des amants qu'elle avait, sollicitait le récit de ses libertinages, et même il finissait par y trouver plaisir. On voyait des amants, gentlemen accomplis, qui étaient les intendants gagés de leurs anciennes maîtresses, veillaient sur leur commerce et leurs accouplements. Les femmes du monde volaient. Les hommes étaient maquereaux, les filles lesbiennes. Tout cela, dans le meilleur monde: le monde riche,—le seul qui comptât. Car il permettait d'offrir aux clients, sous le couvert des séductions du luxe, une marchandise avariée. Ainsi maquillée, elle s'enlevait sur la place; les jeunes femmes et les vieux messieurs en faisaient leurs délices. Il se dégageait de là un fumet de cadavre et de pastilles du sérail.
Leur style n'était pas moins mêlé que leurs sentiments. Ils s'étaient fait un argot composite, d'expressions de toutes classes et de tous pays, pédantesque, chatnoiresque, classique, lyrique, précieux, poisseux, poissard, mixture de coq-à-l'âne, d'afféteries, de grossièretés et de mots d'esprit, qui semblaient avoir un accent étranger. Ironiques, et doués d'un humour bouffon, ils n'avaient pas beaucoup d'esprit naturel; mais, adroits comme ils étaient, ils en fabriquaient assez habilement, à l'instar de Paris. Si la pierre n'était pas toujours de la plus belle eau, et si presque toujours la monture était d'un goût baroque et surchargé, du moins cela brillait, aux lumières: c'était tout ce qu'il fallait. Intelligents d'ailleurs, bons observateurs, mais observateurs myopes, les yeux déformés depuis des siècles par la vie de comptoir, examinant les sentiments à la loupe, grossissant les choses menues et ne voyant pas les grandes, avec une prédilection marquée pour les oripeaux, ils étaient incapables de peindre autre chose que ce qui semblait à leur snobisme de parvenus l'idéal de l'élégance: une poignée de viveurs fatigués et d'aventuriers, qui se disputaient la jouissance de quelque argent volé et de femelles sans vertu.
Parfois la vraie nature de ces écrivains juifs se réveillait, montait des lointains de leur être, à propos d'on ne savait quels échos mystérieux provoqués par le choc d'un mot. Alors, c'était un amalgame étrange de siècles et de races, un souffle du Désert qui, par delà les mers, apportait dans ces alcôves parisiennes des relents de bazar turc, l'éblouissement des sables, des hallucinations, une sensualité ivre, une puissance d'invectives, une névrose enragée, à deux doigts des convulsions, une frénésie de détruire,—Samson, qui brusquement assis depuis des siècles dans l'ombre se lève comme un lion, et secoue avec rage les colonnes du Temple, qui s'écroulent sur lui et sur la race ennemie.
Christophe se boucha le nez, et dit à Sylvain Kohn:
—Il y a de la force là-dedans; mais elle pue. Assez! Allons voir autre chose.
—Quoi? demanda Sylvain Kohn.
—La France.
—La voilà! dit Kohn.
—Ce n'est pas possible, fit Christophe. La France n'est pas ainsi.
—La France, comme l'Allemagne.
—Je n'en crois rien. Un peuple qui serait ainsi n'en aurait pas pour vingt ans: il sent déjà le pourri. Il y a autre chose.
—Il n'y a rien de mieux.
—Il y a autre chose, s'entêta Christophe.
—Oh! nous avons aussi de belles âmes, dit Sylvain Kohn, et des théâtres à leur mesure. Est-ce là ce qu'il vous faut? On peut vous en offrir.
Il conduisit Christophe au Théâtre-Français.
On jouait, ce soir-là, une comédie moderne, en prose, qui traitait d'une question juridique.
Dès les premiers mots, Christophe ne sut plus dans quel monde cela se passait. Les voix des acteurs étaient démesurément amples, lentes, graves, compassées; elles articulaient toutes les syllabes, comme si elles voulaient donner des leçons de diction; elles paraissaient scander perpétuellement des alexandrins, avec des hoquets tragiques. Les gestes étaient solennels et presque hiératiques. L'héroïne, drapée de son peignoir comme d'un péplum grec, le bras levé, la tête baissée, jouait l'Antigone toujours, et souriait d'un sourire d'éternel sacrifice, en modulant les notes les plus profondes de son beau contralto. Le père noble marchait d'un pas de maître d'armes, avec une dignité funèbre, un romantisme en habit noir. Le jeune premier se contractait froidement la gorge pour en tirer des pleurs. La pièce était écrite en style de tragédie-feuilleton: c'étaient des mots abstraits, des épithètes bureaucratiques, des périphrases académiques. Pas un mouvement, pas un cri imprévu. Du commencement à la fin, un mécanisme d'horloge, un problème posé, un schéma dramatique, un squelette de pièce, et dessus, point de chair, des phrases de livre. Au fond de ces discussions qui voulaient paraître hardies, des idées timorées, une âme de petit bourgeois gourmé.
L'héroïne avait divorcé d'avec un mari indigne, dont elle avait un enfant, et elle s'était remariée avec un honnête homme qu'elle aimait. Il s'agissait de prouver que, même en ce cas, le divorce était condamné par la nature, comme par le préjugé. Pour cela, rien de plus facile: l'auteur s'arrangeait de façon à ce que le premier mari reprit la femme, une fois, par surprise. Et après, au lieu de la nature toute simple, qui eût voulu des remords, une honte peut-être, mais le désir d'aimer d'autant plus le second, l'honnête homme, on présentait un cas de conscience héroïque, hors nature. Il en coûte si peu d'être vertueux, hors nature! Les écrivains français n'ont pas l'air familiers avec la vertu: ils forcent la note, quand ils en parlent; il n'y a plus moyen d'y croire. On dirait qu'on a toujours affaire à des héros de Corneille, à des rois de tragédie.—Et ne sont-ils pas des rois, ces héros millionnaires, ces héroïnes qui, toutes, ont, pour le moins, un hôtel à Paris et deux ou trois châteaux? La richesse, pour cette sorte d'écrivains, est une beauté, presque une vertu.
Le public paraissait à Christophe encore plus étonnant que la pièce. Aucune invraisemblance ne le troublait. Il riait aux bons endroits, quand l'acteur disait la phrase qui devait faire rire, en l'annonçant à l'avance, afin qu'on eût le temps de se préparer à rire. Il se mouchait, toussait, ému jusques aux larmes, quand les mannequins tragiques hoquetaient, rugissaient, ou s'évanouissaient, selon des rites consacrés.
—Et on dit que les Français sont légers! s'exclama Christophe, au sortir de la représentation.
—Il y a temps pour tout, dit Sylvain Kohn, gouaillant. Vous vouliez de la vertu? Vous voyez qu'il y en a encore en France.
—Mais ce n'est pas de la vertu, se récria Christophe, c'est de l'éloquence!
—Chez nous, dit Sylvain Kohn, la vertu au théâtre est toujours éloquente.
—Vertu de prétoire, dit Christophe, la palme est au plus bavard. Je hais les avocats. N'avez-vous pas des poètes, en France?
Sylvain Kohn le mena à des théâtres poétiques.
Il y avait des poètes en France. Il y avait même de grands poètes. Mais le théâtre n'était pas pour eux. Il était pour les rimeurs. Le théâtre est à la poésie ce qu'est l'opéra à la musique. Comme disait Berlioz: Sicut amori lupanar.
Christophe vit des princesses courtisanes par sainteté, qui mettaient leur honneur à se prostituer, et que l'on comparait au Christ, gravissant le calvaire;—des amis qui trompaient leur ami, par dévouement pour lui;—de vertueux ménages a trois;—des cocus héroïques: (le type était devenu, comme la chaste prostituée, un article européen; l'exemple du roi Marke leur avait tourné la tête: tel le cerf de saint Hubert, ils ne se présentaient plus qu'avec une auréole).—Christophe vit aussi des filles galantes, qui étaient partagées, comme Chimène, entre la passion et le devoir: la passion était de suivre un nouvel amant; le devoir était de rester avec l'ancien, un vieux qui leur donnait de l'argent, et que d'ailleurs elles trompaient. À la fin, noblement, elles choisissaient le devoir.—Christophe trouvait que ce devoir différait peu du sordide intérêt; mais le public était content. Le mot de Devoir lui suffisait; il ne tenait pas à la chose: le pavillon couvrait la marchandise.
Le comble de l'art était quand pouvaient s'accorder, de la façon la plus paradoxale, l'immoralité sexuelle avec l'héroïsme cornélien. Ainsi, tout était satisfait chez ce public parisien: son libertinage d'esprit, et sa vertu oratoire.—Il faut lui rendre justice: il était encore plus bavard que paillard. L'éloquence faisait ses délices. Il se fût fait fouetter pour un beau discours. Vice ou vertu, héroïsme abracadabrant ou bassesse crapuleuse, il n'était pas de pilule qu'on ne lui fît avaler, dorée de rimes sonores et de mots ronflants. Tout était matière à couplets. Tout était phrases. Tout était jeu. Quand Hugo faisait entendre son tonnerre, vite, (comme disait son apôtre, Mendès), il y mettait une sourdine, pour ne pas effrayer même un petit enfant... (L'apôtre était persuadé qu'il faisait un compliment.)—Jamais on ne sentait dans leur art une force de la nature. Ils mondanisaient tout: l'amour, la souffrance, la mort. Comme en musique,—bien plus encore qu'en musique, qui était un art plus jeune en France et relativement plus naïf,—ils avaient la terreur du «déjà dit». Les mieux doués s'appliquaient froidement à en prendre le contrepied. La recette était simple: on faisait choix d'une légende, ou d'un conte d'enfant, et on leur faisait dire juste le contraire de ce qu'ils voulaient dire. On obtenait ainsi Barbe-Bleue battu par ses femmes, ou Polyphème qui se crève l'œil, par bonté, afin de se sacrifier au bonheur d'Acis et de Galatée. En tout cela, rien de sérieux, que la forme. Encore semblait-il à Christophe (mais il était mauvais juge) que ces maîtres de la forme étaient de petits-maîtres et des maîtres pasticheurs, plutôt que de grands écrivains, créateurs de leur style, et peignant largement.
Nulle part, le mensonge poétique ne s'étalait avec plus d'insolence que dans le drame héroïque. Ils se faisaient du héros une conception burlesque:
«L'important, c'est d'avoir une âme magnifique.
Un œil d'aigle, un front large et haut comme un portique,
Un air puissant et grave, émouvant, radieux,
Un cœur plein de frissons, du rêve plein les yeux.»
De tels vers étaient pris au sérieux. Sous l'affublement des grands mots, des panaches, des parades de théâtre avec des épées de fer-blanc et des casques en carton, on retrouvait toujours l'incurable futilité d'un Sardou, l'intrépide vaudevilliste, qui jouait Guignol avec l'histoire. À quoi pouvait répondre, dans la réalité, l'absurde héroïsme d'un Cyrano? Ces gens-là remuaient le ciel et la terre, ils faisaient sortir de leurs tombeaux l'Empereur et ses légions, les bandes de la Ligue, les condottieri de la Renaissance, tous les cyclones humains qui dévastèrent l'univers:—et c'était pour montrer quelque fantoche, impassible dans les massacres, entouré d'armées de reîtres et de sérails de captives, qui se consumait d'un amour de petit bêta romanesque pour une femme qu'il avait vue, dix ou quinze ans avant,—ou le roi Henri IV, qui allait se faire assassiner, parce que sa maîtresse ne l'aimait pas!
C'est ainsi que ces bonnes gens jouaient les rois et les héros en chambre. Dignes rejetons des illustres benêts du temps du Grand Cyrus, ces Gascons de l'idéal,—Scudéry, La Calprenède,—chantres du faux héroïsme, de l'héroïsme impossible, qui est l'ennemi du vrai... Christophe remarquait avec étonnement que les Français, qui se disent si fins, n'avaient pas le sens du ridicule.
Mais ce qui passait tout, c'était quand la religion était à la mode! Alors, pendant le carême, des comédiens lisaient au théâtre de la Gaîté les sermons de Bossuet, avec accompagnement d'orgue. Des auteurs israélites écrivaient pour des actrices israélites des tragédies sur sainte Thérèse. On jouait Chemin de Croix à la Bodinière, l'Enfant Jésus à l'Ambigu, la Passion à la Porte-Saint-Martin, Jésus à l'Odéon, des Suites d'orchestre sur le Christ, au Jardin d'Acclimatation. Quelque brillant causeur, un poète de l'amour voluptueux, faisait au Châtelet une conférence sur la Rédemption. Naturellement, de tout l'Évangile, ce que ces snobs avaient le mieux retenu, c'était Pilate et la Madeleine:—«Qu'est-ce que la Vérité?», et la vierge folle.—Et leurs Christs boulevardiers étaient d'affreux bavards, au courant des dernières ficelles de la casuistique mondaine.
Christophe dit:
—Cela, c'est le pire de tout. C'est le mensonge incarné. J'étouffe. Sortons d'ici!
Un grand art classique se maintenait pourtant au milieu de ces industries modernes, comme les ruines des temples antiques parmi les constructions prétentieuses de la Rome d'aujourd'hui. Mais, à l'exception de Molière, Christophe n'était pas encore en état de l'apprécier. Il lui manquait le sens intime de la langue, donc, du génie de la race. Rien ne lui était plus incompréhensible que la tragédie du XVIIe siècle,—la province de l'art français la moins accessible aux étrangers, justement parce qu'elle est située au cœur même de la France. Il la trouvait assommante, froide, sèche, écœurante de pédantisme et de minauderies. Une action indigente ou forcée, des personnages abstraits comme des arguments de rhétorique, ou insipides comme une conversation de femmes du monde. Une caricature des sujets et des héros antiques. Un étalage de raison, de raisons, d'arguties, de psychologie, d'archéologie démodée. Des discours, des discours, des discours: l'éternel bavardage français. Que cela fût beau ou non, Christophe se refusait ironiquement à en décider: il ne s'intéressait à rien là-dedans; quelles que fussent les thèses soutenues tour à tour par les orateurs de Cinna, il lui était parfaitement indifférent que l'une ou l'autre de ces machines à harangues l'emportât, à la fin.
Il constatait d'ailleurs que le public français n'était pas de son avis et qu'il applaudissait fort. Cela ne contribuait pas à dissiper le malentendu: il voyait ce théâtre au travers du public; et il reconnaissait dans les Français modernes certains traits, déformés, des classiques. Tel un regard trop lucide qui retrouverait dans le visage flétri d'une vieille coquette les traits purs de sa fille: le spectacle est peu propre à faire naître l'illusion amoureuse!... Comme les gens d'une même famille, qui sont habitués à se voir, les Français ne s'apercevaient pas de la ressemblance. Mais Christophe en était frappé, et il l'exagérait: il ne voyait plus qu'elle. L'art d'aujourd'hui lui semblait offrir les caricatures des grands ancêtres; et les grands ancêtres, à leur tour, lui apparaissaient en caricatures. Il ne distinguait plus Corneille de sa lignée de rhéteurs poétiques, enragés à placer partout des cas de conscience sublimes et absurdes. Et Racine se confondait avec sa postérité de petits psychologues parisiens, penchés prétentieusement sur leurs cœurs.
Tous ces vieux écoliers ne sortaient pas de leurs classiques. Les critiques continuaient indéfiniment à discuter sur Tartuffe et sur Phèdre. Ils ne s'en lassaient point. Ils se délectaient, vieillards, des mêmes plaisanteries qui avaient fait leurs délices, quand ils étaient enfants. Il en serait ainsi jusqu'à la fin de la race. Aucun pays, au monde, ne conservait aussi enraciné le culte de ses arrière-grands-pères. Le reste de l'univers ne l'intéressait point. Combien n'avaient rien lu et ne voulaient rien lire, en dehors de ce qui avait été écrit en France, sous le Grand Roi! Leurs théâtres ne jouaient ni Gœthe, ni Schiller, ni Kleist, ni Grillparzer, ni Hebbel, ni Strindberg, ni Lope, ni Calderon, ni aucun des grands hommes d'aucune des autres nations, à part la Grèce antique, dont ils se disaient les héritiers,—(comme tous les peuples d'Europe). De loin en loin, ils éprouvaient le besoin d'enrôler Shakespeare. C'était la pierre de touche. Il y avait parmi eux deux écoles d'interprètes: les uns jouaient le Roi Lear, avec un réalisme bourgeois, comme une comédie d'Émile Augier; les autres faisaient d'Hamlet un opéra, avec des airs de bravoure et des vocalises à la Victor Hugo. Il ne leur venait point à l'idée que la réalité pût être poétique, ni la poésie une langue spontanée, pour des cœurs débordants de vie. Shakespeare paraissait faux. On en revenait vite à Rostand.
Cependant, depuis vingt ans, un effort était fait pour renouveler le théâtre; le cercle étroit de la littérature parisienne s'était élargi; elle touchait à tout, avec un semblant d'audace. Même, deux ou trois fois, la mêlée du dehors, la vie publique avait crevé, d'une poussée, le rideau des conventions. Mais ils se dépêchaient de recoudre les déchirures. C'étaient des pères douillets, qui avaient peur de voir les choses comme elles sont. Un esprit de société, une tradition classique, une routine de l'esprit et de la forme, un manque de sérieux profond, les empêchaient d'aller jusqu'au bout de leurs audaces. Les problèmes les plus poignants devenaient des jeux ingénieux; et tout se ramenait finalement à des questions de femmes,—de petites femmes. Ô la triste figure que faisaient sur leurs tréteaux les fantômes des grands hommes: l'Anarchie héroïque d'Ibsen, l'Évangile de Tolstoy, le Surhomme de Nietzsche!...
Les écrivains de Paris se donnaient bien du mal pour avoir l'air de penser des choses nouvelles. Au fond, ils étaient tous conservateurs. Il n'était pas en Europe de littérature où régnât plus généralement le passé, «l'éternel hier»: dans les grandes Revues, dans les grands journaux, dans les théâtres subventionnés, dans les Académies. Paris était en littérature ce que Londres était en politique: le frein modérateur de l'esprit européen. L'Académie française était une Chambre des Lords. Des institutions de l'Ancien Régime persistaient à imposer leur norme d'autrefois à la société nouvelle. Les éléments révolutionnaires étaient rejetés ou assimilés promptement. Ils ne demandaient qu'à l'être. Même quand le gouvernement affectait en politique des allures socialistes, en art il se mettait à la remorque des Écoles Académiques. Contre les Académies, on ne luttait qu'à coups de cénacles; et on luttait fort mal. Car aussitôt qu'un du cénacle le pouvait, il enjambait dans une Académie et devenait plus académique que les autres. Au reste, que l'écrivain fût à l'avant-garde, ou dans les fourgons de l'armée, il était prisonnier de son groupe et des idées de son groupe. Les uns s'enfermaient dans leur Credo académique, les autres dans leur Credo révolutionnaire; et, au bout du compte, c'étaient toujours les mêmes œillères.
Pour réveiller Christophe, Sylvain Kohn lui proposa encore de le mener à des théâtres d'un genre spécial,—le dernier mot du raffinement. On y voyait des meurtres, des viols, des folies, des tortures, yeux arrachés, ventres étripés, tout ce qui pouvait secouer les nerfs et satisfaire la barbarie cachée d'une élite trop civilisée. Cela exerçait un attrait sur un public de jolies femmes et de mondains,—les mêmes qui allaient bravement s'enfermer pendant des après-midi dans les salles étouffantes du Palais de Justice, pour suivre des procès scandaleux, en bavardant, riant, et croquant des bonbons. Mais Christophe refusa avec indignation. Plus il avançait dans cet art, plus il sentait se préciser l'odeur, qui, dès les premiers pas, l'avait saisi, sournoise, puis tenace, suffocante: l'odeur de mort.
La mort: elle était partout, sous ce luxe, sous ce bruit. Christophe s'expliquait la répulsion qu'il avait tout d'abord éprouvée pour certaines de ces œuvres. Ce n'était pas leur immoralité qui le choquait. Moralité, immoralité, amoralité,—ces mots ne veulent rien dire. Christophe ne s'était jamais fait de théories morales; il aimait dans le passé de très grands poètes et de très grands musiciens, qui n'étaient pas de petits saints; quand il avait la chance de rencontrer un grand artiste, il ne lui demandait pas son billet de confession; il lui demandait plutôt:
—Es-tu sain?
Être sain, tout est là. «Si le poète est malade, qu'il commence par se guérir, dit Gœthe. Quand il sera guéri, il écrira.»
Les écrivains parisiens étaient malades; ou, quand l'un était sain, il en avait honte; il s'en cachait, il tâchait de se donner une bonne maladie. Leur mal ne se révélait pas à tel trait de leur art:—à l'amour du plaisir, à la licence extrême de la pensée, à l'esprit de critique destructeur. Tous ces traits pouvaient être—étaient, suivant les cas,—sains ou malsains; il n'y avait en eux aucun germe de mort. Si la mort était là, elle ne venait pas de ces forces, elle venait de leur emploi par ces gens, elle était dans ces gens.—Et lui aussi, Christophe, aimait le plaisir. Lui aussi aimait la liberté. Il avait soulevé contre lui l'opinion de sa petite ville allemande, par sa franchise à soutenir des idées, qu'il retrouvait maintenant, prônées par ces Parisiens, et qui, prônées par eux, maintenant le dégoûtaient. Les mêmes idées, pourtant. Mais elles ne sonnaient plus de même. Quand Christophe, impatient, secouait le joug des maîtres du passé, quand il partait en guerre contre l'esthétique et la morale pharisiennes, ce n'était pas un jeu pour lui, comme pour ces beaux esprits; il était sérieux, terriblement sérieux; et sa révolte avait pour but la vie, la vie féconde, grosse des siècles à venir. Chez ces gens, tout allait à la jouissance stérile. Stérile. Stérile. C'était le mot de l'énigme. Une débauche inféconde de la pensée et des sens. Un art brillant, plein d'esprit, d'habileté,—une belle forme, certes, une tradition de la beauté, qui se maintenait indestructible, en dépit des alluvions étrangères,—un théâtre qui était du théâtre, un style qui était un style, des auteurs qui savaient leur métier, des écrivains qui savaient écrire, le squelette assez beau d'un art, d'une pensée, qui avaient été puissants. Mais un squelette. Des mots qui tintent, des phrases qui sonnent, des froissements métalliques d'idées qui se heurtent dans le vide, des jeux d'esprit, des cerveaux sensuels, et des sens raisonneurs. Tout cela ne servait à rien, qu'à jouir égoïstement. Cela allait à la mort. Phénomène analogue à celui de l'effrayante dépopulation de la France, que l'Europe observait—escomptait—en silence. Tant d'esprit et d'intelligence, des sens si affinés, se dépensaient en une sorte d'onanisme honteux! Ils ne s'en doutaient point. Ils riaient. C'était même la seule chose qui rassurât Christophe: ces gens-là savaient encore bien rire; tout n'était pas perdu. Il les aimait beaucoup moins, quand ils voulaient se prendre au sérieux; et rien ne le blessait autant que de voir des écrivains, qui ne cherchaient dans l'art qu'un instrument de plaisir, se donner comme les prêtres d'une religion désintéressée:
—Nous sommes des artistes, répétait avec complaisance Sylvain Kohn. Nous faisons de l'art pour l'art. L'art est toujours pur; il n'a rien que de chaste. Nous explorons la vie, en touristes que tout amuse. Nous sommes les curieux de rares voluptés, les éternels Don Juan amoureux de la beauté.
—Vous êtes des hypocrites, finit par riposter Christophe. Pardonnez-moi de vous le dire. Je croyais jusqu'ici qu'il n'y avait que mon pays qui l'était. En Allemagne, nous avons l'hypocrisie de parler toujours d'idéalisme, en poursuivant toujours notre intérêt; et nous nous persuadons que nous sommes idéalistes, en ne pensant qu'à notre égoïsme. Mais vous êtes bien pires: vous couvrez du nom d'Art et de Beauté (avec une majuscule) votre luxure nationale,—quand vous n'abritez point votre Pilatisme moral sous le nom de Vérité, de Science, de Devoir intellectuel, qui se lave les mains des conséquences possibles de ses recherches hautaines. L'art pour l'art!... Une foi magnifique! Mais la foi seulement des forts. L'art! Étreindre la vie, comme l'aigle sa proie, et l'emporter dans l'air, s'élever avec elle dans l'espace serein!... Pour cela, il faut des serres, de vastes ailes, et un cœur puissant. Mais vous n'êtes que des moineaux, qui, quand ils ont trouvé quelque morceau de charogne, le dépècent sur place et se le disputent en piaillant... L'art pour l'art!... Malheureux! L'art n'est pas une vile pâture, livrée aux vils passants. Une jouissance, certes, et de toutes la plus enivrante. Mais elle n'est le prix que d'une lutte acharnée, et son laurier couronne la victoire de la force. L'art est la vie domptée. L'empereur de la vie. Quand on veut être César, il faut en avoir l'âme. Vous n'êtes que des rois de théâtre: c'est un rôle que vous jouez, vous n'y croyez même pas. Et, comme ces acteurs, qui se font gloire de leurs difformités, vous faites de la littérature avec les vôtres. Vous cultivez amoureusement les maladies de votre peuple, sa peur de l'effort, son amour du plaisir, des idéologies sensuelles, de l'humanitarisme chimérique, de tout ce qui engourdit voluptueusement la volonté et peut lui enlever toutes ses raisons d'agir. Vous le menez droit aux fumeries d'opium. Et vous le savez bien; mais vous ne le dites point: la mort est au bout.—Eh bien, moi, je dis: Où est la mort, l'art n'est point. L'art, c'est ce qui fait vivre. Mais les plus honnêtes d'entre vos écrivains sont si lâches que, même quand le bandeau leur est tombé des yeux, ils affectent de ne pas voir; ils ont le front de dire:
—C'est dangereux, je l'avoue; il y a du poison là-dedans; mais c'est plein de talent!
Comme si, en correctionnelle, le juge disait d'un apache:
—Il est un gredin, c'est vrai; mais il a tant de talent!...
Christophe se demandait à quoi servait la critique française. Ce n'étaient pourtant pas les critiques qui manquaient; ils pullulaient sur l'art. On n'arrivait plus à voir les œuvres: elles disparaissaient sous eux.
Christophe n'était pas tendre pour la critique, en général. Il avait déjà peine à admettre l'utilité de cette multitude d'artistes, qui formaient comme un quatrième, ou un cinquième État, dans la société moderne: il y voyait le signe d'une époque fatiguée, qui s'en remet à d'autres du soin de regarder la vie,—qui sent, par procuration. À plus forte raison, trouvait-il un peu honteux qu'elle ne fût même plus capable de voir avec ses yeux ces reflets de la vie, qu'il lui fallût encore d'autres intermédiaires, des reflets de reflets, en un mot, des critiques. Au moins, eût-il fallu que ces reflets fussent fidèles. Mais ils ne reflétaient rien que l'incertitude de la foule, qui faisait cercle autour. Telles, ces glaces de musée, où se réfléchissent, avec le plafond peint, les visages des curieux qui tâchent de l'y voir.
Il avait été un temps où ces critiques avaient joui en France d'une immense autorité. Le public s'inclinait devant leurs arrêts; et il n'était pas loin de les regarder comme supérieurs aux artistes, comme des artistes intelligents:—(les deux mots ne semblaient pas faits pour aller ensemble).—Puis, ils s'étaient multipliés à l'excès; ils étaient trop d'augures: cela gâte le métier. Quand il y a tant de gens, qui affirment, chacun, qu'il est le seul détenteur de l'unique vérité, on ne peut plus les croire; et ils finissent par ne plus se croire eux-mêmes. Le découragement était venu: du jour au lendemain, suivant l'habitude française, ils avaient passé d'un extrême à l'autre. Après avoir professé qu'ils savaient tout, ils professaient maintenant qu'ils ne savaient rien. Ils y mettaient leur point d'honneur et leur fatuité même. Renan avait enseigné à ces générations amollies qu'il est élégant de ne rien affirmer sans le nier aussitôt, ou du moins sans le mettre en doute. Il était de ceux dont parle saint Paul, «en qui il y a toujours oui, oui, et puis non, non». Toute l'élite française s'était enthousiasmée pour ce Credo amphibie. La paresse de l'esprit et la faiblesse du caractère y avaient trouvé leur compte. On ne disait plus d'une œuvre qu'elle était bonne ou mauvaise, vraie ou fausse, intelligente ou sotte. On disait:
—Il se peut faire... Il n'y a pas d'impossibilité... Je n'en sais rien... Je m'en lave les mains.
Si l'on jouait une ordure, ils ne disaient pas:
—Voilà une ordure.
Ils disaient:
—Seigneur Sganarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de parler de tout avec incertitude; et, par cette raison, vous ne devez pas dire: «Voilà une ordure», mais: «Il me semble... Il m'apparaît que voilà une ordure... Mais il n'est pas assuré que cela soit. Il se pourrait que ce fût un chef-d'œuvre. Et qui sait si ce n'en est pas un?»
Il n'y avait plus de danger qu'on les accusât de tyranniser les arts. Jadis, Schiller leur avait fait la leçon, et il avait rappelé aux tyranneaux de la presse ce qu'il appelait crûment:
Le Devoir des Domestiques.
«Avant tout, que la maison soit nette, où la Reine va paraître. Alerte donc! Balayez les chambres. Voilà pourquoi, Messieurs, vous êtes là.
«Mais dès qu'Elle paraît, vite à la porte, valets! Que la servante ne se carre point dans le fauteuil de la dame!»
Il fallait rendre justice à ceux d'aujourd'hui. Ils ne s'asseyaient plus dans le fauteuil de la dame. On voulait qu'ils fussent domestiques: ils l'étaient.—Mais de mauvais domestiques: ils ne balayaient rien; la chambre était un taudis. Plutôt que d'y remettre l'ordre et la propreté, ils se croisaient les bras, et laissaient la tâche au maître, à la divinité du jour:—le Suffrage Universel.
À la vérité, il se dessinait depuis quelque temps un mouvement de réaction contre la veulerie anarchique du jour. Quelques esprits plus fermes avaient entrepris une campagne—bien faible encore—de salubrité publique; mais Christophe n'en voyait rien, dans le milieu où il se trouvait. D'ailleurs, on ne les écoutait pas, ou l'on se moquait d'eux. Quand il arrivait, de loin en loin, qu'un vigoureux artiste eût un mouvement de révolte contre la niaiserie malsaine de l'art à la mode, les auteurs répliquaient avec superbe qu'ils avaient raison, puisque le public était content. Cela suffisait à fermer la bouche aux objections. Le public avait parlé: suprême loi de l'art! Il ne venait à l'idée de personne que l'on pût récuser le témoignage d'un public dépravé, en faveur de ceux qui le dépravaient, ni que l'artiste fût fait pour commander au public, et non le public à l'artiste. La religion du Nombre—du nombre des spectateurs et du chiffre des recettes—dominait la pensée artistique de cette démocratie mercantilisée. À la suite des auteurs, les critiques docilement décrétaient que l'office essentiel de l'œuvre d'art est de plaire. Le succès est la loi; et quand le succès dure, il n'y a qu'a s'incliner. Ils s'appliquaient donc à pressentir les fluctuations de la Bourse du plaisir, à lire dans les yeux du public ce qu'il pensait des œuvres. Le plaisant, c'était que le public s'évertuait de son côté à lire dans les yeux de la critique ce qu'il fallait penser des œuvres. Ainsi, tous deux se regardaient; et ils ne voyaient dans les yeux l'un de l'autre que leur propre indécision.
Jamais pourtant une critique intrépide n'eût été aussi nécessaire. Dans une République anarchique, la mode, toute-puissante, a rarement des retours en arrière, comme dans un pays conservateur; elle va de l'avant, toujours; et c'est une surenchère perpétuelle de fausse liberté d'esprit, à laquelle presque personne n'ose résister. La foule est incapable de se prononcer; elle est choquée, au fond; mais aucun n'ose dire ce que chacun sent en secret. Si les critiques étaient forts, s'ils osaient être forts, quel serait leur pouvoir! Un robuste critique, (pensait Christophe, ce jeune despote), pourrait, en quelques années, se faire le Napoléon du goût public, et balayer à Bicêtre les malades de l'art. Mais vous n'avez plus de Napoléon... D'abord, tous vos critiques vivent dans cette atmosphère viciée: ils ne s'en aperçoivent plus. Puis, ils n'osent parler. Ils se connaissent tous, ils forment une compagnie, et doivent se ménager: il n'est point d'indépendant. Pour l'être, il faudrait renoncer à la vie de société, et aux amitiés mêmes. Qui en aurait le courage, dans une époque affaiblie où les meilleurs doutent que la justesse d'une franche critique vaille les désagréments qu'elle peut causer à son auteur? Qui se condamnerait, par devoir, à faire de sa vie un enfer: oser tenir tête à l'opinion, lutter contre l'imbécillité publique, mettre à nu la médiocrité des triomphateurs du jour, défendre l'artiste inconnu, seul, et livré aux bêtes, imposer les esprits-rois aux esprits faits pour obéir?—Il arrivait à Christophe d'entendre des critiques se dire, à une première, le soir, dans les couloirs du théâtre:
—Hein! Est-ce assez mauvais! Quel four!
Et, le lendemain, dans leurs chroniques, ils parlaient de chef d'œuvre, de Shakespeare nouveau, et de l'aile du génie, dont le vent avait passé sur les têtes.
—Ce n'est pas le talent qui manque à votre art, disait Christophe à Sylvain Kohn; c'est le caractère. Vous auriez plus besoin d'un grand critique, d'un Lessing, d'un...
—D'un Boileau? dit Sylvain Kohn, goguenardant.
—D'un Boileau, peut-être bien, que de dix artistes de génie.
—Si nous avions un Boileau, dit Sylvain Kohn, on ne l'écouterait pas.
—Si on ne l'écoutait pas, c'est qu'il ne serait pas un Boileau, répliqua Christophe. Je vous réponds que, du jour où je voudrais vous dire vos vérités toutes crues, si maladroit que je sois, vous les entendriez; et il faudrait bien que vous les avaliez.
Mon pauvre vieux! ricana Sylvain Kohn.
Il avait l'air si sûr et si satisfait de la veulerie générale que Christophe, le regardant, eut soudain l'impression que cet homme était cent fois plus un étranger en France que lui-même.
—Ce n'est pas possible, dit-il de nouveau, comme le soir où il était sorti écœuré d'un théâtre des boulevards. Il y a autre chose.
—Qu'est'ce que vous voulez de plus? demanda Kohn.
Christophe répétait avec opiniâtreté:
—La France.
—La France, c'est nous, fit Sylvain Kohn, en s'esclaffant.
Christophe le regarda fixement, un instant, puis secoua la tête, et reprit son refrain:
—Il y a autre chose.
—Eh bien, mon vieux, cherchez, dit Sylvain Kohn, en riant de plus belle.
Christophe pouvait chercher. Ils l'avaient bien cachée.
[3]Voir Le Matin.
Une impression plus forte s'imposait à Christophe, à mesure qu'il voyait plus clair dans la cuve aux idées, où fermentait l'art parisien: la suprématie de la femme sur cette société cosmopolite. Elle y tenait une place absurde, démesurée. Il ne lui suffisait plus d'être la compagne de l'homme. Il ne lui suffisait même pas de devenir son égale. Il fallait que son plaisir fût la première loi pour l'homme. Et l'homme s'y prêtait. Quand un peuple vieillit, il abdique sa volonté, sa foi, toutes ses raisons de vivre, dans les mains de la dispensatrice de plaisir. Les hommes font les œuvres; mais les femmes font les hommes,—(quand elles ne se mêlent pas de faire aussi les œuvres, comme c'était le cas dans la France d'alors);—et ce qu'elles font, il serait plus juste de dire qu'elles le défont. L'éternel féminin a toujours exercé sans doute une force exaltante sur les meilleurs; mais pour le commun des hommes et pour les époques fatiguées, il y a, comme l'a dit quelqu'un, un autre féminin tout aussi éternel, qui les attire en bas. Cet autre était le maître de la pensée, le roi de la République.
Christophe observait curieusement les Parisiennes, dans les salons où la présentation de Sylvain Kohn et son talent de virtuose l'avaient fait accueillir. Comme la plupart des étrangers, il généralisait à toutes les Françaises ses remarques sans indulgence d'après deux ou trois types qu'il avait rencontrés: de jeunes femmes, pas très grandes, sans beaucoup de fraîcheur, la taille souple, les cheveux teints, un grand chapeau sur leur aimable tête, un peu grosse pour le corps; les traits nets, la chair un peu soufflée; un nez assez bien fait, souvent vulgaire, sans caractère, toujours; des yeux en éveil, mais sans vie profonde, qui tâchaient de se rendre le plus brillants et le plus grands possible; la bouche bien dessinée, bien maîtresse d'elle-même; le menton gras; tout le bas de la figure dénotant le caractère matériel de ces élégantes personnes, qui, si occupées qu'elles fussent d'intrigues amoureuses, ne perdaient jamais de vue le souci du monde et de leur ménage. Jolies, mais point de race. Chez presque toutes ces mondaines, on sentait la bourgeoise pervertie, ou qui eût voulu l'être, avec les traditions de sa classe: prudence, économie, froideur, sens pratique, égoïsme. Une vie pauvre. Un désir du plaisir, procédant beaucoup plus d'une curiosité cérébrale que d'un besoin des sens. Une volonté de qualité médiocre, mais décidée. Elles étaient supérieurement habillées, et avaient de menus gestes automatiques. Tapotant leurs cheveux et leurs peignes, du revers ou du creux de leurs mains, par petits coups délicats, elles s'asseyaient toujours de façon à pouvoir se mirer—et surveiller les autres—dans une glace, voisine ou lointaine, sans compter, au dîner ou au thé, les cuillers, les couteaux, les cafetières d'argent, polis et reluisants, où elles attrapaient au passage le reflet de leur visage, qui les intéressait plus que le reste du monde. Elles observaient à table une hygiène sévère: buvant de l'eau, et se privant de tous les mets, qui eussent pu porter atteinte à leur idéal de blancheur enfarinée.
La proportion des Juives était assez forte dans les milieux que fréquentait Christophe; et il était attiré par elles, bien que, depuis sa rencontre avec Judith Mannheim, il n'eût guère d'illusions sur leur compte. Sylvain Kohn l'avait introduit dans quelques salons israélites, où il avait été reçu avec l'intelligence habituelle de cette race, qui aime l'intelligence. Christophe se rencontrait à dîner avec des financiers, des ingénieurs, des brasseurs de journaux, des courtiers internationaux, des espèces de négriers,—les hommes d'affaires de la République. Ils étaient lucides et énergiques, indifférents aux autres, souriants, expansifs, et fermés. Christophe avait le sentiment qu'il y avait des crimes sous ces fronts durs, dans le passé et dans l'avenir de ces hommes assemblés autour de la table somptueuse, chargée de chairs et de fleurs. Presque tous étaient laids. Mais le troupeau des femmes, dans l'ensemble, était assez brillant. Il ne fallait pas les regarder de trop près: la plupart manquaient de finesse dans la ligne ou la couleur. Mais de l'éclat, une apparence de vie matérielle assez forte, de belles épaules qui s'épanouissaient orgueilleusement sous les regards, et un génie pour faire de leur beauté, et même de leur laideur, un piège à prendre l'homme. Un artiste eût retrouvé en certaines d'entre elles l'ancien type romain, les femmes du temps de Néron, ou de celui de Hadrien. On voyait aussi des figures à la Palma, expression charnelle, lourd menton, fortement attaché dans le cou, non sans beauté bestiale. D'autres avaient les cheveux abondants et frisés, des yeux brûlants, hardis: on les devinait fines, incisives, prêtes à tout, plus viriles que les autres femmes, et cependant plus femmes. Au milieu du troupeau, se détachait çà et là un profil plus spiritualisé. Ses traits purs, par delà Rome, remontaient jusqu'au pays de Laban: on y croyait goûter une poésie de silence, l'harmonie du Désert. Mais quand Christophe s'approchait et écoutait les propos qu'échangeait Rébecca avec Faustine la Romaine, ou Sainte Barbe la Vénitienne, il trouvait une juive parisienne, comme les autres, plus Parisienne qu'une Parisienne, plus factice et plus frelatée, qui disait des méchancetés tranquilles, en déshabillant l'âme et le corps des gens avec ses yeux de Madone.
Christophe errait, de groupe en groupe, sans pouvoir se mêler à aucun. Les hommes parlaient de chasse avec férocité, d'amour avec brutalité, d'argent seulement avec une sûre justesse, froide et goguenarde. On prenait des notes d'affaires au fumoir. Christophe entendait dire d'un bellâtre, qui se promenait entre les fauteuils des dames, une rosette à la boutonnière, grasseyant de lourdes gracieusetés:
—Comment! Il est donc en liberté?
Dans un coin du salon, deux dames s'entretenaient des amours d'une jeune actrice et d'une femme du monde. Parfois, il y avait concert. On demandait à Christophe de jouer. Des poétesses, essoufflées, ruisselantes de sueur, proféraient sur un ton apocalyptique des vers de Sully-Prudbomme et de Auguste Dorchain. Un illustre cabotin venait solennellement déclamer une Ballade mystique, avec accompagnement d'orgue céleste. Musique et vers étaient si bêtes que Christophe en était malade. Mais les Romaines étaient charmées, et riaient de bon cœur, en montrant leurs dents magnifiques. On jouait aussi de l'Ibsen. Épilogue de la lutte d'un grand homme contre les Soutiens de la Société, aboutissant à les divertir!
Ensuite, ils se croyaient tenus, naturellement, à deviser sur l'art. C'était une chose écœurante. Les femmes surtout se mettaient à parler d'Ibsen, de Wagner, de Tolstoy, par flirt, par politesse, par ennui, par sottise. Une fois que la conversation était sur ce terrain, plus moyen de l'arrêter. Le mal était contagieux. Il fallait écouter les pensées des banquiers, des courtiers et des négriers sur l'art. Christophe avait beau éviter de répondre, détourner l'entretien: on s'acharnait à lui parler musique, haute poésie. Comme disait Berlioz, «ces gens-là emploient ces termes avec le plus grand sang-froid; on dirait qu'ils parlent vin, femmes, ou autres cochonneries». Un médecin aliéniste reconnaissait dans l'héroïne d'Ibsen une de ses clientes, mais beaucoup plus bête. Un ingénieur assurait, convaincu, que, dans Maison de Poupée, le personnage sympathique était le mari. L'illustre cabotin,—un comique fameux,—ânonnait en vibrant de profondes pensées sur Nietzsche et sur Carlyle; il contait à Christophe qu'il ne pouvait pas voir un tableau de Velasquez,—(c'était le dieu du jour)—«sans que de grosses larmes lui coulassent sur les joues». Toutefois, il confiait—à Christophe, toujours,—que, si haut qu'il mît l'art, il plaçait encore plus haut l'art dans la vie, l'action, et que s'il avait eu le choix du rôle à jouer, il eût choisi Bismarck. Parfois, il se trouvait là un de ces hommes dits d'esprit. La conversation n'en était pas sensiblement relevée. Christophe faisait le compte de ce qu'ils passaient pour dire, et de ce qu'ils disaient en effet. Le plus souvent, ils ne disaient rien; ils s'en tenaient à des sourires énigmatiques; ils vivaient sur leur réputation, et ne la risquaient point. À part quelques discoureurs, en général, du Midi. Ceux-là parlaient de tout. Nul sentiment des valeurs; tout était sur le même plan. Tel était un Shakespeare. Tel était un Molière. Ou tel, un Jésus-Christ. Ils comparaient Ibsen à Dumas fils, Tolstoy à George Sand; et naturellement, c'était pour montrer que la France avait tout inventé. D'ordinaire, ils ne savaient aucune langue étrangère. Mais cela ne les gênait pas. Il importait si peu à leur public, qu'ils disent la vérité! Ce qui importait, c'était qu'ils disent des choses amusantes, et autant que possible flatteuses pour l'amour-propre national. Les étrangers avaient bon dos,—à part l'idole du jour: car il en fallait une pour la mode: que ce fût Grieg, ou Wagner, ou Nietzsche, ou Gorki, ou d'Annunzio. Cela ne durait pas longtemps, et l'idole était sûre de passer, un matin, à la boîte aux ordures.
Pour le moment, l'idole était Beethoven. Beethoven—qui l'eût dit?—était un homme à la mode. Du moins, parmi les gens du monde et les littérateurs: car les musiciens s'étaient sur-le-champ détachés de lui, suivant le système de bascule, qui est une des lois du goût artistique en France. Pour savoir ce qu'il pense, un Français a besoin de savoir ce que pense son voisin, afin de penser de même, ou de penser le contraire. Voyant Beethoven devenir populaire, les plus distingués d'entre les musiciens avaient commencé de ne le plus trouver assez distingué pour eux; ils prétendaient devancer l'opinion, et ne jamais la suivre; plutôt que d'être d'accord avec elle, ils lui tournaient le dos. Ils s'étaient donc mis à traiter Beethoven de vieux sourd, qui criait d'une voix âpre; et certains affirmaient qu'il était peut-être un moraliste estimable, mais un musicien surfait.—Ces mauvaises plaisanteries n'étaient pas du goût de Christophe. L'enthousiasme des gens du monde ne le satisfaisait pas davantage. Si Beethoven était venu à Paris, en ce moment, il eût été le lion du jour: c'était fâcheux pour lui qu'il fût mort depuis un siècle. Sa musique comptait pour moins dans cette vogue que les circonstances plus ou moins romanesques de sa vie, popularisée par des biographies sentimentales. Son masque violent, au mufle de lion, était devenu une figure de romance. Les dames s'apitoyaient sur lui; elles laissaient entendre que, si elles l'avaient connu, il n'eût pas été si malheureux; et leur grand cœur était d'autant plus disposé à s'offrir qu'il n'y avait aucun risque que Beethoven les prît au mot: le vieux bonhomme n'avait plus besoin de rien.—C'est pourquoi les virtuoses, les chefs d'orchestre, les impresarii se découvraient des trésors de piété pour lui; et, en leur qualité de représentants de Beethoven, ils recueillaient les hommages qui lui étaient destinés. De somptueux festivals, à des prix fort élevés, donnaient aux gens du monde l'occasion de montrer leur générosité,—et parfois aussi de découvrir les symphonies de Beethoven. Des comités de comédiens, de mondains, de demi-mondains, et de politiciens chargés par la République de présider aux destinées de l'art, faisaient savoir au monde qu'ils allaient élever un monument à Beethoven: on voyait sur la liste, avec quelques braves gens qui servaient de passeport aux autres, toute cette racaille, qui eût foulé aux pieds Beethoven vivant.
Christophe regardait, écoutait. Il serrait les dents, pour ne pas dire une énormité. Toute la soirée, il restait tendu et crispé. Il ne pouvait ni parler, ni se taire. Parler, non par plaisir ou par nécessité, mais par politesse, parce qu'il faut parler, lui semblait humiliant. Dire le fond de sa pensée, cela ne lui était pas permis. Dire des banalités, cela ne lui était pas possible. Et il n'avait même pas le talent d'être poli, quand il ne disait rien. S'il regardait son voisin, c'était d'une façon trop fixe et trop intense: malgré lui, il l'étudiait, et l'autre en était blessé. S'il parlait, il croyait trop à ce qu'il disait: cela choquait tout le monde, et même lui. Il se rendait compte qu'il n'était pas à sa place; et, comme il était assez intelligent pour avoir le sens de l'harmonie du milieu, où sa présence détonnait, il était aussi choqué de ses façons d'être que ses hôtes eux-mêmes. Il s'en voulait, et il leur en voulait.
Quand il se retrouvait seul enfin dans la rue, au milieu de la nuit, il était si écrasé d'ennui qu'il n'avait pas la force de rentrer à pied chez lui; il avait envie de se coucher par terre, en pleine rue, comme il avait été, vingt fois, sur le point de le faire, lorsque, petit virtuose, il revenait de jouer au château du grand-duc. Parfois, n'ayant plus que cinq à six francs pour la fin de sa semaine, il en dépensait deux à une voiture. Il s'y jetait précipitamment, afin de fuir plus vite; et tandis qu'elle l'emportait, il gémissait d'énervement. Chez lui, il gémissait encore, dans son lit, en dormant... Et puis, brusquement, il éclatait de rire, en se rappelant une parole burlesque. Il se surprenait à la redire, en mimant les gestes. Le lendemain, et plusieurs jours après, il lui arrivait encore, se promenant seul, de gronder tout à coup comme une bête... Pourquoi allait-il voir ces gens? Pourquoi retournait-il les voir? Pourquoi s'obliger à faire des gestes et des grimaces, comme les autres, à feindre de s'intéresser à ce qui ne l'intéressait pas?—Est-ce qu'il était bien vrai que cela ne l'intéressât pas?—Il y a un an, il n'eut jamais pu supporter cette société. Maintenant, elle l'amusait tout en l'irritant. Était-ce un peu de l'indifférence parisienne qui s'insinuait en lui? Il se demandait avec inquiétude s'il était donc devenu moins fort. Mais c'était au contraire qu'il l'était davantage. Il était plus libre d'esprit dans un milieu étranger. Ses yeux s'ouvraient malgré lui a la grande Comédie du monde.
D'ailleurs, que cela lui plût ou non, il fallait bien continuer cette vie, s'il voulait que son art fût connu de la société parisienne, qui ne s'intéresse aux œuvres que dans la mesure où elle connaît les artistes. Et il fallait bien qu'il cherchât à être connu, s'il voulait trouver des leçons à donner parmi ces Philistins, dont il avait besoin pour vivre.
Et puis, l'on a un cœur; et, malgré soi, le cœur s'attache; il trouve à s'attacher, dans quelque milieu que ce soit; s'il ne s'attachait, il ne pourrait vivre.
Parmi les jeunes filles que Christophe avait pour élèves, était la fille d'un riche fabricant d'automobiles, Colette Stevens. Son père était Belge, naturalisé Français, fils d'un Anglo-Américain établi à Anvers et d'une Hollandaise. Sa mère était Italienne. C'était une famille bien parisienne. Pour Christophe,—pour beaucoup d'autres,—Colette Stevens était le type de la jeune fille française.
Elle avait dix-huit ans, des yeux noirs veloutés, qu'elle faisait doux aux jeunes gens, des prunelles d'Espagnole, qui remplissaient tout l'orbite de leur humide éclat, un petit nez un peu long et fantasque, qu'elle fronçait et remuait légèrement en parlant, avec des moues mutines, les cheveux désordonnés, un minois chiffonné, la peau médiocre, frottée de poudre, les traits gros, un peu gonflés, l'air d'un petit chat bouffi.
De proportions toutes menues, très bien habillée, séduisante, agacinante, elle avait des manières mignardes, précieuses, niaisottes; elle jouait la fillette, se balançant deux heures dans son fauteuil à bascule, poussant des petits cris, des:
—Non? C'est pas possible?... à table, battant des mains, quand il y avait un plat qu'elle aimait; au salon, grillant des cigarettes, affectant, devant les hommes, une affection exubérante pour ses amies, se jetant à leur cou, leur caressant la main, leur chuchotant à l'oreille, disant des ingénuités, disant aussi des méchancetés, admirablement, d'une voix douce et frêle, qui savait même, à l'occasion, dire des choses très lestes, sans avoir l'air d'y toucher, qui savait encore mieux en faire dire,—l'air candide d'une petite fille bien sage, les yeux brillants, aux paupières lourdes, voluptueux et sournois, qui regardaient de côté, malignement, guettant tous les potins, happant toutes les polissonneries de la conversation, et tâchant de pêcher çà et là quelque cœur à la ligne.
Ces singeries, ces parades de petit chien, cette ingénuité frelatée, ne plaisaient à Christophe en aucune façon. Il avait autre chose à faire qu'à se prêter aux manèges d'une petite fille rouée, ou même qu'à les considérer, d'un œil amusé. Il avait à gagner son pain, à sauver de la mort sa vie et ses pensées. Le seul intérêt pour lui de ces perruches de salon était de lui en fournir les moyens. En échange de leur argent, il leur donnait ses leçons, en conscience, le front plissé, l'esprit tendu vers la tâche, afin de ne se laisser distraire ni par l'ennui qu'elle lui causait, ni par les agaceries de ses élèves, quand elles étaient aussi coquettes que Colette Stevens. Il ne faisait guère plus d'attention à elle qu'à la petite cousine de Colette, une enfant de douze ans, silencieuse et timide, que les Stevens avaient prise chez eux, et à qui il enseignait aussi le piano.
Mais Colette était trop fine pour ne pas sentir qu'avec lui toutes ses grâces étaient perdues, et trop souple pour ne pas s'adapter instantanément aux façons de Christophe. Elle n'avait même pas besoin de s'appliquer pour cela. C'était un instinct de sa nature. Elle était femme. Elle était une onde sans forme. Toutes les âmes qu'elle rencontrait lui étaient comme des vases, dont, par curiosité, par besoin, sur-le-champ, elle épousait les formes. Pour être, il fallait toujours qu'elle fût un autre. Toute sa personnalité, c'était qu'elle ne le restait pas. Elle changeait de vases, souvent.
Christophe l'attirait, pour beaucoup de raisons, dont la première était qu'il n'était pas attiré par elle. Il l'attirait encore, parce qu'il était différent de tous les jeunes gens qu'elle connaissait: elle n'avait jamais essayé encore d'une potiche de cette forme et de ces aspérités. Il l'attirait enfin, parce qu'experte, de race, à évaluer du premier coup d'œil le prix exact des potiches et des gens, elle se rendait parfaitement compte qu'à défaut d'élégance, Christophe avait une solidité, qu'aucun de ses bibelots parisiens ne pouvait lui offrir.
Elle faisait de la musique, comme la plupart des jeunes filles oisives. Elle en faisait beaucoup et peu. C'est-à-dire qu'elle en était toujours occupée, et qu'elle n'en connaissait presque rien. Elle tripotait son piano, toute la journée, par désœuvrement, par pose, par volupté. Tantôt elle en faisait, comme du vélocipède. Tantôt elle pouvait jouer bien, très bien, avec goût, avec âme,—(on eût presque dit qu'elle en avait une: il suffisait qu'elle se mît à la place de quelqu'un qui en avait une).—Elle était capable d'aimer Massenet, Grieg, Thomé, avant de connaître Christophe. Mais elle était aussi capable de ne plus les aimer, depuis qu'elle connaissait Christophe. Et maintenant, elle jouait Bach et Beethoven très proprement,—(ce qui, à la vérité, n'est pas beaucoup dire);—mais le plus fort, c'est qu'elle les aimait. Au fond, ce n'était ni Beethoven, ni Thomé, ni Bach, ni Grieg, qu'elle aimait: c'étaient les notes, les sons, ses doigts qui couraient sur les touches, les vibrations des cordes qui lui grattaient les nerfs comme autant d'autres cordes, leurs chatouilleries voluptueuses.
Dans le salon de l'hôtel aristocratique, décoré de tapisseries un peu pâles, avec, sur un chevalet, au milieu de la pièce, le portrait de la robuste madame Stevens par un peintre à la mode, qui l'avait représentée languissante, comme une fleur sans eau, les yeux mourants, le corps tordu en spirale, pour exprimer la rareté de son âme millionnaire,—dans le grand salon aux baies vitrées, donnant sur de vieux arbres, que la neige poudrait, Christophe trouvait Colette toujours assise devant son piano, ressassant indéfiniment les mêmes phrases, se caressant les oreilles de dissonances moelleuses.
—Ah! faisait Christophe, en entrant. Voilà la chatte, qui fait encore ronron!
—Malhonnête! disait-elle, en riant...
(Et elle lui tendait sa main un peu moite.)
—... Écoutez cela. Est-ce que ce n'est pas joli?
—Très joli, disait-il, d'un ton indifférent.
—Vous n'écoutez pas!... Voulez-vous bien écouter!
—J'entends... C'est toujours la même chose.
—Ah! vous n'êtes pas musicien, faisait-elle, avec dépit.
—Comme si c'était de musique qu'il s'agissait!
—Comment! ce n'est pas de musique?... Et de quoi, s'il vous plaît?
—Vous le savez très bien; et je ne vous le dirai pas, parce que ce ne serait pas convenable.
—Raison de plus pour le dire.
—Vous le voulez?... Tant pis pour vous!... Eh bien, savez-vous ce que vous faites avec votre piano?... Vous flirtez.
—Par exemple!
—Parfaitement. Vous lui dites: «Cher piano, cher piano, dis-moi des gentils mots, encore, caresse-moi, donne-moi un petit baiser!»
—Mais voulez-vous vous taire! dit Colette, moitié riante, moitié fâchée. Vous n'avez pas la moindre idée du respect.
—Pas la moindre.
—Vous êtes un impertinent... Et puis d'abord, quand cela serait, est-ce que ce n'est pas la vraie façon d'aimer la musique?
—Oh! je vous en prie, ne mêlons pas la musique à cela!
—Mais c'est la musique même! Un bel accord, c'est un baiser.
—Je ne vous l'ai pas fait dire.
—Est-ce que ce n'est pas vrai?... Pourquoi haussez-vous les épaules? Pourquoi faites-vous la grimace?
—Parce que cela me dégoûte.
—De mieux en mieux!
—Cela me dégoûte d'entendre parler de la musique, comme d'un libertinage... Oh! ce n'est pas votre faute. C'est la faute de votre monde. Toute cette fade société qui vous entoure regarde l'art comme une sorte de débauche permise... Allons, assez là-dessus! Jouez-moi votre sonate.
—Mais non, causons encore un peu.
—Je ne suis pas ici pour causer, je suis ici pour vous donner des leçons de piano... En avant, marche!
—Vous êtes poli! disait Colette, vexée,—ravie, au fond, d'être ainsi rudoyée.
Elle jouait son morceau, s'appliquant de son mieux; et, comme elle était habile, elle y réussissait très passablement, parfois même assez bien. Christophe, qui n'était pas dupe, riait en lui-même de l'adresse «de cette sacrée mâtine, qui jouait, comme si elle sentait ce qu'elle jouait, quoiqu'elle n'en sentît rien». Il ne laissait pas d'en éprouver pour elle une sympathie amusée. Colette, de son côté, saisissait tous les prétextes pour reprendre la conversation, qui l'intéressait beaucoup plus que la leçon de piano. Christophe avait beau s'en défendre, prétextant qu'il ne pouvait dire ce qu'il pensait, sans risquer de la blesser: elle arrivait toujours à le lui faire dire; et plus c'était blessant, moins elle était blessée: c'était un amusement. Mais comme la fine mouche sentait que Christophe n'aimait rien tant que la sincérité, elle lui tenait tête hardiment, et discutait mordicus. Ils se quittaient très bons amis.
Pourtant, jamais Christophe n'eût eu la moindre illusion sur cette amitié de salon, jamais la moindre intimité ne se fût établie entre eux, sans les confidences que Colette lui fit, un jour, autant par surprise que par instinct de séduction.
La veille, il y avait eu réception chez ses parents. Elle avait ri, bavardé, flirté comme une enragée; mais, le matin suivant, quand Christophe vint lui donner sa leçon, elle était lasse, les traits tirés, le teint gris, la tête grosse comme le poing. Elle dit à peine quelques mots; elle avait l'air éteinte. Elle se mit au piano, joua mollement, rata ses traits, essaya de les refaire, les rata encore, s'interrompit brusquement, et dit:
—Je ne peux pas... Je vous demande pardon... Voulez-vous, attendons un peu...
Il lui demanda si elle était souffrante. Elle répondit que non:
«Elle n'était pas bien disposée... Elle avait des moments comme cela... C'était ridicule, il ne fallait pas lui en vouloir.»
Il lui proposa de revenir, un autre jour; mais elle insista pour qu'il restât:
—Un instant seulement... Tout à l'heure, ce sera mieux... Comme je suis bête, n'est-ce pas?
Il sentait qu'elle n'était pas dans son état normal; mais il ne voulut pas la questionner; et, pour parler d'autre chose, il dit:
—Voilà ce que c'est d'avoir été si brillante, hier soir! Vous vous êtes trop dépensée.
Elle eut un petit sourire ironique:
—On ne peut pas vous en dire autant, répondit-elle.
Il rit franchement.
—Je crois que vous n'avez pas dit un mot, reprit-elle.
—Pas un.
—Il y avait pourtant des gens intéressants.
—Oui, de fameux bavards, des gens d'esprit. Je suis perdu au milieu de vos Français désossés, qui comprennent tout, qui expliquent tout, qui excusent tout,—qui ne sentent rien. Des gens qui parlent, pendant des heures, d'amour et d'art! N'est-ce pas écœurant?
—Cela devrait pourtant vous intéresser: l'art, sinon l'amour.
—On ne parle pas de ces choses: on les fait.
—Mais quand on ne peut pas les faire? dit Colette, avec une petite moue.
Christophe répondit, en riant:
—Alors, laissez cela à d'autres. Tout le monde n'est pas fait pour l'art.
—Ni pour l'amour?
—Ni pour l'amour.
—Miséricorde! Et qu'est-ce qui nous reste?
—Votre ménage.
—Merci! dit Colette, piquée.
Elle remit ses mains sur le piano, essaya de nouveau, manqua de nouveau ses traits, tapa sur les touches, et gémit:
—Je ne peux pas!... Je ne suis bonne à rien, décidément. Je crois que vous avez raison. Les femmes ne sont bonnes à rien.
—C'est déjà quelque chose de le dire, fit Christophe, avec bonhomie.
Elle le regarda, de l'air penaud d'une petite fille qu'on gronde, et dit:
—Ne soyez pas si dur!
—Je ne dis pas de mal des bonnes femmes, répliqua gaiement Christophe. Une bonne femme, c'est le paradis surterre. Seulement, le paradis sur terre...
—Oui, personne ne l'a jamais vu.
—Je ne suis pas si pessimiste. Je dis: Moi, je ne l'ai jamais vu; mais il se peut bien qu'il existe. Je suis même décidé à le trouver, s'il existe. Seulement, ce n'est pas facile. Une bonne femme et un homme de génie, c'est aussi rare l'un que l'autre.
—Et en dehors d'eux, le reste des hommes et des femmes ne compte pas?
—Au contraire! Il n'y a que le reste qui compte... pour le monde.
—Mais pour vous?
—Pour moi, cela n'existe pas.
—Comme vous êtes dur! répéta Colette.
—Un peu. Il faut bien que quelques-uns le soient. Quand ce ne serait que dans l'intérêt des autres!... S'il n'y avait pas un peu de caillou, par-ci par-là, dans le monde, il s'en irait en bouillie.
—Oui, vous avez raison, vous êtes heureux d'être fort, dit Colette tristement. Mais ne soyez pas trop sévère pour ceux,—surtout pour celles qui ne le sont pas... Vous ne savez pas combien notre faiblesse nous pèse. Parce que vous nous voyez rire, flirter, faire des singeries, vous croyez que nous n'avons rien de plus en tête, et vous nous méprisez. Ah! si vous lisiez tout ce qui se passe dans la tête des petites femmes de quinze à dix-huit ans, qui vont dans le monde, et qui ont le genre de succès que comporte leur vie débordante,—lorsqu'elles ont bien dansé, dit des niaiseries, des paradoxes, des choses amères dont on rit parce qu'elles rient, lorsqu'elles ont livré un peu d'elles-mêmes à des imbéciles, et cherché au fond des yeux de chacun cette lumière qu'on n'y trouve jamais,—si vous les voyiez, quand elles rentrent chez elles, dans la nuit, et s'enferment dans leur chambre silencieuse, et se jettent à genoux dans des agonies de solitude!...
—Est-ce possible? dit Christophe, stupéfait. Quoi! vous souffrez, vous souffrez ainsi?
Colette ne répondit pas; mais des larmes lui vinrent aux yeux. Elle essaya de sourire, et tendit la main à Christophe: il la saisit, ému.
—Pauvre petite! disait-il. Si vous souffrez, pourquoi ne faites-vous rien pour sortir de cette vie?
—Que voulez-vous que nous fassions? Il n'y a rien à faire. Vous, hommes, vous pouvez vous libérer, faire ce que vous voulez. Mais nous, nous sommes enfermées pour toujours dans le cercle des devoirs et des plaisirs mondains: nous ne pouvons en sortir.
—Qui vous empêche de vous affranchir comme nous, de prendre une tâche qui vous plaise et vous assure, comme à nous, l'indépendance?
—Comme à vous? Pauvre monsieur Krafft! Elle ne vous l'assure pas trop!... Enfin! Elle vous plaît, du moins. Mais nous, pour quelle tâche sommes-nous faites? Il n'y en a pas une qui nous intéresse.—Oui, je sais bien, nous nous mêlons de tout maintenant, nous feignons de nous intéresser à des tas de choses qui ne nous regardent pas; nous voudrions tant nous intéresser à quelque chose! Je fais comme les autres. Je m'occupe de patronages, de comités de bienfaisance. Je suis des cours de la Sorbonne, des conférences de Bergson et de Jules Lemaître, des concerts historiques, des matinées classiques, et je prends des notes, des notes... je ne sais pas ce que j'écris!... et je tâche de me persuader que cela me passionne, ou du moins que c'est utile. Ah! comme je sais bien le contraire, comme tout cela m'est égal, et comme je m'ennuie!... Ne recommencez pas à me mépriser, parce que je vous dis franchement ce que tout le monde pense. Je ne suis pas plus bécasse qu'une autre. Mais qu'est-ce que la philosophie, et l'histoire, et la science peuvent bien me faire? Quant à l'art,—vous voyez—je tapote, je barbouille, je fais des petites saletés d'aquarelles;—mais est-ce que cela remplit une vie? Il n'y a qu'un but à la nôtre: c'est le mariage. Mais croyez-vous que c'est gai de se marier avec l'un ou l'autre de ces individus, que je connais aussi bien que vous? Je les vois comme ils sont. Je n'ai pas la chance d'être comme vos Gretchen allemandes, qui savent toujours se faire illusion... Est-ce que ce n'est pas terrible? Regarder autour de soi, voir celles qui se sont mariées, ceux avec qui elles se sont mariées, et penser qu'il faudra faire comme elles, se déformer de corps et d'esprit, devenir banales comme elles!... Il faut du stoïcisme, je vous assure, pour accepter une telle vie et ses devoirs. Toutes les femmes n'en sont pas capables... Et le temps passe, les années coulent, la jeunesse s'en va; et pourtant, il y avait de jolies choses, de bonnes choses en nous,—qui ne serviront à rien, qui meurent tous les jours, qu'il faudra se résigner à donner à des sots, à des êtres qu'on méprise, et qui vous mépriseront!... Et personne ne vous comprend! On dirait que nous sommes une énigme pour les gens. Passe encore pour les hommes, qui nous trouvent insipides et baroques! Mais les femmes devraient nous comprendre! Elles ont été comme nous; elles n'auraient qu'à se souvenir... Point. Aucun secours de leur part. Même nos mères nous ignorent, et ne cherchent pas vraiment à nous connaître. Elles ne cherchent qu'à nous marier. Pour le reste, vis, meurs, arrange-toi comme tu voudras! La société nous laisse dans un abandon absolu.
—Ne vous découragez pas, dit Christophe. Il faut que chacun, à son tour, refasse l'expérience de la vie. Si vous êtes brave, tout ira bien. Cherchez en dehors de votre monde. Il doit pourtant y avoir encore quelques honnêtes hommes en France.
—Il y en a. J'en connais. Mais ils sont si ennuyeux!... Et puis, je vous dirai: le monde où je vis me déplaît; mais je ne crois pas que je pourrais vivre en dehors, maintenant. J'en ai pris l'habitude. J'ai besoin d'un certain bien-être, de certains raffinements de luxe et de société, que l'argent ne suffit pas sans doute à donner, mais pour lesquels il est indispensable. Ce n'est pas brillant, je le sais. Mais je me connais, je suis faible... Je vous en prie, ne vous éloignez pas de moi, parce que je vous dis mes petites lâchetés. Écoutez-moi avec bonté. Cela me fait tant de bien de causer avec vous! Je sens que vous êtes fort, que vous êtes sain: j'ai toute confiance en vous. Soyez un peu mon ami, voulez-vous?
—Je veux bien, dit Christophe. Mais qu'est-ce que je pourrai faire?
—M'écouter, me conseiller, me donner du courage. Je suis dans un tel désarroi, souvent! Alors, je ne sais plus que faire. Je me dis: «À quoi bon lutter? À quoi bon me tourmenter? Ceci ou cela, qu'importe? N'importe qui! N'importe quoi!» C'est un état affreux. Je ne voudrais pas y tomber. Aidez-moi! Aidez-moi!...
Elle avait l'air accablée, vieillie de dix ans; elle regardait Christophe avec de bons yeux soumis et suppliants. Il promit tout ce qu'elle voulut. Alors elle se ranima, sourit, redevint gaie.
Et, le soir, elle riait et flirtait, comme à l'ordinaire.
À partir de ce jour, ils eurent régulièrement des entretiens intimes. Ils étaient seuls ensemble: elle lui confiait ce qu'elle voulait; il se donnait beaucoup de mal pour la comprendre et pour la conseiller; elle écoutait les conseils, au besoin les remontrances, gravement, attentivement, comme une fillette bien sage: cela la distrayait, l'intéressait, la soutenait même; elle le remerciait d'une œillade émue et coquette.—Mais à sa vie, rien n'était changé: il n'y avait qu'une distraction de plus.
Sa journée était une suite de métamorphoses. Elle se levait excessivement tard, vers midi. Elle avait eu des insomnies; elle ne s'endormait guère qu'à l'aube. De tout le jour, elle ne faisait rien. Elle ressassait indéfiniment un vers, une idée, un lambeau d'idée, un souvenir de conversation, une phrase musicale, l'image d'une figure qui lui avait plu. Elle n'était tout à fait éveillée qu'à partir de quatre ou cinq heures du soir. Jusque-là, elle avait les paupières lourdes, le visage gonflé, l'air boudeur, endormi. Elle se ranimait, quand venaient quelques bonnes amies, bavardes comme elle, et comme elle curieuses des potins de Paris. Elles discutaient ensemble à perte de vue sur l'amour. La psychologie amoureuse: c'était l'éternel sujet, avec la toilette, les indiscrétions, les médisances. Elle avait aussi son cercle de petits jeunes gens oisifs, qui avaient besoin de passer deux ou trois heures par jour au milieu des jupes, et qui eussent pu en porter: car ils avaient des âmes et des conversations de filles. Christophe avait son heure: l'heure du confesseur. Colette, instantanément, se faisait grave et recueillie. Elle était comme la jeune Française, dont parle Bodley, qui, au confessionnal, «développait un thème tranquillement préparé, modèle d'ordonnance lumineuse et de clarté, où tout ce qui devait être dit était rangé en bon ordre, et classé en catégories distinctes».—Après quoi, elle s'amusait déplus belle. À mesure que la journée s'avançait, elle redevenait plus jeune. Le soir, on allait au théâtre; et c'était l'éternel plaisir de reconnaître dans la salle les mêmes éternelles figures;—le plaisir, non de la pièce qu'on jouait, mais des acteurs qu'on connaissait, et dont on relevait, une fois de plus, les travers bien connus. On échangeait avec ceux qui venaient vous voir dans votre loge des méchancetés sur ceux qui étaient dans les autres loges, ou bien sur les actrices. On trouvait que l'ingénue avait un filet de voix «comme une mayonnaise tournée», ou que la grande comédienne était habillée «comme un abat-jour».—Ou bien, on allait en soirée; et là, le plaisir était de se montrer, si l'on était jolie:—(cela dépendait des jours: rien de plus capricieux qu'une joliesse de Paris);—on renouvelait sa provision de critiques sur les gens, leurs toilettes et leurs défauts physiques. De conversation, il n'y en avait point.—On rentrait tard. On avait peine à se coucher: (c'était l'heure où l'on était le plus éveillée). On trôlait autour de sa table. On feuilletait un livre. On riait toute seule, au souvenir d'une parole ou d'un geste. On s'ennuyait. On était très malheureuse. On ne pouvait s'endormir. Et la nuit, brusquement, on avait des crises de désespoir.
Christophe, qui ne voyait Colette que quelques heures, de temps en temps, et ne pouvait assister qu'à quelques-unes de ses transformations, avait déjà bien de la peine à s'y reconnaître. Il se demandait à quel moment elle était sincère,—ou si elle était sincère toujours,—ou si elle n'était sincère jamais. Colette elle-même n'aurait pu le lui dire. Elle était comme la plupart des jeunes filles, qui ne sont que désir oisif et contraint, dans la nuit. Elle ne savait pas ce qu'elle était, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, et parce qu'elle ne pouvait pas le savoir, avant de l'avoir essayé. Alors elle l'essayait, à sa façon, avec le plus de liberté et le moins de risques possible, entachant de se calquer sur ceux qui l'entouraient, de prendre leur mesure morale. Elle ne se pressait pas de choisir. Elle eût voulu tout ménager, afin de profiter de tout.
Mais avec un ami comme Christophe, ce n'était pas commode. Il admettait qu'on lui préférât des êtres qu'il n'estimait pas, ou même qu'il méprisait; mais il n'admettait pas qu'on l'égalât à eux. Chacun son goût; mais au moins, fallait-il en avoir un.
Il était d'autant moins disposé à la patience que Colette semblait prendre plaisir à collectionner autour d'elle tous les petits jeunes gens, qui pouvaient le plus exaspérer Christophe: d'écœurants petits snobs, riches pour la plupart, en tout cas oisifs, ou lotis de quelque sinécure dans quelque ministère,—ce qui est tout comme. Tous écrivaient—prétendaient écrire. C'était une névrose, sous la Troisième République. C'était surtout une forme de paresse vaniteuse,—le travail intellectuel étant de tous le plus difficile à contrôler, et celui qui prête le plus au bluff. Ils ne disaient de leurs grands labeurs que quelques mots discrets, mais respectueux. Ils semblaient pénétrés de l'importance de leur tâche, accablés sous le fardeau. Dans les premiers temps, Christophe éprouvait une gêne à ignorer absolument leurs œuvres et leurs noms. Avec timidité, il tâcha de s'informer; il désirait surtout savoir ce qu'avait écrit l'un d'eux, dont leurs discours faisaient un maître du théâtre. Il fut surpris d'apprendre que ce grand dramaturge avait produit un seul acte, lequel était extrait d'un roman, qui lui-même était fait d'une suite de nouvelles, ou plutôt de notations qu'il avait publiées dans une de leurs Revues, au cours des dix dernières années. Les autres n'avaient pas un bagage plus lourd: quelques actes, quelques nouvelles, quelques vers. Certains étaient célèbres pour un article. D'autres pour un livre, «qu'ils devaient faire». Ils professaient du dédain pour les œuvres de longue haleine. Ils semblaient attacher une importance extrême à l'agencement des mots dans la phrase. Cependant, le mot de «pensée» revenait fréquemment dans leurs propos; mais il ne paraissait pas avoir le même sens que dans le langage courant: ils l'appliquaient à des détails de style. Toutefois, il y avait aussi parmi eux de grands penseurs et de grands ironistes, qui, lorsqu'ils écrivaient, mettaient leurs mots profonds et fins en italiques, pour qu'on ne s'y trompât point.
Tous avaient le culte du moi: le seul culte qu'ils eussent. Ils cherchaient à le faire partager aux autres. Le malheur était que les autres étaient déjà pourvus. Ils avaient la préoccupation constante d'un public dans leur façon de parler, marcher, fumer, lire un journal, porter la tête et les yeux, se saluer entre eux. Le cabotinage est naturel aux jeunes gens, et d'autant plus qu'ils sont plus insignifiants, c'est-à-dire moins occupés. C'est surtout pour la femme qu'ils se mettent en frais: car ils la convoitent, et désirent—encore plus—être convoités par elle. Mais même pour le premier venu, ils font la roue: pour un passant qu'ils croisent, et dont ils ne peuvent attendre qu'un regard ébahi. Christophe rencontrait souvent de ces petits paonneaux: rapins, virtuoses, jeunes cabots, qui se font la tête d'un portrait connu: Van Dyck, Rembrandt, Velasquez, Beethoven, ou d'un rôle à jouer: le bon peintre, le bon musicien, le bon ouvrier, le profond penseur, le joyeux drille, le paysan du Danube, l'homme de la nature... Ils jetaient un regard de côté, en passant, pour voir si on les remarquait. Christophe les voyait venir, et, quand ils étaient près de lui, malicieusement, il tournait, avec indifférence, les yeux d'un autre côté. Mais leur déconvenue ne durait guère: deux pas plus loin, ils piaffaient pour le prochain passant.—Ceux du salon de Colette étaient plus raffinés: c'était surtout leur esprit qu'ils grimaient: ils copiaient deux ou trois modèles, qui eux-mêmes n'étaient pas des originaux. Ou bien, ils mimaient une idée: la Force, la Joie, la Pitié, la Solidarité, le Socialisme, l'Anarchisme, la Foi, la Liberté: c'étaient des rôles pour eux. Ils avaient le talent de faire des plus chères pensées une affaire de littérature, et de ramener les plus héroïques élans de l'âme humaine au rôle de cravates à la mode.
Où ils étaient tout à fait dans leur élément, c'était dans l'amour: il leur appartenait. La casuistique du plaisir n'avait point de secrets pour eux; dans leur virtuosité, ils inventaient des cas nouveaux, afin d'avoir l'honneur de les résoudre. Ç'a toujours été l'occupation de ceux qui n'en ont point d'autre: faute d'aimer, ils «font l'amour»; et surtout, ils l'expliquent. Les commentaires étaient plus abondants que le texte, qui, chez eux, était fort mince. La sociologie donnait du ragoût aux pensées les plus scabreuses: tout se couvrait alors du pavillon de la sociologie; quelque plaisir qu'on eût à satisfaire ses vices, il eût manqué quelque chose, si l'on ne s'était persuadé qu'en les satisfaisant, on travaillait pour les temps nouveaux. Un genre de socialisme éminemment parisien: le socialisme érotique.
Parmi les problèmes qui passionnaient alors cette petite cour d'amour, était l'égalité des femmes et des hommes dans le mariage et de leurs droits à l'amour. Il y avait eu de braves jeunes gens, honnêtes, protestants, un peu ridicules,—Scandinaves ou Suisses,—qui avaient réclamé l'égalité dans la vertu: les hommes arrivant au mariage, vierges comme les femmes. Les casuistes parisiens demandaient une égalité d'une autre sorte, l'égalité dans la malpropreté: les femmes arrivant au mariage, souillées comme les hommes,—le droit aux amants. Paris avait fait une telle consommation de l'adultère, en imagination et en pratique, qu'il commençait à sembler insipide: on cherchait à lui substituer, dans le monde des lettres, une invention plus originale: la prostitution des jeunes filles,—j'entends la prostitution régulière, universelle, vertueuse, décente, familiale, et, par-dessus le marché, sociale.—Un livre, plein de talent, qui venait de paraître, faisait loi sur la question: il étudiait en quatre cents pages d'un pédantisme badin, «selon toutes les règles de la méthode Baconienne», le «meilleur aménagement du plaisir». Cours complet d'amour libre, où l'on parlait sans cesse d'élégance, de bienséance, de bon goût, de noblesse, de beauté, de vérité, de pudeur, de morale,—un Berquin pour les jeunes filles du monde qui voulaient mal tourner.—C'était, pour le moment, l'Évangile, dont la petite cour de Colette faisait ses délices, et qu'elle paraphrasait. Il va de soi qu'à la façon des disciples, ils laissaient de côté ce qu'il pouvait y avoir, sous ces paradoxes, de juste, de bien observé et même d'assez humain, pour n'en retenir que le pire. Dans ce parterre de petites fleurs sucrées, ils ne manquaient jamais de cueillir les plus vénéneuses,—des aphorismes de ce genre: «que le goût de la volupté ne peut qu'aiguiser le goût du travail»;—«qu'il est monstrueux qu'une vierge devienne mère avant d'avoir joui»;—«que la possession d'un homme vierge était pour une femme la préparation naturelle à la maternité réfléchie»;—que c'était le rôle des mères «d'organiser la liberté des filles avec cet esprit de délicatesse et de décence qu'elles appliquent à protéger la liberté de leurs fils»;—et que le temps viendrait «où les jeunes filles rentreraient de chez leur amant avec autant de naturel qu'elles reviennent à présent du cours ou de prendre le thé chez une amie».
Colette déclarait, en riant, que de tels préceptes étaient fort raisonnables.
Christophe avait l'horreur de ces propos. Il s'exagérait leur importance et le mal qu'ils pouvaient faire. Les Français ont trop d'esprit pour appliquer leur littérature. Ces Diderots au petit pied, cette menue monnaie du grand Denis, sont, dans la vie ordinaire, comme le génial Panurge de l'Encyclopédie, des bourgeois aussi honnêtes, voire aussi timorés que les autres. C'est justement parce qu'ils sont si timides dans l'action qu'ils s'amusent à pousser l'action (en pensée), jusqu'aux limites du possible. C'est un jeu où l'on ne risque rien.
Mais Christophe n'était pas un dilettante français.
Entre tous les jeunes gens qui entouraient Colette, il y en avait un qu'elle semblait préférer. Naturellement, de tous il était celui qui était le plus insupportable à Christophe.
Un de ces fils de bourgeois enrichis, qui font de la littérature aristocratique, et jouent les patriciens de la Troisième République. Il se nommait Lucien Lévy-Cœur. Il avait les yeux écartés, au regard vif, le nez busqué, les lèvres fortes, la barbe blonde taillée en pointe, à la Van Dyck, un commencement de calvitie précoce, qui ne lui allait point mal, la parole câline, des manières élégantes, des mains fines et molles, qui fondaient dans la main. Il affectait toujours une très grande politesse, une courtoisie raffinée, même avec ceux qu'il n'aimait point, et qu'il cherchait à jeter par-dessus bord.
Christophe l'avait rencontré déjà, au premier dîner d'hommes de lettres, où Sylvain Kohn l'avait introduit; et bien qu'ils ne se fussent point parlé, il lui avait suffi d'entendre le son de sa voix pour éprouver à son égard une aversion, qu'il ne s'expliquait pas, et dont il ne devait comprendre que plus tard les profondes raisons. Il y a des coups de foudre de l'amour. Il y en a aussi de la haine,—ou,—(pour ne point choquer les âmes douces, qui ont peur de ce mot, comme de toutes les passions),—c'est l'instinct de l'être sain, qui sent l'ennemi et se défend.
En face de Christophe, il représentait l'esprit d'ironie et de décomposition, qui s'attaquait doucement, poliment, sourdement, à tout ce qu'il y avait de grand dans l'ancienne société qui mourait: à la famille, au mariage, à la religion, à la patrie; en art, à tout ce qu'il y avait de viril, de pur, de sain, de populaire; à toute foi dans les idées, dans les sentiments, dans les grands hommes, dans l'homme. Au fond de toute cette pensée, il n'y avait qu'un plaisir mécanique d'analyse, d'analyse à outrance, un besoin animal de ronger la pensée, un instinct de ver. Et à côté de cet idéal de rongeur intellectuel, une sensualité de fille, mais de fille bas-bleu: car chez lui, tout était ou devenait littéraire. Tout lui était matière à littérature: ses bonnes fortunes, ses vices et ceux de ses amis. Il avait écrit des romans et des pièces où il narrait avec beaucoup de talent la vie privée de ses parents, leurs aventures intimes, celles de ses amis, les siennes, ses liaisons, une entre autres qu'il avait eue avec la femme de son meilleur ami: les portraits étaient faits avec un grand art; chacun en louait l'exactitude: le public, la femme, et l'ami. Il ne pouvait obtenir les confidences ou les faveurs d'une femme, sans le dire dans un livre.—Il eût semblé naturel que ses indiscrétions le missent en froid avec ses «associées». Mais il n'en était rien: elles en étaient à peine un peu gênées; elles protestaient, pour la forme: au fond, elles étaient ravies qu'on les montrât aux passants, toutes nues; pourvu qu'on leur laissât un masque sur la figure, leur pudeur était en repos. De son côté, il n'apportait à ces commérages aucun esprit de vengeance, ni peut-être même de scandale. Il n'était pas plus mauvais fils, ni plus mauvais amant que la moyenne des gens. Dans les mêmes chapitres où il dévoilait effrontément son père, sa mère et sa maîtresse, il avait des pages où il parlait d'eux avec une tendresse et un charme poétiques. En réalité, il était extrêmement familial; mais de ces gens qui n'ont pas besoin de respecter ce qu'ils aiment: bien au contraire; ils aiment mieux ce qu'ils peuvent un peu mépriser; l'objet de leur affection leur en paraît plus près d'eux, plus humain. Ils sont les gens du monde les moins capables de comprendre l'héroïsme et surtout la pureté. Ils ne sont pas loin de les considérer comme un mensonge ou une faiblesse d'esprit. Il va de soi d'ailleurs qu'ils ont la conviction de comprendre mieux que quiconque les héros de l'art, et qu'ils les jugent avec une familiarité protectrice.
Il s'entendait admirablement avec les ingénues perverties de la société bourgeoise, riche et fainéante. Il était une compagne pour elles, une sorte de servante dépravée, plus libre et plus avertie, qui les instruisait, et qu'elles enviaient. Elles ne se gênaient pas avec lui; et, la lampe de Psyché à la main, elles étudiaient curieusement l'androgyne nu, qui les laissait faire.
Christophe ne pouvait comprendre comment une jeune fille, comme Colette, qui semblait avoir une nature délicate et le désir touchant d'échapper à l'usure dégradante de la vie, pouvait se complaire dans cette société... Christophe n'était point psychologue. Lucien Lévy-Cœur l'était cent fois plus que lui. Christophe était le confident de Colette; mais Colette était la confidente de Lucien Lévy-Cœur. Grande supériorité pour celui-ci. Il est doux à une femme de croire qu'elle a affaire à un homme plus faible qu'elle. Elle trouve à satisfaire, en même temps qu'à ce qu'il y a de moins bon en elle, à ce qu'il y a de meilleur: son instinct maternel. Lucien Lévy-Cœur le savait bien: un des moyens les plus sûrs pour toucher le cœur des femmes est d'éveiller cette corde mystérieuse. Puis, Colette se sentait faible, passablement lâche, avec des instincts dont elle n'était pas très fière, mais qu'elle se fût bien gardée de repousser. Il lui plaisait de se laisser persuader, par les confessions audacieusement calculées de son ami, que les autres étaient de même, et qu'il fallait prendre la nature humaine comme elle était. Elle se donnait alors la satisfaction de ne pas combattre des penchants qui lui étaient agréables, et le luxe de se dire qu'elle avait raison ainsi, que la sagesse était de ne pas se révolter et d'être indulgent pour ce qu'on ne pouvait—«hélas!»—empêcher. C'était là une sagesse dont la pratique n'avait rien de pénible.
Pour qui sait regarder la vie avec sérénité, il y a une forte saveur dans le contraste perpétuel qui existe, au sein de la société, entre l'extrême raffinement de la civilisation apparente et l'animalité profonde. Tout salon, qui n'est point rempli de fossiles et d'âmes pétrifiées, présente, comme deux couches de terrains, deux couches de conversations superposées: l'une,—que tout le monde entend,—entre les intelligences; l'autre,—dont peu de gens ont conscience, et qui est pourtant la plus forte,—entre les instincts, entre les bêtes. Ces deux conversations sont souvent contradictoires. Tandis que les esprits échangent des monnaies de convention, les corps disent: Désir, Aversion, ou, plus souvent: Curiosité, Ennui, Dégoût. La bête, encore que domptée par des siècles de civilisation, et aussi abrutie que les misérables lions dans la cage, rêve toujours à sa pâture.
Mais Christophe n'était pas encore arrivé à ce désintéressement de l'esprit, que seul apporte l'âge et la mort des passions. Il avait pris très au sérieux son rôle de conseiller de Colette. Elle lui avait demandé son aide; et il la voyait s'exposer de gaieté de cœur au danger. Aussi ne cachait-il plus son hostilité a Lucien Lévy-Cœur. Celui-ci s'était tenu d'abord, vis-à-vis de Christophe, dans l'attitude d'une politesse irréprochable et ironique. Lui aussi flairait l'ennemi; mais il ne le jugeait pas redoutable: il le ridiculisait, sans en avoir l'air. Il n'eût demandé qu'à être admiré de Christophe pour rester en bons termes avec lui: mais c'était ce qu'il ne pourrait obtenir jamais; et il le sentait bien, car Christophe n'avait pas l'art de feindre. Alors, Lucien Lévy-Cœur était passé insensiblement d'une opposition tout abstraite de pensées à une petite guerre personnelle, soigneusement voilée, dont Colette devait être le prix.
Entre ses deux amis elle tenait la balance égale. Elle goûtait la supériorité morale et le talent de Christophe; mais elle goûtait aussi l'immoralité amusante et l'esprit de Lucien Lévy-Cœur; et, au fond, elle y trouvait plus de plaisir. Christophe ne lui ménageait pas les remontrances: elle les écoutait avec une humilité touchante, qui le désarmait. Elle était assez bonne, mais sans franchise, par faiblesse, par bonté même. Elle jouait à demi la comédie; elle feignait de penser comme Christophe. Elle savait bien le prix d'un ami comme lui; mais elle ne voulait faire aucun sacrifice à une amitié; elle ne voulait faire aucun sacrifice à rien, ni à personne; elle voulait ce qui lui était le plus commode et le plus agréable. Elle cachait donc à Christophe qu'elle recevait toujours Lucien Lévy-Cœur; elle mentait, avec le naturel charmant des jeunes femmes du monde, expertes dès l'enfance en cet exercice nécessaire à qui doit posséder l'art de garder tous ses amis et de les contenter tous. Elle se donnait comme excuse que c'était pour ne pas faire de peine à Christophe; mais en réalité, c'était parce qu'elle savait qu'il avait raison; et elle n'en voulait pas moins faire ce qui lui plaisait à elle, sans pourtant se brouiller avec lui. Christophe avait parfois le soupçon de ces ruses; il grondait alors, il faisait la grosse voix. Elle, continuait de jouer la petite fille contrite, affectueuse, un peu triste; elle lui faisait les yeux doux,—feminæ ultima ratio.—Cela l'attristait vraiment de sentir qu'elle pouvait perdre l'amitié de Christophe; elle se faisait séduisante et sérieuse; et elle réussissait à désarmer pour quelque temps Christophe. Mais tôt ou tard, il fallait bien en finir par un éclat. Dans l'irritation de Christophe, il entrait, à son insu, un petit peu de jalousie. Et dans les ruses enjôleuses de Colette, il entrait aussi un peu, un petit peu d'amour. La rupture n'en devait être que plus vive.
Un jour que Christophe avait pris Colette en flagrant délit de mensonge, il lui mit marché en main: choisir entre Lucien Lévy-Cœur et lui. Elle essaya d'éluder la question; et, finalement, elle revendiqua son droit d'avoir tous les amis qu'il lui plaisait. Elle avait parfaitement raison; et Christophe se rendit compte qu'il était ridicule; mais il savait aussi que ce n'était pas par égoïsme qu'il se montrait exigeant: il s'était pris pour Colette d'une sincère affection; il voulait la sauver, fut-ce en violentant sa volonté. Il insista donc, maladroitement. Elle refusa de répondre. Il lui dit:
—Colette, vous voulez donc que nous ne soyons plus amis?
Elle dit:
—Non, je vous en prie. Cela me ferait beaucoup de peine, si vous ne l'étiez plus.
—Mais vous ne feriez pas à notre amitié le moindre sacrifice?
—Sacrifice! Quel mot absurde! dit-elle. Pourquoi faudrait-il toujours sacrifier une chose à une autre? Ce sont des bêtes d'idées chrétiennes. Au fond, vous êtes un vieux clérical sans le savoir.
—Cela se peut bien, dit-il. Pour moi, c'est tout un ou tout autre. Entre le bien et le mal, je ne trouve pas de milieu, même pour l'épaisseur d'un cheveu.
—Oui, je sais, dit-elle. C'est pour cela que je vous aime. Je vous aime bien, je vous assure; mais...
—Mais vous aimez bien aussi l'autre?
Elle rit, et dit, en lui faisant ses yeux les plus câlins et sa voix la plus douce:
—Restez!
Il était sur le point de céder encore. Mais Lucien Lévy-Cœur entra; et les mêmes yeux câlins et la même voix douce servirent à le recevoir. Christophe regarda, en silence, Colette faire ses petites comédies; puis il s'en alla, décidé à rompre. Il avait le cœur chagrin. C'était si bête de s'attacher toujours, de se laisser prendre au piège!
En rentrant chez lui, et rangeant machinalement ses livres, il ouvrit par désœuvrement sa Bible, et lut:
... Le Seigneur a dit: Parce que les filles de Sion vont en raidissant le cou, en remuant les yeux, en marchant à petits pas affectés, en faisant résonner les anneaux de leurs pieds,
Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, le Seigneur en découvrira la nudité...
Il éclata de rire, en songeant aux manèges de Colette; et il se coucha, de bonne humeur. Puis il pensa qu'il fallait qu'il fût bien atteint, lui aussi, par la corruption de Paris, pour que la Bible fût devenue pour lui d'une lecture comique. Mais il n'en continua pas moins, dans son lit, à se répéter la sentence du grand Justicier farceur; et il cherchait à en imaginer l'effet sur la tête de sa jeune amie. Il s'endormit, en riant comme un enfant. Il ne songeait déjà plus à son nouveau chagrin. Un de plus, un de moins... Il en prenait l'habitude.
Il ne cessa point de donner des leçons de piano à Colette; mais il évita désormais les occasions qu'elle lui offrait de continuer leurs entretiens amicaux. Elle eut beau s'attrister, se piquer, jouer de ses petites roueries: il s'obstina; ils se boudèrent; d'elle-même, elle finit par trouver des prétextes pour espacer les leçons; et il en trouva pour esquiver les invitations aux soirées des Stevens.
Il en avait assez de la société parisienne; il ne pouvait plus souffrir ce vide, cette oisiveté, cette impuissance morale, cette neurasthénie, cette hypercritique, sans raison et sans but, qui se dévore elle-même. Il se demandait comment un peuple pouvait vivre dans cette atmosphère stagnante d'art pour l'art et de plaisir pour le plaisir. Cependant, ce peuple vivait, il avait été grand, il faisait encore assez bonne figure dans le monde; pour qui le voyait de loin, il faisait illusion. Où pouvait-il puiser ses raisons de vivre? Il ne croyait à rien, à rien qu'au plaisir...
Comme Christophe en était là de ses réflexions, il se heurta dans la rue à une foule hurlante de jeunes gens et de femmes, qui traînaient une voiture, où un vieux prêtre était assis, bénissant à droite et à gauche. Un peu plus loin, il vit des soldats français, qui enfonçaient à coups de hache les portes d'une église, et que des messieurs décorés accueillaient à coups de chaises. Il s'aperçut que les Français croyaient pourtant à quelque chose,—encore qu'il ne comprît pas à quoi. On lui expliqua que c'était l'État qui se séparait de l'Église, après un siècle de vie commune, et que, comme elle ne voulait pas partir de bon gré, fort de son droit et de sa force, il la mettait à la porte. Christophe ne trouva point le procédé galant; mais il était si excédé du dilettantisme anarchique des artistes parisiens qu'il eut plaisir à rencontrer des gens qui étaient prêts à se faire casser la tête pour une cause, si inepte qu'elle fût.
Il ne tarda pas à reconnaître qu'il y avait beaucoup de ces gens en France. Les journaux politiques se livraient des combats, comme les héros d'Homère; ils publiaient journellement des appels à la guerre civile. Il est vrai que cela se passait en paroles, et que l'on en venait rarement aux coups. Cependant, il ne manquait pas de naïfs pour mettre en action la morale que les autres écrivaient. On assistait alors à de curieux spectacles: des départements qui prétendaient se séparer de la France, des régiments qui désertaient, des préfectures brûlées, des percepteurs à cheval, à la tête de compagnies de gendarmes, des paysans armés de faux, faisant bouillir des chaudières pour défendre les églises, que des libres penseurs défonçaient, au nom de la liberté, des Rédempteurs populaires, qui montaient dans les arbres pour parler aux provinces du Vin, soulevées contre les provinces de l'Alcool. Par-ci, par-là, ces millions d'hommes qui se montraient le poing, tout rouges d'avoir crié, finissaient tout de bon par se cogner. La République flattait le peuple; et puis, elle le faisait sabrer. Le peuple, de son côté, cassait la tête à quelques enfants du peuple,—officiers et soldats.—Ainsi, chacun prouvait aux autres l'excellence de sa cause et de ses poings. Quand on regardait cela de loin, au travers des journaux, on se croyait revenu de plusieurs siècles en arrière. Christophe découvrait que la France,—cette France sceptique,—était un peuple fanatique. Mais il lui était impossible de savoir en quel sens. Pour ou contre la religion? Pour ou contre la raison? Pour ou contre la patrie?—Ils l'étaient dans tous les sens. Ils avaient l'air de l'être, pour le plaisir de l'être.
Il fut amené à en causer, un soir, avec un député socialiste, qu'il rencontrait parfois dans le salon des Stevens. Bien qu'il lui eût déjà parlé, il ne se doutait point de la qualité de son interlocuteur: jusque-là, ils ne s'étaient entretenus que de musique. Il fut très étonné d'apprendre que cet homme du monde était un chef de parti violent.
Achille Roussin était un bel homme, à la barbe blonde, au parler grasseyant, le teint fleuri, les manières cordiales, une certaine élégance avec un fond de vulgarité, des gestes de rustre, qui lui échappaient de temps en temps:—une façon de se faire les ongles en société, une habitude toute populaire de ne pouvoir parler à quelqu'un sans happer son habit, l'empoigner, lui palper les bras;—il était gros mangeur, gros buveur, viveur, rieur, les appétits d'un homme du peuple, qui se rue à la conquête du pouvoir; souple, habile à changer de façons, suivant le milieu et l'interlocuteur, exubérant d'une façon raisonnée, sachant écouter, s'assimilant sur-le-champ tout ce qu'il entendait; sympathique d'ailleurs, intelligent, s'intéressant à tout, par goût naturel, par goût acquis, et par vanité; honnête, dans la mesure où son intérêt ne lui commandait pas le contraire, et où il eût été dangereux de ne pas l'être.
Il avait une assez jolie femme, grande, bien faite, solidement charpentée, la taille élégante, un peu étriquée dans de luxueuses toilettes, qui accusaient avec exagération les robustes rondeurs de son anatomie; le visage encadré de cheveux noirs frisottants, les yeux grands, noirs et épais; le menton un peu en galoche; la figure grosse, d'aspect assez mignon toutefois, mais gâté par les petites grimaces des yeux myopes, clignotants, et de la bouche en cul-de-poule. Elle avait une démarche factice, saccadée, comme certains oiseaux, et une façon de parler minaudière, mais beaucoup de bonne grâce et d'amabilité. Elle était de riche famille bourgeoise et commerçante, d'esprit libre et d'espèce vertueuse, attachée aux devoirs innombrables du monde, comme à une religion, sans parler de ceux qu'elle s'imposait, de ses devoirs artistiques et sociaux: avoir un salon, répandre l'art dans les Universités Populaires, s'occuper d'œuvres philanthropiques ou de psychologie de l'enfance,—sans chaleur de cœur, sans intérêt profond,—par bonté naturelle, snobisme, et pédantisme innocent de jeune femme instruite, qui semble réciter perpétuellement une leçon, et qui met son amour-propre à ce qu'elle soit bien sue. Elle avait besoin de s'occuper, mais elle n'avait pas besoin de s'intéresser à ce dont elle s'occupait. Telle, l'activité fébrile de ces femmes, qui ont toujours un tricot entre les doigts, et qui remuent sans trêve les aiguilles, comme si le salut du monde était attaché à ce travail, dont elles n'ont même pas l'emploi. Et puis, il y avait chez elle,—comme chez les «tricoteuses»,—la petite vanité de l'honnête femme, qui fait, par son exemple, la leçon aux autres femmes.
Le député avait pour elle un mépris affectueux. Il l'avait fort bien choisie, pour son plaisir et pour sa tranquillité. Elle était belle, il en jouissait, il ne lui demandait rien de plus; et elle ne lui demandait rien de plus. Il l'aimait, et la trompait. Elle s'en accommodait, pourvu qu'elle eût sa part. Peut-être même y trouvait-elle un certain plaisir. Elle était calme et sensuelle. Une mentalité de femme de harem.
Ils avaient deux jolis enfants de quatre à cinq ans, dont elle s'occupait, en bonne mère de famille, avec la même application aimable et froide qu'elle apportait à suivre la politique de son mari et les dernières manifestations de la mode et de l'art. Et cela faisait, dans ce milieu, le plus singulier mélange de théories avancées, d'art ultra-décadent, d'agitation mondaine, et de sentiment bourgeois.
Ils invitèrent Christophe à venir les voir. Madame Roussin était bonne musicienne, jouait du piano d'une façon charmante; elle avait un toucher délicat et ferme; avec sa petite tête, qui regardait fixement les touches, et ses mains perchées dessus, qui sautillaient, elle avait l'air d'une poule qui donne des coups de bec. Bien douée, et plus instruite en musique que la plupart des Françaises, elle était d'ailleurs indifférente comme une carpe au sens profond de la musique: c'était pour elle une suite de notes, de rythmes et de nuances, qu'elle écoutait ou récitait avec exactitude; elle n'y cherchait point d'âme, n'en ayant pas besoin pour elle-même. Cette aimable femme, intelligente, simple, toujours disposée à rendre service, dispensa à Christophe la bonne grâce accueillante qu'elle avait pour tous. Christophe lui en savait peu de gré; il n'avait pas beaucoup de sympathie pour elle: il la trouvait inexistante. Peut-être ne lui pardonnait-il pas non plus, sans s'en rendre compte, la complaisance qu'elle mettait à accepter le partage avec les maîtresses de son mari, dont elle n'ignorait pas les aventures. La passivité était, de tous les vices, celui qu'il excusait le moins.
Il se lia plus intimement avec Achille Roussin. Roussin aimait la musique, comme les autres arts, d'une façon grossière, mais sincère. Quand il aimait une symphonie, il avait l'air de coucher avec. Il avait une culture superficielle, et il en tirait très bon parti; sa femme ne lui avait pas été inutile en cela. Il s'intéressa à Christophe, parce qu'il voyait en lui un plébéien vigoureux, comme il était lui-même. Il était d'ailleurs curieux d'observer de près un original de ce genre—(il était d'une curiosité inlassable pour observer les hommes)—et de connaître ses impressions sur Paris. La franchise et la rudesse des remarques de Christophe l'amusa. Il était assez sceptique pour en admettre l'exactitude. Que Christophe fût Allemand n'était pas pour le gêner: au contraire! Il se vantait d'être au-dessus des préjugés de patrie. Et, en somme, il était sincèrement «humain»—(sa principale qualité);—il sympathisait avec tout ce qui était homme. Mais cela ne l'empêchait point d'avoir la conviction bien assurée de la supériorité du Français—vieille race, vieille civilisation—sur l'Allemand, et de se gausser de l'Allemand.
Christophe voyait chez Achille Roussin d'autres hommes politiques, ministres de la veille ou du lendemain. Avec chacun d'eux, individuellement, il aurait eu assez de plaisir à causer, si ces illustres personnages l'en avaient jugé digne. Au contraire de l'opinion généralement répandue, il trouvait leur société plus intéressante que celle des littérateurs qu'il connaissait. Ils avaient une intelligence plus vivante, plus ouverte aux passions et aux grands intérêts de l'humanité. Causeurs brillants, méridionaux pour la plupart, ils étaient étonnamment dilettantes; pris à part, ils l'étaient presque autant que les hommes de lettres. Bien entendu, ils étaient assez ignorants de l'art, surtout de l'art étranger; mais ils prétendaient tous plus ou moins s'y connaître; et souvent, ils l'aimaient vraiment. Il y avait des Conseils de ministres, qui ressemblaient à des cénacles de petites Revues. L'un faisait des pièces de théâtre. L'autre raclait du violon et était wagnérien enragé. L'autre gâchait de la peinture. Et tous collectionnaient les tableaux impressionnistes, lisaient les livres décadents, mettaient une coquetterie à goûter un art ultra-aristocratique, qui était l'ennemi mortel de leurs idées. Christophe était gêné de voir ces ministres socialistes, ou radicaux-socialistes, ces apôtres des classes affamées, faire les connaisseurs en jouissances raffinées. Sans doute, c'était leur droit; mais cela ne lui semblait pas très loyal.
Mais le plus curieux, c'était quand ces hommes, qui, pris en particulier, étaient sceptiques, sensualistes, nihilistes, anarchistes, touchaient à l'action: aussitôt, ils devenaient fanatiques. Les plus dilettantes, à peine arrivés au pouvoir, se muaient en petits despotes orientaux; ils étaient pris de la manie de tout diriger, de ne rien laisser libre: ils avaient l'esprit sceptique et le tempérament tyrannique. La tentation était trop forte de pouvoir user du formidable mécanisme de centralisation administrative, qu'avait jadis construit le plus grand des despotes, et de n'en pas abuser. Il s'en suivait une sorte d'impérialisme républicain, sur lequel était venu se greffer, dans les dernières années, un catholicisme athée.
Pendant un certain temps, les politiciens n'avaient prétendu qu'à la domination des corps,—je veux dire des fortunes;—ils laissaient les âmes à peu près tranquilles, les âmes n'étant pas monnayables. De leur côté, les âmes ne s'occupaient pas de politique; elle passait au-dessus ou au-dessous d'elles; la politique, en France, était considérée comme une branche, lucrative, mais suspecte, du commerce et de l'industrie; les intellectuels méprisaient les politiciens, les politiciens méprisaient les intellectuels.—Or, depuis peu un rapprochement s'était fait, puis bientôt une alliance, entre les politiciens et la pire classe des intellectuels. Un nouveau pouvoir était entré en scène, qui s'était arrogé le gouvernement absolu des pensées: c'étaient les Libres Penseurs. Ils avaient lié partie avec l'autre pouvoir, qui avait vu en eux un rouage perfectionné de despotisme politique. Ils tendaient beaucoup moins à détruire l'Église qu'à la remplacer; et, de fait, ils formaient une église de la Libre Pensée, qui avait ses catéchismes et ses cérémonies, ses baptêmes, ses premières communions, ses mariages, ses conciles régionaux, nationaux, voire même œcuméniques à Rome. Inénarrable bouffonnerie que ces milliers de pauvres bêtes, qui avaient besoin de se réunir en troupeaux, pour «penser librement»! il est vrai que leur liberté de pensée consistait à interdire celle des autres, au nom de la Raison: car ils croyaient à la Raison, comme les catholiques à la Sainte Vierge, sans se douter, les uns et les autres, que la Raison, pas plus que la Vierge, n'est rien par elle-même, et que la source est ailleurs. Et, de même que l'Église catholique avait ses armées de moines et ses congrégations, qui sourdement cheminaient dans les veines de la nation, propageaient son virus, et anéantissaient toute vitalité rivale, l'église anti-catholique avait ses francs-maçons, dont la maison mère, le Grand-Orient, tenait registre fidèle de tous les rapports secrets que lui adressaient, chaque jour, de tous les points de France, ses pieux délateurs. L'État républicain encourageait sous main les espionnages sacrés de ces moines mendiants et de ces jésuites de la Raison, qui terrorisaient l'armée, l'Université, tous les corps de l'État; et il ne s'apercevait point qu'en semblant le servir, ils visaient peu à peu à se substituer à lui, et qu'il s'acheminait tout doucement à une théocratie athée, qui n'aurait rien à envier à celle des Jésuites du Paraguay.
Christophe vit chez Roussin quelques-uns de ces calotins. Ils étaient plus fétichistes les uns que les autres. Pour le moment, ils exultaient d'avoir fait enlever le Christ des tribunaux. Ils croyaient avoir détruit la religion, parce qu'ils détruisaient quelques morceaux de bois. D'autres accaparaient Jeanne d'Arc et sa bannière de la Vierge, qu'ils venaient d'arracher aux catholiques. Un des pères de l'église nouvelle, un général qui faisait la guerre aux Français de l'autre église, venait de prononcer un discours anti-clérical en l'honneur de Vercingétorix: il célébrait dans le Brenn gaulois, h qui la Libre Pensée avait élevé une statue, un enfant du peuple et le premier champion de la France contre Rome (l'église de). Un ministre de la marine, pour purifier la flotte et faire enrager les catholiques, donnait à un cuirassé le nom d'Ernest Renan. D'autres libres esprits s'attachaient à purifier l'art. Ils expurgeaient les classiques du XVIIe siècle, et ne permettaient pas que le nom de Dieu souillât les Fables de La Fontaine. Ils ne l'admettaient pas plus dans la musique ancienne; et Christophe entendit un vieux radical,—(«Être radical dans sa vieillesse, dit Gœthe, c'est le comble de toute folie»)—qui s'indignait qu'on osât donner dans un concert populaire les lieder religieux de Beethoven. Il exigeait qu'on changeât les paroles.
D'autres, plus radicaux encore, voulaient qu'on supprimât purement et simplement toute musique religieuse, et les écoles où on l'apprenait. Vainement, un directeur des Beaux-Arts, qui dans cette Béotie passait pour un Athénien, expliquait qu'il fallait pourtant apprendre la musique aux musiciens: car, disait-il: «quand vous envoyez un soldat à la caserne, vous lui apprenez progressivement à se servir de son fusil et à tirer. Il en est de même du jeune compositeur: la tête fourmille d'idées; mais leur classement n'est pas encore opéré.» Effrayé de son courage, protestant à chaque phrase: «Je suis un vieux libre penseur... Je suis un vieux républicain...», il proclamait audacieusement que «peu lui importait de savoir si les compositions de Pergolèse étaient des opéras ou des messes; il s'agissait de savoir si c'étaient des œuvres de l'art humain».—Mais l'implacable logique de son interlocuteur répliquait au «vieux libre penseur», au «vieux républicain», qu'«il y avait deux musiques: celle qu'on chantait dans les églises, et celle qu'on chantait ailleurs». La première était ennemie de la Raison et de l'État; et la Raison d'État devait la supprimer.
Ces imbéciles eussent été plus ridicules que dangereux, s'ils n'avaient eu derrière eux des hommes d'une réelle valeur, sur qui ils s'appuyaient, et qui étaient comme eux,—davantage peut-être,—fanatiques de la Raison. Tolstoy parle quelque part de ces «influences épidémiques», qui règnent en religion, en philosophie, en politique, en art et en science, de ces «influences insensées, dont les hommes ne voient la folie que lorsqu'ils en sont débarrassés, mais qui, tant qu'ils y sont soumis, leur paraissent si vraies qu'ils ne croient même pas nécessaire de les discuter». Ainsi, la passion des tulipes, la croyance aux sorciers, les aberrations des modes littéraires.—La religion de la Raison était une de ces folies. Elle était commune aux plus sots et aux plus cultivés, aux «sous-vétérinaires» de la Chambre et à certains des esprits les plus intelligents de l'Université. Elle était plus dangereuse encore chez ceux-ci que chez ceux-là; car, chez ceux-là, elle s'accommodait d'un optimisme béat et stupide, qui en détendait l'énergie; au lieu que chez les autres, les ressorts en étaient bandés et le tranchant aiguisé par un pessimisme fanatique, qui ne se faisait point illusion sur l'antagonisme foncier de la Nature et de la Raison, et qui n'en était que plus acharné à soutenir le combat de la Liberté abstraite, de la Justice abstraite, de la Vérité abstraite, contre la Nature mauvaise. Il y avait là un fond d'idéalisme calviniste, janséniste, jacobin, une vieille croyance en l'irrémédiable perversité de l'homme, que seul peut et doit briser l'orgueil implacable des Élus chez qui souffle la Raison,—l'Esprit de Dieu. C'était un type bien français, le Français intelligent, qui n'est pas «humain». Un caillou dur comme fer: rien n'y peut pénétrer; et il casse tout ce qu'il touche.
Christophe fut atterré par les conversations qu'il eut chez Achille Roussin avec quelques-uns de ces fous raisonneurs. Ses idées sur la France en étaient bouleversées. Il croyait, d'après l'opinion courante, que les Français étaient un peuple pondéré, sociable, tolérant, aimant la liberté. Et il trouvait des maniaques d'idées abstraites, malades de logique, toujours prêts à sacrifier les autres à un de leurs syllogismes. Ils parlaient constamment de liberté, et personne n'était moins fait pour la comprendre et pour la supporter. Nulle part, des caractères plus froidement, plus atrocement despotiques, par passion intellectuelle, ou parce qu'ils voulaient toujours avoir raison.
Ce n'était pas le fait d'un parti. Tous les partis étaient de même. Ils ne voulaient rien voir en deçà, au delà de leur formulaire politique ou religieux, de leur patrie, de leur province, de leur groupe, de leur étroit cerveau. Il y avait des antisémites, qui dépensaient toutes les forces de leur être en une haine enragée contre tous les privilégiés de la fortune: car ils haïssaient tons les Juifs, et ils appelaient Juifs tous ceux qu'ils haïssaient. Il y avait des nationalistes, qui haïssaient—(quand ils étaient très bons, ils se contentaient de mépriser)—toutes les autres nations, et, dans leur nation même, appelaient étrangers, ou renégats, ou traîtres, ceux qui ne pensaient pas comme eux. Il y avait des antiprotestants, qui se persuadaient que tous les protestants étaient Anglais ou Allemands, et qui eussent voulu les bannir tous de France. Il y avait les gens de l'Occident, qui ne voulaient rien admettre à l'Est de la ligne du Rhin; et les gens du Nord, qui ne voulaient rien admettre au Sud de la ligne de la Loire; et les gens du Midi, qui appelaient Barbares ceux qui étaient au Nord de la ligne de la Loire; et ceux qui se faisaient gloire d'être de race Germanique; et ceux qui se faisaient gloire d'être de race Gauloise; et, les plus fous de tous, les «Romains», qui s'enorgueillissaient de la défaite de leurs pères; et les Bretons, et les Lorrains, et les Félibres, et les Albigeois; et ceux de Carpentras, de Pontoise, et de Quimper-Corentin: chacun n'admettant que soi, se faisant de son soi un titre de noblesse, et ne tolérant pas qu'on pût être autrement. Rien à faire contre cette engeance: ils n'écoutent aucun raisonnement; ils sont faits pour brûler le reste du monde, ou pour être brûlés.
Christophe pensait qu'il était heureux qu'un tel peuple fût en République: car tous ces petits despotes s'annihilaient mutuellement. Mais si l'un d'eux avait été roi, il ne fût plus resté assez d'air pour aucun autre.
Il ne savait pas que les peuples raisonneurs ont une vertu, qui les sauve:—l'inconséquence.
Les politiciens français ne s'en faisaient pas faute. Leur despotisme se tempérait d'anarchisme; ils oscillaient sans cesse de l'un à l'autre pôle. S'ils s'appuyaient à gauche sur les fanatiques de la pensée, à droite ils s'appuyaient sur les anarchistes de la pensée. On voyait avec eux toute une tourbe de socialistes dilettantes, de petits arrivistes, qui s'étaient bien gardés de prendre part au combat, avant qu'il fût gagné, mais qui suivaient à la trace l'armée de la Libre Pensée, et, après chacune de ses victoires, s'abattaient sur les dépouilles des vaincus. Ce n'était pas pour la raison que travaillaient les champions de la raison... Sic vos non vobis... C'était pour ces profiteurs cosmopolites, qui piétinaient joyeusement les traditions du pays, et qui n'entendaient pas détruire une foi pour en installer une autre à la place, mais pour s'installer eux-mêmes.
Christophe retrouva là Lucien Lévy-Cœur. Il ne fut pas trop étonné d'apprendre que Lucien Lévy-Cœur était socialiste. Il pensa simplement qu'il fallait que le socialisme fût bien sûr du succès pour que Lucien Lévy-Cœur vint à lui. Mais il ne savait pas que Lucien Lévy-Cœur avait trouvé moyen d'être tout aussi bien vu dans le camp opposé, où il avait réussi à devenir l'ami des personnalités de la politique et de l'art les plus antilibérales, voire même antisémites. Il demanda à Achille Roussin:
—Comment pouvez-vous garder de tels hommes avec vous?
Roussin répondit:
—Il a tant de talent! Et puis, il travaille pour nous, il détruit le vieux monde.
—Je vois bien qu'il détruit, dit Christophe. Il détruit si bien que je ne sais pas avec quoi vous reconstruirez. Êtes-vous sûr qu'il vous restera assez de charpente pour votre maison nouvelle? Les vers se sont déjà mis dans votre chantier de construction...
Lucien Lévy-Cœur n'était pas le seul à ronger le socialisme. Les feuilles socialistes étaient pleines de ces petits hommes de lettres, art pour l'art, anarchistes de luxe, qui s'étaient emparés de toutes les avenues qui pouvaient conduire au succès. Ils barraient la route aux autres, et remplissaient de leur dilettantisme décadent et struggle for life les journaux, qui se disaient les organes du peuple. Ils ne se contentaient pas des places: il leur fallait la gloire. Dans aucun temps, on n'avait vu tant de statues hâtivement élevées, tant de discours devant des génies de plâtre. Périodiquement, des banquets étaient offerts aux grands hommes de la confrérie par les habituels pique-assiette de la gloire, non pas à l'occasion de leurs travaux, mais de leurs décorations: car c'était là ce qui les touchait le plus. Esthètes, surhommes, métèques, ministres socialistes, se trouvaient tous d'accord pour fêter une promotion dans la Légion d'Honneur, instituée par cet officier corse.
Roussin s'égayait des étonnements de Christophe. Il ne trouvait point que l'Allemand jugeât si mal ses partenaires. Lui-même, quand ils étaient seul à seul, les traitait sans ménagements. Il connaissait mieux que personne leur sottise ou leurs roueries; mais cela ne l'empêchait pas de les soutenir, afin d'être soutenu par eux. Et si, dans l'intimité, il ne se gênait pas pour parler du peuple en termes méprisants, à la tribune il était un autre homme. Il prenait une voix de tête, des tons aigus, nasillards, martelés, solennels, des trémolos, des bêlements, de grands gestes vastes et tremblotants, comme des battements d'ailes: il jouait Mounet-Sully.
Christophe s'évertuait à démêler dans quelle mesure Roussin croyait à son socialisme. L'évidence était qu'il n'y croyait pas, au fond: il était trop sceptique. Il y croyait pourtant, avec une part de sa pensée; et quoiqu'il sût fort bien que ce n'en était qu'une part—(et pas la plus importante),—il avait organisé d'après cela sa vie et sa conduite, parce que cela lui était plus commode, ainsi. Son intérêt pratique n'était pas seul en cause, mais aussi son intérêt vital, sa raison d'être et d'agir. Sa foi socialiste lui était pour lui-même une sorte de religion d'État.—La majorité des hommes ne vit pas autrement. Leur vie repose sur des croyances religieuses, ou morales, ou sociales, ou purement pratiques,—(croyance à leur métier, à leur travail, à l'utilité de leur rôle dans la vie),—auxquelles ils ne croient pas, au fond. Mais ils ne veulent pas le savoir: car ils ont besoin, pour vivre, de ce semblant de foi, de ce culte officiel, dont chacun est le prêtre.
Roussin n'était pas un des pires. Combien d'autres dans le parti «faisaient» du socialisme ou du radicalisme,—on ne pouvait même pas dire, par ambition, tant cette ambition était à courte vue, n'allait pas plus loin que le pillage immédiat et leur réélection! Ces gens avaient l'air de croire en une société nouvelle. Peut-être y avaient-ils cru jadis; mais, en fait, ils ne pensaient plus qu'à vivre sur les dépouilles de la société qui mourait. Un opportunisme myope était au service d'un nihilisme jouisseur. Les grands intérêts de l'avenir étaient sacrifiés à l'égoïsme de l'heure présente. On démembrait l'armée, on eût démembré la patrie pour plaire aux électeurs. Ce n'était point l'intelligence qui manquait: on se rendait compte de ce qu'il eût fallu faire, mais on ne le faisait point, parce qu'il en eût coûté trop d'efforts. On voulait arranger sa vie et celle de la nation avec le minimum de peine. Du haut en bas de l'échelle, c'était la même morale du plus de plaisir possible avec le moins d'efforts possible. Cette morale immorale était le seul fil conducteur au milieu du gâchis politique, où les chefs donnaient l'exemple de l'anarchie, où l'on voyait une politique incohérente poursuivant dix lièvres à la fois, et les lâchant tous l'un après l'autre, une diplomatie belliqueuse côte à côte avec un ministère de la guerre pacifiste, des ministres de la guerre qui détruisaient l'armée afin de l'épurer, des ministres de la marine qui soulevaient les ouvriers des arsenaux, des instructeurs de la guerre qui prêchaient l'horreur de la guerre, des officiers dilettantes, des juges dilettantes, des révolutionnaires dilettantes, des patriotes dilettantes. Une démoralisation politique universelle. Chacun attendait de l'État qu'il le pourvût de fonctions, de pensions, de décorations; et l'État, en effet, ne manquait pas d'en arroser sa clientèle: la curée des honneurs et des charges était offerte aux fils, aux neveux, aux petits-neveux, aux valets du pouvoir; les députés se votaient des augmentations de traitement: un gaspillage effréné des finances, des places, des titres, de toutes les ressources de l'État.—Et, comme un sinistre écho de l'exemple d'en haut, le sabotage d'en bas: les instituteurs enseignant la révolte contre la patrie, les employés des postes brûlant les lettres et les dépêches, les ouvriers des usines jetant du sable et de l'émeri dans les engrenages des machines, les ouvriers des arsenaux détruisant des arsenaux, des navires incendiés, le gâchage monstrueux du travail par les travailleurs,—la destruction non pas des riches, mais de la richesse du monde.
Pour couronner l'œuvre, une élite intellectuelle s'amusait à fonder en raison et en droit ce suicide d'un peuple, au nom des droits sacrés au bonheur. Un humanitarisme morbide rongeait la distinction du bien et du mal, s'apitoyait devant la personne «irresponsable et sacrée» des criminels, capitulait devant le crime et lui livrait la société.
Christophe pensait:
—La France est soûle de liberté. Après avoir déliré, elle tombera ivre-morte. Et quand elle se réveillera, elle sera au violon.
Ce qui blessait le plus Christophe dans cette démagogie, c'était de voir les pires violences politiques froidement accomplies par des hommes, dont il connaissait le fond incertain. La disproportion était trop scandaleuse entre ces êtres ondoyants et l'action âpre qu'ils déchaînaient, ou qu'ils autorisaient. Il semblait qu'il y eût en eux deux éléments contradictoires: un caractère inconsistant, qui ne croyait à rien, et une raison raisonnante, qui saccageait la vie, sans vouloir rien écouter. Christophe se demandait comment la bourgeoisie paisible, les catholiques, les officiers qu'on harcelait de toutes les façons, ne les jetaient pas par la fenêtre. Comme il ne savait rien cacher, Roussin n'eut pas de peine à deviner sa pensée. Il se mit à rire, et dit:
—Sans doute, c'est ce que vous ou moi, nous ferions, n'est-ce pas? Mais il n'y a point de risques avec eux. Ce sont de pauvres bougres, qui ne sont pas capables de prendre le moindre parti énergique; ils ne sont bons qu'à récriminer. Une aristocratie gâteuse, abrutie par les clubs, prostituée aux Américains et aux Juifs, qui, pour prouver son modernisme, s'amuse du rôle insultant qu'on lui prête dans les romans et les pièces à la mode, et fait fête aux insulteurs. Une bourgeoisie grincheuse, qui ne lit rien, qui ne comprend rien, qui ne veut rien comprendre, qui ne sait que dénigrer, dénigrer à vide, aigrement, sans résultat pratique,—qui n'a qu'une passion: dormir, sur son sac aux gros sous, avec la haine de ceux qui la dérangent, ou même de ceux qui travaillent: car cela la dérange que les autres se remuent, tandis qu'elle pionce!... Si vous connaissiez ces gens là, vous finiriez par nous trouver sympathiques...
Mais Christophe n'éprouvait qu'un grand dégoût pour les uns et pour les autres: car il ne pensait point que la bassesse des persécutés fût une excuse pour celle des persécuteurs. Il avait souvent rencontré chez les Stevens des types de cette bourgeoisie riche et maussade, que lui dépeignait Roussin,
... l'anime triste di coloro,
Che visser senza infamia e senza lodo...
Il ne voyait que trop les raisons que Roussin et ses amis avaient d'être sûrs non seulement de leur force sur ces gens, mais de leur droit d'en abuser. Les outils de domination ne leur manquaient point. Des milliers de fonctionnaires sans volonté, obéissant aveuglément. Des mœurs courtisanesques, une République sans républicains; une presse socialiste, en extase devant les rois en visite; des âmes de domestiques, aplaties devant les titres, les galons, les décorations: pour les tenir, il n'y avait qu'à leur jeter en pâture un os à ronger, ou la Légion d'Honneur. Si un roi eût promis d'anoblir tous les citoyens de France, tous les citoyens de France eussent été royalistes.
Les politiciens avaient beau jeu. Des trois États de 89, le premier était anéanti; le second était banni ou suspect; le troisième, repu de sa victoire, dormait. Et quant au quatrième État, qui maintenant se levait, menaçant et jaloux, il n'était pas difficile encore d'en avoir raison. La République décadente le traitait, comme Rome décadente traitait les hordes barbares, qu'elle n'avait plus la force d'expulser de ses frontières: elle les enrôlait; ils devenaient bientôt ses meilleurs chiens de garde. Les ministres bourgeois, qui se disaient socialistes, attiraient sournoisement, annexaient les plus intelligents de l'élite ouvrière; ils décapitaient de leurs chefs le parti des prolétaires, s'infusaient leur sang nouveau, et, en retour, les gorgeaient d'idéologie bourgeoise.
Un spécimen curieux de ces tentatives d'annexion du peuple par la bourgeoisie était, en ce temps-là, les Universités Populaires. C'étaient de petits bazars de connaissances confuses de omni re scibili. On prétendait y enseigner, comme disait un programme, «toutes les branches du savoir, physique, biologique, sociologique: astronomie, cosmologie, anthropologie, ethnologie, physiologie, psychologie, psychiatrie, géographie, linguistique, esthétique, logique, etc.» De quoi faire craquer le cerveau de Pic de la Mirandole.
Certes, il y avait eu à l'origine, il y avait encore dans certaines d'entre elles un idéalisme sincère, un besoin de dispenser à tous la vérité, la beauté, la vie morale, qui avait de la grandeur. Ces ouvriers, qui, après une journée de dur travail, venaient s'entasser dans les salles de conférences étouffantes, et dont la soif de savoir était plus forte que la fatigue, offraient un spectacle touchant. Mais, comme on avait abusé des pauvres gens! Pour quelques vrais apôtres, intelligents et humains, pour quelques bons cœurs, mieux intentionnés qu'adroits, combien de sots, de bavards, d'intrigants, écrivains sans lecteurs, orateurs sans public, professeurs, pasteurs, parleurs, pianistes et critiques, qui inondaient le peuple de leurs produits! Chacun cherchait à placer sa marchandise. Les plus achalandés étaient naturellement les vendeurs d'orviétan, les discoureurs philosophiques, qui remuaient à la pelle des idées générales, avec le paradis social au bout.
Les Universités Populaires servaient aussi de débouché pour un esthétisme ultra-aristocratique: gravures, poésies, musique décadentes. On voulait l'avènement du peuple pour rajeunir la pensée et pour régénérer la race. Et l'on commençait par lui inoculer tous les raffinements de la bourgeoisie! Il les prenait avec avidité, non parce qu'ils lui plaisaient, mais parce qu'ils étaient bourgeois. Christophe, qui avait été amené à une de ces Universités Populaires par Mme Roussin, lui entendit jouer du Debussy au peuple, entre la Bonne Chanson de Gabriel Fauré et l'un des derniers quatuors de Beethoven. Lui qui n'était arrivé à l'intelligence des dernières œuvres de Beethoven qu'après bien des années, par un lent acheminement de son goût et de sa pensée, demanda, plein de pitié, à l'un de ses voisins:
—Mais est-ce que vous comprenez cela?
L'autre se dressa sur ses ergots, comme un coq en colère, et dit:
—Bien sûr! Pourquoi est-ce que je ne comprendrais pas aussi bien que vous?
Et, pour prouver qu'il avait compris, il bissa une fugue, en regardant Christophe, d'un air provocant.
Christophe se sauva, consterné; il se disait que ces animaux-là avaient réussi à empoisonner jusqu'aux sources vives de la nation: il n'y avait plus de peuple.
—Peuple vous-même! comme disait un ouvrier à l'un de ces braves gens qui tentaient de fonder des Théâtres du Peuple. Je suis autant bourgeois que vous!
Un beau soir, que le ciel moelleux, comme un tapis d'Orient, aux teintes chaudes, un peu passées, s'étendait au-dessus de la ville assombrie, Christophe suivait les quais, de Notre-Dame aux Invalides. Dans la nuit qui tombait, les tours de la cathédrale montaient comme les bras de Moïse, dressés pendant la bataille. La lance d'or ciselée de la Sainte-Chapelle, l'épine sainte fleurissante, jaillissait du fourré des maisons. De l'autre côté de l'eau, le Louvre déroulait sa façade royale, dans les yeux ennuyés de laquelle les reflets du soleil couchant mettaient une dernière lueur de vie. Au fond de la plaine des Invalides, derrière ses fossés et ses murailles hautaines, dans son désert majestueux, la coupole d'or sombre planait, comme une symphonie de victoires lointaines. Et l'Arc de Triomphe ouvrait sur la colline, telle une marche héroïque, l'enjambée surhumaine des légions impériales.
Et Christophe eut soudain l'impression d'un géant mort, dont les membres immenses couvraient la plaine. Le cœur serré d'effroi, il s'arrêta, contemplant les fossiles gigantesques d'une espèce fabuleuse, disparue de la terre, et dont toute la terre avait entendu sonner les pas,—la race, casquée du dôme des Invalides, et ceinturée du Louvre, qui étreignait le ciel avec les mille bras de ses cathédrales, et qui arc-boutait sur le monde les deux pieds triomphants de l'Arche Napoléonienne, sous le talon de laquelle grouillait aujourd'hui Lilliput.
Sans qu'il l'eût cherché, Christophe avait acquis une petite notoriété dans les milieux parisiens, où Sylvain Kohn et Goujart l'avaient introduit. L'originalité de sa figure, qu'on apercevait toujours, avec l'un ou l'autre de ses deux amis, aux premières des théâtres et aux concerts, sa laideur puissante, les ridicules même de sa personne, de sa tenue, de ses manières brusques et gauches, les boutades paradoxales qui parfois lui échappaient, son intelligence mal dégrossie, mais large et robuste, et les récits romanesques que Sylvain Kohn avait colportés sur ses escapades en Allemagne, sur ses démêlés avec la police et sur sa fuite en France, l'avaient désigné à la curiosité oisive et affairée de ce grand salon d'hôtel cosmopolite, qu'est devenu le Tout-Paris. Tant qu'il se tint sur la réserve, observant, écoutant, tâchant de comprendre, avant de se prononcer, tant qu'on ignora ses œuvres et le fond de sa pensée, il fut assez bien vu. Les Français lui savaient gré de n'avoir pu rester en Allemagne. Surtout, les musiciens français étaient touchés, comme d'un hommage qui leur était rendu, de l'injustice des jugements de Christophe sur la musique allemande:—(il s'agissait, à la vérité, de jugements déjà anciens, à la plupart desquels il n'eût plus souscrit aujourd'hui: quelques articles publiés naguère dans une Revue allemande, et dont les paradoxes avaient été répandus et amplifiés par Sylvain Kohn).—Christophe intéressait, et il ne gênait point; il ne prenait la place de personne. Il n'eût tenu qu'à lui d'être un grand homme de cénacle. Il n'avait qu'à ne rien écrire, ou le moins possible, surtout à ne rien faire entendre de lui, et à alimenter d'idées Goujart et ses pareils, tous ceux qui ont pris pour devise un mot fameux,—en l'arrangeant un peu:
«Mon verre n'est pas grand; mais je bois... dans celui des autres.»
Une forte personnalité exerce son rayonnement surtout sur les jeunes gens, plus occupés de sentir que d'agir. Il n'en manquait pas autour de Christophe. C'étaient en général de ces êtres oisifs, sans volonté, sans but, sans raison d'être, qui ont peur de la table de travail, peur de se trouver seuls avec eux-mêmes, qui s'éternisent dans un fauteuil, qui errent d'un café à une salle de théâtre, cherchant tous les prétextes pour ne pas rentrer chez eux, pour ne pas se voir face à face. Ils venaient, s'installaient, traînaient pendant des heures, dans ces conversations insipides, d'où l'on sort avec une dilatation d'estomac, écœurés, saturés, et pourtant affamés, avec le besoin et le dégoût à la fois de continuer. Ils entouraient Christophe, comme le barbet de Gœthe, les «larves à l'affût», qui guettent une âme à happer, pour se raccrocher à la vie.
Un sot vaniteux eût trouvé plaisir à cette cour de parasites. Mais Christophe n'aimait pas jouer à l'idole. Il était horripilé d'ailleurs par la prétentieuse bêtise de ses admirateurs, qui trouvaient dans ce qu'il faisait des intentions saugrenues, Renaniennes, Nietzschéennes, Rose-Croix, hermaphrodites. Il les mit à la porte. Il n'était pas fait pour un rôle passif. Tout chez lui avait l'action pour but. Il observait, pour comprendre; et il voulait comprendre, pour agir. Libre de préjugés, il s'informait de tout, étudiait dans la musique toutes les formes de pensée et les ressources d'expression des autres pays et des autres temps. Chacune de celles qui lui paraissaient vraies, il en faisait sa proie. À la différence de ces artistes français qu'il étudiait, ingénieux inventeurs de formes nouvelles, qui s'épuisent à inventer sans cesse et laissent leurs inventions en chemin, il cherchait beaucoup moins à innover dans la langue musicale qu'à la parler avec plus d'énergie; il n'avait point le souci d'être rare, mais celui d'être fort. Cette énergie passionnée s'opposait au génie français de finesse et de mesure. Elle avait le dédain du style pour le style. Les meilleurs artistes français lui faisaient l'effet d'ouvriers de luxe. Un des plus parfaits poètes parisiens s'était amusé lui-même à dresser «la liste ouvrière de la poésie française contemporaine, chacun avec sa denrée, son produit ou ses soldes»; et il énumérait «les lustres de cristal, les étoffes d'Orient, les médailles d'or et de bronze, les guipures pour douairières, les sculptures polychromes, les faïences à fleurs», qui sortaient de la fabrique de tel ou tel de ses confrères. Lui-même se représentait, «dans un coin du vaste atelier des lettres, reprisant de vieilles tapisseries, ou dérouillant des pertuisanes hors d'usage».—Cette conception de l'artiste, comme d'un bon ouvrier, attentif uniquement à la perfection du métier, n'était pas sans beauté. Mais elle ne satisfaisait pas Christophe; tout en reconnaissant sa dignité professionnelle, il avait du mépris pour la pauvreté de vie qu'elle recouvrait. Il ne concevait pas qu'on écrivît pour écrire. Il ne disait pas des mots, il disait—il voulait dire—des choses
Ei dice cose, e voi dite parole...
Après une période de repos où il n'avait été occupé qu'à absorber un monde nouveau, l'esprit de Christophe fut pris brusquement du besoin de créer. L'antagonisme qui s'accusait entre Paris et lui, centuplait sa force, en stimulant sa personnalité. C'était un débordement de passions, qui demandaient impérieusement à s'exprimer. Elles étaient de toute sorte; par toutes, il était sollicité avec la même ardeur. Il lui fallait forger des œuvres, où se décharger de l'amour qui lui gonflait le cœur, et aussi de la haine; et de la volonté, et aussi du renoncement, et de tous les démons qui s'entrechoquaient en lui, et qui avaient un droit égal à vivre. À peine s'était-il soulagé d'une passion dans une œuvre,—(quelquefois, il n'avait même pas la patience d'aller jusqu'à la fin de l'œuvre)—qu'il se jetait dans une passion contraire. Mais la contradiction n'était qu'apparente: s'il changeait toujours, toujours il restait le même. Toutes ses œuvres étaient des chemins différents qui menaient au même but; son âme était une montagne: il en prenait toutes les routes; les unes s'attardaient à l'ombre, en leurs détours moelleux; les autres montaient arides, âprement au soleil; toutes conduisaient au Dieu, qui siégeait sur la cime. Amour, haine, volonté, renoncement, toutes les forces humaines, portées au paroxysme, touchent à l'éternité, déjà y participent. Chacun la porte en soi: le religieux et l'athée, celui qui voit partout la vie, et celui qui la nie partout, et celui qui doute de tout et de la vie et de la négation,—et Christophe, dont l'âme embrassait tous ces contraires à la fois. Tous les contraires se fondent en l'éternelle Force. L'important pour Christophe était de réveiller cette Force en lui et dans les autres, de jeter des brassées de bois sur le brasier, de faire flamber l'Éternité. Une grande flamme s'était levée dans son cœur, au milieu de la nuit voluptueuse de Paris. Il se croyait libre de toute foi, et il n'était tout entier qu'une torche de foi.
Rien ne pouvait davantage prêter le flanc à l'ironie française. La foi est un des sentiments que pardonne le moins une société raffinée: car elle l'a perdu. Dans l'hostilité sourde ou railleuse de la plupart des hommes pour les rêves des jeunes gens, il entre pour beaucoup l'amère pensée qu'eux-mêmes furent ainsi, qu'ils eurent ces ambitions et ne les réalisèrent point. Ceux qui ont renié leur âme, ceux qui avaient en eux une œuvre, et ne l'ont pas accomplie, pensent:
—Puisque je n'ai pu faire ce que j'avais rêvé, pourquoi le feraient-ils, eux? Je ne veux point qu'ils le fassent.
Combien d'Heddas Gabier parmi les hommes! Quelle sourde malveillance qui cherche à annihiler les forces neuves et libres, quelle science pour les tuer par le silence, par l'ironie, par l'usure, par le découragement,—et par quelque séduction perfide, au bon moment!...
Le type est de tous les pays. Christophe le connaissait, pour l'avoir rencontré en Allemagne. Contre cette espèce de gens il était cuirassé. Son système de défense était simple: il attaquait, le premier; dès leurs premières avances, il leur déclarait la guerre; il contraignait ces dangereux amis à se faire ses ennemis. Mais si cette franche politique était la plus efficace à sauvegarder sa personnalité, elle l'était beaucoup moins à lui faciliter sa carrière d'artiste. Christophe recommença ses errements d'Allemagne. C'était plus fort que lui. Une seule chose avait changé: son humeur, qui était fort gaie.
Il exprimait gaillardement à qui voulait l'entendre ses critiques peu mesurées sur les artistes français: il s'attira ainsi beaucoup d'inimitiés. Il ne prenait même pas la précaution de se ménager, comme font les gens avisés, l'appui d'une petite coterie. Il n'eût pas eu de peine à trouver des artistes tout prêts à l'admirer, pourvu qu'il les admirât. Il y en avait même qui l'admiraient d'avance, à charge de revanche. Ils considéraient celui qu'ils louaient, comme un débiteur, auquel ils pouvaient, le moment venu, réclamer le remboursement de leur créance. C'était de l'argent bien placé.—C'était de l'argent mal placé, avec Christophe. Il ne remboursait rien. Bien pis, il avait l'effronterie de trouver médiocres les œuvres de ceux qui trouvaient bonnes les siennes. Ils en gardaient, sans le dire, une rancune profonde, et se promettaient, à la prochaine occasion, de lui rendre la même monnaie.
Entre toutes les maladresses commises, Christophe eut celle de partir en guerre contre Lucien Lévy-Cœur. Il le trouvait partout sur sa route, et il ne pouvait cacher une antipathie exagérée pour cet être doux, poli, qui ne faisait aucun mal apparent, qui semblait même avoir plus de bonté que lui, et qui en tout cas avait bien plus de mesure. Il le provoquait à des discussions; et, si insignifiant qu'en fût l'objet, elles prenaient toujours, par le fait de Christophe, une âpreté subite, qui étonnait l'auditoire. Il semblait que Christophe cherchât tous les prétextes pour fondre, tête baissée, sur Lucien Lévy-Cœur; mais jamais il ne pouvait l'atteindre. Son ennemi avait la suprême habileté, même quand son tort était le plus certain, de se donner le beau rôle; il se défendait avec une courtoisie, qui faisait ressortir le manque d'usages de Christophe. Celui-ci, qui d'ailleurs parlait mal le français, avec des mots d'argot, voire d'assez gros mots, qu'il avait sus tout de suite, et qu'il employait mal à propos, comme beaucoup d'étrangers, était incapable de déjouer la tactique de Lévy-Cœur; et il se débattait furieusement contre cette douceur ironique. Tout le monde lui donnait tort: car on ne voyait pas ce que Christophe sentait obscurément: l'hypocrisie de cette douceur, qui, se heurtant à une force qu'elle ne parvenait pas à entamer, travaillait à l'étouffer, sans éclat, en silence. Il n'était pas pressé, étant, comme Christophe, de ceux qui comptaient sur le temps: mais c'était pour détruire; Christophe, pour édifier. Lévy-Cœur n'eut pas de peine à détacher de Christophe Sylvain Kohn et Goujart, comme il l'avait peu à peu évincé du salon des Stevens. Il fit le vide autour de lui.
Christophe s'en chargeait, de lui-même. Il ne contentait personne, n'étant d'aucun parti, ou mieux, étant contre tous. Il n'aimait pas les Juifs; mais il aimait encore moins les antisémites. Cette lâcheté des masses soulevées contre une minorité puissante, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est puissante, cet appel aux bas instincts de jalousie et de haine, lui répugnait. Les Juifs le regardaient comme un antisémite, les antisémites comme un Juif. Quant aux artistes, ils sentaient en lui l'ennemi. Instinctivement, Christophe se faisait, en art, plus Allemand qu'il n'était. Par opposition avec la voluptueuse ataraxie de certaine musique parisienne, il célébrait la volonté violente, un pessimisme viril et sain. Quand la joie paraissait, c'était avec un manque de goût, une fougue plébéienne, bien faits pour révolter jusqu'aux aristocratiques patrons de l'art populaire. Sa forme était savante et rude. Même, il n'était pas loin d'affecter, par réaction, une négligence apparente dans le style et une insouciance de l'originalité extérieure, qui devaient être très sensibles aux musiciens français. Aussi, ceux d'entre eux, à qui il communiqua ses œuvres, l'englobèrent-ils, sans y regarder de plus près, dans le mépris qu'ils avaient pour le wagnérisme attardé de l'école allemande. Christophe ne s'en souciait guère; il riait intérieurement, se répétant ces vers d'un charmant musicien de la Renaissance française,—adaptés à son usage:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Va, va, ne t'esbahy de ceux la qui diront:
Ce Christophe n'a pas d'un tel le contrepoint,
Il n'a pas de cestuy la pareille harmonie.
J'ai quelque chose aussi que les autres n'ont point.
Mais quand il voulut essayer de faire jouer ses œuvres dans les concerts, il trouva porte close. On avait déjà bien assez à faire de jouer—ou de ne pas jouer—les œuvres des jeunes musiciens français. On n'avait pas de place pour un Allemand inconnu.
Christophe ne s'entêta point à faire des démarches. Il s'enferma chez lui, et se remit à écrire. Peu lui importait que les gens de Paris l'entendissent ou non. Il écrivait pour son plaisir, et non pour réussir. Le vrai artiste ne s'occupe pas de l'avenir de son œuvre. Il est comme ces peintres de la Renaissance, qui peignaient joyeusement des façades de maisons, sachant que dans dix ans il n'en resterait rien. Christophe travaillait donc en paix, attendant des temps meilleurs, quand lui vint un secours inattendu.
Christophe était alors attiré par la forme dramatique. Il n'osait pas s'abandonner librement au flot de son lyrisme intérieur. Il avait besoin de le canaliser en des sujets précis. Et, sans doute, est-il bon pour un jeune génie qui n'est pas encore maître de soi, qui ne sait même pas encore ce qu'il est exactement, de se fixer des limites volontaires où enfermer son âme qui se dérobe à lui. Ce sont les écluses nécessaires qui permettent de diriger le cours de la pensée.—Malheureusement, il manquait à Christophe un poète; il était obligé de se tailler lui-même ses sujets dans la légende ou dans l'histoire.
Parmi les visions qui flottaient en lui depuis quelques mois, étaient des images de la Bible.—La Bible, que sa mère lui avait donnée comme compagne d'exil, avait été pour lui une source de rêves. Bien qu'il ne la lût point dans un esprit religieux, l'énergie morale, ou, pour mieux dire, vitale, de cette Iliade hébraïque lui était une fontaine, où, le soir, il lavait son âme nue, salie par les fumées et les boues de Paris. Il ne s'inquiétait pas du sens sacré du livre; mais ce n'en était pas moins pour lui un livre sacré, par le souffle de nature sauvage et d'individualités primitives, qu'il y respirait. Il buvait ces hymnes de la terre dévorée de foi, des montagnes palpitantes, des cieux exultants, et des lions humains.
Une des figures du livre, pour qui il avait une tendresse, était David adolescent. Il ne lui prêtait pas l'ironique sourire de gamin de Florence, ni la tension tragique, que Verrocchio et Michel-Ange avaient donnés à leurs œuvres sublimes: il ne les connaissait pas. Il voyait son David comme un pâtre poétique, au cœur vierge, où dormait l'héroïsme, un Siegfried du Midi, de race plus affinée, plus harmonieux de corps et de pensée.—Car il avait beau se révolter contre l'esprit latin: cet esprit s'infiltrait en lui. Ce n'est pas seulement l'art qui influe sur l'art, ce n'est pas seulement la pensée, c'est tout ce qui nous entoure:—les êtres et les choses, les gestes et les mouvements, les lignes et la lumière. L'atmosphère de Paris est bien forte: elle modèle les âmes les plus rebelles. Moins que toute autre, une âme germanique est capable de résister: elle se drape en vain dans son orgueil national, elle est, de toutes les âmes d'Europe, la plus prompte à se dénationaliser. Celle de Christophe avait déjà commencé, à son insu, de prendre à l'art latin une sobriété, une clarté du cœur, et même, dans une certaine mesure, une beauté plastique, qu'elle n'aurait pas eues sans cela. Son David l'attestait.
Il avait voulu retracer la rencontre avec Saül; et il l'avait conçue comme un tableau symphonique, à deux personnages.
Sur un plateau désert, dans une lande de bruyères en fleurs, le petit pâtre était couché, et rêvait au soleil. La sereine lumière, le bourdonnement des êtres, le doux frémissement des herbes, les grelots argentins des troupeaux qui paissaient, la force de la terre, berçaient la rêverie de l'enfant inconscient de ses divines destinées. Indolemment, il mêlait sa voix et les sons d'une flûte au silence harmonieux; ce chant était d'une joie si calme, si limpide que l'on ne songeait même plus, en l'entendant, à la joie ou à la douleur, mais qu'il semblait que c'était ainsi, que ce ne pouvait être autrement... Soudain, de grandes ombres s'étendaient sur la lande; l'air se taisait; la vie semblait se retirer dans les veines de la terre. Le chant de flûte, seul, tranquille, continuait. Saül, halluciné, passait. Le roi dément, rongé par le néant, s'agitait comme une flamme qui se dévore, et que tord l'ouragan. Il suppliait, injuriait, défiait le vide qui l'entourait, et qu'il portait en lui. Et lorsque, à bout de souffle, il tombait sur la lande, reparaissait dans le silence le sourire du chant du pâtre, qui ne s'était pas interrompu. Alors Saül, écrasant les battements de son cœur tumultueux, venait, en silence, près de l'enfant couché; en silence, il le contemplait; il s'asseyait près de lui et posait sa main fiévreuse sur la tête du berger. David, sans se troubler, se retournait et regardait le roi. Il appuyait sa tête sur les genoux de Saül, et reprenait sa musique. L'ombre du soir tombait; David s'endormait, en chantant; et Saül pleurait. Et, dans la nuit étoilée, s'élevait de nouveau l'hymne de la nature ressuscitée, et le chant de grâces de l'âme convalescente.
Christophe, en écrivant cette scène, ne s'était occupé que de sa propre joie; il n'avait pas songé aux moyens d'exécution; et surtout, il ne lui serait pas venu à l'idée qu'elle put être représentée. Il la destinait aux concerts, pour le jour où les concerts daigneraient l'accueillir.
Un soir qu'il en parlait à Achille Roussin, et que, sur sa demande, il avait essayé de lui en donner une idée, au piano, il fut bien étonné de voir Roussin prendre feu et flamme pour l'œuvre, déclarant qu'il fallait qu'elle fût jouée sur une scène parisienne, et qu'il en faisait son affaire. Il fut bien plus étonné encore, quand il vit, quelques jours après, que Roussin prenait la chose au sérieux; et son étonnement toucha à la stupeur, lorsqu'il apprit que Sylvain Kohn, Goujart, et Lucien Lévy-Cœur lui-même, s'y intéressaient. Il lui fallait admettre que les rancunes personnelles de ces gens cédaient à l'amour de l'art: cela le surprenait bien. Le moins empressé à faire jouer son œuvre, c'était lui. Elle n'était pas faite pour le théâtre: c'était un non-sens de l'y donner. Mais Roussin fut si insistant, Sylvain Kohn si persuasif, et Goujart si affirmatif, que Christophe se laissa tenter. Il fut lâche. Il avait tellement envie d'entendre sa musique!
Tout fut facile à Roussin. Directeurs et artistes s'empressaient à lui plaire. Justement, un journal organisait une matinée de gala au profit d'une œuvre de bienfaisance. Il fut convenu qu'on y jouerait le David. On réunit un bon orchestre. Quant aux chanteurs, Roussin prétendait avoir trouvé pour le rôle de David l'interprète idéal.
Les répétitions commencèrent. L'orchestre se tira assez bien de la première lecture, quoiqu'il fût peu discipliné, à la façon française. Le Saül avait une voix un peu fatiguée, mais honorable; et il savait son métier. Pour le David, c'était une belle personne, grande, grasse, bien faite, mais une voix sentimentale et vulgaire, qui s'étalait lourdement avec des trémolos de mélodrame et des grâces de café-concert. Christophe fit la grimace. Dès les premières mesures qu'elle chanta, il fut évident pour lui qu'elle ne pourrait conserver le rôle. À la première pause de l'orchestre, il alla trouver l'impresario, qui s'était chargé de l'organisation matérielle du concert, et qui, avec Sylvain Kohn, assistait à la répétition. Ce personnage, le voyant venir, lui dit, le visage rayonnant:
—Eh bien, vous êtes content?
—Oui, dit Christophe, je crois que cela s'arrangera. Il n'y a qu'une chose qui ne va pas: c'est la chanteuse. Il faudra changer cela. Dites-le-lui gentiment; vous avez l'habitude... Il vous sera bien facile de m'en trouver une autre.
L'impresario eut l'air stupéfait; il regarda Christophe, comme s'il ne savait pas si Christophe parlait sérieusement; et il dit:
—Mais ce n'est pas possible!
—Pourquoi ne serait-ce pas possible? demanda Christophe.
L'impresario échangea un coup d'œil avec Sylvain Kohn, narquois, et il reprit:
—Mais elle a tant de talent!
—Elle n'en a aucun, dit Christophe.
—Comment!... Une si belle voix!
—Elle n'en a aucune.
—Et puis, une si belle personne!
—Je m'en fous.
—Cela ne nuit pourtant pas, fit Sylvain Kohn, en riant.
—J'ai besoin d'un David, et d'un David qui sache chanter; je n'ai pas besoin de la belle Hélène, dit Christophe.
L'impresario se frottait le nez avec embarras:
—C'est bien ennuyeux, bien ennuyeux,... dit-il. C'est pourtant une excellente artiste... Je vous assure! Elle n'a peut-être pas tous ses moyens aujourd'hui. Vous devriez encore essayer.
—Je veux bien, dit Christophe; mais c'est du temps perdu.
Il reprit la répétition. Ce fut encore pis. Il eut peine à aller jusqu'au bout: il devenait nerveux; ses observations à la chanteuse, d'abord froides mais polies, se faisaient sèches et coupantes, en dépit de la peine évidente qu'elle se donnait afin de le satisfaire, et des œillades qu'elle lui décochait pour conquérir ses bonnes grâces. L'impresario, prudemment, interrompit la répétition, au moment où les affaires menaçaient de se gâter. Pour effacer le mauvais effet des observations de Christophe, il s'empressait auprès de la chanteuse et lui prodiguait de pesantes galanteries, lorsque Christophe, qui assistait à ce manège, avec une impatience non dissimulée, lui fit signe impérieusement de venir, et dit:
—Il n'y a pas à discuter. Je ne veux pas de cette personne. C'est désagréable, je le sais; mais ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Arrangez-vous comme vous voudrez.
L'impresario s'inclina, d'un air ennuyé, et dit, avec indifférence:
—Je n'y puis rien. Adressez-vous à M. Roussin.
—En quoi cela regarde-t-il M. Roussin? demanda Christophe. Je ne veux pas l'ennuyer de ces affaires.
—Cela ne l'ennuiera pas, dit Sylvain Kohn, ironique.
Et il lui montra Roussin, qui, justement, entrait.
Christophe alla au-devant de lui. Roussin, d'excellente humeur, s'exclamait:
—Eh quoi! déjà fini? J'espérais entendre encore une partie. Eh bien, mon cher maître, qu'est-ce que vous en dites? Êtes-vous satisfait?
—Tout va très bien, dit Christophe. Je ne puis assez vous remercier...
—Du tout! Du tout!
—Il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas marcher.
—Dites, dites. Nous arrangerons cela. Je tiens à ce que vous soyez content.
—Eh bien, c'est la chanteuse. Entre nous, elle est exécrable.
Le visage épanoui de Roussin se glaça subitement. Il dit, d'un air sévère:
—Vous m'étonnez, mon cher.
—Elle ne vaut rien, rien du tout, continua Christophe. Elle n'a ni voix, ni goût, ni métier, pas l'ombre de talent. Vous avez de la chance de ne pas l'avoir entendue tout à l'heure!...
Roussin, de plus en plus pincé, coupa la parole à Christophe, et dit, d'un ton cassant:
—Je connais Mlle de Sainte-Ygraine. C'est une artiste de grand talent. J'ai la plus vive admiration pour elle. Tous les gens de goût, à Paris, pensent comme moi.
Et il tourna le dos à Christophe. Christophe le vit offrir son bras à l'actrice et sortir avec elle. Comme il restait stupéfait, Sylvain Kohn, qui avait suivi la scène avec délices, lui prit le bras, et lui dit, en riant, tandis qu'ils descendaient l'escalier du théâtre:
—Mais vous ne savez donc pas qu'elle est sa maîtresse?
Christophe comprit. Ainsi, c'était pour elle, ce n'était pas pour lui que l'on montait la pièce! Il s'expliqua l'enthousiasme de Roussin, ses dépenses, l'empressement de ses acolytes. Il écoutait Sylvain Kohn qui lui contait l'histoire de la Sainte-Ygraine: une divette de music-hall, qui, après s'être exhibée avec succès dans des petits théâtres de genre, avait été prise de l'ambition, commune à beaucoup de ses pareilles, de se faire entendre sur une scène plus digne de son talent. Elle comptait sur Roussin pour la faire engager à l'Opéra, ou à l'Opéra Comique; et Roussin, qui ne demandait pas mieux, avait trouvé dans la représentation du David une occasion de révéler sans risques au public parisien les dons lyriques de la nouvelle tragédienne, dans un rôle qui n'exigeait presque aucune action dramatique, et qui mettait en pleine valeur l'élégance de ses formes.
Christophe écouta l'histoire jusqu'au bout; puis il se dégagea du bras de Sylvain Kohn, et il éclata de rire. Il rit, il rit longuement. Quand il eut fini de rire, il dit:
—Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez tous. L'art ne compte pas pour vous. Ce sont toujours des questions de femmes. On monte un opéra pour une danseuse, pour une chanteuse, pour la maîtresse de Monsieur un tel, ou de Madame une telle. Vous ne pensez qu'à vos cochonneries. Voyez-vous, je ne vous en veux pas: vous êtes ainsi, restez ainsi, si cela vous plaît, et barbotez dans votre auge. Mais séparons-nous: nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Bonsoir.
Il le quitta; et, rentré chez lui, il écrivit à Roussin qu'il retirait sa pièce, sans lui cacher les raisons qui la lui faisaient reprendre.
Ce fut la rupture avec Roussin et avec tout son clan. Les conséquences s'en firent immédiatement sentir. Les journaux avaient mené un certain bruit autour de la représentation projetée, et l'histoire de la brouille du compositeur avec son interprète ne manqua pas de faire jaser. Un directeur de concerts eut la curiosité de donner l'œuvre dans une de ses matinées du dimanche. Cette bonne fortune fut un désastre pour Christophe. L'œuvre fut jouée—et sifflée. Tous les amis de la chanteuse s'étaient donné le mot pour administrer une leçon à l'insolent musicien; et le reste du public, que le poème symphonique avait ennuyé, s'associa complaisamment au verdict des gens compétents. Pour comble de malchance, Christophe avait eu l'imprudence, afin de faire valoir son talent de virtuose, d'accepter de se faire entendre, au même concert, dans une Fantaisie pour piano et orchestre. Les dispositions malveillantes du public, retenues dans une certaine mesure, pendant l'exécution du David, par le désir de ménager les interprètes, se donnèrent libre champ, quand il se trouva en présence de l'auteur en personne,—dont le jeu n'était pas d'ailleurs trop correct. Christophe, énervé par le bruit de la salle, s'interrompit brusquement au milieu du morceau; et, regardant, d'un air goguenard, le public qui s'était tu soudain, il joua: «Malbrough s'en va-t-en guerre!»—et dit insolemment:
—Voilà ce qu'il vous faut.
Là-dessus, il se leva et partit.
Ce fut un beau tumulte. On criait qu'il avait insulté le public, et qu'il devait venir faire des excuses à la salle. Les journaux, le lendemain, exécutèrent avec ensemble l'Allemand grotesque, dont le bon goût parisien avait fait justice.
Et puis, ce fut le vide, de nouveau, complet, absolu. Christophe se retrouvait seul, une fois de plus, plus seul que jamais, dans la grande ville étrangère et hostile. Il ne s'en affectait plus. Il commençait à croire que c'était sa destinée, et qu'il resterait, toute sa vie, ainsi.
Il ne savait pas qu'une grande âme n'est jamais seule, que si dénuée qu'elle soit d'amis par la fortune, elle finit toujours par les créer, qu'elle rayonne autour d'elle l'amour dont elle est pleine, et qu'à cette heure même, où il se croyait isolé pour toujours, il était plus riche d'amour que les plus heureux du monde.
Il y avait chez les Stevens une petite fille de treize à quatorze ans, à qui Christophe avait donné des leçons, en même temps qu'à Colette. Elle était cousine germaine de Colette, et se nommait Grazia Buontempi. C'était une fillette au teint doré, rosissant délicatement aux pommettes, les joues pleines, d'une santé campagnarde, un petit nez un peu relevé, la bouche grande, bien fendue, à demi entrouverte, le menton rond, très blanc, les yeux tranquilles, doucement souriants, le front rond, encadré d'une profusion de cheveux longs et soyeux, qui descendaient, sans boucles, le long des joues, avec de légères et calmes ondulations. Une petite Vierge d'Andrea del Sarto, figure large, beau regard silencieux.
Elle était Italienne. Ses parents habitaient, presque toute l'année, à la campagne, dans une grande propriété du Nord de l'Italie: plaines, prairies, petits canaux. De la terrasse sur le toit, on avait à ses pieds des flots de vignes d'or, d'où émergeaient de place en place les fuseaux noirs des cyprès. Au delà, c'étaient les champs, les champs. Le silence. On entendait meugler les bœufs qui retournaient le sol, et les cris aigus des paysans à la charrue:
—Ihi!... Fat innanz'!...
Les cigales chantaient dans les arbres, et les grenouilles le long de l'eau. Et, la nuit, c'était l'infini du silence, sous la lune aux flots d'argent. Au loin, de temps en temps, les gardiens des récoltes, qui sommeillaient dans des huttes de branchages, tiraient des coups de fusil, pour avertir les voleurs qu'ils étaient réveillés. Pour ceux qui les entendaient, à demi-assoupis, ce bruit n'avait plus d'autre sens que le tintement d'une horloge pacifique, marquant au loin les heures de la nuit. Et le silence se refermait, comme un manteau moelleux aux vastes plis, sur l'âme.
Autour de la petite Grazia, la vie semblait endormie. On ne s'occupait pas beaucoup d'elle. Elle poussait tranquillement dans le beau calme qui la baignait. Nulle fièvre, nulle hâte. Elle était paresseuse, elle aimait à flâner et dormir longuement. Elle restait étendue, des heures, dans le jardin. Elle se laissait flotter sur le silence, comme une mouche sur un ruisseau d'été. Et parfois, brusquement, sans raison, elle se mettait à courir. Elle courait, comme un petit animal, la tête et le buste légèrement inclinés vers la droite, souplement, sans raideur. Un vrai cabri, qui grimpait, glissait, parmi les pierres, pour la joie de bondir. Elle causait avec les chiens, avec les grenouilles, avec les herbes, avec les arbres, avec les paysans, avec les bêtes de la basse cour. Elle adorait tous les petits êtres qui l'entouraient, et aussi les grands: mais avec ceux-ci elle se livrait moins. Elle voyait très peu de monde. La propriété était loin de la ville, isolée. Bien rarement passait sur la route poudreuse le pas traînant d'un grave paysan, ou d'une belle campagnarde, aux yeux lumineux dans la figure hâlée, marchant d'un rythme balancé, la tête haute, la poitrine en avant. Grazia vivait, des journées, seule, dans le parc silencieux; elle ne voyait personne; elle ne s'ennuyait jamais; elle n'avait peur de rien.
Une fois, un vagabond entra, pour voler une poule dans la ferme déserte. Il s'arrêta, interdit, devant la petite fille couchée dans l'herbe, qui mangeait une longue tartine, en chantonnant une chanson. Elle le regarda tranquillement, et lui demanda ce qu'il voulait. Il dit:
—Donnez-moi quelque chose, ou je deviens méchant.
Elle lui tendit sa tartine, et dit, avec ses yeux souriants:
—Il ne faut pas devenir méchant.
Alors il s'en alla.
Sa mère mourut. Son père, très bon, très faible, était un vieil Italien de bonne race, robuste, jovial, affectueux, mais un peu enfantin, et tout à fait incapable de diriger l'éducation de la petite. La sœur du vieux Buontempi, Mme Stevens, venue pour l'enterrement, fut frappée de l'isolement de l'enfant; pour la distraire de son deuil, elle décida de l'emmener pour quelque temps à Paris. Grazia pleura, et le vieux papa aussi; mais quand Mme Stevens avait décidé quelque chose, il n'y avait plus qu'à se résigner: nul ne pouvait lui résister. Elle était la forte tête de la famille; et, dans sa maison de Paris, elle dirigeait tout: son mari, sa fille, et ses amants;—car elle menait de front ses devoirs et ses plaisirs: c'était une femme pratique et passionnée,—au reste, très mondaine et très agitée.
Transplantée à Paris, la calme Grazia se prit d'adoration pour sa belle cousine Colette, qui s'en amusa. On conduisit dans le monde, on mena au théâtre la douce petite sauvageonne. On continuait de la traiter en enfant, et elle-même se regardait comme une enfant, quand déjà elle ne l'était plus. Elle avait des sentiments qu'elle cachait, et dont elle avait peur: d'immenses élans de tendresse pour un objet, ou pour un être. Elle était amoureuse en secret de Colette: elle lui volait un ruban, un mouchoir; souvent, en sa présence, elle ne pouvait dire un seul mot; et quand elle l'attendait, quand elle savait qu'elle allait la voir, elle tremblait d'impatience et de bonheur. Au théâtre, lorsqu'elle voyait sa jolie cousine, décolletée, entrer dans la loge où elle était et attirer tous les regards, elle avait un bon sourire, humble, affectueux, débordant d'amour; et son cœur se fondait, lorsque Colette lui adressait la parole. En robe blanche, ses beaux cheveux noirs défaits et bouffants sur ses épaules brunes, mordillant le bout de ses longs gants, dans l'ouverture desquels elle fourrait le doigt par désœuvrement,—à tout instant, pendant le spectacle, elle se retournait vers Colette, pour quêter un regard amical, pour partager le plaisir qu'elle ressentait, pour dire de ses yeux bruns et limpides:
—Je vous aime bien.
En promenade, dans les bois, aux environs de Paris, elle marchait dans l'ombre de Colette, s'asseyait à ses pieds, courait devant ses pas, arrachait les branches qui auraient pu la gêner, posait des pierres au milieu de la boue. Et, un soir que Colette, frileuse, au jardin, lui demanda son fichu, elle poussa un rugissement de plaisir,—(elle en fut honteuse après),—du bonheur que la bien-aimée s'enveloppât d'un peu d'elle, et le lui rendit ensuite, imprégné du parfum de son corps.
Il y avait aussi des livres, certaines pages des poètes, lues en cachette,—(car on continuait de lui donner des livres d'enfant),—qui lui causaient des troubles délicieux. Et, plus encore, certaines musiques, bien qu'on lui dît qu'elle n'y pouvait rien comprendre; et elle se persuadait qu'elle n'y comprenait rien;—mais elle était toute pâle et moite d'émotion. Personne ne savait ce qui se passait en elle, à ces moments.
En dehors de cela, elle était une fillette docile, étourdie, paresseuse, assez gourmande, rougissant pour un rien, tantôt se taisant pendant des heures, tantôt parlant avec volubilité, riant et pleurant facilement, ayant de brusques sanglots et un rire d'enfant. Elle aimait rire et s'amusait de petits riens. Jamais elle ne cherchait a jouer la dame. Elle restait enfant. Surtout, elle était bonne, elle ne pouvait souffrir de faire de la peine, et elle avait de la peine du moindre mot un peu fâché contre elle. Très modeste, s'effaçant toujours, toute prête à aimer et à admirer tout ce qu'elle croyait voir de beau et de bon, elle prêtait aux autres des qualités qu'ils n'avaient pas.
On s'occupa de son éducation, qui était très en retard. Ce fut ainsi qu'elle prit des leçons de piano avec Christophe.
Elle le vit, pour la première fois, à une soirée de sa tante, où il y avait une société nombreuse. Christophe, incapable de s'adapter h aucun public, joua un interminable adagio, qui faisait bâiller tout le monde: quand cela semblait fini, cela recommençait; on se demandait si cela finirait jamais. Mme Stevens bouillait d'impatience. Colette s'amusait follement: elle dégustait le ridicule de la chose, et elle ne savait pas mauvais gré à Christophe d'y être, à ce point, insensible; elle sentait qu'il était une force, et cela lui était sympathique; mais c'était comique aussi; et elle se fût bien gardée de prendre sa défense. Seule, la petite Grazia était pénétrée jusqu'aux larmes par celte musique. Elle se dissimulait dans un coin du salon. À la fin, elle se sauva, pour qu'on ne remarquât point son trouble, et aussi parce qu'elle souffrait de voir qu'on se moquait de Christophe.
Quelques jours après, à dîner, Mme Stevens parla, devant elle, de lui faire donner des leçons de piano par Christophe. Grazia fut si troublée qu'elle laissa retomber sa cuiller dans son assiette à soupe, et qu'elle s'éclaboussa, ainsi que sa cousine. Colette dit qu'elle aurait bien besoin d'abord de leçons pour se tenir convenablement à table. Mme Stevens ajouta qu'en ce cas, ce n'était pas à Christophe qu'il faudrait s'adresser. Grazia fut heureuse d'être grondée avec Christophe.
Christophe commença ses leçons. Elle était toute guindée et glacée, elle avait les bras collés au corps, elle ne pouvait remuer; et quand Christophe posait la main sur sa menotte, pour rectifier la position des doigts et les étendre sur les touches, elle se sentait défaillir. Elle tremblait de jouer mal devant lui; mais elle avait beau étudier jusqu'à se rendre malade et jusqu'à faire pousser des cris d'impatience à sa cousine, toujours elle jouait mal, quand Christophe était là; le souffle lui manquait, ses doigts étaient raides comme du bois, ou mous comme du coton; elle accrochait les notes et accentuait à contre-sens; Christophe la grondait et s'en allait fâché: alors, elle avait envie de mourir.
Il ne faisait aucune attention à elle; il n'était occupé que de Colette. Grazia enviait l'intimité de sa cousine avec Christophe; mais quoiqu'elle en souffrît, son bon petit cœur s'en réjouissait pour Colette et pour Christophe. Elle trouvait Colette si supérieure à elle qu'il lui semblait naturel qu'elle absorbât tous les hommages.—Ce ne fut que lorsqu'il fallut choisir entre sa cousine et Christophe qu'elle sentit son cœur prendre parti contre elle. Son intuition de petite femme lui fit voir que Christophe souffrait des coquetteries de Colette et de la cour assidue de Lévy-Cœur. D'instinct, elle n'aimait pas Lévy-Cœur; et elle le détesta, dès le moment qu'elle sut que Christophe le détestait. Elle ne pouvait comprendre comment Colette s'amusait à le mettre en rivalité avec Christophe. Elle commença de la juger sévèrement en secret; elle surprit certains de ses petits mensonges, et elle changea soudain de manières avec elle. Colette s'en aperçut, sans en deviner la cause; elle affectait de l'attribuer à des caprices de petite fille. Mais le certain, c'est qu'elle avait perdu son pouvoir sur Grazia: un fait insignifiant le lui montra. Un soir que, se promenant toutes deux au jardin, Colette voulait, avec une tendresse coquette, abriter Grazia sous les plis de son manteau contre une petite ondée qui s'était mise à tomber, Grazia, pour qui c'eût été, quelques semaines avant, un bonheur ineffable de se blottir contre le sein de sa chère cousine, s'écarta froidement. Et quand Colette disait qu'elle trouvait laid un morceau de musique que jouait Grazia, cela n'empêchait pas Grazia de le jouer, et de l'aimer.
Elle n'était plus attentive qu'à Christophe. Elle avait la divination de la tendresse, et percevait ce qu'il souffrait. Elle se l'exagérait beaucoup, dans son attention inquiète et enfantine. Elle croyait que Christophe était amoureux de Colette, quand il n'avait pour elle qu'une amitié exigeante. Elle pensait qu'il était malheureux, et elle était malheureuse pour lui. La pauvrette n'était guère récompensée de sa sollicitude: elle payait pour Colette quand Colette avait fait enrager Christophe; il était de mauvaise humeur, et se vengeait sur sa petite élève, en relevant impatiemment les fautes de son jeu. Un matin que Colette l'avait exaspéré encore plus qu'à l'ordinaire, il s'assit au piano avec tant de brusquerie que Grazia acheva de perdre le peu de moyens qu'elle avait: elle pataugea; il lui reprocha ses fausses notes avec colère; alors, elle se noya tout à fait; il se fâcha, il lui secoua les mains, il cria qu'elle ne ferait jamais rien de propre, qu'elle s'occupât de cuisine, de couture, de tout ce qu'elle voudrait, mais au nom du ciel! qu'elle ne fit plus de musique! Ce n'était pas la peine de martyriser les gens à entendre ses fausses notes. Sur quoi, il la planta là, au milieu de sa leçon. Et la pauvre Grazia pleura toutes les larmes de son corps, moins encore du chagrin que lui faisaient ces humiliantes paroles, que du chagrin de ne pouvoir faire plaisir à Christophe, malgré tout son désir, et même d'ajouter encore par sa sottise à la peine de celui qu'elle aimait.
Elle souffrit bien plus, quand Christophe cessa de venir chez les Stevens. Elle voulut retourner au pays. Cette enfant, si saine jusque dans ses rêveries, et qui gardait en elle un fond de sérénité rustique, se sentait mal à l'aise dans cette ville, au milieu des Parisiennes neurasthéniques et agitées. Sans oser le dire, elle avait fini par juger assez exactement les gens qui l'entouraient. Mais elle était timide, faible, comme son père, par bonté, par modestie, par défiance de soi. Elle se laissait dominer par sa tante autoritaire et par sa cousine habituée à tout tyranniser. Elle n'osait pas écrire à son vieux papa, à qui elle envoyait régulièrement de longues lettres affectueuses:
—Je t'en prie, reprends-moi!
Et le vieux papa n'osait pas la reprendre, malgré tout son désir; car Mme Stevens avait répondu à ses timides avances que Grazia était bien où elle était, beaucoup mieux qu'elle ne serait avec lui, et que, pour son éducation, il fallait qu'elle restât.
Mais un moment arriva où l'exil devint trop douloureux à la petite âme du Midi, et où il fallut qu'elle reprît son vol vers la lumière.—Ce fut après le concert de Christophe. Elle y était venue avec les Stevens; et ce fut un déchirement pour elle d'assister au spectacle hideux d'une foule s'amusant à outrager un artiste... Un artiste? Celui qui, aux yeux de Grazia, était l'image même de l'art, la personnification de tout ce qu'il y avait de divin dans la vie. Elle avait envie de pleurer, de se sauver. Il lui fallut entendre jusqu'au bout le tapage, les sifflets, les huées, et, au retour chez sa tante, les réflexions désobligeantes, le joli rire de Colette, qui échangeait avec Lucien Lévy-Cœur des propos apitoyés. Réfugiée dans sa chambre, dans son lit, elle sanglota, une partie de la nuit: elle parlait a Christophe, elle le consolait, elle eût voulu donner sa vie pour lui, elle se désespérait de ne pouvoir rien pour le rendre heureux. Il lui fut désormais impossible de rester à Paris. Elle supplia son père de la faire revenir. Elle disait:
—Je ne peux plus vivre ici, je ne peux plus, je mourrai si tu me laisses plus longtemps.
Son père vint aussitôt; et si pénible qu'il leur fût à tous deux de tenir tête à la terrible tante, ils en puisèrent l'énergie dans un effort de volonté désespérée.
Grazia revint dans le grand parc endormi. Elle retrouva avec joie la chère nature et les êtres qu'elle aimait. Elle avait emporté et garda quelque temps encore dans son cœur endolori, qui se rassérénait, un peu de la mélancolie du Nord, comme un voile de brouillards, que le soleil peu à peu faisait fondre. Elle pensait par moments à Christophe malheureux. Couchée sur la pelouse, écoutant les grenouilles et les cigales familières, ou assise au piano, avec qui elle s'entretenait plus souvent qu'autrefois, elle rêvait de l'ami qu'elle s'était choisi; elle causait avec lui, tout bas, pendant des heures, et il ne lui eût pas semblé impossible qu'il ouvrît la porte, un jour, et qu'il entrât. Elle lui écrivit, et, après avoir hésité longtemps, elle lui envoya une lettre, non signée, qu'elle alla, un matin, en cachette, le cœur battant, jeter dans la boîte du village, à trois kilomètres de là, de l'autre côté des grands champs labourés,—une bonne lettre, touchante, qui lui disait qu'il n'était pas seul, qu'il ne devait pas se décourager, qu'on pensait à lui, qu'on l'aimait, qu'on priait Dieu pour lui,—une pauvre lettre, qui s'égara sottement en route, et qu'il ne reçut jamais.
Puis, les jours uniformes et sereins se déroulèrent dans la vie de la lointaine amie. Et la paix italienne, le génie du calme, du bonheur tranquille, de la contemplation muette, rentrèrent dans ce cœur chaste et silencieux, au fond duquel continuait de brûler, comme une flamme immobile, le souvenir de Christophe.
Mais Christophe ignorait la naïve affection, qui de loin veillait sur lui, et qui devait plus tard tenir tant de place dans sa vie. Et il ignorait aussi qu'à ce même concert, où il avait été insulté, assistait celui qui allait être l'ami, le cher compagnon, qui devait marcher auprès de lui, côte à côte, et la main dans la main.
Il était seul. Il se croyait seul. D'ailleurs, il n'en était aucunement accablé. Il ne ressentait plus cette amère tristesse qui l'angoissait naguère, en Allemagne. Il était plus fort, plus mûr: il savait que ce devait être ainsi. Ses illusions sur Paris étaient tombées: tous les hommes étaient partout les mêmes; il fallait en prendre son parti, et ne pas s'obstiner dans une lutte enfantine contre le monde; il fallait être soi-même, avec tranquillité. Comme disait Beethoven, «si nous livrons à la vie les forces de notre vie, que nous restera-t-il pour le plus noble, pour le meilleur?» Il avait pris vigoureusement conscience de sa nature et de sa race, qu'il avait jugée si sévèrement jadis. À mesure qu'il était plus oppressé par l'atmosphère parisienne, il éprouvait le besoin de se réfugier auprès de sa patrie, dans les bras des poètes et des musiciens, où le meilleur d'elle-même s'est recueilli. Dès qu'il ouvrait leurs livres, sa chambre se remplissait du bruissement du Rhin ensoleillé et de l'affectueux sourire des vieux amis délaissés.
Comme il avait été ingrat envers eux! Comment n'avait-il pas senti plus tôt le trésor de leur candide bonté? Il se rappelait avec honte tout ce qu'il avait dit d'injuste et d'outrageant pour eux, quand il était en Allemagne. Alors, il ne voyait que leurs défauts, leurs manières gauches et cérémonieuses, leur idéalisme larmoyant, leurs petits mensonges de pensée, leurs petites lâchetés. Ah! c'était si peu de chose auprès de leurs grandes vertus! Comment avait-il pu être aussi cruel pour des faiblesses, qui les rendaient en ce moment presque plus touchants à ses yeux: car ils en étaient plus humains! Par réaction, il était attiré davantage par ceux d'entre eux pour qui il avait été le plus injuste. Que n'avait-il point dit contre Schubert et contre Bach! Et voici qu'il se sentait tout près d'eux, à présent. Voici que ces grandes âmes, dont il avait relevé avec impatience les ridicules, se penchaient vers lui, exilé loin des siens, et lui disaient avec un bon sourire:
—Frère, nous sommes là. Courage! Nous avons eu, nous aussi, plus que notre lot de misères... Bah! on en vient à bout...
Il entendait gronder l'Océan de l'âme de Jean-Sébastien Bach: les ouragans, les vents qui soufflent, les nuages de la vie qui s'enfuient,—les peuples ivres de joie, de douleur, de fureur, et le Christ, plein de mansuétude, le Prince de la Paix, qui plane au-dessus d'eux,—les villes éveillées par les cris des veilleurs, se ruant, avec des clameurs d'allégresse, au-devant du Fiancé divin, dont les pas ébranlent le monde,—le prodigieux réservoir de pensées, de passions, de formes musicales, de vie héroïque, d'hallucinations shakespeariennes, de prophéties à la Savonarole, de visions pastorales, épiques, apocalyptiques, enfermées dans le corps étriqué du petit cantor thuringien, au doublé menton, aux petits yeux brillants sous les paupières plissées et les sourcils relevés...—il le voyait si bien! sombre, jovial, un peu ridicule, le cerveau bourré d'allégories et de symboles, gothique et rococo, colère, têtu, serein, ayant la passion de la vie et la nostalgie de la mort...—il le voyait dans son école, pédant génial, au milieu de ses élèves, sales, grossiers, mendiants, galeux, aux voix éraillées, ces vauriens avec qui il se chamaillait, avec qui il se battait parfois comme un portefaix, et dont l'un le roua de coups...—il le voyait dans sa famille, au milieu de ses vingt et un enfants, dont treize moururent avant lui, dont un fut idiot; les autres, bons musiciens, lui faisaient de petits concerts... Des maladies, des enterrements, d'aigres disputes, la gêne, son génie méconnu;—et, par là-dessus, sa musique, sa foi, la délivrance et la lumière, la Joie entrevue, pressentie, voulue, saisie,—Dieu, le souffle de Dieu brûlant ses os, hérissant son poil, foudroyant par sa bouche... Ô Force! Force! Tonnerre bienheureux de Force!...
Christophe buvait à longs traits cette force. Il sentait le bienfait de cette puissance de musique, qui ruisselle des âmes allemandes. Médiocre souvent, grossière même, qu'importe? L'essentiel, c'est qu'elle soit, qu'elle coule à pleins bords. En France, la musique est recueillie, goutte à goutte, par des filtres Pasteur dans des carafes soigneusement bouchées. Et ces buveurs d'eau fade font les dégoûtés devant les fleuves de la musique allemande! Ils épluchent les fautes des génies allemands!
—Pauvres petits!—pensait Christophe, sans se souvenir que lui-même naguère avait été aussi ridicule,—ils trouvent des défauts dans Wagner et dans Beethoven! Il leur faudrait des génies qui n'eussent pas de défauts!... Comme si, quand souffle la tempête, elle allait s'occuper de ne rien déranger au bel ordre des choses!...
Il marchait dans Paris, tout joyeux de sa force. Tant mieux s'il était incompris! Il en serait plus libre. Pour créer, comme c'est le rôle du génie, un monde de toutes pièces, organiquement constitué suivant ses lois intérieures, il faut y vivre tout entier. Un artiste n'est jamais trop seul. Ce qui est redoutable, c'est de voir sa pensée se refléter dans un miroir qui la déforme et l'amoindrit. Il ne faut rien dire aux autres de ce qu'on fait, avant de l'avoir fait: sans cela, on n'aurait plus le courage d'aller jusqu'au bout; car ce ne serait plus son idée, mais la misérable idée des autres, qu'on verrait en soi.
Maintenant que rien ne venait plus le distraire de ses rêves, ils jaillissaient comme des fontaines de tous les coins de son âme et de toutes les pierres de sa route. Il vivait dans un état de visionnaire. Tout ce qu'il voyait et entendait évoquait en lui des êtres et des choses différents de ce qu'il voyait et entendait. Il n'avait qu'à se laisser vivre pour retrouver, autour de lui, la vie de ses héros. Leurs sensations venaient le chercher, d'elles-mêmes. Les yeux de ceux qui passaient, le son d'une voix que le vent apportait, la lumière sur une pelouse de gazon, les oiseaux qui chantaient dans les arbres du Luxembourg, une cloche de couvent qui sonnait au loin, le ciel pâle, le petit coin du ciel, vu du fond de sa chambre, les bruits et les nuances des diverses heures du jour, il ne les percevait pas en lui, mais dans les êtres qu'il rêvait.—Christophe était heureux.
Cependant, sa situation était plus difficile que jamais. Il avait perdu les quelques leçons de piano, qui étaient son unique ressource. On était en septembre, la société parisienne était en vacances; et il était malaisé de trouver d'autres élèves. Le seul qu'il eût était un ingénieur, intelligent et braque, qui s'était mis en tête, à quarante ans, de devenir un grand violoniste. Christophe ne jouait pas très bien du violon; mais il en savait toujours plus que son élève; et, pendant quelque temps, il lui donna trois heures de leçons par semaine, à deux francs l'heure. Mais, au bout d'un mois et demi, l'ingénieur se lassa, découvrant tout à coup que sa vocation principale était pour la peinture.—Le jour qu'il fit part de cette découverte à Christophe, Christophe rit beaucoup: mais, quand il eut bien ri, il fit le compte de ses finances, et constata qu'il avait juste en poche les douze francs, que son élève venait de lui payer, pour ses dernières leçons. Cela ne l'émut point; il se dit seulement qu'il allait falloir décidément se mettre en quête d'autres moyens d'existence: recommencer les courses auprès des éditeurs. Ce n'était pas réjouissant... Pff!... Inutile de s'en tourmenter à l'avance! Aujourd'hui, il faisait beau. Il s'en alla à Meudon.
Il avait une fringale de marche. La marche faisait lever des moissons de musique. Il en était plein, comme une ruche de miel; et il riait au bourdonnement doré de ses abeilles. C'était, à l'ordinaire, une musique qui modulait beaucoup. Et des rythmes bondissants, insistants, hallucinants... Allez donc créer des rythmes, quand vous êtes engourdi dans votre chambre! Bon pour amalgamer alors des harmonies subtiles et immobiles, comme ces Parisiens!
Quand il fut las de marcher, il se coucha dans les bois. Les arbres étaient à demi défeuillés, le ciel bleu de pervenche. Christophe s'engourdit dans une rêverie, qui prit bientôt la teinte de la douce lumière qui tombe des nuages d'octobre. Son sang battait. Il écoutait passer les flots pressés de ses pensées. Il en venait de tous les points de l'horizon: mondes jeunes et vieux, qui se livraient bataille, lambeaux d'âmes passées, hôtes anciens, parasites, qui vivaient en lui, comme le peuple d'une ville. L'ancienne parole de Gottfried devant la tombe de Melchior lui revenait à l'esprit: il était un tombeau vivant, plein de morts qui s'agitaient,—toute sa race inconnue. Il écoutait cette multitude de vies, il se plaisait à faire bruire l'orgue de cette forêt séculaire, pleine de monstres, comme la forêt de Dante. Il ne les craignait plus maintenant, comme au temps de son adolescence. Car le maître était là: sa volonté. Il avait une forte joie à faire claquer son fouet, pour que les bêtes hurlassent, et qu'il sentît mieux la richesse de sa ménagerie intérieure. Il n'était pas seul. Il n'y avait pas de risques qu'il le fût jamais. Il était toute une armée, des siècles de Krafft joyeux et sains. Contre Paris hostile, contre un peuple, tout un peuple: la lutte était égale.
Il avait abandonné sa modeste chambre,—trop chère,—pour prendre dans le quartier de Montrouge une mansarde, qui, à défaut d'autres avantages, était très aérée. Un courant d'air perpétuel. Mais il lui fallait respirer. De sa fenêtre, il avait une vue étendue sur les cheminées de Paris. Le déménagement n'avait pas été long: une charrette à bras suffit; Christophe la poussa lui-même. De tout son mobilier, l'objet le plus précieux pour lui était, avec sa vieille malle, un de ces moulages, si vulgarisés depuis, du masque de Beethoven. Il l'avait empaqueté avec autant de soin que s'il s'était agi d'une œuvre d'art du plus haut prix. Il ne s'en séparait pas. C'était son île, au milieu de Paris. Ce lui était aussi un baromètre moral. Le masque lui marquait, plus clairement que sa propre conscience, la température de son âme, ses plus secrètes pensées: tantôt le ciel chargé de nuées, tantôt le coup de vent des passions, tantôt le calme puissant.
Il dut rogner beaucoup sur sa nourriture. Il mangeait une fois par jour, à une heure de l'après-midi. Il avait acheté un gros saucisson, qu'il avait pendu à sa fenêtre; avec une bonne tranche, un solide quignon de pain, et une tasse de café qu'il fabriquait, il faisait un repas des dieux. Mais il en eût bien fait deux. Il était fâché d'avoir si bon appétit. Il s'apostrophait sévèrement; il se traitait de goinfre, qui ne pense qu'à son ventre. De ventre, il n'en avait guère; il était plus efflanqué qu'un chien maigre. Au reste, solide, une charpente de fer, et la tête toujours libre.
Il ne s'inquiétait pas trop du lendemain. Tant qu'il avait devant lui l'argent de la journée, il ne se mettait pas en peine. Le jour où il n'eut plus rien, il se décida enfin à commencer ses tournées chez les éditeurs. Il ne trouva de travail nulle part. Il revenait chez lui, bredouille, quand, passant près du magasin de musique où il avait été présenté naguère par Sylvain Kohn à Daniel Hecht, il entra, sans se rappeler qu'il y était déjà venu dans des circonstances peu agréables. La première personne qu'il vit fut Hecht. Il fut sur le point de rebrousser chemin; mais il était trop tard: Hecht l'avait vu. Christophe ne voulut pas avoir l'air de reculer; il s'avança vers Hecht, ne sachant pas ce qu'il allait lui dire, et prêt à lui tenir tête avec autant d'arrogance qu'il le faudrait: car il était convaincu que Hecht ne lui ménagerait pas les insolences. Il n'en fut rien. Hecht, froidement, lui tendit la main: avec une formule de politesse banale, il s'informa de sa santé, et, sans même attendre que Christophe lui en fît la demande, il lui désigna la porte de son cabinet, et s'effaça pour le laisser passer. Il était heureux, secrètement, de cette visite, que son orgueil avait prévue, mais qu'il n'attendait plus. Sans en avoir l'air, il avait suivi très attentivement Christophe; il n'avait manqué aucune occasion de connaître sa musique; il était au fameux concert du David; et l'accueil hostile du public l'avait d'autant moins étonné, dans son mépris du public, qu'il avait parfaitement senti toute la beauté de l'œuvre. Il n'y avait peut-être pas deux personnes à Paris qui fussent plus capables que Hecht d'apprécier l'originalité artistique de Christophe. Mais il se fût bien gardé de lui en rien dire, non seulement parce qu'il était piqué de l'attitude de Christophe à son égard, mais parce qu'il lui était impossible d'être aimable: c'était une disgrâce spéciale de sa nature. Il était sincèrement disposé à aider Christophe; mais il n'eût point fait un pas pour cela: il attendait que Christophe vînt le lui demander. Et maintenant que Christophe était venu,—au lieu de saisir généreusement l'occasion d'effacer le souvenir de leur malentendu, en épargnant à son visiteur une démarche humiliante, il se donna la satisfaction de le laisser exposer tout au long sa requête; et il tint à lui imposer, au moins pour une fois, les travaux que Christophe avait refusés jadis. Il lui donna, pour le lendemain, cinquante pages de musique à transposer pour mandoline et guitare. Après quoi, satisfait de l'avoir fait plier, il lui trouva des occupations moins rebutantes, mais toujours avec une telle absence de bonne grâce qu'il était impossible de lui en savoir gré; il fallait que Christophe fût talonné par la gêne pour recourir de nouveau à lui. En tout cas, il aimait encore mieux gagner son argent par ces travaux, si irritants qu'ils fussent, que le recevoir en don de Hecht, comme Hecht le lui offrit, une fois:—et certes, c'était de bon cœur; mais Christophe avait senti l'intention que Hecht avait eue de l'humilier d'abord; contraint d'accepter ses conditions, il se refusa du moins à accepter ses bienfaits; il voulait bien travailler pour lui:—donnant, donnant, il était quitte;—mais il ne voulait rien lui devoir. Il n'était pas comme Wagner, ce mendiant impudent pour son art, il ne mettait pas son art au-dessus de son âme; le pain qu'il n'eût pas gagné lui-même l'eût étouffé.—Un jour qu'il venait de rapporter la tâche qu'il avait passé la nuit à faire, il trouva Hecht à table. Hecht, remarquant sa pâleur et les regards qu'il jeta involontairement sur les plats, eut la certitude qu'il n'avait pas mangé, et l'invita à déjeuner. L'intention était bonne; mais Hecht laissa si lourdement sentir qu'il avait vu le dénuement de Christophe, que son invitation ressemblait à une aumône: Christophe fût mort de faim, plutôt que d'accepter. Il ne put refuser de s'asseoir à table—(Hecht avait à lui parler);—mais il ne toucha à rien: il prétendit qu'il venait de déjeuner. Son estomac se crispait de besoin.
Christophe eût voulu se passer de Hecht; mais les autres éditeurs étaient encore pires.—Il y avait aussi les riches dilettantes, qui accouchaient d'un lambeau de phrase musicale, et qui n'étaient même pas capables de l'écrire. Ils faisaient venir Christophe, et lui chantaient leur élucubration:
—Hein! est-ce beau!
Ils la lui donnaient à «développer»,—(à écrire en entier);—et cela paraissait sous leur nom chez un grand éditeur. Après, ils étaient persuadés que le morceau était d'eux. Christophe en connut un, gentilhomme de bonne marque, un grand corps agité, qui lui donna du: «cher ami», l'empoigna par le bras, lui prodiguant les démonstrations d'enthousiasme tempétueux, ricanant à son oreille, bafouillant des coq-à-l'âne et des incongruités mêlées de cris d'extase: Beethoven, Verlaine, Offenhach, Yvette Guilbert... Il le faisait travailler, et négligeait de le payer. Il soldait en invitations à déjeuner et en poignées de mains. À la fin des fins, il envoya à Christophe vingt francs, que Christophe se donna le luxe stupide de lui renvoyer. Ce jour-là, il n'avait pas vingt sous en poche; et il lui avait fallu acheter un timbre de vingt-cinq centimes pour écrire à sa mère. C'était le jour de fête de la vieille Louisa; et, pour rien au monde, Christophe n'eût voulu y manquer: la bonne femme comptait trop sur la lettre de son garçon, elle n'aurait pu s'en passer. Elle lui écrivait un peu plus souvent, depuis quelques semaines, malgré la peine que cela lui coûtait d'écrire. Elle souffrait de sa solitude. Mais elle n'aurait pu se décider à venir rejoindre Christophe à Paris: elle était trop timorée, attachée à sa petite ville, à son église, à sa maison, elle avait peur des voyages. Et d'ailleurs, quand elle eût voulu venir, Christophe n'avait pas d'argent pour elle; il n'en avait pas tous les jours, pour lui-même.
Un envoi qui lui fit bien plaisir, une fois, ce fut de Lorchen, la jeune paysanne pour laquelle il avait eu une rixe avec des soldats prussiens: elle lui écrivait qu'elle se mariait; elle donnait des nouvelles de la maman, et elle lui expédiait un panier de pommes et une part de galette, pour manger en son honneur. Cela tomba joliment à propos. Ce soir-là chez Christophe, c'était jeûne, quatre-temps, et carême: du saucisson pendu au clou, près de la fenêtre, il ne restait plus que la ficelle. Christophe se compara aux saints anachorètes, qu'un corbeau vient nourrir sur leur rocher. Mais le corbeau avait beaucoup à faire sans doute de nourrir tous les anachorètes, car il ne revint plus.
Malgré tous ces ennuis, Christophe gardait son entrain. Il faisait dans sa cuvette la lessive de son linge, et il cirait ses chaussures, en sifflant comme un merle. Il se consolait avec les mots de Berlioz: «Élevons-nous au-dessus des misères de la vie, et chantons d'une voix légère le gai refrain si connu: Dies iræ...»—Il le chantait parfois, au scandale des voisins, stupéfiés de l'entendre s'interrompre au milieu par des éclats de rire.
Il menait une vie rigoureusement chaste. Comme dit cet autre, «la carrière d'amant est une carrière d'oisif et de riche». La misère de Christophe, sa chasse au pain quotidien, sa sobriété excessive, et sa fièvre de création ne lui laissaient ni le temps, ni le goût de songer au plaisir. Il n'y était pas seulement indifférent; par réaction contre Paris, il s'était jeté dans une sorte d'ascétisme moral. Il avait un besoin passionné de pureté, l'horreur de toute souillure. Ce n'était pas qu'il fût à l'abri des passions. À d'autres moments, il y avait été livré. Mais ces passions restaient chastes, même quand il y cédait: car il n'y cherchait pas le plaisir, mais le don absolu de soi et la plénitude de l'être. Et quand il voyait qu'il s'était trompé, il les rejetait avec fureur. La luxure n'était pas pour lui un péché comme les autres. C'était bien le grand Péché, celui qui souille les sources de la vie. Tous ceux chez qui le vieux fond chrétien n'a pas été totalement enseveli sous les alluvions étrangères, tous ceux qui se sentent encore aujourd'hui les fils des races vigoureuses, qui, au prix d'une discipline héroïque, édifièrent la civilisation de l'Occident, n'ont pas de peine à le comprendre. Christophe méprisait la société cosmopolite, dont le plaisir était l'unique but, le credo.—Certes, on fait bien de chercher le bonheur, de le vouloir pour les hommes, de combattre les déprimantes croyances pessimistes, amassées sur l'humanité par vingt siècles de christianisme gothique. Mais c'est à condition que ce soit une généreuse foi, qui veuille le bien des autres. Au lieu de cela, de quoi s'agit-il? De l'égoïsme le plus piteux. Une poignée de jouisseurs cherchent à «faire rendre» à leurs sens le maximum de plaisirs avec le minimum de risques, en s'accommodant fort bien que les autres en pâtissent.—Oui, sans doute, on connaît leur socialisme de salon!... Mais est-ce qu'ils ne sont pas les premiers à savoir que leurs doctrines voluptueuses ne valent que pour le peuple des «gras», pour une «élite» à l'engrais, et que pour les pauvres, c'est un poison?...
«La carrière du plaisir est une carrière de riches.»
Christophe n'était point riche, ni fait pour le devenir. Quand il venait de gagner quelque argent, il se hâtait de le dépenser aussitôt en musique; il se privait de nourriture pour aller au concert. Il prenait des dernières places, tout en haut du théâtre du Châtelet; et il se remplissait de musique: elle lui tenait lieu de souper et de maitresse. Il avait une telle faim de bonheur et tant d'aptitude à en jouir que les imperfections de l'orchestre ne parvenaient pas à le troubler; il restait, deux ou trois heures, engourdi dans un état de béatitude, sans que les fautes de goût et les fausses notes provoquassent en lui autre chose qu'un sourire indulgent: il avait laissé sa critique à la porte; il venait pour aimer et non pas pour juger. Autour de lui, le public s'abandonnait, comme lui, immobile, les yeux à demi-clos, au grand torrent de rêves. Christophe avait la vision d'un peuple tapi dans l'ombre, ramassé sur lui-même, comme un énorme chat, couvant des hallucinations de volupté et de carnage. Dans les demi-ténèbres épaisses et dorées, se modelaient mystérieusement certaines figures, dont le charme inconnu et l'extase muette attiraient les regards et le cœur de Christophe; il s'attachait à elles; il écoutait en elles; il finissait par s'assimiler corps et âme avec elles. Il arrivait qu'une d'elles s'en aperçût, et qu'il se tissât entre eux deux, pendant la durée du concert, une de ces sympathies obscures, qui vont jusqu'au plus profond de l'être, sans qu'il en reste rien, une fois le concert fini et le courant rompu qui unissait les âmes. C'est un état que connaissent bien ceux qui aiment la musique, surtout quand ils sont jeunes et se donnent le plus: l'essence de la musique est tellement l'amour qu'on ne la goûte complètement que si on la goûte en un autre; et au concert on cherche instinctivement des yeux, au milieu de la foule, un ami avec qui partager une joie trop grande pour soi seul.
Parmi ces amis d'une heure, dont Christophe faisait choix, afin de savourer mieux la douceur de la musique, une figure l'attirait, qu'il revoyait, à chaque concert. C'était une petite grisette, qui devait adorer la musique, sans rien y comprendre. Elle avait un profil de petite bête, un petit nez droit, dépassant à peine la ligne de la bouche légèrement avancée et du menton délicat, des sourcils fins et levés, des yeux clairs: un de ces minois insouciants, sous le voile desquels on sent de la joie, du rire, enveloppés d'une paix indifférente. Ces fillettes vicieuses, ces gamines ouvrières, reflètent peut-être le plus de la sérénité disparue, celle des statues antiques et des figures de Raphaël. Ce n'est là qu'un instant dans leur vie, le premier éveil du plaisir; la flétrissure est proche. Mais elles ont vécu du moins une jolie heure.
Christophe se délectait à la regarder: une gentille figure lui faisait du bien au cœur; il savait en jouir sans la désirer; il y puisait de la joie, de la force, de l'apaisement,—oui, presque de la vertu. Elle,—cela va sans dire,—avait vite remarqué qu'il la regardait; et il s'était établi entre eux, sans y penser, un courant magnétique. Et comme ils se retrouvaient, à peu près aux mêmes places, à presque tous les concerts, ils n'avaient pas tardé à connaître leurs goûts. À certains passages, ils échangeaient un regard d'intelligence; lorsqu'elle aimait particulièrement une phrase, elle tirait légèrement la langue, comme pour se lécher les lèvres; ou, pour montrer qu'elle ne trouvait pas cela bon, elle avançait dédaigneusement son gentil museau. Il se mêlait à ces petites mines un peu de ce cabotinage innocent, dont presque aucun être ne peut se dégager quand il se sait observé. Elle voulait se donner parfois, pendant les morceaux sérieux, une expression grave; et, tournée de profil, l'air absorbé, et la joue souriante, du coin de l'œil elle regardait s'il la regardait. Ils étaient devenus très bons amis, sans s'être jamais dit un mot, et sans avoir même essayé—(Christophe tout au moins)—de se rencontrer à la sortie.
Le hasard fit enfin qu'à un concert du soir, ils se trouvèrent placés l'un à côté de l'autre. Après un instant d'hésitation souriante, ils se mirent à causer amicalement. Elle avait une voix charmante, et disait beaucoup de bêtises sur la musique: car elle n'y connaissait rien, et voulait avoir l'air de s'y connaître; mais elle l'aimait passionnément. Elle aimait la pire et la meilleure, Massenet et Wagner; il n'y avait que la médiocre qui l'ennuyât. La musique était une volupté pour elle; elle la buvait par tous les pores de son corps, comme Danaé la pluie d'or. Le prélude de Tristan lui donnait la petite mort; et elle jouissait de se sentir emportée, comme une proie dans la bataille, par la Symphonie Héroïque. Elle apprit à Christophe que Beethoven était sourd-muet, et que, malgré cela, si elle l'avait connu, elle l'aurait bien aimé, quoiqu'il fût joliment laid. Christophe protesta que Beethoven n'était pas si laid; alors, ils discutèrent sur la beauté et sur la laideur; et elle convint que tout dépendait des goûts; ce qui était beau pour l'un ne l'était pas pour l'autre: «on n'était pas le louis d'or, on ne pouvait pas plaire à tout le monde».—Il aimait mieux qu'elle ne parlât point: il l'entendait bien mieux. Pendant la Mort d'Ysolde, elle lui tendit sa main; sa main était toute moite; il la garda dans la sienne jusqu'à la fin du morceau; ils sentaient, à travers leurs doigts entrelacés, couler le flot de la symphonie.
Ils sortirent ensemble; il était près de minuit. Ils remontèrent, en causant, vers le quartier Latin; elle lui avait pris le bras, et il la reconduisit chez elle; mais arrivés à la porte, comme elle se disposait à lui montrer le chemin, il la quitta, sans prendre garde à ses yeux engageants. Sur le moment, elle fut stupéfaite, puis furieuse; puis, elle se tordit de rire, en pensant à sa sottise; puis, rentrée dans sa chambre et se déshabillant, elle fut de nouveau agacée, et finalement pleura en silence. Quand elle le revit au concert, elle voulut se montrer piquée, indifférente, un peu cassante. Mais il était si bon enfant que sa résolution ne tint pas. Ils se remirent à causer; seulement, elle gardait avec lui maintenant une réserve. Il lui parlait cordialement, mais avec une grande politesse, et de choses sérieuses, de belles choses, de la musique qu'ils entendaient et de ce que cela signifiait pour lui. Elle l'écoutait attentivement, et tâchait de penser comme lui. Le sens de ses paroles lui échappait souvent; mais elle y croyait quand même. Elle avait pour Christophe un respect reconnaissant, qu'elle lui montrait à peine. D'un accord tacite, ils ne se parlaient qu'au concert. Il la rencontra une fois au milieu d'étudiants. Ils se saluèrent gravement. À personne elle ne parlait de lui. Il y avait dans le fond de son âme une petite province sacrée, quelque chose de beau, de pur, de consolant.
Ainsi, Christophe commençait à exercer par sa seule présence, parle seul fait qu'il existait, une influence apaisante. Partout où il passait, il laissait inconsciemment une trace de sa lumière intérieure. Il était le dernier à s'en douter. Il y avait près de lui, dans sa maison, des gens qu'il n'avait jamais vus, et qui, sans s'en douter eux-mêmes, subissaient peu à peu son rayonnement bienfaisant.
Depuis plusieurs semaines, Christophe n'avait plus d'argent pour aller au concert, même en faisant carême; et, dans sa chambre sous les toits, maintenant que l'hiver venait, il se sentait transi; il ne pouvait rester immobile à sa table. Alors il descendait, et marchait dans Paris, afin de se réchauffer. Il avait la faculté d'oublier par instants la ville grouillante qui l'entourait, et de se sauver dans l'infini du temps. Il lui suffisait de voir au-dessus de la rue tumultueuse la lune morte et glacée, suspendue dans le gouffre du ciel, ou le disque du soleil, roulant dans le brouillard blanc, pour que le bruit de la rue s'effaçât, pour que Paris s'enfonçât dans le vide sans bornes, pour que toute cette vie ne lui apparût plus que comme le fantôme d'une vie qui avait été, il y avait longtemps, longtemps,... il y avait des siècles... Le moindre petit signe, imperceptible au commun des hommes, de la grande vie sauvage de la nature, que recouvre tant bien que mal la livrée de la civilisation, suffisait à la faire surgir tout entière à ses yeux. L'herbe qui poussait entre les pavés, le renouveau d'un arbre étranglé dans son carcan de fonte, sans air et sans terre, sur un boulevard aride; un chien, un oiseau qui passaient, derniers vestiges de la faune qui remplissait l'univers primitif, et que l'homme a détruite; une nuée de moucherons; l'épidémie invisible qui dévorait un quartier:—c'était assez pour que, dans l'asphyxie de cette serre-chaude humaine, le souffle de l'Esprit de la Terre vînt le frapper au visage et fouetter son énergie.
Dans ces longues promenades, à jeun souvent, et n'ayant pas causé, de plusieurs jours, avec qui que ce fût, il rêvait intarissablement. Les privations et le silence surexcitaient cette disposition morbide. La nuit, il avait des sommeils pénibles, des rêves fatigants: sans cesse, il revoyait la vieille maison, la chambre où il avait vécu, enfant; il était poursuivi par des obsessions musicales. Le jour, il conversait avec ses êtres intérieurs et avec ceux qu'il aimait, les absents et les morts.
Une après-midi de décembre humide, que le givre couvrait les pelouses raidies, que les toits des maisons et les dômes gris se diluaient dans le brouillard, et que les arbres, aux branches nues, grêles et tourmentées, dans la vapeur qui les noyait, semblaient des végétations marines au fond e l'Océan,—Christophe, qui, depuis la veille, se sentait frissonnant et ne parvenait point à se réchauffer, entra au Louvre, qu'il connaissait à peine.
Il n'était pas, jusque-là, très touché par la peinture. Il était trop absorbé par l'univers intérieur pour bien saisir le monde des couleurs et des formes. Elles n'agissaient sur lui que par leurs résonances musicales, qui ne lui en apportaient qu'un écho déformé. Sans doute, son instinct percevait obscurément les lois identiques, qui président à l'harmonie des formes visuelles comme des formes sonores, et les nappes profondes de l'âme, d'où sourdent les deux fleuves de couleurs et de sons, qui baignent les deux versants opposés de la vie. Mais il ne connaissait que l'un des deux versants, et il était perdu dans le royaume de l'œil. Ainsi, lui échappait le secret du charme le plus exquis, le plus naturel peut-être, de la France au clair regard, reine dans le monde de la lumière.
Eût-il été plus curieux de peinture, Christophe était trop Allemand pour s'adapter aisément à une vision des choses aussi différente. Il n'était pas de ces Allemands dernier-cri, qui renient la façon de sentir germanique, et qui se persuadent qu'ils raffolent de l'impressionnisme ou du dix-huitième siècle français,—quand, d'aventure, ils n'ont pas la ferme assurance qu'ils les comprennent mieux que les Français. Christophe était un barbare, peut-être; mais il l'était franchement. Les petits culs roses de Boucher, les mentons gras de Watteau, les bergers ennuyés et les bergères dodues, sanglées dans leur corset, les âmes de crème fouettée, les vertueuses œillades de Greuze, les chemises troussées de Fragonard, tout ce poétique déculottage ne lui inspirait pas beaucoup plus d'intérêt qu'un journal élégant et polisson. Il n'en entendait point la riche et brillante harmonie; les rêves voluptueux, parfois mélancoliques, de cette vieille civilisation, la plus raffinée de l'Europe, lui étaient étrangers. Quant au dix-septième siècle français, il ne goûtait pas plus sa dévotion cérémonieuse et ses portraits d'apparat; la réserve un peu froide des plus graves entre ces maîtres, un certain gris de l'âme répandu sur l'œuvre hautain de Nicolas Poussin et sur les figures pâles de Philippe de Champaigne, éloignaient Christophe de l'ancien art français. Et du nouveau, il ne connaissait rien. S'il l'eût connu, il l'eût méconnu. Le seul peintre moderne, dont il eût, en Allemagne, subi la fascination, Boecklinle Bâlois, ne l'avait point préparé à voir l'art latin. Christophe gardait en lui le choc de ce brutal génie, qui sentait la terre et les fauves relents du bestiaire héroïque qu'il en avait fait sortir. Ses yeux, brûlés par la lumière crue, habitués au bariolage frénétique de ce sauvage ivre, avaient de la peine à se faire aux demi-teintes, aux harmonies morcelées et moelleuses de l'art français.
Mais ce n'est pas impunément qu'on vit dans un monde étranger. On en subit l'empreinte. On a beau se murer en soi: on s'aperçoit un jour qu'il y a quelque chose de changé.
Il y avait quelque chose de changé dans Christophe, ce soir-là où il errait par les salles du Louvre. Il était las, il avait froid, il avait faim, il était seul. Autour de lui, l'ombre descendait dans les galeries désertes, les formes endormies s'animaient. Christophe passait, silencieux et glacé, au milieu des sphinx d'Égypte, des monstres assyriens, des taureaux de Persépolis, des serpents gluants de Palissy. Il se sentait dans une atmosphère de contes de fées; et dans son cœur montait un émoi mystérieux; Le rêve de l'humanité l'enveloppait,—les fleurs étranges de l'âme...
Dans le poudroiement doré des galeries de peinture, les jardins de couleurs éclatantes et mûres, les prairies de tableaux, où l'air manque, Christophe, fiévreux, au seuil de la maladie, eut un coup de foudre.—Il allait, presque sans voir, étourdi par le besoin, par la tiédeur des salles, et par cette orgie d'images: la tête lui tournait. Arrivé au bout de la galerie du bord de l'eau, devant le Bon Samaritain de Rembrandt, il s'appuya des deux mains, pour ne pas tomber, sur la rampe de fer qui entoure les tableaux, il ferma les yeux, un instant. Quand il les rouvrit sur l'œuvre qui était en face de lui, tout près de son visage, il fut fasciné...
Le jour s'éteignait. Le jour était lointain déjà, déjà mort. Le soleil invisible s'effondrait dans la nuit. C'était l'heure magique où les hallucinations sont sur le point de sortir de l'âme endolorie par les travaux du jour, immobile, engourdie. Tout se tait, on n'entend que le bruit des artères. On n'a plus la force de remuer, à peine de respirer, on est triste et livré... Un immense besoin de s'abandonner dans les bras d'un ami... On implore le miracle, on sent qu'il va venir... Il vient! Dans le crépuscule un flot d'or flamboie, rejaillit sur le mur, sur l'épaule de l'homme qui porte le mourant, baigne ces humbles objets et ces êtres médiocres, et tout prend une douceur, une gloire divine. C'est Dieu même, qui étreint dans ses bras terribles et tendres ces misérables, faibles, laids, pauvres, sales, ce valet pouilleux, aux bas sur les talons, ces visages difformes, qui se pressent lourdement à la fenêtre, ces êtres apathiques, qui se taisent, épeurés,—toute cette humanité pitoyable de Rembrandt, ce troupeau des âmes obscures et ligotées, qui ne savent rien, qui ne peuvent rien, qu'attendre, trembler, pleurer, prier.—Mais le Maître est là. On ne Le voit pas Lui-même; on voit son auréole et l'ombre de lumière qu'il projette sur les hommes...
Christophe sortit du Louvre, d'un pas mal assuré. La tête lui faisait mal. Il ne voyait plus rien. Dans la rue, sous la pluie, il remarquait à peine les flaques entre les pavés et l'eau ruisselant de ses souliers. Le ciel jaunâtre, sur la Seine, s'allumait, à la tombée du jour, d'une flamme intérieure,—une lumière de lampe. Christophe emportait dans ses yeux la fascination d'un regard. Il lui semblait que rien n'existait: non, les voitures n'ébranlaient pas les pavés, avec un bruit impitoyable; les passants ne le heurtaient point avec leurs parapluies mouillés; il ne marchait point dans la rue; peut-être qu'il était assis chez lui et qu'il rêvait; peut-être qu'il n'existait plus... Et brusquement,—(il était si faible)!—un étourdissement le prit, il se sentit tomber comme une masse, la tête en avant... Ce ne fut qu'un éclair: il serra les poings, et s'arc-boutant sur ses jambes, il reprit son aplomb.
À ce moment précis, dans la seconde où sa conscience émergeait du gouffre, son regard se heurta, de l'autre côté de la rue, à un regard qu'il connaissait bien, et qui semblait l'appeler. Il s'arrêta, interdit, cherchant où il l'avait déjà vu. Ce ne fut qu'au bout d'un moment qu'il reconnut ces yeux tristes et doux: la petite institutrice française, qu'il avait sans le vouloir fait chasser de sa place, en Allemagne, et qu'il avait tant cherchée depuis, pour lui demander pardon. Elle s'était arrêtée aussi, au milieu de la cohue des passants, et elle le regardait. Soudain, il la vit essayer de remonter le courant de la foule, et descendre sur la chaussée, pour venir à lui. Il se jeta à sa rencontre; mais un encombrement inextricable de voitures les sépara; il l'aperçut encore un instant, se débattant de l'autre côté de cette muraille vivante; il voulut traverser quand même, fut bousculé par un cheval, glissa, tomba sur l'asphalte gluant, faillit être écrasé. Quand il se releva, couvert de boue, et réussit à passer de l'autre côté, elle avait disparu.
Il voulut se mettre à sa poursuite. Mais son vertige redoublait: il dut y renoncer. La maladie venait: il le sentait, mais il ne voulait pas en convenir. Il s'obstina à ne pas rentrer tout de suite, à prendre le plus long chemin. Torture inutile: il lui fallut se reconnaître vaincu; il avait les jambes cassées, il se traînait, il eut peine à revenir chez lui. Dans l'escalier, il étouffa, il dut s'asseoir sur les marches. Rentré dans sa chambre glacée, il s'entêta à ne pas se coucher; il restait sur sa chaise, trempé de pluie, la tête lourde et la poitrine haletante, s'engourdissant dans des musiques courbaturées, comme lui. Il entendait passer des phrases de la Symphonie inachevée de Schubert. Pauvre petit Schubert! Quand il écrivait cela, il était seul, fiévreux et somnolent, lui aussi, dans l'état de demi-torpeur qui précède le grand sommeil; il rêvait au coin du feu; des musiques engourdies flottaient autour de lui, comme des eaux un peu stagnantes; il s'y attardait, tel un enfant à demi endormi qui se complaît à l'histoire qu'il se raconte, en répète un passage vingt fois; le sommeil vient... la mort vient...—Et Christophe entendit passer aussi cette autre musique aux mains brûlantes, aux yeux fermés, souriant d'un sourire las, le cœur gonflé de soupirs, rêvant de la mort qui délivre:—le premier chœur de la Cantate de J. S. Bach: «Cher Dieu, quand mourrai-je?»... Il faisait bon s'enfoncer dans les moelleuses phrases qui se déroulent avec de lentes ondulations, le bourdonnement des cloches lointaines et voilées... Mourir, se fondre dans la paix de la terre!... «Und dann selber Erde werden»... «Et puis soi-même devenir terre...»
Christophe secoua ces pensées maladives, le sourire meurtrier de la sirène qui guette les âmes affaiblies. Il se leva et essaya de marcher dans sa chambre; mais il ne put tenir debout. Il grelottait de fièvre. Il dut se mettre au lit. Il sentait que, cette fois, c'était sérieux; mais il ne désarmait pas; il n'était pas de ceux qui, quand ils sont malades, s'abandonnent à la maladie; il luttait, il ne voulait pas être malade, et surtout, il était parfaitement décidé à ne pas mourir. Il avait sa pauvre maman qui l'attendait là-bas. Et il avait son œuvre à faire: il ne se laisserait pas tuer. Il serrait ses dents qui claquaient, il tendait sa volonté qui lui échappait; ainsi, un bon nageur qui continue de lutter sous les vagues qui le recouvrent. À tout instant, il plongeait: c'étaient des divagations, des images sans suite, des souvenirs du pays ou des salons parisiens; aussi, des obsessions de rythmes et de phrases, qui tournaient, tournaient indéfiniment, comme des chevaux de cirque; le choc soudain de la lumière d'or du Bon Samaritain; les figures d'épouvante dans l'ombre; et puis, des abîmes, des nuits. Puis, il surnageait de nouveau, il déchirait les nuées grimaçantes, il crispait les poings et la mâchoire. Il s'accrochait à tous ceux qu'il aimait dans le présent et le passé, à la figure amie qu'il avait entrevue tout à l'heure, à la chère maman, et aussi à son être indestructible, qu'il sentait comme un roc: «la mort n'y mord»...—Mais le roc était de nouveau recouvert par la mer; un choc des vagues faisait lâcher prise à l'âme; elle était balayée par l'écume. Et Christophe se débattait dans le délire, disant des paroles insensées, dirigeant et jouant un orchestre imaginaire: trombones, trompettes, cymbales, timbales, bassons, et contrebasses,... il raclait, soufflait, tapait, avec frénésie. Le malheureux bouillait de musique rentrée. Depuis des semaines qu'il ne pouvait plus en entendre, ni en jouer, il était comme une chaudière sous pression, près d'éclater. Certaines phrases obstinées s'enfonçaient dans son cerveau comme des vrilles, lui perforaient le tympan, le faisaient souffrir à hurler. Au sortir de ces crises, il retombait sur son oreiller, mort de fatigue, trempé, moulu, haletant, étouffant. Il avait installé près de son lit son pot à eau, dont il buvait des gorgées. Les bruits des chambres voisines, les portes des mansardes qu'on refermait, le faisaient ressauter. Il avait le dégoût halluciné de ces êtres entassés autour de lui. Mais sa volonté luttait toujours, elle soufflait des fanfares belliqueuses, le combat contre les diables... «Und wenn die Welt voll Teufel wär, und wollten uns verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr...» («Et quand bien même le monde serait plein de diables, et qu'ils voudraient nous avaler, cela ne nous ferait pas peur...»)
Et sur l'océan de ténèbres brûlantes où son être roulait, s'ouvrait soudain une accalmie, des éclaircies de lumière, un murmure apaisé des violons et des violes, de calmes sonneries de gloire des trompettes et des cors, tandis que, presque immobile, tel un grand mur, s'élevait de l'âme malade un chant inébranlable, comme un choral de J. S. Bach.
Tandis qu'il se débattait contre les fantômes de la fièvre et contre l'étouffement qui gagnait sa poitrine, il eut vaguement conscience qu'on ouvrait la porte de sa chambre, et qu'une femme entrait, une bougie à la main. Il crut que c'était encore une hallucination. Il voulut parler. Mais il ne put, et retomba. Quand, de loin en loin, une vague de conscience le ramenait du fond à la surface, il sentait qu'on avait soulevé son oreiller, qu'on lui avait mis une couverture sur les pieds, qu'il avait sur le dos quelque chose qui le brûlait; ou il voyait, assise au pied du lit, cette femme, dont la figure ne lui était pas tout à fait inconnue. Puis il vint une autre figure, un médecin, qui l'ausculta. Christophe n'entendait pas ce qu'on disait; mais il devina qu'on parlait de le porter à l'hôpital. Il essaya de protester, de crier qu'il ne voulait pas, qu'il voulait mourir ici, seul; mais il ne sortait de sa bouche que des sons incompréhensibles. La femme le comprit pourtant: car elle prit sa défense, et elle le calma. Il s'épuisait à savoir qui elle était. Aussitôt qu'il put formuler une phrase suivie, au prix d'efforts inouïs, il le lui demanda.. Elle lui répondit qu'elle était sa voisine de mansarde, qu'elle l'avait entendu gémir de l'autre côté du mur, et qu'elle s'était permis d'entrer, pensant qu'il avait besoin d'aide. Elle le pria respectueusement de ne pas se fatiguer à parler. Il lui obéit. Au reste, il était brisé par l'effort qu'il avait fait; il se tint donc immobile, et se tut; mais son cerveau continuait de travailler, rassemblant péniblement ses souvenirs épars. Où donc l'avait-il vue?... Il finit par se rappeler: oui, il l'avait rencontrée dans le couloir des mansardes; elle était domestique, elle se nommait Sidonie.
Les yeux à demi clos, il la regardait, sans qu'elle le vît. Elle était petite, la figure sérieuse, le front bombé, les cheveux relevés, le haut des joues et les tempes découverts, pâles et de forte ossature, le nez court, les yeux bleu-clair, au regard doux et obstiné, les lèvres grosses et serrées, le teint anémié, l'air humble, concentré, un peu raidi. Elle s'occupait de Christophe, avec un dévouement actif et silencieux, sans familiarité, sans se départir jamais de la réserve d'une domestique qui n'oublie pas la différence de classes.
Peu à peu cependant, lorsqu'il alla mieux et qu'il put causer avec elle, la bonhomie affectueuse de Christophe amena Sidoine à lui parler un peu plus librement; mais elle se surveillait toujours; il y avait certaines choses (on le voyait), qu'elle ne disait pas. Elle avait un mélange d'humilité et de fierté. Christophe apprit qu'elle était bretonne. Elle avait laissé au pays son père, dont elle parlait avec beaucoup de discrétion; mais Christophe n'eut pas de peine à deviner qu'il ne faisait rien que boire, se donner du bon temps, et exploiter sa fille; elle se laissait exploiter, sans rien dire, par orgueil; et elle ne manquait jamais de lui envoyer une partie de l'argent de son mois; mais elle n'était pas dupe. Elle avait aussi une sœur plus jeune, qui se préparait à un examen d'institutrice, et dont elle était très fière. Elle payait presque tous les frais de son éducation. Elle s'acharnait au travail, d'une façon entêtée.
—«Est-ce qu'elle avait une bonne place?» lui demandait Christophe.
—«Oui; mais elle pensait à la quitter.»
—«Pourquoi? Est-ce qu'elle avait à se plaindre de ses maîtres?»
—«Oh! non. Ils étaient très bons pour elle.»
—«Est-ce qu'elle ne gagnait pas assez?»
—«Si...»
Il ne comprenait pas bien; il essayait de comprendre, il l'encourageait à parler. Mais elle n'avait rien à lui raconter que sa vie monotone, la peine qu'on avait à gagner sa vie, elle n'y insistait point: le travail ne l'effrayait pas, il lui était un besoin, presque un plaisir. Elle ne parlait pas de ce qui lui était le plus pesant: l'ennui. Il le devinait. Peu à peu, il lisait en elle, avec l'intuition d'une grande sympathie, que la maladie avait aiguisée, et que rendait plus pénétrante le souvenir des épreuves supportées dans une vie analogue par la chère maman. Il voyait, comme s'il l'avait vécue, cette existence morne, malsaine, contre nature,—l'existence ordinaire, que la société bourgeoise impose aux domestiques:—des maîtres pas méchants, mais indifférents, qui la laissaient parfois plusieurs jours, sans lui dire un mot, sauf pour le service. Des heures, des heures, dans l'étouffante cuisine, dont la lucarne, encombrée par un garde-manger, donnait sur un mur blanc sale. Toutes ses joies, quand on lui disait négligemment que la sauce était bonne, ou le rôti bien cuit. Une vie murée, sans air, sans avenir, sans une lueur de désir et d'espoir, sans intérêt à rien.—Le plus mauvais moment pour elle était quand ses maîtres s'en allaient à la campagne. Ils ne l'emmenaient pas avec eux, par économie; ils lui payaient son mois, mais ne lui payaient pas son voyage pour retourner au pays; ils la laissaient libre d'y aller à ses frais. Elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas le faire. Alors, elle restait seule dans la maison à peu près abandonnée. Elle n'avait pas envie de sortir, elle ne causait même pas avec les autres domestiques, qu'elle méprisait un peu à cause de leur grossièreté et de leur immoralité. Elle n'allait pas s'amuser: elle était sérieuse de nature, économe, et elle avait la crainte des mauvaises rencontres. Elle restait assise, dans sa cuisine, ou dans sa chambre, d'où par-dessus les cheminées elle apercevait le sommet d'un arbre, dans un jardin d'hôpital. Elle ne lisait pas, elle essayait de travailler, elle s'engourdissait, elle s'ennuyait, elle pleurait d'ennui; elle avait un pouvoir singulier de pleurer, indéfiniment: c'était son plaisir. Mais quand elle s'ennuyait trop, elle ne pouvait même plus pleurer, elle était comme gelée, le cœur mort. Puis, elle se secouait; ou la vie revenait d'elle-même. Elle pensait à sa sœur, elle écoutait un orgue de barbarie dans le lointain, elle rêvassait, elle comptait longuement combien il lui faudrait de jours pour avoir fini tel travail, pour avoir gagné telle somme; elle se trompait dans ses comptes; elle recommençait à compter; elle dormait. Les jours passaient...
Avec ces accès de dépression alternaient des réveils de gaieté enfantine et gouailleuse. Elle se gaussait des autres et d'elle-même. Elle n'était pas sans voir et sans juger ses maîtres, les soucis que se créait leur désœuvrement, les vapeurs de Madame et ses mélancolies, les soi-disant occupations de cette soi-disant élite, l'intérêt qu'ils prenaient à un tableau, a un morceau de musique, à un livre de vers. Avec son bon sens un peu gros, également éloigné du snobisme des domestiques très parisiens et de la bêtise épaisse des domestiques provinciaux, qui n'admirent que ce qu'ils ne comprennent pas, elle avait un mépris respectueux pour ces pianotages, ces bavardages, toutes ces choses intellectuelles, parfaitement inutiles, et ennuyeuses par surcroît, qui prennent une si grande place dans ces existences mensongères. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer silencieusement la vie réelle, avec laquelle elle était aux prises, aux plaisirs et aux peines imaginaires de cette vie de luxe, où tout semble fabriqué par l'ennui. Au reste, elle n'en était pas révoltée. C'était ainsi: c'était ainsi. Elle admettait tout, les méchantes gens et les sots. Elle disait:
—Faut de tout, pour faire un monde.
Christophe s'imaginait qu'elle était soutenue par sa foi religieuse; mais un jour, elle dit, à propos des autres, plus riches et plus heureux:
—Au bout du compte, on sera tous pareils, plus tard.
—Quand donc? demanda-t-il. Après la révolution sociale?
—La révolution? dit-elle. Oh! bien, il passera de l'eau sous le pont, avant. Je ne crois pas à ces bêtises. Tout sera toujours de même.
—Alors, quand est-ce qu'on sera pareils?
—Après la mort, bien sûr! Il ne reste rien de personne.
Il fut bien étonné de ce matérialisme tranquille. Il n'osa pas lui dire:
—Est-ce que ce n'est pas affreux, en ce cas, si l'on n'a qu'une vie, qu'elle soit comme la vôtre, tandis qu'il y a d'autres gens qui sont heureux?
Mais elle sembla avoir deviné ce qu'il pensait; elle continua, avec un flegme résigné et un peu ironique:
—Il faut bien se faire une raison. Tout le monde ne peut pas tirer le gros lot. On est mal tombé: tant pis!
Elle ne songeait même pas à chercher hors de France (comme on le lui avait offert en Amérique) une place qui lui rapportât davantage. L'idée de quitter le pays ne pouvait entrer dans sa tête. Elle disait:
—C'est partout que les pierres sont dures.
Il y avait en elle un fond de fatalisme sceptique et railleur. Elle était bien de cette race, qui a peu ou point de foi, peu de raisons intellectuelles de vivre, et pourtant une tenace vitalité,—de ce peuple des campagnes françaises, laborieux et apathique, frondeur et soumis, qui n'aime pas beaucoup la vie, mais qui y tient, et qui n'a pas besoin d'encouragements factices pour garder son courage.
Christophe, qui ne le connaissait pas encore, s'étonnait de trouver chez cette simple fille un désintéressement de toute foi; il admirait son attachement à la vie, sans plaisir et sans but, et, plus que tout, son robuste sens moral, qui ne s'appuyait sur rien. Il n'avait vu jusque-là les gens du peuple français qu'à travers les romans naturalistes et les théories des petits hommes de lettres contemporains, qui, au rebours de ceux du siècle des bergeries et de la Révolution, aimaient à se représenter l'homme de la nature comme un animal vicieux, afin de légitimer leurs propres vices... Il découvrait avec surprise l'intransigeante honnêteté de Sidonie. Ce n'était pas une affaire de morale; c'était une affaire d'instinct et de fierté. Elle avait son orgueil aristocratique. Car c'est une sottise de croire que qui dit: peuple, dit: populaire. Le peuple a ses aristocrates, de même que la bourgeoisie a ses âmes de la plèbe. Des aristocrates, c'est-à-dire des êtres qui ont des instincts, un sang peut-être, plus purs que les, autres, et qui le savent, qui ont la conscience de ce qu'ils sont, et la fierté de ne pas déchoir. Ils sont minorité; mais, même tenus à l'écart, on sait bien qu'ils sont les premiers; et leur seule présence est un frein pour les autres. Les autres sont contraints de se modeler sur eux, ou de faire semblant. Chaque province, chaque village, chaque groupement d'hommes est, dans une certaine mesure, ce que sont ses aristocrates; et, suivant ce qu'ils sont, l'opinion est, ici, extrêmement sévère; et là, elle est relâchée. Le débordement anarchique des majorités, à l'heure actuelle, ne changera rien à cette autorité immanente des minorités muettes. Plus dangereux pour elles est leur déracinement du sol natal, et leur éparpillement au loin, dans les grandes villes. Mais même ainsi, perdues dans des milieux étrangers, isolées les unes des autres, les individualités de bonne race persistent, sans se mêler à ce qui les entoure.—De tout ce que Christophe avait vu à Paris, Sidonie ne connaissait quasi rien, et ne cherchait à rien connaître. La littérature sentimentale et malpropre des journaux ne l'atteignait pas plus que les nouvelles politiques. Elle ne savait même pas qu'il y eût des Universités Populaires; et, si elle l'avait su, il est probable qu'elle ne s'en serait pas plus souciée que d'aller au sermon. Elle faisait son métier, et pensait ses pensées; elle ne s'inquiétait pas de penser celles des autres. Christophe lui en fit ses compliments.
—Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? dit-elle. Je suis comme tout le monde. Vous n'avez donc pas vu de Français?
—Voilà un an que j'habite au milieu d'eux, dit Christophe; et je n'en ai pas rencontré un seul qui parût penser à autre chose qu'à s'amuser, ou à singer ceux qui s'amusent.
—Bien oui, dit Sidonie. Vous n'avez vu que des riches. Les riches, c'est partout les mêmes. Vous n'avez encore rien vu.
—Si fait, dit Christophe. Je commence.
Il entrevoyait, pour la première fois, ce peuple de France, qui donne l'impression d'une durée éternelle, qui fait corps avec sa terre, qui a vu passer, comme elle, tant de races conquérantes, tant de maîtres d'un jour, et qui ne passe pas.
Il allait mieux maintenant et commençait à se lever.
La première chose dont il s'inquiéta fut de rembourser à Sidonie les dépenses qu'elle avait faites pour lui, pendant qu'il était malade. Dans l'impossibilité où il se trouvait de courir dans Paris pour chercher de l'ouvrage, il dut se résoudre à écrire à Hecht: il demandait qu'on voulût bien lui faire une avance d'argent sur son prochain travail. Avec son mélange étonnant d'indifférence et de bienfaisance, Hecht lui fit attendre, plus de quinze jours, la réponse,—quinze jours, durant lesquels Christophe se tortura, se refusant presque à toucher à la nourriture que lui apportait Sidonie, n'acceptant qu'un peu de lait et de pain qu'elle le forçait à prendre, et qu'il se reprochait ensuite, parce qu'il ne l'avait pas gagné: après quoi il reçut de Hecht, sans un mot, la somme demandée; et pas une fois, pendant les mois que dura la maladie de Christophe, Hecht ne chercha à savoir comment il allait. Il avait le génie de ne pas se faire aimer, même en faisant du bien. C'était, du reste, qu'en faisant du bien, il n'aimait pas.
Sidonie venait, chaque jour, un moment dans l'après-midi, et le soir. Elle préparait le dîner de Christophe. Elle ne faisait aucun bruit; elle s'occupait discrètement de ses affaires; et, ayant vu le délabrement de son linge, sans le dire, elle l'emportait chez elle, pour le raccommoder. Insensiblement, s'était glissé dans leurs relations quelque chose de plus affectueux. Christophe parlait longuement de sa vieille maman. Sidonie était émue; elle se mettait à la place de Louisa, seule, là-bas; et elle avait pour Christophe un sentiment maternel. Lui-même, en causant avec elle, s'efforçait de tromper son besoin d'affection familiale, dont on souffre bien plus, quand on est faible et malade. Il se sentait plus près de Louisa avec Sidonie qu'avec toute autre. Il lui confiait parfois quelques-uns de ses chagrins d'artiste. Elle le plaignait doucement, avec un peu d'ironie pour ces tristesses intellectuelles. Cela aussi lui rappelait sa mère, et lui faisait du bien.
Il cherchait à provoquer ses confidences; mais elle se livrait beaucoup moins que lui. Il lui demandait, en plaisantant, si elle ne se marierait pas. Elle répondait, sur son ton habituel de résignation railleuse, que «ce n'était pas permis, quand on est domestique: cela complique trop les choses. Et puis, il faut bien tomber dans son choix, et ce n'est pas commode. Les hommes sont de fameuses canailles. Ils viennent vous faire la cour, quand vous avez de l'argent; ils mangent votre argent, et puis après, ils vous plantent là. Elle en avait vu trop d'exemples autour d'elle: elle n'était pas tentée de faire de même.»—Elle ne disait pas qu'elle avait eu un mariage manqué: son «futur» l'avait laissée, quand il avait vu qu'elle donnait tout ce qu'elle gagnait aux siens.—Christophe la voyait jouer maternellement dans la cour avec les enfants d'une famille qui habitait la maison. Quand elle les rencontrait seuls dans l'escalier, il lui arrivait de les embrasser avec passion. Christophe l'imaginait à la place d'une des dames qu'il connaissait: elle n'était point sotte, elle n'était pas plus laide qu'une autre; il se disait qu'à leur place, elle eût été mieux qu'elles. Tant de puissances de vie enterrées, sans que personne s'en souciât! Et, en revanche, tous ces morts vivants, qui encombrent la terre, et qui prennent, au soleil, la place et le bonheur des autres!...
Christophe ne se méfiait pas. Il était très affectueux, trop affectueux pour elle; il se faisait câliner, comme un grand enfant.
Sidonie, certains jours, avait l'air abattue; mais il l'attribuait à sa tâche. Une fois, au milieu d'un entretien, elle se leva brusquement, et quitta Christophe, prétextant un ouvrage. Enfin, après un jour où Christophe lui avait témoigné plus de confiance encore qu'à l'ordinaire, elle interrompit ses visites pour quelque temps; et, quand elle revint, elle ne lui parla plus qu'avec contrainte. Il se demandait en quoi il avait pu l'offenser. Il le lui demanda. Elle répondit avec vivacité qu'il ne l'avait offensée en rien; mais elle continua de s'éloigner de lui. Quelques jours après, elle lui annonça qu'elle partait: elle avait laissé sa place, et quittait la maison. En termes froids et guindés, elle le remercia des bontés qu'il lui avait témoignées, lui exprima les souhaits qu'elle formait pour sa santé et pour celle de sa mère, et elle lui fit ses adieux. Il fut si étonné de ce brusque départ qu'il ne sut que dire; il essaya de connaître les motifs qui l'y déterminaient: elle répliqua, d'une manière évasive. Il lui demanda où elle allait se placer: elle évita de répondre; et, pour couper court à ses questions, elle partit. Sur le seuil de la porte, il lui tendit la main; elle la serra un peu vivement; mais sa figure ne se démentit pas; et, jusqu'au bout, elle garda son air raide et glacé. Elle s'en alla.
Il ne comprit jamais pourquoi.
L'hiver s'éternisait. Un hiver humide, brumeux et boueux. Des semaines sans soleil. Bien que Christophe allât mieux, il n'était pas guéri. Il avait toujours un point douloureux au poumon droit, une lésion qui se cicatrisait lentement, et des accès de toux nerveuse, qui l'empêchaient de dormir, la nuit. Le médecin lui avait défendu de sortir. Il aurait pu tout autant lui ordonner de s'en aller sur la Côte d'Azur, ou dans les Canaries. Il fallait bien qu'il sortit! S'il n'était pas allé chercher son dîner, ce n'était pas son dîner qui serait venu le chercher.—On lui ordonnait aussi des drogues qu'il n'avait pas les moyens de payer. Aussi avait-il renoncé à demander conseil aux médecins: c'était de l'argent perdu; et puis, il se sentait toujours mal à l'aise avec eux; eux et lui ne pouvaient se comprendre: deux mondes opposés. Ils avaient une compassion ironique et un peu méprisante pour ce pauvre diable d'artiste, qui prétendait être un monde à lui tout seul, et qui était balayé comme une paille par le fleuve de la vie. Il était humilié d'être regardé, palpé, tripoté par ces hommes. Il avait honte de son corps malade. Il pensait:
—Comme je serai content, lorsqu'il mourra!
Malgré la solitude, la maladie, la misère, tant de raisons de souffrir, Christophe supportait son sort patiemment. Jamais il n'avait été si patient. Il s'en étonnait lui-même. La maladie est bienfaisante, souvent. En brisant le corps, elle affranchit l'âme; elle la purifie: dans les nuits et les jours d'inaction forcée, se lèvent des pensées, qui ont peur de la lumière trop crue, et que brûle le soleil de la santé. Qui n'a jamais été malade ne s'est connu jamais tout entier.
La maladie avait mis en Christophe un apaisement singulier. Elle l'avait dépouillé de ce qu'il y avait de plus grossier dans son être. Il sentait, avec des organes plus subtils, le monde des forces mystérieuses qui sont en chacun de nous, et que le tumulte de la vie nous empêche d'entendre. Depuis la visite au Louvre, dans ces heures de fièvre, dont les moindres souvenirs s'étaient gravés en lui, il vivait dans une atmosphère analogue à celle du tableau de Rembrandt, chaude, douce et profonde. Il sentait, lui aussi, dans son cœur, les magiques reflets d'un soleil invisible. Et bien qu'il ne crût point, il savait qu'il n'était point seul: un Dieu le tenait par la main, le menait où il fallait qu'il vînt. Il se confiait à lui comme un petit enfant.
Pour la première fois depuis des années, il était contraint de se reposer. La lassitude même de la convalescence lui était un repos, après l'extraordinaire tension intellectuelle, qui avait précédé la maladie, et qui le courbaturait encore. Christophe qui, depuis plusieurs mois, se raidissait dans un état de qui-vive perpétuel, sentait se détendre peu à peu la fixité de son regard. Il n'en était pas moins fort; il en était plus humain. La vie puissante, mais un peu monstrueuse, du génie, était passée à l'arrière-plan; il se retrouvait un homme comme les autres, dépouillé de ses fanatismes d'esprit, et de tout ce que l'action a de dur et d'impitoyable. Il ne haïssait plus rien; il ne pensait plus aux choses irritantes, ou seulement avec un haussement d'épaules; il songeait moins à ses peines, et plus à celles des autres. Depuis que Sidonie lui avait rappelé les souffrances silencieuses des humbles âmes, qui luttaient sans se plaindre, sur tous les points de la terre, il s'oubliait en elles. Lui qui n'était pas sentimental à l'ordinaire, il avait maintenant des accès de cette tendresse mystique, qui est la fleur de la faiblesse. Le soir, accoudé à sa fenêtre, au-dessus de la cour, écoutant les bruits mystérieux de la nuit, ... une voix qui chantait dans une maison voisine, et que l'éloignement faisait paraître émouvante, une petite fille qui pianotait naïvement du Mozart, ... il pensait:
—Vous tous que j'aime, et que je ne connais pas! Vous que la vie n'a point flétris, qui rêvez a de grandes choses que vous savez impossibles, et qui vous débattez contre le monde ennemi,—je veux que vous ayez le bonheur—il est si bon d'être heureux!... Ô mes amis, je sais que vous êtes là, et je vous tends les bras... Il y a un mur entre nous. Pierre à pierre, je l'use; mais je m'use; en même temps. Nous rejoindrons-nous jamais? Arriverai-je à vous, avant que se soit dressé l'autre mur: la mort?...—N'importe! Que je sois seul, toute ma vie, pourvu que je travaille pour vous, que je vous fasse du bien, et que vous m'aimiez un peu, plus tard, après ma mort!...
Ainsi, Christophe convalescent buvait le lait des deux bonnes nourrices: «Liebe and Not» (Amour et Misère).
Dans cette détente de sa volonté, il sentait le besoin de se rapprocher des autres. Et, bien qu'il fût très faible encore, et que ce ne fût guère prudent, il sortait, de bon matin, à l'heure où le flot du peuple dévalait des rues populeuses vers le travail lointain, ou le soir, quand il revenait. Il voulait se plonger dans le bain rafraîchissant de la sympathie humaine. Non qu'il parlât à personne. Il ne le cherchait même pas. Il lui suffisait de regarder passer les gens, de les deviner, et de les aimer. Il observait, avec une affectueuse pitié, ces travailleurs qui se hâtaient, ayant tous, par avance, la lassitude de la journée,—ces figures de jeunes hommes, de jeunes filles, au teint étiolé, aux expressions aiguës, aux sourires étranges,—ces visages transparents et mobiles, sous lesquels on voyait passer des flots de désirs, de soucis, d'ironies changeantes,—ce peuple si intelligent, trop intelligent, un peu morbide, des grandes villes. Ils marchaient vite, tous, les hommes lisant les journaux, les femmes grignotant un croissant. Christophe eût bien donné un mois de sa vie pour que la blondine ébouriffée, aux traits bouffis de sommeil, qui venait de passer près de lui, d'un petit pas de chèvre, nerveux et sec, pût dormir encore une heure ou deux de plus. Oh! qu'elle n'eût pas dit non, si on le lui avait offert! Il eût voulu enlever de leurs appartements, hermétiquement clos à cette heure, toutes les riches oisives, qui jouissaient ennuyeusement de leur bien-être, et mettre à leur place, dans leurs lits, dans leur vie reposante, ces petits corps ardents et las, ces âmes non blasées, pas abondantes, mais vives et gourmandes de vivre. Il se sentait plein d'indulgence pour elles, à présent; et il souriait de ces minois éveillés et vannés, où il y a de la rouerie et de l'ingénuité, un désir effronté et naïf du plaisir, et, au fond, une brave petite âme, honnête et travailleuse. Et il ne se fâchait pas, quand quelques-unes lui riaient au nez, ou se poussaient du coude, en se montrant ce grand garçon, aux yeux ardents.
Il s'attardait aussi sur les quais, à rêver. C'était sa promenade de prédilection. Elle calmait un peu sa nostalgie du grand fleuve, qui avait bercé son enfance. Ah! ce n'était plus sans doute le Vater Rhein! Rien de sa force toute-puissante. Rien des larges horizons, des vastes plaines, où l'esprit plane et se perd. Une rivière aux yeux gris, à la robe vert-pâle, aux traits fins et précis, une rivière de grâce, aux souples mouvements, s'étirant avec une spirituelle nonchalance dans la parure somptueuse et sobre de sa ville, les bracelets de ses ponts, les colliers de ses monuments, et souriant à sa joliesse, comme une belle flâneuse... La délicieuse lumière de Paris! C'était la première chose que Christophe avait aimée dans cette ville; elle le pénétrait, doucement, doucement; peu à peu, elle transformait son cœur, sans qu'il s'en aperçût. Elle était pour lui la plus belle des musiques, la seule musique parisienne. Il passait des heures, le soir, le long des quais, ou dans les jardins de l'ancienne France, à savourer les harmonies du jour sur les grands arbres baignés de brume violette, sur les statues et les vases gris, sur la pierre patinée des monuments royaux, qui avait bu la lumière des siècles,—cette atmosphère subtile, faite de soleil fin et de vapeur laiteuse, où flotte, dans une poussière d'argent, l'esprit riant de la race.
Un soir, il était accoudé près du pont Saint-Michel, et, tout en regardant l'eau, il feuilletait distraitement les livres d'un bouquiniste, étalés sur le parapet. Il ouvrit au hasard un volume dépareillé de Michelet. Il avait déjà lu quelques pages de cet historien, qui ne lui avait pas trop plu par sa hâblerie française, son pouvoir de se griser de mots, et son débit trépidant. Mais, ce soir là, dès les premières lignes, il fut saisi: c'était la fin du procès de Jeanne d'Arc. Il connaissait par Schiller la Pucelle d'Orléans; mais jusqu'ici, elle n'était pour lui qu'une héroïne romanesque, à laquelle un grand poète avait prêté une vie imaginaire. Brusquement, la réalité lui apparut, et elle l'étreignit. Il lisait, il lisait, le cœur broyé par l'horreur tragique du sublime récit; et lorsqu'il arriva au moment où Jeanne apprend qu'elle va mourir le soir et où elle défaille d'effroi, ses mains se mirent à trembler, les larmes le prirent, et il dut s'interrompre. La maladie l'avait affaibli: il était devenu d'une sensibilité ridicule, qui l'exaspérait.—Quand il voulut achever sa lecture, il était tard, et le bouquiniste fermait ses caisses. Il résolut d'acheter le livre; il chercha dans ses poches: il lui restait six sous. Il n'était pas rare qu'il fût aussi dénué: il ne s'en inquiétait pas; il venait d'acheter son dîner, et il comptait, le lendemain, toucher un peu d'argent chez Hecht, pour une copie de musique. Mais attendre jusqu'au lendemain, c'était dur! Pourquoi venait-il justement de dépenser à son dîner le peu qui lui restait? Ah! s'il avait pu offrir en paiement au bouquiniste le pain et le saucisson, qu'il avait dans sa poche!
Le lendemain matin, très tôt, il alla chez Hecht, pour chercher l'argent; mais en passant près du pont, qui porte le nom de l'archange des batailles,—«le frère du paradis» de Jeanne,—il n'eut pas le courage de ne pas s'arrêter. Il retrouva le précieux volume dans les caisses du bouquiniste; il le lut en entier; il passa près de deux heures à le lire; il manqua le rendez-vous chez Hecht; et, pour le rencontrer ensuite, il dut perdre presque toute sa journée. Enfin, il réussit à avoir sa nouvelle commande et a se faire payer. Aussitôt, il courut acheter le livre. Il avait peur qu'un autre acheteur ne l'eût pris. Sans doute, le mal n'eût pas été grand: il était facile de se procurer d'autres exemplaires; mais Christophe ne savait pas si le livre était rare ou non; et d'ailleurs, c'était ce volume-là qu'il voulait, et non un autre. Ceux qui aiment les livres sont volontiers fétichistes. Les feuillets, même salis et tachés, d'où la source des rêves a jailli, sont pour eux sacrés.
Christophe relut chez lui, dans le silence de la nuit, l'Évangile de la Passion de Jeanne; et aucun respect humain ne l'obligea plus à contenir son émotion. Une tendresse, une pitié, une douleur infinie le remplissaient pour la pauvre petite bergeronnette, dans ses gros habits rouges de paysanne, grande, timide, la voix douce, rêvant au chant des cloches,—(elle les aimait comme lui)—avec son beau sourire, plein de finesse et de bonté, ses larmes toujours prêtes à couler,—larmes d'amour, larmes de pitié, larmes de faiblesse: car elle était à la fois si virile et si femme, la pure et vaillante fille, qui domptait les volontés sauvages d'une armée de bandits, et tranquillement, avec son bon sens intrépide, sa subtilité de femme, et son doux entêtement, déjouait pendant des mois, seule et trahie par tous, les menaces et les ruses hypocrites d'une meute de gens d'église et de loi,—loups et renards, aux yeux sanglants,—faisant cercle autour d'elle.
Ce qui pénétrait le plus Christophe, c'était sa bonté, sa tendresse de cœur,—pleurant après les victoires, pleurant sur les ennemis morts, sur ceux qui l'avaient insultée, les consolant quand ils étaient blessés, les aidant à mourir, sans amertume contre ceux qui la livrèrent, et, sur le bûcher même, quand les flammes s'élevaient, ne pensant pas à elle, s'inquiétant du moine qui l'exhortait, et le forçant à partir. Elle était «douce dans la plus âpre lutte, bonne parmi les mauvais, pacifique dans la guerre même. La guerre, ce triomphe du diable, elle y porta l'esprit de Dieu».
Et Christophe, faisant un retour sur lui-même, pensait:
—Je n'y ai pas assez porté l'esprit de Dieu.
Il relisait les belles paroles de l'évangéliste de Jeanne:
«Être bon, rester bon, entre les injustices des hommes et les sévérités du sort... Garder la douceur et la bienveillance parmi tant d'aigres disputes, traverser l'expérience sans lui permettre de toucher à ce trésor intérieur...»
Et il se répétait:
—J'ai péché. Je n'ai pas été bon. J'ai manqué de bienveillance. J'ai été trop sévère.—Pardon. Ne croyez pas que je sois votre ennemi, vous que je combats! Je voudrais vous faire du bien, à vous aussi... Mais il faut pourtant vous empêcher de faire le mal...
Et comme il n'était pas un saint, il lui suffisait de penser à eux pour que sa haine se réveillât. Ce qu'il leur pardonnait le moins, c'était qu'à les voir, à voir la France à travers eux, il était impossible d'imaginer qu'une telle fleur de pureté et de poésie héroïque eût pu jamais pousser de ce sol. Et pourtant, cela était. Qui pouvait dire qu'elle n'en sortirait pas encore une seconde fois? La France d'aujourd'hui ne pouvait être pire que celle de Charles VII, la nation prostituée d'où sortit la Pucelle. Le temple était vide à présent, souillé, à demi ruiné. N'importe! Dieu y avait parlé.
Christophe cherchait un Français à aimer, pour l'amour de la France.
C'était vers la fin de mars. Depuis des mois, Christophe n'avait causé avec personne, ni reçu aucune lettre, sauf de loin en loin quelques mots de la vieille maman, qui ne savait point qu'il était malade, qui ne lui disait point qu'elle était malade. Toutes ses relations avec le monde se réduisaient à ses courses au magasin de musique, pour prendre ou rapporter du travail. Il y allait à des heures où il savait que Hecht n'y était pas,—afin d'éviter de causer avec lui. Précaution superflue: car la seule fois qu'il avait rencontré Hecht, celui-ci lui avait à peine adressé quelques mots indifférents au sujet de sa santé.
Il était donc bloqué dans une prison de silence, quand, un matin, lui arriva une invitation de Mme Roussin à une soirée musicale: un quatuor fameux devait s'y faire entendre La lettre était fort aimable, et Roussin y avait ajouté quelques lignes cordiales. Il n'était pas très fier de sa brouille avec Christophe. Il l'était d'autant moins que, depuis, il s'était brouillé avec sa chanteuse et la jugeait sans ménagements. C'était un bon garçon; il n'en voulait jamais à ceux à qui il avait fait tort. Il lui eût paru ridicule que ses victimes eussent plus de susceptibilité que lui. Aussi, quand il avait plaisir à les revoir, n'hésitait-il pas à leur tendre la main.
Le premier mouvement de Christophe fut de hausser les épaules et de jurer qu'il n'irait pas. Mais à mesure que le jour du concert approchait, il était moins décidé. Il étouffait de ne plus entendre une parole humaine, ni surtout une note de musique. Il se répétait pourtant que jamais il ne remettrait les pieds chez ces gens-là. Mais, le soir venu, il y alla, tout honteux de sa lâcheté.
Il en fut mal récompensé. À peine se retrouva-t-il dans ce milieu de politiciens et de snobs qu'il fut ressaisi d'une aversion pour eux plus violente encore que naguère: car, dans ses mois de solitude, il s'était déshabitué de cette ménagerie. Impossible d'entendre de la musique ici: c'était une profanation. Christophe décida de partir, aussitôt après le premier morceau.
Il parcourait des yeux tout ce cercle de figures et de corps antipathiques. Il rencontra, à l'autre extrémité du salon, des yeux qui le regardaient et se détournèrent aussitôt. Il y avait en eux je ne sais quelle candeur qui le frappa, parmi ces regards blasés. C'étaient des yeux timides, mais clairs, précis, des yeux à la française, qui, une fois qu'ils se fixaient sur vous, vous regardaient avec une vérité absolue, qui ne cachaient rien de soi, et à qui rien de vous n'était peut-être caché. Il connaissait ces yeux. Pourtant, il ne connaissait pas la figure qu'ils éclairaient. C'était celle d'un jeune homme de vingt à vingt-cinq ans, de petite taille, un peu penché, l'air débile, le visage imberbe et souffreteux, avec des cheveux châtains, des traits irréguliers et fins, une certaine asymétrie, donnant à l'expression quelque chose, non de trouble, mais d'un peu troublé, qui n'était pas sans charme, et semblait contredire la tranquillité des yeux. Il était debout dans l'embrasure d'une porte; et personne ne faisait attention à lui. De nouveau, Christophe le regarda; et, à chaque fois, il rencontrait ces yeux, qui se détournaient timidement, avec une aimable maladresse; et à chaque fois, il les «reconnaissait»: il avait l'impression de les avoir vus déjà dans un autre visage.
Incapable de cacher ce qu'il sentait, suivant son habitude, Christophe se dirigea vers le jeune homme; mais, tout en approchant, il se demandait ce qu'il pourrait lui dire; et il s'attardait, indécis, regardant à droite et à gauche, comme s'il allait au hasard. L'autre n'en était pas dupe, et comprenait que Christophe venait à lui; il était si intimidé, à la pensée de lui parler, qu'il songeait à passer dans la pièce voisine; mais il était doué sur place par sa gaucherie même. Ils se trouvèrent l'un en face de l'autre. Il se passa quelques moments avant qu'ils réussissent à trouver une entrée en matière. À mesure que la situation se prolongeait, chacun d'eux se croyait ridicule aux yeux de l'autre. Enfin, Christophe regarda en face le jeune homme, et, sans autre préambule, lui dit en souriant, sur un ton bourru:
—Vous n'êtes pas Parisien?
À cette question inattendue, le jeune homme sourit, malgré sa gêne, et répondit que non. Sa voix faible et d'une sonorité voilée était comme un instrument fragile.
—Je m'en doutais, fit Christophe.
Et, comme il le vit un peu confus de cette singulière remarque, il ajouta:
—Ce n'est pas un reproche.
Mais la gêne de l'autre ne fit qu'en augmenter.
Il y eut un nouveau silence. Le jeune homme faisait des efforts pour parler; ses lèvres tremblaient; on sentait qu'il avait une phrase toute prête à dire, mais qu'il ne pouvait se décider à la prononcer. Christophe étudiait avec curiosité ce visage mobile, où l'on voyait passer de petits frémissements sous la peau transparente; il ne semblait pas de la même essence que ceux qui l'entouraient dans ce salon, des faces massives, de lourde matière, qui n'étaient qu'un prolongement du cou, un morceau du corps. Ici, l'âme affleurait à la surface; il y avait une vie morale dans chaque parcelle de chair.
Il ne réussissait pas à parler. Christophe, bonhomme, continua:
—Que faites-vous ici, au milieu de ces êtres?
Il parlait tout haut, avec cette étrange liberté, qui le faisait haïr. Le jeune homme, gêné, ne put s'empêcher de regarder autour d'eux si on ne les entendait pas; et ce mouvement déplut à Christophe. Puis, au lieu de répondre, il demanda, avec un sourire gauche et gentil:
—Et vous?
Christophe se mit à rire, de son rire un peu lourd.
—Oui. Et moi? fit-il, de bonne humeur.
Le jeune homme se décida brusquement:
—Comme j'aime votre musique! dit-il, d'une voix étranglée.
Puis, il s'arrêta, faisant de nouveaux et inutiles efforts pour vaincre sa timidité. Il rougissait; il le sentait; et sa rougeur en augmentait, gagnait les tempes et les oreilles. Christophe le regardait en souriant, et il avait envie de l'embrasser. Le jeune homme leva des yeux découragés vers lui.
—Non, décidément, dit-il; je ne puis pas, je ne puis pas parler de cela... pas ici...
Christophe lui prit la main, avec un rire muet de sa large bouche fermée. Il sentit les doigts maigres de l'inconnu trembler légèrement contre sa paume, et l'étreindre avec une tendresse involontaire; et le jeune homme sentit la robuste main de Christophe qui lui écrasait affectueusement la main. Le bruit du salon disparut autour d'eux. Ils étaient seuls ensemble, et ils comprirent qu'ils étaient amis.
Ce ne fut qu'une seconde, après laquelle Mme Roussin, touchant légèrement le bras de Christophe avec son éventail, lui dit:
—Je vois que vous avez fait connaissance, et qu'il est inutile de vous présenter. Ce grand garçon est venu pour vous, ce soir.
Alors, ils s'écartèrent l'un de l'autre, avec un peu de gêne.
Christophe demanda à Mme Roussin:
—Qui est-ce?
—Comment! fit-elle, vous ne le connaissez pas? C'est un petit poète, qui écrit gentiment. Un de vos admirateurs. Il est bon musicien, et joue bien du piano. Il ne fait pas bon vous discuter devant lui: il est amoureux de vous. L'autre jour, il a failli avoir une altercation, à votre sujet, avec Lucien Lévy-Cœur.
—Ah! le brave garçon! dit Christophe.
—Oui, je sais, vous êtes injuste pour ce pauvre Lucien. Cependant, il vous aime aussi.
—Ah! ne me dites pas cela! Je me haïrais.
—Je vous assure.
—Jamais! Jamais! Je le lui défends.
—Juste ce qu'a fait votre amoureux. Vous êtes aussi fous l'un que l'autre. Lucien était en train de nous expliquer une de vos œuvres. Ce petit timide que vous venez de voir s'est levé, tremblant de colère, et lui a défendu de parler de vous. Voyez-vous cette prétention!... Heureusement que j'étais là. J'ai pris le parti de rire; Lucien a fait comme moi; et l'autre s'est tu, tout confits; et il a fini par faire des excuses.
—Pauvre petit! dit Christophe.
Il était ému.
—Où est-il passé? continuait-il, sans écouter Mme Roussin, qui lui parlait d'autre chose.
Il se mit à sa recherche. Mais l'ami inconnu avait disparu. Christophe revint vers Mme Roussin:
—Dites-moi comment il se nomme.
—Qui? demanda-t-elle.
—Celui dont vous m'avez parlé.
—Votre petit poète? dit-elle. Il se nomme Olivier Jeannin.
L'écho de ce nom tinta aux oreilles de Christophe comme une musique connue. Une silhouette de jeune fille flotta, une seconde, au fond de ses yeux. Mais la nouvelle image, l'image de l'ami l'effaça aussitôt.
Christophe rentrait chez lui. Il marchait dans les rues de Paris, au milieu de la foule. Il ne voyait, il n'entendait rien, il avait les sens fermés à tout ce qui l'entourait. Il était comme un lac, séparé du reste du monde par un cirque de montagnes. Nul souffle, nul bruit, nul trouble. La paix. Il se répétait:
—J'ai un ami.
FIN DU DEUXIÈME VOLUME
LA RÉVOLTE
LA FOIRE SUR LA PLACE