
L'image de couverture a été réalisée pour cette édition électronique.
Elle appartient au domaine public.

L'image de couverture a été réalisée pour cette édition électronique.
Elle appartient au domaine public.
ESTIENNE DOLET
Tiré à 500 exemplaires:
| 50 | sur papier vergé; |
| 4 | sur papier de couleur; |
| 446 | sur papier vélin. |
Tous droits réservés.

ÉTUDES SUR LE SEIZIÈME SIÈCLE
SA VIE
SES ŒUVRES, SON MARTYRE
PAR JOSEPH BOULMIER

PARIS
AUGUSTE AUBRY
L’UN DES LIBRAIRES DE LA SOCIETE DES BIBLIOPHILES FRANÇOIS
RUE DAUPHINE, No 16
M.DCCC.LVII
Agréez, Monsieur, le faible mais juste hommage de mon travail sur Dolet. C’est une dédicace qui vous revient de droit. L’homme étrange et remarquable dont je me suis fait, en quelque sorte, le contemporain par une étude assidue de dix années, cet homme-là, sans parler de sa réputation comme savant, compte au premier rang parmi les gloires typographiques de ce grand seizième siècle que, vous aussi, vous savez aimer, admirer et comprendre. A ce double titre d’érudit sachant écrire et d’imprimeur dévoué à son art, il peut donc vous tendre la main avec confiance, à vous, Monsieur, qui, par un privilége héréditaire, continuez si dignement les doctes traditions des Sébastien Gryphius, des Simon de Colines, et de cette admirable dynastie des Estienne, dont vous avez pu, mieux que personne, nous retracer l’histoire et les travaux.
JOSEPH BOULMIER.
Paris, le 15 septembre 1857.
«Ce n’est pas assis sur la plume, ou couché sur la soie, qu’on arrive à la gloire. Qui sans elle dissipe sa vie, laisse derrière lui moins de trace que la fumée dans l’air, et l’écume sur l’eau.»
Dante, Enfer, chant XXVI, v. 47-51.


Transportons-nous par la pensée en plein seizième siècle, en pleine renaissance grecque et latine; à cette époque d’enthousiasme, je dirais presque de fanatisme antique... Mais le fanatisme semble permis, quand la religion est si belle!
Nous sommes à Lyon. La voix multiple et confuse de la grande ville ne se fait plus entendre depuis longtemps, et minuit vibre seul aux tours imposantes de la vieille cathédrale Saint-Jean.
[p. X] Remarquez-vous, au-dessus de ce quai sombre qui longe la Saône, une large et haute fenêtre, la seule qui soit encore éclairée à travers ses vitres en losange?
Que peut faire soupçonner, à l’intérieur, cette clarté mystérieuse?
Un fils malade sur qui veille en ce moment l’infatigable tendresse d’une mère? Un agonisant au chevet duquel une ou deux vieilles femmes, avec leurs voix pieuses et somnolentes, murmurent lentement les prières des morts? Ou bien, peut-être, un sombre alchimiste épiant, avec une anxiété fiévreuse, l’apparition de l’or au fond de son creuset?
Oui, justement, c’est un alchimiste; mais non pas de l’espèce vulgaire des souffleurs. C’est un de ceux qui peuvent dire avec Perse:
Il n’a d’autre creuset qu’un robuste cerveau de penseur; et la science, l’auguste science, voilà tout l’or de ses rêves.
Pénétrons dans ce calme sanctuaire du travail. A peine entré, voici déjà qu’on respire comme un parfum studieux, comme une suave odeur de recueillement et de méditation. Jetons les yeux sur cet ameublement, d’une sévérité claustrale: d’abord, une table énorme, solidement appuyée sur de massifs pieds de chêne; au centre de cette table, à l’instar du [p. XI] feu sacré sur le trépied delphique, la vieille lampe des nuits dont la flamme ondule, fumeuse et noirâtre, et dont les reflets concentriques vont s’élargir et trembloter au plafond noirci. Cinq ou six chaises de bois, aux sculptures gothiques; des livres, partout des livres; quelques-uns ouverts çà et là sur la table, d’autres s’égarant pêle-mêle sur les siéges, ceux-là parsemant au hasard les carreaux; le plus grand nombre, enfin, garnissant les rayons d’une bibliothèque.
Comme partie saillante du tableau, figurez-vous maintenant un homme, assis devant la table et courbé, pour ne pas dire ployé de tout son corps sur une besogne absorbante. On pourrait le croire, de prime abord, non moins immobile que ses livres, non moins inerte que ses meubles, si le frôlement sec de sa plume, courant et criant sur le parchemin, si le mouvement brusque avec lequel, de temps en temps, il se rejette sur un in-folio pour le feuilleter, ne révélait bien vite un être vivant... un être vivant, dans le plus noble exercice de la vie, je veux dire dans le travail de la pensée.
Une calvitie précoce a dénudé presque toute la partie antérieure de son crâne[3]; son front vaste est labouré de rides; l’action, ou plutôt, si j’ose m’exprimer ainsi, l’ébullition silencieuse de l’intelligence, qui fait vivre l’âme en tuant le corps, voilà ce qui s’annonce en profonds stigmates sur cette austère et puissante figure. Ajoutez à cela, pour compléter la ressemblance, une pâleur bilieuse, une teinte de [p. XII] médaille romaine, que l’habitude des veilles a répandue sur ces traits fortement accentués; d’épais sourcils; un regard d’aigle, dont souvent l’étincelle s’allume au vol d’une pensée rapide; enfin, glissant parfois sur les lèvres, ce mince et caustique sourire que reproduira plus tard la bouche de Voltaire. Vous aurez alors un portrait à peu près fidèle de l’homme que je vais mettre en scène.
Cet homme a nom Estienne Dolet, d’Orléans, Stephanus Doletus Aurelius; et il appartient à l’immortelle phalange du SEIZIÈME SIÈCLE.
Ah! certes, je l’ai toujours aimé, ce siècle des géants!
Grands hommes, grandes choses; de l’énergie et du calme, de la science et de l’action, de la pensée et de la vie.
En d’autres termes, de l’encre à flots sur le papier; mais aussi, du sang à flots hors des veines, pour engraisser les sillons de l’avenir.
«Ma vie est un combat», disaient après Job, Voltaire et Beaumarchais. Dolet et ses compagnons d’armes auraient eu, cent fois plus encore, le droit de parler ainsi.
Véritablement, il n’y a rien de plus beau, dans l’histoire, que ces luttes héroïques de la plume et de l’épée, de l’âme et du bras, de la tête et du cœur, au service d’une conviction généreuse, et sous l’invincible drapeau du progrès. Lorsque Arouet, cet Attila du sarcasme, envahissait avec son armée d’encyclopédistes tout un Bas-Empire social et religieux, mille rencontres particulières atténuaient déjà la résistance et diminuaient le péril. Au pis aller, le téméraire en était quitte pour quelques mois de Bastille. Mais, du temps [p. XIII] de notre Orléanais, c’était bien autre chose: il y allait de la corde ou du bûcher; l’homme se dressait presque seul contre tout son siècle. Duel magnifique!
Certes, s’il y a des époques où il fait bon vivre, il y en a d’autres, en revanche, où il fait beau mourir!
C’est à l’une de ces dernières qu’Estienne Dolet, l’imprimeur, eut le privilége de combattre, au nom de l’intelligence humaine, et la gloire de triompher par le martyre, sur le bûcher de la place Maubert.
Sublime époque, en effet! Cinquante ans à peine s’étaient écoulés, depuis qu’au Fiat lux de Guttemberg, la liberté, cette lumière des âmes, avait inondé les peuples d’une soudaine irradiation; et déjà, de toutes parts, le moyen âge était chassé par l’ère moderne, le chaos faisait place au monde!
Combat de la renaissance contre la routine, de la liberté contre la tradition, de l’idéalité du droit contre la brutalité du fait, voilà le seizième siècle. Il dure encore!
J’ai voulu l’exhumer du répertoire éternel, ce grand drame, dont la Providence développait alors les premières scènes; et j’ai choisi Dolet comme le héros de la pièce, parce qu’il est, selon moi, le type le plus vigoureux, la personnification la plus complète, et, pour ainsi dire, l’incarnation, le verbe de cette grande époque.
C’est le Christ de la pensée libre!
Qu’on ne s’attende point à trouver ici de l’histoire impartiale, autrement dit, impassible; une espèce de procès-verbal, sans parti pris et sans âme, où les faits s’alignent, [p. XIV] froids et cadavéreux, comme une rangée de squelettes dans un caveau. Je ne suis pas un greffier: je suis un avocat, et Dolet est mon client.
Bien plus, je vais, dès à présent, l’avouer avec franchise: Dolet est mon homme, pour parler la bonne langue du peuple; j’épouse toutes ses haines, je m’enfièvre de toutes ses colères, je m’exalte de tous ses enthousiasmes. Enfin c’est mon ami, ce vieux mort... et je lui tends la main par dessus trois siècles.
A ceux qui consentiront à parcourir ces pages, plus d’une fois, sans doute, elles remettront en mémoire cet immortel passage des Provinciales, qu’ils doivent savoir par cœur aussi bien que moi:
«C’est une étrange et longue guerre, que celle où la violence essaie d’opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, et ne servent qu’à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence, et ne font que l’irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre; quand on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n’ont que la vanité et le mensonge: mais la violence et la vérité ne peuvent rien l’une sur l’autre. Qu’on ne prétende pas de là, néanmoins, que les choses soient égales: car il y a cette extrême différence, que la violence n’a qu’un cours borné par l’ordre de Dieu, qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu’elle attaque; au lieu que la vérité subsiste éternellement, et triomphe enfin de ses [p. XV] ennemis, parce qu’elle est éternelle et puissante comme Dieu même[4].»
Pascal a raison. Cette guerre de la force et de la justice, de l’erreur et de la vérité, ressemble, dans la genèse humanitaire, à l’antagonisme du bien et du mal, dans le système cosmologique des mages.
Elle est vieille comme le monde, opiniâtre comme la haine, terrible comme le désespoir; elle lasse parfois le bras du fort, elle angoisse le cœur du brave. Mais elle finira, tôt ou tard, par le triomphe d’Ormuzd sur Ahriman.
[1] Proœmium, προοίμιον, avant-route (πρὸ, avant; οἶμος, route.) Ce mot expressif, particulier au seizième siècle, et, comme tant d’autres, puisé par lui dans la source antique, m’a semblé parfaitement à sa place, au début de la pénible carrière que je me propose de parcourir. Préambule, préface, avant-propos, introduction, etc., n’auraient pas rendu mon idée avec la même justesse et la même énergie. C’est qu’en effet, avant de me mettre en route à la suite de mon héros, j’ai eu besoin de rassembler toutes mes forces et de me stimuler moi-même, en évoquant le spectre de la grande époque dont je vais retracer l’épisode littéraire le plus dramatique et le plus émouvant.
[2] Sat. V, v. 62.
[3] Voir plus loin, ch. VII, p. 113.
[4] Douzième Provinciale, dernier alinéa.


ESTIENNE DOLET
Naissance de Dolet. — Ses premières années. — Son éducation.

Le plus énergique représentant de la renaissance intellectuelle en France, au seizième siècle, Estienne Dolet, l’imprimeur, l’humaniste, le cicéronien, naquit à Orléans en 1509, et peut-être le 3 août, suivant une hypothèse que je vais hasarder tout à l’heure. Par une étonnante coïncidence, nous le verrons mourir à Paris le même jour, trente-sept ans plus tard, sur la place Maubert.
Il n’existe aucun doute sur l’année précise de sa naissance: lui-même a pris soin de nous en instruire, dans une lettre-préface, datée du 22 avril 1536, qu’il adresse au célèbre helléniste Budé (Stephanus Doletus Gulielmo Budæo salutem), en tête du premier volume de ses Commentaires sur la langue latine. Dolet nous [p. 2] apprend, dès la première ligne, qu’il avait alors VINGT-SEPT ANS (ad septimum et vigesimum annum ætate jam provecta mea); et, plus loin, nous lisons qu’il en avait SEIZE, lorsque François Ier tomba au pouvoir des impériaux, à la bataille de Pavie, le 24 février 1525.
Quant au jour authentique où le héros de la pensée, en surgissant à l’existence, entra par cela même dans la douleur et la lutte, nul biographe, que je sache encore, n’a pris soin de relever une date si considérable. J’ai voulu, naturellement, combler cette lacune dans l’histoire d’une vie où tout intéresse, et, faute de mieux, voici ce que j’ai trouvé:
Le Laboureur, qui, dans ses Additions aux Mémoires de Castelnau[5], nous a conservé plusieurs poésies de l’époque relatives au supplice de Dolet, cite, entre autres, une pièce de vers latins de Théodore de Bèze, au bas de laquelle se lit la phrase suivante, probablement du même auteur: Stephanus Doletus, Aurelius, Gallus, die sancto Stephano sacro, et NATUS et Vulcano devotus, in Malbertina area, Lutetiæ, 3 augusti 1546. «Estienne Dolet, d’Orléans, né le jour de la fête de saint Estienne, livré au feu le même jour, à Paris, en place Maubert, le 3 août 1546.»
Ce témoignage formel d’un ami et d’un contemporain m’a paru suffisant pour déterminer, ainsi que je l’ai fait, et sans préjudice des renseignements ultérieurs qui pourront m’échoir, le jour sacré pour toute âme libre, pour tout zélateur du progrès et de [p. 3] la science, où notre Dolet fit son apparition dans la vie, et, plus tard, son apparition devant Dieu.
C’est lui-même, comme nous l’avons vu précédemment, qui nous fixe l’année de sa naissance, et par un soin pieux dont nous devons le remercier, c’est encore lui qui nous apprend le nom de sa ville natale. Dans une épître au cardinal de Tournon, qui se trouve au livre II, p. 61 de ses Carmina, publiés en 1538, et sortis de ses belles presses, voici comment il s’exprime:
«Incontinent, nous nous livrons au vaste courant de la Loire, qui m’entraîne vers une ville, une ville autrefois célèbre, Orléans. Berceau de mon enfance, je te reconnais et je couvre de baisers les autels de la patrie.»
Sa famille[6], honnête mais pauvre, comme presque [p. 4] toute la bourgeoisie de cette époque, ne put guère lui léguer d’autre patrimoine qu’un nom sans tache, un nom plébéien; et le silence obstiné qu’il garde sur ses parents ferait même croire, ou qu’il les perdit de bonne heure, ou qu’à un certain âge il en fut complètement abandonné. Voilà pourquoi, sans doute, nous le verrons achever presque toutes ses études aux frais de quelques hauts et puissants protecteurs, ou plutôt, s’il faut le dire, aux dépens de leur auguste charité.
Plus d’une fois, assurément, sa position demi-servile auprès de ces hautains Mécènes lui fit répéter la sombre exclamation de l’exilé florentin:
«Qu’il est amer, le pain de l’étranger; et qu’il est dur à gravir et à descendre, l’escalier d’autrui!»
Une âme aussi fière, aussi réluctante à toute espèce de joug, devait, j’imagine, se plier difficilement à l’obséquieuse humblesse, à la basse reptilité que les patriciens de tous les temps semblent exiger, à titre de reconnaissance, des pauvres diables de la plèbe que leur main puissante a bien voulu tirer du néant social. Mais il y avait, dans le noble cœur de notre Estienne, une passion plus forte encore que la soif de l’indépendance personnelle: c’était l’amour de la [p. 5] science. Aussi, pendant les plus belles années de sa jeunesse, se résigna-t-il à l’acquérir à tout prix, cette science tant aimée... en d’autres termes, à l’arracher comme on arrache une aumône!
Quant au mutisme absolu de Dolet à l’endroit de sa famille, il a été largement suppléé par d’officieux généalogistes, qui ont imaginé pour notre héros une naissance des plus originales. A les entendre, il était fils naturel de François Ier. Bayle, qui mentionne ce petit conte de fées, en refusant d’y croire, bien entendu (Maittaire et le Duchat ont eu le bon sens de suivre cet exemple), Bayle, dis-je, cite en marge à ce propos le Patiniana, p. 22, édition de Paris. Les lecteurs curieux de semblables anecdotes, pourront encore trouver cette fable dans les Mémoires historiques, politiques et littéraires, d’Amelot de la Houssaye, t. II, p. 233. Au surplus, pour leur éviter la peine de la chercher jusque-là, voici les propres paroles de cet écrivain:
«On disoit en ce temps-là (et je connois des gens qui le disent encore) qu’il étoit fils naturel du roi François Ier et d’une Orléanoise nommée Cureau; et qu’il ne fut point reconnu, à cause du commerce que l’on dit au roi que cette demoiselle avoit eu avec un seigneur de la cour.»
Tout cela est charmant d’imagination, et ce serait une bonne fortune pour un romancier; mais ce n’est fondé, par malheur pour le biographe, sur aucune vraisemblance historique. D’abord, l’écrivain que je viens de citer suppose que François Ier était déjà roi lorsque Dolet naquit; première erreur, car Dolet [p. 6] naquit en 1509 et François Ier ne monta sur le trône qu’en 1515. Ensuite, l’auguste Valois, né en 1494, comme chacun sait, n’aurait eu, dans l’hypothèse qui nous occupe, que quinze ans lors de la naissance de Dolet, ce qui constitue une paternité bien précoce... même pour un prince. L’histoire s’est déjà montrée assez libérale envers François Ier, quand elle a cru devoir le gratifier du surnom de Père des lettres: il est inutile d’en faire encore le père des littérateurs.
Quoi qu’il en soit, après avoir puisé dans sa ville natale, jusqu’à l’âge de douze ans, les éléments d’une robuste éducation du seizième siècle, le jeune Orléanais vint à Paris[8], centre intellectuel, foyer de la pensée française, alors comme à présent.
C’était en l’an de grâce 1521. Tout d’abord l’enfant s’enthousiasma de Cicéron[9]; et ce docte fanatisme [p. 7] ne fit que s’accroître, plus tard, avec les progrès du laborieux étudiant. Bientôt, en effet, l’admiration fit place à l’amour, à un véritable amour... Dolet fut avare et jaloux; il eut tout l’égoïsme de la possession. Marcus Tullius devint son bien, son trésor, sa maîtresse; il l’enferma tout entier dans sa mémoire, il le réchauffa chaque jour dans son cœur. Grande et sainte passion que nous ne pouvons plus comprendre, nous autres beaux fils, enfants d’un siècle frivole, descendants bâtards de ces sublimes ouvriers de la science, dont toutes les journées de travail comptaient quatorze heures, et qui souvent, au bout de leur tâche, ne recevaient d’autre salaire que la persécution et la mort! Nous avons oublié, pour longtemps peut-être, que le bien dire a pour corollaires le bien penser, le bien vivre, le bien mourir!
En 1525, assidu disciple, notre Estienne suivait à Paris le cours d’éloquence latine de Nicolas Bérauld[10] et bientôt après, en 1526, il prenait son [p. 8] essor vers l’Italie, vers la terre sainte où se dirigent, dans un éternel pèlerinage, les poëtes et les savants, les artistes et les penseurs.
Qu’allait-il faire, dans ce pays classique du beau? Dolet, sans doute, n’était point étranger aux divines jouissances de l’art; et ce qui le prouve, c’est son goût pour la musique, dont je parlerai dans l’occasion[11]. Mais les chefs-d’œuvre plastiques des grands maîtres, bronzes, marbres ou toiles, n’étaient pas, il faut en convenir, ce qui l’attirait avec le plus de force. Non moins altéré que le cerf des psaumes, qui s’élance haletant vers l’eau fraîche des fontaines:
Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, etc.[12],
l’avide étudiant courait vers l’Italie, comme à la source de l’antique savoir. Pour Dolet, avant d’être la patrie de Raphaël, l’Italie était la terre natale de Cicéron.
[5] Paris, 1659, in-fol., t. I, p. 356.
[6] «J’ignore, dit en note Née de la Rochelle, p. 2 de sa Vie de Dolet, quel degré de parenté il y avoit entre notre imprimeur et Matthieu Dolet, clerc ou plutôt commis du greffe criminel du parlement de Paris. Suivant le continuateur de Nicole Gilles, t. II de ses Annales, feuillet 128 verso (Paris, Oudin Petit, 1551, in-fol.), ce Matthieu Dolet avoit lu devant le peuple les lettres de grâce accordées par François Ier à Jean de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint-Vallier, qui avoit été condamné à avoir la tête tranchée, le 17 février 1523, vieux style. Le 16 août 1603, un Léon Dolet, avocat, fut élu échevin de Paris. Voyez les Antiquités de Paris, par Malingre, 1640, in-fol., p. 690. Un Jacques Dolet, aussi avocat, posséda la même dignité, le 16 août 1623. Ibid., p. 692.»
[7] Dante, Paradiso, XVII, v. 58-60.
[8] Genabi duodecim annos liberaliter educatum exepit Parisiorum Lutetia, ubi primarum litterarum rudimenta posui.
«Au sortir d’Orléans, où j’avais reçu jusqu’à ma douzième année une éducation libérale, Paris m’accueillit dans son sein, et c’est là que je commençai mon initiation littéraire.»
(Orat. sec. in Thol., p. 105.)
Et ailleurs (Comment., t. I, col. 938):
Genabum, præclarum Galliæ oppidum, in quo et natus, et ad duodecimum annum adolescens educatus sum, Ligerim fluvium tangit.
«Orléans, célèbre ville de France, dans laquelle j’ai reçu le jour, et dans laquelle, enfant, j’ai poussé mon éducation jusqu’à ma douzième année, est baignée par les eaux de la Loire.»
[9] Tum artibus omnibus quibus ætas puerilis ad humanitatem informari solet, operam diligenter dedi, politioribusque disciplinis memetipsum quinquennio excolui, Ciceronis lectioni interim semper deditus.
«Ensuite, j’appliquai mon zèle à tous les exercices qui développent la pensée du jeune âge; pendant cinq ans, je cultivai mon intelligence par l’étude, et je m’adonnai dès lors assidûment à la lecture de Cicéron.»
(Orat. sec. in Thol., p. 105.)
[10] Nicolaus Beraldus, quo præceptore, annos natus sedecim, rhetorica Lutetiæ didici.
«Nicolas Bérauld, sous la direction duquel, à l’âge de seize ans, j’ai appris la rhétorique à Paris.»
(Comment. sur la langue lat., t. I, col. 1157.)
Nicolas Bérauld naquit à Orléans en 1473, et mourut en 1550. Comme on le voit, le maître survécut à l’élève. Bérauld fut aussi précepteur du cardinal Odet de Coligny, de l’amiral son frère, et de Châtillon. Erasme, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, reconnaît, par de chaleureux éloges, l’hospitalité courtoise avec laquelle il fut accueilli de Bérauld, lorsqu’il passa en 1500 par Orléans, pour se rendre en Italie.
[12] Psalm. XLI, v. 1.


Son séjour en Italie. — Simon de Villeneuve. — Jean du Bellay-Langey. — Amours avec une Vénitienne. — Son talent comme poëte latin. — Opinion de Buchanan et de Scaliger à cet égard.

Le jeune humaniste s’arrêta trois ans à Padoue; pendant ces trois années il travailla, comme on travaillait alors, je veux dire en doublant les jours par les nuits. Bientôt ses progrès furent immenses, grâce à la direction savante de Simon de Villeneuve[13], avec lequel il contracta dès lors l’amitié la plus étroite. Il composa même, en l’honneur de ce maître chéri, plusieurs poésies latines, entre autres la pièce 33, qu’il lui adresse au IIe livre de ses Carmina, p. 89. Il eut la douleur de le perdre en 1530, et cette cruelle circonstance lui dicta encore trois pièces de vers, qui font partie du même recueil, p. 154 et suivantes. Je vais citer et traduire la première de ces pièces; elle prouvera que notre caustique [p. 10] savant avait du cœur au milieu de sa science, et c’est assez rare pour qu’on le remarque en passant:
«O toi, qu’une vie toute de probité, toute de candeur, avait fait mon ami; toi qui m’étais lié d’une chaîne indissoluble, et que la Fortune, dans un de ses jours de clémence, m’avait donné pour frère; compagnon qu’une mort cruelle m’enlève, eh quoi! te voilà plongé dans une éternité de sommeil, dans un abîme de ténèbres! C’est donc en vain qu’à présent je te consacre mes tristes vers: ce chant de ma tendresse te trouvera sourd, peut-être; mais, dans un devoir, il n’y a pas de honte à pécher par excès. Adieu, cher!... toi que j’aimais uniquement, que j’aimais plus que mes yeux, et que cet amour m’ordonne d’aimer toujours davantage. Que tes nuits [p. 11] soient tranquilles, que ton sommeil soit calme; jouis d’un silence éternel, d’un éternel bonheur. Et, si les ombres conservent un peu de sentiment, ne méprise pas ma prière: aime qui, en retour, t’aimera sans fin.»
Ce touchant hommage ne suffisait point encore à la piété filiale de notre Estienne; il fit à son cher Villeneuve l’épitaphe suivante, qui fut, par ses soins, gravée sur une table de bronze. Je la transcris, dans sa teneur exacte, en l’accompagnant aussi d’une traduction:
«Salut, voyageur, et détourne un peu ton attention sur cette tombe. Ce que vous autres mortels regardez comme un malheur, mourir jeune, je le regarde, moi, comme le bonheur suprême. Félicite-moi donc d’être mort, et abstiens-toi de me plaindre; car, par la mort, j’ai cessé d’être mortel. Adieu, et souhaite-moi un bon repos.»
On sent déjà dans ces quelques lignes, mornes et glaciales comme le bronze qu’elles couvraient, cet incurable dégoût du monde, cet amer mépris de la vie, cette sombre et froide aspiration vers le repos [p. 12] du néant, qui forme un des traits distinctifs du caractère de ce malheureux Dolet, et dont nous retrouverons plus d’une fois l’expression navrante dans ses poésies latines et dans son Second Enfer.
Comme on le voit, la mort de Villeneuve l’affecta profondément... Ah! c’est que l’absence éternelle du seul être que l’on aimât au monde laisse autour du cœur un vide bien affreux!... L’aspect, sans cesse présent, des lieux mêmes où l’on a vécu deux dans un, où l’on a senti, pensé, travaillé ensemble, fait de la douleur une plaie toujours vive, toujours saignante.
Ne pouvant plus vivre d’une vie semblable, Dolet songea sérieusement à quitter Padoue et l’Italie, pour rentrer en France. Mais, cédant aux amicales instances de Jean du Bellay-Langey[15], alors chargé d’une [p. 13] mission politique à Venise, il consentit à rester dans cette dernière ville en qualité de secrétaire de l’ambassadeur. Là, pendant toute une année, l’infatigable travailleur suivit les leçons de Battista Egnazio[16], qui expliquait à ses nombreux auditeurs le de Officiis, de Cicéron, et le fameux poëme de Lucrèce de Rerum natura.
Il prit aussi, vers la même époque, des leçons d’un autre genre, et, puisqu’il faut l’avouer, d’une nature très-peu cicéronienne.
«Un jour, dit Athanase Christopoulo[17], l’Anacréon de la Grèce moderne, un jour qu’à la sortie de l’école, je retournais au logis vers l’heure du dîner, mon livre à la main et d’un pas fort lent, je rencontre Amour qui me dit:—Quelle espèce de leçon étudies-tu?—Maître, j’étudie l’art poétique; je l’étudie avec beaucoup de peine, voilà trois ans entiers, [p. 14] et je ne sais pas encore former un seul hémistiche.—Hé, mon cher! c’est la faute de ton maître, qui ne suit pas la vraie méthode. Viens avec moi, et je t’enseignerai tous les secrets de l’art en moins d’un instant. Toutefois, avant de commencer mes leçons, j’exige de ta part une récompense: laisse-moi prendre un doux baiser sur tes lèvres, afin que nous devenions bons amis.—Voici ma bouche, ô mon maître! baise-la autant que tu voudras. Aussitôt il me saisit, prend le salaire convenu, couvre ma bouche de baisers... et je deviens son poëte.»
Même chose advint à notre Estienne. Il fit rencontre du malin dieu d’amour, au sortir d’une des plus graves leçons d’Egnazio. En d’autres termes, au beau milieu de ses labeurs d’humaniste, il sut trouver le temps de s’enamourer d’une jeune Vénitienne, qui portait le doux et traître nom d’Eléna[18], et qui inspira plus d’une fois la verve latine du jeune savant.
A la mort de cette maîtresse adorée, notre homme se consola comme tous les poëtes... par des vers. Il consacra, en effet, à la giovinetta trois pièces qui forment la 40e, la 41e et la 42e du Ier livre de ses poésies latines.
«O ma muse, s’écrie-t-il dans la première, celle qui naguère t’encourageait avec tant de grâce à la douce élégie amoureuse, lorsque je sentais mon pauvre cœur se fondre tout entier au feu pénétrant [p. 15] de Vénus; cette belle Eléna, mes délices, mes amours... eh bien! devenue la proie du sombre Averne, elle maudit désormais l’impudique élégie qui retrace, dans ses brûlantes peintures, les jeux folâtres des amants; elle m’en demande une autre, plus décente, et dont les yeux soient baignés de larmes...»
La dernière pièce est une épitaphe, que l’abbé Goujet a trouvée très-profane, et qui n’est, selon moi, que bizarre, prétentieuse et dénuée, par malheur, de tout sentiment vrai. Au surplus, je vais mettre le lecteur à même d’en juger:
«Pourquoi t’étonner, passant, de voir s’enfler ma tombe? Seule, dis-tu, je ne puis produire ce résultat? [p. 16] Voici de quoi t’émerveiller davantage: celle qu’enferme ce tombeau, même après la blessure que la mort lui a faite, a doublé son âme. J’ai payé, je l’avoue, mon tribut à la nature, et j’ai succombé sous l’atteinte du trépas: il est constant que chacun doit périr un jour ou l’autre. Mais il ne faut pas t’étonner que mon sépulcre s’enfle, et qu’après la blessure de la mort, j’aie deux âmes au lieu d’une. Car l’amant qui brûlait pour moi, cette part de mon âme, ma vie, pour mieux dire... eh bien! il est là, confondu avec moi. Cette âme que l’affreuse mort a voulu me ravir, il la recueille dans la sienne. Et non-seulement il la conserve, mais il veut la rendre à sa primitive lumière; il veut, enfin, me relever de la tombe et me rouvrir ses bras. A ce noble effort, mon tombeau surgit d’orgueil, et, comme tu le vois, s’enfle d’une manière surnaturelle.»
Je ne découvre qu’une chose à retenir dans toute cette prosopopée tumulaire: Hic mecum certe est! «Il est là, confondu avec moi!» Ce trait me rappelle les vers de Ronsard:
Ou ceux de Millevoye:
Il n’est guère possible, en l’absence de tout renseignement positif, de se représenter au juste, caractère et figure, cette mystérieuse ondine de l’Adriatique. Je puis seulement, pour contenter un peu la curiosité de mes lecteurs, mettre sous leurs yeux certaine peinture catullienne que notre Estienne adresse à son ami Vulteius[22], au sujet de la maîtresse qu’il lui faudrait. Une induction assez naturelle nous permettra peut-être d’en conclure que la jeune Vénitienne remplissait les conditions exigées. Écoutons parler cet original de Dolet:
[p. 18] «Une maîtresse?... oui... j’en veux une: mais pas trop belle, de peur que sa beauté ne remue la lubricité des galants. Pourtant, je la veux assez belle, pour que son aspect hideux, son visage noir et difforme, ne me fassent pas fuir à tous les diables. Je la veux, en outre, pleine d’amabilité, charmante dans la conversation, folâtre dans le tête-à-tête, réservée hors de là. Qu’elle soit faite au moule de mon caractère; qu’elle veuille ce que je voudrai, et ne veuille pas ce que je ne voudrai pas non plus. Douce Vénus, accorde-moi une maîtresse dans ce genre-là, et je serai content.»
Maître Estienne n’était pas dégoûté, comme on voit. Au surplus, tout cela nous prouve que, payant tribut à jeunesse, il trempa d’abord ses lèvres dans la coupe de Circé, pour parler le style de son temps. Mais son âme était trop altérée d’infini, pour étancher sa soif à cette source impure; et puis, il avait un coup d’œil trop perçant, pour ne pas découvrir bientôt la lie au fond du vase. Pareil à l’Hercule antique, il se trouva placé, un beau jour, entre la double sollicitation de la volupté et de la vertu[24], de Vénus l’enchanteresse et de Minerve la sainte. Il prit le parti des héros, il se décida pour Minerve. Dès lors, il ne rechercha plus d’autres faveurs que celles de la science, cette austère maîtresse, toujours belle, toujours jeune, toujours fidèle. Il exprime lui-même, avec son énergie coutumière, la ferveur de sa [p. 19] conversion, dans une boutade originale dont le titre est ainsi conçu: Venerem a se aufugere jubet, ce qui veut dire en français familier: Il envoie promener Vénus. La pièce est vraiment trop curieuse pour ne pas être citée in extenso, texte et traduction:
«A quoi bon, Vénus, attaquer mon cœur par un [p. 20] nouveau feu? Je me suis endurci contre tes flammes. Certes! je n’ai plus rien, à présent, de commun avec toi. Tant que m’emportaient la fougue d’une aveugle jeunesse et la chaleur d’un âge sans frein, j’ai peut-être, plus qu’il ne convenait à la chasteté, servi sous ton empire: il m’était doux d’être vaincu par ce coquin d’Amour. Mais aujourd’hui je sens qu’un autre feu me maîtrise, moi qu’embrasa trop longtemps ton incendie; un autre feu me maîtrise, le feu sacré de la pudique Pallas. Ni ton enfant porte-carquois, ni toi-même par aucune ruse, rien ne pourrait le chasser de mon âme, lui faire céder la place aux sales polissonneries. Va te faire pendre, déesse impudique; va, cruelle peste des mortels. Si tu ne décampes sur l’heure, pour t’en aller au diable; si tu ne cesses de me harceler, tu auras affaire au sanglant visage de la Gorgone, que tient caché sous son égide... qui?... Pallas!... Eh bien! tiendrais-tu jamais tête à si grande divinité, toi, lâche et flasque déesse?»
O mon noble Estienne! tu avais raison, tu avais cent fois raison dans ta généreuse colère. Ames artistes, mâles natures, qui, comme lui, voulez vivre de la grande vie de l’intelligence, répétez, répétez sans cesse un pareil anathème. Oui! répétez sans cesse, avec le géant scientifique du seizième siècle:
Arrière la volupté terrestre et ses amorces fallacieuses! Arrière l’amour terrestre et ses spasmes énervants, et ses furieux désirs, toujours inassouvis! Arrière tout ce désespoir, arrière tout ce néant! Abi in malam crucem, dea impudica!
Sur ce globe de boue, dans ce monde de misères [p. 21] et de déceptions,—soyez-en tous bien convaincus, jeunes hommes qui pouvez me lire,—il n’y a qu’une passion qui soit digne des grands cœurs: c’est le culte de la pensée, la religion de l’étude, l’amour saint du travail!
Poursuivants aveugles de l’introuvable moitié de votre âme, il n’y a qu’une maîtresse, ici-bas, qui ne trahisse jamais ses adorateurs: c’est la science!
Amour de la science! amour sublime et divin! tu es le seul, et je dis vrai, qui s’accroisse avec le temps; le seul qui, dans l’objet aimé, fasse découvrir tous les jours des perfections nouvelles; le seul enfin, sur la terre, où l’on n’arrive jamais au bout de la jouissance et de l’illusion[26]!
On trouvera peut-être, à ce propos, que je mets beaucoup trop de chaleur dans mon style d’historien. Une simple page de biographie, me diront certains lecteurs, ne doit pas s’écrire absolument sur le ton d’un dithyrambe. Je le sais. Mais j’ai le malheureux défaut de penser avec le cœur, plus souvent encore qu’avec la tête. Après tout, on ne peut exiger de moi [p. 22] qu’une chose, amplement suffisante à elle seule, pour donner sa raison d’être au présent travail: je veux dire, l’exactitude la plus scrupuleuse dans le narré des faits. Cette chose-là, je puis la garantir d’avance, autant que dix années d’études sur Dolet me donnent le droit de parler ainsi. Quant au reste, appréciation plus ou moins calme des événements que je raconte, sympathie plus ou moins vive pour mon héros, tout cela me regarde... d’autant plus qu’il sera toujours facile de n’en prendre que ce qu’on voudra.
Les pièces de vers que j’ai citées plus haut ont, à mes yeux du moins, une franchise d’allure, un primesaut d’expression, en un mot, une originalité bien rare parmi les poëtes latins modernes. Il me semble qu’elles peignent leur homme des pieds à la tête; on y retrouve Dolet tout entier; c’est bien là son caractère âpre, brusque et hardi. Malgré cela, le croirait-on? son talent poétique a été complétement nié par quelques écrivains, entre autres Buchanan et les deux Scaliger, Jules-César surtout. Pour commencer par Buchanan, il a décoché, ou plutôt asséné à notre Estienne les deux épigrammes suivantes... qui ressemblent à des épigrammes, comme des massues ressemblent à des flèches. Voici la première:
«Pourquoi s’étonner que les vers de Dolet manquent de sens? L’auteur en avait-il?»
[p. 23] Et voici la seconde, d’un genre aussi fort:
«Dolet, personne ne l’ignore, a des mots splendides: mais... c’est tout.»
Comme c’est méchant!
Au surplus, je dois laisser au lecteur à décider, d’après les vers latins de Dolet que j’ai déjà transcrits, et d’après ceux que je transcrirai encore toutes les fois que l’occasion s’en présentera, si réellement il a manqué de sens, lui aussi bien que sa muse, et si vraiment il n’avait pour tout bagage que des mots splendides. Passons au terrible autocrate de l’empire littéraire, Scaliger Ier, dit Jules-César! Si nous voulons bien l’en croire sur parole, Dolet a faussé, corrompu, vicié l’iambe latin (Doletus iambos vitiavit). Aussi, déchaîne-t-il à ses trousses l’iambe lui même, l’iambe personnifié. Gare à toi, pauvre poëte!
«Allons, allons, allons, Iambe, Iambe, réveille-toi: attaque, frappe, saisis, entraîne, tue, anéantis. Me voici! d’une main menaçante, je porte avec moi la crainte livide, et un serpent de feu s’entortille autour de ma langue. Moi si vif, si fougueux, si farouche, est-il possible, Dolet, que tu m’aies énervé à ce point-là! Quoi! tu n’as pas même fourré un grain de sel dans ton incroyable salmigondis! Je m’étais exilé loin de toi, loin de tes inepties plus ineptes que toute la bêtise de l’âne; mais je te reviens, ennemi plus acharné que jamais, et je te dis: Chien, laisse-moi tranquille! Car veux-tu savoir ce que pensent de tes balivernes les juges dont le goût est le plus fin, dont l’oreille est la plus délicate? Écoute... Folie furieuse, fumée noire sans feu ni lumière, voilà comment ils t’appellent; ils te nomment encore écorce pourrie vide de moelle. Dogue stupide! tu n’as pour admirateurs que les roquets de ta suite; ceux-là viennent lécher tes abcès purulents, en vertu du principe: Qui se ressemble s’assemble.»
Que l’on prononce entre Scaliger et Dolet[27]: c’est [p. 25] tout ce que je puis dire, car il me répugnerait de discuter sérieusement une critique formulée en termes semblables. Ce ne sera pas la dernière fois, du reste, que nous aurons à surprendre le gracieux Aristarque en flagrant délit de mensonge, d’injustice et d’animosité brutale.
[13] Simon Villanovanus latini sermonis puritatem, atque artem rhetoricam Doletum docuit.
«Simon de Villeneuve a enseigné à Dolet la pureté du style latin et l’art de la rhétorique.»
(Comment., t. I, col. 1178.)
[14] Carm., IV, 2.
[15] Et non Jean de Langeac, comme l’ont dit presque tous les biographes de Dolet, à l’exception du moins inexact, Née de la Rochelle. Voici la source de cette erreur:
Dolet nomme généralement ce personnage Langiacus, ou même Langiachus. Mais il est impossible que le Joannes Langiacus, dont il fut secrétaire à Venise, ne soit pas le Joannes Langiachus, episcopus Lemovicensis, dont il a raconté l’ambassade à la suite de son traité de Officio legati, 1541, in-4o. Le prétendu Jean de Langeac ne pouvait donc être évêque de Limoges en 1541, puisque alors Jean du Bellay en occupait le siége. Aussi, tout ce que Dolet adresse à Joanni Langiaco, doit-il s’entendre de Jean du Bellay-Langey, que l’historien de Thou appelle Joannes Bellaius Langæus.
Jean du Bellay, né en 1492, mort à Rome le 16 février 1560, «estoit, dit Brantôme, un des plus sçavans, éloquens, sages et advisés de son temps; un des plus grands personnages en tout, et de lettres et d’armes, qui fust». Il fut successivement évêque de Bayonne, de Paris, de Limoges, archevêque de Bordeaux, enfin, évêque du Mans. On parla même un instant de l’asseoir sur le trône pontifical, après la mort de Marcel II. Il était cardinal depuis 1535. C’est Jean du Bellay qui, joignant ses efforts à ceux du célèbre helléniste Budé, parvint à obtenir de François Ier la création du collège de France. Rabelais fit quelque temps partie de sa maison, en qualité de médecin.
[16] Baptistam Egnatium, quem Officia Ciceronis et Lucretium interpretantem Venetiis juvenis audivi.
«Battista Egnazio, dont je fus l’auditeur à Venise, dans ma jeunesse, à l’époque où il expliquait Lucrèce et le traité de Cicéron sur les Devoirs.»
(Comment., t. I, col. 1156.)
Egnazio, en latin Egnatius, dont le véritable nom était Giovanni-Battista Cipelli, naquit à Venise vers 1478, et mourut dans la même ville le 4 juillet 1553. Ses leçons attiraient une foule d’auditeurs de tous les pays; on en comptait chaque jour jusqu’à cinq cents et davantage.
[17] Athanase Christopoulo Caminaris naquit, dans le siècle dernier, à Castorie, en Macédoine, ou, suivant d’autres, à Janina, en Epire. Il prit Anacréon pour modèle, sans toutefois le copier servilement. Ses poésies ont obtenu un succès national.
[18] Il l’appelle en latin Helena; mais, comme traducteur, j’ai préféré suivre l’orthographe italienne.
[19] Carm., I, 42.
[20] Amours de Marie.
[21] Œuvres de Millevoye, Paris, Furne, 1833, 2 vol. in-8o (t. I, p. 188).
[22] Jean Voulté, dit Vulteius, poëte latin et professeur à Toulouse, naquit à Reims vers le commencement du seizième siècle. Il mourut le 30 décembre 1542, tué par un homme qui avait perdu un procès contre lui. Ce misérable, pour se venger, le fit tomber dans un guet-apens, et lui porta un coup mortel dans la mamelle gauche. Vulteius avait pris pour modèle Jean Second, auquel il est resté bien inférieur. J’aurai souvent à parler de lui dans le courant de mon travail.
[23] Carm., I, 19.
[24] Voir, dans les Mémoires de Socrate, par Xénophon, le fameux apologue de Prodicus.
[25] Carm., II, 56.
[26] Écoutez encore, à cet égard, la grave parole d’un maître, de celui que Chateaubriand a surnommé l’Homère de l’histoire:
«L’étude sérieuse et calme n’est-elle pas là?... Avec elle on traverse les mauvais jours sans en sentir le poids, on se fait à soi-même sa destinée, on use noblement sa vie. Voilà ce que j’ai fait et ce que je ferais encore, si j’avais à recommencer ma route; je prendrais celle qui m’a conduit où je suis. Aveugle et souffrant sans espoir et presque sans relâche, je puis rendre ce témoignage, qui de ma part ne sera pas suspect: il y a au monde quelque chose qui vaut mieux que les jouissances matérielles, mieux que la fortune, mieux que la santé elle-même, c’est le dévouement à la science.»
(Augustin Thierry, Dix Ans d’études historiques, préface.)
[27] Ses vers latins, suivant la remarque de Bayle, ont paru dignes à Gruter d’être insérés dans les Délices des poëtes français; et, ajoute ce judicieux critique, «s’ils ne sont pas excellents, ils sont encore moins dans le degré d’imperfection où Jules-César Scaliger les représente».



Retour en France. — Dolet à Toulouse. — Son premier emprisonnement et son expulsion.

De retour en France avec du Bellay, vers 1530, Dolet poursuivit avec un redoublement d’activité ses chères études cicéroniennes. Déjà nous le voyons recueillir les matériaux qui l’aidèrent depuis à rédiger ses deux immenses volumes de Commentaires sur la langue latine, prodige effrayant de patience et d’érudition.
Absorbé dans cet énorme travail, il avait fini par oublier totalement le soin de son avenir. Ses amis, plus positifs, y songèrent à sa place. Langey, le premier, lui conseilla l’étude du droit, comme un moyen plus direct et moins chanceux que la littérature, d’arriver à une position dans le monde. Humblement docile à des conseils qui lui paraissaient dictés par la sagesse, et ne pouvant prévoir ce qui l’attendait pour les avoir suivis, le pauvre Dolet s’arracha, en soupirant, à ses bienheureux tête-à-tête avec l’antiquité latine, et se rendit à Toulouse, dans le courant de l’année 1531. Le prélat, son protecteur, lui fournit tous les secours pécuniaires dont il pouvait [p. 28] avoir besoin dans cette nouvelle phase de son existence[28].
Toulouse possédait, à cette époque, une école de droit d’une célébrité littéralement européenne. On y voyait affluer, comme à une métropole de lumières, des étudiants de toute langue et de toute patrie. Le concours d’une multitude aussi peu homogène avait nécessité l’établissement d’un certain nombre de sociétés, que composaient respectivement ceux d’une même nation[29]. Les Français et les Aquitains s’étaient organisés d’abord de cette manière; les Espagnols, et successivement tous les autres étrangers, ne tardèrent pas à suivre cet exemple. Une fois ces différentes associations constituées, chacune d’elles s’était choisi un jour pour fêter le saint qui lui servait de patron. De plus, toutes avaient leur chef: à lui seul était dévolu le droit de convocation; il était chargé de défendre, en toute occurrence, les intérêts et les priviléges de ses compatriotes; en un mot, il était leur conseil vivant, leur tribun du peuple, leur défenseur toujours sur la brèche. Par une réminiscence entièrement romaine, les assemblées se faisaient par centuries; et des questeurs, nommés à la pluralité des voix, exigeaient des membres de chaque centurie la cotisation à laquelle ils s’étaient engagés. Le jour de la fête du saint patron, [p. 29] un orateur, élu dans le sein de la société, prononçait un discours, dans lequel il célébrait la mémoire des sociétaires que la mort avait fait disparaître dans le courant de l’année. C’était encore un souvenir de l’âge antique. Songeant à payer un tribut de gloire à leurs compagnons d’armes, aux jeunes braves qu’ils avaient vus succomber à leurs côtés ou à leur tête, sur le champ de bataille de la science, ces héroïques écoliers s’étaient rappelé, sans doute, le discours de Périclès en l’honneur des Athéniens morts pendant la guerre du Péloponnèse.
Ah! je le déclare sans crainte, lorsqu’à la solennelle revue un de ces conscrits de la pensée faisait défaut à l’appel, l’orateur chargé de l’éloge funèbre aurait pu répondre à sa place, comme plus tard on répondait au nom de la Tour d’Auvergne: «Mort au champ d’honneur!»
De telles réunions, comme on le pense bien, éveillèrent vivement l’attention soupçonneuse du pouvoir. Aussi, le parlement de Toulouse saisit-il, avec un empressement inflexible, l’occasion de quelques légers désordres dont les étudiants s’étaient rendus coupables, pour proscrire en masse leurs associations.
Je vous laisse imaginer si, à cette nouvelle inattendue, l’irritation fut grande parmi toutes ces jeunes têtes! Les Français, surtout, se signalèrent par leurs énergiques protestations, par leur véhémence oppositionnelle. Au mépris des sévères injonctions du parlement, ils continuèrent, comme par le passé, l’observance exacte de leurs statuts.
Sur ces entrefaites, notre Estienne arrivait à Toulouse. [p. 30] Sa réputation naissante, la vigueur déjà connue de son caractère, le firent accueillir avec enthousiasme par ses bouillants compatriotes. Presque aussitôt, il fut élu d’une voix unanime orateur de la nation de France: distinction aussi honorable que périlleuse! Impatient de la justifier de prime abord et d’une manière éclatante, il prononça publiquement, le 9 octobre 1532, un discours dont la hardiesse ne tarda pas à lui devenir fatale. Dans cette verte harangue, le jeune et intrépide orateur exaltait les Français avec un patriotisme dithyrambique; tandis qu’en sens contraire, il accusait Toulouse de barbarie, et frondait avec emportement l’acte arbitraire du parlement de cette ville.
«A moins de vivre exilé à l’autre bout du monde, s’écriait-il dans son audacieuse catilinaire, personne n’ignore quelle affluence de jeunes gens et d’hommes de tout âge l’étude du droit attire à Toulouse, des pays les plus divers et les plus éloignés. Et puisque, arrachés des bras qui leur sont chers, ils se trouvent en présence de visages étrangers, puisqu’ils ont quitté le toit natal pour des demeures inconnues, et la société des humains pour celle des barbares (au fait, pourquoi hésiterais-je à les stigmatiser du nom de barbares, ceux qui préfèrent la sauvagerie primitive à la libre pensée qui crée l’homme?); enfin, puisqu’ils ont émigré d’amis à ennemis, le consentement unanime des dieux immortels et des hommes n’approuve-t-il pas que l’amour de la patrie, que cette tendresse réciproque qui date du berceau, s’établisse entre eux de Français à Français, d’Italien [p. 31] à Italien, d’Espagnol à Espagnol? N’ont-ils pas le droit, au nom de cet amour éternel, de s’unir, de s’embrasser, de ne former respectivement qu’un seul corps? Non!... Car là-dessus le parlement s’inquiète, Toulouse tout entière est en ébullition. De là viennent ces tragédies dont nous sommes les héros, de là ces décrets officiels qui nous poursuivent, de là ces sentences prétoriennes qui nous accablent. Et quel est notre crime, après tout? Notre crime, c’est de nous unir, de vivre ensemble comme bons compagnons, de nous secourir mutuellement comme frères. Dieux immortels! dans quel pays sommes-nous? Chez quelles gens vivons-nous? La grossièreté des Scythes, la monstrueuse barbarie des Gètes, ont-elles fait irruption dans cette ville, pour que les pestes humaines qui l’habitent, haïssent, persécutent et proscrivent ainsi la sainte pensée[30]?»
Ce devait être un curieux spectacle que de voir le fougueux humaniste s’agiter sur son estrade, au milieu d’une assemblée silencieuse et stupéfaite; que de l’entendre dérouler, en périodes cicéroniennes, en phrases d’une sonorité toute latine, son acerbe et nerveuse invective. Un témoin oculaire, Simon Finet (Finetius), ami intime de Dolet, nous rendra en quelques mots l’effet inouï que dut produire une pareille scène:
«Comme orateur, écrit-il à Cottereau[31], leur ami [p. 32] commun, notre Estienne est hors de pair. Son débit fait succéder tour à tour la douceur et la gravité; geste éloquent, physionomie expressive, organe d’une souplesse variée comme le sujet, il a tout pour lui. A quoi bon insister là-dessus? Vous l’avez entendu vous-même, tonnant du haut de sa tribune; et vous savez aussi bien que moi quel silence d’admiration planait alors sur tout l’auditoire![32]»
Redoublant d’énergie et de colère, à mesure qu’il avançait dans son discours, s’enivrant pour ainsi dire de ses propres paroles, et comme fouetté sans cesse par le bruit des applaudissements, Dolet continuait en ces termes:
«Ne reconnaissez-vous pas, à cette marque, la grossièreté manifeste, la méchanceté scandaleuse de ces gens-là? Ce foyer de mutuel amour que la nature avive sans cesse dans nos cœurs, ils ont voulu l’éteindre; cette fraternité que les dieux mêmes nous inspirent, ils ont voulu l’étouffer; ce droit de libre réunion que toutes les sympathies nous accordent, ils ont voulu l’anéantir! S’il faut proscrire impitoyablement [p. 33] toute association d’étrangers, pourquoi donc, en vertu d’un arbitraire et d’une tyrannie semblables, ces mêmes associations ne sont-elles point prohibées à Rome et à Venise? Bien au contraire, à Venise comme à Rome, Français, Allemands, Anglais, Espagnols, Dalmates et Tartares, ceux mêmes dont la croyance est diamétralement opposée à la nôtre, Turcs, Juifs, Arabes ou Mores, enfin les représentants de toutes les races du monde, conservent intactes leurs lois et leurs franchises nationales, et se réunissent librement et sans blâme. Malgré la divergence radicale des opinions religieuses, les nations que nous appelons barbares observent envers nous le même droit des gens: les Turcs[33], notamment, laissent les chrétiens s’assembler entre eux sans la moindre opposition; ils ne font violence à personne; ils souffrent que les étrangers s’organisent à part, et leur permettent de se régir eux-mêmes d’après une législation spéciale. Il n’en est pas ainsi des magistrats toulousains: nous pratiquons avec eux la même religion; nous vivons soumis au même gouvernement; nous parlons à peu près la même langue[34]. Eh bien! toutes ces considérations ne les [p. 34] empêchent pas de nous traiter en étrangers, que dis-je? en ennemis! et de nous interdire, contre toute justice divine et humaine, le privilége de l’association, le bonheur de l’amitié. Qui ne verrait dans de semblables actes des hallucinations de gens ivres plutôt que de sobres décisions, des accès de folie furieuse plutôt que des oracles de sagesse? Qu’ils nous produisent donc, ces superbes autocrates qui s’arrogent une autorité absolue dans l’empire du droit, soit une loi des Douze Tables, soit un article des coutumes provinciales, soit un sénatus-consulte emprunté aux cinquante livres des Pandectes ou au volumineux recueil de Justinien, soit un plébiscite, soit un décret prétorien, soit un rescrit de jurisconsulte, soit enfin un édit royal, qui jamais ait prohibé une amicale et honorable corporation[35].»
En s’exprimant de la sorte, l’étudiant orléanais apportait le premier fagot à l’horrible bûcher qui devait le dévorer plus tard. Il y eut contre l’audacieux un déchaînement terrible de la part des amours-propres de province qu’il avait si rudement froissés. Toutes ces laves méridionales débordèrent. Un certain Pierre Pinache (Petrus Pinachius)[36], orateur de la nation d’Aquitaine, se leva lorsque Dolet eut fini de parler, et riposta par un discours aussi violent pour le moins que celui de notre humaniste.
[p. 35] Il défendit, avec cette pieuse fureur dont l’apologiste du bourreau, Joseph de Maistre, a donné tout à la fois la définition et l’exemple, avec cette rage sainte qui n’a pas de nom, l’honneur attaqué des magistrats et des citoyens de Toulouse, et s’efforça de justifier le sénat auguste dont l’irrévérent Estienne avait tenté d’infirmer l’arrêt.
Dolet répliqua, cela va sans dire; il prit corps à corps ce malencontreux Pinache; il le tordit, il le terrassa sous son ironie implacable.
«Tu m’as posé, lui répondait-il entre autres choses, cette question vraiment triomphante: Qui donc s’avise d’attaquer les décrets de notre parlement? Qui donc ose assumer sur sa tête la responsabilité d’un tel attentat? En parlant ainsi, tu as cru me tenir au pied du mur, et me fermer à jamais la bouche. Redoublant alors de haine et de fureur, tu m’as en quelque sorte accusé de haute trahison, de lèse-majesté divine et humaine; et tu as gracieusement conclu, soit à me faire décapiter, soit à me précipiter du haut d’un roc, soit à me coudre dans un sac et à m’envoyer au fond de ta Garonne. Attends, mon brave! je vais te rendre la pareille; seulement, je serai plus humain, plus chrétien que toi. Je te le demande à mon tour, qui donc se pose en défenseur du parlement? Qui donc prétend venger l’honneur de ce noble corps? C’est toi, terrible Pinache!... Approche, valeureux champion! Viens me terrifier sous le double éclair de tes yeux caves et féroces; tourne contre moi ta face de bête fauve, ta barbe de satyre velu; déchire-moi de ta bouche impudente, [p. 36] couvre-moi de ta bave impure; et, pour en finir d’un seul coup, fais-moi traîner dans les cachots de cette bonne ville. C’en est fait! mon arrêt de mort est prononcé; voilà le licteur, voilà le bourreau, voilà l’instrument du supplice... N’est-ce pas à pouffer de rire? Regardez-le bien: nouveau Fabius, enlevé à sa charrue des enfers, il va rétablir les affaires de Toulouse, non plus par la sage temporisation du Cunctator, mais par l’effronterie de sa langue de vipère; nouveau Marcus Tullius, il va sauvegarder contre mon complot catilinaire l’amplitude et l’autorité du sénat. Va, Pinache! pour prix d’un tel exploit, les comices par centuries t’élèveront à la dignité de consul: à toi le triomphe, à toi la statue d’or du Forum. Courage, intrépide Gascon! frappe, redouble, achève-moi. La postérité tombera de stupeur aux pieds de ta gloire; l’admiration du monde entier te portera jusqu’aux cieux; ton nom brillera d’une auréole immortelle, et jamais l’oubli jaloux n’obscurcira de sa rouille tes nobles efforts[37].»
Ce pauvre diable de Pinache avait eu, à ce qu’il paraît, la malheureuse idée de reprocher à Dolet le fanatisme de sa religion cicéronienne. Il aurait mieux fait de se taire.
«Je rirais de bon cœur de toutes tes inepties, lui rétorqua son adversaire avec sa voix cinglante et moqueuse, si je n’avais à rire, avant tout, de la plus grosse, de la plus énorme: je veux parler de la [p. 37] stupidité incroyable avec laquelle, en voulant rabaisser mon mérite littéraire, tu n’as fait que l’exalter par delà toutes mes espérances. Tu as cru m’écraser sous une mortelle injure, en m’appelant un religieux imitateur de Cicéron. Dieux immortels! c’est le plus beau jour de ma vie, que ce jour où ton illustre témoignage me garantit enfin cette gloire, objet de ma plus fervente ambition, dès mon enfance; ce beau rêve, que ma pudeur d’écrivain, que la conscience de mon faible talent me défendaient encore de croire réalisé. Ah! je suis au comble de la joie! Tu m’as accordé le seul but de mes désirs, de mes études, de mes labeurs. De ton propre aveu, mon style paraît calqué sur celui de Cicéron; c’est-à-dire (je n’en demande pas davantage) que je reproduis une ombre de cette perfection souveraine, sans que je prétende, pour cela, rivaliser d’éloquence avec un homme qu’il est bien permis d’admirer, qu’il est tout à fait loisible d’imiter, mais à la taille duquel il est impossible de jamais atteindre[38].»
Désespérant de vaincre Estienne, en continuant de le combattre avec l’arme de la parole, Pinache, pour être plus sûr d’avoir raison, le dénonça au parlement comme séditieux et luthérien; en un mot, si l’on veut bien me permettre d’employer ici l’expression moderne, il le représenta comme un révolutionnaire dangereux. Tout ce que la jalousie littéraire, stimulée par la haine la plus implacable et la vanité la plus profondément blessée, peut ourdir d’ignoble [p. 38] en fait d’artifices et de calomnies, fut mis en œuvre par cet homme et ses acolytes contre l’imprudent Dolet.
Ces lâches menées aboutirent au résultat que chacun pouvait prévoir. Un beau jour, l’orateur de la nation de France se vit appréhendé au corps et conduit dans les prisons de Toulouse, par ordre du juge-mage Dampmartin, le 25 mars 1533.
La Monnoye assurait d’abord que Dolet, à cette occasion, avait été honteusement promené par les carrefours de Toulouse; et il citait, à l’appui de son assertion, la strophe suivante de Dolet lui-même, dans la pièce qu’il adresse au juge-mage Dampmartin:
«Aucun crime n’exigeait que je fusse jeté dans les fers, ni conduit ignominieusement par les carrefours, comme un misérable qui aurait creusé, à coups de poignard, le sein de son père.»
On ne tarda pas à faire sentir au savant dijonnais l’erreur dans laquelle il était tombé; c’est lui-même qui nous l’apprend, avec sa franchise et sa rondeur bourguignonnes:
«Un illustre Orléanois, dit-il, a pris de là occasion de m’écrire que l’endroit de l’ode citée ne marquoit nulle autre injure faite à Dolet, que d’avoir été honteusement conduit par les rues en prison, ce [p. 39] que deux lettres du même auteur à Jacques de Minut, premier président au parlement de Toulouse, confirmoient; dans la première desquelles s’étant plaint de son emprisonnement à ce magistrat, il en obtint un prompt élargissement, dont il le remercia par la seconde, sans que dans l’une ni dans l’autre il ait fait la moindre mention de cette ignominieuse promenade dont j’ai parlé.»
L’auteur de l’article Dolet, dans la Biographie universelle, est allé bien plus loin que La Monnoye, à propos de supposition gratuite et de fantaisie anecdotique. Sans prendre la peine d’en fournir aucune preuve, il affirme gravement que Dolet fut conduit dans les grandes rues de Toulouse, pour y faire amende honorable. Et c’est ainsi que l’on écrit l’histoire... dans la Biographie universelle.
Revenons à notre héros. Le voilà donc entre les mains de messieurs de la justice. Pauvre Estienne! c’est alors que commence pour lui cette longue série d’emprisonnements qui a fait dire à l’un de ses innombrables ennemis, à François Floridus, que la prison était la patrie de Dolet[39].
Sa situation menaçait de devenir critique. Il avait violemment attaqué, dans son dernier discours, les superstitions plus que puériles de la population toulousaine, en s’écriant avec toute son audace de jeune homme:
[p. 40] «Cette ville, qui s’arroge avec tant d’ineptie le monopole de la vraie foi; cette ville absurde, qui se pose en flambeau du catholicisme, examinons, en passant, jusqu’à quel point sa prétention est fondée à cet égard...
«J’invoque ici votre assentiment sincère, continuait-il en faisant un appel direct à ses auditeurs, et je ne crois pas que vous songiez à me démentir, quand je vous dirai que Toulouse en est encore aux plus informes rudiments du culte chrétien, et qu’elle est même entièrement adonnée aux ridicules superstitions des Turcs. Comment qualifier, en effet, cette cérémonie qui a lieu tous les ans, le jour de la fête de saint Georges, et qui consiste à faire neuf fois le tour de l’église sur des chevaux lancés au galop?... Que pensez-vous de cette croix qu’à de certains jours on plonge dans la Garonne, comme pour amadouer un Eridan, un Danube, un Nil quelconque, ou le vieux père Océan? Que signifient ces vœux adressés au fleuve, soit pour en obtenir un cours paisible, soit pour se préserver d’une inondation? Que veulent dire, en été, quand la sécheresse fait désirer la pluie, ces statues de saints, ces magots de bois pourri, que des enfants promènent par la ville?... Et cette ville, si honteusement ignare en fait de religion véritable, cette ville ose imposer à tous un christianisme de sa façon, et traiter d’hérétiques les libres esprits qui n’en veulent pas[40]!...»
De tout cela, il était résulté pour l’étudiant une [p. 41] accusation de luthéranisme, et c’est à quoi, sans doute, il a fait plus tard allusion dans ses Commentaires, t. 1, col. 20, où il s’exprime ainsi:
«Les Toulousains (que les dieux les maudissent, eux et toutes les pestes humaines qui leur ressemblent!) les Toulousains se sont déchaînés auprès du roi, contre le discours dans lequel je tançais leurs superstitions. Ils saisissaient là une superbe occasion de me calomnier, moi, Dolet; mais leur malveillance et leurs criminels efforts ont été facilement reconnus par le roi, grâce à la finesse de son jugement, à son équité souveraine, à la justice toute particulière dont il fait preuve envers les innocents. Il n’a donc pas voulu que leur inique délation fût cause de ma perte. Qui ne serait pas, en effet, écrasé par la fausse accusation des envieux, si le pouvoir ne couvrait les innocents de son égide, et ne veillait à leur honneur et à leur salut? Qui ne serait pas sans cesse sous le coup d’un fléau, qui n’aurait pas toujours sur la tête une calamité suspendue, si la prudence et la sagesse de ceux qui nous gouvernent ne confondaient les viles intrigues des méchants?»
Hélas! on le verra bientôt, l’égide du pouvoir ne protégea pas longtemps notre malheureux Dolet; le sceptre sauveur ne tarda pas à se changer en massue.
Du reste, Estienne avait pressenti lui-même la dénonciation dont il vient de nous parler. En voici la preuve:
«Personne de vous ne l’ignore, disait-il aux auditeurs de son second discours, la révolution dont [p. 42] Luther s’est fait récemment le promoteur dans le sein de la république chrétienne, a soulevé partout de violentes animosités; c’est au point que, vis-à-vis du plus grand nombre, elle ne peut avoir pour fauteurs que des esprits turbulents, et poussés par une détestable manie d’innovation. Vous savez aussi que, plus on s’élève au-dessus du vulgaire par l’intelligence et par le cœur, par le génie et par la science, plus cet ignoble vulgaire est prompt à vous suspecter de luthéranisme. Saisissant cette occasion d’assouvir leur haine contre les studieux et les doctes, que d’érudits illustres les furies de Toulouse n’ont-elles point cherché à faire périr! A cette assertion de ma part, je vois déjà les sycophantes de cette ville grincer des dents contre moi, et couver à mon sujet mille pensées de haine; j’entends déjà leurs atroces menaces; je les sens, je les devine autour de moi, préparant dans l’ombre mon exil ou ma mort[41]!»
L’année d’auparavant, un drame horrible s’était accompli à Toulouse, et une accusation de luthéranisme, analogue à celle qui pesait alors sur Dolet, en avait été l’occasion et le prétexte. Un savant professeur, Jean Caturce, de Limoux, compromis dans sa ville natale à la suite de certains discours qu’il y avait tenus, en 1531, le jour de la Toussaint, avait pris le parti de se retirer à Toulouse, où il obtint presque aussitôt une chaire de droit. La veille du jour des Rois de l’année 1532, quelques amis l’invitèrent à manger avec eux le gâteau traditionnel. Il [p. 43] accepta, mais à une condition; c’est qu’au lieu de crier, suivant l’habitude en pareille circonstance: Le roi boit! ses compagnons de table feraient entendre cette formule, beaucoup plus chrétienne, suivant lui: Jésus-Christ règne dans nos cœurs!
Il exigea, en outre, qu’avant de se séparer, toutes les personnes qui avaient pris place à ce banquet épiphanique d’un nouveau genre, portassent, à tour de rôle, une espèce de toast édifiant. Le sien lui coûta la vie. Parmi les convives, se trouvaient à son insu des affidés de la police toulousaine, qui, au sortir de là, coururent le dénoncer comme luthérien. Caturce, arrêté presque immédiatement, témoigna d’abord quelque faiblesse; il parla même un instant de rétractation. Mais il ne tarda pas à rougir de sa pusillanimité, et maintint hardiment la profession de foi évangélique qui l’avait fait décréter de prise de corps. En conséquence, il fut brûlé vif comme hérétique, sur une des places publiques de Toulouse, au mois de juin 1532.
Je ne surprendrai personne, en ajoutant que la religion officielle ne gagna rien à cet auto-da-fé: au contraire. Caturce était chéri de ses élèves. Plusieurs d’entre eux, témoins de son supplice, furent vivement frappés de l’héroïsme qu’il déploya dans ses derniers moments, et se convertirent à la doctrine pour laquelle ils avaient vu leur régent mourir avec tant de constance.
Rabelais fait allusion à ce tragique événement, dans son Pantagruel, liv. II, ch. V, où il nous dit, en parlant de son héros:
[p. 44] «De là vint à Toulouse, où apprint fort bien à dancer et à jouer de l’espée à deux mains, comme est l’usance des escholiers de ladicte Université; mais il n’y demoura guieres, quand il veit qu’ils faisoient brusler leurs regents touts vifs comme harencs soretz, disant: Jà Dieu ne plaise que ainsi je meure, car je suis de ma nature assez altéré sans me chauffer d’advantaige!»
Voilà bien Rabelais. C’était Dolet le verre en main: in vino... prudentia. Dolet, au contraire, malheureusement pour lui, c’était Rabelais moins son masque bachique.
En effet, comme s’il eût voulu porter au comble l’exaspération des Toulousains à son égard, comme s’il eût pensé que les braves gens n’étaient pas encore assez montés contre lui, le téméraire étudiant les souffleta, pour ainsi dire, dans sa seconde harangue, avec l’apologie de Caturce leur victime. Je vais reproduire tout au long cette nerveuse tirade, en la faisant précéder de son texte; on y reconnaîtra, plus que jamais, cette belle prose latine du martyr cicéronien de la place Maubert, si franche, si spontanée, si profondément empreinte du caractère de l’homme, dans ses accents heurtés et ses rudes négligences:
«Dixisset multa audacter, pleraque esset non moderate locutus, omni scelere coopertus esset, hæreticorum supplicio plectenda admisisset, quem vivum comburi in hac urbe vidistis (nomen mortui prætereo, igne quidem consumpti, sed hic adhuc invidiæ flamma flagrantis): an tamen pœnitenti via ad sanitatem salutemque præcise intercludi debuit? [p. 45] Numquid scimus cujusvis esse hominis errare et labi, nullius nisi insipientis perseverare? An post discussam illius caliginem, dilucescere mox posse diffidendum erat? Quare ex erroris vortice voragineque emergenti, et se ad portum frugemque bonam recipere cupienti, non omnium consensu data est navem inhibendi facultas? Fuit hæc ultima illius vox, et a pontificis sententia, et a senatus judicio capitali provocatio: quam quis probabilem acceptamque haberi debuisse jure ullo inficietur? Profuit tamen nihil post erratum in viam redire voluisse, nec, quæ portus pœnitenti esse solet, mutatio consilii, vitam illi incolumem ab iniquorum immanitate servare potuit. Immemor suo more humanitatis, cujus nunquam particeps fuit, Tholosa, insatiabilem suam crudelitatem exercuit in eo lacerando atque vexando; et in opprimendo exstinguendoque animum explevit, ac oculos pavit suos: hac opinione gloriaque præpostere et absurde superba, se quidem esse in officio, atque adeo ad religionis nostræ dignitatem obnixe incumbere, dum summa injuria pro summo jure utatur, ac, qui in levem aliquam erroris suspicionem ceciderint, aut invidiose criminis alicujus insimulentur, eos aspere crudeliterque vexet, et Christum potius ejurare quam resipiscere, cruciatibus adigat!...[42]»
«Vous avez tous vu brûler vif, ici même, dans cette ville, un malheureux dont je passe le nom sous silence. La flamme du bûcher a dévoré sa dépouille [p. 46] mortelle, mais celle de l’envie s’acharne encore après sa mémoire. Admettons qu’il ait poussé trop loin l’audace de ses discours, qu’il ait presque toujours manqué de modération dans son langage, qu’il ait été scélérat des pieds à la tête, et qu’il ait mérité mille fois le supplice des hérétiques. Devait-on, néanmoins, à l’heure où il faisait acte de repentir, lui fermer brusquement la route vers des idées plus saines, et couper en quelque sorte devant lui le pont du salut? Ne savons-nous pas que tout homme est sujet à l’erreur et à la chute, mais aussi que nul, à part l’insensé, ne persévère dans une faute qu’on lui a fait apercevoir? Une fois dissipées les ténèbres qui enveloppaient son âme, devait-on désespérer d’y voir renaître le jour? Au moment où il s’efforçait de remonter hors du gouffre moral qui l’avait englouti, où il aspirait à rentrer au port de la vérité religieuse, pourquoi n’a-t-il pas eu, du consentement de tous, le droit d’y ancrer son navire? C’est là, du reste, la dernière parole qu’il ait fait entendre lui-même, sa protestation contre la sentence ecclésiastique, son appel de l’arrêt du parlement qui le condamnait à la peine capitale. Pourrait-on soutenir, sans violer toute justice, qu’un tel recours n’était ni fondé ni valable? Mais c’est en vain qu’après son erratum, il a voulu revenir à la bonne voie: la résipiscence, ce port ordinaire du repentir, n’a pu lui sauver la vie; les bourreaux ont accompli leur iniquité. Sourde, suivant sa coutume, à la voix de l’humanité que, du reste, elle n’a jamais entendue, Toulouse a satisfait son insatiable cruauté en déchirant [p. 47] cette victime: il lui a fallu cette proie pour assouvir sa rage, ce supplice pour repaître ses yeux! Dans son absurde jactance, dans son orgueil à contre-temps, elle s’est même vantée d’avoir agi conformément au devoir, et d’avoir maintenu avec zèle la dignité de notre religion. Elle n’a pas vu qu’elle prenait la souveraine iniquité pour la souveraine justice, et qu’en poursuivant avec cette atroce barbarie des infortunés sur qui planait un léger soupçon d’erreur, ou qui se trouvaient victimes d’une envieuse délation, elle les poussait, à force de tortures, non point à se repentir, mais à renier le Christ!...»
Cet anathème lancé au fanatisme religieux, ce long cri d’une indignation vibrante et sympathique, joint aux railleries précédentes contre les superstitions locales, devait achever de représenter Dolet comme un suppôt de Satan, comme un véritable fils de Bélial. Il fut donc réputé décidément, par les bonnes gens de Toulouse, hérétique damnable, luthérien au premier chef, en dépit de toutes ses protestations catholiques. Être luthérien, dans une pareille ville et à une pareille époque, c’était être pour le moins athée ou esprit fort; c’était sentir furieusement la hart ou le fagot. Après les hardiesses inouïes dont il avait émaillé sa seconde harangue, Estienne pouvait parfaitement s’attendre à la mesure de sûreté dont il se vit l’objet, de la part des magistrats toulousains. Heureusement que cette fois sa détention ne fut pas trop longue; il en fut quitte à bon marché. Au bout de quelques jours, il fut relâché par le crédit de Jacques de Minut, premier président du parlement [p. 48] de Toulouse, qui, à ce qu’il paraît, céda en cette circonstance aux chaleureuses sollicitations de Jean Dupin (Joannes Pinus)[43], évêque de Rieux, un des plus dévoués protecteurs de Dolet. Entrons, à cet égard, dans quelques détails.
Le troisième jour de son incarcération, c’est-à-dire le 28 mars 1533, Estienne écrivit au président la lettre suivante:
«Unum jam atque alterum diem hic occludor, nulli neque culpæ affinis, neque criminis cujuspiam gravioris accusatus. Me miserum! existimationi meæ dum animose servio, litteris dum contendo, ad obtrectatorum maledicta dum respondeo, ecce tibi, in carcerem conjicior. Fraudi mihi est, quod cum ornamento, tum præsidio esse debuerat, immodicum virtutis studium. At vero tu quando litteratis omnium cupidissime hactenus adfuisse visus es, obstestor te, Doleto ne desis, et hoc nomine tibi me obligari velis. Ipsum illud quæ abs te suo jure postulent, nulla sunt mea in te officia: observantia certe ea est, cui non id protinus negandum censeas. Prohibeor animi perturbatione ne plura hoc tempore scribam. Ad extremum, obsecro te etiam atque etiam vehementer, hanc nobis molestiam dele, si quidem tanta tua est in eloquentiæ studiosos benevolentia, quantum esse arbitror, prædicantque passim ad unum omnes. Hoc si a te impetrem, studiis nostris non parum consules, [p. 49] et tuæ humanitatis laudem augebis plurimum. Ego tanti beneficii tui memoriam sempiternam præstabo, tibique me mancipio et nexu proprium esse perpetuo profitebor. Vale. Datum Tholosæ, in carcere regio.»
«Me voici en prison depuis deux jours, et pourtant je ne me sens coupable d’aucune faute; nulle prévention grave ne s’élève contre moi. Malheureux que je suis! au moment où je défends ma réputation en homme de cœur, où je combats, la plume à la main, où je réponds aux diatribes de la calomnie, voilà qu’on me plonge au fond d’un cachot. J’ai vu se tourner contre moi la chose même qui devait m’illustrer, que dis-je? me défendre, mon amour sans bornes pour la vertu. Ah! je vous en conjure, vous qui, entre tous, avez chaudement appuyé jusqu’à ce jour les amis des lettres, n’abandonnez pas le pauvre Dolet, et daignez, à ce titre, m’enchaîner à vous par les liens de la reconnaissance. Sans doute, je n’ai pas le moindre service personnel à faire valoir auprès de vous; dans cette occasion, je ne puis invoquer que mon profond respect, et puissiez-vous en tenir compte! Dominé par le trouble de mon âme, je ne puis vous en écrire davantage. Un mot encore, cependant. Je vous en prie, je vous en supplie de toutes mes forces, tirez-moi de ce mauvais pas, s’il est vrai que votre sympathie pour les zélateurs de l’éloquence est aussi grande que je l’imagine, et que tout le monde le déclare, sans exception. Si j’obtiens de vous cette grâce, vous serez le sauveur de mes études, et vous augmenterez encore votre réputation de bonté. Quant à moi, j’éterniserai la [p. 50] mémoire d’un si grand bienfait, et je me reconnaîtrai à jamais votre obligé, votre fidèle serviteur. Adieu. Écrit à Toulouse, dans la prison du roi.»
Dupin soutint cette requête, en adressant de son côté à Jacques de Minut la chaude recommandation que l’on va lire:
«Ego nisi plane compertum haberem, quantopere bonis artibus et præclaris hominum ingeniis studiisque faveas, non scriberem ad te, nec rogarem ut Stephanum Doletum, juvenem rara et excellenti quadam ingenii bonitate præditum, commendatum haberes, eumque in suis periculis summo isto tuo et æquissimo patrocinio defendendum susciperes: quod tamen minime factum iri despero, si hominis doctrinam et eximiam eruditionem cognoveris. Scio enim: te non minus quam me delectabit singularis et incredibilis ejus ingenii dexteritas. Sic habet in promptu, sic velut in numerato linguam latinam possidet, ut ad quamcumque rem si verterit, ad eam potissimum et natus et aptus videatur... Cœperant nuper, inter hunc et Aquitanum nescio quem rhetorem, contentiones litterariæ quædam intercedere, quibus primum ego gaudebam, quod ita utriusque et ali ingenium, et augeri facundiam putabam... Verum, ut video, longe secus accidit. Nam illi factiosis partium suarum studiis incensi, facile a litteris ad arma prosilierunt. Sed in quibus nihil adhuc, ut audio, injuriæ acceptum sit. Doletus tamen conjectus est in carcerem, communique suorum invidia laborat et premitur, atque etiam gravissimo crimine contempti senatus in discrimen vocatur. De quo nolim [p. 51] tecum pluribus agere, ne tibi molestiam afferam. Amicus iste noster, qui ad te litteras meas tulit, faciet te de ea re quam copiosissime certiorem.»
«Si je ne savais parfaitement combien vous êtes favorable aux bonnes études et aux esprits d’élite qui les cultivent, je ne me permettrais pas de vous écrire; je ne vous recommanderais pas Estienne Dolet, jeune homme d’une intelligence rare et supérieure; je ne vous prierais pas de le défendre, au milieu de ses périls, par votre suprême et très-équitable patronage. Pourtant, je ne désespère en aucune façon de vous voir accéder à ma demande, quand vous connaîtrez la science et l’érudition hors ligne de mon protégé. Car, je le sais d’avance: vous ne serez pas moins charmé que moi de sa singulière et incroyable dextérité d’esprit. Il dispose en maître de la langue latine, à tel point qu’il semble né pour tout ce qu’il veut en faire... Il s’est élevé dernièrement, entre lui et je ne sais quel rhéteur aquitain, une discussion littéraire qui m’a réjoui d’abord, dans la pensée qu’ils y trouveraient l’un et l’autre un moyen d’exercer leur talent et d’augmenter leur éloquence... Mais, à ce que je vois, il en est résulté tout autre chose. Entraînés par les passions factieuses qui animent leurs partis respectifs, ces jeunes gens ont bientôt quitté le champ clos des lettres pour courir aux armes. Par bonheur, j’apprends que, jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu de malheur à déplorer à la suite de tout cela. En attendant, Dolet a été mis en prison, victime solidaire chargée de payer pour tous. Il est même sous le coup d’une imputation très-grave, [p. 52] puisqu’on l’accuse d’avoir manqué de respect envers le parlement. Assez sur ce chapitre: je craindrais de vous importuner. L’ami commun qui vous remettra ma lettre, vous donnera en même temps les plus amples détails sur cette affaire.»
Je ne m’étonne pas de la sympathie courageuse que ce docte prélat fit paraître alors pour notre Estienne. Il y avait entre eux comme une solidarité de persécution. Écoutons parler Dolet:
«Jean Dupin, nous dit-il à la page 60 de son second discours, cet homme que tout recommande à l’estime et à l’affection des gens de bien, vertu, sagesse, élévation de caractère, avait reçu d’Erasme de Rotterdam une lettre dans laquelle ce savant le priait de lui prêter, pour quelques mois, un manuscrit grec de Josèphe, trouvé dans la bibliothèque de Philelphe, et que sa vétusté rendait presque illisible. Aussitôt Dupin est accusé d’hérésie; sa lettre est interceptée, et le voilà contraint d’en faire lecture en plein parlement. Pour les vautours en robe noire, ce grand nom d’Erasme était une promesse de proie opime, et Dupin était sérieusement atteint et convaincu d’une correspondance avec lui. Donc, lecture est faite de l’épître: la besogne n’était pas facile, surtout en présence de barbares comme ceux-là. Enfin, leur grossière intelligence parvient à démêler, tant bien que mal, qu’Erasme demandait à Dupin son manuscrit de Josèphe. Rien de plus, rien de moins; pas un mot qui sente l’hérésie; tout est calculé, prudent, circonspect. Dieux immortels! quel désappointement pour nos sycophantes! Les loups du prétoire [p. 53] se voient arracher leur victime d’entre les dents. Absous par eux, bien à contre-cœur, du soupçon d’hérésie, Dupin s’abandonne à un rire inextinguible, en présence de toutes ces figures allongées.»
Quant à Jacques de Minut, Dolet nous a transmis, dans ses lettres, divers témoignages de sa gratitude envers ce digne président. Du reste, la plupart des savants ses contemporains l’honoraient comme leur protecteur, et le chérissaient comme leur père. Giovanni-Battista Egnazio (Joannes-Baptista Egnatius), dont j’ai eu déjà l’occasion d’entretenir mes lecteurs au début de ce travail, lui a fait hommage de ses trois livres: De Romanorum principibus, réimprimés par notre Estienne lui-même, en 1541, à la suite de son édition de Suétone, Argelati, dans sa Bibliothèque des écrivains milanais, lui consacre un article, col. 929, et nous apprend qu’il mourut le 6 novembre 1536. En 1538, Dolet lui composa, dans ses Poésies latines, IV, 16, l’épitaphe suivante:
«Assez longtemps j’ai vécu, rendant la justice aux innocents et aux coupables; enfin, j’ai voulu voir comment Rhadamanthe s’en acquittait envers les ombres. Passant, si le même désir te sollicite, viens me retrouver.»
Après la mise en liberté d’Estienne, ses ennemis ne se tinrent pas pour battus. Leur désappointement [p. 54] devint de la fureur, et leur fureur tourna bientôt à la frénésie. Ils soudoyèrent des assassins contre la victime qui leur échappait, firent courir à son sujet d’infâmes libelles, et promenèrent sur un char, dans les rues de Toulouse, un cochon revêtu d’un écriteau, qui portait en grosses lettres le nom de DOLET[44].
Plusieurs écrivains, entre autres Niceron, se sont amusés à noircir le caractère de notre savant, à le représenter comme un être fielleux et vindicatif. Certes, je crois qu’on le serait à moins!
Lui-même avait prévu cette accusation, et il y a répondu, suivant moi, d’une manière victorieuse, dans la lettre déjà citée, qu’il adresse à Guillaume Budé, son ami, en tête du premier volume de ses Commentaires sur la langue latine. Voici le passage:
«Tu vero non dubitas, sciuntque certo omnes qui meam lenitatem norunt, si quid in eos ardentius conscripsi, non ferendis injuriis mihi stomachum, qui antea hebetabat, præter sententiam fuisse exacutum. Incalui forte impotentius, atque non sine iratioris animi (id quod inepte inimici mihi objiciunt) specie, sed quem incenderat læsa violataque patientia. Quare æquo animo ferant, qui innocentem ignominiis onerarunt, ac perditis profligatisque sententiis jugularunt, justo et mihi in calamitate relicto solo styli oratoriæque exercitationis præsidio, meum me dolorem ab eis inustum ulcisci contendisse.»
«Vous ne doutez pas, et tous ceux qui connaissent [p. 55] la douceur de mon caractère le savent parfaitement, que si j’ai mis trop d’ardeur dans ma polémique, c’est que d’intolérables injures avaient, contre toute attente, exaspéré mon humeur si calme auparavant. Je me suis peut-être échauffé sans trop de retenue, et en laissant paraître (suivant le reproche inepte de mes ennemis) un esprit trop irrité; mais ma patience avait été réellement poussée à bout. Qu’ils en prennent donc leur parti, ceux qui m’ont abreuvé d’ignominies malgré mon innocence, et qui m’ont comme égorgé dans un infâme guet-apens judiciaire: il ne me restait, dans mon malheur, que ma plume, que mon talent oratoire; c’est avec cela que j’ai cherché à me venger, en les stigmatisant à mon tour du fer chaud de la douleur.»
En présence de l’atroce acharnement de ses persécuteurs, Dolet se réfugia dans une campagne assez éloignée de la ville, pour se mettre à l’abri de leurs embûches. Mais, avant son départ, il ne put résister à un mouvement de vengeance, et les perça, l’un après l’autre, des flèches acérées de l’épigramme. Il s’en prit d’abord à Pinache[45], son ennemi intime: Ab Jove principium... puis au juge-mage Dampmartin[46], enfin à Gratien du Pont, sieur de Drusac[47]. [p. 56] Ce Drusac venait de composer les Controverses du sexe masculin et féminin, publiées pour la première fois, sans nom d’auteur, à Toulouse, chez Jacques Colomiez, 1534 (in-fol., caract. goth.). Il se permettait, dans cet ouvrage, toute sorte de blasphèmes contre la plus belle moitié du genre humain. Comme un courtois chevalier, Dolet prit en main la défense des dames, et tonna de toutes ses foudres épigrammatiques contre ce crime de lèse-beauté.
Les clientes ne pouvaient manquer de récompenser l’avocat. Il paraît, effectivement, que notre Estienne gagna sa cause auprès d’elles, car un ami lui écrivait, le 5 juin 1533:
«Sachez que vous êtes regretté à Toulouse, et que ceux qui vous aiment sont fâchés de votre éloignement, à commencer par les dames les plus honnêtes et de la plus haute condition, auprès desquelles vous avez trouvé grâce, en faveur de vos épigrammes contre le Drusac.»
Celui-ci, bien entendu, n’en devint que plus ardent à la vengeance. Mettant aussitôt son influence aristocratique au service de son ressentiment personnel, il obtint du parlement un arrêt qui défendait à Dolet de rentrer dans Toulouse, et même, probablement, [p. 57] de séjourner plus longtemps dans l’étendue de la juridiction parlementaire[48].
La protection puissante du président Bertrandi[49], protection qu’il devait à l’amitié de Hugues Salel[50], lui fut dans ce cas absolument inutile. Il fut obligé de partir au plus vite. Le malheureux étudiant se mit donc en chemin pour Lyon, accompagné de son Pylade, le brave Finetius: mais tant de tracasseries, tant de persécutions, tant de tortures physiques et morales, n’avaient pu que réagir d’une manière funeste sur sa santé déjà peu robuste. Ce n’est pas tout: la chaleur d’un été torride, les fatigues d’un voyage incommode, que son état maladif lui rendait plus pénible encore, toutes ces causes réunies lui redonnèrent une fièvre dont il se croyait débarrassé. Ce fut au point qu’il se trouva forcé d’interrompre sa route et de s’arrêter quelques jours au Puy en Velay. Néanmoins, faisant effort sur lui-même, il se remit en [p. 58] marche et finit par arriver à Lyon, le 1er août 1533, anéanti de lassitude, brisé de désespoir et conservant à peine un souffle de vie!
C’est alors, sans doute, qu’il fit entendre à son ami Cottereau ce cri de douleur furieuse: Expetendam esse mortem, Il faut souhaiter la mort; chant lugubre, aux strophes tourmentées comme son âme, poésie rauque et stridente, rivale du pleur éternel des damnés:
«Changer la vie contre la mort... qui n’accepterait?... à part l’être absolument inerte, l’idiot, le stupide bétail. Être soulagé de ce corps, qui donc, mais qui donc s’en trouverait malheureux?
«En sommes-nous à ce degré de folie, qu’il nous plaise d’étouffer sans cesse dans une prison fangeuse; ou, comme la nef sous l’autan furieux, d’être ici-bas le jouet de mille tempêtes?
«Hélas! hélas! trop ridicule humanité!... Quel [p. 59] mal n’apporte point un jour à l’autre? Que de souffrances, que d’horribles angoisses ne vient-il point ajouter à la somme de nos misères?...»
Et plus loin, dans la même pièce:
«Insensé! pourquoi te cramponner à la vie? pourquoi t’attacher à un corps que toutes les douleurs ont choisi pour cible? pourquoi souhaiter, misérable fou, l’éternité de ton supplice?
«Ne tremble pas ainsi devant l’aiguillon de la mort: elle te donnera le bonheur, si l’espoir de l’autre monde n’est pas un rêve; sinon, tu lui devras le repos du néant!»
Mors dabit sensu carere... Voilà probablement une des phrases qui ont dû faire traiter ce pauvre Dolet d’athée et de matérialiste. Mais a-t-on jamais eu le droit d’interpréter comme une conviction formelle le blasphème involontaire d’un cœur saignant et torturé? Le Christ lui-même, du haut de sa croix, ne s’est-il pas écrié dans une heure d’angoisse: Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m’as-tu abandonné?
[28] On en trouvera la preuve dans les lettres et les poésies qui suivent ses Orationes in Tholosam, p. 136 à 139 et 204.
[29] J’emprunte ce détail et ceux qui vont suivre au discours préliminaire de Simon Finetius, sur les Orationes Doleti in Tholosam.
[30] Doleti in Thol. orat. prima, p. 6 et 7.
[31] J’aurai souvent à parler de ce personnage dans le cours de mon travail, et je vais dès à présent le faire connaître à mes lecteurs.
Claude Cottereau naquit à Tours, au commencement du seizième siècle. Il s’acquit une grande réputation comme jurisconsulte, et, par la suite, ayant embrassé l’état ecclésiastique, obtint un canonicat à Notre-Dame de Paris, où il mourut vers 1560. Outre sa science du droit, il possédait à fond le grec, le latin et même l’hébreu.
Dans sa jeunesse, il avait composé l’ouvrage suivant:
De Jure et Privilegio militum libri tres, et de Officio imperatoris liber unus. «Du droit et privilége des soldats, trois livres; et du devoir du général, un livre.»
Il en confia le manuscrit à Dolet, qui l’imprima en 1539, in-fol., et le dédia, par une belle épître latine, au cardinal Jean du Bellay.
[32] Lettre de Simon Finet à Claude Cottereau (Simon Finetius Claudio Cotteræo salutem), en tête des Orationes duæ in Tholosam.
[33] On le voit: ces pauvres Turcs n’ont jamais eu, vis-à-vis des giaours, l’intolérance farouche que tant de bonnes âmes leur supposent chrétiennement. Le fait curieux que Dolet invoque à l’appui de sa thèse, reçoit, des événements auxquels nous avons assisté naguère, un véritable cachet d’actualité.
[34] Les Toulousains parlaient la langue d’oc; Estienne était un enfant de la langue d’oil. A l’époque où ce discours fut prononcé, la différence, je dirais presque l’hostilité entre les deux dialectes, devait encore se faire sentir très-fortement.
[35] Orat. prima in Thol., p. 9 et 10.
[36] Niceron prétend que ce Pinache était Toulousain; mais Dolet l’appelle Gascon (In Petrum Pinachium Vasconem, p. 129 des Carmina), et Simon Finet le qualifie de même, dans sa préface aux deux harangues contre Toulouse.
[37] Orat. sec. in Thol., p. 33 à 36.
[38] Orat. sec. in Thol., p. 33 à 36.
[39] Dans un opuscule latin publié à Rome en 1541, in-8o, et qui porte le titre suivant: Adversus Doleti calumnias, «Contre les calomnies de Dolet». Il en sera question plus loin, quand je parlerai de la querelle des cicéroniens.
[40] Orat. sec. in Thol., p. 56 à 58.
[41] Orat. sec. in Thol., p. 54 à 56.
[42] Orat. sec. in Thol., p. 54 à 56.
[43] Dolet lui adresse une ode alcaïque, qui forme la 51e pièce du livre II de ses Poésies latines. Voyez aussi l’épitaphe de ce même Dupin, ibid., IV, 15. Du reste, elle n’offre rien de bien remarquable.
[44] Voir la correspondance qui suit les deux Discours contre Toulouse.
[45] In Petrum Pinachium Vasconem, Carm., III, 23 et 24.
[46] In Dampmartin, judicem Tholosanum, ibid., III, 22.
[47] Ibid., III, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
Voici, du reste, un échantillon de la manière dont Dolet traita Drusac, à propos de son livre des Controverses:
Ce latin-là, surtout dans la première strophe, n’est vraiment pas à traduire. On me permettra donc, pour cette fois, de déroger à mes habitudes.
[48] Dolet fut remplacé, comme orateur de la nation de France, par un nommé Thomassin. (Vol. cité, p. 93; Maittaire, Ann. typ., t. III, part. 1, p. 31 et 32.)
[49] Voyez, dans les Poésies latines, une petite pièce: Ad Joannem Bertrandum, præsidem primarium senatus Tholosani; «A Jean Bertrandi, premier président du parlement de Toulouse.» III, 26.
[50] Dolet l’en remercie, dans les termes suivants:
«Il y avait longtemps que j’étais tourmenté d’un violent désir; je voulais connaître un personnage qui, tout à la fois affable et grave, sût par là conquérir en même temps l’estime et l’amour. Et voilà justement le bonheur que je te dois: tu m’as acquis l’amitié d’un homme plus facile, et avec cela plus imposant que le reste des mortels. Que nous sommes heureux l’un et l’autre, toi, de m’avoir procuré ce bienfait, et moi, de l’avoir reçu!»
Carm., II, 44.
[51] Carm., I, 15.


Épisode littéraire. — Dolet aux Jeux floraux.

Avant de quitter Toulouse pour ne plus y revenir, avant de secouer à jamais sur cette ville inhospitalière la poussière de nos sandales, mentionnons dans un chapitre à part certain épisode littéraire dont elle fut le théâtre, et qui se rattache encore à notre héros. Ce sera, du reste, si l’on veut, un temps d’arrêt, un moment de repos, une halte qui nous permettra de respirer, au milieu du voyage assez souvent pénible que nous entreprenons à la suite de cette existence aventureuse.
Tout le monde connaît Clémence Isaure et les Jeux floraux dont elle passe pour avoir été la fondatrice. Au concours de 1496, une dame de Villeneuve la célébra en ces termes:
[p. 62] Deux ans après, nous rencontrons un autre lauréat du gai savoir, dont le triomphe est annoncé de la manière suivante:
Causo per laquel mosseu Bertrand de Roaix gasanhet l’églantina novella, que foë dada per dona Clamença, l’an 1498. «Cause pour laquelle monsieur Bertrand de Roaix gagna l’églantine nouvelle donnée par dame Clémence, l’an 1498.»
En 1530, Jean de Boysson, professeur de droit à Toulouse, avec qui nous ferons connaissance dans le chapitre suivant, célébra également, en vers latins et français, l’institution de la belle Isaure.
Notre Estienne, à son tour, stimulé sans doute par cet exemple d’un ami, se laissa tenter par la même ambition. En 1532, c’est-à-dire, selon toute apparence, antérieurement à ses démêlés avec Pinache, Drusac et consorts, il concourut aux Jeux floraux, armé de dix poésies latines, que, plus tard, il inséra l’une après l’autre, dans son recueil déjà cité de 1538.
La première est adressée aux Muses (Ad Musas: quo carmine usus est Tholosæ in publico litterario certamine, quum illic versu contenderet). En servant féal, il se recommande à ses dames, avant de se lancer dans le tournoi littéraire:
«Muses, troupe sacrée, cohorte bienheureuse, race féconde des cieux haut-tonnants, c’est vous qui réchauffez les doctes dans votre sein plus blanc que la neige; c’est par vous que l’on arrive à la perfection de l’art, et sans votre aveu nul ne peut l’atteindre. Divines sœurs, portez ici vos pas; Muses, troupe sacrée, cohorte bienheureuse, contentez mon désir, exaucez ma prière en me prêtant votre appui.
«Ne craignez pas d’abandonner, à ma requête, les verdoyants sommets de l’Hémus, les ondes de la source Aganippide ou les grottes mystérieuses de la roche Aonienne.
«Aidez en moi le compagnon de votre assemblée, l’associé de votre art; ceignez mon front d’un noble laurier, abreuvez-moi des eaux Castaliennes; donnez-moi la voix d’Apollon quand il chante, lui, ce dieu si beau! donnez-moi celle dont vous répondez à la sienne, alors que, dispersant autour de vos tempes votre blonde chevelure, vous conduisez vos chœurs dansants de manière à charmer tous les regards. C’est ainsi que j’épancherai des chants limpides, d’une élégance plus que virgilienne, d’une grâce à rivaliser avec la sémillance de Catulle.
«Oh! si, protégé par vous, je sors vainqueur de la lutte, par Jupiter! comme j’exalterai, célestes [p. 65] Piérides, votre nom et la gloire de Phébus! Avec quel zèle je célébrerai les fêtes mémorables du Parnasse!
«Divines sœurs, portez ici vos pas; Muses, daignez approcher de ma bouche un peu rude vos lèvres pleines de rosée, vos lèvres si douces, si tendres, si délicates! La reine de la persuasion, Pitho, les a trempées de son miel; que cette noble déesse humecte de la même liqueur mon gosier trop aride.
«Un censeur morose blâmera peut-être ces vœux peu réservés; peut-être encore ma barbe inculte effraiera vos yeux charmants, et vous aurez peur de respirer mon haleine virile. Souriez cependant, divines sœurs, aux efforts d’un poëte novice, et faites vibrer mon âme sous votre inspiration. En un clin d’œil, elle rendra mon esprit aussi disert qu’il est rude et grossier.»
Dans la seconde pièce, Dolet implore sur le même ton l’assistance de Phébus; dans la troisième, il célèbre les juges du concours; la quatrième est un panégyrique de Clémence Isaure; la cinquième, que je vais citer et traduire, parce qu’elle ne manque pas d’une certaine grâce, d’une certaine couleur antique, n’est autre chose, comme on pourra le voir, qu’une espèce de bouquet à Cloris, galamment adressé aux beautés toulousaines (ad puellas Tholosæ: quod in eodem certamine recitatum est). Écoutons le jeune humaniste:
«Assez et trop longtemps l’hiver, l’âpre hiver vous a retenues tristement captives; secouez sa langueur, ô jeunes vierges! Bannissez les soucis qui creusent les joues, assombrissent le front, enlaidissent tous [p. 67] les membres. Oui, assez et trop longtemps l’hiver, l’âpre hiver vous a retenues tristement captives; secouez sa langueur, ô jeunes vierges!
«A l’heure où la terre enfante, fécondée par le souffle du renouveau; où partout les arbres se parent d’un luxuriant feuillage, d’une verte chevelure; ornez, vous aussi, votre visage et votre sein. Alerte! volez, d’un pas rapide, à travers la campagne fleurie. Diane, la chaste déesse qui vous protège, ne se cache plus au fond des grottes rocailleuses; elle a montré sa tête charmante, elle respire enfin sous un beau ciel calme! Errante au milieu des bois, elle arrête sous ses traits la course foudroyante des sangliers; entourée de ses nymphes, elle conduit avec grâce leurs danses bruyantes et joyeuses. Vienne la sueur qui les inonde, la soif qui les dévore: tout près d’elles sont de fraîches fontaines, pour étancher leur soif brûlante, pour baigner leurs membres accablés de chaleur.
«Puis, étendues sous le vert abri d’un hêtre, elles savourent, d’une oreille attentive, les doux concerts d’un millier d’oiseaux; elles étudient la plaintive romance dont Philomèle les ravit, et, chanteuses rivales, font retentir aussi de leurs modulations les échos de la voûte céleste. Le feuillage du thyrse environne leurs tempes; d’une main légère elles tressent en guirlandes variées l’hyacinthe et la rose purpurine.
«Et tant de séductions ne vous décideraient pas à vivre de la vie des champs, à devenir les suivantes de Diane, à partager avec elle les délices qui [p. 68] l’enchantent? Allons, livrez-vous aux jeux folâtres, faites-vous une existence joyeuse. Vous en avez le loisir; votre âge le permet, et le sourire de la jeune saison vous y invite.»
Les cinq autres pièces comprennent: un Eloge de Paris, que j’aurai occasion de citer à la fin du chapitre suivant; une nouvelle invocation; deux odes en l’honneur de la Vierge; enfin, un dernier appel à la Muse (Ad Musam: quod carmen ultimum fuit recitatum in certamine).
Dolet en fut pour ses frais poétiques, j’ai tout lieu de le croire[54]. Vainqueur, il n’eût pas manqué de nous apprendre son triomphe, car je dois convenir que la modestie était son moindre défaut. Maintenant, je ne m’étonnerais pas que les poésies couronnées ne fussent réellement inférieures aux vers latins qu’on vient de lire. Nous savons tous qu’une semblable anomalie n’est pas absolument sans exemple dans les annales des concours académiques. Églantine d’or ou souci d’argent,—le nom pas plus que la chose n’y fait rien,—il faut parfois se baisser pour cueillir ces fleurs-là. Certaines originalités, particulières au [p. 69] vrai talent, effarouchent des juges pudiques, amoureux quand même de la vulgarité coulante; et l’on est souvent tenté de répéter avec Horace: Aurea mediocritas!
Quoi qu’il en soit, le souvenir de son échec aux Jeux floraux dut entrer pour une forte dose dans la rancune de Dolet contre une ville barbare. Quand les harangues antitoulousaines firent explosion, c’étaient des armes chargées depuis longtemps.
[52] Carm., III, 27.
[53] Carm., III, 31.
[54] Voulté semble faire allusion, dans les vers suivants, à cette déconvenue de son ami:
«O Clémence! quel accès de folie t’a fait choisir pour héritière une maison ingrate? Je veux bien que tes intentions aient été bonnes, mais on ne s’y est jamais conformé; tes couronnes ne tombent que sur les têtes sans cervelle....»



A Lyon. — Sébastien Gryphius. — Publication des deux harangues contre Toulouse. — Voyage à Paris. — Science, poésie et musique.

Le principal but de notre humaniste, en s’arrêtant à Lyon, était d’y faire imprimer ses deux discours contre Toulouse, avec les épigrammes latines dont il accablait ses ennemis. Faible et malade comme il l’était encore, il lui fallut cependant différer l’exécution de ce cher projet de vengeance[55]. Sa première visite, en arrivant, fut pour le célèbre imprimeur Sébastien Gryphius[56], à qui son ami Jean de Boysson[57] l’avait chaudement [p. 72] recommandé. Gryphius le reçut avec une cordialité touchante[58], et voulut même, à toute force, le faire loger dans sa maison. Profondément ému d’un accueil aussi patriarcal, surtout après les orages qu’il venait de traverser, Dolet remercia ce digne homme avec effusion; mais, par un louable sentiment de délicatesse, il refusa de lui être à charge. Une docte et solide amitié s’établit alors entre ces deux hommes, si bien faits pour se comprendre malgré la profonde différence de leurs caractères; amitié dont notre Estienne ne se départit jamais, et dont il a laissé dans ses œuvres de nombreux monuments[59].
[p. 73]
Bientôt après, tandis qu’il rétablissait à l’air pur de la campagne sa santé défaillante, les harangues vengeresses, échappées d’une presse clandestine[60], coururent un beau jour dans les mains d’un public avide. Comme il pouvait y avoir du danger pour Dolet dans une publication de cette nature, ce ne fut pas en son propre nom qu’elle eut lieu; Simon Finetius, un de ses fidèles, avec qui déjà nous avons fait connaissance, prétendit, dans une lettre-préface adressée à Claude Cottereau, leur ami commun, s’être permis de dérober les manuscrits de l’auteur et les avoir édités à son insu. Mais j’ai de fortes raisons pour soupçonner, dans cet innocent manège, un de ces officieux mensonges que l’amitié hasarde en pareil cas, sans encourir pour ce fait la damnation catholiquement réservée à tout péché mortel. Au surplus, le lecteur en jugera; je vais traduire ici les paroles mêmes de ce bon Finetius.
«Verrez-vous un crime dans ma façon d’agir, [p. 74] écrit-il à Cottereau, ou plutôt ne sera-ce pas à vos yeux un titre de gloire? Voici le fait en peu de mots: prononcez en toute justice. Estienne Dolet, vous n’êtes pas sans le savoir, m’est uni par l’amitié la plus intime. Contraint par les menaces, et plus encore par le crédit pernicieux de je ne sais quel misérable, à quitter la ville de Toulouse, il se réfugia, sous ma conduite, dans celle de Lyon. Il se proposait d’y publier tout ce qu’il avait écrit contre Toulouse, et ce qu’il avait adressé dans cette conjoncture, soit en prose, soit en vers pleins d’élégance, à différentes personnes; il voulait, en un mot, armé d’un style de fer, se venger des outrages et des avanies qu’il avait eues à subir de la part des Toulousains. Mais à peine étions-nous arrivés, qu’une grave indisposition dont il n’était pas encore bien remis le reprend de plus belle, et finit même par dégénérer en fièvre quarte. Vous savez, mieux que personne, de quelle hauteur, de quelle fermeté d’âme il est doué; par quel stoïque dédain la trempe énergique de son caractère se révèle en face des malheurs qui viennent l’assaillir, et quel héroïsme il oppose à la souffrance. Cependant, il se lasse de cette lutte sans trêve contre l’injustice du sort; il renonce à publier ses écrits, et n’a plus qu’une chose en tête, c’est de soigner, le plus tranquillement possible, sa convalescence. Mais moi, je n’ai pu souffrir que cette maladie importune reculât plus longtemps la réparation due à l’honneur de mon ami; je n’ai pu voir ses infâmes persécuteurs se targuer plus longtemps de leur impunité. Apprenez donc à quelle résolution je me suis arrêté, pour défendre [p. 75] la réputation d’un homme que j’aime, et décidez ensuite quelle part d’éloge ou de blâme il doit m’en revenir. Vous connaissez comme moi les deux discours qu’il a prononcés à Toulouse, au milieu d’une affluence d’auditeurs telle, que nul orateur de nos jours ne peut se flatter d’en avoir jamais réuni de semblable. Vous savez, en outre, qu’il n’y traitait point un sujet en l’air, mais un thème réel et que les circonstances avaient eu soin de lui fournir. Eh bien! ces deux discours, je les ai secrètement dérobés à leur auteur; je les ai enrichis, toujours furtivement, de deux livres supplémentaires, composés d’épîtres latines qui cadrent à merveille avec les discours en question; puis, comme une proie si riche redoublait mon avidité, j’ai recueilli, par la même occasion, deux livres de ses poésies latines, et j’ai publié le tout à l’insu et sans l’avis de l’auteur.»
La même tactique se reproduit dans la lettre suivante d’un certain Chrysogon Hammonius, insérée après celle de Finet, toujours en guise de précaution oratoire:
«Le hasard, dit ce nouveau compère, m’appelait hier chez l’imprimeur. Là, je rencontre Simon Finetius, un ami intime de Dolet. Intrigué par le trouble et l’émotion que je remarquais sur son visage, je lui demande aussitôt ce qui l’amenait chez notre typographe. Il s’agit d’un trésor que je veux porter à la connaissance du public, me répond ce jeune homme, qui n’est pas médiocrement versé dans la science des bonnes lettres. En même temps, il me montre les deux discours de Dolet. Que j’encoure toute la haine [p. 76] des dieux, si, jamais de ma vie, j’ai rien lu de plus docte, de plus élégant! Il les avait, disait-il, dérobés à Dolet, et son dessein était de les faire servir à la gloire de son ami... Utile et généreux larcin, que j’ai couvert de ma plus vive approbation, en conseillant avec instance à Finetius de se donner tout le monde pour complice... Je renonce à vous exprimer la colère avec laquelle notre auteur accueillera cette édition subreptice de ses œuvres, et la grave responsabilité qu’il fera peser sur nous. Mais, quelle que puisse être sa fureur, on n’en jouira pas moins de cette aubaine inespérée.»
L’aventure de Toulouse avait complètement dégoûté Dolet de l’étude du droit. Résolu de revenir à ses premières amours, à son cher Marcus Tullius, il quitta Lyon et se rendit à Paris, où il arriva le 15 octobre 1534[61]. Il venait d’atteindre ses vingt-cinq ans. Avec quelle ivresse de bonheur il dut saluer la grande ville, après plus de trois années d’une absence angoisseuse! C’était le théâtre de ses jeunes études; c’était, en quelque sorte, sa mère scientifique, l’alme nourrice qui avait abreuvé son enfance du lait des bonnes lettres. Aussi l’aimait-il d’un cœur filial, comme l’atteste un brillant éloge qui fait partie de ses poésies latines, et dont mes lecteurs, sans doute, ne trouveront pas mauvais que j’insère ici le texte et la traduction:
«Déesse, qui gouvernes l’essaim des vierges Libéthrides, et toi, souverain de la colline toujours verte, ô père des poëtes! allons, prends en main ta lyre sonore, et, de ton trône du Parnasse abaissant ici tes pas, éveille sur tes cordes une mélodie nouvelle, [p. 78] entonne un chant nouveau. Rends hommage à cette ville que fortifient de superbes tours, que la Seine aux riches ondes traverse de son beau fleuve, qu’une vaste enceinte protège d’un triple mur; enfin, qu’embellit un printemps éternel, qu’un ciel serein caresse de ses brises, et que Titan, le père du jour, échauffe de son astre ami.
«Bacchus et Cybèle ont, à l’envi, comblé ce séjour de leurs bienfaits; les Napées l’entourent de champs fleuris et d’arbres chevelus qui tempèrent la force de la chaleur, quand le soleil blanchit d’intensité, et que les guérets altérés se crevassent de sécheresse. A cette ville encore, celles qui président aux sources, les jeunes Naïades, ont donné des fontaines dont le lit n’est jamais fangeux.
«C’est elle que les Muses ont, depuis longtemps, élue pour demeure; elle qu’embellit la culture des arts, l’exacte observance de la justice; elle, enfin, qu’illustre un parlement dont la conduite rigide lutterait avec celle de Caton, ou de tout autre juge encore plus sévère.
«Que dire de plus? La peindrai-je florissante en hommes, non d’un esprit barbare et grossier, mais que Pallas elle-même, sous sa grotte Aonienne, a doucement réchauffés dans son sein, comme de chers nourrissons?
«Ah! qu’Athènes lui céderait volontiers la palme, en la voyant surgir, constellation nouvelle, au ciel de l’histoire! Que volontiers Rome inclinerait devant elle son grand nom, sa vieille gloire, si elle entendait la terre et l’océan retentir de tant d’illustration!» [p. 79]
L’auteur anonyme du Calendrier des bergères, vieux poëme du quinzième siècle, avait déjà fait, en ces termes, le panégyrique de la célèbre capitale:
N’en doutons pas: notre Estienne, de retour enfin dans son cher Paris, a dû ressentir quelque chose de cet enthousiasme naïf et sincère. Pouvait-il prévoir la dernière caresse que lui réservait cette mère si tendre... le baiser des flammes catholiques, en place Maubert, à deux pas de Nostre-Dame, le noble lieu! [p. 80]
Il me semble voir le jeune humaniste, à cette époque décisive de sa vie. Fatigué par une veille laborieuse, il vient de s’assoupir malgré lui devant sa lampe qui s’épuise à son tour, devant sa table de travail encombrée de livres et de manuscrits; sa main sèche et nerveuse a laissé retomber la plume qui, tout à l’heure encore, écrivait une page de plus des Commentaires sur la langue latine; une foule d’images confuses passent et repassent à l’horizon vague de ses rêves.
En ce moment, deux femmes surgissent: l’une, blonde et souriante; l’autre, brune et sévère.
«Jeune homme, lui dit celle-ci, te voilà maintenant au seuil de ta destinée virile. Je suis ta mère, enfant! je suis la Science... Viens avec moi.
«Guidé par mon flambeau, tu pénétreras sans crainte les lointaines ténèbres du passé; tu comprendras le présent, tu devineras l’avenir; tu sonderas les profondeurs de l’océan, et le cœur humain, plus profond encore; tu passeras la grande revue des générations éteintes, qui toutes défileront sous tes yeux, avec leurs lois, leurs mœurs, leurs langues, leurs sentiments et leurs actes, leurs passions et leurs pensées, leurs préjugés et leurs misères; comme Archimède, enfin, tu saisiras le monde entre les deux branches de ton compas, et tu entreras de vive force dans l’immense secret de Dieu!»
«Jeune homme, reprend d’un ton suave l’autre apparition, écoute-moi plutôt, car je suis à moi seule la vérité et la vie. Je suis ta sœur, ô mon frère! je suis la Poésie... Viens avec moi. [p. 81]
«Ne va point pâlir sur de vieux in-folio, sur une lettre morte. Mon livre est bien plus beau que celui de la Science; car il s’intitule la nature, le printemps, la jeunesse, la femme, l’amour, l’éternelle splendeur! Au lieu de t’ensevelir, vivant cadavre, dans le sépulcre nauséabond de l’étude; laisse-toi conduire, de ma main blanche et douce, à l’ombre des vertes feuillées qui frissonnent, aux marges des frais ruisseaux qui chantent; viens, te dis-je, viens écouter et reproduire les grandes voix du ciel et de la terre, les ineffables harmonies d’en haut, les délicieux soupirs d’en bas. Savoir n’est rien, sentir est tout!»
Il hésite, le savant; il hésite, le poëte. Il regarde, l’une après l’autre, les deux fées qui le sollicitent. L’une est si jolie! l’autre est si belle! Mais, au bout d’une seconde, l’éclair de la décision vient illuminer son mâle visage.
«Oh! s’écrie-t-il dans un fervent transport. Dieu me préserve de choisir entre vous! Toutes deux vous êtes saintes, et toutes deux je vous aime. Je me sens le cœur assez vaste pour vous y loger ensemble, pour y enfermer à jamais votre double amour. Comme le démon de l’Evangile, je m’appelle Légion! Votre culte fraternel m’accompagnera jusqu’à la tombe; jusqu’au dernier moment je chanterai, jusqu’au dernier moment j’étudierai. Et c’est ainsi que j’atteindrai l’heure, l’heure salutaire et divine, où, dégagé de mon enveloppe périssable, affranchi de la terre et des hommes, je serai poëte avec les anges, et savant avec Dieu!»
[p. 82] Dolet tint parole: il fut fidèle toute sa vie à ce double culte, à cet amour sacré de la poésie et de la science. Une troisième sœur, la Musique, vint également prendre place dans cette grande âme. C’était la seule distraction qu’il se permît, en même temps que les vers latins ou français, pour faire trêve à ses absorbantes préoccupations de philologue; et c’est lui-même qui nous a transmis cette curieuse confidence, avec son habituelle chaleur de style. Écoutons-le parler:
«Chacun vante son plaisir. Et moi, n’en ferai-je pas autant pour le mien, surtout quand il est si honnête, si pur, si cher à tout esprit d’élite? Oh! si, j’en parlerai... Quel est donc ce bonheur qui m’enivre? La table? l’ivresse? le luxe effréné des vêtements? la danse? le jeu? l’amour? Pas le moins du monde. La musique, l’harmonie, voilà ma seule volupté. Quoi de plus propre, en effet, à remuer comme à calmer les âmes? Quoi de plus efficace pour éteindre le feu de la colère, ou pour en accroître l’intensité? Quoi de plus convenable pour distraire l’esprit d’un homme de lettres? Le jeu, le vin, la table, l’amour, ce sont là des passe-temps dont je m’abstiendrai sans peine, ou dont je n’userai, du moins, qu’avec modération. Mais il n’en est pas de même de la musique; elle seule, entre toutes les jouissances d’ici-bas, me séduit, me captive, me plonge dans un océan d’extases! Je lui dois ma vie, je lui dois tous mes studieux efforts. Ah! soyez-en bien convaincus: je n’aurais pu supporter, comme je l’ai fait, le travail assidu, colossal, immense de mes Commentaires, si la musique, avec sa voix [p. 83] tantôt imprégnée d’une douceur qui me charmait, tantôt vibrante d’une énergie dont j’étais enflammé, ne m’eût rappelé sans cesse à ma rude tâche de glossateur, au moment même où un accès de dégoût me la faisait rejeter bien loin[63]!»
[55] Voir la première harangue, p. 125, 126 et 127.
[56] Son nom allemand était Greyff; il eut raison de lui donner une forme latine, afin de le rendre un peu plus euphonique. Natif de Reutlingen, en Souabe, Gryphius mourut à Lyon en 1556, et survécut par conséquent dix années à notre Dolet. Un poëte contemporain, Charles Fontaine, lui consacra le ridicule quatrain que voici:
[57] Trompé sans doute par le nom latin Joannes Boyssonæus, Née de la Rochelle appelle ce personnage Jean Boyssonnée; mais, dans la correspondance qui suit les deux Discours contre Toulouse, il est appelé partout Joannes a Boyssone, que j’ai cru devoir traduire Jean de Boysson. C’est à Jean de Boysson que Dolet adresse le troisième livre de ses Poésies latines, et la première des pièces qui le composent. Rabelais le mentionne également dans son Pantagruel, III, 29.
Il paraît que ce Jean de Boysson eut aussi maille à partir avec les bonnes gens de Toulouse. «Je ne passerai pas sous silence, dit Estienne (Orat. II, p. 59), la conduite infâme des Toulousains envers Jean de Boysson, le plus estimable des hommes, mais atteint et convaincu de deux grands crimes, la science et la fortune. Les lâches délateurs qui dévoraient des yeux cette fortune, l’ont circonvenu de mille calomnies, au sujet de son prétendu manque de respect envers la religion. Innocent, ils l’ont fait condamner; ils lui ont extorqué une amende énorme.»
[58] «Je suis allé voir Sébastien Gryphius, écrivait quelque temps après notre Estienne à Jean de Boysson, et je l’ai salué de votre part; c’est un homme tout à fait serviable et bien digne de l’amitié des savants. Il a montré beaucoup de sensibilité quand je lui ai parlé du bonheur que vous aviez eu de recouvrer votre emploi.»
[59] Il lui dédie, en ces termes, le quatrième livre de ses poésies:
«Estienne Dolet à Sébastien Gryphius, salut.
«Dans le quatrième livre de mes Poésies, ma tâche principale consiste à donner aux vertueux des témoignages de leurs vertus après leur mort. C’est aussi le but que, dans ta louable ardeur, tu poursuis avec moi par ton art, quand les chefs-d’œuvre de l’antiquité, en même temps que les ouvrages qui feront vivre la gloire de nos contemporains, sortent si beaux de tes presses, pour passer à la postérité la plus lointaine. Voilà pourquoi j’ai voulu te dédier ce quatrième livre, qui atteste en nous un double effort si honorable, et où l’amitié, qui depuis longtemps nous unit, trouve un gage éternel. Adieu. Lyon, calendes de mai M D XXXVIII.»
Suit une toute petite pièce de trois vers, dont voici la traduction:
«D’autres ont le vice à cœur; qu’ils fassent assaut de vice. Nous, que la vertu seule a séduits, luttons de vertu. Voilà mon duel avec toi.»
[60] Elles parurent sous ce titre: Stephani Doleti Orationes duæ in Tholosam, etc., sans nom d’imprimeur, sans désignation de lieu ni d’année. Mais une lettre de Chrysogon Hammonius, un des amis de Dolet, nous apprend qu’elles furent imprimées chez Gryphius.
[61] Voir à ce propos Maittaire, Ann. typogr., t. III, part. 1, p. 32 et 33; et la lettre de Dolet à Guillaume de Scève, au-devant du dialogue Sur l’imitation cicéronienne.
[62] Carm., III, 32. La pièce est adressée ad Ægidium Jordanum.
[63] Comment., t. II, col. 1294.
Dolet se vante aussi, à la page 170 du même volume, de son habileté comme nageur:
«Aliquando, in loco ubi cum Arare Rhodanus immiscetur, proxime urbem Lugdunum, ad ædem divi Laurentii, quum hos Commentarios Lugduni excudi curaremus, animi gratia natavimus; litteras enim, et natare scimus, si quisquam alius.»
«Dans le temps que je m’occupais de faire imprimer à Lyon les présents Commentaires, je me suis livré plus d’une fois au plaisir de la nage, tout près de cette ville et de l’église de Saint-Laurent. Car il en est pour moi de la natation comme de la science des lettres: je les possède l’une et l’autre autant qu’homme du monde.»



Querelle des cicéroniens. — Erasme, Longueil, Scaliger, Floridus Sabinus.

C’est au giron maternel de sa Lutèce tant aimée, que Dolet composa son fameux dialogue latin: De l’Imitation cicéronienne, contre Didier Erasme, pour Christophe de Longueil; ouvrage qui lui valut l’inimitié d’Erasme, et plus encore,—chose étonnante, mais qui s’expliquera tout à l’heure,—celle de l’orgueilleux Jules-César Scaliger, bien que ce farouche érudit se fût montré l’adversaire d’Erasme dans la même question.
La querelle des cicéroniens et des anticicéroniens était alors à son apogée d’effervescence; or, voici l’origine de cette guerre civile dans ce qu’on appelait, à cette époque, la république des lettres. Bembo, Sadolet et Longueil, qui honoraient leur dieu Cicéron d’un véritable culte de latrie, avaient fait circuler dans l’Italie entière leur électrique enthousiasme. En tout temps, le disciple a dépassé le maître dans la carrière d’un faux système; en tout temps, la médiocrité qui singe a outré les petits travers du génie. O imitatores, servum pecus!... Bientôt les adeptes de [p. 86] ces savants hommes poussèrent l’absurdité du rigorisme jusqu’à n’employer dans leurs ouvrages latins que des expressions consacrées, et, pour ainsi dire, sanctifiées par l’orateur catilinaire. De la Rome capitoline et papale, où cette épidémie classique avait pris naissance, elle s’était bien vite répandue, comme une conquête nouvelle du peuple-roi, en Allemagne et dans notre vieille Gaule, une seconde fois envahie. Tout excès amène une réaction. Erasme de Rotterdam, ce Voltaire de la renaissance par l’esprit sarcastique et le bon sens implacable, se mit naturellement à la tête de la contre-révolution cicéronienne, et commença les hostilités par son Ciceronianus[64], où il maltraita surtout Christophe de Longueil, qu’il semblait regarder comme le Luther de cette réformation littéraire.
N’allez pas croire cependant que le spirituel aristarque, en vertu d’une absurde responsabilité, fît peser sur le dieu le ridicule des adorateurs. Pour lui, Marcus Tullius n’était pas en cause: il savait rendre, dans l’occasion, la plus éclatante justice au génie de ce grand homme, et le cicéronien le plus fanatique n’a jamais été plus loin qu’Erasme, lorsque, dans sa préface sur les Tusculanes, franchissant les bornes étroites de l’orthodoxie catholique, il va jusqu’à ranger Cicéron parmi les bienheureux et les saints. Lisez plutôt:
«Quid aliis accidat, nescio: me legentem sic afficere solet Marcus Tullius, præsertim ubi de bene [p. 87] vivendo disserit, ut dubitare non possim, quin illud pectus, unde ista prodierunt, aliqua divinitas occuparit. Atque hoc meum judicium mihi magis blanditur, quoties animo reputo, quam immensa sit, quamque inæstimabilis æterni numinis benignitas, quam quidam ex ingenio, opinor, suo nimis in angustum contrahere conantur. Ubi nunc agat anima Ciceronis, fortasse non est humani judicii pronuntiare. Me certe non admodum aversum habituri sint in ferendis calculis, qui sperant illum apud superos quietam vitam agere.»
«Que se passe-t-il dans l’esprit des autres? Je l’ignore; mais, pour mon compte, la lecture de Marcus Tullius, principalement lorsqu’il discute un point de morale, m’affecte d’une étrange manière. Je ne doute plus, dans ces moments-là, qu’une divine émanation n’ait inondé ce cœur, d’où jaillirent de si belles pensées. Et cette croyance me sourit encore davantage quand je songe à l’immense, à l’inappréciable bonté de l’Eternel, à cette bonté que certains esprits s’efforcent de restreindre, en la mesurant sans doute à l’étroitesse de leur cervelle. Où se trouve, à présent, l’âme de Cicéron? C’est sur quoi, peut-être, un jugement humain ne saurait prononcer. Néanmoins, je l’avoue, je n’aurais pas de répugnance a voter d’espoir avec ceux qui se le figurent là-haut, dans la paix et le bonheur du ciel.»
Revenons à la question cicéronienne. Longueil était mort en 1522, et, même, à cette occasion, notre Estienne lui avait consacré l’apothéose suivante, en beaux vers latins:
«Oh! que Longueil, avec sa docte parole, n’a-t-il eu, sur la Mort rapace et les Parques cruelles, l’ascendant qu’il exerça jadis, quand sa voix éloquente courba de stupeur la foule romaine! Il vivrait en pleine santé, il n’aurait point succombé sous un noir trépas; pour lui le Temps,—il en était digne!—devait sans cesse renouveler sa course. Mais que dis-je? il vit, et jamais la mort ne l’anéantira, protégé qu’il est, comme dans une citadelle, par sa gloire éclatante, par son grand nom! Il a parfait un monument plus éternel que le bronze, et dont la renommée, vaste écho qui se prolonge, a volé jusqu’aux astres; un monument qui ne croulera ni sous la série des [p. 89] ans, ni sous l’effort de l’autan fougueux, ni sous l’action corrosive des pluies. Tant que les constellations adhéreront à la voûte céleste, tant que l’Ourse au pas tardif, fournissant sa carrière, circulera dans l’empyrée, les peuples du couchant, ceux qui contemplent le lever du soleil, tous enfin, l’un après l’autre, décerneront à Longueil un culte d’admiration. Donc, loin d’ici les chants plaintifs du sépulcre, et les pleurs honteux que versent les vieilles femmes!»
Voici, maintenant, un échantillon du cicéronianisme de Longueil. C’est une lettre, également en latin, adressée à l’un de ses amis. Je vais la traduire tout au long; car, pour ceux qui aiment à entrer in visceribus rei, dans la partie intime d’une époque, surtout d’une époque comme le seizième siècle, un document de cette nature ne saurait être sans intérêt. J’aurais donc tort de le passer sous silence:
«Christophe de Longueil à Stéphane Théolus, salut au nom du Seigneur.
«J’ai lu, de votre jeune fils Camille, une lettre qu’il m’adresse, et qui me donne la plus haute idée de son intelligence et de son cœur. Je ne saurais vous dire tout le bonheur qu’elle m’a fait éprouver. Après en avoir achevé la lecture, je n’ai pu faire autrement que d’y répondre, courrier par courrier, et de vous féliciter, par la même occasion, vous le principal instigateur des progrès de cet enfant dans les saines études. Car sachez-le bien: de son âge, et même d’un âge plus avancé, on ne pouvait rien attendre [p. 90] de plus élégant, de plus correct, que cette lettre qu’il vient de m’envoyer. Je vous en conjure: qu’il marche toujours vers la science, en suivant la voie dans laquelle il est entré; et qu’il ne s’écarte jamais de cette voie salutaire, fût-ce de l’épaisseur d’un ongle (ne transversum quidem unguem digrediatur). Qu’il ait toujours Cicéron à la main, qu’il le lise, l’aime et l’admire, à l’exclusion de tous les auteurs, et qu’il n’hésite pas à contracter auprès de lui toute sorte d’emprunts, soit pour le discours parlé, soit pour le style écrit. Il abordera plus tard les autres écrivains, quand il en aura le loisir, et qu’il pourra se fier à son propre jugement. D’ici là, je le répète, qu’il ne quitte jamais Cicéron, et qu’il y puise, comme à la source la plus pure et la plus abondante du beau langage latin, toute la richesse, toute la correction possibles. Si j’avais affaire à tout autre qu’à vous, j’appuierais d’un plus grand nombre d’arguments ce système qui n’est point encore assez en crédit; mais vous connaissez, mieux que personne, toute l’absurdité, toute la grossièreté du style de ceux qui, en pareille matière, s’obstinent à écouter un autre maître que Cicéron. Je reviens donc au sujet de ma lettre: celle de votre Camille m’a tellement plu, que j’ai cru devoir vous en témoigner ma joie sur-le-champ, à vous le digne père d’un tel fils, à vous qui l’avez ainsi façonné par votre inspiration libérale. Vous n’avez plus qu’à redoubler de zèle, et qu’à maintenir ce cher élève, surtout à l’âge critique où il se trouve, dans l’excellente méthode que vous avez adoptée pour ses études. Adieu.» [p. 91]
Du reste, il faut le dire avant d’aller plus loin: Longueil était un des hommes les plus remarquables du seizième siècle, où le hommes remarquables ne manquaient pas. Il n’avait que dix-neuf ans, qu’on le désignait déjà pour occuper une chaire de droit à Poitiers, au mois d’octobre 1510. A cette occasion, il lui arriva dans cette ville une aventure tragi-comique, dont il nous a transmis lui-même les détails, dans une lettre à Jean de Balêne, de Beauvais. Le jeune professeur venait de commencer son discours d’ouverture: tout à coup ses élèves, presque tous plus âgés que lui, mirent l’épée au poing et fondirent sur leur nouveau maître, pour le contraindre à céder sa place à un régent gascon. Mais notre homme, conservant le plus héroïque sang-froid dans sa forteresse magistrale, terrassa sous le poids de trois énormes volumes de l’Infortiat (des in-folio du seizième siècle!) ceux des mutins qui s’étaient avancés le plus près de sa chaire. Les autres se le tinrent pour dit,
Et le combat cessa, faute de combattants.
On croirait lire le récit de la célèbre bataille du Lutrin.
Cet intrépide Longueil étant mort, comme je l’ai dit plus haut, en 1522, six ans avant la publication du Ciceronianus, la défense contre l’attaque d’Erasme lui devenait tout aussi difficile qu’elle aurait pu l’être à Cicéron lui-même, en supposant que le célèbre orateur eût été réellement impliqué dans ce bizarre procès littéraire. Qu’on se rassure, dans tous les cas: l’un et l’autre ne tardèrent pas à trouver de valeureux [p. 92] champions. Scaliger, en effet, lança d’abord contre Erasme une harangue[66] pleine d’injures, selon sa docte habitude; et, trois ans plus tard, notre héros à son tour vengea la mémoire de son cher Marcus Tullius, cette mémoire inviolable sur laquelle il ne pouvait supporter l’ombre même d’un outrage, en même temps qu’il entreprit de plaider la cause de son ancien ami Longueil.
Inde iræ!... Le hautain Jules-César ne put voir, sans être piqué au vif, un rival aussi jeune que Dolet courir sur les brisées de sa polémique. Jusqu’alors il régnait, entre notre Estienne et lui, je ne sais quelle liaison banale de savant à savant, qui avait eu pour médiateur un certain Arnoul Ferron[67]. Mais à partir de ce moment, cette demi-amitié fit place à la haine la plus étrange qu’il soit possible de concevoir, et [p. 93] Scaliger ne cessa de poursuivre son émule cicéronien par les plus absurdes diatribes, par les plus atroces calomnies[68]. Le monstrueux échantillon que l’on va lire, et pour la traduction littérale duquel j’ai dû me faire violence, donnera, j’en suis convaincu, la plus haute idée de cette noblesse de style et de cœur qui caractérisa toujours le noble[69] écrivain véronais. Par un raffinement de générosité, c’est après la mort de son adversaire qu’il publia ce morceau dithyrambique, en guise, probablement, d’oraison funèbre ou d’apothéose cicéronienne. Le voici dans toute son étendue; je l’emprunte à l’Hypercritique, page 305, colonne 2:
«Dolet!... s’écrie Scaliger en écumant, on peut bien l’appeler le chancre ou l’abcès des muses (Musarum carcinoma aut vomica). Car, outre qu’un si grand corps, suivant l’expression de Catulle, ne renferme pas même un grain de sel, l’insensé qu’il est se pose en autocrate de la poésie. Et le voilà, au gré de son caprice, incrustant dans la poix de son style les perles virgiliennes, comme pour faire croire à tout le monde que c’est son bien. Impuissant rabâcheur (ignavus locutuleius), qui, après avoir, à force de souder sa marqueterie cicéronienne, fabriqué ce je ne sais quoi de fiévreux qu’il appelle des discours[70], et [p. 94] que les doctes qualifient d’aboiements, a cru pouvoir se permettre la même licence aux dépens du divin trésor de Virgile! Aussi, tandis qu’il chante les Destins du très-bon et très-grand roi François Ier, il a lui-même à régler avec son mauvais destin[71]; et, ce qui était bien dû au poëte comme aux vers, seul de son temps, il subit comme athée le supplice de la flamme. Mais la flamme a beau faire, elle ne peut venir à bout de le purifier: c’est plutôt lui qui souille la flamme. Quant aux égouts, aux latrines qu’il intitule Epigrammes[72], à quoi bon vous en détailler toutes les ordures! C’est flasque, froid, insipide, et, pour tout dire, plein de cette folie furieuse qui, s’armant d’un excès d’impudence, n’a pas même reconnu l’existence d’un Dieu[73].
«En conséquence, à l’exemple d’Aristote, cette sommité de la philosophie, qui, dans son Histoire naturelle, ayant analysé, d’après toutes ses parties constitutives, l’organisme animal, fait encore mention des excréments... je veux qu’ici le nom de cet homme se lise, en sa qualité, non de poëte, mais d’excrément de la poésie!»
Que répondre à cela? Rien. Un haussement d’épaules, et passons.
[p. 95]
Dolet, je m’empresse de le dire à sa louange,—car malheureusement il n’a pas toujours été sans reproche de ce côté-là,—Dolet se conduisit d’une tout autre manière à l’égard d’Erasme, son ancien antagoniste, lorsque ce dernier mourut, en 1536. Voici la traduction des vers qu’il adressa, dans cette circonstance, à Scaliger lui même, avec lequel sans doute il n’avait pas encore l’honneur d’être brouillé. On y remarquera, je l’espère, une certaine différence avec la prose de l’Hypercritique:
«Jadis les généraux de Rome et de Carthage se livrèrent une guerre acharnée. Tant que l’ennemi lutta plein de force et de vie, tant qu’il grinça des dents avec menace, l’assaillir de près avec le glaive, le cribler de traits, n’est-ce pas que c’était beau, n’est-ce pas que c’était grand? Eh bien! tant qu’il conserva sa force et son ardeur pour le combat, j’ai fait sentir mes traits à l’ennemi de Cicéron, au jaloux détracteur du nom français. Il est mort... je l’épargne, et mon style empoisonné ne blessera pas un cadavre. Muses, payons à ce vieillard un juste tribut d’éloges. La tombe avide l’a dévorée, cette gloire de la patrie germaine, cette gloire des savants qu’a produits l’Italie ou la France (avec toi cependant, Budé, et toi aussi, Longueil); oui, cette gloire de la patrie germaine, cette gloire des savants, la tombe avide l’a dévorée[74]!»
Écoutons à présent l’illustre Bayle:
«L’emportement de ce critique contre Dolet, [p. 96] observe-t-il en parlant de Scaliger, a quelque chose de si outré, et, si j’ose le dire, de si brutal, qu’on ne sçauroit s’empêcher de croire qu’un ressentiment personnel dirigeoit la plume de ce grand homme.»
Bayle n’était pas le seul de cette opinion. Baillet, dans ses Jugements sur quelques poëtes, tome III, no 1279, tance le Jules-César avec la plus juste sévérité; enfin, Naudé, le célèbre bibliothécaire du cardinal Mazarin, soupçonnait pareillement dans ce misérable Scaliger une rancune particulière[75]. Mais il n’en connaissait pas l’origine.
«Je crois, dit encore Bayle, l’avoir déterrée. Dolet s’ingéra de courir sur les brisées de Scaliger; il écrivit contre Erasme en faveur de la secte cicéronienne, après que Scaliger eut soutenu cette cause. Il n’y a guère d’auteur à qui un tel procédé soit agréable. On le regarde comme un dessein affecté, ou de surpasser le premier tenant, ou de lui ôter la gloire d’être le seul qui rompe une lance. On croit même que celui qui se vient mêler du combat, prétend que la cause a été mal soutenue, et qu’elle a besoin de secours. Si tel est pour l’ordinaire le naturel des auteurs, jugez quelle fut l’indignation de Scaliger, quand il vit Dolet sur les rangs, et qu’il prétendit le surprendre dans plusieurs mauvais artifices. Il prétendit, entre autres choses, que les plus beaux ornements de sa harangue avoient été pillez par Dolet et [p. 97] placez dans un faux jour; et pour ce qui est des louanges que Dolet lui avoit données, il ne lui en sçavoit point de gré: elles vinrent après coup, et de trop mauvaise grâce, pour réparer la première offense.»
C’est dans une lettre de Scaliger à Ferron, que Bayle a puisé tous ces détails. Je vais la citer et la traduire, afin que rien ne manque à l’exposé du débat:
«Arbitror te Doleti vidisse Dialogum adversus Erasmum; quem non puduit, exstantibus scriptis meis, flexu alio orationis omnia mea suffurari, atque ineptissimis inurere calamistris. Itaque eædem, quæ in Orationibus, intemperiæ, stylus paulo minus asper, sed emendicatus, ut verbis potius alienis conquisitis atque corrogatis, quam oblato argumento ejus loquacitas excrescere videatur. At Cæsarem laudat, inquies: accipio. Nam te aiunt ad eum retulisse, consuleret dignitati suæ, qui temere atque stolide nimis super italico nomine ineptisset; a me integrum dialogum apparatum, quo illius ostenderem et malevolum animum cum inani gloria conjunctum, et præceps ingenium cum stupore, et impurum dicendi genus cum loquacitate, et amentem dictionem cum impudentia. Ita igitur adblanditum, ut animum meum deflecteret a proposito; ita laudasse, ut sequi potius aliorum judicium invitus, quam suum ipse libens apponere videretur.»
«Vous avez vu, je pense, le Dialogue de Dolet contre Erasme. Il n’a pas eu honte, connaissant mes écrits sur cette matière, de me les dérober tous, [p. 98] moyennant quelques altérations dans le tour des phrases, et de les travestir sous les plus ineptes enjolivements. Ce sont les mêmes entorses au bon sens que dans ses Discours. Le style est un peu moins rocailleux, c’est possible; mais l’auteur l’a mendié à droite et à gauche, et c’est ainsi, plutôt qu’en s’appuyant sur le fond même du sujet, qu’il est parvenu à soutenir son interminable bavardage. Mais, me direz-vous, il fait votre éloge, à vous, Scaliger. Soit! J’en découvre la raison. Vous lui avez, m’a-t-on dit, conseillé de prendre une tenue plus digne; vous avez blâmé ses sottes et téméraires divagations sur le nom italien; vous lui avez annoncé que je préparais contre lui un dialogue tout entier, dans lequel je faisais toucher au doigt sa malveillance et sa gloriole, son étourderie et sa stupidité, sa diction incorrecte et prolixe, folle et impudente. Si donc il me cajole, c’est afin de détourner le coup dont je le menace; s’il me loue, c’est à contre-cœur et en suivant la trace du jugement d’autrui, bien plus que sa propre et libre inspiration.»
Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît à toi-même, a dit la morale avec son éternel axiome. Plusieurs écrivains ont traité Scaliger à peu près de la même façon qu’il a traité Dolet. Ce n’était que justice, après tout. Œil pour œil, dent pour dent.
«Il n’est guère de plus méchant livre, observe Ménage à propos des poésies latines du Jules-César en question; il s’y trouve à peine quatre ou cinq épigrammes qui puissent passer à la montre.» [p. 99]
Huet, le savant évêque d’Avranches, n’est pas moins explicite et vigoureux dans sa censure de Scaliger.
«Avec tout le mérite qu’il avoit, écrit-il carrément, et tout celui qu’il croyoit avoir, il a bien montré dans son Hypercritique qu’il n’avoit nulle délicatesse de goût, par les jugements faux qu’il a faits... Il l’a encore mieux montré par les poésies brutes et informes dont il a déshonoré le Parnasse... C’étoit un homme, à la vérité, d’un esprit vaste et élevé, mais d’un très-mauvais goût dans la poésie. Quand on n’auroit pas lu son Hypercritique, si plein de fausses vues, bien plus occupé à juger du détail des vers, et à corriger des minuties souvent de mal en pis, qu’à porter un jugement sain sur le gros des ouvrages; pourroit-on se soumettre aux décisions d’un homme qui a répandu dans le public tant de mauvais vers!»
A quoi Maittaire ajoute:
«Huetii quidem judicium tantum abest ut improbem, ut potius justissimum esse arbitrer; neque unquam animum inducam credere eum fore styli æquum judicem, qui stylo uti nescierit. At vero nil est frequentius quam in criticos incidere nullis moribus præditos, vultu elato, inverecunda fronte magistellos, qui scriptores optimos ferulæ suæ audaci subjiciunt, ipsi interim scriptionis imperitia et styli scabritie famosissimi.»
«Loin d’improuver la critique de Huet, je la trouve parfaitement juste; et jamais je n’ai pu me mettre dans la tête qu’il fût, en matière de style, un juge compétent, celui-là même qui ne sait pas écrire. [p. 100] Cependant, on rencontre tous les jours des Zoïles sans mœurs, des cuistres pleins de morgue et d’effronterie, qui soumettent les meilleurs écrivains à leur audacieuse férule, oubliant qu’une forme gauche et raboteuse les place eux-mêmes sur la sellette du ridicule.»
La querelle cicéronienne parut un instant s’assoupir, après que Scaliger se fut abandonné aux derniers transports de sa colère contre Erasme, dans sa seconde harangue, publiée en 1537. Tout à coup, au moment où chacun la croyait bien morte et bien enterrée, elle ressuscita, plus haineuse, plus violente, plus grossière que jamais, entre un certain Franciscus Floridus Sabinus et notre Dolet, de 1539 à 1541. Cette polémique se compose: des Subcisivorum libri tres, de Floridus; du Liber adversus Floridum Sabinum, de Dolet; et d’une dernière réplique de Floridus: Adversus Doleti calumnias, que j’ai eu déjà l’occasion de mentionner, dans une de mes notes précédentes.
Sabinus, dans sa première attaque de 1539, avait accumulé les injures personnelles contre son partner cicéronien. Celui-ci répliqua, l’année suivante, et divisa son plaidoyer en deux livres. Le premier n’est guère que la répétition du Dialogue contre Erasme; en agissant ainsi, Dolet a voulu mettre ses lecteurs à même de décider si Sabinus avait eu raison de le reprendre. Dans le second livre, qu’il a subdivisé en deux parties, il discute tour à tour le style de son adversaire, le sien propre, celui d’Erasme, de Longueil et des latinistes allemands; il cite Budé, Bembo [p. 101] et Sadolet, et repousse avec un emportement assez excusable toutes les calomnies, toutes les horreurs sans nom dont Sabinus s’était plu à le charger. Cela fait, il consacre la dernière partie de ce même livre à se justifier d’une odieuse imputation, celle de plagiat; puis il termine le volume par des épigrammes contre son antagoniste.
En résumé, suivant l’observation de Née de la Rochelle, Dolet se défendit assez bien d’avoir été un flatteur, un gourmand, un impie, et d’avoir jamais songé à interdire la lecture de Virgile et de Térence. Usant même de représailles, à propos du surnom de plagiaire qu’on avait prétendu lui décerner, il accusa son rival de s’être approprié tout un ouvrage d’Albert Pius, prince de Carpi, De C. Julii Cæsaris præstantia, imprimé avec d’autres écrits de Sabinus, à Bâle, chez Robert Winter, en 1540, in-4o.
Voici maintenant, comme dernier détail, un ensemble complet des différentes phases que cette longue querelle des cicéroniens eut à traverser, pendant une période de près de trente ans. C’est le cas, ou jamais, de s’écrier avec Dolet lui-même:
En 1528, Erasme publia son Ciceronianus. Scaliger y répondit d’abord par un discours imprimé à Paris, chez Pierre Vidoué, en septembre 1531, in-8o; puis Dolet publia chez Gryphius, en 1535, in-4o, son Dialogue sur l’imitation cicéronienne. Vient ensuite la seconde harangue de Scaliger contre Erasme, Paris, Vidoué, 1537. Après cela, Floridus Sabinus attaqua [p. 102] Dolet en 1539; celui-ci riposta en 1540, et Sabinus le combattit une dernière fois en 1541. Enfin, Pierre Ramus traita le même sujet dans son Ciceronianus, Paris, André Wechel, 1557, in-8o.
Arrêtons-nous: il faut en finir avec cette interminable bataille de mots, où trop souvent Cicéron n’était qu’un prétexte à des ressentiments d’érudits qui se gourmaient entre eux dans un latin pittoresque, digne cousin du langage des halles ou de l’idiome accentué du mardi gras. Entraîner mes lecteurs dans de nouveaux détails, ce serait abuser de leur patience. De part et d’autre, hélas! il faut bien que je le confesse, à la honte de mon seizième siècle, on combattit avec les mêmes raisons... c’est-à-dire avec les mêmes injures.
Tant de fiel entre-t-il dans l’âme des savants!
[64] Ciceronianus, sive de optimo dicendi genere. Bâle, J. Froben, 1528.
[65] Carm., IV, 1.
[66] Imprimée à Paris, chez Pierre Vidoué, en 1531, in-8o. Elle est très-difficile à trouver. Erasme ne daigna pas répondre à la grossière attaque de Scaliger: «Il attend ma réponse, disait-il, et prépare déjà une autre invective; mais je n’ai pas encore lu son livre, et je n’ai fait que le parcourir. (Lettre 372, édit. de Leyde, 1703)» Scaliger écrivit, en effet, une seconde harangue en 1537; mais Erasme la lut encore moins que la première, car il était mort l’année d’auparavant.
[67] A la suite d’une édition de l’historien Paul-Emile (De Rebus gestis Francorum, Vascosan, 1550, in-fol.), on trouve:
Arnoldi Ferroni de Rebus gestis Gallorum libri IX, usque ad Henricum II.
Cette continuation d’Arnoul Ferron se trouve encore à la suite des éditions de Paul-Emile de 1548 et 1555, in-8o, imprimée à part; et à la suite d’une autre de 1576, in-fol. Paul-Emile et Ferron ont encore été réimprimés, et probablement pour la dernière fois, à Bâle, en 1601, in-fol., avec une continuation par Jac. Henric. Petrus.
On a une traduction française de Paul-Emile, par Jean Regnart, avec la suite tirée de Ferron, Paris, Morel, 1581 et 1597, 1602, 1609, in-fol.
[68] Voy. Maittaire, vol. déjà cité, p. 29.
[69] Tout le monde sait que Scaliger avait la prétention de descendre des princes della Scala, tandis qu’en réalité il n’était que le fils du peintre Bordoni.
[70] Les harangues contre Toulouse.
[71] A la bonne heure! voilà ce qui s’appelle un jeu de mots plein d’atticisme. Il veut parler d’un poème latin de notre Estienne, intitulé: Francisci Valesii Gallorum regis Fata (Lyon, Dolet, 1539, in-4o), que Dolet lui-même, un an après, translata en langue françoyse, comme nous le verrons plus loin.
[72] Allusion aux Poésies latines de Dolet.
[73] L’examen de ses opinions religieuses trouvera plus tard sa place dans un chapitre spécial.
[74] Carm., II, 20.
[75] «Tu en oublies deux qui valoient mieux que ton Badius, sçavoir: Geoffroy Tory et Estienne Dolet, quoi que Scaliger, par je ne sçais quelle haine, ait dit du dernier.» (Dial. de Mascurat, p. 8.)


Apparition des Commentaires sur la langue latine. — Dolet accusé de plagiat.

Les tracas de la polémique n’avaient pas empêché Dolet de poursuivre ses gigantesques travaux sur la langue latine. Bientôt même, cette besogne des jours et des nuits le captiva tellement, qu’il en négligea ses relations avec Budé, Emile Perrot, et les autres savants dont l’honorable amitié le soutenait et l’encourageait sans cesse dans sa rude carrière[76].
«Songeant à passer en Italie, nous apprend Hubert Sussanneau, dans la lettre qui précède son Dictionarium ciceronianum (Paris, Simon de Colines, 1536, in-8o), je m’arrêtai à Lyon, où Sébastien Gryphius me fit présider à la correction de quelques ouvrages de Cicéron, d’Horace et de saint Cyprien. Dolet vivait alors avec cet imprimeur. Tout ce que je puis dire de l’habileté et de l’érudition de ce jeune homme, c’est qu’en lui la nature surpasse l’art, et [p. 104] que, dans un âge encore tendre, il est, si j’ose m’exprimer ainsi, porté sur un char au milieu des louanges. Attaché dès l’enfance à la lecture de Cicéron, il composait alors des Commentaires sur la langue latine, qui, par l’admiration qu’ils m’ont causée, ont failli me faire abandonner mon propre travail.»
Les vers suivants de Vulteius (Jean Voulté) me sembleraient aussi prouver qu’à cette même époque, notre Estienne remplissait, momentanément peut-être et par complaisance, les fonctions de correcteur dans l’imprimerie gryphienne:
«Va, mon livre, fuis à Lyon sans moi; va, fuis dans cette ville, où, d’une main prompte, viendra t’accueillir ce fameux Gryphius, qui te soumettra, bientôt après, à la savante révision de Dolet. Qu’il te soit doux de passer à sa coupelle: car, une fois sorti de là, tu nargueras enfin la censure la plus rechignée, la rage des chiens de la critique, et les coups de griffe de messieurs les Zoïles.»
En 1535, Dolet sollicita le privilége pour l’impression de ses Commentaires; mais il eut toutes les peines [p. 105] du monde à l’obtenir. Il lui fallut, auparavant, triompher des préventions que ses ennemis avaient fait naître, en haut lieu, contre l’ouvrage et contre l’auteur; et son ami Vulteius éclata, dans cette circonstance, en plaintes énergiques au sujet de la jalousie dont ce pauvre Estienne avait failli se voir victime.
«Personne, disait Vulteius, personne, je crois, à parler avec franchise, n’est aussi hostile au nom français qu’un Français même. Maintes fois déjà cette expérience avait été faite; mais la voici renouvelée par Estienne Dolet, jeune Orléanais, qui, pour ne rien dire de plus, a glorieusement mérité de la langue latine, dès sa plus tendre adolescence. En fournissant le reste de sa carrière, quels progrès ne fera-t-il pas faire aux lettres, grâce au divin génie qu’il doit à la nature, grâce à sa colossale patience, en face de toute espèce de travaux, grâce enfin à l’ardeur généreuse qui le pousse à l’immortalité! Eh bien! ce flambeau scientifique de notre époque, cette gloire éternelle de la France, a dû sentir les plus acerbes morsures de l’envie. En effet, dès qu’il a voulu publier ses Commentaires sur la langue latine (quel ouvrage, et qu’on devait peu l’attendre d’un jeune homme! quel monument de travail et de goût!), dès qu’il a voulu, dis-je, mettre au jour ce vaste répertoire, afin de se rendre utile aux fidèles du beau langage romain, c’est parmi ceux dont il avait le droit d’espérer le fruit le plus abondant de son labeur, qu’il a reconnu ses adversaires les plus acharnés. Ah! maudites soient-elles à jamais, toutes ces [p. 106] pestes de la littérature! Elles veulent enténébrer le soleil levant de la science, et ne font alors qu’en rehausser l’éclat[77].»
Aussitôt après l’obtention de son privilége, Dolet revint à Lyon, dans le courant du mois d’avril 1536, pour veiller lui-même à la correction typographique du grand ouvrage. Il venait de le confier aux presses de Sébastien Gryphius, bien digne réellement de l’honorable préférence et de l’affection peu prodiguée du savant humaniste, autant par la probité germanique de son caractère que par ses talents supérieurs dans sa noble profession.
L’Index erratorum du premier volume des Commentaires ne contient que HUIT FAUTES pour 1708 colonnes in-folio. Que l’on juge, d’après cela, de la conscience avec laquelle travaillait Gryphius.
Ce n’était pas seulement par la correction du texte, mais encore par la beauté des caractères que les éditions gryphiennes se faisaient remarquer, à cet âge d’or de la typographie. Sous ce double rapport, l’enthousiaste Voulté n’hésite pas à mettre Gryphius au-dessus même de Robert Estienne et de Simon de Colines.
«Parmi tant d’imprimeurs, nous dit-il, j’en connais trois hors ligne; le reste est une tourbe qui meurt de faim. Robert Estienne brille par la correction, Simon de Colines par la beauté des caractères. [p. 107] Habile d’esprit comme de main, Gryphius réunit ces deux qualités.»
Ce poëte n’était pas le seul à rendre ainsi justice au docte imprimeur. Écoutons à présent l’Horace français, Salmon Macrin, de Loudun:
«Gryphius, le plus illustre de nos illustres typographes, et le prince de ton art, par ton génie artiste, ton goût sûr, ta correction consciencieuse et sévère, l’ampleur de tes marges et leur éclatante [p. 108] netteté; enfin, les soins opiniâtres dont tu entoures les ouvrages qui te sont confiés, quand tu les multiplies sous tes presses laborieuses: je te recommande ce tout petit livre, dédié au meilleur, au plus grand des rois; oui, ce fruit récent de mes veilles, je te le recommande avec instance. Il ne vaut pas trois onces; mais s’il paraît sous les auspices de ton zèle habile; si, prenant l’essor de tes presses, il vole de bouche en bouche dans le monde savant, sous une forme brillante et correcte; il te devra plus qu’à Macrin, et te reconnaîtra justement pour son père, ô Gryphius, le plus illustre de nos illustres typographes, et le prince de ton art!»
Enfin, l’année 1536 vit paraître, avec toute la splendeur matérielle qu’une édition pouvait déployer à cette époque, et notamment avec un superbe titre en forme de cadre, gravé sur bois, le tome premier, depuis si longtemps attendu, des Commentaires de la langue latine[79].
Voici la description fidèle du frontispice xylographique dont je viens de parler:
En haut de la page on aperçoit Salomon, ayant à sa droite Socrate et Pythagore, à sa gauche Aristote et Platon. Le compartiment inférieur du cadre nous laisse voir Homère, agenouillé devant la classique fontaine du Parnasse; les Muses l’entourent, et l’une [p. 109] d’elles, Calliope, dépose sur sa tête l’immortelle couronne de laurier.
Les marges verticales représentent les principales célébrités des antiques littératures grecque et latine; à gauche: Aristide et Démosthène, Lucien et Plutarque, Cicéron et Quintilien, Pline et Aulu-Gelle, Tite-Live et Salluste; à droite: Homère et Hésiode, Euripide et Aristophane, Théocrite et Pindare, Virgile et Horace, Ovide et Lucrèce; en tout vingt personnages, dix de chaque côté.
Après leur avoir donné cette vénérable escorte, Estienne laissa partir ses chers Commentaires. L’allocution suivante, d’une tendresse toute paternelle, lui servit d’adieu à l’heure de la séparation:
«Premiers monuments de mon art, monuments premiers de ma jeunesse, paraissez enfin sous d’heureux auspices; et, fatigués d’un trop long retard, d’une trop dure captivité, livrez-vous à votre désir de voir le jour, surgissez à la vie. Que l’insolence agressive, que l’âpre sarcasme des envieux ne vous [p. 110] inspire aucune crainte; non! altérés de lumière, allez (la peur dénonce une âme sans énergie), allez, vous dis-je, premiers monuments de mon art, monuments premiers de ma jeunesse, et paraissez enfin sous d’heureux auspices.»
Il faut lire, dans les lettres de Dolet à François Ier, à Guillaume Budé, et dans les préliminaires de ce savant ouvrage, les détails intéressants que notre humaniste y a donnés lui-même sur ses travaux, l’exposé de l’ordre et de la méthode qu’il observa dans leur pénible rédaction. Quels hommes, que ces laboureurs du champ de la pensée, au seizième siècle! quelles natures de fer! quels prodiges de patience et d’étude! Et que nous avons bien raison de les dédaigner aujourd’hui, nous autres qui nous contentons de retourner, en la brossant un peu, leur immortelle défroque!
Le succès fut grand, l’envie plus grande encore; les aimables Zoïles que nous connaissons déjà, se déchaînèrent à qui mieux mieux contre Dolet. Floridus entre autres, dans sa rancune anticicéronienne, non content de lui jeter à la face l’accusation de plagiat, lui reprocha sur tous les tons d’avoir manqué de méthode. Savez-vous pourquoi? c’est qu’au lieu de suivre l’éternelle routine des lexicographes, au lieu d’employer leur vieux système de classification abécédaire, notre judicieux Estienne avait rangé ses mots dans l’ordre logique, en rattachant chaque série d’idées particulières à l’idée principale, à l’idée génératrice. De nos jours, la docte Allemagne aurait admiré un pareil travail. Un autre pédant en us, Jean [p. 111] Sturmius[81], publia que, lors de son séjour à Venise, Dolet s’était fait aider par Andrea Navagero, dont il était le commensal; et, pour tout dire, Charles Estienne lui imputa d’avoir volé, dans l’article qu’il consacrait à la navigation, l’ouvrage que Lazare de Baïf venait de faire paraître sur le même sujet[82].
De toutes ces accusations, celle de Charles Estienne était sans contredit la plus grave; aussi provoqua-t-elle, entre ce savant et notre Dolet, une polémique acharnée dont je vais tracer l’historique en quelques mots.
Christophe Richer de Thorigny, savant sénonais, ami commun de Baïf et de Dolet, vint remettre à ce dernier l’ouvrage de Baïf, De Re navali, au moment où l’on mettait sous presse le passage du second volume des Commentaires, dans lequel la même matière se trouvait traitée. Dolet parcourut avec un vif intérêt la publication consciencieuse de Baïf; mais il [p. 112] ne suspendit point, pour cela, l’impression de son article. Seulement, comme il voulait témoigner sa reconnaissance à Richer, il lui fit présent à son tour de son propre travail, que Richer lui promit, sans attendre qu’il l’en priât, d’envoyer à Baïf par le plus prochain courrier. La conduite de Dolet en cette occasion, comme l’observe avec raison Née de la Rochelle, ne prouve nullement qu’il ait dû prévoir ni craindre l’accusation de plagiat dont la démarche de Richer fut en partie la cause occasionnelle. En effet, dès que l’ombrageux Charles Estienne eut reçu de Baïf son élève les feuilles du second volume des Commentaires, il s’imagina tout d’abord que Dolet avait pillé le travail de Baïf, et il résolut d’en fournir immédiatement la preuve, dans un abrégé de cet ouvrage, abrégé qu’il fit imprimer exprès chez François Estienne, son frère, en 1537, in-8o. Dolet, pour se disculper, fit imprimer aussitôt séparément l’article d’où naissait l’accusation; et comme s’il eût tenu à démontrer hautement qu’il avait sous ce rapport la conscience on ne peut plus tranquille, il inséra en tête une apologie qu’il adressa carrément à Baïf lui-même, partie très-intéressée dans le procès.
«J’avoue, dit-il avec franchise, qu’en faisant mes recherches sur les noms et les parties des vaisseaux, j’ai cru devoir en expliquer plusieurs avec les propres paroles de Baïf, ou par des termes approchants. Mais je nierai toujours que ce soit un vol, à moins qu’on ne veuille stigmatiser d’une imputation pareille Budé, Erasme, Politien, Rhodiginus, le Volterran, Nicolas Perrot, et tous ceux qui composent des dictionnaires. [p. 113] C’est une des nécessités du métier de compilateur et de lexicographe, qu’on n’ait presque rien à tirer de son propre fonds, et qu’on se voie forcé, par conséquent, de tout emprunter aux autres.»
Le poëte a bien eu raison de s’écrier:
C’est une règle sans exception, et dont les exemples sont infinis: Dolet me semble un des plus navrants. Pauvre ouvrier de la science! on ne songea pas à lui payer son salaire avec la sympathie, cet or du cœur!... Amère, amère injustice!... Oh! que l’histoire vous juge, vous tous qui l’avez méconnu et persécuté, ce travailleur sublime! Dès l’âge de seize ans, érudit encore imberbe, il avait osé l’entreprise titanique de ses Commentaires[83]; dès l’âge de seize ans, alchimiste de gloire, il avait sué sur le grand œuvre. A vingt-six, il était chauve de la moitié du crâne, au point qu’un nommé Jean-Ange Odonus, qui avait eu occasion de le voir, lui donnait alors QUARANTE ANS[84]!
«On ne saurait croire, nous apprend tout le premier cet héroïque Estienne, on ne saurait croire combien la rédaction de mes Commentaires m’a coûté [p. 114] de patience, de veilles, de sueurs! combien de jours elle m’a pris, combien de nuits elle m’a dévorées! combien de fois j’ai dû m’abstenir de nourriture et de sommeil! Que dis-je? il a fallu m’interdire moi-même tout relâche, tout loisir, toute distraction; tout commerce avec mes amis, tout plaisir honnête, en un mot, l’usage même de la vie. Mais j’avais sous les yeux, comme une perspective consolante, la postérité si digne de respect; je rêvais l’éternité de mon nom!»
Cet amour de la gloire, ce noble et chaste amour, qui, dans son âme, avait triomphé de toutes les déceptions, qui toujours avait surnagé dans le naufrage de ses croyances, qui seul enfin le consolait de ses misères quotidiennes, de son martyre incessant; cet amour, dis-je, cet amour unique... il brille, il éclate, il étincelle, comme un diamant céleste, à chaque page de ses livres: par exemple, dans les nombreuses digressions de ses Commentaires, et dans le recueil si intéressant et néanmoins si peu connu de ses poésies latines. Quels beaux vers il adresse là-dessus à son ami Nicolas Bourbon, de Vandœuvre! Vous allez en juger:
En vérité, cette fois, je n’ai pas osé les traduire en vile prose; j’ai préféré les développer sous une forme rhythmique, et luttant de toutes mes forces contre l’original, j’en ai fait le sonnet que voici:
Oh! oui, science et gloire! Ce double amour électrisa, d’un bout à l’autre, une existence à la fois si courte et si pleine. Autant notre Estienne aimait la gloire, comme prix de la science, autant il aimait la science comme instrument de la gloire. C’était chez lui, de même que chez le Claude Frollo du grand poëte moderne, «une véritable fièvre [p. 116] d’acquérir et de thésauriser en fait de science; il semblait au jeune homme que la vie avait un but unique: savoir![86]» On eût dit, en un mot, qu’il avait arboré la devise bénédictine, cette pathétique devise que je n’ai jamais pu répéter, pour mon compte, qu’avec des larmes d’admiration et d’envie:
Immorior studiis, et amore senesco sciendi!
«Je meurs sur l’étude, et la passion du savoir me fait vieillir.»
Ne l’accusez pas de fanatisme, vous qui ne croyez à rien. Je l’ai dit au début de cet ouvrage, et je le répète: le fanatisme est une vertu quand la religion est si belle! Moi, l’obscur néophyte qui écris ces lignes, je me mettrais à genoux devant de pareils hommes: ce sont les pères de la véritable église, de cette grande église du progrès, hors de laquelle il n’y a point de salut pour le genre humain.
Je me résume avant de passer outre.
Rival de la fière Emilie du vieux Corneille, qui, selon certain docteur dont nous parle Balzac[87], était possédée du démon de la république, le brave étudiant du seizième siècle était possédé du démon de la science. Mais ce n’était pas, nous le verrons bientôt, cette science inféconde qui n’apprend que des mots et n’invente que des systèmes; cette science pédantesque et mesquine, fille, dans une nature médiocre, de la patience et de l’amour-propre; cette [p. 117] science postiche, enfin (permettez-moi l’expression), qui, dans plus d’un esprit, se confond avec la science véritable.
Non! c’était une autre science: celle qui cingle vers l’avenir, au fanal d’une conviction resplendissante; qui travaille, non pour une égoïste satisfaction, mais pour le bonheur de tous; qui dissipe les préjugés, éclaircit les mystères, rapproche et identifie les peuples, se marie dans une trinité sublime avec l’amour des hommes et l’amour de Dieu... la vraie science, en un mot; la science qui a du cœur!
Science! progrès! liberté!... Ces trois mots désignent une seule et même chose; et toutes les fois que la science n’est pas un progrès, toutes les fois que la science n’est pas une liberté, cette science-là n’est que de l’érudition. C’est un chaos; ce n’est plus un monde!
[76] Voy. sa lettre à Guillaume de Scève, en tête de son Dialogue sur l’imitation cicéronienne.
[77] C’est ainsi que Voulté s’exprime, dans sa dédicace au cardinal de Lorraine, en tête de ses Epigrammes latines, imprimées à Lyon, chez Gryphius, en 1536.
[78] Salmonii Macrini Juliodunensis, etc. Odarum libri sex, ad Franciscum regem... Lyon, Séb. Gryphius, 1537, in-8o. La pièce citée se trouve au verso du premier feuillet.
[79] Dolet nous apprend lui-même, avec la plus honorable franchise, qu’il dut beaucoup, en cette circonstance, à la collaboration intelligente et dévouée de son ami Bonaventure Desperiers, cujus opera fideli et accurata in primo Commentariorum suorum tomo usus est.
[80] Cette pièce se trouve également dans les Carmina, I, 35.
[81] Voy. sa préface, en tête de la réimpression des Formulæ latinarum locutionum Doleti, 1576, in-8o. Ce qu’il ajoute, néanmoins, est un peu plus équitable:
«Je n’examine pas, dit-il en parlant de Dolet et de ses Commentaires, d’où il les a tirés; mais certainement ils ont été utiles aux amateurs de l’éloquence et des bonnes lettres; et plût à Dieu que Naugerius, ou Dolet, ou quelque autre eût pu les achever! Nous aurions ainsi à notre disposition le répertoire complet de la langue latine, habilement distribué dans un ordre lumineux.»
[82] En 1536, in-4o. L’impression fut achevée le 31 août.
Jacques Thomasius a recueilli, dans son traité De Plagio litterario, Suobaci, 1692, in-4o, toutes les accusations de plagiat dirigées contre Dolet. Voy. les nombres 409, 410, 411, 412, 225. Les réflexions qu’il ajoute sont généralement hostiles à notre savant.
[83] C’est ce qu’il nous apprend lui-même dans sa lettre à Budé, lettre dont j’ai déjà parlé précédemment.
[84] J’emprunte cette particularité curieuse à la lettre, du reste fort malveillante pour Dolet, que cet Odonus adresse de Strasbourg à Gilbert Cousin, en date du 29 octobre 1535, et qui nous a été conservée par Niceron.
[85] Carm., I, 68.
[86] Notre-Dame de Paris, liv. IV, ch. II.
[87] Celui du dix-septième siècle, bien entendu.


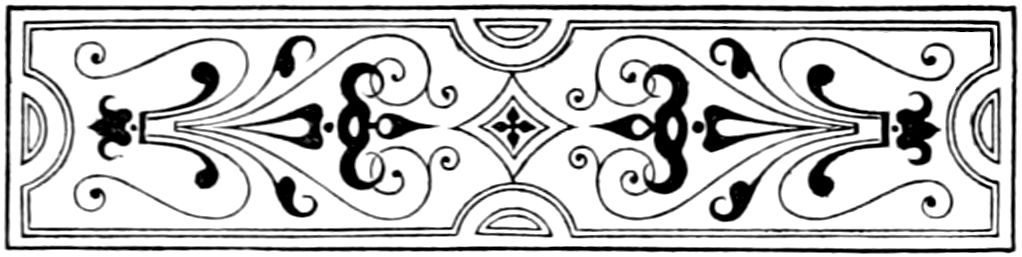
Mouvement intellectuel de la renaissance,
d’après les Commentaires.

Grand et bizarre ouvrage, que ces deux in-folio de Commentaires sur la langue latine! On s’attend à n’y trouver qu’un immense désert, un Sahara d’érudition; et l’on est tout surpris d’y rencontrer çà et là, comme autant de vertes oasis, de piquantes digressions sur les hommes et les choses du seizième siècle. On y voit se dérouler, notamment, tout un panorama du vaste mouvement scientifique et littéraire de la renaissance, tableau d’autant plus précieux qu’il est tracé, d’une main ferme, par un témoin oculaire, et même par un homme qui pouvait dire à juste titre: Et quorum pars magna fui!
Avant d’aborder cette citation d’un si haut intérêt, qu’on me permette ici quelques réflexions préliminaires.
Quelques années à peine s’étaient écoulées depuis l’immense découverte du Mayençais Guttemberg, ce Christophe Colomb du progrès et de la liberté; quelques années à peine!... et déjà l’Europe du moyen [p. 120] âge, la vieille cathédrale gothique, assaillie par tous les vents du ciel, ébranlée dans ses fondements séculaires, tremblait, craquait, menaçait ruine. Filia Babylonis misera!... le jour de Dieu s’était levé; la grande prostituée féodale voyait arriver sur elle, sombres et silencieux, les Attilas de la science, les vengeurs des Albigeois et des Jacques, les implacables démolisseurs de l’antique Pandémonium. Qu’ils étaient beaux à voir, ces héros de la sainte bataille, brandissant la plume en guise de glaive, et traînant à l’assaut du vieux Louvre leur formidable machine de guerre... le pressoir de Strasbourg, qui distillait, rouge comme du sang, le vin généreux de la pensée!... Vandales providentiels, ils s’avançaient lentement vers leur but mystérieux, guidés, dans la nuit de leur époque, par l’étoile de la justice divine. C’était comme une invasion, par représailles, de la pensée dans la matière, de la civilisation dans la barbarie. L’antiquité pullulante, semée par millions d’exemplaires sur un sol vierge et chaud, germait, s’épanouissait, fructifiait au centuple. Avant-garde de cette armée de l’intelligence, les gothiques incunables, débordant par myriades de la presse, comme d’une nouvelle officina gentium, marchaient en pionniers hardis au défrichement de l’ignorance. L’avenir se dévoilait, le ciel de la pensée s’ouvrait aux regards, dans toute la splendeur de son soleil, dans toute la hauteur de son azur infini; des perspectives jusqu’alors inconnues fascinaient les âmes.
Mais la forme antique devait encore pour un temps, parvenue en quelque sorte à sa période de [p. 121] classicisme moderne, dominer tous ces bégayeurs novices, et leur imposer en souveraine ses salutaires exigences; en attendant que la pensée européenne, moins timide, moins tâtonneuse, moins enfant pour tout dire, se fût creusé dans l’argile romaine et grecque un moule plus exact, plus vrai, plus national.
Oui, cette tyrannie provisoire du latin était nécessaire, inévitable, je dirais presque providentielle. Le monde romain, considéré dans son organisme extérieur, en d’autres termes, comme un vaste corps politique et social, était mort depuis longtemps, ou, pour parler plus juste, s’était transformé: car, en vertu de cette métempsycose par laquelle revivait, sous la forme chrétienne et sous le nom de Saint-Empire, l’âme de ce grand corps éteint, c’est à cette cosmopolite animation que les nationalités européennes, encore à l’état d’embryon pour la plupart, empruntaient sans le savoir leur existence parcellaire; c’est là que nos braves communes du moyen âge, ces vaillants municipes chrétiens, retrouvaient dans la nuit du labyrinthe le fil sauveur de leurs traditions perdues; c’est là que les bourgeois de nos bonnes villes reprenaient, avec l’âme de leurs pères gaulois, Vercingétorix et Indutiomar, l’audacieuse raison des légistes romains, et revêtaient en quelque sorte, comme une vieille cuirasse héréditaire, la constance d’efforts de la ville aux sept collines, luttant contre les hostilités environnantes, d’abord pour se défendre, plus tard pour envahir.
Cependant, si l’esprit persistait, le corps avait disparu. Mais le monde romain littéraire, mais l’idiome [p. 122] sacré de Brutus et de Cicéron s’était perpétué, éternisé de lui-même; phénix rajeuni de siècle en siècle, on le voyait s’essorer vers l’avenir, du milieu même des bûchers qu’allumaient chaque jour l’ignorance et le fanatisme. Imperium sine fine dedi! Cet oracle de Jupiter Optimus-Maximus avait dit vrai: grâce au latin, grâce aux héroïques souvenirs qu’il réveillait sans cesse dans les âmes, côte à côte de la catholicité chrétienne grandissait une catholicité païenne, de jour en jour plus envahissante. En face de l’aristocratie féodale, qui signait encore avec le pommeau de son épée[88], se formait d’un bout de l’Europe à l’autre la sainte république des lettres. Anglais, Allemands, Français ou Italiens, Vivès, Erasme, Budé, Thomas Morus, tous les hommes de cœur, toutes les intelligences d’élite, n’avaient plus qu’une patrie et ne parlaient plus qu’une langue: ils étaient citoyens de la ville éternelle.
Ainsi, vis-à-vis de la Rome papale s’élevait silencieusement la Rome de l’avenir, la Rome des idées. Durant une grande partie du moyen âge, ces deux sœurs, ou plutôt ces deux rivales, vécurent soi-disant en assez bonne intelligence. Il y avait bien de temps à autre quelques brouilleries peu profondes, [p. 123] comme à l’époque d’Abailard et de l’abbé de Clairvaux; mais ces passagers symptômes d’une mutuelle antipathie n’aboutissaient guère qu’au triomphe de l’élément chrétien sur cet audacieux ferment païen, si réluctant, si révolutionnaire, et qui montait, montait toujours... Operta tumescere bella.
Il n’en fut plus de même au seizième siècle: le plébéianisme gallo-romain, représenté par Erasme et Luther, osa, par un beau jour, en face de la Rome patricienne et papale, se retirer sur le mont Aventin. Dès lors, scission complète: d’un côté, l’on tient à ses priviléges, à ses acquêts séculaires, aux mille petites douceurs de son fructueux statu quo; de l’autre, on marche tout droit de la renaissance à la réforme, de la réforme à la philosophie, et de la philosophie à la révolution.
N’était-ce pas, du reste, avec une fierté déjà républicaine et révolutionnaire que les géants de l’érudition, les chevaliers de l’exégèse, les héroïques glossateurs du quinzième et du seizième siècle opposaient au latin de l’Église et des Pères le latin de Cicéron et de Brutus, la langue des Catilinaires et de l’antique liberté romaine aux sauvages barbarismes de la scolastique, au patois brutal de la tyrannie intellectuelle?
Je cède maintenant la parole à Dolet:
«Les lettres, de nos jours, s’épanouissent avec splendeur: heureuse et brillante floraison, dont je m’applaudis pour elles! Les études littéraires sont cultivées avec des efforts si grands et si universels, que, pour atteindre à la gloire des anciens, une seule [p. 124] condition nous manque: je veux dire l’antique liberté des esprits, et la perspective de la louange au bout de la carrière des arts. Ce qui nous manque aussi, c’est l’amour, la libéralité, la courtoisie des puissants envers les doctes; c’est la faveur des Mécènes, comme stimulant du génie, comme aiguillon des studieux labeurs; c’est une tribune où l’éloquence puisse trôner au grand jour; une sorte de sénat romain, une république, en un mot, qui fasse rayonner la palme aux yeux du talent, et décerne des éloges capables à la fois d’électriser les natures les moins littéraires, et d’enflammer de plus en plus les intelligences privilégiées. Au lieu de ces encouragements à la culture des arts, trop souvent l’essor de l’étude est entravé par le mépris qu’elle rencontre chez bien des gens, et le rire qui poursuit les champions du progrès. Au terme d’une carrière studieuse, nulle récompense, que dis-je? nul espoir! C’est une vie tout entière à traîner sans honneur; il faut dévorer mille affronts, se courber sous la tyrannie, sous l’insolence des barbares; et souvent même, pour vos jours en danger, la littérature est un redoutable guet-apens[89]. Néanmoins, ces vices de notre époque n’ont pas relégué si loin de l’Europe le progrès intellectuel, qu’on ne rencontre, sur tous les points, des cœurs brûlants de ce noble amour. Ah! sans doute, elle a été sans trêve et sans merci, la lutte qui, depuis un siècle, se livre à la barbarie du [p. 125] moyen âge, et souvent la victoire a chancelé, grâce aux forces prodigieuses dont disposaient les barbares; mais enfin, le succès a couronné la phalange du progrès. Au premier rang, voici Laurent Valla, qui, soutenu dans sa vigoureuse attaque par les centuries de ses contemporains, ouvre une brèche dans les bataillons ennemis. Mais ce n’est là, pour ainsi dire, qu’un premier engagement de troupes légères; en définitive, on a combattu de loin plutôt que de près. La brèche est ouverte, sans que les deux ailes de l’armée barbare soient assez fortement ébranlées par l’assaillant. Alors, au moment où, malgré leur prouesse, Valla et ses compagnons d’armes succombent déjà sous les chefs de l’obscurantisme, accourent pour les soutenir Ange Politien, Hermolaüs Barbarus, Pic de la Mirandole, le Volterran, Cœlius Rodiginus, Sabellicus, Crinitus, Philelphe, Marsile Ficin; et toute cette illustre génération que nous venons de passer en revue, fond à la fois sur la barbarie, qui se ralliait d’heure en heure et recouvrait ses forces. Les armes de l’éloquence à la main, ces grands hommes déploient à la rescousse toute la bravoure qui les anime... Hélas! morts au champ d’honneur, ils ne font que heurter les hordes barbares sans les anéantir. L’aile gauche des ennemis a disparu, mais la droite survit tout entière au combat. Soudain, de tous les points de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Espagne et de la France, la pensée fait partir en même temps ses foudres de guerre. Ils tombent sur la barbarie encore debout, et dont la crête superbe se dresse toujours contre [p. 126] eux; ils l’ébranlent, la renversent... Victoire! elle abandonne ses mains aux fers, et se laisse traîner en triomphe. L’Italie, qui n’a jamais cessé d’être la métropole de l’éloquence, et le sol fécond où le génie prend racine pour s’élever jusqu’au ciel, l’Italie fournit d’abord son contingent, chefs d’élite, orateurs célèbres, athlètes vingt fois couronnés dans l’arène littéraire: c’est Pierre Bembo, Jacques Sadolet, Baptiste Egnatius (dont j’ai suivi les leçons dans ma jeunesse, lorsqu’il expliquait le traité des Devoirs, de Cicéron, et le poëme de Lucrèce), André Navagérius, Romulus Amazéus, Nicolas Léonicène, Lampride et Lazare Buonamico. Viennent ensuite trois poëtes: Jovien Pontanus, Jérôme Vida et Actius Sincérus Sannazar. Quels hommes! que de louanges ils méritent! de quel éclat resplendissent leurs noms parmi les doctes! Immédiatement après eux, intrépides aux rangs divers que la science leur assigne, tombent sur la barbarie le cardinal Adrien, Bartholomeo Ricci, Marius Nizolius, Hortensius Appianus; et, avec eux, un médecin des plus célèbres, Jean Manardo, André Alciat donne à son tour: dès sa première adolescence, transfuge du camp barbare des légistes, il se retrempe au baptême de la littérature, et maintenant il brille parmi les zélateurs de l’éloquence. Ce héros n’est pas seul au combat; accompagné d’Emile Ferretti et d’Othon Bosio, il marche avec un redoublement de courage. Voilà donc, avec tous ses illustres capitaines (je ne parle point des vélites et des jeunes soldats, dont le nom encore obscur brillera dans son temps), la belle [p. 127] phalange que l’Italie fait sortir de son sein. Ardente et studieuse émule, la Germanie, à son tour, donne le signal et précipite ses braves au combat. A la voix de la patrie, Jean Reuchlin prend les armes avec Rodolphe Agricola, et tous deux s’associent pour la grande guerre Didier Erasme de Rotterdam, leur disciple, écrivain plus fort en verbiage[90], il est vrai, qu’en solide éloquence, mais qui, cependant, par son avalanche de livres, n’a pas été le moins actif promoteur de la cause littéraire. Incontinent accourt Philippe Mélanchthon, le premier entre les Germains. Derrière lui se pressent Ulric Hutten, Béatus Rhénanus, Simon Grynée, Henri Glaréanus, Martin Dorp, Conrad Goclénius, Héobanus Hessus, Jacques Mycille, Jean Oporinus, Jacques Omphalius, Ulrich Zazius, Viglius Zuichémus, Charles Sucquet, Cop de Bâle et Léonard Fuchsius. Tous brûlent d’affranchir du joug de la barbarie, les uns l’art oratoire, les autres la poétique, ceux-ci la science du droit civil, ceux-là, enfin, la médecine. En Angleterre, la barbarie voit s’armer contre elle Cuthbert Tunstall, Thomas Linacre, et Thomas Morus, aussi heureusement partagé, quant aux succès littéraires, que malheureusement accablé, en dernier lieu, par l’injustice de la fortune. De l’Espagne s’avancent Louis Vivès et Antoine de Lébrixa; soldat de la science plus courageux que bien armé, celui-ci fait [p. 128] place à Coclés Ninivite, que j’ai failli passer sous silence, et qui, le premier, attaque la barbarie à coups de traits et la provoque au combat. La France, enfin (je la place au dernier rang, pour que la calomnie ne m’accuse pas d’un nationalisme partial), la France ne veut point paraître manquer seule à cette sublime croisade; aux troupes étrangères de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Angleterre et de l’Espagne, elle joint ses phalanges qui ne sont pas les moins nombreuses. Voici paraître, comme chef de file, Guillaume Budé, également profond dans les littératures grecque et latine; immédiatement après lui marche le Fèvre d’Estaples, couvert, ainsi que d’un bouclier, par l’escorte de la philosophie. A Christophe de Longueil (peu m’importe que, dans sa jeunesse, blessé par ses concitoyens, il ait voulu renier son pays natal pour une patrie étrangère: réellement il était Français); à Christophe de Longueil, dis-je, et à Simon de Villeneuve, est confiée la mission d’étendre plus au loin les frontières de la langue latine, d’accomplir avec zèle cette noble tâche, et, sur le cadavre de la barbarie vaincue, de rétablir l’éloquence dans sa dignité première. Aussitôt ce désir de la patrie connu, à Budé, à le Fèvre, à Longueil, à Villeneuve, s’adjoignent comme compagnons d’armes Jean Dupin, Nicolas Bérauld (sous la direction duquel, à l’âge de seize ans, j’ai appris la rhétorique au sein de Lutèce), Germain Brice, Lazare de Baïf, Pierre Danès, Jacques Tusanus, Salmon Macrin, Nicolas Bourbon, Guillaume du Maine, Jean Voulté, Orontius Finéus le Dauphinois, et Pierre Gilles. Arrivent [p. 129] ensuite, pour grossir leurs rangs, nos jurisconsultes français, coalisés en masse contre les barbares: Pyrrhus Angleberméus d’Orléans, Pierre de l’Estoile, son compatriote, Gui Brelé, Jean de Boysson le Toulousain, Guillaume Scève de Lyon, Claudius Cantiuncula, Emile Perrot et Michel de l’Hospital. Du fond de leurs écoles, les médecins à leur tour s’élancent dans la mêlée: voici accourir Symphorius Campégius, Jacques Sylvius, Jean Ruel, Jean Cop, François Rabelais et Charles Paludanus. Recruté partout, cet escadron de la science fait sur le camp de la barbarie une charge si vigoureuse, que la vaincue lui cède jusqu’à son dernier pouce de terrain. L’Italie, depuis longtemps, l’a vue tourner le dos; l’Allemagne, battre en retraite; l’Angleterre, s’échapper; l’Espagne, s’enfuir, et la France, disparaître sous les sifflets. Pas une ville, en Europe, qui ne soit délivrée de l’horrible monstre: plus que jamais, les lettres sont cultivées; la sève de l’étude circule dans toutes les branches de l’art, et le monde, sortant du chaos intellectuel, marche, avec l’aide et sous l’impulsion de la littérature, à la conquête de la justice et de la vérité. Maintenant les hommes ont appris à se connaître; maintenant leurs yeux s’ouvrent à la lumière universelle, tandis qu’auparavant, couverts de ténèbres, ils se fermaient dans une complète et déplorable cécité; maintenant, enfin, l’on peut dire qu’ils diffèrent véritablement des brutes, tant la culture des arts a développé leur intelligence! tant leur langage, c’est-à-dire ce qui trace entre eux et les animaux la ligne de démarcation la plus profonde, a [p. 130] conquis de splendeur et de correction! N’ai-je donc pas raison d’applaudir au triomphe des lettres, puisqu’elles ont recouvré leur gloire antique, et que par elles (noble privilége!) la vie humaine se voit prodiguer les jouissances? Ah! si seulement l’envie de certains barbares, étrangers à toute espèce d’éducation, ne s’acharnait plus contre les lettres et contre leurs fidèles; si notre sol était purgé de toutes ces pestes humaines, que pourrait-on souhaiter encore pour le bonheur de notre âge? Mais enfin elle tombera de vieillesse, la tyrannie des pervers; et cette jeunesse qui, de nos jours, se transfigure au sein du progrès et de la science, grandissant avec la dignité des lettres, renversera leurs ennemis du haut rang qu’ils occupent, entrera dans la carrière des fonctions publiques et dans le conseil des rois, et, marchant à la tête des affaires, prendra partout en main les rênes d’une intègre administration. Ce n’est pas tout: comme elle aura grandi avec les lettres, elle voudra les voir étendre dans toutes les âmes leurs racines vigoureuses, ces saintes lettres! dont la voix austère nous préserve du vice, engendre dans nos cœurs l’amour de la vertu, ordonne aux rois d’appeler et de retenir auprès d’eux les zélés observateurs de la justice et de l’équité; en même temps qu’elle leur prescrit de fuir et d’éloigner comme un poison, les âmes gangrenées, les vils flatteurs, les flagorneurs rampants, les entremetteurs de voluptés dont fourmillent les cours. Oh! alors, que manquera-t-il à Platon pour le bonheur de sa république? Il n’y admet que des princes philosophes, ou, du moins, [p. 131] qui aiment les philosophes et recourent à leurs conseils. Eh bien! ce jour-là, nul ne regrettera dans les princes une sagesse absente; on verra qu’ils n’ont rien de plus cher, de plus agréable que le commerce des sages; magnifique idéal, que réaliseront enfin la culture des lettres, l’amour des bonnes études et des saintes disciplines, qu’un enthousiasme électrique propage, à l’heure qu’il est, dans tous les cœurs et dans toutes les intelligences[91].»
Vous venez d’entendre, chantés par une voix contemporaine, l’invocation, en quelque sorte, et les premiers épisodes de cette grande Iliade qui s’appelle LE SEIZIÈME SIÈCLE. Vers le même temps, merveilleuse coïncidence! un poëte chanta la première croisade catholique. Rien d’étonnant: la mélodieuse octave du Tasse, d’un fou de génie, devait célébrer, dans un de ses plus beaux accès, la folie du moyen âge, la folie de la croix. Ici, au contraire, c’est un érudit qui célèbre en prose latine, en larges périodes cicéroniennes, l’austère et sérieuse croisade de la science. C’est un martyr de la pensée qui entonne, en plein glossaire, au cœur même d’un volumineux in-folio sur la vieille langue latine, l’hymne retentissant de la liberté moderne, le dithyrambe électrisant du progrès et de l’avenir. Quand, uni à ses compagnons d’armes, il soulevait avec eux la pierre du sépulcre où, depuis tant de siècles, étouffait la pensée humaine... lui aussi, lui surtout, il aurait eu le droit de s’écrier avec enthousiasme: Canto [p. 132] l’armi pietose! je chante la guerre sainte, la délivrance du grand tombeau!
Ivre encore de ses classiques souvenirs, le généreux humaniste en verse le reflet brûlant et sympathique sur l’immense tableau qu’il retrace. On croirait entendre Hérodote, l’Homère de l’histoire, chanter les Thermophiles, Léonidas et les Trois-Cents. La voyez-vous, l’innombrable armée des barbares? Elle couvre l’Europe entière; horde noire de l’obscurantisme, elle enténèbre de ses traits le ciel de l’intelligence humaine. Tant mieux! répondent les héros, nous combattrons à l’ombre. Tout à coup, au milieu du chaos, Guttemberg a proféré son FIAT LUX! le cri de guerre a retenti; les braves s’élancent à la rescousse. Oh! la lutte est longue, terrible, inexorable; bien des vaillants succombent au champ d’honneur. Mais les vengeurs remplacent les morts; sur tous les points la barbarie est refoulée, le moyen âge est vaincu... la pensée triomphante plane sur le monde!
[88] En plein seizième siècle, ou pleine renaissance, le connétable Anne de Montmorency disait à qui voulait l’entendre qu’un noble dérogeait en s’instruisant!
[89] Encore un arrière-goût du bon temps où notre humaniste étudiait le droit à Toulouse! Dolet tenait ferme dans ses rancunes.
[90] Je n’ai pas besoin de le dire: ce n’est point précisément à Dolet qu’il faut s’en rapporter au sujet d’Erasme, son adversaire dans la question cicéronienne.
[91] Comment., t. I, col. 1156, 1157, 1158.

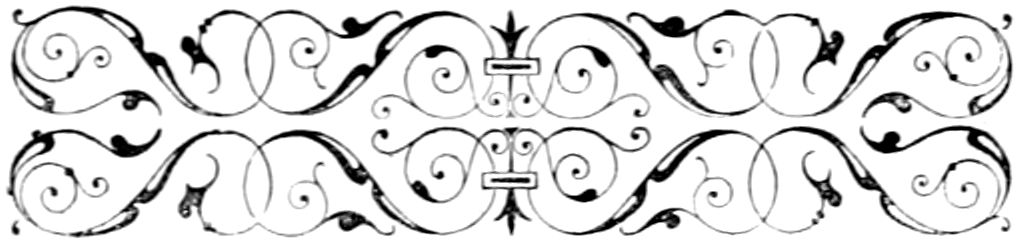
Meurtre forcément commis par Dolet. — Résultats de cette malheureuse affaire.

Ce n’était point assez que l’injustice humaine tourmentât, comme nous l’avons vu, l’existence laborieuse de notre Estienne; une sorte de fatalité jalouse[92] ne tarda pas à se mettre de la partie. Le 31 décembre 1536, il luy advint, dit une des pièces[93] de son procès, une fortune et malheur de commectre homicide en la personne d’un peintre nommé Compaing[94]. Ennemi mortel de Dolet, cet homme avait voulu l’assassiner; mais, non moins habile à tenir l’épée qu’à manier la plume, aussi calme, aussi impavide que le juste d’Horace, l’étudiant orléanais se défendit avec tant de vigueur et de sang-froid, que l’assassin tomba victime de son propre guet-apens. Dolet raconte lui-même cet [p. 134] événement tragique et ses suites, dans une épître au cardinal de Tournon, qui forme la première pièce du deuxième livre de ses Poésies latines. Je vais la traduire en entier, car elle abonde en détails curieux:
«De sa double face, dit l’humaniste, Janus contemplait à la fois deux années, l’une sur son déclin, l’autre prête à naître, quand tout à coup je me vois attaqué par un ennemi félon, qui me porte l’épée à la gorge. Alors moi, je résiste à l’agresseur qui menace mes jours, et j’étends mort à mes pieds celui qui s’efforçait de me détruire par le fer.
«Mon Dieu! j’étais cependant tout aux Muses; et brûlant d’illustrer un jour ma patrie par des écrits immortels, je concentrais mon âme sur ce noble idéal. Mais à qui le sort jaloux fait-il grâce?
«Connue sous le nom de Lugdunum, une ville antique s’élevait dans la Gaule; elle couronnait le front d’une colline au pied de laquelle, à la suite d’un incendie, Plancus, chef des armées romaines, la rebâtit en la tournant vers le nord. La Saône, au milieu d’elle, traîne ses eaux lentes; d’un autre côté, le Rhône la presse d’une ceinture humide; puis, retardant leur cours, ces deux beaux fleuves, par une large embouchure, se plongent dans le sein l’un de l’autre. Riche, populeuse, superbe d’architecture, à ses enfants, aux étrangers, à tous, elle s’ouvre comme le temple du commerce.
«C’est dans un lieu si célèbre que s’écoulait ma vie studieuse, lorsqu’une cruelle attaque me contraignit d’opposer la force à la force, et de chercher mon salut dans le meurtre. Aussitôt, un nombreux [p. 135] détachement du guet s’élance à ma poursuite; sans tenir compte de mon innocence, on veut m’ensevelir dans les ténèbres d’une prison: mais il est toujours facile à un homme de cœur d’échapper aux embûches de ces lâches ribauds. Protégé par une escorte d’amis, je sors de la ville au point du jour; et d’abord je vole en Auvergne, malgré l’âpre froidure qui régnait alors, malgré toute la fureur des vents déchaînés.
«Au loin m’apparaissent, comme des rois en cheveux blancs sur un trône de montagnes, de vieux ornes couverts de neige; à travers les vallons (spectacle sublime!) un torrent fougueux se précipite en imitant la voix sonore de la tempête, et, frappant le sol avec le bruit de la grêle qui tombe, court ensuite inonder les campagnes.
«Déjà, parmi les hautes forêts de l’Auvergne, l’Allier superbe, enflant ses ondes, déploie sous mes yeux toute l’étendue de son cours. L’idée me vient aussitôt d’accélérer mon voyage, en me servant de cette rivière; je m’embarque. Sous l’impulsion des rames, le bateau glisse plus rapide que les vents; à droite, à gauche, villes, campagnes, tout fuit en arrière, tandis que ma nef agile sillonne le long ruban des eaux.
«Mais l’implacable hiver s’attarde en ces contrées; du fond à la surface, pour ainsi dire, le froid condense la rivière; la glace refuse tout passage aux avirons, heurte, à chaque instant, notre frêle embarcation qui bondit sous la secousse, et, de distance en distance, nous oblige à nous arrêter. Lancée par un arc bien tendu, d’abord la flèche du Parthe fend [p. 136] avec vigueur l’air environnant, puis, rencontrant un arbre, elle se plonge dans sa printanière chevelure, s’amortit à travers le feuillage, et finit par tomber mourante. Ainsi se ralentit, au milieu des glaçons, notre petit navire qui, tout à l’heure encore, devançait les flots à la course. Alors, enflammé par mes promesses, le batelier redouble de courage; il lutte, il se roidit des deux mains, il s’ouvre une large issue, et la glace brisée cède enfin aux innombrables coups de rame qui la dispersent. Incontinent, nous nous livrons au vaste courant de la Loire, qui m’entraîne vers une ville, une ville autrefois célèbre, Orléans. Berceau de mon enfance, je te reconnais, et je couvre de baisers les autels de la patrie.
«De là, renvoyant mon bateau, je franchis la plaine à franc étrier; le roi! voilà le seul but de ma course. Je me dirige donc vers la grande et populeuse Lutèce, où l’on me dit que je trouverai François Ier, à qui le ciel a confié les destinées de la France. O soleil, toi dont les regards embrassent le monde, que peux-tu voir de meilleur, de plus auguste, de plus clément?
«Je l’aborde et lui présente mes humbles hommages; puis, je lui raconte en ces termes le malheur déplorable dont le sort m’avait rendu victime:
«O roi plein d’amour pour la justice, c’est au nom de cette justice même qu’en toute sécurité je m’adresse à toi. Je l’avoue, j’ai privé quelqu’un de la vie; mais un danger pressant m’a contraint à cette violence. S’il est vrai qu’en cela j’aie suivi la loi salutaire de notre mère suprême, la nature; s’il est vrai, [p. 137] d’un autre côté, que le droit civil autorise une défense personnelle, ma requête est juste: fais-la triompher, en m’accordant ma grâce. Oui, l’accident est fatal, j’en conviens; le premier, il m’a convaincu que nous sommes tous, au même titre, le jouet des vicissitudes humaines. Mon bras n’était pas fait à l’œuvre du sang. Eh bien! malgré tout, il m’a fallu frapper un ennemi et devoir mon salut à des armes cruelles. Grâce, je t’en conjure! grâce, ô mon roi! Si ton glaive légal anéantit justement le coupable, tourne vers l’innocent un regard de mansuétude, et sauve celui qu’a voulu perdre la fatalité.
«Le roi se laisse fléchir: sa voix m’ordonne de me retirer sans crainte. Pallas, accompagnée des neuf vierges de la double montagne, m’accueille au sortir de l’audience, et félicite avec transport son cher nourrisson.
«Arrive l’heure d’un banquet préparé par les soins de mes doctes confrères en Apollo. Chacun prend place; au nombre des convives se font remarquer tous ceux qu’à bon droit l’on nomme les flambeaux de la France: entre autres Budé, le plus grand de tous, Budé, cette gloire encyclopédique; Bérauld, l’heureux Bérauld, qui fait envier son génie supérieur et sa facile éloquence; Danès, qui s’est illustré dans toutes les branches de l’art littéraire; Tusanus, qu’une justice honorable a surnommé bibliothèque parlante; Macrin, ce favori de Phébus, habile à manier tous les rhythmes; Bourbon, non moins riche en verve poétique; Dampierre, et, près de lui, ce jeune Vulteius qui fait concevoir au monde savant [p. 138] de si hautes espérances; Marot, ce Virgile français qui déploie dans ses vers un divin trésor d’imagination; Rabelais, enfin, cette grande illustration médicale, cette renommée de si bon aloi, François Rabelais, qui, du seuil même de Pluton, rappellerait les morts à l’existence et les rendrait à la lumière.
«Sur tous les points, une vaste conversation s’engage; on passe en revue les doctes compagnons d’armes, les gloires contemporaines qui fleurissent aux rives étrangères. Erasme, Mélanchthon, Bembo, Sadolet, Vida, Jacques Sannazar, voilà ceux qui, tour à tour, sont loués à pleine voix.
«Déjà s’épanouit à l’horizon l’aurore du lendemain; je songe à quitter Paris, je hâte mon retour à Lyon. Mon itinéraire est tout tracé; je le prends à travers les beaux lieux qu’arrose la Seine, à travers ce champ de bataille de César, où resplendirent tant de fois les aigles invaincues.
«J’arrive enfin; me voilà de nouveau dans ce vieux Lugdunum que partage en deux l’Arar au long cours. Alors, écoutez les avis que me donnent les Muses:—Jouis, me disent-elles, jouis désormais en toute sûreté de ta première liberté d’âme, et poursuis jusqu’au bout ta studieuse carrière. Que l’insolent sarcasme des détracteurs ne brise pas ton élan; non! marche à la conquête de ton immortalité; marche, et fais attester aux siècles futurs qu’un fils de la France a vécu sous le nom de Dolet, et qu’il a vécu, brûlant sans cesse d’un noble amour pour l’idéal le plus sublime!—
«Après m’avoir stimulé de la sorte, elles retournent [p. 139] à leur grotte de la double montagne. Docile aux belles paroles des Castalides, je laisserai des œuvres dignes de moi; tu peux en être sûre, ô postérité!»
L’événement dont notre héros vient d’achever le récit, fut encore pour sa muse latine l’objet de plusieurs pièces de vers, qui se lisent à la suite l’une de l’autre, dans le deuxième livre de ses Carmina. C’est ainsi qu’en vertu d’une prosopopée oratoire, il introduisit le chœur des Muses, plaidant au pied du trône, avec une tendresse pathétique, la cause de leur cher nourrisson.
«Grâce pour Estienne! s’écriaient d’une seule voix les saintes Aonides; grand roi! sois exorable à nos vœux; laisse retourner le savant à ses études, le poëte à ses inspirations.»
«En revanche, ajoutait le docte chœur dans la pièce immédiatement suivante, tu entendras bientôt, dans un style élégant et plein d’élévation, le récit des événements qui ont signalé notre époque[95].»
Vulteius, ayant appris à Toulouse la position critique de Dolet, se hâta d’en prévenir Jean Dupin, leur commun protecteur, cet excellent évêque de Rieux avec lequel nous avons déjà fait connaissance. L’épître n’est rien moins que cicéronienne sous le rapport du style, je suis forcé d’en convenir; mais elle respire le plus rare dévouement, et cela vaut mieux, à mon avis, que d’élégantes périodes à la [p. 140] Bembo. Elle prouve, en même temps, que si notre Estienne avait eu le malheur ou le tort de s’attirer bien des haines implacables, il avait toujours su conserver, d’autre part, de bonnes et solides amitiés. Je vais donc en traduire les passages les plus intéressants.
«La rumeur publique, écrit ce brave Vulteius, m’avait appris depuis quelque temps la mésaventure d’Estienne Dolet; les lettres de mes amis ne tardèrent pas à me confirmer cette fâcheuse nouvelle. Ma première pensée fut aussitôt d’abandonner Toulouse et mes études, pour me rendre au plus vite à Lyon. J’avais hâte de prouver ma fidélité inébranlable à un vieil ami dans le malheur, de mettre à sa disposition mes conseils et ma bourse, et de lui offrir spontanément tout ce qu’il est en droit d’attendre d’un homme qui se reconnaît, à tant de titres, son débiteur et son obligé. Je voulais surtout, dans le cas où ce pauvre Dolet, succombant sous les coups de l’envie, accablé par ses lâches calomniateurs, ne trouvant personne autour de lui pour lui tendre la main, se serait vu déclaré coupable de meurtre, et, comme tel, forcé de s’expatrier (chose que je redoutais plus que tout au monde, et pour lui-même, et pour son pays, et pour la littérature); je voulais, dis-je, l’accompagner à son départ, acquittant de la sorte une promesse que j’avais faite depuis longtemps... Pouvais-je, en effet, consentir à me séparer d’un homme si docte, d’un ami si rare, l’ornement et le flambeau de la France?... Espérons, cependant, que tout ira pour le mieux; espérons qu’il ne sera [p. 141] condamné ni au gibet, ni à la prison, ni à l’exil, ni à d’autres supplices, et que, bien au contraire, il pourra revenir, plus alerte et plus joyeux que jamais, à ses études interrompues. Puisse-t-il achever ce second volume des Commentaires, dans lequel il s’absorbait tout entier, à l’instant même où un affreux malheur est venu fondre sur lui! Puisse-t-il attaquer ensuite cette Histoire contemporaine depuis longtemps promise, et y déployer toute la gravité, toute l’élégance de son style! Puisse-t-il faire paraître, avec le temps, son livre sur l’Opinion, ouvrage assurément aussi agréable que nécessaire! Puisse-t-il mettre au jour de nouvelles poésies, empreintes de cette grâce et de cette véhémence que tout le monde lui reconnaît! Puisse-t-il, enfin, terminer les nombreux travaux qu’il nous annonce, ce génie divin, si infatigable au labeur, si puissamment rompu dès le berceau à toutes les difficultés de l’étude, que (sans prétendre pour cela ravaler aucun mérite ni aucune gloire) je me demande s’il est possible qu’un autre homme atteigne jamais à cette hauteur!»
Un autre ami de Dolet, Finetius, dans une lettre à Cottereau que j’ai déjà citée au chapitre V du présent ouvrage, s’exprimait avec un égal enthousiasme sur le compte de notre cher cicéronien.
«Je n’admire pas seulement, disait-il, un jeune homme de tant de mérite: j’ai l’intime conviction, pourvu que Dieu lui prête vie, de le voir un jour surpasser l’admiration générale. Que ne doit-on pas attendre de ses viriles années, puisque au début même de l’adolescence, non content de se maintenir à la [p. 142] hauteur des espérances qu’il a fait naître, il s’élève encore, à force d’éloquence et de courage, au-dessus de son âge, que dis-je? au-dessus même d’un âge plus avancé! Je ne prétends point l’exalter ici par une stupide apothéose; je n’irai point crier par-dessus les toits, comme un louangeur mercenaire, qu’il a parcouru en triomphateur le cercle entier des connaissances humaines; j’attesterai simplement que, pour tout ce qui tient à la science des bonnes disciplines, à la faculté de bien dire, il n’a rien négligé de ce qui peut affermir ses pas dans cette noble carrière.»
On a remarqué sans doute, au commencement de cette citation, les mots que j’ai soulignés: Pourvu que Dieu lui prête vie. Dolet n’était pas le seul, cette parenthèse en est la preuve, que poursuivît le pressentiment de sa lugubre fin.
Cette fois cependant, le roi lui fit grâce, comme on l’a vu plus haut; mais la haute clémence du protecteur des lettres n’empêcha pas instantanément l’action des lois contre notre Estienne. Bon gré, mal gré, l’humaniste dut se rendre en prison. Seulement, armé de l’ïambe latin, qu’il maniait parfois avec toute la nerveur d’Archiloque, il soulagea plus tard, dans une violente invective, sa profonde rancune contre le juge qui l’avait décrété de prise de corps.
«Non! s’écria-t-il en s’adressant à ce personnage, non! ce n’est point un accès de folie, ce n’est point un élan de haine qui a pu m’entraîner au meurtre d’un homme. C’est au nom d’une loi formelle de la nature que j’ai repoussé la force par la force; en un [p. 143] mot, j’étais dans mon droit, lorsque en homme de cœur j’ai brisé l’affreuse attaque d’un sicaire. Et voilà pourquoi tu me fais incontinent plonger dans un cachot, jeter dans les fers? Voilà pourquoi tu prétends, au moyen d’une charmante pendaison, me voir la pâture des mouches, des vers et des corbeaux? Va! telle n’est pas la destinée que me réserve Pallas, dans son cœur maternel. Souffre donc que j’aie fait ce que la nature tolère et même conseille; ou bien avoue franchement que, sous ta face d’homme, vivent incarnés en toi des milliers de tigres, ou je ne sais quoi de plus monstrueux, de plus atroce encore que des tigres. En avouant de la sorte ta cruauté inouïe, tu rendras hommage à la vérité[96].»
C’était déjà le second emprisonnement que notre Estienne avait à subir. Il ne comptait pas, il est vrai, sa première et courte détention dans les geôles de Toulouse; mais il lui fallut bien, à cette fois, prendre la peine de compter. Le pauvre savant ne put s’arracher aux griffes de ces voraces justiciers du seizième siècle, qu’après mainte sollicitation désespérée, mainte anxieuse requête, adressée coup sur coup, soit en vers, soit en prose, au cardinal de Tournon, établi par François Ier régent du royaume, tandis que ce prince marchait lui-même à la tête de ses armées.
Je me suis demandé plus d’une fois s’il n’eût pas mieux valu, pour Dolet, succomber alors, en toute sève, en pleine gloire, sous les coups de son [p. 144] lâche agresseur; et si la Providence n’avait pas été cruellement injuste envers cette grande victime, en la réservant pour cette mort atroce et ignominieuse qui, dans la suite, fut son partage. Mais non! j’avais tort: il fallait que la pensée eût son martyr; il fallait que la foi du progrès eût son confesseur, son athlète victorieux, couronné de la palme des élus; il fallait, en un mot, que l’horrible flamme du bûcher de la place Maubert se reflétât de siècle en siècle, sanglante et indélébile, sur les fronts maudits des inquisiteurs, sur les faces de Caïn de tous ces impuissants bourreaux de l’intelligence!
[92] Fati invidia, comme il l’appelle lui-même.
[93] Retrouvées par M. A. Taillandier dans les registres criminels du parlement de Paris, et publiées chez Techener, en 1836.
[94] Dans les pièces déjà citées, on le désigne tantôt sous l’appellation de Guillaume Compaing, tantôt sous celle de Henry Guillot, dict Compaing.
[95] Il tint parole, ou à peu près, au moyen de ses Fata Regis, ouvrage que j’ai déjà mentionné.
[96] Carm., II, 5.


Dolet imprimeur. — Son mariage. — Naissance de son fils Claude. — Premières productions de sa presse.

Quelque temps après cette funeste aventure du meurtre de Compaing, Dolet parvint à obtenir un privilége de dix ans, qui lui bailloit licence, au nom du roi, «d’imprimer ou de faire imprimer tous les livres par luy composez et traduicts, et aultres œuvres des autheurs modernes et anticques, qui par luy seroient deuement reveus, amendez, illustrez ou annotez, soit par forme d’interprétation, scholies, ou aultre déclaration, tant en lettres latines, grecques, italiennes, que françoyses.»
Ce document est daté de Moulins, le 6 mars 1537, et signé par le roy, monseigneur le cardinal de Tournon présent. Ce prélat avait été l’introducteur de Dolet auprès de François Ier, et en avait dit à ce prince trop plus de bien, comme nous l’apprend Estienne lui-même. Nous verrons dans la suite à quoi aboutirent ces bienveillantes dispositions de l’Éminence.
C’était, du reste, comme on le voit, un privilége très-avantageux pour le temps; mais les circonstances ne permirent pas à Dolet d’en faire immédiatement [p. 146] usage. Il dut, avant tout, sortir de prison; puis, une fois libre, il lui fallut achever la publication du second volume de ses Commentaires, in-folio de 1716 colonnes (sans compter 32 feuillets de pièces liminaires), qui parut en 1538, après avoir pris naissance, comme son frère aîné, sous les admirables presses de Sébastien Gryphius[97].
Outre ces deux premiers volumes, notre infatigable Estienne en promettait un troisième et dernier, où, comme il le disait lui-même, en tête du 1er livre de ses Poésies latines, à son ami Claude Cottereau (plus tard le parrain de son petit filz Claude, ainsi que nous le verrons tout à l’heure), «il se réservait de donner toute la mesure de son génie, toute celle de son jugement, en fait de style et d’éloquence». Sa mort cruelle et prématurée l’empêcha de réaliser ce cher projet; j’imagine seulement que l’on peut regarder comme des fragments de cette œuvre colossale,
ses Formulæ latinarum locutionum, et ses Observationes [p. 147] in Terentii Andriam et Eunuchum, ouvrages publiés, le premier en 1539, et le second en 1540.
Voilà donc notre cicéronien débarrassé de sa rude besogne des Commentaires. C’est alors, enfin, qu’il fut loisible au savant de s’abandonner à tout son zèle pour le triomphe de la science et la diffusion des lumières. Mais, cette fois, dans la sainte ferveur qui dévorait son âme, l’artisan du progrès intellectuel ne se contenta plus de penser et d’écrire: à son tour, il voulut avoir en main l’outil sublime de la pensée, ce glaive de justice, ce tonnerre à mille carreaux qui s’appelait (autrefois) la PRESSE.
Il se fit donc imprimeur. En d’autres termes, comme il le disait lui-même à François Ier, «se trouvant à repos avec mesnaige et famille (car il venait de prendre femme[98]; j’oubliais, Dieu me pardonne! d’en parler à mes lecteurs), il avoit voulu travailler pour mectre et rediger par escript quelques œuvres par lui inventez et composez, et aussi pour amender et corriger à l’imprimerie aulcuns livres utiles qui en avoient besoing, affin qu’il peust, avec ce peu d’intelligence et d’industrie que Dieu luy avoit presté, gaigner quelque honneste moyen de vivre, et aulcunement [p. 148] subvenir et aider à la décoration des bonnes lettres et sciences. En quoy faisant, il avoit mis ensemble quelque peu d’argent, avec lequel et l’aide de ses amis, il, despieça, leve quelques presses d’imprimerie, et soubz ycelles imprime et faict imprimer plusieurs beaulx livres, tenant boutique de librairie[99].»
Du reste, sa boutique, comme il l’appelle, se trouva bientôt parfaitement achalandée. «J’ay publicquement», dit-il encore à François Ier, dans une épître en rimes, qui fait partie de son Second Enfer:
C’est bien! le voilà compagnon d’armes des Alde, des Gryphius, des Froben, de tous ces héroïques typographes du seizième siècle. Alors, debout et fier, la main sur sa presse belliqueuse, il s’écria, d’une voix plus que jamais retentissante:
Malheur!... ce cri de guerre de sa pensée, les obscurantistes l’entendirent; l’exclamation vibrante avait ébranlé le sol jusqu’au plus creux de leurs [p. 149] repaires. La bande entière en frémit, et, du milieu de leurs trous fétides, les hiboux s’apprêtèrent, en dépit du soleil, à fondre sur l’aigle isolé.
Du reste, le pauvre Estienne avait toujours eu le pressentiment de sa fin cruelle. On peut s’en convaincre, d’abord, en lisant certain passage de son Second Enfer que je citerai tout à l’heure, et de plus, l’endroit suivant de la lettre à Budé qui précède le tome second des Commentaires sur la langue latine:
«Je nourris de plus hauts projets, y disait-il, et après ce labeur de mes Commentaires, j’ai depuis longtemps l’intention d’aborder l’histoire contemporaine. De cette manière, la jeunesse amante des lettres aura trouvé dans mon zèle un concours utile. La patrie, à son tour, ne me reprochera pas d’avoir gaspillé mes studieux loisirs en barbouillages insipides et superflus. C’est ainsi que, jeune homme et vieillard (SI TOUTEFOIS UNE MORT PRÉMATURÉE NE M’ÉTOUFFE), j’aurai, selon mes vœux, consacré ma vie au plus honorable, au plus noble travail.»
Ensuite, un autre indice de cet instinct prophétique, dont toute sa vie fut empoisonnée, se tire de l’emblème qu’il avait adopté pour les productions de sa presse, en vertu d’un usage alors universel chez ses doctes confrères. L’enseigne typographique de notre malheureux imprimeur est allusive à son nom de Dolet; c’est une doloire (espèce de hache) tenue par une main qui sort d’un nuage. L’instrument est suspendu, comme le glaive de Damoclès; on le voit prêt à frapper le tronc noueux d’un arbre qui s’étale horizontalement sur le sol, pareil au condamné dans [p. 150] l’attente du coup mortel. Le tout s’encadre dans la légende suivante:
SCABRA ET IMPOLITA AD AMVSSIM
DOLO ATQVE PERPOLIO.
Je polis et repolis
Le raboteux des écrits.
George Sabinus, un des ennemis de Dolet, s’empara de cette légende dans un distique latin, où il s’efforça de ridiculiser le savant typographe, au moyen du facile et stupide jeu de mots que vous allez voir:
«Si Dolet, avec sa doloire, polit tout avec tant de soin, pourquoi ne polit-il pas aussi ses vers rocailleux?»
Presque toujours, notre Estienne imprimait cette marque à la fin de ses éditions; mais alors, au lieu de la devise précédente, il y plaçait ces mots:
DVRIOR EST SPECTATÆ VIRTVTIS
QVAM INCOGNITÆ
CONDITIO.
De la vertu, soumise à des luttes sans nombre,
Le sort est bien plus dur au grand jour que dans l’ombre.
Ou bien, quand il s’agissait d’une publication française:
PRÉSERVE-MOY, O SEIGNEVR,
DES CALVMNIES DES
HOMMES.
[p. 151] Si l’on veut se convaincre maintenant de la conscience, ou plutôt (le mot n’est pas trop fort) de la religion que Dolet dut apporter dans son sacerdoce typographique, on n’a qu’à lire le passage suivant, que j’emprunte au tome Ier des Commentaires, colonne 266. Ce passage, écrit avec la rudesse habituelle de notre bilieux humaniste, à une époque où il ne songeait pas encore à s’établir comme imprimeur, explique la correction scrupuleuse qui distingue tous les ouvrages édités par Estienne, et qui le place au premier rang parmi ses doctes rivaux du seizième siècle:
«Quels animaux bâilleurs et dormants, s’écriait-il, que tous ces manœuvres de la typographie! Que de lourdes bévues ils commettent, ces ivrognes, lorsqu’ils sont occupés à cuver leur vin! Que de changements effrontés ils se permettent, même (ce qui est extrêmement rare) lorsqu’ils ont une imperceptible teinture des lettres! Aussi, je vous défie bien de tomber sur un livre sorti de leurs presses, qui ne fourmille des fautes les plus grossières. Soyons juste cependant: personne de vous n’ignore qu’Alde Manuce le Romain a pris vivement à cœur la correction typographique. On peut en dire autant de Josse Badius et de Jean Froben, morts tous deux il n’y a pas longtemps. Enfin, le même zèle se fait remarquer dans l’imprimeur allemand Sébastien Gryphius, et dans les imprimeurs français Robert Estienne et Simon de Colines. Que d’éloges n’ont pas mérités leurs nobles travaux! Mais c’est en vain qu’ils ont redoublé d’efforts et multiplié leur active surveillance: le ramas [p. 152] ivre des goujats secondaires qui les entourent n’en a pas moins empêché les fidèles amants des lettres de recueillir le fruit complet de leurs généreux labeurs.»
«J’augmenterai, dit-il encore dans sa belle préface latine en tête du livre de Cottereau, De Jure militiæ, j’augmenterai de toutes mes forces les richesses littéraires. J’ai résolu de m’attacher les mânes sacrés des anciens par l’impression scrupuleuse de leurs œuvres, et de prêter mon travail et mon industrie aux écrits contemporains. Mais autant j’accueillerai les vrais chefs-d’œuvre, autant je dédaignerai les insipides barbouillages de quelques vils écrivailleurs qui sont la honte de leur siècle[100].»
Maittaire le caractérise en ces termes: Typographus brevis ævi, eruditionis haud vulgaris, indefessæ industriæ. «Ce fut un typographe d’une courte vie, mais d’une érudition non vulgaire et d’une activité infatigable.»
«Si tous ceux qui s’adonnent à cet art (l’imprimerie), observe noblement dans son mauvais style Née de la Rochelle, ne l’exerçoient point sans avoir au préalable acquis toutes les connoissances dont il est certain que Dolet étoit orné quand il s’y appliqua, on ne verroit point sortir journellement de dessous la presse une foule de productions dangereuses et inutiles, qui déshonorent l’art, l’artiste et [p. 153] l’auteur, et avilissent à la fois l’homme de lettres, l’imprimeur et le libraire.»
Dolet, ainsi que je l’ai dit plus haut, s’était marié très-peu de temps avant d’embrasser la sainte profession dont il comprenait si bien, lui, tous les devoirs. Son imprimerie, sa muse et sa femme (ces trois parts égales de son cœur, cette indivisible trinité de son amour) enfantèrent toutes les trois presque en même temps. En 1538, on vit paraître les deux premières productions qui soient sorties de ses presses: d’abord, son Cato christianus, petite brochure de 38 pages in-8o, en réponse au cardinal Sadolet, qui lui avait reproché de ne jamais parler de religion dans ses livres; et, quelque temps après, le recueil original et bizarre de ses Poésies latines. L’année suivante, c’est-à-dire au commencement de 1539, naquit son petit filz Claude, qui fut tenu sur les fonts par Claude Cottereau, de Tours, célèbre jurisconsulte du seizième siècle, un des intimes du père, comme nous l’avons déjà vu plusieurs fois.
Dolet chanta la naissance de cet enfant, dans un poëme latin qui a pour titre: Genethliacum Claudii Doleti, Stephani Doleti filii, etc. L’auteur l’a fait précéder d’une courte lettre en prose, où il rend compte en ces termes à son ami Cottereau de la pensée morale qui lui a dicté cette élucubration paternelle:
«Regum morem non ignoras. Solent, prole illis nata, actutum nuntios quovis gentium mittere, gratulationem sibi undique ambitiosius aucupari, reges externos ad lustricum diem evocare, nova tum superbia, luxuque, quanto maximo possunt, splendidius [p. 154] circumfluere. Nos vero qua natum nobis filium pompa excipiemus? Litteraria sane: quando regia magnificentia non licet. Agedum, carmine Orbi significemus, susceptam nobis sobolem. Quæ ut suo statim ortu omnibus sit utilis, nataque auspicato videatur, argumentum nobis versus scribendi dedit, quo universam juventutem ad communis prudentiæ præcepta breviter informamus. Itaque placuit, istiusmodi pompa prolem a me excipi, me digna, proli honorifica, omnibus fructuosa. In qua commentatione, paucis ea perstrinximus, quæ ad sapienter, recte, et feliciter vivendum pertinere sumus arbitrati, sive interiora animi bona spectes, sive exteriora consideres. Hoc ipsum otioli nostri oblectamentum tibi dicatum volo, tum quod puero ad sacrum lavacrum tollendo præfueris, tum quod talem institutionem a philosophiæ, cui totus deditus es, normis non abhorrentem unus omnium cupidissime videaris amplexurus...»
«Tu n’ignores pas la coutume des rois. Un fils leur naît-il? à l’instant même, ils dépêchent des estafettes aux quatre points cardinaux; leur vanité quête partout des félicitations, ils convoquent les rois étrangers à la cérémonie du baptême, et redoublent, en cette circonstance, d’orgueil, de luxe, de splendeur. Et nous, avec quelle pompe accueillerons-nous le fils qui nous est né? Elle sera toute littéraire, attendu que la magnificence royale nous est interdite. Çà donc! signifions en vers au monde entier qu’un rejeton vient d’entrer dans notre famille. Nous voulons que, dès sa naissance, il soit utile à tous, et [p. 155] que d’heureux auspices planent sur son berceau; pour cela, nous avons songé à consigner, dans un court poëme, des préceptes capables de guider vers la prudence commune la jeunesse en général. C’est avec cette pompe qu’il nous a plu de recevoir notre fils: elle est digne de nous, honorable pour lui, profitable pour tous. Dans cet opuscule, nous effleurons en peu de mots tout ce qui nous a paru se rapporter à la sagesse, à la rectitude, au bonheur de la vie, soit au point de vue des biens intérieurs de l’âme, soit relativement aux avantages extérieurs. Tel qu’il est, ce léger amusement de notre part, nous avons cru devoir t’en faire hommage. N’est-ce pas toi qui as tenu l’enfant sur les fonts sacrés? D’ailleurs, comme une instruction de cette nature ne s’écarte pas trop des maximes de la philosophie à laquelle tu as voué toute ton âme, il nous a semblé qu’entre tous tu devais l’accepter avec joie et comme à bras ouverts...»
L’année même de son apparition (1539), ce poëme de Dolet fut traduict en langue françoyse par ung sien amy, qu’on croit être Claude Cottereau, le parrain du nouveau-né[101]. Cette traduction n’est le plus souvent [p. 156] qu’une diffuse paraphrase, ainsi que Maittaire l’a fort bien remarqué longtemps avant moi. Je m’en servirai néanmoins, concuremment avec le texte original, dans les deux ou trois citations que je vais faire du Genethliacum, ou, comme dit le translateur, de l’Avant-Naissance[102] de Claude Dolet.
L’auteur convoque d’abord Apollon et les neuf Muses autour du berceau de son enfant:
Entre autres conseils que notre Estienne prodigue ensuite à son cher petit Claude avec une sollicitude vraiment paternelle, il l’exhorte à s’armer d’avance d’un indéfectible courage contre les attaques de l’envie, et se vante d’en avoir lui-même triomphé jusqu’alors:
Ailleurs, fidèle aux idées sombres dont il avait depuis si longtemps l’habitude, en face de ce jeune berceau Dolet prévoit déjà la tombe, et sa bouche laisse tomber une à une ces paroles austères:
[p. 160] Je reviendrai bientôt, dans un chapitre spécial, sur la partie philosophique et religieuse de l’Avant-Naissance. Parlons un peu maintenant du recueil des Poésies latines de Dolet (Carminum libri quatuor), qui parut, comme je l’ai dit plus haut, en 1538, et qui fut la seconde production de ses presses.
Ce volume lui fait honneur, ainsi que toutes les éditions qui suivirent, par la pureté du texte, la beauté des caractères et l’éclatante largeur des marges.
Voici la préface adressée à Claude Cottereau:
«Stephanus Doletus Claudio Cotterœo salutem.
«Post longum diuturnumque laborem, quem in edendo primo et secundo meorum linguæ latinæ Commentariorum tomo consumpsi, antequam ad tertii tomi (quo mei omne ingenii, et in eloquentia judicii, documentum servo) editionem progrederer, suaviorum Musarum jocis oblectare me visum est. Visum vero id est, non tam oblectationis causa, quam nonnullorum obtrectatorum frangendorum nomine, qui maledicendi ansam eo in me arripiunt, quod Commentariis conscribendis tempus tantum dederim: perinde quasi majora præstare nequeam, et ad mediocria vel vulgaria sim solum ipse natus. Verum hic stultam obtrectatorum petulantiam acerbius insectari non constitui. Me igitur his suaviorum Musarum intermissis ad tempus jocis oblectare visum est: quibus te etiam mecum oblectari et volo et cupio. In eo autem carminis iambici genere si quis me reprehendat, quod in secunda, quarta et sexta [p. 161] sede, iambum, dactylum, anapæstum, tribrachum, pyrrhichium, et spondæum interdum indifferenter locem, quisquis is est, is id me, non sine antiquorum omnium poetarum, exemplo et imitatione, facere me intelligat, a reprehensioneque abstineat: nec me id facere in aliis versus iambici sedibus aut miretur, aut calumnietur. Etenim doctis omnibus usitatum est. Ad hæc jejuni ingenii et puerilis esse sciat, nimia grammaticarum in re ejusmodi præceptionum observatione in obscuritatem incidere, rem ob oculos prima lectione non ponere. Id quod facere semper conati sumus, in posterumque perpetuo conabimur, laudem summam ex facilitate in re omni aucupantes. Vale. Ludguni, calendis junii M D XXXVIII.»
«Estienne Dolet à Claude Cottereau, salut.
«Après ce long, cet éternel travail que m’a coûté la publication du premier et du second volume de mes Commentaires sur la langue latine; avant d’aborder la rédaction du troisième, où je me propose de donner toute la mesure de mon génie, toute celle de mon jugement en fait de style et d’éloquence, il m’a paru bon de me récréer aux jeux plus doux des Muses. En cela même, mon but est moins de me divertir que d’écraser certains détracteurs qui s’emparent, comme d’une bonne fortune pour leur méchanceté, du temps énorme que m’a pris la composition de mes Commentaires. A les entendre, je ne pourrais aspirer plus haut; une compilation vulgaire est seule à ma portée. Mais que m’importe, après [p. 162] tout? Laissons dans l’ombre la sotte effronterie de mes envieux; en tirer une vengeance acerbe, ce n’est point ici mon affaire. Il m’a donc paru bon de m’interrompre quelque temps pour me délasser à ces doux jeux des Muses; partage-les maintenant, je t’en prie, je le désire. Quant au système de vers ïambiques adopté par moi, si quelqu’un me blâme de placer indifféremment au second, au quatrième et au sixième pied, un ïambe, un dactyle, un anapeste, un tribraque, un pyrrhique ou un spondée, quel qu’il soit, il lui faut comprendre qu’en cela j’imite l’exemple de tous les anciens poëtes, et s’abstenir ici d’une censure sans fondement. Qu’il ne s’étonne pas ensuite et ne me cherche pas chicane si je n’en fais pas de même aux autres pieds du vers, car c’est l’usage de tous les doctes. En outre, il saura qu’il est d’un esprit puérilement étroit d’outrer en pareille matière le scrupule grammatical, et de tomber par là dans l’obscurité. L’idée doit sauter aux yeux à la première lecture. C’est à quoi je me suis toujours appliqué, c’est à quoi je m’appliquerai sans cesse à l’avenir, dans l’attente que cette clarté soutenue me comblera de gloire. Adieu. Lyon, calendes de juin M D XXXVIII.»
Dolet semble avoir pressenti les tempêtes qu’allait soulever contre lui sa fière et violente personnalité, largement étalée à chaque page de ce curieux volume. Il les brave d’avance, en tête de son recueil, dans la pièce liminaire qu’on va lire:
«Je te vois d’ici, Zoïle: tu vas pouffer de rire, tantôt quand je me traiterai moi-même de grand poëte, tantôt quand je me vanterai de réussir dans tous les rhythmes. Ris si tu veux, tu feras une chose déjà faite. Moi tout le premier, j’ai ri de mon outrecuidance; elle n’est guère passible après tout que du rire de Démocrite. Mais toi, joins ton animosité à toutes les haines que soulève ma gloire, et saisis ce prétexte d’aboyer contre moi. De quelle façon, vous autres, pensez-vous me terrifier par vos aboiements? De la même façon que les roquets de Malte épouvantent le lion ou le sanglier, que le cousin microscopique fait peur à l’éléphant des Indes, et les faibles pies au puissant épervier.»
Ce volume des Carmina comprend quatre livres, à la suite desquels se lisent différentes pièces de vers grecs et latins, composés en l’honneur de Dolet par quelques-uns de ses amis: Salmon Macrin, Nicolas Bourbon de Vandœuvre, Honoré Veracius, Jean Voulté, Godefroi Beringius. Le premier livre débute par un hommage à François Ier. Etienne lui consacre en peu de mots son offrande poétique, et le prie d’accueillir avec bonté, sinon ce léger présent, au [p. 164] moins le cœur qui l’offre. Vient ensuite une ode plus étendue, où le poëte recommande au Protecteur des lettres les Muses, qui seules empêchent un grand homme ou un grand peuple de mourir. Mais cédons encore la parole au savant humaniste:
Deux ans plus tard, en 1540, Dolet traduisit lui-même cette pièce en vers français, sous le titre de Cantique au Roy mesmes, en tête de son essai historique intitulé les Gestes de Françoys de Valois, roy de France, etc. Notons ici que, pour Estienne, cantique était tout bonnement la traduction du mot grec ᾠδή. Ode n’avait pas encore été mis en circulation par Ronsard.
Voici le morceau:
Il me semble avoir parfaitement peint, de sa propre palette et comme en face d’un miroir, son caractère indépendant, capricieux et fantasque, sa bizarre humeur aux allures de chèvre, dans la petite pièce suivante, qu’il adresse à son livre, quelques pages plus loin:
«Mon livre, si d’aventure un médisant cherche à mordre sur toi, tantôt parce que ton langage est trop libre et trop lascif, tantôt parce qu’il est trop chaste, trop sévère, et qu’il semble en divorce avec la grâce et la gaieté; réponds à ce Zoïle, ou à toute autre mauvaise langue, que je suis un homme à varier d’heure en heure, et que mon caractère versatile se prête à tous les genres de vie. Suis-je un stoïcien? suis-je un disciple d’Epicure? Ma foi! c’est selon. Vivre libre, à mes yeux c’est vivre!»
Le morceau qui vient après nous donne la preuve immédiate de cette humeur changeante. Par une de ces inconséquences naturelles au cœur de l’homme, raillant cet amour d’une gloire posthume qui, dans mainte autre occasion, lui a dicté de si belles, de si nobles pages, Dolet déclare ouvertement à son ami Pierre Danès, qu’il tient à jouir d’une réputation actuelle et vivante:
«Vivant et voyant, c’est ainsi que je veux jouir de ma gloire. La belle avance, quand on est mort, que d’avoir eu du talent au bout de sa plume, ou du cœur dans ses actions! Homère, Virgile, Démosthène, Cicéron, foulent à cette heure les allées du bocage élysien; leurs oreilles sont rebattues du bruit des châtiments qu’infligent aux misérables ombres les farouches Euménides. Combien grande ici-bas est leur gloire, et combien leur nom répandu, voilà ce qu’ils ignorent; ou s’ils le savent, absorbés qu’ils sont par de plus enivrantes délices, ils négligent ces jouissances terrestres. C’est donc avec raison que, vivant et voyant, je veux jouir de ma gloire. Oui, tant qu’il y a moyen, goûtons un plaisir mortel. Peut-être, après ma mort, en aurai-je un plus délectable à savourer; mais en attendant, vive celui qu’on a sous la main!»
Les épigrammes contre les moines ne sont pas la partie la moins curieuse de ce curieux volume. En voici un échantillon:
«La race des encapuchonnés, ce bétail à tête basse, a toujours à la bouche le refrain suivant: Nous sommes morts au monde. Et pourtant, il mange à ravir, ce digne bétail; il ne boit pas trop mal; il ronfle à merveille, enseveli dans sa crapule; il procède avec conscience à sa besogne vénérienne; en un mot, il se vautre dans la fange de toutes les voluptés. Est-ce là ce qu’ils appellent, ces révérends, être morts au monde? Il s’agit de s’entendre: morts au monde, ils le sont assurément; mais parce qu’on les voit, ici-bas, fatiguer la terre de leur masse inerte, et qu’ils ne sont bons à rien... qu’à la scélératesse et au vice!»
Si les encapuchonnés en question n’étaient pas contents de ce petit morceau, il faut avouer qu’ils étaient bien difficiles.
Dolet, comme on vient de le voir, avait contre eux une profonde rancune. Le passage suivant des Commentaires (t. I, col. 266) en fournira, j’en suis sûr, une explication plus que satisfaisante:
[p. 171] «Je ne saurais, y disait-il en 1536, deux ans avant de s’établir imprimeur, je ne saurais déguiser sous un lâche silence l’infamie de certains monstres à face humaine, qui, voulant frapper au cœur notre avenir littéraire, ont pensé qu’il fallait, de nos jours, anéantir l’art typographique. Que dis-je? pensé! N’ont-ils pas conseillé cet horrible meurtre à François de Valois, roi de France; c’est-à-dire, à l’unique appui des lettres et des littérateurs, à leur partisan le plus chaud, à leur père le plus aimant? Et quel motif ont-ils fait valoir? Un seul: c’est qu’à les entendre, l’erreur luthérienne trouvait, dans la littérature et dans l’art typographique, un trop docile instrument de vulgarisation. Ridicule nation de crétins (ridiculam stultorum nationem)! Comme si, par elles-mêmes, les armes étaient chose pernicieuse et fatale, et comme s’il fallait les supprimer, à cause des blessures qu’elles font et de la mort qu’elles donnent! Avec quoi donc se défendent les braves? avec quoi défendent-ils leur patrie? N’est-ce pas avec les armes? Sans doute, on en fait parfois un usage inique et criminel; mais quels sont-ils, les dignes champions qui se permettent cet usage? Et! c’est vous, précisément, c’est l’iniquité, le crime!
«Heureusement que l’abominable, le monstrueux complot de la Sorbonaille, de ce ramas d’ivrognes et de sophistes, s’est vu briser par la sagesse et la prudence de Guillaume Budé, ce soleil scientifique de notre âge, et de Jean du Bellay, évêque de Paris, prélat hors ligne, autant par sa vertu que par sa haute dignité.»
[p. 172] Imprudent Dolet! Encore un fagot qu’il apportait lui-même d’avance à son bûcher depuis longtemps en préparation!
Pour en revenir une dernière fois à ses Poésies latines de 1538, voici de quelle manière Salmon Macrin leur souhaita la bienvenue:
«Paraissez enfin, doctes vers du docte Dolet; soyez à jamais dans toutes les mains, et passez du vieillard au jeune homme. Vous le méritez au plus haut point, entre toutes les œuvres des poëtes qui vivent actuellement, ou de ceux qui ont existé depuis le siècle de Virgile. Vivez comme vous êtes dignes de vivre, c’est-à-dire éternellement, et faites vivre de même le nom de votre poëte. D’ordinaire, les ruisseaux enfants d’une source vive ont un cours perpétuel; eh bien! quoi de plus vif que votre source?»
Le bon Macrin prophétisait juste. Rien n’a pu la tarir, cette source d’une généreuse pensée! Grossie plus tard par les mille affluents des nobles cœurs et des grandes intelligences, elle est devenue torrent, torrent irrésistible! Elle a entraîné le moyen âge, [p. 173] avec toutes ses barbaries féodales; elle a fait large place au dix-huitième siècle, à ce Nil fécondant de la civilisation moderne, qui, quoi qu’on en dise, a roulé tant d’idées et d’avenir dans ses flots profonds!
[97] «In lucem prodit, retardatus quidem diu multis et fortunæ et hominum injuriis; sed authoris constantia foras ita semper protrusus, ut contra omnem fortunæ hominumque invidiam jam tandem publico fruatur.» (Comment., t. II, Epist. ad Bud.)
«Il paraît enfin ce second volume des Commentaires, longtemps retardé par les mille injustices de la fortune et des hommes; mais la constance de l’auteur l’a toujours poussé en avant, hors de sa retraite, si bien qu’aujourd’hui, bravant cette double envie des hommes et de la fortune, le voilà en possession de son public.» (Comment., t. II, Lettre à Budé.)
[98] Aucuns l’en blâmèrent; mais son ami Claudin de Touraine (Claude Cottereau) approuva le grand heur de ce mariage, «lequel, dit-il, combien que plusieurs (peu congnoissantz ton esprit et jugement) ayent trouvé estrange, pource que par là cuydoient ta fortune (quant aux biens) estre troncquée ou pour le moyns retardée de beaucoup, je l’ay toutesfoys tousjours trouvé bon et louable... Ces raisons doncques sont apparentes, que non follement et sans jugement tu t’es marié, mais pour le plus hault bien... soit pour vivre entre les hommes sans reproche de paillardise, soit pour augmenter le bien litteral par tes labeurs assiduz.»
[99] Procès d’Estienne Dolet, Techener, 1836, p. 7.
[100] Voir encore, à ce propos, la dédicace du De Moribus in mensa servandis, qui lui est adressée par Guillaume Durand, l’éditeur. Ce dernier le complimente sur la beauté de ses caractères et le choix des ouvrages qu’il reproduisait à l’aide de ses presses.
[101] L’épître liminaire du traducteur nous offre, dans un de ses passages, cette énumération curieuse des poëtes français contemporains:
«La composition latine de Dolet meritoit trop plus excellent traducteur que moy; comme pourroit estre ung Maurice Sceve (petit homme en stature, mais du tout grand en sçavoir et composition vulgaire), ung seigneur de Sainct-Ambroise (chef des poëtes françois), ung Heroët, dict la Maison-Neufve (heureux illustrateur du hault sens de Platon), ung Brodeau aisné et puisné (tous deux honneur singulier de nostre langue), un Sainct-Gelais (divin esprit en toute composition), ung Salel (poëte aultant plus excellent que peu congneu entre les vulgaires), ung Clement Marot (esmerveillable en doulceur de poésie), ung Charles Fontaine (jeune homme de grande esperance), ung petit Moyne de Vendosme (sçavant et eloquent, contre le naturel et coustume des moynes), ou quelques aultres, etc.»
[102] Marot, en 1536, s’était déjà servi de cette expression bizarre, dans un opuscule intitulé: Avant-Naissance du troisième enfant de Mme la duchesse de Ferrare. Voy. l’édit. in-4o de ses Œuvres, par Lenglet-Dufresnoy, t. I, p. 189.
[103] Le rhythme de cette pièce est curieux; je crois même, sauf erreur, qu’il ne manque pas d’une certaine grâce. On le rencontre deux ou trois fois dans Marot. Dolet, à son tour, en a fait usage dans le Cantique au Roy que je citerai tout à l’heure, et dans un autre Cantique qu’il composa, prisonnier à la Conciergerie, sur sa désolation et sa consolation. (V. plus loin, ch. XV). D’où je concluerais assez volontiers qu’il est lui-même l’auteur des vers à l’occasion desquels j’écris cette note, et peut-être de toute la traduction française de son Genethliacum. Il a beau l’attribuer à ung sien amy; j’y retrouve à chaque instant, et d’une manière trop évidente, son style habituel en fait de poésie française, ses procédés ordinaires de versification, et jusqu’à ses rhythmes favoris.
[104] Carm., I, 4.
[105] Carm., I, 5.
[106] Carm., I, 17.

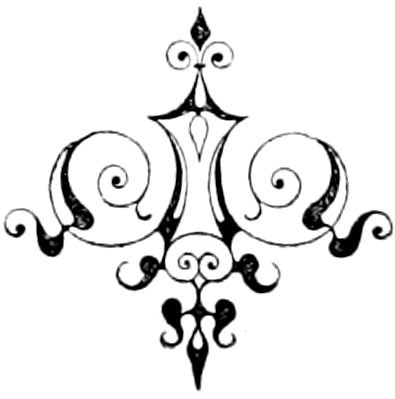

Publications diverses. — Dolet grammairien, historien et traducteur.

Iusqu’a présent, on n’a guère pu apprécier, dans notre Estienne, que le poëte ou le prosateur latin. Il me reste à le faire connaître plus en détail comme écrivain français.
En 1540, il publia la Manière de bien traduire d’une langue en aultre; d’advantage, de la punctuation de la langue françoyse; plus, des accents d’ycelle, etc. Ces trois opuscules se rattachaient, dans la pensée de leur auteur, à un ouvrage d’ensemble intitulé l’Orateur françoys, et dont les traités suivants devaient faire partie: la Grammaire, l’Orthographe, les Accents, la Punctuation, la Pronuntiation, l’Origine d’aulcunes dictions, la Manière de bien traduire d’une langue en aultre, l’Art oratoire, et, en dernier lieu, l’Art poétique.
La Manière de bien traduire est dédiée par Estienne à Guillaume du Bellay-Langey, l’un de ses plus puissants protecteurs, par une épître en prose qu’il a fait précéder des paroles suivantes: Estienne Dolet à [p. 176] Monseigneur de Langey, humble salut, et recongnoissance de sa libéralité envers luy.
«Je n’ignore pas, lui dit-il ensuite, seigneur par gloire immortel, que plusieurs ne s’esbaïssent grandement de voir sortir de moy ce present œuvre: attendu que par le passé j’ay faict, et fais encores maintenant profession totalle de la langue latine. Mais à cecy je donne deux raisons: l’une, que mon affection est telle envers l’honneur de mon païs, que je veulx trouver tout moyen de l’illustrer, et ne le puis mieulx faire, que de celebrer sa langue, comme ont faict Grecs et Rommains la leur; l’aultre raison est, que non sans exemple de plusieurs je m’addonne à ceste exercitation.»
A commencer, en effet, par les écrivains de l’antiquité gréco-latine, ils n’ont jamais pris, pour rendre leur pensée, d’autre instrument que leur langue maternelle. Si quelques Latins ont étudié à fond la langue grecque, c’était, avant tout, dans le but de s’approprier directement «les arts et disciplines traictées par les autheurs d’ycelle».
Quant aux modernes, déjà beaucoup d’entre eux, avant Dolet, avaient formé le généreux dessein d’illustrer leur langue natale; par exemple, en Italie: Léonard Arétin, Sannazar, Pétrarque, Bembo; et en France Budé, le grand Budé lui-même.
«Doncques, poursuit le savant typographe, non sans l’exemple de plusieurs excellents personnages, j’entreprends ce labeur, lequel (seigneur plein de jugement) tu recepvras non comme parfaict en la demonstration de nostre langue, mais seulement [p. 177] comme ung commencement d’ycelle. Car je sçay, que quand on voulut reduire la langue grecque et latine en art, cela ne fut absolu par ung homme, mais par plusieurs. Ce qui se faira pareillement en la langue françoyse; et peu à peu, par le moyen et travail des gens doctes, elle pourra estre reduicte en telle perfection que les langues dessus dictes.»
Comme toujours, Estienne comptait sur la postérité pour lui rendre justice et le récompenser de ce nouveau travail; témoin le passage suivant de son Epistre au peuple françoys, pièce qui fait partie du même volume:
«J’attends plus tost contentement de la postérité, que du siècle present; car le cours des choses humaines est tel, que la vertu du vivant est toujours enviée et deprimée par detracteurs, qui se pensent advantager en reputation s’ils mesprisent les labeurs d’aultruy. Mais l’homme de sçavoir et de bon jugement ne doibt regarder à tels resveurs, et plus tost s’en mocquer du tout. Ainsi faisant, je poursuivray mon effort, et attendray legitime los de la posterité, non d’aulcuns vivants par trop pleins d’ingratitude et maulvais vouloir.»
Il y a, d’après Estienne, cinq règles principales pour bien traduire:
1o Il faut que le traducteur comprenne parfaitement son texte;
2o Qu’il ait une connaissance, aussi approfondie que possible, des deux idiomes sur lesquels il opère;
3o Qu’il ne s’efforce pas de rendre absolument mot [p. 178] pour mot, et, pour ainsi dire, de calquer son auteur à la vitre: au contraire, «sans avoir esgard à l’ordre des mots, il s’arrestera aux sentences, et faira en sorte que l’intention de l’autheur sera exprimée, gardant curieusement la propriété de l’une et l’aultre langue.» C’est donc folie de vouloir rendre, comme aulcuns, ligne pour ligne ou vers par vers.
4o On ne doit jamais, hors le cas d’extrême nécessité, employer des mots trop approchants du latin, et, à ce titre, peu usités auparavant; mais se contenter du répertoire de la langue parlée et comprise par tout le monde. Ainsi Dolet condamne d’avance, et formellement, un des principaux côtés de la tentative de Ronsard. L’arrêt est sévère, mais il ne me surprend pas. Notre humaniste n’était pas seulement un disciple de Cicéron, c’était en même temps un compaing de Clément Marot; il avait, comme celui-ci,—son Second Enfer en fournira bientôt la preuve,—du sang de Villon dans les veines. De plus, il était intime avec Rabelais, et devait croire en conséquence que la langue gauloise de Panurge pouvait suffire amplement à tous les besoins de la pensée française. Ce n’est pas tout à fait mon avis; mais pour le moment, il n’importe.
5o Enfin, continue l’auteur de la Manière de bien traduire, on doit observer scrupuleusement les nombres oratoires, c’est-à-dire cette harmonie du style qui satisfait à la fois l’âme et l’oreille.
Le traité sur les accents renferme ce passage remarquable, où Dolet se fait le promoteur d’une réforme orthographique dont l’urgence a dû être [p. 179] contestée de son temps, mais qui, plus tard, a fini comme tant d’autres par passer à l’état de loi:
«Le e masculin (l’é fermé), en noms de plurier nombre, ne doibt recepvoir ung z, mais ung s, et doibt estre marcqué de son accent, tout ainsi qu’ung singulier nombre. Tu escriras doncq voluptés, dignités, iniquités, vérités; et non pas voluptez, dignitez, iniquitez, veritez... Car z est le signe de e masculin au plurier nombre des verbes de seconde personne; et ce, sans aulcun accent marcqué dessus. Exemple: Si vous aymez vertu, jamais vous ne vous addonnerez à vice, et vous esbatterez tousjours à quelcque exercice honneste... Sur ce propos, je sçay bien que plusieurs non bien congnoissants la virilité du son de l’e masculin, trouveront estrange que je repudie le z en ces mots: voluptés, dignités, et aultres semblables. Mais s’ilz le trouvent estrange, il leur procedera d’ignorance et maulvaise coustume d’escrire: laquelle il convient reformer peu à peu[107].»
[p. 180] Le volume se termine par ce dizain de Sainte-Marthe, Au lecteur françoys:
Comme historien, l’infatigable travailleur nous a laissé: les Gestes de Françoys de Valois, roy de France, dedans lequel œuvre on peult cognoistre tout ce qui a esté faict par les Françoys, depuis l’an mil cinq cents treize, jusques en l’an mil cinq cents trente-neuf; premierement [p. 181] composé en latin par Estienne Dolet, et après par luy mesmes translaté en langue françoyse[108].
L’ouvrage entier se divise en deux livres, dont le premier commence à la prise de Térouane et de Tournay par le roy d’Angleterre, en 1513, et s’arrête à la défaite de Pavie, en 1525; quant au second, il s’étend jusqu’à la mort de l’impératrice, femme de Charles-Quint, arrivée en 1539. Au recto du dernier feuillet, sur le verso duquel se place la fameuse doloire, Dolet prend ainsi congé de son lecteur:
«En tel ordre et sorte de composition, tu auras par moy descript tout ce qu’il se faira à l’advenir par les Françoys: jusques au temps qu’il plaira à Dieu faire son commandement de moy, et m’oster du monde où il m’a mys.»
Hélas! il n’était pas si loin déjà, le jour où la main de Dieu devait l’oster de ce monde, pour le transporter sans doute dans un monde meilleur!
Au début du premier livre, l’auteur explique en ces termes le motif qui l’a «induict d’intituler ce présent œuvre en latin Fata, qui en nostre langue veult aultant à dire que destinées». C’est que, nous déclare-t-il, «par sus tout ordre et pouvoir humain, ay veu advenir au roy tout ce qu’il a souffert [p. 182] d’infortune en aulcunes entreprinses de ses guerres». Et, quelques lignes plus loin, il ajoute: «Destinée est une fille de Dieu omnipotent, laquelle suivant le vouloir et commandement de son pere, nous cause et pourchasse tout ce que nous appellons bien et mal. Et ces deux choses, les humains les reçoipvent par ung infaillible vouloir de Dieu, lequel droictement s’appelle Destinée; car Destinée n’est rien aultre, qu’ung ordre éternel des choses. Et combien qu’à ycelle se puisse joindre quelque prudence ou vertu humaine, toutesfois c’est elle qui règne et ha tout pouvoir en noz actes.»
La destinée est donc comme le bras droit de la volonté divine; en conséquence, elle fait et défait les empires. On n’a, pour s’en convaincre, qu’à parcourir les annales des peuples de l’antiquité, celles des Romains par exemple:
«Par destinée les Rommains, après tant de fortunes et guerres, ont subjugué toutes nations estranges, et Romme a esté le chef du monde: laquelle au commencement habitoient pauvres pasteurs, et toutes gens de maulvaise vie, qui en ycelle recouroient comme en franchise, après avoir esté bannis de leur païs pour leurs forfaictz. Avec le temps, par destinée contraire, vindrent yceulx Rommains en decadence et ruine; et Romme, privée de ses tant grands triumphes, et opprimée par violateurs de la Republique, maintenant ne retient aultre chose de sa dignité que son seul nom ancien.»
Au surplus, pour mettre mes lecteurs en mesure d’apprécier, d’une manière à peu près complète, le [p. 183] style historique de Dolet, je vais transcrire d’un bout à l’autre son récit de la bataille de Marignan:
«Les Françoys partirent de Novarre, qui ne fut pillée par le commandement du Roy, et s’en allèrent à Bufferole. Cependant le Roy eut nouvelles qu’entre luy et les Suysses l’appoinctement avoit esté faict, conclud et accordé, moyennant certaine grosse somme de deniers, qu’il feit delivrer pour leur envoyer par le seigneur de Lautrec, lequel en eut la charge. Et comme on portoit ledict argent, les Suysses furent preschez et subornez par le cardinal de Syon, qui tenoit le party du duc Maximilian: en sorte que, contre leur foy et promesse qu’ils avoient donnée et faicte aux gens du Roy, aveuglez de l’ambition qu’ils avoient de dominer sur les roys et princes (comme ils s’attendoient bien par le moïen de ceste guerre), deliberèrent de faire ung villain et lasche tour. Qui estoit de surprendre le Roy et son armée, cependant qu’on leur portoit ce qu’il leur avoit esté promis. Et d’advantage, ils avoient deliberé de prendre l’argent du Roy, et après ce luy donner la bataille, comme ils feirent, n’ayantz aulcun esgard à justice et equité. Mais la fin miserable de leur entreprinse donne à entendre aux hommes, quelle meschanceté c’est de contrevenir à la foy compromise. Parquoy en ce lieu apprenez, traystres et violateurs de foy, comme il est desplaisant à Dieu omnipotent d’user de trahison, et esmouvoir guerre où paix est accordée.
«Le Roy fut adverty de ceste trahison, à l’heure qu’il pensoit que les Suysses comptassent son argent; [p. 184] et sceut la verité, qu’ilz estoient jà près de luy pour luy livrer bataille: dont il ne s’estonna. Comme ung lyon magnanime environné d’une troupe d’animaulx, bœufs, ours, loups, chiens, pour tout cela ne s’estonne, mais d’ung seul tremblement de sa hure espouvante ceste tourbe audacieuse; et s’il advient que, en derrière, par morsures clandestines il soit blessé, lors par sa force victorieuse il deffaict telle vermine: en ceste sorte le Roy, ayant enduré pour ung temps l’insolence des Suysses, et congnoissant qu’ilz s’efforçoient de le dompter, jaçoit qu’il fust jeune, se delibéra de les attendre et d’estre le premier en ce labeur. Où il ne s’espairgna, et voulut bien rabattre l’orgueil d’une nation qui se dict estre née aux armes.
«Le quatorziesme jour de septembre, mil cinq cents et quinze, environ trois ou quatre heures après mydi, les Suysses accompaignez des Millannois vindrent frapper sur l’armée de France, qui estoit au champ Saincte-Brigide, près Marignan. Les Françoys ne s’esbahirent aulcunement, et, sur touts, les adventuriers se porterent très-bien, et supplièrent le deffault des Allemands de la bande noyre, qui avoient tourné le doz, pensantz que le Roy eust intelligence avec les Suysses, et qu’on les voulust deffaire. Lesquelz incontinent après, advertiz de la verité, se misrent en debvoir et frapperent sur les Suysses: desquelz les adventuriers françoys (qui n’estoient que deux mille, ou environ) avoient deffaict une bande de quatre mille. Les aultres bandes se misrent à frapper sur la bataille où estoit le Roy, et s’attendoient bien de mectre en desarroy les Françoys, comme ilz [p. 185] avoient faict à Novarre, l’an mil cinq cents et treize. Mais l’artillerie besongna si bien avec les hommes, que les Suysses ne furent pas les plus fortz. Non dissemblable fureur convertit en ire deux taureaux courantz du hault d’une montaigne après une vache chaulde. L’un et l’aultre se faict guerre, front contre front, cornes contre cornes. Ainsi entrelassez se donnent plusieurs coups, se fichant les cornes dans la chair l’ung de l’autre: tant qu’on leur voirroit le col et espaules rougir de sang. Si n’est leur combat fini jusques à ce que l’ung, vaincu, fasse tel bruict par sa voix, que ciel, et terre, et lieux circunvoisins en retentissent. En telle ardeur estoient les Françoys et Suysses meslez ensemble, ne craignantz, d’ung costé et aultre, ou coups ou plaies: comme ung sanglier eschauffé ne crainct en rien la morsure des chiens, et ne daigner eviter espée ou dart du veneur.
«Les Suysses de plus en plus assailloient les Françoys à eulx resistantz; et combien qu’ilz se sentissent les moindres, pour cela n’estoit remise leur ardeur, mais de plus en plus s’efforçoient d’entrer sur les Françoys. De l’aultre part, les Françoys tenoient bon et faisoient une merveilleuse tuerie sur leurs ennemys. Sur ce conflict la nuit survint, qui n’empescha toutesfois que d’ung costé et aultre le combat ne fust maintenu, pour ce qu’il y avoit pleine lune. Et lors il y eut grande effusion de sang: car ilz estoient tant encharnez les ungs sur les aultres, que jamais ne se departirent tant qu’ilz se peurent recongnoistre. Voire et si, entrerent au camp [p. 186] l’ung de l’aultre. Et pour abuser les Françoys, les Suysses, en ceste obscurité de la nuit, crioient: France! France! et neantmoins tuoient les Françoys. A la fin, chascun fut contrainct de cesser après que la lune fut couchée. Et lors chascun cherchoit son ennemy, comme ung lymier chercheroit sa proye si elle luy estoit eschappée.
«Ceste nuict là n’y eut aulcun repos en tous les deux camps. Et eust on dict que ce premier conflict estoit une flamme grande dedans laquelle on jecte une goutte d’eau qui ne la peult estaindre, mais plus tost augmenter; ou bien que c’estoit ung ulcere attainct d’ung coup d’ongle sans estre purgé de son infection; car, pour toute la tuerie precedente, l’ardeur de ces deux camps n’estoit amoindrie; mais, d’ung costé et aultre, on n’eust ouy toute la nuict que menaces de mort et d’ung combat plus cruel que devant. Ceulx qui estoient blessez esperoient se venger le lendemain sur leurs ennemys; ceulx qui estoient entiers et sans blessure enrageoient d’entrer au combat et donner coups ou en recepvoir. Et ainsi, les ungs et les aultres ne desiroient aultre chose que le retour du jour pour renouveler la bataille.
«Cependant le roy Françoys, de son costé, visitoit son camp et incitoit ses gens de guerre pour le lendemain en telles paroles:
«—Et ainsi, ainsi triumphe de son ennemy la nation françoyse (ô compaignons), et ne peult estre domptée par armes. Le Suysse est rompu, la victoire est nostre. Que tel honneur, que telle gloire ne nous soit ostée! Et si aulcune affection de renom vous [p. 187] esmeut, si aussi je me suis promis par vostre vertu la victoire (que jà eussions sans la nuict survenue), que demain chascun de vous se monstre couraigeux et ne se laisse surmonter. O que les Suysses sont bien gens pour vaincre et la nation françoyse et le roy des Françoys! Seriez-vous si depourveuz de cœur d’endurer telle injure?»
«Par telle maniere le roy Françoys alloit çà et là, exhortant ses bandes, incitant ceulx qui d’eulx-mesmes estoient assez enflammez. A telle exhortation, chascun augmentoit son couraige, conspirant la deffaicte universelle des Suysses, et sembloit à veoir que ce feussent tigres qui ont perdu leurs petitz. Telle beste en telle infortune est remplie de fureur et monstre bien semblant de vouloir perdre la vie pour se venger du rapteur; elle court çà et là toute enragée, aguisant ses dents et ongles à toutes heurtes, et s’il advient qu’elle rencontre le larron de sa lignée, c’est merveille de veoir la rage qu’elle exerce sur iceluy, en façon qu’elle n’est contente de le mectre en mille pieces. De telle fureur doncq estoient esprins les Françoys contre les Suysses quand ce viendroit à l’aulbe du jour pour se mectre en combat.
«De l’aultre part, les cappitaines des Suysses faisaient leur debvoir d’inciter leurs gens, et les eschauffoient par telz dictz:
«—Serons-nous à ceste heure vaincus par les Françoys sans nous venger, nous ausquelz on a tousjours attribué toute louange en faict d’armes, nous ausquelz à grand’peine l’invincible Cæsar peult resister au temps passé? Sera-t-il dict que la vertu tant [p. 188] excellente de noz predecesseurs preigne fin en nous? Nostre loz et renommée anticque sera elle ainsi conculquée et deprimée par nostre deffault? Nos forces ne sont encore bien attainctes au vif; les Françoys n’ont encores soustenu qu’ung commencement de bataille. Demain au matin ils congnoistront que sçavons faire, moyennant qu’ayons bon cueur et deschassions toute craincte, usantz de nostre magnanimité anticque. Noz ennemys ne nous surmontent ny par multitude ny par usage d’armes: faisons donc que de hardiesse et prouesse ilz n’aient advantage sur nous. Il n’y a aucune volonté divine à nous adversaire; ce sont touts mortelz contre lesquelz debvons combattre, nous avons aultant de mains et aultant d’armes qu’eulx. Parquoy faisons en sorte que l’on die par cy après qu’avons vaincu ung roy de France, comme les plus puissantz de touts; faisons que ce comble de louange soit adjousté à nostre renom premier. En ceste sorte toutes nations estranges craindront par cy-après d’entrer en bataille contre les Suysses.»
«Par telles exhortations les bandes des ennemys furent si fort esmeues, qu’elles ne desiroient aultre chose que ruer sur les Françoys, se persuadantz estre ung acte fort honorable que de mourir en bataille ou reporter en leur païs leurs enseignes triumphantes de la deffaicte d’ung roy. Et en telle ardeur de combattre estoit l’ung et l’aultre camp, consumant la nuict en menaces horribles, et n’attendant aultre chose que le jour pour recommencer le conflict.
«Le jour venu, tabourins, fifres et trompettes [p. 189] commencerent à sonner asprement des deux costés. Les Suysses encharnez sur les Françoys retournèrent hardyment au combat, faisantz grand effort sur noz gens; mais ilz furent recullez et fort endommagez par l’artillerie, qui feit merveille de bien tirer soubz la conduicte du seneschal d’Armignac, où il acquist gros honneur. Et de l’aultre part, les Françoys se voïantz les plus fortz augmentèrent leur courage, et commencèrent à entrer bien avant sur les Suysses. Comme ung loup enragé de faim, se trouvant en la troupe ou de brebis ou de chievres, avec la gueulle ouverte et son chef incliné, se repaist du sang de tel bestail, et se lave la gorge à l’occision d’icelluy; puis, par mespris, chasse devant luy le remanant des bestes vivantes, et se baigne au sang de celles qu’il voit couchées par terre: non aultrement faisoient les Françoys contre les Suysses; et d’aultant plus que lesdictz Suysses s’efforçoient de mectre en roupte les Françoys, d’aultant plus les Françoys se trouvoient resistantz et courageux au combat.
«Neantmoins, pour tout cela, l’ardeur d’ung costé et aultre ne cesse, mais s’augmente de plus en plus en combattant; et ne sçait-on en quelle part doibt incliner la victoire, tant est la fin de ce conflict douteuse. Maintenant les Suysses prennent courage, et cuident avoir surmonté les Françoys; maintenant les Françoys se pensent estre victorieux. En tel espoir, le conflict dure long temps, et n’est à presupposer que d’ung costé et aultre les cappitaines et chefz de l’armée ne feissent leur debvoir de bien instiguer leur souldarts à combattre vaillamment. Tout ainsi que si [p. 190] les vents s’eslievent en l’air, de couraige et force semblable combattantz entre eulx, ny les ungs ny les aultres ne se veulent montrer inferieurs; les nues tiennent bon, la mer tient bon, le conflict est doubteux long temps, et quant aux vents, chascun d’eulx pretend la victoire: en telle obstination combattoient l’ung contre l’aultre Françoys et Suysses. Mais, à la fin, Mars commença à adherer à la partie des Françoys, et delaissa les Suysses. Ce que voïantz lesdictz Suysses, et cognoissantz leur perte et desarroy, tournèrent le doz et s’enfuirent vers Millan; et n’eust esté la poulcière, jamais ne s’en fust saulvé cent. Toutefois, pour leur roupte, ils ne laissèrent de faire front en partie, et cachèrent leur fuyte le plus honnestement qu’ils peulrent, se retirantz comme ne se voulantz retirer. En la sorte qu’ung serpent se trouvant au chemin, si quelcque charrette luy passe par dessus, ou si quelcque voyageur le persecute de coups de pierre et le laisse demy mort, bien en vain allors il commence de se contourner, ouvrir ses yeulx ardentz plus que devant, et siffler à toute oultrance, haussant le col plus que de mesure; la partie blessée retarde son effort, et à la fin est contrainct, tellement quellement, trouver refuge en son pertuis et eviter l’instance du voïageur: en semblable figure les Suysses se commencèrent à retirer, et tourner le doz aux Françoys victorieux. Toutesfoys il en demeura de quinze à seize mille, tant au camp que par les chemins, en fuyant vers Cosme et Millan. Les Venitiens vindrent au secours soubz la conduicte de messire Barthelemy d’Alviane, et aussi le filz du [p. 191] comte Petiliane, qui donnèrent sur la queue desdictz Suysses et aultres gens qui estoient venuz avec eulx: car ils estoient sortiz de Millan trente et six mille combattantz, tant à pied qu’à cheval.
«Plusieurs princes de France et d’ailleurs, tenantz le party du roy, furent vaillamment occiz en ceste bataille et seconde journée; et entre aultres: le filz du comte de Petiliane; le seigneur de Hymbercourt; François monsieur, frère puisné du duc de Bourbon; monseigneur Charles de la Trimouille, prince de Thalemont, filz du seigneur de la Trimouille, lequel estoit aussi avec le roy. Aussi y furent occiz: le comte de Sanxerre; le seigneur de Bussy; le cappitaine Mouy, et aultres cappitaines et gens de bien. Une bande desdictz Suysses, qui s’estoient retirez à l’avant garde que conduisoit le duc de Bourbon, comme gens aveuglez, se misrent en une cassine, où ledict seigneur de Bourbon les feit tous brusler. Or, enfin, la gendarmerie de France ne cessa de les poursuivre, tant que l’haleine des chevaulx peult durer.»
Il y a, si je ne me trompe, du mouvement, du drame et de la vie, dans ce vaste tableau d’histoire nationale, dans ce récit à la Tite-Live d’une bataille épique à laquelle nous pouvons encore songer avec orgueil. N’y retrouvons-nous pas, en effet, la France militaire du seizième siècle, aussi rapide, aussi foudroyante, aussi indomptable dans son élan sur l’ennemi, que la France de nos jours? Franchement, j’aime à sentir vibrer, au cœur de mon héros, la fibre patriotique en même temps que le classique enthousiasme, et la religion du pays à côté du culte de [p. 192] Cicéron. Il y a place pour tout dans une grande âme! Malgré des latinismes un peu trop fréquents, la prose française de notre Estienne me paraît presque toujours à la hauteur du noble sujet qu’elle retrace. Ce vieux style, aux naïves rudesses, ne s’ajuste pas trop mal, il me semble, à la taille des hommes de fer du combat des géants.
Après l’historien, voyons maintenant le traducteur. L’échantillon suivant, précédé du texte original dont il est la reproduction, pourra suffire à faire connaître Dolet sous ce rapport. Je l’emprunte à ses Epistres familiaires de Marc Tulle Cicero, père d’eloquence latine, etc. (fol. 203, recto et verso):
«M. T. Cicero, procos., C. Marcello, Cos. design., s. p. d.
«Maxima sum lætitia affectus, quum audivi, te consulem factum esse: eumque honorem tibi Deos fortunare volo, atque a te pro tua parentisque tui dignitate administrari. Nam quum te semper amavi dilexique, tum mei amantissimum cognovi in omni varietate rerum mearum; tum patris tui pluribus beneficiis vel defensus tristibus temporibus, vel ornatus secundis, et sum totus vester, et esse debeo; quum præsertim matris tuæ, gravissimæ atque optimæ feminæ, majora erga salutem dignitatemque meam studia, quam erant a muliere postulanda, perspexerim. Quapropter a te peto in majorem modum, ut me absentem diligas atque defendas. Vale.»
[p. 193] «M. T. Cicero, proconsul, à C. Marcellus, consul designé, salut.
«J’ay repceu une grand’joye, quand j’ay entendu que tu estoys consul: et prie les Dieux qu’ilz te donnent bon heur en ceste office, et te facent la grâce que tu la puisses administrer selon ta dignité et reputation, et la renommée de ton père. Car si je t’ay tousjours aymé et tenu cher, pource que je t’ay trouvé amy en toutes mes fortunes; à cause aussi que j’ay repceu plusieurs plaisirs de ton père, soit pour avoir esté deffendu par luy en mes infortunes, ou aorné en ma prosperité: il est besoing que je soys et que je doibve estre tout vostre, veu mesmement que ta mère (femme de singulière gravité et bonté) a faict, pour mon salut et dignité, plus beaucoup qu’il ne se peult espérer d’une femme. Parquoy je te prie, tant que je puis, que tu m’aymes et deffendes en mon absence. Adieu.»
Dans l’Epistre au lecteur qu’il a mise en tête de ce volume, Dolet annonce, comme complément de ses travaux sur la langue française, un grand dictionnaire vulgaire dont il garantit la prochaine impression... Hélas! le malheureux comptait encore sans le bûcher de la place Maubert!... Quoique nous ayons dans le même genre l’ouvrage bien connu de Nicot, celui de notre Estienne n’en est pas moins à regretter; et tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de notre ancien idiome, partageront, j’en suis convaincu, mon sentiment à cet égard. Quand je songe à l’érudition, à l’exactitude, à la puissante méthode, à la [p. 194] sévère conscience qui distinguent les Commentaires sur la langue latine, quel dommage, me dis-je alors malgré moi,—et cela, du fond du cœur,—quel dommage qu’on n’ait pu avoir de la même main deux pareils volumes in-folio de Commentaires sur la langue française... c’est-à-dire sur la vieille langue gauloise de Marot, de Desperiers et de Rabelais!
Au recto du dernier feuillet des Epistres familiaires, je découvre, à propos de notre savant imprimeur, un renseignement curieux, et que j’aurais grand tort de passer sous silence. Le voici; je ne saurais mieux terminer ce chapitre:
«Ce present Œuvre fut achevé d’imprimer, le XXVIII d’apvril 1542, à Lyon, chés Estienne Dolet, pour lors demeurant en rue Mercière, à l’enseigne de la Dolouëre d’or.»
[107] Ramus a donné, dans sa Grammaire françoyse (Paris, André Wechel, 1572, in-8o), la liste des grammairiens qui, avant lui, ont essayé de réformer l’abus de nostre escripture. Voici le passage en entier; on verra que Dolet y tient sa place:
«Je commenceray par la Grammaire gaulloyse ou françoyse anciennement celebrée par nos druydes, par nos roys Chilperic et Charlemagne, nagueres comme revoquée des enfers par le grand roy Françoys, traictée en diverses façons par plusieurs autheurs. Jacques Sylvius, qui est decedé en la profession royalle de medecine, la presenta à la royne Leonor à son advenement, et tascha de reformer l’abus de nostre escripture, et faire qu’elle convint à la parolle, comme appert par les characteres lors figurés par Robert Estienne, et pratiqués par toute la Grammaire. Geoffroy Tory, maistre du pot cassé, lors imprimeur du roy, en mit en lumière quelque traicté. Dolet en a composé quelque partie, comme des poins et apostrophes; mais la conduicte de ceste œuvre plus haulte et plus magnifique et de plus riche et diverse estoffe est propre à Loys Megret, combien qu’il n’ayt point persuadé entierement à ung chascun touchant l’orthographe. Jacques Pelletier a debatu subtillement ce poinct d’orthographe, en ensuivant, non pas les characteres, mais le conseil de Sylvius et de Megret. Guillaume des Autels l’a fort combattu, pour deffendre et maintenir l’escripture vulgaire. Lors, esmeus d’une si louable entreprise, nous en fismes aussi quelque coup d’essay, tendants à demonstrer que nostre langue estoit capable de tout embellissement et aornement, que les aultres ayent jamais eu. Les plus recens ont evité toute controverse, et ont faict quelque forme de doctrine chascun à sa fantaisie. Jean Pilot, Jean Grenier, Anthoine Caucie en latin; Robert Estienne en latin et en françoys; Joachim du Bellay, le vray Catulle des Françoys, a mis en lumiere une Illustration de la langue françoyse. Depuis, Henry Estienne a escrit la Conformité du langaige françoys avec le grec; et ne doubte point (s’il s’adonne à ceste estude) qu’il ne nous donne ung aussi riche Tresor de la langue françoyse, comme il nous a donné de la langue grecque. Nagueres J. A. de Baïf a doctement et vertueusement entreprins le poinct de la droicte escripture, et l’a fort esbranlé par ses vives et pregnantes persuasions.»
[108] On a, dans le même genre, d’un contemporain de Dolet, Guillaume Paradin de Cuiseaux:
Histoire de nostre temps (depuis l’avénement de François Ier jusqu’en 1558). Lyon, de Tournes ou Michel, 1558, in-16.
Cet ouvrage de Paradin n’est point sans mérite. Comme Dolet, l’auteur l’écrivit d’abord en latin, et en publia plus tard la traduction et la continuation en français.


Ses relations avec Budé, Rabelais, Marot, Salmon Macrin
et Jean de Tournes. — Savait-il le grec?

Encore une digression: mais avec Dolet, il n’y a guère moyen de procéder autrement. D’ailleurs, elle achèvera de donner toute sa ressemblance au portrait multiple que j’essaye de tracer.
A la page 169 du volume déjà cité qui renferme les deux Harangues contre Toulouse, je trouve la lettre suivante, adressée à mon héros par le célèbre helléniste Guillaume Budé, par celui qu’Erasme surnommait hautement le Prodige de la France:
«Quod tu mihi in eleganti et tersa epistola tua operam, studium, curam, defers officiose et ingenue, id vero gratum mihi atque jucundum, per (inquam) gratum fuit, ut debuit; velimque ut existimes eo me animo erga te esse, ut pares officii vices refundere tibi statuerim, ad eumdemque modum benignitatis egregiæque voluntatis atque obsequiosæ, idque sine vaniloquentiæ fuco: tametsi doctrinam tuam ex litteris tuis suspicari et judicare, non etiam institutum vitæ et conditionem cognoscere potui. Vale, et [p. 196] quod a me contendisse litteris tuis videre, ut amicorum meorum numero te adscribam, hujus epistolæ fide abstulisse te tibimet ipse sine cunctatione sponde. Parisiis, nono cal. febr.»
«Dans votre lettre élégante et châtiée, vous mettez à mon service votre zèle, votre affection et votre dévouement. Cette déférence officieuse et ingénue m’a été douce, oui, bien douce, comme de raison. A votre tour, soyez convaincu d’une chose: c’est que j’ai la ferme intention de vous rendre la pareille; de vous traiter, en un mot, avec la même bienveillance et la même courtoisie, toute vanterie à part. Un mot seulement: votre lettre me laisse soupçonner et apprécier en vous un homme instruit, sans toutefois qu’elle puisse me faire connaître votre genre de vie et votre condition. Adieu; et quant à ce que vous semblez réclamer de moi par votre correspondance, à savoir que je vous compte au nombre de mes amis, ma présente lettre vous garantira, sans l’ombre d’un doute, l’accomplissement de vos vœux à cet égard. Paris, 23 janvier (1533).»
Comme on le voit par l’avant-dernière phrase, Budé manifestait le désir de connaître, d’une façon plus intime et plus personnelle, son jeune et docte correspondant. Dolet s’empressa de le satisfaire, et en lui répondant de Toulouse le 20 avril suivant, il lui raconta de point en point toutes les particularités de son enfance, de son éducation, de son voyage et de son séjour en Italie. Il lui fit part en même temps de ses chères études, de ses travaux assidus sur Cicéron, de son culte pour ce grand homme, auquel il [p. 197] associait, en raison de la pureté de leur style, Salluste, César, Térence et Tite-Live. Cette confiance, cette franchise juvénile flatta sans doute l’austère Budé; notre Estienne, un jour peut-être en sa vie, s’était montré habile et prudent. Plus d’une fois, par la suite, il dut se ressentir de la sympathie puissamment protectrice qu’il avait eu le bonheur et l’adresse de conquérir ce jour-là. Ce fut donc vraisemblablement pour faire acte de reconnaissance, comme aussi, je n’en doute pas, dans le but d’avouer loyalement son devancier et son initiateur, qu’il dédia plus tard, en 1536 et en 1538, ses Commentaires sur la langue latine à l’auteur des Commentaires sur la langue grecque, dont la première édition avait paru chez Robert Estienne, en 1529, in-folio.
Passons au sublime abstracteur de quintessence, au très-véridique chroniqueur du grand Gargantua et de Pantagruel son fils, à cet Homère bouffon dont notre imprimeur, en bon et féal compaing qu’il était, publia l’Iliade en l’an de grâce 1542[109]. Bon an, bonne œuvre.
C’est à Lyon que Dolet le cicéronien avait fait connaissance avec le joyeux Panurge, grand amateur aussi, malgré sa nature gauloise, de la belle langue romaine du siècle d’Auguste. Estienne, entre autres souvenirs d’amitié, lui a consacré trois de ses Poésies latines (I, 56; II, 14; IV, 18). La deuxième de ces pièces est une courte réponse à cinq distiques latins, [p. 198] dans lesquels Rabelais envoyait à notre humaniste la recette jusque alors perdue du Garum, espèce de saumure antique. La dernière et la plus originale fait parler en ces termes le cadavre d’un pendu, qui s’applaudit d’être disséqué publiquement par le docte François, médecin à l’hôpital de Lyon:
[p. 199] «La Fortune, dans sa fureur, avait juré par le Styx et par le sombre Orcus, d’amasser tous les maux, tous les opprobres sur ma tête. Tandis qu’elle poursuit son but, et qu’elle redouble d’efforts pour assouvir sur moi sa haine infernale, en un clin d’œil me voici plongé dans un cachot; et je n’en sors, pauvre diable! que pour grimacer au bout d’une potence. Mais voyez un peu le caprice du Destin! En un clin d’œil, j’avais péri d’une mort violente: en un clin d’œil aussi, j’obtiens ce qu’à peine l’on oserait demander au grand Jupiter. Publiquement exposé dans une vaste enceinte, je sers de sujet à une merveilleuse dissection; un médecin, véritable prodige de science, explique avec une lucidité sans égale l’habileté, l’artiste symétrie que notre mère la Nature a déployées dans la composition du corps humain. Un nombreux amphithéâtre contemple ma dissection, et admire en moi le chef-d’œuvre de Dieu. Pends-toi, Fortune! Je nage dans les honneurs, moi que tu as voulu servir en pâture aux corbeaux, moi dont tu as prétendu faire le jouet des vents.»
Ami de Rabelais, et consultant volontiers à son exemple, comme on le verra tout à l’heure quand je parlerai de Jean de Tournes, l’oracle infaillible de la dive Bacbuc, Dolet ne pouvait manquer de se lier au même titre avec Clément Marot, cet autre héritier de Villon, cet autre enfant de la vieille Gaule, magna parens virûm! D’ailleurs, on le devine aisément, il y avait entre eux accord parfait de goûts et d’opinions, communauté de hardiesses compromettantes, et, pour ainsi dire, affinité d’humeur buissonnière, [p. 200] sauf, j’en conviens, un peu plus d’entregent de la part de Marot. Quoi qu’il en soit, Estienne a consigné, dans ses Commentaires et surtout dans ses Poésies latines[110], des preuves nombreuses de l’amitié qui l’unissait au gracieux trouvère du seizième siècle. Je trouve, par exemple, au second volume des Commentaires, colonne 403, la digression suivante, qui m’a semblé valoir la peine d’être citée et traduite, ne fût-ce que pour l’énergie du style et la noblesse des sentiments qu’elle exprime:
«Gallicæ linguæ primas partes tenuit nostra ætate Clemens Marotus, poeta versu scribendo felicissimus atque præstantissimus: in quo si quid desideres, Fortunam tantum secundam desideres, quæ virum tantum indigne omni semper injuria contumeliaque affecit, et casibus acerbissimis jactavit. Sed quis litterarum amans et Virtutis studio deditus, Fortunæ invidia non exagitatur? Quis doctus simul, et felix? Quis simul virtutis laude clarus, et fortunæ bonis cumulatus? At omnis calamitatis una est consolatio, vel merces potius maxima, posteritatis pollicitatio atque exspectatio. Virtutis prolem omni contumelia premant, flagitiose vexent, a patria ablegent, misere apud exteros exsulare cogant nefaria Fortunæ mancipia. Facile hominum stultorum conatus, facile invidiam, facile injurias ferunt, qui proposito posteritatis præmio oblectantur, et sua jam gloria defruuntur vivi, longe majore post mortem cumulandi: at [p. 201] corpore et nomine prorsus, ut pecora, exstinctis, a quibus tam nefarie jactati aliquando fuerint.»
«Au premier rang des écrivains qui savent manier la langue française, se place de nos jours Clément Marot, poëte de la veine la plus heureuse et la plus brillante. Je ne vois en lui qu’une chose à désirer, l’appui de la Fortune; elle n’a jamais cessé de poursuivre indignement ce grand homme, elle s’est plu à l’accabler d’outrages et d’amères persécutions. Mais où est l’amant des lettres, le zélateur de la Vertu, qui ne soit pas en butte à l’envie de la Fortune? Peut-on être à la fois savant et heureux, illustre par son mérite et favorisé des biens de ce monde? N’importe! tout malheur porte avec lui son unique consolation, que dis-je? sa haute récompense: la promesse et l’attente de la postérité. C’est en vain que les misérables esclaves de la Fortune infligent aux clients de la Vertu les affronts les plus sanglants, les avanies les plus ignominieuses; c’est en vain qu’ils les proscrivent, qu’ils les condamnent aux tortures de l’exil. On brave aisément les efforts des sots, leurs jalousies et leurs injustices, quand on a devant soi le prix de la lutte, la douce perspective de l’avenir; quand on jouit déjà d’une gloire vivante, en attendant l’immortalité d’outre-tombe; quand on sait, enfin, qu’ils meurent comme des brutes, qu’ils disparaissent, corps et nom, tous ces lâches bourreaux de la pensée!»
En 1536, maître Clément s’était vu rappeler de son exil par François Ier, et, de retour à Paris, avait reçu de ce prince le plus aimable accueil. Dolet [p. 202] s’empressa d’en féliciter son ami, par la pièce de vers que l’on va lire:
«Assez longtemps la cruelle Fortune t’a fait servir de jouet à ses caprices: espère et prends courage. Le ciel n’est pas toujours assombri par les nuées, et l’on y voit reparaître enfin la lumière des beaux jours. Sur la mer profonde, ne pèse pas à jamais l’horrible nuit des tempêtes. Toi non plus, tu ne seras pas continuellement en proie aux morsures de l’envie, et condamné à ramper dans une longue indigence. Il te relèvera, pauvre opprimé, cet homme en qui nous voyons la bonté, la clémence même, le roi de France! Espère, te dis-je, espère. Il sait, d’une main riche en largesses, faire pleuvoir sur le mérite les biens et les honneurs. Avec un tel prince, peux-tu rien espérer, rien désirer en vain?»
[p. 203] Deux ans plus tard, c’est-à-dire en 1538, Marot chargea le savant typographe, à peine installé, de faire paraître une édition exacte et complète de ses œuvres. A cette occasion, il lui écrivit une espèce de lettre-préface où il l’appelle son cher amy Dolet. Cette lettre se retrouve dans les éditions de 1542 et 1543, in-8o, sorties également des presses de notre Estienne. Je vais en extraire les passages les plus intéressants:
«Clement Marot à Estienne Dolet, salut.
«Le tort que m’ont faict ceulx qui par cy-devant ont imprimé mes œuvres, est si grand et si outrageulx, cher amy Dolet, qu’il a touché mon honneur et mis en danger ma personne: car par avare convoytise de vendre plus cher et plus tost ce qui se vendoit assez, ont adjousté à ycelles miennes œuvres plusieurs aultres qui ne me sont rien; dont les unes sont froidement et de maulvaise grâce composées, mectant sur moy l’ignorance d’aultruy, et les aultres toutes pleines de scandale et sedition... Ce que je n’ay peu sçavoir et souffrir tout ensemble. Si ay-je jecté hors de mon livre, non-seulement les maulvaises, mais les bonnes choses qui ne sont à moy ne de moy, me contentant de celles que nostre muse nous produict... Et après avoir reveu le vieil et le nouveau, changé l’ordre du livre en mieulx, et corrigé mille sortes de faultes infinies procedantes de l’imprimerie, j’ay conclud t’envoïer le tout, affin que soubz le bel et ample privileige qui, pour ta vertu meritoyre, t’a esté octroyé du roy, tu le fasses (en faveur de nostre amytié) r’imprimer, non-seulement [p. 204] ainsy correct que je le t’envoie, mais encores mieulx: qui te sera facile, si tu y veulx mettre la diligence esgalle à ton sçavoir...»
Il donne ensuite cet avis aux lecteurs debonnaires:
«De tous les livres qui, par cy-devant, ont esté imprimés soubz mon nom, j’advoue ceux-ci pour les meilleurs, plus amples et mieulx ordonnés; et desadvoue les aultres comme bastards ou comme enfantz gastés. Escript à Lyon, ce dernier jour de juillet, l’an mil cinq centz trente et huict.»
Jusque alors, comme vous voyez, tout allait bien entre Marot et Dolet; des deux parts, on faisait assaut de compliments. Cette même année 1538, les Commentaires du second avaient reçu du premier, aussitôt après leur apparition, l’accueil de fête, le bouquet flatteur que voici:
Plus tard, les deux intimes se brouillèrent à mort; j’ignore à quel sujet, mais ce fut probablement au milieu ou vers la fin de l’année 1543: car Dolet, qui publia cette année, comme je l’ai dit tout à l’heure, une édition in-8o des œuvres de Marot, y parle encore de celui-ci dans les termes les plus affectueux.
[p. 205] Mais tout changea, quand l’amour-propre froissé, mettant la haine et le mépris à la place de l’affection et de l’estime, eut séparé pour jamais ces deux natures également susceptibles. Je ne crois pas, cependant, que Marot se soit montré le plus acharné, dans le duel d’injures qui sans doute eut lieu à cette occasion. Maître Clément n’était pas un homme de fiel et de rancune; il se contenta de porter une ou deux bottes à son adversaire, puis il le laissa tranquille et passa son chemin.
En effet, parmi les épigrammes de ce poëte, j’en ai trouvé deux, pas davantage, qui se rattachent à sa querelle avec Dolet. La première, intitulée Contre l’inique, est adressée à Antoine Dumoulin[112], Masconnois, et à Claude Galland. Voici en quels termes:
[p. 206] La seconde, imitée de Martial, est ainsi conçue:
Marot n’a pas eu de bonheur dans sa prophétie, suivant une remarque spirituelle de son éditeur Lenglet-Dufresnoy. Bien des opinions peuvent se formuler sur le compte de Dolet; mais, à coup sûr, on ne dira jamais qu’il n’a pas fait de bruit à sa mort.
C’est probablement par l’intermédiaire de Marot, leur ami commun, que Dolet fut mis en relation avec l’Horace français, Salmon Macrin de Loudun, l’un des plus célèbres poëtes latins modernes du seizième siècle. On a déjà vu précédemment, au chapitre X, avec quelle chaleur d’enthousiasme Macrin salua l’apparition des poésies latines de Dolet. Ce n’était pas le premier témoignage de sa sympathie pour le courageux savant. En 1537, il inséra (p. 37) dans le volume de ses Hymnes, publié chez Robert Estienne, une assez longue pièce hendécasyllabique (Ad Poetas gallicos, Aux Poëtes de la France), où il associa notre humaniste à quatre autres héritiers de la muse antique, Germain Brice, Dampierre, Nicolas Bourbon et Jean Voulté, pour leur rendre à tous les cinq un hommage collectif, et les prier de l’admettre, lui sixième, dans leur poétique phalange. Voici, du [p. 207] reste, les vers de Macrin, suivis, comme toujours, de la traduction française:
«Brice, Dampierre, Bourbon, Dolet, et toi, Vulteius, auteur d’un récent ouvrage; poëtes riches en bien dire, en nombres élégants, âmes heureuses et dignes d’honneur; vous dont notre France est glorieuse et qu’elle oppose avec une noble audace aux nations ausoniennes, quelle récompense obtiendrez-vous de la patrie? Quels décrets vous dresseront un piédestal à la hauteur de votre génie charmant, célèbres fils de la Muse? car c’est grâce à vos soins, à [p. 209] vos veilles, à votre insigne érudition, que cette France, naguère encore barbare et sans culture, se polit en dépouillant ses mœurs agrestes; c’est par vous qu’elle défie l’Attique elle-même, la Grèce tout entière, les doctes arrière-neveux de Rémus, et qu’elle ne se croit pas inférieure à l’Italie. Il est beau, sans doute, de défendre son pays, d’écraser sous les armes l’agression étrangère, d’enceindre les villes de hautes murailles, de trôner au-dessus d’un attelage blanc comme la neige, d’ériger des arcs de triomphe et d’orner çà et là de superbes trophées en y fixant les dépouilles des vaincus; il est beau de construire des cirques, d’élever des temples, de bâtir des citadelles, de faire passer des aqueducs à travers une ville, et de répandre avec une largesse chevaleresque, sur ceux-ci, sur ceux-là, homme par homme, le congiarium ou les donativa. Oh! voilà qui est grand, je l’avoue; et pour soutenir le contraire, Brice, Dampierre, Bourbon, Dolet, et toi, Vulteius, auteur d’un récent ouvrage, il faudrait avoir les fibres du cœur pétrifiées. Eh bien! avec la longueur du temps, toutes ces gloires se lézardent; exposées aux chutes, aux ruines, elles s’écroulent au sinistre contact de la foudre. Mais le brillant panégyrique des poëtes, mais la Muse abreuvée du nectar de l’Hymète, voilà ce qui supportera sans cesse l’assaut des années, ce qui ne périra jamais; tant que le dôme céleste allumera ses étoiles d’or, tant que l’été redoublera ses ardeurs excessives et que les fleuves se précipiteront dans la vaste mer... Oui, les artistes des louanges poétiques et ceux qu’avec une fanfare sonore le clairon sacré [p. 210] des bardes a exaltés pour jamais, ceux-là sont transfigurés, ceux-là sont immortels. Ils braveront la série des ans; œuvres et poëtes vivront dans l’éternité. Donc, puisque l’enthousiasme aonien me transporte, admettez-moi dans vos chœurs à titre d’ami; appelez-moi, sixième, dans votre sainte phalange. Si j’obtiens cette juste faveur, mon front sublime ira toucher les astres, et je ne changerai pas ma gloire contre les richesses de Crassus, Brice, Dampierre, Bourbon, Dolet, et toi, Vulteius, auteur d’un récent ouvrage.»
Estienne voulut acquitter sa dette et répondre de son mieux à la courtoisie de cet excellent Macrin. Bonne pensée, comme toutes les pensées du cœur. Elle lui inspira la pièce suivante, qui forme la huitième du second livre de ses Carmina de 1538:
[p. 211] «Harcelé par une légion d’ennuis que je m’efforçais bravement de mettre en fuite, le hasard veut, cher Macrin, que je rende visite à Robert Estienne. Là, quelle faveur du sort! je tombe sur un volume de tes vers, encore chaud des étreintes de la presse; tu devines alors ma joie soudaine. D’abord je me sens ravi par la merveilleuse élégance de ton style et par cette grâce poétique inconnue même aux anciens; ensuite je m’applaudis de voir la gloire française s’élever jusqu’au ciel sous ton heureuse impulsion. Oh! mon ivresse était bien naturelle; un instant j’ai pu bannir mes chagrins, oublier mes angoisses, et c’est à toi, cher Macrin, que j’ai dû ce bonheur!»
Parmi tous ces compaings de notre Estienne, je n’aurai garde d’oublier un de ses plus célèbres confrères, l’imprimeur Jean de Tournes. Né à Lyon en 1504, mort de la peste, dans la même ville, en 1564, cet habile typographe avait fait, avant 1540, son apprentissage dans les doctes ateliers de Sébastien Gryphius, et c’est là sans doute qu’il connut Dolet. Comme preuve de la bonne amitié qui dès lors s’établit entre eux, je trouve dans les Poésies latines de celui-ci (II, 36) la pièce suivante, adressée ad Joannem Turnœum et Vincentium Piletum combibones suos (A Jean de Tournes et à Vincent Pilet, ses camarades de bouteille):
«En quelque lieu que tu sois, Bacchus, viens, porte ici tes pas, et amène avec toi toutes les Charites. Les ennuis décamperont à l’aspect de ta sainte divinité; ils décamperont devant toi, ces ennuis si peu propices aux festins, si antipathiques aux assemblées de buveurs. Que le chant, les jeux, la danse, ébranlent la maison: au diable les visages sévères, les fronts lourds de gravité! Combattons avec cœur, en héros, le verre à la main. Vive la joie! c’est l’ordre du jour. Arrière les conseils prudents et sobres: qu’ici la folie soit reine, et que chacun se fonde dans une douce ivresse. A toi, Lyæus, joyeux père, à toi de nous procurer ce bonheur; viens nous échauffer de ta flamme puissante; viens, te dis-je, Lyæus, père des bons compagnons! Nous t’immolerons cent boucs, nous célébrerons en ton honneur les Bacchanales; tout ce que le vin, ta liqueur, enfante de génie, nous te le réservons sans fraude!»
[p. 213] Au dire de la Monnoye (dans son édition de Baillet, t. I, p. 372), «il ne paroît point par les œuvres de Dolet, qu’il ait sçu le grec. Ses prétendues versions de l’Hipparchus de Platon, et de l’Axiochus, ont été faites d’après les interprétations latines qu’il en avoit trouvées».
Maittaire, qui reproduit en note (vol. cité, p. 82) cette assertion du savant dijonnais, la combat au moyen d’un argument plus spécieux que solide, en invoquant l’autorité de La Croix du Maine et de Du Verdier, tous deux probablement versés dans la langue grecque.
«C’est pourquoi, dit Née de la Rochelle, je crois devoir le renforcer: 1o par cet aveu de Dolet, qui nous dit, dans une Epistre au peuple françoys imprimée avec sa Manière de bien traduire, que «la lecture des langues latine et grecque estoit son estude principale»; 2o par le privilége qui lui fut accordé par François Ier «pour l’impression des livres en lettres latines, grecques, italiennes et françoyses, qu’il auroit composez en ces langues, ou traduictz, deument reveuz, amendez, illustrez, annotez», etc.; 3o en affirmant qu’il lui auroit été impossible d’entendre et de traduire les ouvrages de Cicéron sans savoir la langue grecque, puisque cet orateur a fait un usage fréquent de mots grecs, ou composés par lui du grec, qu’il a inséré dans ses ouvrages un assez grand nombre de vers et de passages grecs, et qu’il en a traduit ou imité une plus grande quantité: ainsi Dolet auroit été arrêté à chaque ligne de sa traduction des Lettres familières et surtout des Tusculanes de Cicéron, où [p. 214] cet auteur traite de tant de matières curieuses et philosophiques; 4o en rétorquant l’argument qu’on pourroit tirer de ce qu’il n’a point imprimé de livres grecs, car je n’ai vu aucun ouvrage italien qui soit sorti de ses presses: pourroit-on nier cependant qu’il ait su cette langue, après un séjour de quatre ans et plus en Italie?»
A la suite du recueil des Poésies latines de Dolet, on trouve, comme je l’ai déjà dit, un certain nombre de vers grecs et latins, composés en son honneur par quelques-uns de ses amis. Honoré Veracius, entre autres, lui consacre deux petites pièces grecques, dont voici la première:
«Bon grammairien, bon poëte, si quelqu’un l’est aujourd’hui, c’est à coup sûr Dolet, bon grammairien, bon poëte.
«Brillant historien, doux chanteur, si quelqu’un l’est aujourd’hui, c’est à coup sûr Dolet, brillant historien, doux chanteur.
«Savant astronome, orateur disert, si quelqu’un [p. 215] l’est aujourd’hui, c’est à coup sûr Dolet, savant astronome, orateur disert.»
Je partage encore, à cet égard, l’opinion de Née de la Rochelle: ce serait se moquer d’un savant, que de lui adresser, ou, si l’on veut, de lui asséner des compliments de cette force, dans une langue qu’il ne comprendrait pas. Dolet comprit si bien, qu’il répondit à Veracius. Cette réponse est même plus modeste qu’on ne le croirait. La voici:
«Les éloges dont tu m’accables me sont doux à entendre, j’en conviens; car il est toujours agréable d’être loué par un homme que chacun loue. Mais qu’il me serait bien plus doux, bien plus agréable, de voir les dieux, fléchis par tes prières, me départir à profusion les glorieuses faveurs pour lesquelles tu m’accables d’éloges, toi qui les réunis toutes dans un degré souverain de perfection!»
Concluons maintenant que, sans être un helléniste de la force de Guillaume Budé, Dolet néanmoins savait encore assez de grec pour comprendre et traduire Platon, non-seulement à l’aide de telle ou telle version latine, ainsi que la Monnoye l’affirme sans aucune espèce de preuve, mais directement et sur le texte original.
[p. 216] Après cela, quand on traduit un auteur grec, il n’a jamais été défendu, que je sache, de s’appuyer un peu sur les interprètes latins. Le droit au bâton est un des priviléges du voyage à pied.
[109] V. plus loin, à ma Bibliographie dolétienne, un épisode relatif à cette édition de Rabelais.
[110] I, 23, 24, 28, 58, 70; II, 21, 22, 23; III, 4.
[111] Carm., II, 22.
[112] C’est Antoine Dumoulin, suivant La Croix du Maine, qui a recueilli et rassemblé, dans les dernières éditions faites de son temps, les œuvres de Clément Marot.
[113] Carm., I, 15.


Nouvelle arrestation. — Il est sauvé par Pierre du Chastel. — On brûle ses livres.

Vne femme qu’on aime, un enfant qu’on élève, de joyeulx compaignons, frères de science et de cœur, qu’on accueille à son foyer du soir; tout cela, c’est le bonheur, le bonheur calme et vrai. Mais il était dit que ce malheureux Dolet ne compterait jamais un jour paisible, un seul jour à marquer, comme les anciens, de la blanche pierre des Thraces, meliore lapillo. Il paraît qu’en le voyant établir ses presses, «les aultres maistres imprimeurs et libraires de la ville de Lyon auroient prins une grande jalousie et secrette envie, voyant qu’il commençoit à honnestement proffiter, et que, par succession de temps, il pouvoit grandement s’augmenter; et tant à ceste occasion que pour avoir soustenu les compaignons imprimeurs, au procès meu entre lesdict maistres et eulx, yceulx maistres, auroient conceu haine mortelle et inimitié capitale contre luy, [p. 218] et se seroient ensemble bandez pour conspirer sa ruine[114].»
Le procès dont il vient de parler fut, sans doute, celui qui surgit à Lyon, vers 1538, entre les maistres imprimeurs et leurs compaignons, parce que ces derniers s’étaient bandez ensemble pour constraindre les maistres imprimeurs de leur fournir plus gros gages et nourriture plus opulente. Cette coalition des ouvriers imprimeurs occasionna l’édit du 28 décembre 1541[115].
Mais ce n’était rien encore que cette haine mortelle et inimitié capitale des maistres imprimeurs: la monacaille du temps gardait à notre pauvre Estienne une rancune bien autrement terrible. Elle n’avait pas oublié (ces gens-là n’oublient jamais!) la grêle d’épigrammes[116] dont il avait criblé le capuchon; elle sentait toujours au cœur, comme une gangrène corrosive, la blessure que notre courageux savant lui avait faite, en foudroyant dans ses Commentaires le sacrilége complot des sorbonistes contre l’art typographique[117]. Et puis, comment lui pardonner les sobriquets indécents dont il avait affublé tous les membres de cette auguste Sorbonne, dans son édition de Rabelais[118]? N’avait-il pas, en outre, imprimé les Œuvres de maistre Clément Marot, cet infâme qui mangeait du lard en plein vendredi, sans craindre une indigestion [p. 219] providentielle? Que dis-je? n’était-il pas lui-même «reprins d’avoir mangé chair en temps de karesme, et aultres jours prohibez et deffenduz par saincte Eglise[119]?» N’était il pas accusé d’avoir dit, à ce propos, «qu’il pouvoit aussy bien manger de la viande, comme le pape le vouloit constraindre à manger du poisson[120]?» Enfin, pour combler la mesure des attentats, ne publiait-il pas la saincte Escripture en langue vulgaire?...
Traduire la Bible dans l’idiome des masses! admettre le menu peuple, aussi bien que les Scribes et les Pharisiens, à l’examen sur pièces de la vérité catholique!... Haro, haro sur l’impie!...
Provisoirement, on dénonça Dolet à la sainte inquisition. Frère Matthieu Orry, inquisiteur, et maistre Estienne Faye, official et vicaire de l’archevêque et comte de Lyon, rendirent, le 2 octobre 1542, une sentence par laquelle ils déclaraient bel et bien «le dict Estienne Dolet maulvais, scandaleux, schismaticque, hereticque, fauteur et deffenseur des heresies et erreurs, et comme tel, le delaissoient reaulment au bras seculier[121]».
Le bras séculier, c’était tout simplement la mort... et quelle mort!... la corde ou le feu!
[p. 220] J’y songe: avant d’aller plus loin, un mot sur ce digne frère Matthieu Orry.
Dans le procès, on l’appelle Oroy; mais le véritable nom de ce révérend personnage était, à ce qu’il semble, Orry. Il avait été promu à la charge d’inquisiteur de la foi, par des lettres patentes du 30 mai 1536; et il fut confirmé dans ces pieuses fonctions par un édit de Henri II, du 22 juin 1550[122].
C’est ce même Orry que Rabelais a baptisé quelque part nostre maistre Doribus. Voici, sur l’interrogatoire que cet homme fit subir à Dolet, une épigramme contemporaine, digne assurément de sortir de l’oubli dans lequel la plupart des biographes mes prédécesseurs ont cru devoir la laisser[123].
Revenons à Dolet. En présence de son bûcher qui s’élevait déjà, ou peu s’en fallait, le pauvre imprimeur s’adressa de rechef à la clémence royale; il protesta de toutes ses forces, «que, en tous et chascun les livres qu’il avoit composez et imprimez, tant de luy que après les aultres, et en ceulx ès quelz il avoit mis [p. 221] seulement les epistres liminaires, il n’avoit entendu ni entendoit qu’il y eust aulcune erreur ou chose mal sentant de la foy, et contre les commandements de Dieu et de nostre mère saincte Eglise... Et quant à ce qu’il avoit esté trouvé mangeant chair ès jours prohibez et deffenduz par l’Eglise, ce avoit esté par le conseil du medecin, à cause d’une longue maladie qu’il avoit, et par permission expresse de l’official et des ministres de saincte Eglise, ne entendant par cela aulcunement avoir scandalisé ne contempné les institutions d’ycelle, qu’il approuve et veult entièrement ensuivre comme filz d’obédience[124]».
Tout ce bel acte de contrition, plus ou moins sincère, n’empêcha pas notre homme de croupir QUINZE MOIS dans les cachots de saincte Eglise; il ne dut, en dernier lieu son salut et sa liberté qu’à l’intercession généreuse de Pierre du Chastel, alors évêque de Tulle.
Ce digne prélat, suivant l’expression de Bayle, relança d’une manière très-raisonnable, et même très-énergique, en cette occasion, certain cardinal (celui de Tournon, à ce qu’il paraît) qui lui faisait un crime de sa compatissance évangélique.
«Comment! lui disait ce haut et puissant personnage, vous qui tenez rang de prélat dans l’Église orthodoxe, vous osez, à l’encontre de tous ceux qui ont à cœur l’intérêt de la religion, prendre fait et cause pour des misérables qui, non-seulement sont [p. 222] infestés de la peste luthérienne, mais qui encore se mettent sous le coup d’une accusation d’athéisme!»
A cela du Chastel répondit, avec l’accent de la plus noble indignation:
«J’ai pour moi l’exemple du Christ, des apôtres et de tous ceux qui, par leur sang, ont cimenté l’édifice de notre sainte Église. Il m’apprend, cet exemple, que le véritable rôle d’un évêque et d’un prêtre de Dieu consiste à détourner l’esprit des rois de la barbarie et de la cruauté, pour le porter à la mansuétude, à la clémence, à la miséricorde. Vous donc, qui m’accusez d’oublier mon titre de prélat, sachez, monseigneur, que je puis, à plus juste titre, rétorquer cette accusation contre vous. Nous sommes deux ici, d’opinion contraire. Eh bien! l’un remplit le devoir d’un prélat: c’est moi; l’autre fait le métier d’un bourreau: c’est vous![125]»
En présence d’une intervention aussi chaleureuse, le roi, vivement ému, ne put se dispenser de faire grâce. Toutefois, les pièces du procès de Dolet prouvent que, dans cette occasion, le parlement résista longtemps aux ordres formels de ce prince. En effet, les lettres de rémission sont du mois de juin 1543. Mais on prétendit que l’impétrant n’était pas en règle, relativement à l’affaire de Compaing, et qu’il avait faussement annoncé l’entérinement des lettres, [p. 223] du mois de février 1536, portant rémission de cet homicide. Il obtint alors du roi, le 1er août 1543, des lettres ampliatives qu’il croyait de nature à lever tout obstacle; mais il eut beau faire, le parlement ne se rendit pas encore. Bref, il fallut une seconde fois l’injonction expresse de François Ier, et de nouvelles lettres, en date du 21 septembre, pour que l’élargissement fût définitivement ordonné. Encore n’eut-il lieu que le 13 octobre suivant.
Estienne échappa donc, par un miracle de plus, aux bêtes féroces du prétoire.
N’importe: à défaut de l’auteur, et en attendant qu’on pût le reprendre, on se vengea sur les livres. Par un arrêt[126] du parlement de Paris, en date du 14 février 1543, les treize ouvrages dont je vais donner la liste, presque tous imprimés par Dolet, et quelques-uns composés par lui, furent «condamnez à estre bruslez, mis et convertis ensemble en cendres, comme contenant damnable, pernicieuse et hereticque doctrine.» C’étaient:
La souveraine Court, dis-je, condamna ces différents livres «à estre brûlez, au parvis de l’eglise Notre-Dame de Paris, au son de la grosse cloche d’ycelle eglise»; le tout, bien entendu, «à l’edification du peuple et à l’augmentation de la foy chrestienne et catholicque[130]!»
Ridiculam stultorum nationem! pour parler comme notre martyr lui-même; ridicule nation d’insensés! stupide ramas de fanatiques! Vous espériez donc brûler, en même temps que ces quelques livres, la pensée, l’incombustible pensée qu’ils renfermaient? vous espériez donc anéantir, en même temps que l’encre et le papier, le dieu caché sous ces matérielles espèces?... Oh! pauvres gens! que vous me faites [p. 225] pitié!... Cette pensée que vous prétendiez asservir, Spartacus victorieux, elle a brisé vos entraves; cette pensée que vous prétendiez rendre muette, parole irrésistible, elle a crevé vos bâillons; cette pensée, enfin, que vous prétendiez étouffer dans l’oubli, Christ éternel, sublime Rédempteur du genre humain, du milieu de son sépulcre factice elle s’est élancée vers l’avenir, terrassant à force de splendeur les soldats de Caïphe et de Pilate!... Et maintenant, elle plane, triomphante, sur vos tombes à jamais inconnues... Des livres d’Estienne le martyr, elle a passé dans la conscience des peuples; de l’âme d’Estienne le martyr, elle a passé dans l’âme de Voltaire. En un mot, elle a fait le dix-huitième siècle, elle a fait la Révolution française; Esprit-Saint des temps modernes, elle a changé, renouvelé la face du vieux monde, RENOVAVIT FACIEM TERRÆ!...
[114] Procès d’Estienne Dolet, p. 7.
[115] V. Fontanon, t. IV, p. 467, et le Rec. gén. des anc. lois franç., t. XII, p. 763.
[118] V. le Ducatiana, t. I, p. 178.
[119] Procès, p. 11.
[120] Procès, p. 15.
[121] Procès, p. 5.
[122] V. le Rec. gén. des anc. lois franç., t. XII, p. 503, et t. XIII, p. 173.
[123] A l’exception de Joly, dans son Supplément au Dictionnaire de Bayle.
[124] Procès, p. 14.
[125] J’emprunte ces curieux détails à la p. 62 de la Vie de Pierre du Chastel, écrite en latin par Pierre Galland, professeur de grec et d’éloquence au Collége Royal (Collége de France). Cet ouvrage a été publié, pour la première fois, par Etienne Baluze, en 1674, in-8o.
[126] Rapporté tout au long dans le recueil qui a pour titre: Collectio judiciorum de novis erroribus, in-fol., t. II, 1re part., p. 133 et 134.
[127] Ouvrage imprimé vers 1542. Du Verdier en cite une édition de Lyon, Jacques Berjon, 1549, in-16.
[128] Version française, attribuée à Dolet, de l’Enchiridion militis christiani, d’Erasme.
[129] Traduction également attribuée à Dolet.
[130] Procès, p. 31.



Quatrième emprisonnement. — Évasion originale. — Cinquième et dernière arrestation.

Dolet est libre encore une fois; le voilà de retour auprès de sa femme, de son enfant, de son cher Cicéron. Va-t-il enfin (qu’on me pardonne cette vieille métaphore), va-t-il enfin, sorti d’une lutte orageuse, entrer dans le port du calme et du bonheur? Non! la haine et l’envie ne lâcheront pas ainsi leur proie; la persécution s’acharnera jusqu’au bout sur cette fière victime... Estienne Dolet, d’Orléans, ne se reposera que dans la tombe!
disait-il lui-même, dans une de ses Poésies latines, comme inspiré par un morne pressentiment.
A peine le malheureux commençait-il à respirer, que voici déjà nouvel esclandre. On saisit en 1544, aux portes de Paris, deux ballots de livres, portant [p. 228] sur l’enveloppe, en lettre assez grosse et lisable, le nom bien connu de DOLET. C’était encore un mauvais tour de ses ennemis: les deux ballots en question se composaient, l’un d’ouvrages imprimés à Lyon, chez notre Estienne; et l’autre, d’écrits prohibés, sortis des presses calvinistes de Genève; le tout, comme dit Dolet, conduict par grand’ruse et praticque, afin de mieux prouver qu’il était l’auteur de ce double envoi.
L’injustice et la prévention ne sont jamais bien difficiles à convaincre; il n’en fallut pas davantage pour motiver l’ordre d’un quatrième emprisonnement. Le 5 ou le 6 janvier 1544, en pleine réunion de famille, au moment où, suivant son expression naïve, il s’apprêtait à crier: Le roy boit! la main brutale des gens du roy vint arracher notre pauvre imprimeur à sa femme, à son petit Claude, à ses bons amis, à son féal compagnon de veilles, Marcus Tullius, et, pour tout dire, à sa chère ville de Lyon, où, de si bon cœur, il aurait voulu consumer sa vie:
Heureusement qu’il avait appris, dans son existence de cachots, ung million de bien bons tours, pour faire pièce aux geôliers:
Le troisième jour de son incarcération, notre homme eut l’inappréciable bonheur de rencontrer la clef des champs; et cela, grâce au stratagème le [p. 229] mieux combiné, le plus spirituel qu’il soit possible de voir. Comme il en fait lui-même, dans son Second Enfer, un récit poétique très-amusant et très-détaillé, je crois, en conscience, que mes lecteurs ne perdront pas beaucoup à laisser là ma prose, pour écouter un peu le vieux style de maistre Estienne. Laissons-le donc parler, dans son bizarre et piquant langage du seizième siècle:
Mon naturel est d’apprendre tousjours,
dit-il au roi;
Dolet se réfugia bien vite en Piémont, où, caché dans une retraite studieuse, il ne tarda pas à composer les neuf épistres de son Second Enfer[132]. La première et la plus longue s’adresse à François Ier[133]; c’est là qu’Estienne a consigné le récit de son évasion. Le noble poëte, après s’être lavé des lâches imputations de ses envieux, termine en demandant la vie; mais il la demande pour achever en paix la tâche patriotique et sublime qu’il s’impose depuis si longtemps; mais il la demande avec une grandeur d’âme, avec une dignité de style et de cœur qui, véritablement, fait pleurer d’admiration. Vivre je veulx! s’écrie-t-il,
Souvent aussi, dans ce curieux volume, il passe du grave au doux, du plaisant au sévère. On n’a qu’à parcourir, pour s’en convaincre, son épître à la duchesse d’Estampes, alors maîtresse du roi. C’est la quatrième du recueil. Hélas! dit-il à cette haute et puissante dame, avec une familiarité passablement originale, en la suppliant de hâter l’heure si désirée de sa délivrance,
Mais en général, dans ces requêtes singulières, c’est l’indignation qui déborde; une indignation vibrante et généreuse, qui chasse bien loin la prière servile et parle plus haut que la prudence. Dolet ne songe plus alors à pénétrer de clémence et de compassion l’oreille sourde, l’âme insensible de ses juges; dans ces moments-là, le style de l’audacieux humaniste, au lieu de se teindre à l’eau rose, se fait rouge de colère, en quelque sorte; rouge comme le sang qui jaillit, en pleine artère, d’un cœur blessé par le couteau du lâche!... Que me veult-on? demande-t-il à la souveraine et venerable Court du Parlement de Paris:
Puis le pauvre poëte ajoute, sur un ton pathétique:
Et là-dessus, interrogeant avec une profonde sévérité de philosophe et de vrai chrétien, lui, l’athéiste, comme on l’appelait, tous ces abuseurs de la peine de mort, tous ces dévorateurs de chair humaine, qui, de son temps, faisaient si peu de cas d’une existence [p. 234] d’homme, d’une créature de Dieu, le saint martyr poursuit en ces termes navrants:
[132] Ce titre annonce un Premier Enfer; mais cet ouvrage, qui devait raconter l’emprisonnement de 1542, ne fut jamais publié. Voici, maintenant, l’origine de ces bizarres appellations de Premier et de Second Enfer:
Marot, prisonnier en 1525, décrivit sa captivité sous le nom d’Enfer. Depuis ce temps-là, l’Enfer de Marot signifia prison; et Dolet ne crut pouvoir mieux faire que d’emprunter cette énergique expression de son ami, maistre Clément.
[133] Les huit autres sont dédiées:
[134] L’Axiochus est apocryphe: les uns l’attribuent à Eschine, les autres à Xénocrate. Voir plus loin, à ma Bibliographie dolétienne.
[135] Procès, p. 36.


Cinquième et dernière arrestation.

Estienne, je l’ai dit plus haut, avait trouvé un refuge en Piémont: le malheureux n’aurait jamais dû quitter cet asile. Mais, hélas! il se promettait un si favorable succès des épîtres du Second Enfer, qu’il devança l’assurance officielle et positive de sa grâce. Il eut donc l’imprudence de revenir secrètement à Lyon, pour imprimer ces différentes pièces, en même temps que la traduction française de deux dialogues: l’Axiochus[134] et l’Hipparchus, qu’il attribuait à Platon. Infortuné Dolet! un motif, d’une attraction plus puissante encore que tout cela, le ramenait malgré lui sur le sol d’une patrie marâtre; un motif respectable et touchant, à désarmer, si la chose eût été possible, [p. 236] l’horrible acharnement de ses bourreaux; en un mot, à trouver grâce devant l’enfer même, si, comme dit Virgile, l’enfer savait pardonner:
Il voulait revoir, embrasser encore une fois sa femme et son cher petit Claude; il avait hâte aussi de retrouver les enfants de sa plume, cette autre famille sur le sort de laquelle il n’était pas moins inquiet. C’est lui-même qui nous apprend toutes ces particularités intimes:
«Retournant dernièrement de Piedmont avec les bandes vieilles, dit-il au roy très-chrestien dans la dédicace en prose de son Second Enfer, pour avec ycelles me conduire au camp que vous dressez en Champaigne; l’affection et amour paternelle ne permist que, passant prez de Lyon, je ne misse tout hazard et danger en oubly, pour aller veoir mon petit fils et visiter ma famille. Estant là quatre ou cinq jours (pour le contentement de mon esprit) ce ne fut sans desployer mes thresors, et prendre garde s’il y avait rien de gasté ou perdu. Mes thresors sont non or ou argent, pierreries et telles choses caducques et de peu de durée, mais les efforts de mon esprit, tant en latin qu’en vostre langue françoyse; thresors de trop plus grand’conséquence que les richesses terriennes. Et pour ceste cause, je les ay en singulière recommandation. Car ce sont eulx qui me feront vivre aprez ma mort, et qui donneront tesmoignage que je n’ai vescu en ce monde comme personne ocieuse et inutile.»
[p. 237] Dolet n’eut pas longtemps à jouir des embrassements de sa femme, des caresses de son petit fils, de la société de ses vieulx livres et de la révision de ses chers manuscrits. A peine arrivé, nous le voyons déjà ressaisi par les soins de maistre Jacques Devaulx, messager ordinaire de Lyon, qui réclame, à ce propos, mille escuz d’indemnité, tant pour la fuyte industrieuse du dict Dolet, dont il avoit la charge, que pour l’avoir reprins et amené à grands frais, prisonnier en la Conciergerie du Palais, à Paris[135].
Le 4 novembre 1544, la Faculté de théologie étant assemblée, lecture fut faite, en sa présence, d’une proposition françoyse (propositio gallica), extraite d’un ouvrage de Platon, qu’ung certain Dolet (quidam Doletus) avait traduit de latin en français. Cette proposition était ainsi conçue: Après la mort, tu ne seras plus rien du tout. Elle fut jugée hérétique, et conforme à l’opinion des saducéens et des épicuriens. En conséquence, l’examen de ce livre fut commis à des «députés en matière de foi», deputatis in materia fidei... Pardon de ce latin catholique!
Voici le résultat de leur béate censure:
«Quant à ce dialogue mis en françoys, intitulé Acochius (les braves gens voulaient dire Axiochus), ce lieu et passage, c’est à sçavoir: Attendu que tu ne seras plus rien du tout, est mal traduict, et est contre l’intention de Platon, auquel n’y a, ni en grec, ni en latin, ces mots: Rien du tout[136].»
[p. 238] Le texte de Platon est ainsi conçu:
«Σωκράτης. Ὅτι περὶ μὲν τοὺς ζῶντας οὐκ ἔστιν, οἱ δὲ ἀποθανόντες οὐκ εἰσίν· ὥστε οὔτε περὶ σὲ νῦν ἐστίν, οὐ γὰρ τέθνηκας, οὔτε εἴ τι πάθοις, ἔσται περὶ σέ· ΣY ΓÀΡ ΟΥΚ ἜΣΕΙ.»
σὺ γὰρ οὐκ ἔσῃ.
Ce que Dolet traduisit de la manière suivante:
«Socrates. Pour ce qu’il est certain que la mort n’est point aux vivantz, et quant aux deffunctz, ilz ne sont plus: doncques la mort les attouche encores moins. Pour quoy elle ne peult rien sur toy, car tu n’es pas encores cy prest à deceder; et quand tu seras decedé, elle n’y pourra rien aussi, attendu que tu ne seras plus rien du tout.»
En supposant même qu’Estienne eût fait un contresens dans sa traduction, était-ce une raison suffisante pour brûler le traducteur? Le pensum me semble un peu sévère! Et que serait-ce donc, s’il n’y avait pas eu d’erreur? Tu enim non eris; telle est, littéralement, la version latine du passage de l’auteur grec. Lorsqu’il ajouta: Rien du tout, il est de la dernière évidence qu’au lieu d’altérer le sens du texte, Dolet ne fit que le développer, en lui donnant une extension qu’il comportait implicitement. L’habile humaniste connaissait beaucoup mieux la juste valeur des expressions, que les théologiens ignares qui se mêlaient de le juger... et de le condamner.
Trois monosyllabes: RIEN DU TOUT! Voilà pourtant ce qui a fait brûler un homme!... Oh! l’aimable époque, le bon vieux temps! Et que le sieur Louis Veuillot doit être bien venu, de prétendre nous y ramener!
Cette fois, pas un ami, pas un protecteur, si puissant qu’il fût, n’osa plus intercéder en faveur du [p. 239] malheureux Estienne; et le parlement de Paris porta contre la victime un arrêt définitif de condamnation, dont je vais transcrire l’article principal:
«La dicte Court a condamné le dict Dolet prisonnier, pour reparation des dicts cas, crimes et delicts, à plain contenuz au dict procès contre lui faict; à estre mené et conduict par l’executeur de la haulte justice en ung tumbereau, depuis les dictes prisons de la dicte Conciergerie du Palais, jusques en la place Maubert; où sera dressé et planté, en lieu plus commode et convenable, une potence; à l’entour de laquelle sera faict ung grand feu, auquel, après avoir esté soublevé en la dicte potence, son corps sera jecté et bruslé avec ses livres, et son corps mué et converty en cendres; et a declairé et declaire tous et chascun les biens du dict prisonnier acquis et confisquez au Roy... Et ordonne la dicte Cour, que, auparavant l’execution de mort du dict Dolet, IL SERA MIS EN TORTURE ET QUESTION EXTRAORDINAIRE pour enseigner ses compaignons[137].»
Entouré de ces cannibales du seizième siècle, que fait notre héroïque Dolet?... Il entonne son chant de mort... Écoutez:
Brave Estienne! Il tient parole, comme vous allez voir.


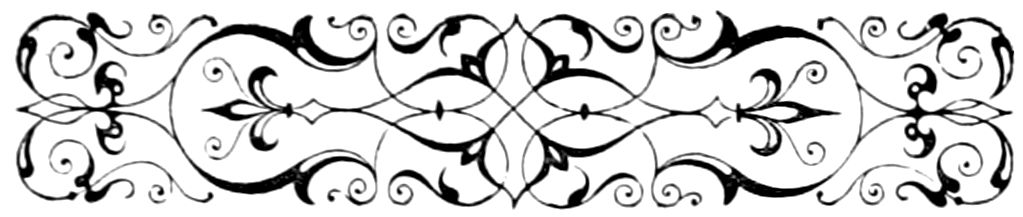
Supplice de Dolet.

Le 3 août 1546, le fatal tombereau le conduisit au supplice.
«Quand Dolet, dit à ce propos Jacques Severt dans son Anti-Martyrologe, sermocinoit près du brasier, il cuidoit d’abondant preschotter, et s’imaginoit que la populace circonstante lamentoit en regret de sa perte. Dont, pour toute prière, il profera ce vers latin:
«Non! ce n’est pas Dolet lui-même qui s’afflige, mais cette foule pieuse.»
«Sur quoy à l’instant, du contraire, luy fut sagement respondu par le lieutenant criminel, sis à cheval (dans le Patiniana, p. 38, par le docteur qui l’accompagnait pour le convertir):
«Non! ce n’est pas cette foule pieuse qui s’afflige, mais Dolet lui-même.»
[p. 246] Je ne sais, en vérité, pourquoi la plupart des biographes d’Estienne, qui cependant ne lui ont pas épargné les contes, ont si facilement révoqué en doute cette curieuse anecdote. Il est possible, je le veux bien, qu’on l’ait inventée après coup; il est possible, en un mot, qu’elle ne soit pas vraie: mais, à mon avis, elle est parfaitement vraisemblable; elle est tout à fait dans le goût de l’époque, dans le caractère français de tous les temps, et surtout dans celui de Dolet. Il n’y avait que lui pour trouver un calembour pareil en face du bûcher, comme il n’y avait qu’un lieutenant criminel pour lui répondre aussi sagement que le déclare maître Jacques Severt.
On s’est appuyé sur une lettre[138] écrite de Paris par un certain Florent Junius, le 23 août 1546, pour assurer qu’à son dernier moment, notre Estienne s’était repenti de ce qu’on appelle ses erreurs. Cette lettre porte, en effet, qu’après avoir terminé les apprêts du supplice, l’exécuteur avertit le patient de songer à son salut, et de se recommander à Dieu et aux saints. Comme Dolet ne se pressait guère, et qu’il continuait toujours à marmotter quelque chose, cet homme lui déclara qu’il avait ordre de lui parler de son salut devant tout le monde (plaisant directeur de conscience!). «Il faut, lui disait-il encore, que vous invoquiez la sainte Vierge et saint Estienne, votre patron, de qui l’on célèbre aujourd’hui la fête (on la célébrait d’une façon peu commune, il faut en [p. 247] convenir!); et si vous ne le faites pas, je vois bien ce que j’aurai à faire.»
Qu’est-ce donc que l’homme de la justice humaine avait à faire, dans le cas où la victime aurait refusé de se soumettre à ses injonctions? Un retentum qui suit l’arrêt, va nous l’apprendre. Ce retentum est ainsi conçu:
«Et neantmoins est retenu in mente Curiæ (dans l’intention de la Cour), que, où le dict Dolet fera aulcun scandale, ou dira aulcun blasphème, la langue luy sera coupée, et sera bruslé TOUT VIF[139].»
Voilà qui nous explique à merveille la prétendue conversion d’Estienne; il aura trouvé, sans doute, qu’il lui suffisait d’être simplement pendu, et de n’être brûlé du moins qu’après sa mort. Conformément au formulaire du bourreau confesseur, il récita donc en latin la courte prière que voici:
«Mi Deus, quem toties offendi, propitius esto; teque Virginem Matrem precor, divumque Stephanum, ut apud Dominum pro me peccatore intercedatis.»
«Mon Dieu, vous que j’ai tant offensé, soyez-moi propice; et vous aussi, Vierge Mère, je vous en conjure, ainsi que saint Estienne: intercédez là-haut pour moi, pauvre pécheur!»
Il avertit ensuite les assistants, toujours sans doute par crainte du retentum, et soufflé par le pieux bourreau, de lire ses livres avec beaucoup de circonspection, et protesta plus de trois fois qu’ils [p. 248] contenaient bien des choses qu’il n’avait jamais entendues[140].
Un instant après, il était, suivant la teneur de sa sentence, pendu d’abord et brûlé ensuite, sur cette place Maubert de sinistre mémoire[141].
Il avait alors, jour pour jour, trente-sept ans accomplis.
Ce drame épouvantable eut un profond retentissement dans le seizième siècle. Un poëte contemporain, qui malheureusement est resté anonyme, fit au pauvre Estienne l’épitaphe suivante, rapportée par le Laboureur:
Théodore de Bèze, à son tour, chanta dans une [p. 249] belle pièce d’hendécasyllabes latins l’apothéose de Dolet, son ancien ami. Suivant la coutume de l’époque, il fit usage d’une allégorie antique, empruntée à la mythologie païenne:
En voici la traduction, vers pour vers, en décasyllabes français:
C’était vraiment une magnifique idée, selon moi, que de comparer en ces termes l’Hercule de la pensée avec l’Hercule de la force; mais ce dernier me semble encore le moins admirable. L’Alcide moderne domptait des monstres bien plus dangereux: les préjugés! Il attaquait des tyrans bien plus terribles: l’ignorance et le despotisme!
Lui mort, on perd complètement la trace de son fils, Claude Dolet. «Ce jeune infortuné, dit avec émotion Née de la Rochelle (p. 63 et 64), excite la compassion et arrache des larmes. Victime innocente et plus à plaindre de la fureur des ennemis de Dolet, que devint-il après la mort de son malheureux père? Forcée par un préjugé qui existe encore, de cacher son malheur, sa mère lui chercha peut-être, loin de la ville qui le vit naître, un asile où ils pussent vivre ensemble, ignorés, tranquilles, et à couvert de la persécution des faux dévots et des défenseurs trop zélés de la religion catholique. Il est certain [p. 251] néanmoins que cet enfant, destiné à paroître avec éclat dans le monde littéraire, fut perdu pour lui, ou qu’il déroba tellement son nom à la curiosité du vulgaire, que personne n’a plus parlé de son existence, ni même de sa mort.»
Maittaire, le savant et laborieux auteur des Annales typographiques, termine en ces termes chaleureux, auxquels je m’associe de tout mon cœur, la notice pleine de conscience et de recherches qu’il a consacrée à notre Dolet:
«Jam tandem calamitosæ Stephani Doleti vitæ finem imposui: quo (si breve annorum spatium, magnam eruditionem, latinæ præsertim linguæ peritiam, operosos in re litteraria labores, crebras quas cum multis habuit concertationes, et plurima quæ a studiis animum subinde avocabant impedimenta, perpendamus) vix alius fuit fortunam magis aut secundam meritus, eut adversam expertus.»
«Enfin, j’arrive au bout de cette douloureuse carrière d’Estienne Dolet. Si l’on considère le court espace d’années qu’il a vécu, sa vaste érudition, son habileté, notamment dans la langue latine, ses pénibles travaux littéraires, ses fréquents démêlés avec une foule d’ennemis, en un mot, les mille obstacles qui, à chaque instant, détournaient son esprit de l’étude; peu d’hommes, on en conviendra, auront mérité plus de bonheur, et rencontré plus d’infortune!»
[138] V. Almeloveen (Amœnitates theologico-philologicæ, Amst., 1694), et Bayle (Dict. hist.), art. Dolet.
[139] Procès, p. 37.
[140] Florent Junius affirme qu’un homme qui assistait d’office à l’exécution, lui raconta toutes ces choses.
[141] De tout temps, en France, on s’est montré curieux des rapprochements dus au hasard. On a donc remarqué, à l’occasion du supplice de notre martyr, que la place Maubert était de la paroisse Saint-Etienne, que Dolet s’appelait Etienne, et qu’il fut brûlé le 3 août, jour de l’Invention de saint Etienne, son patron.
[142] Théodore de Bèze, qui avait fait imprimer cette pièce à Paris, en 1548, parmi le recueil des poésies latines de sa jeunesse (Juvenilia), la retrancha plus tard dans les éditions de 1567 et 1569, in-8o, et cela, dit-on, pour ne pas se mettre en mauvaise odeur auprès de ses coreligionnaires. La lâcheté humaine est de tous les temps!



Examen de ses opinions religieuses.

Longtemps on put appliquer à l’héroïque cicéronien ce qu’autrefois, par une sorte d’intuition personnelle et prophétique, il avait dit lui-même du malheureux Caturce, son devancier dans le martyre: «La flamme du bûcher a dévoré sa dépouille mortelle, mais celle de l’envie s’acharne encore après sa mémoire[143].» Catholiques et protestants, suivant la remarque de Maittaire[144], se déchaînèrent à l’envi contre l’infortuné Dolet; trouvant en cela, comme l’observe Bayle, un centre d’unité, les uns et les autres parurent enfin s’entendre pour le stigmatiser après sa mort du double surnom d’athée et de matérialiste. Déjà, au chapitre VI, p. 94 du présent ouvrage, nous avons entendu Scaliger soutenir [p. 254] bravement, dans sa généreuse invective contre un adversaire qui ne pouvait plus lui répondre, que cette souillure d’impiété avait sali jusqu’au feu de la place Maubert!... A l’occasion d’un poëme historique de notre Estienne, intitulé, comme nous l’avons vu précédemment, Francisci Valesii Fata (les Destins de François de Valois), un certain Binet (Binetus), composa les deux distiques suivants:
«Ce Dolet qui naguère nous a retracé les Destins de François Ier, n’a pas prévu, le malheureux! son propre destin; il aurait dû suivre la trace du Christ et ne pas vivre en athée, destiné à périr dans un foyer dévorant.»
André Frusius, autre plaisant en us de la même époque, s’avisa (p. 40 de ses Epigrammes) de jouer en ces termes sur le nom de la victime, rapproché du verbe latin dolere, souffrir... C’est une terrible chose, que l’esprit des savants:
«Hier encore, tu soutenais avec joie que l’âme devait périr; tu vois maintenant qu’elle est immortelle... O Dolet, quelle douleur!»
Je lis dans les Mémoires de Michel de Castelnau, publiés par J. le Laboureur (Paris, Pierre Lamy, 1660, 2 vol. in-fol.), t. 1, p. 355 et 356:
[p. 255] «Philibert Babou, dit de la Bourdaisière, cardinal, successivement evesque d’Engoulesme et d’Auxerre, parle ainsi de nos premiers huguenots, en deux lettres originales du 23 may et du 13 juin, lesquelles je croy estre de l’année 1562, et qu’il escrivit de Rome à Bernardin Bochetel, evesque de Rennes, ambassadeur du roy auprès de l’empereur:
«..... S’ils sont huguenaulx, je ne m’esbays pas s’ils sont traistres, pour n’avoir jamais veu un seul homme de bien de ceste nouvelle religion, et de très-meschants un monde; me souvenant avoir veu en ma jeunesse Dolet un des premiers, qui, commençant par assez légères opinions et de peu d’importance, tomba en peu de temps ès plus execrables blasphemes que j’ouys jamais...»
Voici maintenant l’opinion que Calvin prêtait à notre Estienne, au sujet de l’immortalité de l’âme. Elle se trouve à la page 78 de son livre de Scandalo (Genevæ, in officina Jo. Crispini, 1551, in-8o):
«Agrippam, Villanovanum (id est Servetum), Doletum et similes vulgo notum est tanquam Cyclopas quospiam Evangelium semper fastuose sprevisse. Tandem eo prolapsi sunt amentiæ et furoris, ut non modo in Filium Dei exsecrabiles blasphemias evomerent, sed quantum ad animœ vitam attinet, nihil a canibus et porcis putarent se differre.»
«C’est une chose vulgairement notoire qu’Agrippa, Servet, Dolet et consorts, ont toujours, nouveaux Cyclopes, outragé l’Evangile de leurs fastueux mépris. Ils ont même glissé si avant sur cette pente de folie furieuse, que, non contents de vomir contre le [p. 256] Fils de Dieu d’exécrables blasphèmes, ils ont, relativement à la vie de l’âme, déclaré qu’ils ne différaient en rien des chiens et des pourceaux.»
Enfin, un écrivain catholique cité par Bayle, Prateolus (Elench. Hœret.), parlant des athées, associe Estienne Dolet avec Diagoras, Evhémère, Théodore et autres philosophes que l’antiquité reconnaissait généralement pour avoir nié l’existence de Dieu.
Le bon Maittaire, avec cette loyale naïveté d’un savant qui n’a jamais vécu qu’avec les livres, cherche en vain à s’expliquer les motifs de cette odieuse imputation d’athéisme, lancée contre la mémoire de Dolet par l’animosité commune des protestants et des catholiques[145]. La fin de ce chapitre donnera, je l’espère, le mot probable d’une énigme qui ne laisse pas que d’être curieuse.
Je vais, à mon tour, essayer de résoudre cette question si longtemps controversée des opinions religieuses ou irréligieuses de Dolet. Elle se résume en deux chefs principaux, qu’il s’agit d’examiner successivement:
1o Était-il protestant?
2o Était-il athée?
Estienne se chargera lui-même de répondre à la première partie de l’accusation. A la page 55 de ses [p. 257] Harangues contre Toulouse, il proteste en ces termes de son orthodoxie catholique:
«Je vous prie donc et vous conjure d’être bien persuadés que, loin de suivre en quoi que ce soit cette inique et impie obstination des hérétiques, il n’y a rien de pire et qui soit plus haïssable et plus condamnable à mes yeux que ce désir des novateurs à la règle; la seule religion qui me plaise est celle qui nous a été apportée et transmise depuis tant de siècles par ces saints et pieux héros de notre croyance. Je ne saurais donc approuver en rien ces nouvelles opinions qui ne sont nullement nécessaires; je n’observe que celle dont nos pères ont jusqu’à ce jour pratiqué les rites.»
Et il termine ainsi son dialogue, De l’Imitation cicéronienne, contre Erasme et pour Christophe de Longueil:
«La méprisable curiosité des luthériens a porté une cruelle atteinte à la dignité de la religion; ces hérétiques ont fourni le prétexte de mépriser les choses les plus connues; en place des divines institutions qu’ils ont renversées, ils en ont introduit de purement humaines; ils ont aiguisé l’esprit des ignorants et des brutes.»
Ce fut sans doute pour corroborer de son mieux cette double profession de foi, qu’au nombre des pièces présentées par lui au concours des Jeux floraux, il inséra les deux odes suivantes en l’honneur de la Vierge, odes qu’il dédia plus tard à son ami Salmon Macrin, en les réimprimant dans son recueil de 1538:
«Bienveillant modérateur du Parnasse, m’abandonneras-tu, Phébus, moi ton poëte, à l’heure où je consacre à Marie, cette gloire du ciel, une sainte couronne de louanges?
«Et vous, divines sœurs, que l’ombre printanière de l’Hélicon protége contre les regards enflammés du soleil, souffrirez-vous, ô Muses, qu’en poursuivant un si grand but, j’aboutisse au ridicule?
«Assez longtemps vous avez aidé les poëtes à chanter les horribles tumultes de Mars, ou, par contre, à retracer les jeux de Vénus dans leurs vers efféminés.
«Qu’un plus grave sujet ressorte aujourd’hui de vos chants, et que votre lyre sonore élève jusqu’aux cieux l’honneur de Marie.
«Aux lieux où le soleil se lève dans son effrayante splendeur, aux lieux où il se plonge sous les flots de la mer occidentale, partout on adore Marie, partout on révère sa divine puissance.
«Aux bords du Rhin et de l’Ebre, comme aux [p. 261] plages que baignent les Palus-Méotides, on reconnaît, on célèbre à genoux son saint nom.
«A son moindre signe le firmament allume tous ses feux, la mer houleuse et folle comprime sa grande voix.
«Vierge féconde, elle a enfanté le Fils de Dieu, le guide éternel de notre salut; elle nous a ramenés tous des ténèbres de l’enfer à l’atmosphère de la vie.
«N’est-ce pas elle aussi qui retient loin de nous la fureur et les menaces du ciel haut-tonnant? elle qui détourne de nos têtes le souffle mortel du courroux divin?
«Cueillez donc, enfants, cueillez à pleines mains des fleurs dans la campagne qu’inonde le soleil, dépouillez la tige de l’hyacinthe, pour embellir les autels de la Vierge.
«Entrelacez en guirlandes de neige le lis et le troëne, mariez l’amarante à l’amome, pillez les herbes odorantes qui rappellent les vives senteurs de l’Arabie.
«Et quand, jonché de fleurs, le temple saint exhalera mille parfums, que cette prière commune vienne frapper l’oreille attentive de la Mère de Dieu:
«—O voie de bonheur et d’espérance ouverte aux pieux élans, soulagement infaillible des malheureux qui plient sous le fardeau de leurs fautes, repos toujours prêt, rade toujours sûre pour les vaisseaux qu’a fatigués la tempête!
«Par le fruit de ton chaste amour, par le nom de ton bienheureux Fils, par ce sein qui jadis allaita l’enfance d’un Dieu;
[p. 262] «Par ton nom, divine souveraine, par toi-même, Vierge compatissante à nos plaintes, exorable à nos prières, par les riantes pelouses que foulent tes pieds;
«Viens, Reine du ciel, viens à nous comme une vivante promesse de félicité; Vierge pieuse, accueille de ton plus doux sourire les vœux du peuple qui crie jusqu’à toi.
«Éloigne de nous la guerre et la peste; que la blonde Cérès soit vaincue en richesse par le dieu de la vigne, et que la vendange regorge sous nos pressoirs.
«Une prière encore; quand la cruelle Atropos aura coupé la trame de nos jours, que le haut Olympe nous ouvre ses portes, et que le saint porte-clefs nous admette dans l’immense palais des cieux.»
«Quel déficit de gloire pour les plus grands poëtes, s’ils ont le malheur de traiter en méchants vers un sujet insignifiant, sans pouvoir même venir à bout de cette besogne mesquine et vulgaire!
«En revanche, qu’il déchoit peu de sa réputation, celui qui chancelle en marchant vers un but trop élevé, et qui, trahi par ses forces, succombe sous une tâche impossible!
«Quand Virgile chante les infortunes de Priam, on pardonne volontiers à sa muse épique de s’affaisser parfois sur elle-même, et de s’avouer vaincue.
«On n’aime, on n’admire pas moins, dans l’Iliade, le génie d’Homère, pour tel ou tel obstacle que ce roi des poëtes n’a pu franchir.
«Et l’on refuserait de m’épargner le sarcasme, à moi qui, pour célébrer la Vierge, la Mère du Christ, ne trouve aucune ressource dans ma veine stérile; à moi dont un pareil sujet écrase l’impuissance!
[p. 264] «Elle, la Reine des cieux!... ni la célèbre Pallas, ni Apollon lui même, ni l’Hélicon tout entier avec le chœur des Muses, ne sauraient l’exalter dignement!»
Je ne voudrais pas, avec tout cela, donner mon héros pour meilleur catholique qu’il ne l’était en réalité; ce serait dépasser le but que je me propose d’atteindre. Dolet, comme beaucoup d’autres n’a pu manquer d’être séduit par cette douce et poétique figure de la Vierge, que le sec protestantisme n’a jamais voulu comprendre: mais en général il évite, autant que possible, de s’engager dans le labyrinthe des mystères; ce ferme et sévère esprit s’en tient, par une préférence instinctive, aux plus hautes généralités de la religion universelle; et quant à la partie explicite et spéciale du dogme adopté par l’Église romaine, il se garde bien, sous ce rapport, de formuler nettement sa pensée philosophique. Tout à l’heure, on verra pourquoi.
Passons au second chef d’accusation. Il se subdivise en deux autres, qui s’impliquent mutuellement; autrement dit, on a prétendu que Dolet avait nié:
1o L’immortalité de l’âme;
2o L’existence de Dieu.
J’avoue franchement qu’il a fourni lui-même plus d’un prétexte à la première de ces deux terribles imputations. On doit se rappeler, notamment, cette phrase un peu scabreuse, que j’ai déjà citée dans le courant de mon travail. (V. plus haut, ch. III, p. 59):
[p. 265] «Ne tremble pas devant l’aiguillon de la mort; elle te donnera le bonheur de ne plus rien sentir.»
Mais je l’ai dit et je le répète: un cri de douleur n’est pas une preuve, un blasphème n’est pas un aveu; c’est le mensonge déchirant arraché par la torture morale! En mainte autre circonstance, Dolet a proclamé hautement et dans les plus nobles termes le grand principe de l’immortalité de l’âme. Écoutons-le, par exemple, dans sa réponse aux lâches personnalités de l’Italien Sabinus, qui, lui aussi, l’avait accusé de matérialisme, à propos d’une question purement littéraire:
«Ausus es graviorem aliam notam nobis inurere, Italis propriam, Gallis incognitam: sane de animæ mortalitate sensum... Animam, inquis, corpori superstitem non credit Doletus... At quis meus inter omnes sermo, nisi pius, nisi castus, nisi Dei honore plenus? Quod meum exstat scriptum, quod vel tenuissimam impietatis (impietatem voco de animæ interitu opinionem) bono alicui suspicionem concitet? Et vita quam degimus, non plane christiana?...»
«Tu as eu l’audace de m’imprimer un autre stigmate encore plus honteux, un stigmate inhérent aux Italiens, mais inconnu des Français, le sentiment de la mortalité de l’âme... Dolet, dis-tu, ne croit pas que l’âme survive au corps... Mais quel est mon langage, au su de tout le monde, sinon pieux, chaste et plein de respect pour la Divinité? Existe-t-il un seul écrit de ma main, qui puisse faire naître chez les bons esprits le plus léger soupçon d’impiété (j’appelle impiété l’opinion qui suppose la mort de [p. 266] l’âme)? Ma vie, enfin, n’est-elle pas absolument chrétienne?...»
Dans son Genethliacum Claudii Doleti, traduit, comme nous l’avons vu, par son ami Cottereau, sous le titre d’Avant-Naissance de Claude Dolet, voici de quelle manière il s’exprime, relativement à cette grave question de l’âme, en s’adressant à son fils au berceau; je me sers à la fois du texte latin et de la traduction, ou plutôt de la paraphrase française:
[p. 267] On remarquera sans doute que, sur la fin de cette tirade, le traducteur paraphraste ajoute à la pensée de son auteur, en parlant du mystère de la Rédemption dont celui-ci ne dit pas un mot; car, ainsi que j’en ai déjà fait l’observation, c’est un parti pris chez Estienne de se renfermer dans l’expression générale du sentiment religieux, sans jamais se déclarer positivement pour tel ou tel article formel du dogme catholique.
Abordons, à présent, l’accusation d’athéisme.
Depuis dix ans que je m’occupe de Dolet, je crois avoir lu avec une certaine attention à peu près tout ce qui est sorti de sa plume. Eh bien! je l’affirme sans crainte: je n’ai pas trouvé chez cet homme si indignement traqué par la calomnie contemporaine, une phrase, un mot, qui, même avec l’interprétation la plus malveillante, puisse faire croire qu’il ait nié, ou simplement mis en doute l’existence de Dieu. Bien au contraire, j’ai rencontré çà et là dans ses livres une foule de passages d’où jaillissent, pour ainsi dire, les plus vifs élans vers la toute-puissance et la toute-bonté divines.
C’est ainsi qu’à la page 1328 du second volume de ses Commentaires, il adresse aux Dieux la prière suivante, pour détourner de sa tête un fléau depuis longtemps prévu, celui de la justice humaine:
«Superi, rerum omnium præpotentes Superi, hanc mihi unam, hanc unam largimini felicitatem, ut mea nunquam existimatio, mea nunquam salus, mea nunquam vita (fortunæ bona, ut caduca et inania, curis vestris digna non censeo, neque vos pro iis prece [p. 268] ulla velim obtundere) ex judicum pendeat sententiis. Bonis omnibus abundasse, felicitate omni cumulatus, voluptate omni in vita colliquisse mihi sane quidem videbor, si hoc precibus a vobis assequor. Quod ut assequar, tanto vos opere flagito, quam ingenue ex animoque omnia vobis accepta refero, quam studiose vestra suspicio numina, quam vestram in omni re intueor et admiror potentiam.»
«Grands Dieux, souverains ordonnateurs de toutes choses, accordez-moi ce bonheur, cette unique félicité. Je ne vous parle pas des biens de la fortune: caduques et vides, je les crois indignes de vos soins, et ce n’est pas pour eux que je voudrais vous importuner de la moindre prière. Mais faites que mon honneur, mon salut, ma vie, ne dépendent jamais d’une sentence de juge. Ah! certes, si j’obtiens de vous l’accomplissement de mes vœux à cet égard, ce sera la plus riche abondance, la jouissance la plus vive, la plus entière volupté de mes jours. Cette faveur, je vous la demande avec autant d’instance, que je mets de franchise et de cœur à vous rapporter tout, de zèle à reconnaître vos suprêmes volontés, d’admiration à contempler en tout et partout votre éternelle puissance!»
Le croirait-on? Ses ennemis l’accusèrent de paganisme, pour avoir, dans cette prière, remplacé Dieu par les Dieux. Ils appelèrent hérésie ce qui n’était qu’une élégance latine, une tournure cicéronienne. Personne n’aurait dû s’y tromper; mais la haine voit trouble en plein midi.
Ailleurs, dans le Genethliacum déjà cité, Dolet [p. 269] recommande en ces termes, à son jeune fils, la croyance en Dieu, comme la plus sûre et la plus salutaire de toutes:
Ce que l’Avant-Naissance reproduit ainsi:
J’en viens, maintenant, à la question que s’est posée Maittaire, sans pouvoir ou sans vouloir la résoudre. Pourquoi les catholiques et les protestants du seizième siècle ont-ils, d’une voix presque unanime, taxé Dolet d’athéisme?
Je m’explique facilement cette imputation haineuse, de la part des premiers. Ce qu’ils détestaient dans le pauvre Estienne, ce n’était pas, au fond, le traducteur prétendu athée de l’Axiochus (l’accusation d’athéisme ne fut alors qu’un prétexte sournoisement saisi); c’était l’homme qui osait proclamer, avec suffisante probation des docteurs de l’Eglise, la nécessité de traduire les Sainctes Lettres en langue vulgaire, et mesmement en la françoyse; l’homme qui essayait d’introduire dans le sanctuaire, jusqu’alors fermé aux profanes, l’esprit d’indépendance et d’examen; l’homme qui prétendait donner à l’autorité de la parole divine la sanction de la liberté humaine; [p. 270] l’homme, enfin, qui voulait que l’on pût dire: Je pense! avant de s’écrier: Je crois!
Mais alors, objectera-t-on peut-être, Dolet devait avoir pour lui toutes les sympathies du protestantisme. Pourquoi donc, à l’exemple des catholiques, les luthériens et les calvinistes de l’époque ont-ils déployé tant d’acharnement contre lui?
C’est qu’avant tout, Estienne Dolet l’humaniste, Estienne Dolet le cicéronien, était un homme de l’antiquité, un esprit logique et sincère. Profondément hostile aux tendances moyen âge de l’Église catholique, il n’éprouvait pas une moins grande répugnance pour cette réforme qui, au bout du compte, n’en était pas une. Ce n’était pas vers Luther ou Calvin qu’il marchait; c’était ailleurs, bien plus loin, du côté de Voltaire. A quoi bon, en effet, s’arrêter à moitié de la route? Aïeul intellectuel des vrais réformateurs, des francs révoltés du dix-huitième siècle, Dolet avait raison deux siècles trop tôt. Contemporain de Diderot,
mais, à coup sûr, il ne serait pas mort sur le bûcher de la place Maubert.
En un mot, et Maittaire l’avoue lui-même[148], à [p. 271] une époque où le christianisme se fractionnait en tant de sectes divergentes qui se brûlaient et se damnaient mutuellement, notre Estienne, également antipathique à Rome et à Genève, ne voyant que tyrannie et corruption d’un côté, qu’ambition et hypocrisie de l’autre, que fanatisme atroce des deux parts, aima mieux, je l’ai déjà dit, s’en tenir aux vérités générales et inattaquables, que de prendre lâchement parti pour telle ou telle faction religieuse. Ce n’était donc ni un protestant, ni un catholique, encore moins un athée; c’était,—et, quoi qu’en puissent dire certaines gens, le titre est glorieux pour tout homme qui veut être vraiment homme,—c’était un LIBRE PENSEUR.
[143] V. plus haut, ch. III, p. 45.
[144] «Male apud multos cum papistas tum protestantes, quoad suam de religiosis rebus opinionem, audit Doletus.» (Vol. cité, p. 101.)
«Auprès de beaucoup, papistes ou protestants, une mauvaise réputation s’attache à Dolet, relativement à ses opinions en matière religieuse.»
[145] «Nec satis adhuc potui comperire, quid in causa fuerit, ut sinistram hanc famam consequeretur.» (Vol. cité, p. 101.)
«Je n’ai pas encore pu me rendre compte du motif qui lui a valu cette sinistre réputation.»
[146] Carm., III, 34.
[147] Carm., III, 35.
[148] «Quum autem tunc maxime temporis id accidisset infortunii per nimiam perversorum hominum aut superstitionem aut licentiam, ut religio misere in varias sectas scinderetur, maluit intra generaliores terminos se tutum continere, quam ad quas potius partes accederet, disertis verbis enuntiare.»
«A cette époque malheureuse et perverse, la superstition d’un côté, la licence de l’autre, avaient introduit dans la religion la déplorable anarchie des sectes. Dolet crut voir plus de sûreté à se maintenir dans les termes généraux, qu’à s’enrôler hautement dans un parti ou dans l’autre.»



Conclusion.

Pour toute âme libre, pour tout cœur viril qui se sent battre aux grandes choses, c’est une imposante et profonde allégorie, dans l’austère symbolisme des vieux Hellènes, que ce beau dogme du Titan Prométhée.
Qu’y voyons-nous? Nous y voyons, à l’aurore des temps, l’intelligence en lutte avec la tyrannie brutale. Celle-ci, furieuse de ne pouvoir anéantir l’immortelle réfractaire, l’enchaîne, la brise, la torture à plaisir.
Nous y voyons la lumière aux prises avec les ténèbres, le feu créateur et victorieux domptant et animant la matière inerte.
En un mot, l’avenir contre le passé; la force du droit contre le droit de la force; la liberté vivifiante contre le despotisme qui tue!
Bravant l’ire et la foudre de Jupiter l’usurpateur, l’audacieux enfant de la sage Thémis dérobe un jour à sa source primitive, en faveur des pauvres mortels qu’il aime d’un amour de père, le feu, le feu céleste, principe de la vie, âme de l’âme!
[p. 274] Mais Jupiter est là! Jupiter n’entend pas qu’on le précipite ainsi du sommet de sa toute-puissance héréditaire: il s’y trouve trop bien. Cette lumière expansive et pénétrante, qui menace d’envahir les ténèbres dont il s’entoure, de percer l’auguste nuit, sanctuaire de son inviolable majesté; ce feu sacré que le Prométhée du progrès et de la science voudrait faire circuler dans les veines du pauvre peuple, il n’en veut pas, lui, car ce serait la fin de son règne!
Et la lutte s’engage. D’un côté, la science, la justice, la liberté, l’avenir!... de l’autre, l’ignorance, l’iniquité, l’esclavage, le passé!...
Prométhée contre Jupiter!... voilà toute la vie d’Estienne Dolet.
Avant d’abandonner ce long travail où j’ai mis toutes mes études et toute mon âme, résumons en quelques lignes les traits saillants, les principaux caractères de la grande figure que je viens d’esquisser.
Comme on l’a vu, de 1533 à 1544, Estienne Dolet fut emprisonné CINQ FOIS; en outre, d’un bout à l’autre de sa brève et douloureuse existence, il fut assailli de persécutions et d’avanies, harcelé de haines sans trêve et de ressentiments sans pardon.
Eh bien! tant d’affreux dérangements ne l’empêchèrent pas, cet HOMME!... d’être à la fois orateur, philosophe, historien, commentateur, poëte et artiste.
Si dans sa courte carrière il fut parfois coupable, en revanche, il fut presque toujours malheureux... [p. 275] et le malheur est comme le repentir... c’est un baptême expiatoire, un lavacrum providentiel qui efface bien des fautes.
Oh! oui, noble et sainte victime! bien loin que ton supplice ait souillé la flamme, suivant l’infâme expression de Scaliger... cette flamme purificatrice a dévoré toutes les souillures de ta vie mortelle, enlevé toutes les taches de ton humanité caduque... et maintenant elle environne à jamais ton front du nimbe des vrais élus, de l’auréole des vrais martyrs!
Ta mort, aux yeux du vulgaire, fut sans doute bien cruelle. Mais il ne sait pas, ce lâche vulgaire, il ne saura jamais combien il est doux aux grands hommes de mourir pour une conviction. Ils ont tous la consolation suprême qu’après eux leur idée ne sera pas perdue; ils savent d’avance qu’elle germera dans le monde, et que, tôt ou tard, elle produira ses fleurs et ses fruits; ils savent, enfin, que l’erreur tombe et que la vérité se lève, que les tyrans passent et que la liberté demeure!



1509.—3 Août (?).—Estienne Dolet naît à Orléans.
1521.—Sa famille l’envoie à Paris, pour y achever son éducation.
1525.—Il suit, dans cette même ville, le cours d’éloquence latine de Nicolas Bérauld.
1526.—Son départ pour l’Italie. Il étudie à Padoue, sous Simon de Villeneuve.
1530.—Villeneuve étant mort cette année, Dolet lui compose une épitaphe et la fait graver sur une table de bronze. Il s’attache à Jean du Bellay-Langey, ambassadeur de France à Venise, et suit pendant un an, dans cette dernière ville, les leçons d’Egnatius. Ses amours avec [p. 278] Eléna la Vénitienne. Retour en France. Il commence à recueillir les matériaux de ses Commentaires sur la langue latine.
1531.—Dolet se rend à Toulouse, pour y étudier le droit.
1532.—Il concourt aux Jeux floraux.
9 Octobre.—Il prononce en public son premier discours contre Toulouse.
1533.—25 Mars.—Il est arrêté et conduit dans les prisons de Toulouse, par ordre du juge-mage Dampmartin. Quelques jours après, il est relâché par le crédit de Jacques de Minut, premier président du parlement de Toulouse, et à la sollicitation de Jean Dupin, évêque de Rieux. On promène dans les rues de Toulouse un cochon revêtu d’un écriteau portant le nom de Dolet.
Arrêt du parlement de Toulouse, qui expulse Dolet. Il arrive à Lyon, le 1er août 1533. Visite à l’imprimeur Sébastien Gryphius. Publication des deux harangues contre Toulouse.
1534.—Dolet quitte Lyon, et se rend à Paris, où il arrive le 15 octobre. Il compose son dialogue latin: De l’Imitation cicéronienne, publié l’année suivante chez Gryphius, in-4o.
1535.—Il obtient, mais avec peine, le privilége pour l’impression de ses Commentaires.
1536.—Il confie ce travail à Sébastien Gryphius, et [p. 279] retourne à Lyon pour corriger lui-même ses épreuves. Publication du tome Ier.
31 Décembre.—Un peintre, nommé Compaing, ayant voulu assassiner Dolet, succombe victime de son propre guet-apens.
1537.—Dolet s’enfuit de Lyon aussitôt après cette malheureuse aventure. Il s’embarque sur l’Allier, et voyage ainsi par eau jusqu’à Orléans, où il prend un cheval pour aller jusqu’à Paris. Le roi lui fait grâce. A cette occasion, les amis de Dolet l’invitent à un repas de réjouissance. Les principaux convives, avec Dolet, sont: Budé, Bérauld, Pierre Danès, Tusanus (Toussaint), Salmon Macrin (l’Horace français), Nicolas Bourbon, Dampierre, Voulté, Marot et Rabelais. Le lendemain de ce repas, Dolet repart pour Lyon.
La même année, il obtient de François Ier un privilége de dix ans pour imprimer ou faire imprimer tant les ouvrages de sa composition que ceux des auteurs anciens et modernes.
1538.—Publication du tome II des Commentaires sur la langue latine. Mariage de Dolet. Il organise ses presses et tient boutique de librairie, suivant son expression naïve.
Dolet fait paraître le Cato christianus, premier livre qu’il ait imprimé.
Bientôt après, il publie le recueil complet de ses poésies latines.
1539.—Naissance de Claude Dolet, fils d’Estienne [p. 280] Dolet. L’enfant est tenu sur les fonts par Claude Cottereau. A cette occasion, Dolet imprime, en latin et en français, un poëme pour célébrer la naissance de son fils.
1542.—Sentence rendue, le 2 octobre, par l’inquisiteur Matthieu Orry et l’official Estienne Faye, par laquelle Dolet est déclaré hérétique, et, comme tel, abandonné au bras séculier.
1543.—Dolet, après quinze mois de prison, est mis en liberté par l’intercession de Pierre du Chastel, évêque de Tulle.
14 Février.—Arrêt du parlement de Paris, qui condamne à être brûlés, au parvis Notre-Dame, treize ouvrages imprimés par Dolet, et dont plusieurs étaient de sa composition.
1544.—5 ou 6 Janvier.—Dolet est arrêté de nouveau à Lyon, au moment de célébrer la fête des Rois.
7 ou 8 Janvier.—Il s’échappe de prison et se réfugie en Piémont.
1er Mai.—Publication du Second Enfer. Dolet était revenu secrètement à Lyon pour imprimer cet ouvrage. Il imprime en même temps sa traduction française de l’Axiochus et de l’Hipparchus, cause occasionnelle de sa mort.
1544.—Dolet est arrêté par Jacques Devaux, qui le conduit à Paris et le dépose à la Conciergerie.
4 Novembre.—Une commission est chargée par la Faculté de théologie d’examiner un [p. 281] passage de l’Axiochus de Dolet. Le passage est déclaré mal traduit. Dolet est abandonné au bras séculier, comme athée relaps.
1546.—Dolet compose son dernier ouvrage, le Cantique d’Estienne Dolet, prisonnier en la Conciergerie de Paris, l’an 1546, sur sa désolation et sa consolation.
2 Août.—Arrêt du parlement, qui condamne Dolet à être pendu et brûlé en place Maubert.
3 Août.—Supplice de Dolet.




Ie vais établir, pour plus de clarté, quatre subdivisions dans cette partie importante de mon travail:
La première contiendra les ouvrages de Dolet publiés avant son établissement comme imprimeur;
La seconde renfermera tous les livres de sa composition sortis de ses presses;
La troisième embrassera les différentes publications dont il n’a été que l’éditeur;
La quatrième, enfin, fera connaître les réimpressions de ses ouvrages, exécutées par d’autres libraires.
Orationes duæ in Tholosam; epistolarum libri duo; carminum libri duo; epistolarum amicorum liber (cum præfatione et argumento in primam orationem Symonis [p. 284] Finetii). Lugduni, apud Gryphium (circa 1533), in-8o de 4 feuillets préliminaires, 246 pages, et 1 feuillet pour la fin de l’errata.
Stephani Doleti dialogus de Imitatione ciceroniana, adversus Desiderium Erasmum Roterodamum, pro Christophoro Longolio. Lugduni, apud Seb. Gryphium, M D XXXV, in-4o de 200 pages.
La préface, datée de Paris, quinto idus novembris, 1534, est adressée à Guillaume de Scève. L’ouvrage entier est dédié Ad Joannem Langiacum Episcopum Lemovicensem, etc. C’est un dialogue, dont les interlocuteurs sont Simon de Villeneuve et Thomas Morus. A la page 8, Dolet insère cet avis au lecteur:
«Ne hoc nescias, Lector, omnia pene quæ Morus disputat et loquitur ex Ciceroniano Erasmi dialogo assumpta sunt. Cujus te rei certiorem facere visum est, ne Doletum sui dissimilem, id est, stylo modo inflatiore, modo flaccido esse putes. Vale.»
Stephani Doleti De Re navali Liber, ad Lazarum Bayfium. Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1537, in-4o de 192 pages, plus 28 pages liminaires.
Commentariorum linguæ latinæ tomi duo. Lugduni, apud Gryphium, 1536-38, 2 volumes grand in-fo, caractères ital.
Cet ouvrage, dont on ne trouve que très-difficilement des exemplaires bien conservés, offre les particularités suivantes:
Le premier volume contient 28 feuillets préliminaires, et 854 pages ou 1708 colonnes, suivis d’un frontispice, au verso duquel est le gryphon ailé, emblème de l’imprimeur Gryphius.
Le deuxième volume renferme 858 pages ou 1716 colonnes, précédées de 32 feuillets préliminaires, et suivies d’un frontispice séparé, au recto duquel est un avis au sujet du troisième volume projeté.
Ces Commentaires sur la langue latine sont dédiés à François Ier et à Guillaume Budé, auteur lui-même d’un ouvrage analogue sur la langue grecque, où Dolet me semble avoir puisé l’idée première de son travail. Les titres sont décorés d’un beau cadre gravé sur bois, dont j’ai donné plus haut la description. (V. à la p. 108.)
Cato christianus, id est, Decalogi expositio, etc. Lugduni, apud Steph. Doletum, 1538, in-8o de 38 pages.
Petit livre fort rare. C’est une réponse au cardinal Sadolet, qui reprochait à l’auteur de ne jamais parler de religion dans ses livres (v. ci-dessus, p. 153). On lit à la fin: Odæ de laudibus Virginis Mariæ.
Stephani Doleti Galli Aurelii Carminum libri quatuor. Lugduni, anno M D XXXVIII, in-4o de 175 pages, y compris 6 feuillets préliminaires, caractères italiques. Sur le titre, l’emblème de l’auteur.
Au verso de la 175e page et sur les 2 feuillets suivants, se lisent des vers latins et grecs adressés à Dolet par ses amis.
Formulæ latinarum locutionum illustrium, in tres partes divisæ. Lugduni, Steph. Doletus, 1539, petit in-fo.
Des trois parties annoncées au titre de cet ouvrage, celle ci seulement a été mise au jour; elle est devenue fort rare.
Genethliacum Claudii Doleti, Stephani Doleti filii. Liber vitæ communi in primis utilis et necessarius, authore patre. Lugduni, apud eundem Doletum, 1539, in-4o de 12 feuilles. Il y a 3 feuillets préliminaires.
L’Avant-Naissance de Claude Dolet, filz de Estienne Dolet, premierement composee en latin par le pere, et maintenant par ung sien amy traduicte en langue françoyse; œuvre très utile et necessaire à la vie commune, contenant comme [p. 286] l’homme se doibt gouverner en ce monde (avec les dixains et huictains de Claudin de Touraine). Lyon, chés Est. Dolet, 1539, in-4o de 32 pages, y compris 3 feuillets préliminaires.
Francisci Valesii Gallorum regis Fata; ubi rem omnem celebriorem a Gallis gestam nosces, ab anno Christi M D XIII usque ad annum ineuntem M D XXXIX: Stephano Doleto Gallo Aurelio autore. Lugduni, anno M D XXXIX; in-4o de 79 pages, y compris 4 feuillets préliminaires, caractères italiques. Au verso du dernier feuillet, l’emblème de Dolet.
Les Gestes de Françoys de Valois, roy de France; dedans lequel œuvre on peult congnoistre tout ce qui a esté faict par les Françoys, depuis l’an mil cinq cent treize jusques en l’an mil cinq cent trente-neuf: premièrement composé en latin par Estienne Dolet, et après par luy mesmes translaté en langue françoyse. A Lyon, chés Estienne Dolet, M D XL; in-4o de 78 pages, y compris feuillets préliminaires, plus, à la fin, 1 feuillet contenant sur le recto un avis au lecteur, et au verso l’emblème de Dolet. Lettres rondes.
Les mêmes (comme ci-dessus, mais continués jusqu’en l’an 1543). A Lyon, chés Estienne Dolet, 1543; in-8o de 94 pages, y compris 5 feuillets préliminaires. A la fin l’avis au lecteur, avec l’emblème. Lettres rondes.
Stephani Doleti Galli Aurelii liber de Imitatione ciceroniana, adversus Floridum Sabinum. Lugduni, apud eundem Doletum, 1540; in-4o de 56 pages.
La dernière ne renferme que l’emblème de Dolet, la doloire, et au-dessous:
DOLETVS.
Durior est spectatæ virtutis,
quam incognitæ,
conditio.
La préface, datée de Lyon, cal. d’oct., 1540, est adressée à Guillaume Bigot.
[p. 287]Observationes in Terentii Andriam et Eunuchum. Lugduni, apud Doletum, 1540 et 1543, in-8o.
La Maniere de bien traduire d’une langue en aultre; de la Punctuation françoyse; des Accentz d’ycelle (sans lieu ni date), 1540; in-8o de 20 feuillets.
Cette édition, où l’on a conservé les deux dédicaces de Dolet, datées de Lyon, dernier may 1540, doit être une réimpression de celle de Lyon, 1540, in-4o.
On cite des éditions du même opuscule, imprimées à Lyon, chez Dolet, en 1541, 1542, 1543, etc.
Ce traité de la Manière de bien traduire est le premier qui ait paru en France sur cette matière.
De Officio legati, de Immunitate legatorum, et de Joannis Lemovicensis episcopi legationibus. Lyon, Dolet, 1541, in-4o.
Exhortation à la lecture des sainctes Lettres: avec suffisante probation des docteurs de l’Eglise, qu’il est licite et nécessaire ycelles estre translatees en langue vulgaire, et mesmement en la françoyse. Lyon, Estienne Dolet, 1542; in-16 de 126 pages, plus 1 feuillet pour la souscription et l’emblème de Dolet.
Ouvrage rare, dont il n’a peut-être été que l’éditeur.
Le Manuel du chevalier chrestien, traduict du latin d’Erasme. Lyon, Dolet, 1542, in-16.
V. du Verdier et la Caille. Cette traduction est attribuée à Dolet.
Le Vray Moyen de bien et catholicquement se confesser; opuscule faict premierement en latin par Erasme. Lyon, Dolet, 1542, in-16.
V. du Verdier et la Caille. Autre traduction attribuée à Dolet.
[p. 288]La paraphrase de Campensis sur les Psalmes de David et Ecclesiaste de Salomon (traduit et imprimé par Dolet), 1542, in-8o.
V. du Verdier.
Cantica canticorum en français (sans date).
V. Lelong (Bibl. Sacr. Édit., Lips., 1709, t. 2, p. 111.)
Les Epistres familiaires de Marc Tulle Cicero, père d’eloquence latine, nouvellement traduictes de latin en françoys, par Estienne Dolet, natif d’Orléans. A Lyon, chés Estienne Dolet, 1542; in-8o de 208 feuillets. Sur le verso du dernier, la doloire, et au bas, ces mots:
DOLET.
Preserve-moy, ô Seigneur,
des calumnies
des hommes.
Brief discours de la republicque françoyse desirant la lecture des livres de la saincte Escripture luy estre loysible en sa langue vulgaire... Lyon, Dolet, 1544, in-16.
A la suite de ce petit ouvrage en vers, Dolet a réimprimé l’Exhortation à la lecture des sainctes Lettres.
Ce Brief discours devait avoir paru en 1542, puisqu’il est porté dans le catalogue des livres qui ont été censurés en cette année-là. Il fut brûlé, avec le traité en prose sur le même sujet, à la requête de la Faculté de théologie, quinze ans après la mort de Dolet.
Le Second Enfer d’Estienne Dolet, natif d’Orléans, qui sont certaines compositions faictes par luy mesmes, sur la justification de son second emprisonnement. Lyon, Dolet, 1544, in-16 ou petit in-8o.
Deux dialogues de Platon, l’ung intitulé Axiochus, qui est des misères de la vie humaine, de l’immortalité de [p. 289] l’ame, etc.; et l’aultre, Hypparchus, qui est de la convoitise de l’homme touchant la lucrative, traduictz par Estienne Dolet. Lyon, Dolet, 1544, in-16.
L’Axiochus a été attribué à Platon; mais il a aussi été imprimé (à la suite du Jamblicus, édit. d’Alde, 1497, et dans d’autres recueils) sous le nom de Xénocrate; on le trouve encore imprimé avec les dialogues d’Eschine le socratique.
On a vu précédemment, au chap. XV du présent ouvrage, p. 237, que la manière dont Dolet traduisit l’un des passages de l’Axiochus fut la principale cause de sa mort.
Cantique d’Estienne Dolet, prisonnier à la Conciergerie de Paris, sur sa desolation et sur sa consolation. Dolet. Imp. l’an M D XLVI.
Édition excessivement rare, communiquée par Guillaume Debure à Née de la Rochelle, qui la reproduisit, comme nous le verrons plus loin, dans sa Vie de Dolet.
Claudii Cotteræi Turonensis, De jure et privilegiis militum libri tres; et de Officio imperatoris liber unus. Lugduni, apud Stephanum Doletum, 1539, in-fo. Caractères ronds.
On voit en tête de ce volume une lettre de Dolet, et une pièce de vers, adressées toutes deux au cardinal Jean du Bellay; plus, une autre lettre, adressée à l’auteur.
La Chirurgie de Paulus Ægineta, autheur grec, qui est le sixiesme livre de ses Œuvres; avec ung Opuscule de Galien, des Tumeurs, oultre le Coustumier de Nature; plus ung aultre Opuscule dudict Galien, de la Maniere de curer par [p. 290] abstraction de sang et par sangsues, revulsion, cornettes et scarifications; traduictz par Pierre Tolet. Lyon, par Estienne Dolet, 1540.
V. la Croix du Maine et du Verdier, art. Pierre Tolet. Aucun d’eux n’a indiqué le format de ce livre.
Novum Testamentum, latine. Lyon, par Est. Dolet, 1541, in-16.
Dominicæ Precationis explanatio. Lyon, par Est. Dolet, 1541, in-16. Caractères italiques et ronds par intervalles.
Ce volume contient, outre ce qui est annoncé dans le titre:
C. Suetonii XII Cæsares, ad veterum codicum spectatam atque probatam fidem, summa virorum multorum doctissim. diligentia recogniti. Lyon, par Est. Dolet, 1541, in-8o. Caractères italiques.
Édition rare, présentant un texte correct et les notes d’Erasme et de J. Raynerius. Elle a été faite d’après celle de Gryphius, 1537, in-8o.
Laurentii Vallæ Elegantiæ latinæ linguæ. Lyon, par Est. Dolet, 1541, in-8o.
Gentiani Herveti Orationes tres, de patientia, de vitando otio, de grati animi virtute; Item ab eo trad. e græco D. Basilii sermones adversus irascentes, de invidia; et ab eodem versa e græco Sophoclis Antigone; et Herveti ejusdem Epigrammata aliquot. Lyon, par Est. Dolet, 1541, in-16.
[p. 291] Pandora Jani Oliverii Andium hierophantæ (Carmen). Lyon, par Est. Dolet, 1541, in-4o. Caractères italiques.
Dolet a dédié ce volume, qui est très-bien imprimé, à François Olivier, chancelier de France et oncle de Jean. La dédicace est datée de Lyon, calendis martiis, anno a salute mortalibus 1541.
Ce poëme de Jean Olivier, évêque d’Angers, a été traduit en vers français par Guillaume Michel, dit de Tours, Paris, les Angeliers, 1542, in-8o; et par Pierre Boucher, Poictiers, 1548, in-4o. Ces deux traductions sont rares, et la dernière surtout. L’auteur du poëme suppose que les femmes sont la boîte de Pandore, d’où sont sortis tous les maux de ce monde.
Les Epistres et Evangiles des cinquante et deux dimanches de l’an, avec briefves et très utiles expositions d’ycelles. Lyon, chés Est. Dolet, 1542, in-16 de 665 pages.
Ce volume renferme les cinquante-deux dimanches, d’après la traduction qu’en avait donnée le Fèvre d’Estaples. L’Epistre au lecteur chrestien qu’on lit au deuxième fol. est de Dolet.
Discours contenant le seul et vray moyen par lequel ung serviteur favorisé et constitué au service d’ung prince, peult conserver sa felicité eternelle et temporelle, et eviter les choses qui luy pourroyent l’une ou l’aultre faire perdre. Lyon, Est. Dolet, 1542, petit in-8o de 31 pages, y compris 3 feuillets préliminaires.
C’est un petit ouvrage anonyme, avec une dédicace à M. de l’Estrange, par Dolet, où ce dernier déclare qu’il n’est point l’auteur du discours.
Guillelmus Paradinus, de antiquo statu Burgundiæ. Lyon, Est. Dolet, 1542, in-4o.
De Moribus in mensa servandis, Joan. Sulpitii Verulani libellus, cum elucidatione gallico-latina Gul. Durandi. Lyon, Est. Dolet, 1542, in-8o.
Cet ouvrage est dédié à Dolet par l’éditeur, qui lui dit que ses [p. 292] caractères ont par-dessus tous les autres une beauté particulière, capable de donner de l’importance à des bagatelles, ce qui leur procure de la considération auprès des savants. Il le complimente encore sur le choix des livres qu’il imprimait.
La plaisante et joyeuse Histoyre du grant Gargantua, prochainement reveue et de beaucoup augmentee par l’autheur mesme. Pantagruel, roy des Dipsodes, restitué en son naturel... plus, les merveilleuses navigations du disciple de Pantagruel, dict Panurge. Lyon, Est. Dolet, 1542, 2 volumes in-16, figures en bois. Caractères ronds.
Édition rare et recherchée. Il ne paraît pas, cependant, qu’elle ait été revue et augmentée par l’auteur même, comme le porte le titre. Les Merveilleuses Navigations, ajoutées au second livre, sont un ouvrage peu digne de Rabelais, mais que des critiques modernes lui attribuent.
La première partie du volume renferme 282 pages, plus un feuillet pour la souscription et la marque de Dolet.
La seconde se compose de 350 pages, non compris un dernier feuillet, au verso duquel se voit la marque du libraire.
Dans la préface de deux autres éditions de Rabelais, données à Lyon par un certain Pierre de Tours, on lit un détail curieux. S’il faut en croire cet imprimeur, son exemplaire, étant encore sous presse, lui aurait été soustrait par un plagiaire qu’il ne nomme point, mais qu’il désigne trop clairement pour qu’on ne reconnaisse pas tout de suite Estienne Dolet. Il ajoute que, s’étant aperçu de la fraude, quoique un peu tard, il avait fait en sorte que les dernières feuilles ne pussent être détournées comme les premières. Toutesfoys, dit-il au lecteur, pour t’advertir de l’enseigne et marque donnant à congnoistre le faulx aloy du bon et vray, saches que les dernieres feuilles de son œuvre plagiaire ne sont correspondantes à celles du vray original que nous avons eu de l’autheur.
Dolet néanmoins, comme le remarque M. Brunet, était fort innocent d’une telle supercherie. Son édition est, pour la première partie, entièrement conforme à l’in-8o (ou in-16) gothique de François Juste, Lyon, 1535, et très-différente des deux autres éditions gothiques, sous la date de 1542.
Prologue et chapitre singulier de maistre Guidon de Cauliac, le tout nouvellement traduict et illustré de commentaires [p. 293] par Jehan Canappe. Lyon, Est. Dolet, 1542, petit in-8o de 128 pages.
V. la Croix du Maine et du Verdier, art. Jehan Canappe.
Le Guidon de Cauliac, traité de chirurgie, composé en 1363, a été longtemps en usage dans toute l’Europe, et on l’a très souvent réimprimé, soit en latin, soit en français, en italien ou en espagnol.
Deux livres des simples de Galien, c’est assavoir le cinquiesme et neufviesme, nouvellement traduictz de latin en françoys par maistre Jehan Canappe. Lyon, Est. Dolet, 1542, petit in-8o de 164 pages (la dernière cotée 162).
L’anatomie du corps humain reduicte en tables, trad. du latin de Loys Vassée, par Jehan Canappe. Lyon, Est. Dolet, 1542.
La Croix du Maine et du Verdier n’indiquent point le format de cette édition. C’était probablement un in-16; format dans lequel Jean de Tournes l’a réimprimée en 1552, peut-être d’après Dolet, dont il a souvent reproduit les éditions.
Le livre des Presaiges du divin Hyppocrates, divisé en trois parties. Item la protestation que ledit Hyppocrates faisoit faire à ses disciples; le tout traduict par Pierre Verney. Lyon, Est. Dolet, 1542, petit in-8o de 38 pages, avec la marque de Dolet sur un feuillet séparé.
V. du Verdier, article Pierre Verney.
Exposition sur la premiere Epistre de sainct Jean, divisee par sermons (sans date).
L’Internelle Consolation. Lyon, chés Estienne Dolet, 1542, in-16.
Du Verdier prétend que cette édition a été censurée. Il y en a d’autres plus anciennes, une notamment que Dolet s’est contenté de reproduire: celle de Paris, Ambroise Girault, 1537, in-8o, gothique, [p. 294] de 6 feuillets préliminaires et 142 feuillets chiffrés. Du reste, le volume de Dolet est fort rare. On y trouve, comme particularités, un avis au lecteur et plusieurs dizains de sa façon.
Epistre du Pecheur à Jesus-Christ, par Victor Brodeau, imprimé par Dolet vers 1542.
V. d’Argentré, p. 133. Cette édition a été mise à la censure. L’auteur mourut au mois de septembre 1540. Peut-être a-t-elle vu le jour en cette année.
La Parfaicte Amye, nouvellement composee par Antoine Heroet dict de la Maison Neufve, avec plusieurs autres compositions du mesme autheur. Petit in-8o de 95 pages.
Je n’ai trouvé cet ouvrage que dans la bibliothèque de M. Ambroise-Firmin Didot, si riche en éditions dolétiennes. Il en possède deux exemplaires. Dans l’un, le titre est en fac simile manuscrit portant la date de 1542.
La seconde édition porte la date de 1543.
Dans l’une et dans l’autre, le privilége, daté de Lyon, 1er juin 1542, est imprimé en caractères italiques et me paraît même absolument identique.
Mais dans l’édition de 1542, les trois livres de la Parfaicte Amye, l’Androgyne de Platon, précédé de l’Epistre de l’autheur au roy, l’Accroissement d’Amour et la Complaincte d’une dame, sont imprimés en caractères italiques, tandis que, dans l’édition de 1543, ils le sont en caractères romains.
Toutes deux portent la doloire avec la devise française, sont du même format et ont le même nombre de pages.
L’Amye de court, nouvellement inventé par le sieur de la Borderie. Lyon, Est. Dolet, 1542, petit in-8o.
C’est la première édition de cet opuscule.
Les Prieres et Oraisons de la Bible, faictes par les Saincts Peres, tant du Vieil que du Nouveau Testament. A Lyon, par Jean de Tournes, 1544, aussi par Dolet.
Édition censurée. V. encore d’Argentré, p. 133, 134, 173, 177.
[p. 295] Œuvres de Clement Marot de Cahors.... augmentees de deux livres d’Epigrammes, et d’ung grand nombre d’aultres Œuvres par cy devant non imprimees. Le tout songneusement par luy mesmes reveu et mieulx ordonné. A Lyon, au logis de monsieur Dolet, M D XXXVIII, petit in-8o. Caractères goth.
Édition donnée par Marot lui-même, ainsi que nous l’apprend sa lettre à Dolet placée au commencement du volume, et reproduite dans les deux autres éditions de Dolet, Lyon, 1542-1543. Le volume est divisé en quatre parties, dont la première a 90 feuillets; la seconde (Suite de l’Adolescence), 66 feuillets; la troisième (les Epigrammes), 32 feuillets, et la quatrième (le Premier livre de la Métamorphose d’Ovide), 26 feuillets.
Les Œuvres de Clément Marot.... augmentees d’ung grand nombre de ses compositions nouvelles, par cy devant non imprimees. Le tout songneusement par luy mesmes reveu et mieulx ordonné, comme l’on voyrra cy après. A Lyon, chés Estienne Dolet, 1542, petit in-8o de 324 feuillets en tout, le dernier non chiffré. Lettres rondes.
Belle et rare édition. Elle contient: l’Adolescence; la Suicte; Œuvres translatees de latin en françoys, et les Œuvres nouvelles, qui commencent au feuillet 281, et dont la première pièce est l’Enfer de Clement Marot. Celle (Pour le perron de monseigneur le Daulphin) qui se lit au recto du dernier feuillet porte la date de 1541.
Les Mêmes. Lyon, chés Estienne Dolet, 1543, petit in-8o. Lettres rondes.
Autre édition précieuse. La première partie renferme 304 feuillets en tout, y compris les traductions et les psalmes. La seconde, contenant les Œuvres les plus nouvelles et recentes, est de 76 feuillets.
Cæsaris Commentarii. Lyon, chés Estienne Dolet, 1543, in-8o. Caractères italiques.
Du Mespris de la court, et de la Louange de la vie rusticque, trad. de l’espagnol de Ant. de Guevarre, en françoys, par Ant. Allegre. Lyon, chés Estienne Dolet, 1545, in-8o.
V. Bibliogr. instruct., no 1327.
Commentariorum linguæ latinæ Epitome duplex, per quendam Doleti nominis studiosum (Jonam Philomusum). Basileæ, 1537-39, vel 1540, 2 vol. in-8o.
On croit que l’auteur caché sous le nom de Jonas Philomusus, est J. Gontier d’Andernac. (V. Barbier, Anonymes, 20060 et 20366.)
Stephani Doleti De Re navali Liber, etc.
Réimprimé, avec le traité de Lazare de Baïf sur le même sujet, au t. XI du Thesaurus græcarum antiquitatum de Gronovius. Lugduni Butavorum, apud Petrum vander Aa, M DCC I, in-fo.
Les Faictz et Gestes du Roy Françoys, premier de ce nom, tant contre l’Empereur que ses subjectz et aultres nations estranges: depuis l’an mil cinq cens treize jusques à present. Composez par Estienne Dolet. La prinse de Luxembourg, Landrezy et aultres villes circonvoysines. Les Flamens prins à Cherebourg par les habitans de la ville. Le Triumphant Baptesme de monsieur le Duc, premier filz de monsieur le Daulphin. La description d’ung enfant né en forme de monstre aux basses Allemaignes (sans lieu ni date). Petit in-8o goth. de 6 feuillets préliminaires, 75 feuillets chiffrés et 4 feuillets contenant le Triumphant Baptesme.
Il est probable que cette édition a été faite sur celle de 1540. La description de l’enfant fait partie des pièces préliminaires, où ne se trouve point le Canticque au roy mesmes, inséré dans les deux éditions de Dolet.
[p. 297] Sommaire et Recueil des Faictz et Gestes du roy Françoys premier, etc. Paris, Alain Lotrian, 1543, in-8o.
Ce doit être la copie de la seconde édition de Lyon, chés Estienne Dolet, 1543.
Traicté touchant le commun usage de l’escriture françoyse, faict par Loys Meigret, Lyonnais: auquel est desbattu des faultes et abus en la vraye et ancienne puissance des lettres. Paris, Jeanne de Marnef, veufve de Denys Janot, 1545, petit in-8o de 64 feuillets non chiffrés, signat. A-H.
Cette édition est augmentée de plusieurs opuscules d’Estienne Dolet, savoir: la Maniere de bien traduire d’une langue en aultre; la Punctuation de la langue françoyse, et les Accents de la langue françoyse.
Exhortation à la lecture des sainctes Lettres, etc.
Réimprimé, selon du Verdier, avec des augmentations: Lyon, Balth. Arnoullet, 1554, petit in 8o.
Phrases et Formulæ linguæ latinæ elegantiores, cum præfat. Joan. Sturmii, quibus adjecimus Connubium adverbiorum ciceronianorum Hub. Sussannæi. Argentorati, 1576, 1596 et 1610.
Les Questions tusculanes de Marc-Tulle Cicero, nouvellement traduictes de latin en françoys par Estienne Dolet. Paris, J. Ruelle, 1544, in-16 de 133 feuillets chiffrés et une table des matières.
Ce doit être la reproduction d’une édition antérieure de Dolet, laquelle ne se sera pas conservée.
Les Epistres familiaires de Marc-Tulle Cicero, etc. Lyon, Jean de Tournes, 1549, in-16; Chambéry, 1569, in-16.
[p. 298] Le Second Enfer d’Estienne Dolet, etc. Troyes, par maistre Nicole Paris, 1544, petit in-8o de 95 pages, en lettres rondes; dont le frontispice porte la marque de Paris (un enfant nu suspendu à un palmier); mais peut-être est-ce la même édition que celle de Lyon, sous un nouveau titre.
Canticque d’Estienne Dolet, prisonnier à la Conciergerie de Paris, etc. Réimprimé à Paris, chez Guiraudet, 1829, in-16 de 6 feuillets en caractères gothiques.
Le Second Enfer et autres Œuvres d’Est. Dolet, précédés de sa réhabilitation (par Aimé Martin). Paris, Techener, 1830, 2 volumes in-12.
Cette collection n’a été tirée qu’à 120 exemplaires. Elle contient les six ouvrages suivants de Dolet, réimprimés séparément d’après les éditions originales et sous les mêmes dates:
Procès d’Estienne Dolet... 1543-46, précédé d’un avant-propos sur la vie et les ouvrages d’Est. Dolet, par A. T. (Taillandier). Paris, Techener, 1836, in-12.


| Pages. | |
| A Monsieur Ambroise-Firmin Didot | V |
| Proème | IX |
| Chapitre Ier. Naissance de Dolet.—Ses premières années.—Son éducation | 1 |
| Chap. II. Son séjour en Italie.—Simon de Villeneuve.—Jean du Bellay-Langey.—Amours avec une Vénitienne.—Son talent comme poëte latin.—Opinion de Buchanan et de Scaliger à cet égard | 9 |
| Chap. III. Retour en France.—Dolet à Toulouse.—Son premier emprisonnement et son expulsion | 27 |
| Chap. IV. Épisode littéraire.—Dolet aux Jeux floraux | 61 |
| Chap. V. A Lyon.—Sébastien Gryphius.—Publication des deux harangues contre Toulouse.—Voyage à Paris.—Science, poésie et musique | 71 |
| Chap. VI. Querelle des cicéroniens.—Erasme, Longueil, Scaliger, Floridus Sabinus | 85 |
| [p. 300] Chap. VII Apparition des Commentaires sur la langue latine.—Dolet accusé de plagiat | 103 |
| Chap. VIII. Mouvement intellectuel de la renaissance, d’après les Commentaires | 119 |
| Chap. IX. Meurtre forcément commis par Dolet.—Résultats de cette malheureuse affaire | 133 |
| Chap. X. Dolet imprimeur.—Son mariage.—Naissance de son fils Claude.—Premières productions de sa presse | 145 |
| Chap. XI. Publications diverses.—Dolet grammairien, historien et traducteur | 175 |
| Chap. XII. Ses relations avec Budé, Rabelais, Marot, Salmon Macrin et Jean de Tournes.—Savait-il le grec? | 195 |
| Chap. XIII. Nouvelle arrestation.—Il est sauvé par Pierre du Chastel.—On brûle ses livres | 217 |
| Chap. XIV. Quatrième emprisonnement.—Évasion originale | 227 |
| Chap. XV. Cinquième et dernière arrestation | 235 |
| Chap. XVI. Supplice de Dolet | 245 |
| Chap. XVII. Examen de ses opinions religieuses | 253 |
| Chap. XVIII. Conclusion | 273 |
| Résumé chronologique de la vie d’Estienne Dolet | 277 |
| [p. 301] Bibliographie dolétienne | 283 |
| I. Ouvrages de Dolet, publiés avant son établissement comme imprimeur | 283 |
| II. Ouvrages de Dolet, imprimés par lui-même | 285 |
| III. Publications dont Dolet n’a été que l’éditeur | 289 |
| IV. Réimpressions des ouvrages de Dolet, exécutées par d’autres éditeurs | 296 |


Ce présent Livre fut achevé d’imprimer
le XX septembre M DCCC LVII,
à Evreux, par A. Hérissey,
pour A. Aubry, libraire
à Paris.
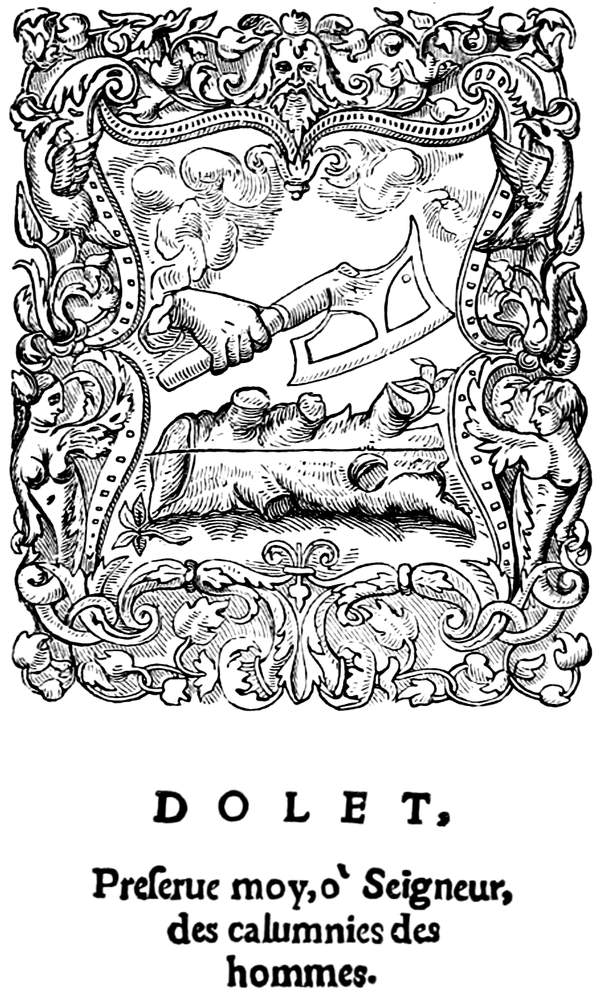
DOLET,
Preserue moy, ô Seigneur,
des calumnies des
hommes.
Au lecteur.
L’orthographe d’origine a été conservée et n’a pas été harmonisée, mais les erreurs clairement introduites par le typographe ou à l’impression ont été corrigées. Les mots ainsi corrigés sont soulignés en pointillés. Placez le curseur dessus pour faire apparaître le texte original. Également à quelques endroits la ponctuation a été corrigée.
Les notes ont été renumérotées consécutivement et placées à la fin de chaque chapitre.