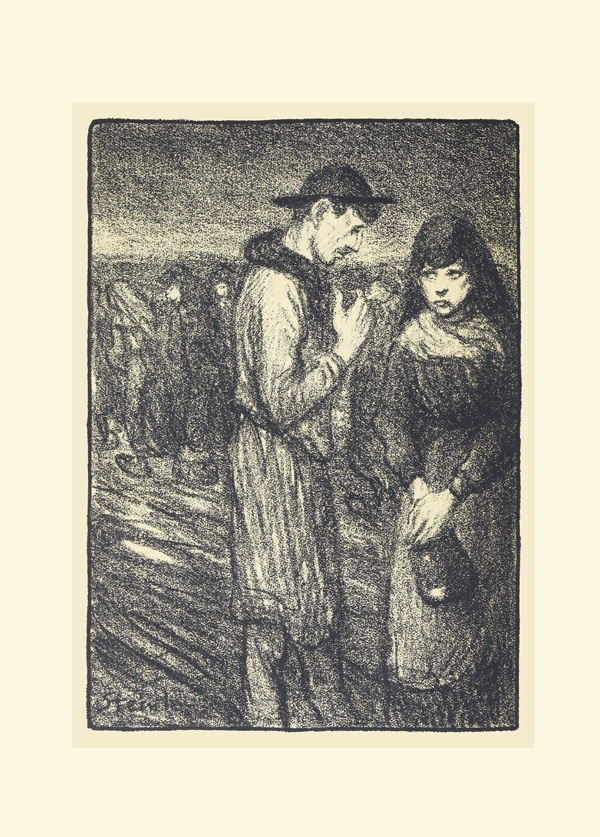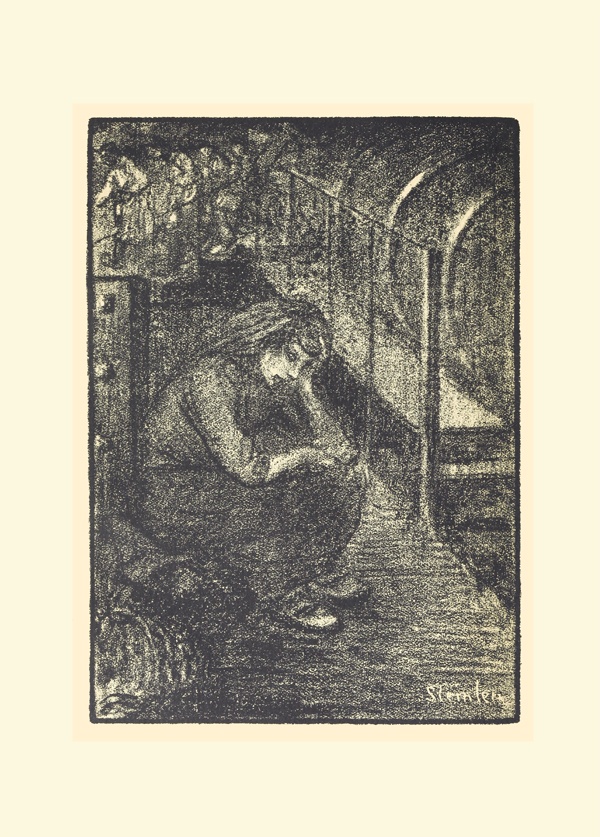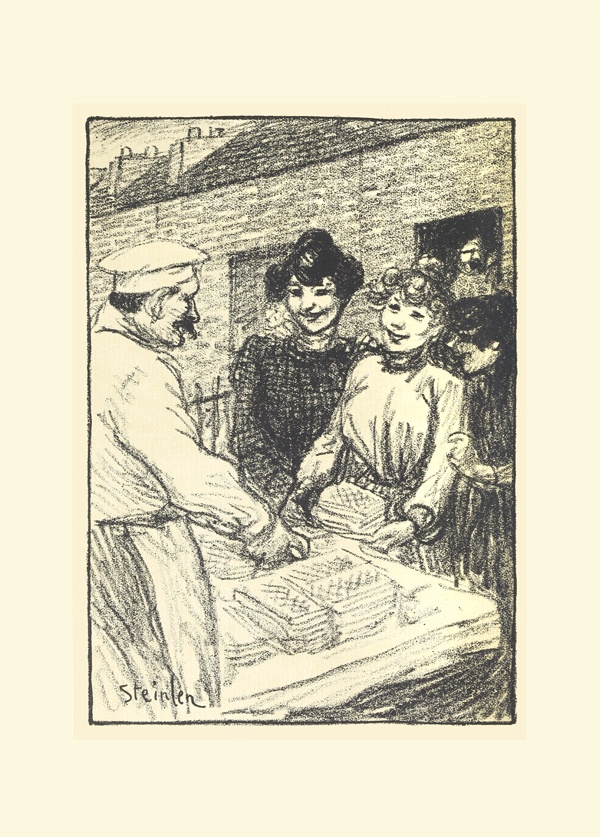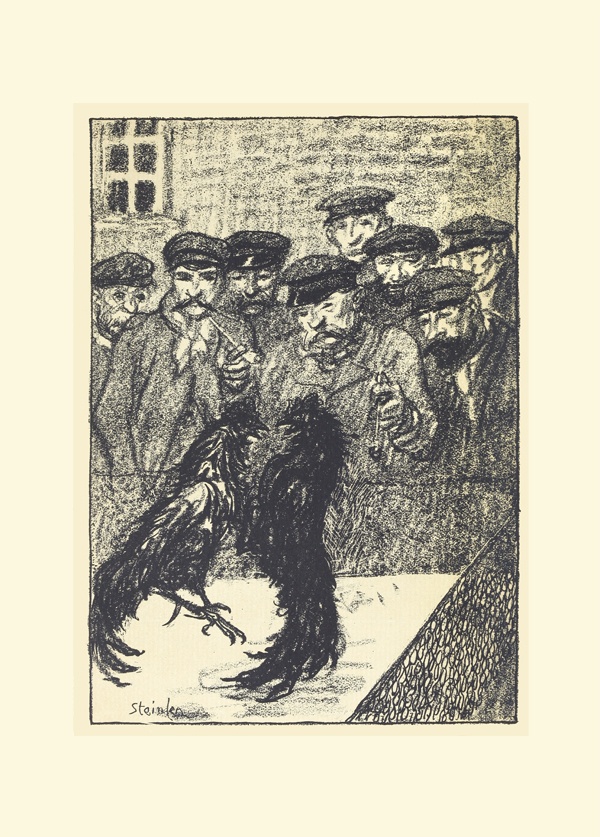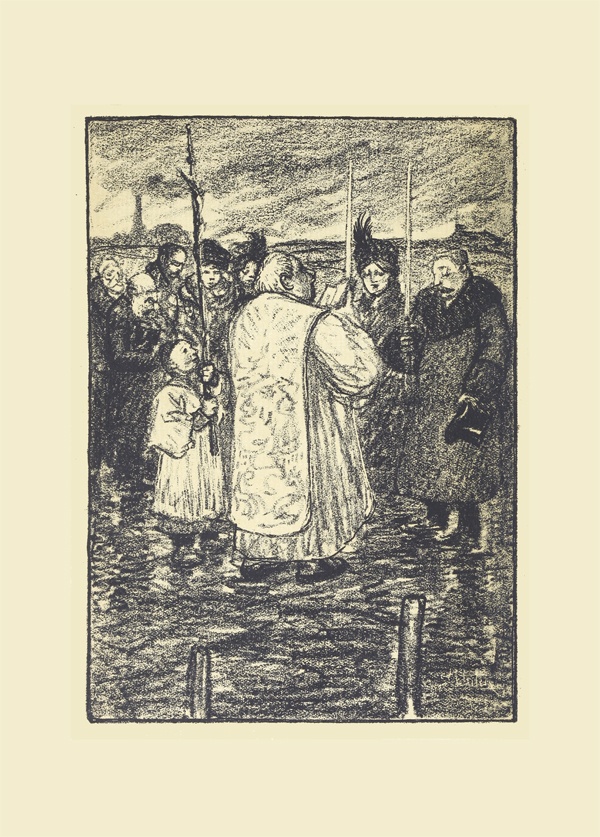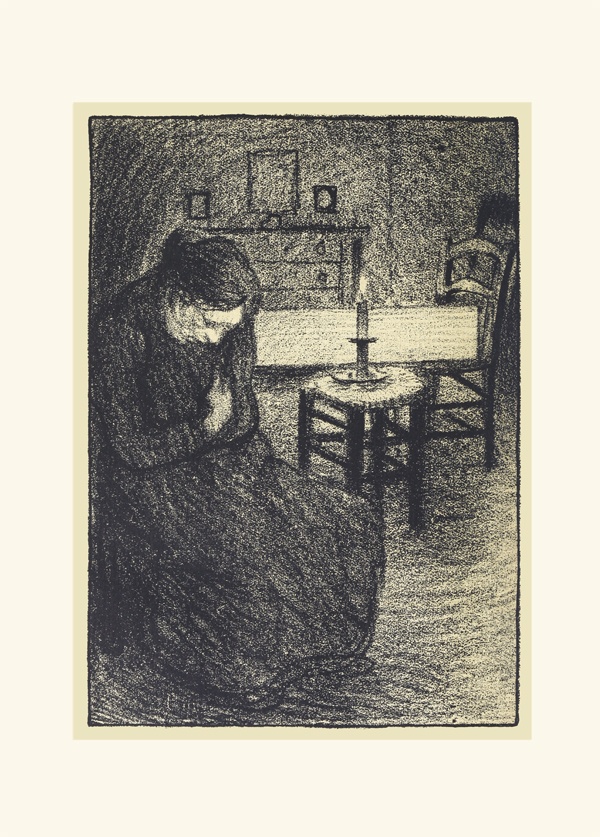ÉMILE MOREL
Les
Gueules Noires
PRÉFACE DE PAUL ADAM
Illustrations de STEINLEN

PARIS
BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE D'ÉDITION
E. SANSOT & Cie
7, Rue de l’Eperon, 7
MCMVII
2e Édition
Il a été tiré de cet ouvrage:
Vingt-cinq exemplaires sur Japon Impérial
et cinq exemplaires sur Chine
numérotés à la presse
Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
5

PRÉFACE
Dès le XVIIIe siècle, nos encyclopédistes surent préparer la force d’apostolat qui devait d’abord, par les armées de la Révolution et de l’Empire, ensuite, par l’action de leurs disciples parlementaires, imposer à l’Europe monarchiste de 1848, après treize siècles d’oppression féodale, la suprématie latine de 6 la Loi sur les dynasties barbares. C’est encore chez nous, aujourd’hui, que la passion de la fraternité internationale puissamment développée, convertit l’État aux espoirs de paix définitive, et entreprend de soumettre les autocraties sanguinaires, même s’il faut pour cela quelque lutte suprême.
Aussi nos écrivains, depuis vingt ans, s’ingénient-ils à découvrir les talents des élites voisines. Ils établissent des unions entre les mentalités des peuples. M. de Vogüé nous enseigna de la sorte plusieurs raisons d’admirer Tolstoï et Dostoïevski. Nous comprenons les idées graves, profondes et vivantes du Nord, qu’Ibsen incarna dans les personnages de ses tragédies. Meredith, Kipling, Wells, après Swinburne et Oscar Wilde, recueillirent les tributs légitimes de nos louanges. Les poèmes de Carducci, les drames si noblement méditerranéens que composa d’Annunzio, les pensées d’Ugo Ojetti, nous captivèrent. Et l’on alla prônant les créateurs qui s’évertuent par delà les mers septentrionales, les Alpes ou le Rhin.
Cette affection très sincère de nos intelligences pour les chefs-d’œuvres étrangers, a malheureusement secondé, parfois, quelques jalousies d’écoles. Il fut une heure où cet amour fut exagérément affecté par les auteurs méconnus qui déniaient à leurs émules célèbres, les talents vantés par certains dilettantes ou par certaines 7 foules. En outre le sentiment politique dicta des verdicts littéraires. A l’internationalisme enthousiaste, les Hauptmann, les Sudermann, les Matilde Serao, les Thomas Hardy, tant d’autres non moins secondaires durent leur renommée parisienne. Très-supérieur à ceux-ci, Maxime Gorki peut cependant remercier l’opinion de notre jeunesse, adversaire de l’autocratie russe. Il incarne le prestige du rebelle intelligent. Nous aimâmes tout de suite les observations du chemineau réaliste et libertaire. Ses façons de rude examinateur interrogeant la vie sans indulgence nous séduisirent; sa pitié malveillante pour la bêtise des humbles nous enchanta. Enfin nous honorâmes ses manières de Diogène incorruptible aboyant au fond d’un tonneau. Un étranger, qui décrit les mœurs de ses compatriotes fort éloignés de nous, a toutes chances de nous intéresser; même si elles étaient plates et vaines, ses peintures nous plairaient par l’imprévu de détails spéciaux à la race du conteur. Telle histoire de paysan ou de boutiquier, pour fade et banale qu’elle soit en elle-même, peut devenir singulière et poignante, grâce aux locutions curieuses traduites d’un patois de la Chersonèse, grâce au caractère soudain révélé d’individus très différents de nous-mêmes, et influencés par des dogmes, des traditions tout autres. Gorki bénéficia de cet avantage. Autant que Gogol, 8 il nous introduit dans un monde d’âmes enfantines, passives, ébaubies, résignées à leurs instincts et à leurs maîtres, toujours asiatiques un peu. Cette nouveauté nous plut. Bientôt les louanges de Gorki retentirent. L’on répétait à l’envie que nous ne possédions pas un écrivain capable d’une pareille sincérité. On se trompait du moins jusqu’aujourd’hui.
Il est toujours utile de réconforter la foi dans notre excellence en attirant l’attention du public sur ceux d’entre nous qui manifestent le génie national. Les adorateurs de Gorki se défendront mal d’une extrême sympathie pour l’œuvre de M. Morel pour ce volume. Sans que le cachet de l’exotisme ajoute aux qualités de ce conteur une vertu toute extérieure et trop alliciante, il réussit à surprendre notre sympathie par la rude évocation de types tragiquement nets. Il les érige dans leur décor propre, et ils vivent en toute vérité.
Or la vérité constitue le mérite si rare de ce livre. Il la contient précise, soudaine, effroyable, ironique envers soi. La fatalité des lois économiques écrasant les foules industrielles est subie par les travailleurs non sans une abnégation analogue à celle des multitudes religieuses qui dans l’Inde, naguère, laissaient le char de Shiva écraser les dévots précipités sous les roues saintes. Certes, il y a les grèves, les émeutes, les 9 protestations électorales. Mais la secousse d’énergie apaisée, chacun reprend le collier de misère et convaincu qu’une nécessité quasi divine l’emportera longtemps sur les efforts de ses frères. Hagard, farouche, le peuple se remet à l’œuvre de produire pour l’aisance des élites favorisées, la richesse de la patrie. La substitution progressive d’actionnaires anonymes au patron réel et haï, ne cesse de confirmer le caractère fatal du salariat. Au loin, épars, intangibles, vagues, les uns presque pauvres peut-être, les autres étrangers, tous ignorants des supplices que leur capital inflige, les actionnaires sont devenus une entité que le prolétariat se définit mal. Ennemie nébuleuse, incorporelle, insaisissable, en tout cas phénomène subtil et dangereux comme le choléra. Car si les meneurs de syndicats s’assimilent à demi les thèses du collectivisme, l’énorme masse de leurs commettants n’y comprend goutte. Elle crie «Vive la Sociale!» comme les gens de 1830 criaient «Vive la Charte!», ceux de 1790 «Vive la Liberté!» et ceux d’autrefois «Vive Notre-Dame!», par besoin spontané de lutte contre les Huguenots, la dynastie franque et les Bourgeois, causes personnifiées du malaise général. Aujourd’hui l’amorphisme de la tyrannie capitaliste la rend quasi divine. Et l’effroi, comme la haine qu’elle inspire maintenant, acquièrent des apparences religieuses.
10
C’est l’empire de cette terrible force sur l’individu que M. Morel exprime dans les contes réunis en ce volume. De page en page, se convulsent la douleur, l’ivresse et la bêtise des troupeaux humains réduits à l’état indécis d’éléments. Rien dans les littératures antérieures ne put être suggéré par des observations semblables; seuls les tragiques grecs imputèrent à l’ανάγκη une pareille influence sur les crimes et les guerres. La mentalité de la foule industrielle, de l’homme-outil, est une chose particulière à ce temps. Jadis l’artisan faisait à lui seul, un objet total. Qu’il abattit un arbre dans la forêt, qu’il forgea une dague ou qu’il construisit une huche, il possédait le sens tonique de créer. Il pouvait se satisfaire devant un ensemble sorti de ses mains ingénieuses. Rares étaient ceux qui remplissaient les tâches purement mécaniques de l’ouvrier contemporain. Et ces tâches semblaient si pénibles qu’on les réservait aux criminels, ou condamnés aux mines. Lisez le très beau conte qui a pour titre Multitude-Solitude et que l’art vigoureux de M. Morel semble avoir choyé; apprenez le labeur monotone et indéfini des trieuses dans un puits du Nord; quelle impression funèbre on éprouve, à s’imaginer la pente lente de la personnalité, saisie dans la continuité du mouvement producteur, celui qui commence au coup de pioche détachant la 11 boule dans la galerie souterraine, et qui s’achève avec le geste de la fillette remplissant la corbeille. Ce mouvement général semble l’Être unique dont ce hercheur et la trieuse, aux deux extrémités de son élan, paraissent les organes analogues aux mécanismes charriant les bennes, hissant les cages, ventilant la mine, versant le charbon, l’emportant sur les trucks des trains en partance pour mille usines différentes qu’il alimentera.
M. Morel a parfaitement suggéré cette absorption de l’ouvrier par l’usine, qui le dévore, le savoure, le digère, puis l’excrète sous forme d’invalide ou de cadavre. Cela, le singulier talent de l’auteur nous a permis de le concevoir, en objectivant à nos yeux les heures pathétiques des existences ainsi consommées.
Amour angoissé puis mortel de La Marie pour le mineur qui l’a prise, entre tant d’autres, et qui la chasse à coups de pierres quand elle le découvre par mégarde aux bras d’une rivale. Stupidité touchante et avilie de Bécu, qui paie sa boisson avec l’argent destiné au cercueil de son enfant. Ignorances, souffrances, brutalités de tout ce peuple houiller, grouillant à la surface de la plaine flamande, sous les longues pluies froides, dans les cases des corons, à la lueur des astres électriques qui bleuissent les vitrages des ateliers, les courbes des rails, les fils du télégraphe, les flaques d’eau semées dans la sombre étendue 12 de mâchefer et de boue. Toutes ces peines vivantes accomplissent le drame de leur effacement au bénéfice de la Force immatérielle, accroupie, là, parmi les bâtisses lugubres et retentissantes, dans le paysage de désolation . . .
Quel décor plus tragique: cités de briques noirâtres frangées de maigres potagers, chemins d’escarbilles entre les terrains chauves, groupes de passants aux hardes flasques, déteintes, et qui se frôlent en affectant le verbe le plus canaille, le ton le plus abject. Cabarets aux salles basses empuanties d’odeur aigre, de pétrole et de sueur. Immondes injures proférées par les bouches d’enfants malingres et hâves qui cruellement se bousculent. Et ce ciel fumeux qui pleure sur l’infortune de la multitude hargneuse ou saoule. Telles sont les lignes, les couleurs, les cortèges et les voix de l’un de ces lieux où se recrutent les milices de la prochaine révolution sociale, celle qui changera les institutions humaines.
M. Morel façonne magistralement les statues littéraires des individus que forment ce climat, ces parentages et ces mœurs. Frère de l’art qui valut à Constantin Meunier tant de noblesse, celui-ci appartient en toute originalité au nouveau conteur. Depuis l’époque où Zola composait Germinal, deux générations surgirent dans le bassin minier du Nord. Elles présentent à 13 l’observateur des caractères très différents de ceux que nota le romantisme lyrique du maître défunt. Tout a pris là-bas un autre aspect. La magie de la science a modifié l’usine et son outillage. Les personnalités se sont mieux diluées dans la masse. Les rancœurs d’une population athée, rebelle, ironique, graveleuse et complètement adaptée à ses tâches, ont marqué plus profondément de leur empreinte les descendances: ce qui s’avère dans ce livre.
Il m’étonnerait fort qu’on ménageât la faveur à cet ouvrage d’un Gorki français qui vient d’ajouter plusieurs pages insignes à l’étude contemporaine du peuple, essayée par les auteurs de Jacquou le Croquant, de La Vie d’un simple, de La Maternelle.
Pour épris que nous soyons de tentatives étrangères, il sied que nous aimions les nôtres aussi, lorsqu’elles offrent à l’esprit tant de chances pour s’instruire et s’accroître, en apprenant plus de douleurs et plus de joies, en participant à plus de vies. Savoir rassembler et serrer autour d’un personnage les forces de l’univers est l’intuition philosophique seule capable de justifier l’usage des belles lettres.
A Courrières, des héros se sont révélés au printemps de 1906.
Cet admirable Pruvost qui sut vingt jours, dans la mine 14 délétère, faire survivre les courages de ses compagnons, qui les mena vers le salut, en dépit des âmes ébranlées par les horreurs du réel et par les terreurs de l’imaginaire. Quelle relation d’un siège, quel récit d’une bataille comprirent jamais des péripéties plus atroces que celle de cette longue angoisse? La viande arrachée au cadavre d’un cheval pourrissant, l’avoine, les échardes, l’urine humaine, l’eau sale qui composèrent la nourriture et la boisson de ces malheureux n’étaient pas pour les nantir d’énergie. Celui qui les réconforta par l’aliment sublime de sa parole rude et bonne, de son exemple, celui-là mérita plus que tout autre d’être enrôlé dans notre Légion d’honneur. Élève d’une École des Mines, Nény a montré ce que l’instruction et l’intelligence apportent de force aux caractères qu’elles façonnent.
Et voici maintenant un livre qui marque de quelles peines naissent ces courages.
Certains aiment répéter qu’il n’est plus en France, de cœurs valeureux. Pruvost dément cette opinion. Il offrit la preuve manifeste qu’au milieu de notre peuple se préservent et se perpétuent les qualités du chef. Car grouper des compagnons à l’heure du péril, les guider dans les chemins de douleur, les contraindre à subsister, à marcher, à espérer et à vaincre, c’est 15 là l’œuvre propre du chef. Pruvost témoigna que, parmi nous, se conservent latentes, les vertus des humbles officiers légendaires encadrant les soldats de la Révolution et de l’Empire, les maintenant, décimés, sur le plateau de Praszen, malgré la victoire momentanée des masses ennemies, les conduisant à l’assaut d’une Saragosse fumeuse et meurtrière, les ramenant à reculons et face aux cosaques, depuis Smolensk jusqu’à la Bérésina.
En ce Pruvost s’éternise le type du héros français. Pendant la bataille contre la nature inclémente, contre la terre avare, contre les gaz assassins, ils parurent tels que les aïeux dans la guerre contre les tyrans d’autrefois. J’eusse voulu que M. Fallières allât lui-même sur le carreau de la fosse attacher la croix contre ces poitrines amaigries. J’eusse voulu que, représentée par sa jeunesse en armes, ses plus somptueux régiments de cavalerie et d’infanterie en lignes sous les drapeaux déployés, la France acclamât de ses fanfares, les héros du travail.
Rien n’eût été trop magnifique pour attester l’hommage de la nation à ceux qui la servent en multipliant leur vigueur morale, leur esprit de solidarité. Décorant ces mineurs, elle vénère en leurs personnes les mille victimes du devoir social englouties dans les souterrains de la houille, sous les éboulements. Elle 16 enseigne au monde ceci: l’ouvrier atteint en besognant pour produire l’aise humaine, mérite autant que le soldat blessé en combattant pour détruire les adversaires de nos idées essentielles, de nos idées libératrices.
Pruvost, c’est le peuple qui, par son labeur opiniâtre, constitue la richesse de la patrie, donc la puissance de ses concitoyens à l’époque où l’argent commande et même dote d’efficacité les courages militaires en mettant les inventions de la science dans les mains des états-majors. Aujourd’hui, les grands États achètent la paix au prix d’un énorme appareil de guerre. L’ouvrier d’industrie fournit le principal de ce prix. Aux mineurs, aux verriers, aux forgerons, aux tisserands, à tous ceux qui manient le fer et le feu dans les enfers des usines, nous devons cet or sacré, garantie contre les massacres et les ruines du pire fléau. Si les Germains hésitent à nous attaquer, c’est que les Russes, débiteurs loyaux et reconnaissants, annoncèrent l’union avec la nôtre de leur force que les dépêches anglaises et les révolutionnaires européens décrient faussement, puisque cette simple déclaration de Pétersbourg suffit pour amener la conciliation entre les diplomates d’Algésiras.
A l’ouvrier, nous devons les motifs de notre quiétude relative. La richesse qu’engendre l’effort assidu de ses muscles assure 17 la vie de nos principes, de nos mœurs et de nos traditions. Il est le citoyen tutélaire, le palladium de toutes les patries. Sans lui, le soldat se trouverait, à l’heure dangereuse désarmé. Nos arts latins, notre pensée romaine, notre République législative, notre indépendance spirituelle et civique dépendent de son obstination à produire, en échange d’un salaire médiocre, les objets de nos négoces, les causes de nos millions. Afin que nous jouissions tous de cette sécurité, il livre, par morceaux, son existence aux catastrophes, aux accidents, aux maladies professionnelles. Il ignore, presque toujours, la longévité. L’excès de labeur, l’excès d’alcool le tuent avant la vieillesse. Sans l’excitation du vin, pourrait-il réaliser un effort aussi considérable! Et chaque année, cent cinquante mille tuberculeux expient, en mourant, le péché d’alcoolisme héréditaire.
L’agriculteur fournit le pain quotidien des français. Il ne crée pas la fortune indispensable à leur défense. Peu s’exporte de ce qu’il cultive, de ce qu’il transforme dans les champs. Il oblige les parlementaires au protectionnisme le plus néfaste. Au contraire, l’ouvrier livre tout de lui-même. Chacune de nos excellences est pétrie de sa chair, de son sang, de ses larmes. La table sur laquelle nous écrivons le verre que nous vidons, l’habit que nous portons, le mur que nous regardons: tout 18 naît de sa peine. Notre vie est faite en ses minuties, par les soins douloureux du travailleur manuel.
Or, il a livré pour nous, à la nature souterraine, un épouvantable combat. Mille de ses frères ont péri; et nous savons aujourd’hui, dans quelles tortures. Si mille soldats avaient péri de même sous les décombres d’une citadelle assiégée, nous ne saurions qu’imaginer à la gloire de ces héros. Il sied que notre dévotion s’affirme pareillement à l’égard des travailleurs morts pour la puissance de la patrie. Sur le sol de Courrières, un édifice ne doit-il pas s’ériger, consacrant, grâce à l’art d’un illustre sculpteur, la religion du sacrifice consenti par l’individu afin que la société progresse. Depuis longtemps M. Rodin parfait la maquette d’un monument au Travail. L’heure ne sonne-t-elle pas de dresser ce symbole du génie laborieux sur le tombeau des Mille?
A la gloire de l’ouvrier, la nation reconnaissante dédierait l’œuvre de son plus beau talent.
Nul hommage qui puisse dépasser la mesure du sacrifice. Si les lois de l’évolution économique s’opposent encore aux désirs légitimes du prolétariat, si l’on ne peut lui tailler sa juste part dans les bénéfices sans détruire l’industrie même qui le nourrit, si, par l’iniquité des choses fatales, l’ouvrier reste, comme l’employé, 19 contraint de subir ces influences de la vie générale, il a du moins conquis le respect des penseurs, des élites intelligentes, jadis insoucieuses de sa dignité. C’est ce sentiment de respect, de gratitude et d’amour fraternel qu’il nous appartient de manifester le plus généreusement autour du sépulcre noir.
Et je suis extrêmement heureux d’écrire ces lignes au seuil d’une œuvre d’un écrivain du Nord, un qui connaît les âmes des corons et les humbles intelligences engainées dans la blouse du mineur. M. Morel, le premier, élève ce monument littéraire en l’honneur de nos héros, monument de sincérité, de pitié, de vérité. Il convient de le louer pour avoir uni son rare talent au service d’une si noble cause.
Paul ADAM.
23

La Paye
Elles sont là une vingtaine qui piétinent dans la neige, devant la grosse grille fermée, attendant leurs hommes.
24
Là-bas, au fond de l’immense cour, où la neige est devenue une boue noirâtre, comme si la houille suintait du sol, le grand bâtiment de fer se profile, pesant et sombre, sur le ciel uniformément gris.
Tous les regards scrutent au flanc de cette bâtisse rigide et farouche, une sorte de brèche, à laquelle on accède par la montée d’une rampe de terre qui se cabre sur des arches de brique. Car, c’est par ce vomitoire, que s’écoulera le flot humain jailli des sources profondes.
Et c’est chose poignante que l’attente transie de ces quelques malheureuses, qui sont venues épier la «remonte» du jour de paie, pour disputer à l’alcool, leur pain et celui des petits. Combien hélas, de celles qui tranquillement au coron s’invitent autour des cafetières, viendront aussi un jour, se joindre au groupe lamentable?
Il en est, qui ont amené un enfant, l’aîné, ou bien encore le tout petit: celui enfin que leur homme préfère, afin de l’attendrir et de l’entraîner. Car l’ennemi est derrière elles: une rangée d’estaminets, placés devant la sortie, comme des pièges et qui, eux aussi, guettent la remonte de quinzaine.
C’est là que l’homme va rapidement prendre courage 25 pour son vice. Il est lâche, il hésite, avant d’en avoir franchi le seuil, mais lorsqu’il en sort, il a le regard mauvais déjà et l’argent enfermé dans le poing. Il est devenu insensible aux larmes et aux supplications éperdues de celle qui l’attend encore. Et, sans attendrissement pour l’enfant effaré qui pleure, il s’en va menaçant.
Alors, vaincue, la femme s’en retourne en sanglotant à la maison, où, peu à peu, entrent la misère et la faim.
Or, si leur attente vous angoisse le cœur, c’est qu’elle évoque tous ces drames et toutes ces souffrances.
Voici que l’on ouvre la lourde grille, la défense hérissée, derrière laquelle aux heures hallucinées, les soldats veillent.
Les femmes s’approchent, et leur groupe, calme jusqu’ici, maintenant s’agite. Celle-ci gifle l’enfant qui s’obstine à grimper aux barreaux, cette autre se courbe, et d’un geste cru, se mouche entre les doigts, sur la neige; il en est une, qui berce avec un air de rudesse et d’alarme, le nourrisson qui se réveille. Et ce sont là, les frémissements grossiers de leur impatience et de leur inquiétude.
Un homme, frileusement enveloppé dans une houppelande, comme celles que portent les bergers, est venu 26 s’asseoir à l’entrée, sur l’une des bornes de fer. C’est un mineur, qu’un éboulement a tordu comme une vrille. Les secours de la compagnie ne lui suffisant pas à nourrir sa famille, il vient tendre la main aux camarades.
Les estaminets s’agitent aussi. Une servante à la tignasse d’un blond de lin, balaie le seuil du «Grand Saint-Éloi». Plus loin, «Au rendez-vous des Coqueleux» fluent, par la porte entrouverte, les sons aigrelets d’une boîte à musique.
Brusquement, là-bas, les hommes noirs sont apparus, tenant en main leurs lampes encore allumées. Et celles-ci ont au jour, un aspect funéraire, un éclat blafard, rappelant celui des lampadaires, qui éclairent en plein midi, à travers un crêpe.
Ils descendent en courant la rampe de terre, comme pour secouer la tristesse des ténèbres du fond, restée accrochée à leurs épaules. Puis, ils vont de nouveau se perdre, dans une autre partie de l’étrange monument de fer, par une large ouverture béante, où le regard suit un instant, semblables à de petites étoiles, leurs lampes qui s’éloignent.
Ils apparaissent et disparaissent par groupes, selon la montée des cages, qui viennent des ténèbres les rejeter au jour.
27
Là-haut, dans le beffroi qui se dresse vers le ciel immobile, les molettes par où dévalent les câbles de l’ascenseur monstre, tournent, tournent, lancées dans une giration folle. Et c’est lorsqu’elles s’arrêtent un instant, qu’un flot d’hommes surgit et roule, comme si la gorge profonde vomissait ceux-ci par hoquets.
Quelques trieuses, dont le travail se trouve interrompu par la «remonte», sont venues s’accouder au garde-fou d’une plate-forme, sans doute pour reconnaître quelque amoureux, car ces petites «gaillettes», ces gamines de quatorze ans, sont déjà des femmes. Il en est une, qui a ramassé de la neige, et la lance au-dessous d’elle, sur les houilleurs. Alors ceux-ci, d’en bas, ripostent avec des mots qui sont une boue. Et ces mots infâmes font fuser des rires frais d’enfants.
Les houilleurs, que les cages viennent de rejeter hors des ténèbres, galopent toujours en descendant la rampe, mais à présent, ils se heurtent en bas, à ceux qui s’en reviennent, recomptant la paie qu’ils ont touchée au sortir de la lampisterie. Ces derniers tiennent encore en main, leurs bulletins de «quinzaine»: des petits carrés de papier d’un rouge écarlate qui mettent une pauvre joie éparpillée, dans la foule pesante et boueuse.
28
La fosse, hoquet par hoquet, continue à vomir son outillage humain. Avec un piétinement harassé, des pas ivres de fatigue, les centaines d’hommes loqueteux et maculés se tassent à la sortie.
C’est entre les grilles, la coulée fangeuse d’êtres rugueux comme les anthracites de la mine, d’êtres aux ossatures gourdes et animales. Et cette plèbe, calcinée par l’approche du grand feu souterrain, cette plèbe sordide que l’on voit derrière les barreaux de fer aux pointes hérissées, donne une tragique impression de force comprimée et aveugle.
Ils sortent; les gros sous tombent dans l’assiette de l’estropié; ils tombent lourdement, jetés par des mains énormes et souillées, des mains déformées par les meurtrissures. Et tous ces hommes qui font l’aumône, ont un même air féroce et tourmenté, avec leurs faces machurées dans lesquelles roule le blanc des yeux.
Sur la route envahie, c’est une cohue aux gestes entrecroisés et confus, un grouillement dans lequel les quelques femmes qui attendaient, disparaissent noyées, comme là-bas, au coron, leurs peines et leurs foyers de souffrance sont perdus, parmi les centaines et les centaines d’autres foyers. Une senteur tiède de troupeau, une odeur écœurante de sueur et de houille, 29 flotte dans l’air glacé, au-dessus de la foule qui sur la neige s’élargit comme une tâche d’encre.
Les portes des estaminets s’ouvrent et se referment avec un ébranlement de vitres. Et sur les seuils, ce sont des appels, des noms criés par des voix qu’enrouent les poussiers de charbon restés accrochés dans les gorges.
Un sou lancé maladroitement, est tombé sur le sol gluant. Le houilleur qui l’a jeté le ramasse et le dépose dans l’assiette que l’affligé tient sur ses genoux.
Ce houilleur doit être l’un des plus anciens de la mine, car son corps porte le stigmate des longues heures de travail, pendant lesquelles les jambes ployées, les reins ankylosés, les épaules voûtées, seuls, les bras se détendent, frappant le long du gisement pour extirper l’or noir.
Son allure en est affaissée, et ses jambes demeurent arquées en avant, comme chez les vieux chevaux rompus. Puis, sur ce corps vidé de graisse, la tête portée par un cou amaigri, cordé par les carotides, apparaît trop grosse.
Tout en marchant, l’échine prostrée, il noue sa paie dans le serre tête de toile bleue qu’il a retiré de 30 dessous sa barrette en cuir bouilli. Il fait les nœuds lentement, avec des doigts gourds et inhabiles. Parfois, il relève la tête, et ses yeux enfoncés dans un visage bosselé par les pommettes, fouillent d’un regard inquiet la cohue.
Tout à coup, une grosse femme aux cheveux roux a surgi devant lui. Impérieuse et rogue, vivement elle saisit le serre tête, d’un tour de main le dénoue et en verse le contenu dans son tablier.
Dans la figure elle lui crie:
—Ch’ bulletin, faudra me l’ faire vir à nous mason.
Après quoi, ayant tourné un dos énorme, elle s’éloigne à grands pas farouches, fendant la foule de sa grosse poitrine tendue en avant comme une proue.
Lui, reste là, les bras tombant très bas, avec ses grosses mains déformées au bout, hébété, perdu. Bousculé ici, il va plus loin et s’arrête, regardant les autres sortir, mais les yeux vagues, l’esprit ailleurs.
Enfin, il palpe l’intérieur de son bourgeron serré à la taille par une lanière de cuir.
Il en retire son bulletin de quinzaine et y fixe sa pensée qui errait.
La coulée de la foule le frôle, l’ébranle comme ces piquets de bois enfoncés au milieu d’un cours d’eau.
31
Soudain, il a un mouvement des épaules, relève les yeux, et le voilà qui remonte le courant humain où sa grosse tête ballotte dans la houle des visages noirs.
Il repasse la grille, puis dans la grande cour, il se dirige à droite, vers le long bâtiment bas et sans étage des bureaux.
Assis derrière son grillage, le comptable le regarde entrer, furieusement hostile déjà, envers ce numéro de son grand registre qui a pris forme humaine.
—Qu’est-ce que vous venez fiche ici?
Le houilleur demeure une seconde ahuri, comme une brave bête paisible qui ne sait pourquoi on vient de la cingler d’un coup de fouet.
—. . . . . Ben Voilà, je viens rapport à les frais d’interment de min fiu qu’est mort ch’ mois passé. A l’ paie, l’ porion il a dit comme çà, que vous ne lui aviez encore rien donné pour mi.
—Votre nom?
—Bécu Désiré.
—A quelle date votre fils a-t-il été enterré?
—L’ quatre ed’ janvier.
Le comptable, le front chagrin, a ouvert son grand registre à coins de cuivre, et de ses doigts pâles tourne les pages où, rivés chacun à son numéro, se succèdent 32 les quatorze cents noms, inscrits en grosses lettres rondes, enlacées comme des maillons de chaînes.
Dans le silence, on entend un bruit sourd qui vient du bâtiment d’extraction, un bruit au rythme large, comme une respiration profonde et égale. Et, à travers les vitres en moiteur, on voit là-bas, à une grande baie, le bras énorme d’une bielle, dont le geste humain passe et repasse.
L’employé a pris son carnet à souche, puis s’est mis à écrire.
Le poêle rougi a rejeté par son œil de feu une escarbille, une larme incandescente qui a roulé sur le plancher. Bécu s’est précipité lourdement, et d’un coup de son gros soulier ferré a repoussé l’escarbille sur la plaque de tôle. Mais derrière le grillage, on lui a jeté un regard furibond et la plume a eu sur le papier un grincement exaspéré.
Alors, pour prendre contenance, l’homme croise les bras, et, se penchant un peu, il suit du regard avec une attention stupide, le fantôme de force qui, là-bas, passe et repasse.
Le comptable s’est levé et s’approche du guichet.
—Tenez, voilà vos bons.
Sur la planchette, il a appliqué du plat de la main, 33 avec un bruit de gifle, deux feuillets détachés du livre à souche.
Bécu les regarde d’un air désappointé.
—Alors, c’est pas nous qu’on touche ch’l’argent?
On ne répond même pas à sa question.
—Celui-ci, vous le remettrez au curé, celui-là, aux pompes funèbres, afin qu’on puisse venir les toucher à la caisse. Nous ne donnons pas de bon pour le menuisier. L’indemnité est fixée à cinq francs pour les cercueils d’enfants. Je vais vous remettre l’argent.
Cette fois, Bécu a eu un dandinement de satisfaction.
La pièce a sonnée, brillante, sur la planchette. Aussitôt, l’énorme main noire l’a saisie puis étouffée en se refermant.
Dans la cour redevenue déserte, il n’y a plus qu’un groupe de chefs porions qui causent entre eux tout bas, leurs gros ventres se touchant.
Et maintenant, Bécu se trouve seul sur la route. On ne voit plus qu’une femme et son enfant, qui attendent, en détresse, devant la porte d’un cabaret et aussi le malheureux qu’un éboulement a tordu, qui s’en va, lentement, de côté, comme un crabe.
Bécu se dirige aussitôt vers l’estaminet du «Grand Saint-Éloi.»
34
La salle enfumée est pleine de houilleurs, assis autour du poêle, serrés sur des bancs le long des murs ou debout devant le comptoir. Au relent épais et fade de la bière, dans l’atmosphère empestée par l’âcre fumée du tabac de contrebande, se mêle la senteur vineuse de l’alcool. Et le patois grossier, le lourd patois du Nord, sort comme mâchonné des bouches où s’accrochent les pipes en terre.
Bécu s’assied près de la porte, au bout d’un banc.
Mais dans le fond de la salle, un homme s’est dressé, émergeant du remous des carrures.
—Hé Désiré? Viens par ichi nom de Dieu!
Lui, s’est levé docile, et sa grosse tête dodelinant, va s’asseoir à côté de celui qui l’a appelé.
Au comptoir, le cabaretier, une main sur le levier de la pompe, remplit les chopes que sa femme et la servante à la tignasse de lin vont porter sur les tables. Ou bien, d’un broc d’étain, il verse du genièvre dans les verres. Parfois, il sort du comptoir pour aller boire avec les clients. Il a l’air satisfait, réjoui, et là où il va vider une chope, il lâche des plaisanteries et donne de grosses tapes amicales sur les épaules boueuses, comme s’il voulait donner du courage pour les tournées à venir.
Les houilleurs vident leurs chopes avec des gestes 35 traînards, des mouvements déformés de leurs corps devenus à l’image de leur vie. Et les pensées qui roulent dans le vacarme des voix semblent être tirées avec effort, comme à coups de pioche, des fronts durs.
Bécu, lui, ne parle pas; il écoute le camarade qui pérore. Silencieusement il boit et mâchonne une chique de tabac. De temps à autre, il lance sur le carrelage un long jet de salive jaunâtre. Lorsque vient son tour de faire la politesse d’une tournée, il demande d’une voix sourde qu’on remplisse les énormes chopes. Puis il s’efface dans le silence. Trente années de fond et vingt ans pendant lesquels cet homme a tremblé devant une épouse terrible, ont fait de lui un être timide et triste.
Parfois, dans le brouhaha, un juron du rude patois se détache et isolément va résonner aux murs où sont accrochés les chromos violemment enluminés qui représentent les députés-mineurs.
Mais on boit ici, simplement histoire de se laver le gosier, avant d’aller au coron se décrasser dans les cuvelles et manger la soupe. Ou bien encore, pour certains, avant de prendre le train-tramway qui reconduit au-delà du pays noir, dans les villages agricoles, ceux qui, pour les salaires de la mine, ont 36 abandonné les champs. Les uns après les autres, les hommes boueux et aux visages lugubres se lèvent. Il a beau sourire le gros cabaretier, il a beau donner des tapes amicales, les gros souliers aux semelles cloutées font crier le sable blanc semé sur le carrelage. Quelques mineurs vont décrocher, dans un corridor qui mène à la cour du cabaret, des vieux pardessus qu’ils ont habitude de remiser en cet endroit avant d’entrer à la fosse. Ce sont là d’étranges vêtements rapiécés, de vieilles guenilles qui ne craignent pas le contact des loques de fond. Et ceux qui les endossent prennent un aspect de bandits, dont le visage serait barbouillé pour un guet-apens.
Le camarade aussi s’est levé, enroulant autour de son cou, un large cache-nez rouge qui lui donne un air louche d’émeutier. Et comme il discute politique avec un houilleur qui s’achemine vers la porte, il oublie là Bécu.
Oh! celui-ci n’est guère pressé de retourner au coron. Il lui importe peu d’aller savonner le charbon collé à sa peau et au sortir de la cuvelle, après avoir passé du linge propre, d’avaler la «dréchure». Il a une autre pensée en tête que celle de changer sa loque de fond, et dans l’estomac, il a une autre fringale que celle d’une soupe au lard frais.
37
Au travers de la toile noircie de son bourgeron, il palpe la pièce d’argent que lui a remis le comptable. Il la palpe avec la joie sournoise d’avoir trompé celle qui aux jours de paie, épie la remonte non pas avec une timidité éplorée comme les autres malheureuses, mais farouchement, en haute et robuste femelle.
Et il pense que de cet argent, il faut en tirer du plaisir jusqu’au bout. Or, prendre du plaisir, pour lui, c’est boire, s’abreuver jusqu’à l’inconscience.
Dans cette existence de labeur sombre et grossier où il va tête basse, lourd et stupide comme le bœuf à l’attelage, dans cette vie sans espoir, sans but, qui ne sera jamais que la misère supportable, l’ivresse que donne l’alcool est devenue la seule lueur et la seule secousse rompant la longue monotonie, dans laquelle se confondent les nuits, les jours, les années obscures des fonds...
Ayant craché la chique qu’il avait logée dans un coin de sa bouche, il se lève et s’approche du comptoir. Dans un faisceau de pipes qui sortent d’une chope, la tête en l’air, il en choisit une d’un sou. Il rompt le bout du tuyau qui lui paraît trop long. A ce moment, le cabaretier lui tend sa blague à tabac.
—Tiens bourre t’ pipe.
38
Alors, pour remercier, Bécu commande deux chopes. On les tire en deux coups de levier pendant que lui, allume sa pipe avec des aspirations longues et bruyantes, au «couvé» de cuivre dans lequel sommeillent les braises.
Ils trinquent.
—Écoute Bécu, c’est mi pour t’ faire tort, mais tu me dois encore quarante sous de l’ semaine passée.
Celui-ci pose sa chope, s’essuie la bouche du revers de sa grosse patte, délayant ainsi la poussière de charbon d’un peu de bière blonde et demeure balourd. Ça lui donne un petit choc au creux de la poitrine, le rappel de cette dette, qu’il va falloir payer aujourd’hui, où il aurait voulu boire tout son saoul. Il ne se souvenait plus de celle-ci, sans cela assurément, il serait entré dans un autre estaminet. Car, Bécu ne se presse guère à payer ses petits comptes arriérés. Il ne les acquitte que lorsqu’on l’interpelle du seuil des portes, parce que sa timidité alors s’affole.
—Oh tu ne m’ fais mi d’ tort, ce qui est dû, ça est dû.
Il reprend sa chope et la vide en se penchant en arrière, d’un petit coup brusque, afin de bien en sucer le fond.
Puis, il fouille dans sa loque de fond et en retire la pièce 39 de cinq francs qu’il pose gravement sur le comptoir, en la suivant d’un long regard qui la voit disparaître.
Le cabaretier, ayant retenu le montant de la petite dette et celui des tournées offertes, replace devant Bécu une poignée de sous, que celui-ci ramasse tristement, comme si c’était là les miettes de la belle pièce d’argent qui serait brisée.

Il a quitté l’estaminet.
Sur la route, il suit la direction opposée à celle du coron et ayant dépassé le dernier cabaret il s’arrête.
40
A droite, la vue est encore barrée par la palissade qui entoure la fosse, une clôture formée par d’anciennes traverses de voies ferrées que l’on a taillées en épieu et badigeonnées au goudron.
Mais à gauche s’étend la plaine, la plaine immense qui ondule sous la neige éclaboussée, sous la neige machurée par places de pustules noirâtres, de plaques sombres qui sont des corons et des fosses, jusqu’au mur gris et vague de l’horizon. Les lignes ferrées serpentent, s’entrecroisent sur des remblais, en minces rubans noirs, comme un réseau d’araignée; et l’on devine des routes et des canaux aux squelettes échelonnés des arbres. Sur l’immense étendue rase, des rumeurs roulent sourdement et des sifflements s’élèvent comme des fusées. Des innombrables cheminées géantes, les fumées sortent lourdes et se traînent toutes dans un même sens horizontal, en longues stries parallèles sur le ciel, où passent des bandes de corbeaux planant sur la tristesse muette des choses.
Le regard embrassant l’immensité décolorée, toute de blancheur et de noir, comme un paysage d’eau-forte, Bécu hésite, car un chemin, devant lui s’enfonce dans un champ ainsi qu’un profond sillon.
Enfin il se décide à quitter la grand’route. Et le 41 voici, les mains fourrées dans les poches, les coudes serrés au corps, marchant vite à cause de l’air froid qui commence à lui mordre la peau.
Les deux talus de l’étroite route encaissée et sinueuse cachent le paysage brutal. Et la voilà qui semble perdue, loin de toute chose, cette petite route solitaire qu’oppresse la morne grisaille du ciel d’hiver: perdue et solitaire, comme celle qui, là-dessous, s’en va mystérieuse, oppressée par un ciel pesant de ténèbres éternelles. Mais à un tournant, la plaine reparaît; et là, dans un large pli onduleux, se révèle une fosse que l’on ne voyait pas auparavant. Les quatre rangs successifs de son coron évoquent, par leur alignement discipliné, un souvenir de caserne ou de prison.
A la droite de la cité ouvrière se dresse le bâtiment d’extraction surmonté de son beffroi, à sa gauche, s’élève l’église toute en brique.
Mais la petite route ne va pas de ce côté; elle suit la pente contournante d’un vallon et conduit à une fabrique de sucre, laquelle attend, en un aspect de ruine et d’abandon, la prochaine récolte de betteraves, la récolte qui sortira des champs environnants, des champs déjà fécondés par les semences d’automne et qui maintenant dorment sous le drap blanc de la neige.
42
Bécu descend dans ce creux que l’on dirait laissé par un arbre gigantesque, déraciné de la plaine. L’immense étendue plate des terres et l’horizon lointain bientôt disparaissent. Une odeur de pulpe en pourriture stagne dans le vallon. Tout, ici, semble mort, alors qu’aux alentours la plaine respire.
Voici qu’il longe un mur de briques clôturant les terrains de la sucrerie. Et son pas fait hurler longuement un chien dans la fabrique abandonnée.
En face du portail fermé, de l’autre côté du chemin élargi par les charrois, il y a une maison de paysan avec grange et hangar pour les instruments de culture. Mais une enseigne apprend que c’est là aussi un estaminet. Au temps où la fabrique travaille, les ouvriers sucriers et les Belges qu’on emploie à l’arrachage des betteraves, doivent, aux heures des repas, y boire des triboulettes de bière blonde, en taillant leurs chanteaux de pain.
Bécu traverse le chemin aux ornières durcies, et cogne contre la marche du seuil ses souliers ferrés.
Pas un houilleur: la salle du cabaret est déserte, silencieuse comme l’usine, avec ce même air d’attente désolée. Seule une paysanne, près d’une fenêtre, tricote de gros bas de laine bruns.
43
Bécu, aussitôt assis, lui demande une bistouille, ce qui signifie du café renforcé d’eau-de-vie. Alors, la paysanne se lève, grande, sèche comme une bique et le teint bis comme la terre des champs qu’elle sarcle depuis l’enfance. Traînant ses savates éculées, elle va tisonner le poêle qui répand dans la pièce une chaleur de four, met une pelletée de charbon, puis ayant posé en plein feu la bouilloire elle dit d’une voix aigre:
—A ch’t’heure, faut que vous attindiez que ch’l’iau qu’alle bout.
Puis auprès de la fenêtre, elle va se rasseoir, et, reprenant son tricot, recommence le va et vient rapide et monotone des aiguilles longues. Parfois elle en retire une du jeu, et du bout pointu, gratte sa chevelure qui la démange.
Et lui, attend patiemment, en écoutant la chanson plaintive de l’eau.
Il est peut-être bien isolé et perdu ce lieu, et ce silence où pleure la grêle chanson est bien pesant; mais quand on a trente ans de fond, quand pendant trente ans on a rampé dans les profondeurs écrasées, côte à côte avec les veines noires de la terre, le cœur s’est habitué au silence et à l’isolement, comme les yeux se sont habitués aux ténèbres.
44
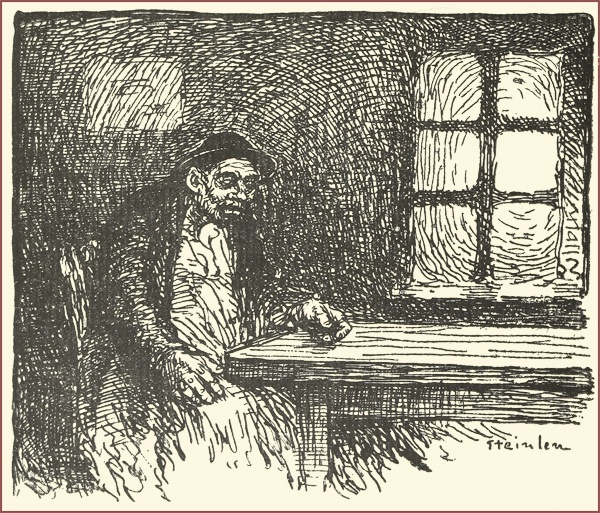
Puis, il préfère venir se cacher ici, car au moins, il peut y boire à son aise, à petits coups, en tête à tête avec son verre, sans la crainte de voir surgir dans le carré clair de la porte vitrée, l’énorme carrure de sa femme, la «rouge», comme on la surnomme au coron, à cause de sa chevelure rousse et de son teint allumé de femme toujours grondante.
45
Plus tard, quand il se sentira fort et plein de courage, c’est-à-dire quand il commencera à chanceler sur ses jambes, il ira boire les derniers verres au coron, près de sa demeure, avant de heurter du nez sa porte et de recevoir la terrible poussée donnée à poings fermés, qui l’enverra s’affaler sur le lit, où longtemps encore, déferleront les injures et par instant les gifles.
La paysanne a de nouveau arrêté le va et vient de ses bouts d’aiguilles entremêlés au sautillement de ses doigts secs. Elle s’est levée, pour verser l’eau bouillante sur la cafetière, et le liquide qui tombe, goutte à goutte à travers le filtre, égraine des petites notes claires.
Enfin la bistouille, le jus noir au relent de chicorée vitriolée d’alcool, fume devant lui. Ses grosses lèvres l’aspirent avec une joie goulue, et, après chaque lampée, il suçote les poils humectés de sa moustache. Il fait durer le plaisir, longtemps il gargarise son palais que met en éveil, la brûlure adoucie de l’eau-de-vie qui se dissimule et semble se faire désirer.
Sa bistouille finie, Bécu se carre dans sa chaise, allonge les jambes, élargit les épaules et la poitrine. On dirait que toute sa carcasse se dilate de contentement. Puis, il retire de son bourgeron un vieux morceau de 46 journal, où il y a du tabac, et se met à bourrer sa pipe en tassant fortement du pouce le tabac échevelé.
Alors, d’un nuage de fumée âcre, sort la voix sourde, la voix qui semble toujours résonner au fond de la mine.
—In verre ed geniève, de ch’ti lau qui pique.
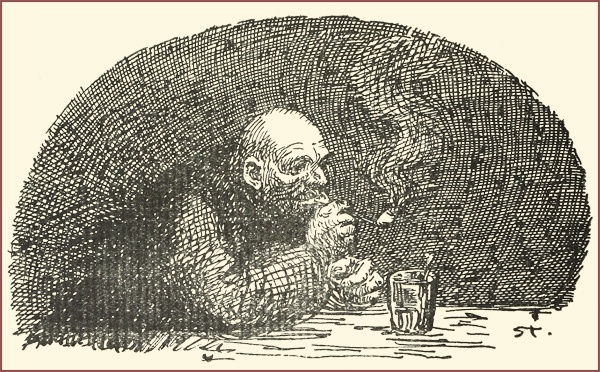
47

Cinq heures tombent lourdement de l’œil de bœuf accroché en haut du mur. Maintenant, dehors, il fait sombre; la nuit hâtive de l’hiver a effacé l’usine muette et aveuglé les fenêtres du cabaret. La lampe suspendue au milieu de la pièce l’éclaire d’un rayonnement assoupi, en laissant beaucoup d’ombre dans les coins.
Bécu en est à son huitième verre de genièvre, et ses yeux brillent au fond de leurs orbites. Ils ont les lueurs verdâtres et fugitives d’une flambée d’alcool, ils ont, ces yeux, les reflets métalliques et étranges du poison absorbé.
48
Quand il veut boire, c’est d’une main crispée qu’il saisit son verre et pour que le tremblotement de ses nerfs ne le vide pas, il y accroche brusquement ses lèvres. Alors, descend en lui cette eau ardente qui lui donne une bonne chaleur, là, dans sa poitrine, puis partout, et lui fait la tête légère, légère, comme si elle allait sur ses épaules tourner ainsi qu’une toupie.
Les idées, qui se mouvaient dans ce crâne en un roulement massif et lent de meule, maintenant sautillent comme ces images projetées sur un écran lumineux.
Lorsqu’un houilleur est remonté au jour, le souvenir du fond l’obsède; et il garde, dans les nerfs, la vibration rythmée des coups de pics, comme le marin, sur la terre garde dans les jambes le roulis du navire. Poursuivi par cette hantise du labeur, Bécu pense à la mine. Il pense loin de lui, et ses bras qui sont allongés sur la table, de chaque côté de son verre, frappent là-bas à la veine des coups enfiévrés par l’alcool.
A présent, il bredouille des mots: il imagine tout un colloque avec son porion, à propos du boisage. Et le voilà, lui si timide dans la réalité, qui à la fin se fâche et se met à insulter son chef. Alors, comme si le porion s’éloignait, il crie une dernière injure «Arsouille» à haute voix, dans le silence de la pièce.
49
Mais le voici qui se met à sourire, en laissant dégouliner un peu de salive du côté où il tient sa pipe. C’est que l’image de sa femme vient de lui passer par l’esprit. Et il se moque, dans la sûre quiétude de sa cachette, de cette face rougeaude toute bouffie de colère.
Décidément l’eau-de-vie lui chauffe trop la tête, car il a enlevé son chapeau de cuir, découvrant ainsi un crâne chauve, un crâne qui lui donne un air morose de vieil oiseau déplumé. Et maintenant, avec le sommet du front qui apparaît blanc, la souillure de houille plaquée sur le visage est devenue un véritable masque.
Près du fourneau, la paysanne épluche des pommes de terre pour la soupe du soir. Une à une, elle les jette dans la marmite, faisant éclabousser l’eau dont les gouttelettes grésillent. Elle demeure indifférente devant cet homme qui s’enivre, étant habituée à ces sortes de choses.
Son fils, un enfant d’une douzaine d’années, est venu s’asseoir devant une des tables. Il grignote un croûton de pain, en buvant un fond de chope que sa mère lui a versé. Et le petit paysan, aux yeux avides et au front déjà obstiné, regarde longuement ce mineur. Il songe sans doute à l’âge, où, lui aussi portera la barrette de cuir et touchera les grosses pièces blanches 50 des Compagnies, au lieu du maigre salaire du travailleur des champs; au temps où le dimanche, il fera ronfler les rayons clairs d’une bicyclette—le luxe de la jeune génération des corons—sur les routes qui mènent aux ribotes de la ville.
On a ouvert la porte. Le cultivateur, un homme robuste et sanguin, planté carrément sur les jambes, entre en disant «Bonsoir» d’une voix forte et rude, une voix accoutumée aux larges espaces des champs. Il dépose sur une table quatre planches de bois blanc qu’il a rapportées, sans doute pour réparer son clapier à lapins. Puis, il va s’asseoir près du feu et s’occupe à décrotter ses houseaux en toile bleue, avec la lame de son couteau.
Bécu, depuis un instant, s’assoupit sur sa chaise. La chaleur torpide de l’alcool l’engourdit. Ses membres sont devenus lourds comme si, dans les veines qui les sillonnent, se traînait du plomb. Sa grosse tête qui lui semblait si légère, prête à tourner comme une toupie, a roulé sur une épaule. Il a regardé le paysan entrer, déposer les planches de bois blanc sur une table, puis ses paupières lourdes se sont abaissées sur ses yeux.
Sa pipe, décrochée de la bouche, vient de se briser sur le carrelage avec un petit bruit sec.
51
—Le v’la qu’il a tout bu, a ch’t’heure, ce cochon-là....
Le mari a crié cela avec la haine qu’ont les paysans pour ces houilleurs qui gagnent beaucoup et gaspillent l’argent.
—Si qu’il m’ paie, ça n’est mi encore rien, a ajouté la femme.
Il dort, mais par instants ses lèvres remuent convulsivement, et ses grosses mains déformées, qui pendent contre les bougeons de la chaise, s’agitent et se contractent.
C’est que son cerveau de vieille bête de travail, son cerveau durci, calleux comme ses mains, s’exalte sous l’influence de l’alcool. Dans la nuit de son crâne, se déroule une vie monstrueuse, une vie désordonnée, frénétique, qui le fait tressaillir.
Il est au fond, il marche du pas léthargique des songes, il va à la lueur de sa lampe, suivant le sentier qui passe dans les forêts enfouies. Et partout ce sont des feuillages, des feuillages immobiles incrustés aux murs sombres. Les palmes élancées des fougères arborescentes se courbent vers des troncs de sigillaires aux écorces ondulées. On dirait un dessous de bois 52 somnolant dans l’ombre opaque. Parfois, la lueur de la petite lampe allume une lamelle de mica qui se met à luire comme le calice d’une fleur chimérique. Et de l’eau qui source, s’écoule avec le doux murmure d’un ruisseau glissant sous la mousse.
Mais le voici qui arrive à une clairière, à une taille.
Là, des hommes aux torses nus, leur chair livide dans la nuit qu’étoilent les lampes, conduisent la morsure des perforatrices qui mordent la terre rageusement avec un air de bête mauvaise. Elles allongent des dards qui semblent fouailler des entrailles et ont des sifflements de serpents en colère.
Lui, ne s’arrête pas; il continue à traîner ses jambes engluées, et rentre dans une galerie s’enfonçant dans beaucoup d’ombre et de silence.
Il va toujours de la même marche entravée et lente du rêve, dans l’humide obscurité de cette galerie qui est une voie de roulage. Ses yeux suivent, à la lueur qu’il porte avec lui, les deux éclairs des rails qui s’allongent dans le noir comme deux cornes.
Soudain, il sent que son chapeau de cuir frôle les bois d’étais, qui, transversalement, soutiennent le toit de la galerie. Pour avancer il courbe les épaules. Mais le frôlement recommence, le toit s’est encore abaissé, 53 l’obligeant à marcher sur les genoux. Et voici que l’atmosphère devient étouffante. Il s’arrête. Alors, avec horreur, il sent sur le dos, le toucher dur et glacé de ce toit qui continue de s’abaisser en un lent, très lent, mais irrésistible glissement. Ses reins doivent bientôt céder à l’affreux affaissement. Il s’aplatit sur le sol. Pour fuir, pour se dégager, il recule en rampant. Sa lampe s’éteint et dans l’étouffement des ténèbres, recommence la pression diabolique des quatre cents mètres de terre qui le surplombent. Sa poitrine ne peut plus se dilater au rythme de son souffle et ses tempes battent contre le roc. Il étouffe, il râle.
Mourir! Non, il ne veut pas mourir; il se débat, se révolte et, d’un sursaut de volonté, il se réveille.....
Ses yeux hébétés errent un instant dans la salle. Puis sans avoir bougé, dans la même pose affalée, les bras tombants, la tête gisante sur une épaule, il retombe dans le sommeil.
Et la vie du rêve reprend, fantastique et fantomale.
A présent, il va, la tête en avant, les jambes molles, dans un tâtonnement continuel de l’équilibre, à droite, à gauche. Il s’arrête, hésite entre une chute en avant 54 ou en arrière. Puis, il repart en quelques pas rapides que suit un nouveau repos vacillant.
La première rue du coron est là devant lui, toute droite, en un allongement de perspective démesurée. De toute la force de sa volonté il tend à l’atteindre. Mais elle pivote, avec ses deux rangées de maisons, comme un carrousel de chevaux de bois.
Il y avait là, près de lui, une palissade contre laquelle il allait s’appuyer. Or, celle-ci vient de disparaître. A cette même place, il voit maintenant un mont de betteraves.
Après une grande oscillation de tout son corps et une alternative de petits pas butés, zigzaguants, il vient se coller contre sa porte.
Brusquement on ouvre, l’appui se dérobe, et il entre dans sa maison comme s’il tombait dans le vide.
Sa femme est devant lui, énorme, terrible. Et derrière elle, dans un coin, étendu sur un lit aux draps très blancs où ondoie la caresse douce et blonde d’un cierge, son fieu repose, pauvre petit corps tout raidi.
—Ah te voilà, saligaud d’ivrogne! Et ch’ cercueil? l’as-tu acheté ch’ cercueil?
55
— !
—Non? Alors qu’est-ce que t’en as fait de ch’ l’argent? Tu l’as encore bu, dis, saligaud? Et l’ petiot on va être obligé de l’ mettre comme il est là dedans l’ froidure de l’ terre! Ah tiens, un père comme ti, on devrait le jeter du carreau de l’ fosse, dans le fond de ch’ puit, dans ch’ bougnou!
Tout se brouille devant lui, une gifle lui a éclaté dans la figure. Une poussée dans les reins, l’envoie s’affaler dehors.
Sa grosse tête a frappé sur le pavé, mais il n’a ressenti qu’un choc très mou. Il se redresse et va s’adosser contre le mur, auprès de la fenêtre.
La rue toujours si animée par les enfants qui jouent, par les femmes qui voisinent, est déserte. Les maisons semblent inhabitées. Quelque chose de lugubre et de tragique plane dans le silence.
Et le malaise qui vient de cette absence de vie, de toute cette immobilité, est encore accru par une fin de jour sinistre. Dans le prolongement de la rue, à l’horizon, s’abaisse un coucher de feu et de sang. Des vitres, aux fenêtres closes, s’allument et rougeoient; les silhouettes des cheminées, les arêtes et les saillies des 56 toits, s’entourent d’un cerne lumineux couleur de soufre, et les ombres s’allongent.
Appuyé contre le mur il ne bouge pas. Il regarde autour de lui avec des yeux troubles, et son cœur inquiet écoute le calme surnaturel.
Soudain, une rumeur monte sourdement, une rumeur de foule, avec un piétinement lointain et confus. Cela grossit, et cela s’approche; on dirait tout un peuple en marche.
Bientôt apparaît une sorte de marée humaine dont le flux pénètre dans la rue qui l’endigue.
Bécu de loin reconnaît des barrettes de cuir, des serre-tête de toile bleue. Ce sont des houilleurs qui viennent du fond. Mais il y a aussi parmi eux des femmes, des enfants. Et ils sont tant et tant, que tous ceux du pays noir ont dû se donner rendez-vous ici bien sûr.
Les voilà, ils vont le frôler dans leur marche. Bécu frissonne car tous le regardent, tous rivent leurs yeux aux siens.
Puis, maintenant, chacun d’eux fait en passant un geste de menace ou de dégoût et chacun lui jette une injure comme s’il lui jetait une pierre: Ah l’ mauvais 57 père! Ah l’ saligaud d’ivrogne; il a bu ch’l’argent de ch’ cercueil!
Un galibot pas plus haut qu’une botte, l’a injurié aussi, d’une petite voix exaspérée, aiguë, qui lui entrait dans la tête comme une vrille. Ensuite c’est une trieuse, une jolie fille souriante sous les plis flottants de son béguin et qui fait en passant, une moue dégoûtée puis crache par terre. Un houilleur, un vieux camarade à lui s’est arrêté, l’a fixé longuement avec des prunelles sombres; après quoi il s’en est allé en secouant tristement la tête.
Il en vient encore, il en vient toujours: des hommes, des femmes, des gosses. Il y a parmi eux des gens qu’il avait connus il y a bien longtemps et dont il ne se souvenait plus. Il a même reconnu un homme qui fut tué il y a dix ans d’un coup de grisou.
Et sur les poings tendus, sur les faces qui crient l’injure, le couchant sinistre met une lueur de sang.
Terrifié, Bécu se détourne pour ne plus voir. Mais voici que par la fenêtre de sa maison, il aperçoit la petite flamme blonde du cierge qui veille. Il voit aussi sur l’appui intérieur son corbeau apprivoisé, son corbeau aux ailes rognées qui va et vient en boitillant—oiseau 58 funèbre—et qui méchamment frappe du bec le carreau.
Alors, Bécu se cache le visage dans les mains et se met à hurler plaintivement, comme on hurle dans l’angoisse du cauchemar.
Le paysan qui a fini de décrotter ses houseaux et qui silencieusement fume sa pipe, trouve que ce mineur saoul dort bien longtemps, d’autant plus, que celui-ci l’énerve par ses soubresauts et par les gémissements qu’il pousse dans son rêve.
Il décide de le réveiller. Pour cela, il va prendre les quatre planches de bois blanc qu’il a déposées sur une table et, s’esclaffant de rire, les laisse tomber de très haut sur le carrelage.
D’un bond Bécu s’est levé, éperdu. Et les yeux fous, le regard comme fasciné en apercevant les quatre planches de sapin qui semblent les bris d’une bière neuve, il tend vers elles des bras raidis de visionnaire, des bras qui se défendent contre une apparition. Puis il fait entendre une sorte d’aboiement rauque d’où les mots sortent étranglés: ..... ch’ cer..... ch’ cer..... ch’ cercueil.....
59
Le paysan ne rit plus. Sa femme et son fils se sont levés. Tous trois contemplent cette face de folie et tous trois sentent passer en eux un frisson d’épouvante.
Éveillé, le malheureux voit encore le surnaturel et le fantastique de son rêve.
Maintenant ce n’est plus comme dans le sommeil la seule illusion imaginative de la peur. C’est un effroi atroce de toute la chair, c’est une panique du cœur et un spasme hideux des nerfs.
Mais l’hallucination ne dure qu’un instant. Comme un ressort qui se casse, les nerfs brusquement se détendent et les bras roidis tombent.
Seul, le regard conserve une expression d’étrange égarement. D’une main inerte, mollement, Bécu s’essuie le front, puis il prend son chapeau de cuir posé sur la table et le met sur son crâne chauve.
A ce moment, la paysanne vient se planter devant lui, tout son long corps maigre de vieille bique frémissant encore. Et d’une voix blanche:
—Ah! mais avant de vous ensauver y faut m’ payer; cha fait trente sous que vous me devez.
Lui, gauchement, tâte son bourgeron et en tire un 60 franc ainsi qu’une petite pièce. Quelques sous sont tombés, il ne les ramasse même pas.
Il se dirige vers la porte, non en titubant comme un homme ivre, mais du pas défaillant d’un homme qui vient de recevoir un grand coup sur la tête.

61

Il avance dans la nuit glacée.
Tout est sombre dans le vallon, il n’y a que les deux yeux lumineux de la maison d’où il sort qui le regardent s’éloigner.
Le chien a encore hurlé dans la fabrique abandonnée 62 et puis s’est tu, n’entendant plus le long du mur le pas rôdeur.
La gorge serrée, la poitrine pantelante, Bécu va à pas entrecoupés. Dans sa tête bourdonnent encore les imprécations de la bande hurlante—mauvais père—salaud d’ivrogne. Les mots argent et cercueil lui martèlent le cœur tour à tour, comme les gros marteaux des forgerons viennent l’un après l’autre, en cadence, frapper l’enclume.
De son cauchemar, il lui reste une sensation physique étrangement douloureuse et un frisson de mystère. Le souvenir des reproches et des insultes de la foule fantomatique l’effraie d’une façon superstitieuse et l’accable comme une malédiction.
Il éprouve encore l’épouvante du surnaturel.
Quoique conscient d’être éveillé, il craint que cette nuit sans ciel, ces ténèbres épaisses—comme elles l’étaient là-bas au fond quand sa lampe s’est éteinte—il craint que cela ne soit la continuité du songe et qu’autour de lui ne surgisse encore d’affreuses choses.
Le mois passé, durant l’horrible agonie de son petit gars qui avait été pressé entre deux berlines, il pleura. Le jour de l’enterrement, lorsqu’il vit le fossoyeur enfouir le cercueil, il dut s’appuyer au bras de son fils aîné. Et 63 puis ce fut tout. Les jours suivants, où reprit sa morne existence de houilleur, il ne ressentit plus rien. Peut-être que, lorsqu’on a travaillé toute sa vie enseveli sous terre, il vous est entré tant de noir dans l’âme qu’il n’y reste plus de place pour la tristesse.
Mais ce cauchemar, c’est comme si son enfant s’était dressé devant lui pour le maudire. Et cet argent qu’il a dans la poche, cet argent du cercueil, lui paraît un fardeau.
Il avance toujours droit devant lui, montant péniblement la pente du sol vaguement pâlie par la neige.
Tout à coup, dans l’espace de ténèbres, une énorme étoile surgit; puis deux, puis d’autres encore, brillant toutes d’un éclat immobile.
C’est l’infini de la plaine avec les lumières électriques de ses fosses.
Au loin, vers la gauche, un immense incendie projette au ciel une large lueur. De hautes flammes se tordent, bleuâtres et sanglantes. Et sur ce lointain embrasement des fours à cokes, un vieux moulin du temps passé se silhouette les bras en croix.
Bécu s’arrête pour souffler, et aussi parce qu’il y a là, barrant sa fuite éperdue, une grande route dont 64 les arbres dessinent en noir leurs squelettes tortionnés sur la sinistre lueur.
Il n’aurait qu’à la suivre cette route, pour rentrer au coron.
Il hésite... Mais non, il ne la suivra pas car le coron, sa maisonnette de brique, tout cela pour lui reste hanté. Il les revoit par la pensée comme il les a vus en rêve. Il en garde un effroi surnaturel, l’effroi des êtres simples qui croient aux mauvais présages et aux revenants. Le lit mortuaire caressé par la lueur blonde du cierge, la foule maudissante, ce coucher de soleil dans lequel le coron baignait comme dans du sang, jusqu’à son corbeau apprivoisé qui frappait méchamment du bec à la fenêtre, tout ceci lui apparaît comme de sinistres et mystérieux ressentiments. Et sa conscience confuse, dans une sorte de remords, lui fait entrevoir la profanation qu’il a commise en s’ivrognant avec l’argent destiné à payer le cercueil.
Mauvais père!... Il lui semble par moments que c’est le petit mort qui lui crie cela. Et cette idée lui bat le crâne comme le battant d’une cloche.
Il recommence à fuir.
Il a traversé la route et s’en va à travers la plaine buttant ici, glissant là.
65
Tout à coup il s’arrête. Là-bas, sur la neige, quelque chose de noir remue. C’est une forme vague qui rampe à droite, à gauche, ensuite s’arrête, se rapetisse, puis rampe encore en s’étirant.
Une nouvelle terreur l’étreint. Quelle est cette étrange chose qui s’avance en zigzag?....
Enfin cela se précise. Bécu reconnaît une horde silencieuse de chiens chargés de tabac de zone et que conduit un contrebandier.
Les chiens, l’homme, s’évanouissent dans la nuit, troupeau et pasteur fantômes.
Alors, lui, recommence à déambuler.
Mais trois cents pas plus loin, il s’arrête encore. Il se trouve devant le remblai d’une voie ferrée et un sifflement vient de déchirer le silence.
Bientôt, un gros disque flamboyant apparaît et grandit, augmente d’éclat, lançant sur les rails un jet lumineux. Puis, un grondement trépidant accourt. Et la monstrueuse locomotive, ébranlant le sol, passe en ronflant, avec un hiement de bielles, avec toute une résonance de sa carcasse de fer mêlée à l’ébrouement de vapeur qui sort de ses poumons d’acier.
Celle-ci emmène un train de houille, cinquante wagons, lesquels semblent dans l’ombre, le corps annelé 66 d’un serpent qui ondule rapide à la courbe de la voie.
Et cela disparaît éventrant la nuit.
Longuement, Bécu suit des yeux le fanal rouge accroché à l’arrière du train. Et même après que la petite lumière sinueuse a disparu, il reste encore un instant immobile, fixant l’endroit où les ténèbres se sont refermés comme se referme l’eau sur une chose qui sombre.
Puis il monte sur la voie et la traverse. Mais en redescendant le remblai, il glisse et tombe sur le dos. Lentement, il se relève, replace sa barrette de cuir sur son crâne chauve, et le pas épais, les bras ballants, il repart droit devant lui dans l’obscurité.
Pourtant, l’air gelé de cette nuit d’hiver, cet air qui semble devenu consistant comme de la glace, lui enserre plus étroitement le front, les tempes. Peu à peu se fige l’effervescence de son cerveau.
Déjà les visions s’éteignent et leur souvenir se voile.
Ce qu’il y avait de surnaturel et de menaçant accroché à lui meurt tué par le froid.
Il ne marche plus inconsciemment, fasciné par la peur; il reprend graduellement contact avec le réel. Voici maintenant que cette immense houle de ténèbres 67 parsemée de points brillants lui redevient familière.
Ses yeux devinent la plaine sous l’embrun opaque des ombres.
Les éclats bleutés, essaimés sur ce grand lac d’ombre, le guident, comme en mer, les constellations guident le pêcheur.
Là-bas, où il y a trois feux électriques, c’est la fosse numéro 4, baptisée Saint-André. Ces deux feux plus proches et ce hall, dont le vitrage est éclairé, c’est la fosse numéro 7 ou fosse Sainte-Marie-Madeleine. Tout au fond, un groupe de lumières qui clignotent, tant elles sont éloignées, c’est une fosse de la Compagnie d’Heurchin.
La sienne, oh il sait bien où elle se trouve, elle est là, dans la direction de la lueur qui monte des fours à coke. Pourtant on ne voit aucun de ses fanaux; sans doute une ondulation de terrain la cache-t-elle pour l’instant.
Parfois, dans le vague, s’élève le bruit d’un choc puissant, le bruit de deux choses de fer entre-heurtées. C’est une seule note sonore qui s’élève, s’étend. Et à l’ampleur des vibrations se révèle l’immensité rase. Ou bien, c’est le roulement d’un train, une rumeur sourde qui s’éloigne et expire sans écho.
68
Et lui, devine, et lui écoute la vie formidable et cachée de la plaine.
Il ne regarde plus en lui-même, car en lui tout est redevenu immobile et sombre. La grande flambée de l’exaltation et de la fièvre s’est éteinte. Tout ce qui grimaçait, toutes les idées et les mots qui flamboyaient, tout cela a disparu.
Mais ce calme subit, il ne le raisonne même pas. Il subit l’effet apaisant du froid sans apprécier la sensation de bien-être. Car chez cet être hébété de servage et d’alcool, il arrive souvent que les impressions se succèdent sans se souder l’une à l’autre par un raisonnement.
Cependant, il n’oublie point avoir bu avec un argent qu’il n’aurait peut-être pas dû dépenser au cabaret. Mais comme en lui une froide sécurité a étouffé ce qui lui apparaissait avant comme de sinistres ressentiments, il ne sait plus très bien s’il commit une vilaine action. C’est au fond de son âme quelque chose de trouble, impossible à débrouiller. Avec le calme, il redevient la bête de somme indifférente, la pauvre brute accablée par vingt ans de fond, avec ses demies sensations informes, ses demies pensées mal équarries.
69
Il a repris son allure épaisse, sa marche aux pas affaissés. Mais il grelotte, serre ses épaules, car l’alcool éliminé ne lui chauffe plus les veines. Alors, il prend la direction du coron, fuyant le froid, comme il fuyait talonné par la peur. Il ne cherche même pas à se représenter comment sa femme va l’accueillir.
On n’aperçoit plus les flammes des fours à coke, on ne voit plus que la lueur qui dans le ciel fouille les gros nuages d’encre. Des feux électriques ont disparu.
Soudainement, à sa droite, le blanc indécis de la neige vient de disparaître. Et dans un vide qui s’allonge tranchant le sol pâle, des petites clartés glissent, très lentes. On entend des voix qui se répondent, avec une longue sonorité, une portée flottante. Puis, un éclair en coup de faux, un éclair très bleu, révèle furtivement le canal et un chapelet de péniches chargées de houille, que hâle, roulant silencieuse sur la berme, la locomobile électrique dont le trolley vient de faire dans la nuit une fulgurante déchirure.
Bécu ne détourne même pas la tête pour regarder le canal. Une sirène ayant meuglé lugubrement au loin, il écoute ce signal. Et voici que sa pensée lourde, s’enfonce là-dessous, au fond, là où rampent les camarades de la coupe à terre.
70
«A quelle heure vont-ils remonter cette nuit? A onze heures? Où peut-être bien encore à la demie passée douze heures.» Cette simple idée, il la tourne, la retourne, la mastique longuement. Elle occupe son cerveau jusqu’au moment où il a atteint la grand’route qu’il avait auparavant hésité à suivre.
Maintenant, sur ce sol pavé qu’aucune neige ne recouvre, à cause des nombreux charrois de houille, on entend résonner son pas solitaire.
Des profondeurs de la plaine, un peu de vent s’est levé, qui souffle et pleure dans les peupliers décharnés bordant la route. Et là haut, dans le ciel noir, transparaît vague et blême, la face cachée de la lune sur laquelle, lentement, glissent des nuages semblables à des voiles de deuil.
Il se hâte, grelottant, meurtri de fatigue.
Mais voici que, tout à coup, deux rais de lumière transpercent l’embrun des ténèbres. Une maison se trouve là, au bord de la route.
Derrière les fenêtres flambantes, on voit des silhouettes se démener avec des gestes grandis; on voit des profils anguleux, arrêtés au front par la saillie rigide des barrettes de cuir, se confondre violents et tourmentés. Des cris rauques, des rires énormes, font 71 vibrer les vitres. C’est là dedans une ivresse sauvage, une gaieté désespérée, pareille à une exaspération.
Sur la route on n’entend plus le bruit mélancolique du pas solitaire. Bécu est immobile. Il fouille dans son bourgeron; ses doigts font tinter des sous, ceux qui lui restent encore de l’indemnité funèbre.
Comme la gueule hurlante et enflammée d’un monstre, la porte vient de s’ouvrir, puis elle s’est refermée sur lui.
Et là, tout autour, il fait sombre: sombre comme dans cette pauvre âme humaine.

75

Multitude
Solitude
Le jour se lève, blême dans le brouillard qui enlinceule la plaine. Et dans cette lourde vapeur qui flotte sur le sol noir et gluant, s’épand un meuglement sinistre comme en clament tristement les gros vapeurs perdus dans la brume.
Confuses et vagues dans le brouillard qu’elles semblent déchiqueter, des silhouettes humaines se meuvent, avec un piétinement sourd.
76
Et cette exode d’ombres s’avance de partout, vers l’étrange appel.
A travers un champ labouré, écrasant de leurs sabots les lourdes mottes humides et luisantes de la terre éventrée, une bande de trieuses se hâte dans une marche trébuchante. Frileuses sous leurs robes de cotonnade bleue parsemée de pois blancs, elles vont les bras croisés, les mains cachées sous les aisselles, en faisant un gros dos sur lequel flottent les jolis plis du mouchoir de percaline dont elles s’entourent coquettement la tête. Elles ne causent guère, mais lorsqu’un sabot reste englué au fond d’un sillon, ces fillettes jettent de leurs voix claires, des jurons comme les hommes.
Elles ont atteint une petite route pavée qui passe au bout du champ et leurs sabots font entendre maintenant, sur les grès, un clappement sec, presque joyeux, dans ce jour lugubre où plane le rugissant appel à la peine.
Tout à coup surgi de la brume, un homme sur la route les croise. C’est un grand gars vêtu de toile grisâtre, maculée de houille, avec un foulard de laine 77 rouge enroulé autour du cou et dont la face apparaît très pâle sous la barrette de cuir noir.
Une des trieuses, une maigre fillette aux joues creuses, qui suivait les autres à l’écart, s’est brusquement arrêtée devant l’homme. Tous deux se sont reconnus et se considèrent un instant en silence tandis que le clappement des sabots s’éloigne.
Alors, craintivement le petite interroge:
—«Eh bien Honoré, te vlà? T’es mi donc descendu au fond a ce matin?»
—«Ah non, pour sûr! Et puis j’y descendrai mi demain non plus, ni après-demain, ni les autres jours non plus, vu que j’en on quasiment soupé de l’ Compagnie.»
Il a répondu cela nerveusement, avec l’entêtement exalté d’une ivresse d’alcool qui a dû commencer hier, aussitôt après la remonte: ribote qui sans doute a duré toute la nuit dans quelque estaminet avoisinant les fosses, puisqu’il porte encore son bourgeron de travail.
La petite demeure passive, habituée aux propos qu’ont les hommes dans leurs soûleries, habituée à ces idées de révolte qu’ils ont tous ici quand ils ont bu.
Lui, détourne la tête, d’un pressement de lèvres fait gicler sur le sol un jet de salive, et, du revers de sa 78 main fébrile, essuie sa fine moustache de joli blond. Puis il reprend:
—«Ah! ben que non! j’y descendrai plus dans les fonds de par ici. J’on retiré min livret, je vas m’embaucher en Belgique, dans le Borinage. Demain à l’heure d’aujourd’hui j’aurons passé l’ frontière ».
Très raide, sans tituber, mais le regard fou, il a fait un geste ivre qui indiquait les au-delà de la plaine.
La petite reste encore silencieuse, mais maintenant son maigre visage se crispe. Ses paupières battent un instant sur ses yeux devenus fixes et troubles, et deux larmes coulent sur ses joues. Pour les cacher, elle baisse la tête et se met à tourner d’un gauche va-et-vient le talon de son sabot dans la terre molle.
Elle reste muette devant lui, toute petite et chétive, avec un air souffreteux et soumis, le dos voûté, tournant toujours gauchement le talon de son sabot dans la terre.
Mais, l’homme qui grelotte, les mains dans les poches, pendant que l’alcool le brûle sous la peau, brusquement s’écrie, piétinant à reculons, pressé sans doute à présent de regagner les corons:
—«Allons la Marie, je te dis adieu, et aussi bonne chance . . . . »
79
Elle le regarde s’évanouir dans la brume et ses yeux semblent s’agrandir et son regard s’affoler, comme si la plaine voilée l’entourait d’un espace immense et vide, un vide qui lui donnerait le vertige.
Le meuglement sinistre s’est tu; mais au loin, dominant de sourds roulements et des heurts profonds, s’élèvent des sifflements mélancoliques et les lamentations sonores du fer.
Avec une hâte convulsive, comme une bête blessée, la fillette suit de nouveau la petite route pavée qui s’enfonce là-bas, vers l’inconnu en rumeur.

80

Elle n’avait pas quinze ans lorsqu’il la posséda un soir. Elle s’était laissée entraîner à l’écart par celui-là, parce qu’il avait des yeux très bleus et très doux. Il l’avait possédée sans lutte, car dans l’ombre, lorsqu’elle avait senti sur ses lèvres la bouche du gars, elle avait aussitôt sur lui refermé les bras passionnément.
Presque toutes commencent d’abord par une recherche vicieuse dans un coin, avec un galibot de leur âge. Après, par une veulerie d’âme et des sens, par lassitude aussi de se défendre, elles abandonnent leur corps au hasard, parmi les centaines et les centaines de mâles. Mais la fillette s’était donnée par un coup de cœur, et, comme l’amour est une chose forte et saine, dès ce soir-là, elle repoussa brutalement le frôlement 81 des autres gars. Ce fut chez cette enfant la fidélité farouche de la femme qui aime.
Mais à quoi bon cette fidélité! Marie n’existait pas plus pour Lui—moins peut-être—que les autres filles qu’il culbutait au hasard des rencontres, dans une frénésie fouettée par l’alcool, qui rendait son acte semblable à un viol. Et lorsqu’il la trouvait sur son chemin et qu’il était sans désirs, il passait, sans lui adresser une parole, indifférent au doux regard qui longtemps le suivait.
Alors que l’homme demeurait la brute aveugle et insensible, cette fille du peuple, abêtie par atavisme et les trop hâtifs labeurs de la mine, était initiée par son cœur à tout ce que la passion fait naître de sentiments complexes et douloureux. Dans sa raison frustre survint un idéal, une aspiration vers un bonheur imprécis mais soupçonné, et, au milieu de ses pensées vulgaires, habita la rêverie. Elle souffrit de ne pas se sentir entièrement possédée, de ne pas lui appartenir davantage, de ne jamais voir la douceur menteuse des yeux très-bleus s’éclairer pour elle d’une lueur d’amitié. Sa laideur aussi la tortura, car elle pensait que celle-ci était la cause de cette indifférence, et cela rendit son amour encore plus craintif et dissimulé. 82 Elle eut les navrantes coquetteries des filles laides. Puis, pendant les rares instants d’étreintes, elle essaya de lui exprimer tout ce qu’elle ressentait. Mais il ne fut point encore touché par tout ce que cette passion fit vibrer pour lui du lourd et grossier patois.
Une fois, le hasard voulut qu’elle le surprit caressant une moulineuse entre les piles de madriers servant aux boisages de la mine. Lui se redressa, furieux, croyant que la petite était venue là pour les épier. Il ramassa une pierre et la lui lança à toute volée. Elle ne fut pas atteinte, mais elle reçut un choc douloureux au cœur, comme si la pierre y avait fait une blessure.
Rongée par un désespoir silencieux et par une jalousie sans révolte, elle a vécu jusqu’à maintenant une existence de fièvre et de misère à travers les jours et les mois, avec seulement un peu de bonheur longuement espacé pour la soutenir: ces minutes brèves où il la tient brutalement sous lui.
Le désir de mourir lui était pourtant venu dans un moment de plus grande détresse et de découragement.
C’était un soir d’hiver, elle longeait le canal; les rafales qui galopaient par la plaine rase hululaient aux gibets de fer et aux câbles électriques du chemin de 83 halage; l’eau morte était immobile. L’idée lui vint pour en finir, pour dormir toujours, pour ne plus sentir cette plaie vive au cœur, de s’ensevelir-là entre ces berges, dans cette chose d’épouvante comme le vide. Elle s’arrêta et s’approcha, mais soudain elle eut un recul de terreur comme si elle avait vu une chose affreuse et elle s’enfuit jusqu’au coron en sanglotant.
Ce ne fut qu’un spasme de désespoir qui jamais ne revint. Souffrante et résignée, elle continua à l’aimer, sans que nul soupçonnât que, sous l’enfant laide et chétive, il y avait une amoureuse au cœur exalté, sans entrevoir l’amour fanatique, l’amour navrant qui la faisait taciturne dans la horde bruyante de ses compagnes.

84
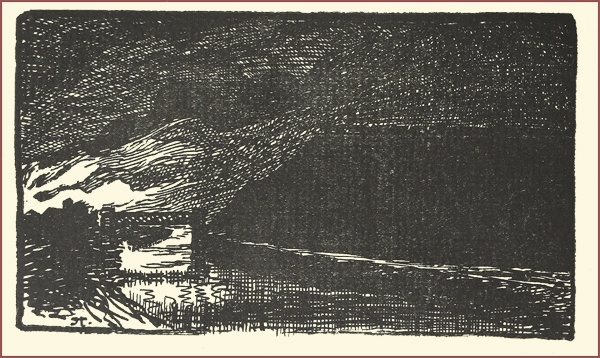
Courbant sa maigre échine, elle se hâte. Maintenant elle longe un grand talus, quelque chose de haut et de vague, très sombre; et cette immense tâche noire du terri, lui semble le reflet de son âme. Elle traverse des voies ferrées, passe entre des files de wagons vides, puis devant elle, se dresse une forme géante qui s’allonge confuse dans le jour embrumé et livide, en une sorte de beffroi.
Jamais, elle ne lui est apparue aussi triste, cette grande carcasse de fer qu’empanachent au rythme de leurs râles crachotants les tuyaux de vapeur, ni plus angoissant ce ciel d’automne bas et délavé, qu’endeuillent encore les lourdes torsades de fumée noire vomie par une cheminée massive.
85
Sur la bâtisse sombre, une inscription en grosses lettres blanches se détache: Fosse Sainte-Marie-Madeleine. Oh! l’ironie de ce doux nom mystique donné à cette chose noire et sinistre!
Comme elle gravissait la dernière marche de l’escalier qui aboutit à la salle de triage, le surveillant du carreau lui pointa une amende. Elle eut un juron, un mot ordurier entre les lèvres, et vint se ranger parmi celles de son équipe, au bord de l’une des longues glissières aux fonds mouvants, sur lesquelles le charbon passe comme un lent ruisseau.
Ses mains se mirent aussitôt à happer au passage les pierres mauvaises et à les jeter dans une manette. Le geste continu, le geste monotone, cette houille qui passe et passe interminablement de son cours uniforme, peu à peu cela lui fascine la pensée, enveloppe sa raison d’une abrutissante torpeur.

86

Elle ne pense plus. Le souvenir a sombré dans le cours de ce ruisseau de houille où il faut puiser et puiser toujours les pierres brillantes. Mais, aujourd’hui, pour la première fois, tous les bruits du triage irritent ses nerfs: grondements des berlines sur les armatures de fer, crissements des engrenages, et chaque conversion fracassante des culbuteurs la fait tressaillir. L’odeur moite et grasse du charbon l’écœure, l’embrun de poussière fuligineuse, au miroitement métallique, qui s’élève des cascades venues des berlines déversées, gêne sa respiration. Elle étouffe..... Sa manette lui échappe des mains, un râle rauque sort de sa gorge et elle tombe à la renverse, toute roide, les yeux 87 révulsés. Les trieuses se précipitent et la transportent jusqu’à l’ouverture béant sur la plaine, qui se révèle hérissée de bâtiments sombres. Le surveillant accourt, et, bourru, les renvoie toutes au travail.
Une seule fille est restée; penchée, elle dégrafe le corsage. Mais la petite exhale un long soupir et ses yeux se rouvrent, un peu égarés. Puis aussitôt, sans une parole, avec un geste frileux de pauvre enfant chétive, elle reboutonne sur sa poitrine creuse le corsage entr’ouvert.
Debout, elle refuse de retourner au coron comme le lui conseille le contre-maître.
—Mais oui!... que t’es bête! retourne chez ti, puisque t’as tombé du haut mal, insiste la fille qui l’aide à rajuster son béguin.
Non, elle ne veut pas; le visage fermé, elle regagne son poste.
Le surveillant, une main accrochée à la lanière de son sifflet de commandement, est debout sur une passerelle d’où il enveloppe le triage de ses regards soupçonneux.
Toutes les trieuses sont redevenues muettes dans le vacarme grondant et criard des machines, que semble animer une cruauté froide qui veut, qu’à leur 88 contact, s’usent des générations. Elles sont attentives, leurs gestes actifs happent le schiste; et voici que les robes bleues à pois blancs, les gracieux mouchoirs aux plis flottants, tout cela a repris, sous la discipline, l’aspect d’un uniforme de bagne.
Le travail a de nouveau absorbé la fillette. Ses mains vont et viennent régulièrement de la glissière à la manette qu’une trieuse remplace par une autre lorsque les pierres en débordent. Elle n’a plus conscience de sa vie, elle fait partie de toute cette machinerie, de tous ces outils qui pivotent et trépident avec précision; la voici devenue une pauvre chose, semblable à une de ces petites poulies qui tournent en grinçant plaintivement.
Et les heures passent, lentes et monotones, charriées semble-t-il, par le lent ruisseau de houille.

89

Le bourdonnement sonore d’un timbre électrique a retenti à la recette, à l’orifice du puits d’où émergent brusquement, entre les montants de fer, les cages qui contiennent les berlines. Le langage cynique du mineur nomme cela «la sonnerie à la viande» parce qu’elle est pour le machineur chargé de régler la marche des cages, le signal de la remonte des ouvriers.
Un coup de sifflet répondant à la sonnerie de la recette a vrillé le hall du triage; la source qui l’alimente va tarir, jusqu’à ce que ceux qui ont saigné les veines noires de la terre soient remontés. Avec une gaieté bruyante, une exubérance de jeunesse qui a été opprimée par la discipline, les trieuses se bousculent, enjambent les glissières, sautent les degrés des gradins de criblage, ce qui fait vaciller, sous la cotonnade, les pointes de leurs seins. Les plus impatientes à atteindre le carré libre de machineries où elles vont toutes 90 prendre leur repas, pincent les croupes de celles qui les précèdent et qui se retournent alors en criant des mots abominables.
Assises sur le carrelage, le dos appuyé contre le mur ou contre des civières pleines de schiste, elles retirent les chanteaux de pain hors des musettes de toile. Les dents qui mordent avidement, apparaissent très blanches, dans les faces souillés par la poussière noire et les yeux, largement cernés de bistre, ont un éclat étrange.
Un gros bidon de fer-blanc passe de main en main. Chaque trieuse fait pisser de très haut, dans son gosier tendu, la bière blonde qui glougloute dans le goulot. Et un grand rire les secoue toutes, lorsque une voisine ayant poussé celle qui boit, le liquide lui inonde les cheveux ou le visage.
La petite souffreteuse n’est pas avec ses compagnes; elle est restée à l’écart, cachée derrière un culbuteur. Accroupie, la tête entre les mains, les coudes sur les genoux, elle songe. De l’endroit où elle s’est blottie, ses yeux mornes voient les cages qui, soudainement sorties de l’abîme et encore toutes trempées d’ombre, s’accrochent avec un bruit saccadé aux verrous. Ils voient les moulineuses attirer les berlines d’où 91 bondissent, comme des diables, des hommes effrayants, aux faces noires dans lesquelles roule le blanc des yeux, et qui s’en vont pressés.
Elle songe aux autres remontes qu’elle venait épier jusqu’à ce que, d’une berline, ce fut Lui qui surgit, ce qui lui donnait un petit choc au cœur, doux et nostalgique. A présent, autour d’elle, c’est le vide; elle se sent seule, toute seule, malgré le grouillement humain de la fosse.
Là-dessous, dans les entrailles de la terre, c’est le vide aussi: le chantier souterrain où souvent descendait sa pensée n’est plus qu’un amas de nuit.
Ce Borinage? Eh bien, oui, elle voudrait le suivre jusque-là, humblement, de loin, comme un chien suit, désolé et craintif, les pas d’un maître qui veut le perdre. Mais elle n’a pas l’âge d’agir à sa volonté; et puis, elle est si lasse!....
C’est fini à jamais. Elle ne pourra même plus l’aimer par le regard, elle ne pourra plus rôder autour de Lui comme jadis; sa chair ne connaîtra plus l’anxiété frémissante de l’attente, l’attente d’une de ces possessions si brèves, mais qui, malgré tout, la rendait heureuse jusqu’à ce que l’éternel inassouvissement la rongeât de nouveau sourdement.
92
En cet instant elle se sent encore plus laide et misérable et rompue aussi, comme si les engrenages l’avaient happée, broyée, puis rejetée sur les dalles de fonte.
Les cages qui remontent des mineurs ne redescendent plus à vide; d’autres travailleurs se tassent dans les berlines qu’on repousse sur les barreaux. Ceux-là vont déblayer les terres, dégager la veine pour la saignée du lendemain. Ils tombent dans le vide, et, à leur suite, le large câble qui se dévide du haut du beffroi, défile avec un bruissement d’aile.
Et longtemps encore la petite demeure immobile, les regards hantés, si frêle parmi toutes ces choses de fer pesantes et farouches qui l’entourent.
Un nouveau signal: la gueule de ténèbres a fini de vomir et d’avaler des hommes. Et voici que la machinerie compliquée du triage reprend ses mouvements rythmés. Les raclettes crissent, les arbres ronronnent dans les coussinets, les pignons grincent des dents, tous les muscles durs et noirs pivotent, virent, et des tuyauteries s’élève une buée qui semble la sueur du fer et de l’acier qui travaillent. Du haut des tréteaux, les culbuteurs, en chavirant les berlines emboîtées, déversent des cataractes de houille sur les cribles en 93 gradins, et les cataractes deviennent des cascades, puis des ruisseaux lents qui se perdent enfin là-dessous, dans le hangar où s’entrechoquent des wagons et où respire puissamment une locomotive.
Les filles-outils ont repris la monotone, l’abrutissante besogne. Et la petite désespérée s’est remise elle aussi à remplir des mannettes. Mais parfois son geste s’arrête, ses traits se contractent et ses yeux demeurent étrangement fixes. Puis soudain, elle recommence à puiser dans la trémie au fond mouvant, le visage devenu sérieux et calme comme si elle venait de prendre une forte et froide résolution.

94
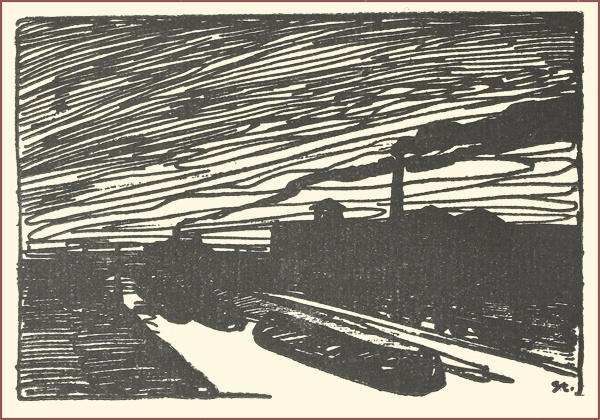
Le soir tombe, il bruine sur la plaine. Les bâtiments d’extraction qui barrent sombrement, par endroits, sa perspective étalée et qui balafrent de leurs cheminées géantes et de leurs beffrois la cernure livide de l’horizon, s’éclairent intérieurement de lueurs mystérieuses, ainsi que des châteaux fantastiques, et leurs noires silhouettes s’évanouissent lentement. Les longues files massées des corons trapus sont déjà des plaques uniformes et sans relief. Tout ce qui se hérissait sur la plaine, s’aplatit, se confond peu à peu avec elle.
95
Les rumeurs du travail s’apaisent, et, dans la fin du crépuscule, un train qui roule, rapide, met un bruit solitaire et mélancolique.
Le long du canal qui déroule son ruban clair, tout droit, comme une route, une petite ombre glisse.
Mais voici qu’elle s’est arrêtée et demeure immobile sous le voile triste de la pluie fine et glacée.... là, tout près de l’eau morte, au-dessus de laquelle flottent des vapeurs blanchâtres qui semblent un suaire....
Puis, brusquement, la berge est déserte: la petite ombre immobile a disparu. Mais l’onde blême se plisse de rides, qui, de la rive, vont s’élargissant comme un rictus mauvais et mystérieux.

99
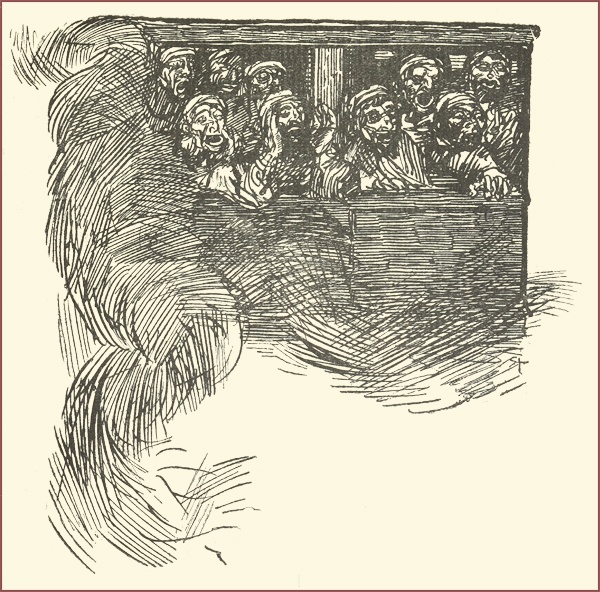
Train-Tramway
La grande faux de la moissonneuse flamboie dans l’or ondoyant des blés. Les épis tombent comme une vague qui déferle. Parfois, sur les aciers tranchants, un coquelicot demeure attaché, semblable à une gouttelette de sang.
100
Derrière l’outil laborieux, sur le champ rasé où le chaume scintille, la récolte bottelée s’échelonne. Et une odeur forte et saine, une senteur chaude s’exhale, haleine du sol.
Les paysans aux bras hâlés, ramassent les bottes avec une mâle lenteur et forment les faisceaux des moyettes, que le grand soleil allume comme des brandons, cependant que les femmes, courbées, la croupe tendue, glanent de-ci, de-là, en faisant rouler sous la cotte leurs hanches puissantes.
Au loin, dans la mer de récoltes, le village somnolent pointe le clocher de son église vers la grande coupole bleue du ciel où stagnent, immobiles et isolés, des nuages semblables à de gros flocons de ouate.
Parfois, un homme s’arrête en son travail, suit un instant des yeux les chevaux qui avancent lentement enfoncés jusqu’au poitrail dans le blé fauve, puis se reprend à ramasser les javelles. Ou encore une des glaneuses se redresse, et de la main essuie, par l’échancrure de la chemise, ses seins moites de sueur. Et la moissonneuse élargit sans cesse l’espace ras du chaume, entre des avoines et des seigles.
Dans l’infini silence des champs, on n’entend que les hue-dia criés aux bons chevaux indolents par celui 101 qui les conduit, et les trilles aiguës des alouettes, qui s’élèvent ivres de soleil et demeurent en extase, au-dessus de la vieille terre féconde, lourde de moissons.
Soudain un coup de sifflet strident transperce le calme. Et sur une voie ferrée que cachent les récoltes, un train accourt, un train tout noir, dont la locomotive barbouille de fumée la perspective blonde et claire.
A mesure que dans un roulement rapide il approche, grandit aussi une clameur étrange. C’est dans la campagne paisible, comme une traînée de hurlements et de vociférations.
Les paysans ont levé la tête. L’un d’eux a dit:
—V’là ch’ train des gueules noires!...
Puis tous se sont remis à brasser les gerbes, dans le sillage élargi de la faucheuse, dont les râteaux au geste circulaire, semblent peigner une chevelure d’or.
Le train infernal a bondi derrière une pièce de froment et s’est arrêté, tout secoué de bruit, toutes les ouvertures de ses wagons tumultueuses, grouillantes de visages atroces, aux bouches torves, d’où sortent des jurons et des chansons ivres. D’un bout à l’autre du train immobile, mais plein de trépignements, c’est une houle de faces machurées et grimaçantes.
102
Tous ces hommes tassés, empilés, crient, gesticulent, paraissant s’exalter entre eux.
Il semble que chez ces lugubres ouvriers des fonds, ce soit une revanche brutale, de bruit et de mouvement, après les longues heures de courbature et de silence à quinze cents pieds sous terre. Et peut-être aussi, parmi ces houilleurs fébriles, qui naguère étaient de placides gars de village, se trouve-t-il quelques nostalgies exaspérées.
Ils interpellent effrontément les moissonneurs qui ne se détournent même pas, et ils lâchent par bordées des mots obscènes, qui vont aux croupes tendues des glaneuses.
Mais un sifflement bref, quelques crachats de vapeur saccadés: le convoi s’éloigne, fumeux et tonitruant, par la campagne brûlante et calme.
Dans une sente qui, de la voie ferrée, coule vers le village, une file d’êtres aux faces mangées de suie, d’êtres aux ossatures pointant sous la toile grise encrassée de houille, longe les beaux épis mûrs.
Ils chantent avec des voix rauques, une chanson farouche, apprise là-bas, dans les bagnes souterrains, où couve la révolte des plèbes. L’un d’eux, avec une gourde de fer qu’il tient au bout d’une lanière, imite le 103 geste oublié du faucheur, et cheminant, abat les têtes de froment gonflées de graines, sans respect pour ce qui vient de la terre, comme s’il n’était plus déjà d’une race de paysan.
La chanson farouche s’éloigne, noir frisson dans la sereine torpeur des sèves. Et les silhouettes sombres qui suivent le sentier, semblent maintenant une loque sale qui traîne sur la diaprure vermeille des graminées.
Les râteaux ont cessé leur moulinet, les roues dentelées qui actionnent la morsure des aciers ne font plus entendre leur bruit de cliquet: toutes les tiges hérissées de fiammettes sont abattues. Le champ n’est plus qu’une vaste éteule, où les rayons qui ruissellent de la grande coupole bleue, font luire mille fétus de feu, entre les moyettes que les moissonneurs toujours impassibles et graves continuent d’ériger.
Et partout, sur la large poitrine tendue de cette plaine, ceux qui restent attachés à la glèbe accomplissent la saine besogne, la tâche immuable, aux périodes éternelles, réglées comme la marche silencieuse des astres.
Là-bas, au village, ils vont fermer leurs yeux de fièvre, les tape-à-la-veine, sans connaître la douceur 104 de la fin du jour, sans goûter le calme serein du long crépuscule. Puis en pleine nuit, ils se lèveront et s’en iront, comme des fantômes, jusqu’à cette voie ferrée qui, des chantiers monstrueux, s’allonge sournoisement dans les campagnes vierges, ainsi que la tentacule d’une pieuvre avide de forces humaines.

107
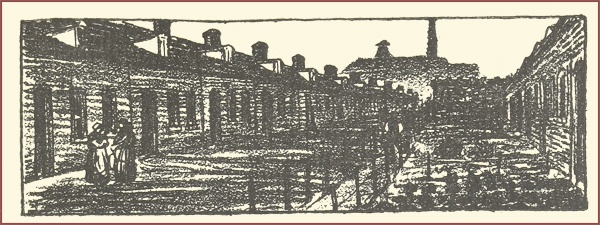
Dimanche
C’est un grand coron tout neuf, poussé là au milieu des étendues de betteraves, au hasard de la plaine, mais selon la volonté occulte des nuits souterraines. A mesure qu’un gouffre se creusait, lui s’était élevé, symétrique, dans un alignement sévère et discipliné de cellules. Quatre cents fois, la même basse maisonnette en briques avec son courtil exigu avait été répété, et cela sur quatre rangs uniformes tirés au cordeau. Puis quand terminé, lorsque prêt à contenir l’énergie nécessaire à la nouvelle fosse, on l’avait baptisé Coron Saint-Joseph, car les gros capitaux sont très pieux.
Maintenant il apparaît, ce village artificiel, comme un îlot au milieu des espaces de betteraves dont le vert acide vient hurler au rouge cru des briques et 108 des tuiles. Et la grande carcasse du bâtiment d’extraction, l’énorme ventouse de fer collée sur la blessure qui va jusqu’aux entrailles de la terre, le domine, se dresse toute noire, menaçante, avec son étrange belvédère et sa cheminée gigantesque.
Dimanche, tout travail a cessé. Comme le cratère d’un volcan assoupi, la massive et haute cheminée ne laisse échapper qu’un mince filet de fumée grisâtre, qui monte un instant tout droit et disparaît bue par l’atmosphère. On n’entend aucun halètement de vapeur, aucune rumeur sourde, aucun heurt. Et ce grand calme est une sorte de tristesse, qui plane au-dessus des petits toits alignés et sur les mornes et monotones étendues de betteraves.
Dans le coron, le silence a pénétré aussi, car c’est l’heure du repas. Désertes, les rues et les venelles recouvertes de mâchefer à cause des longues pluies, semblent sertir chaque demeure d’un listel de deuil.
Parfois une porte s’ouvre, une femme va tirer de l’eau à un puits. On entend le grincement de la poulie, un bruit aigu qui monte plaintif vers le ciel gris, un ciel pluvieux des automnes hâtifs du Nord, ou encore, résonne aux murailles le pas pressé d’un mineur 109 endimanché qui, en bras de chemise, portant un pot de grès, s’en va quérir de la bière à l’un de ces cabarets venus se placer au flanc du coron comme des sangsues.
Partout, ouvriers de la veine, ouvriers de la coupe à terre, haveurs, galibots, trieuses, sont assis autour des tables pour ce repas qui, par le chômage, réunit chaque maisonnée—parents et logeurs—pour ce repas où l’on mâche de meilleurs morceaux et où l’on entonne plus de bière dans les gosiers, que la houille a encrassés toute la semaine.
Une odeur d’oignons frits et de lard s’échappe de chacune des petites maisons. Depuis le quartier des Belges jusqu’à celui des Jaunes, l’air en est imprégné. Il n’est qu’un endroit où flotte une senteur plus distinguée de gigot cuit au four, c’est là où le coron affecte de ne loger que des porions.
Car il a déjà ses habitudes, ses manies, tout comme une personne a les siennes, ce coron né d’hier. Et c’est ainsi que, dans sa partie la plus rapprochée de la fosse et de l’habitation de l’ingénieur, il ne loge que des gens paisibles: les surveillants, les gardes-magasins et les chefs d’un syndicat toujours hostile aux grèves.
On voit souvent Monsieur le curé entrer ou sortir 110 de ces maisons: Monsieur le curé que la Compagnie a demandé à l’évêché du diocèse et qu’elle a installé dans un joli petit presbytère, auprès de l’église, toute en briques dont les vitraux ont été offerts par les pieuses épouses des gros actionnaires.
Et cette habitude plaît à la Compagnie, car celle-ci aime à voir rassemblées ses brebis obéissantes.
Mais par contre, voici que là-bas, du côté où sournoisement les cabarets sont venus se placer, le coron a pris la funeste manie de grouper les Borains et les Flamands, tous gens brutaux et ivrognes. Dans ce quartier, on n’aperçoit jamais la douillette de M. le curé, mais parfois on y rencontre les képis des gendarmes. Les soirs de paie, on s’y bat, on s’y assomme, et les maisons ont souvent des fenêtres dont les vitres sont crevées, ce qui leur donne l’air borgne.
On doit encore dire qu’il possède, éparpillées ici et là, quelques maisons fatales, renfermant en elles un destin inévitable, des maisons où les premiers occupants à peine installés, la ménagère s’y conduisit mal aussitôt, recevant des hommes tandis que le sien se trouvait au fond de la mine. Et la Compagnie sévère et bien renseignée par son ecclésiastique a eu beau faire maison vide, la nouvelle ménagère, comme si 111 ce vice suintait des murs, s’est mise peu à peu à recevoir les galants qui, par habitude, venaient encore rôder derrière le courtil.
Pourtant, celui-ci n’est ni pire ni meilleur que les autres corons, et si un peu partout ses hommes s’enivrent, si ses gaillettes et ses moulineuses ont le ventre gros vers leur quinzième année, ce ne sont là que choses communes à tous les tassements humains du pays noir.

112

—Vlau des gauff’... vlau des belles gauff’...
Et lancé dans le calme, le cri du pâtissier ambulant qui chaque dimanche, à cette heure, parcourt le coron, ricoche à tous les angles des petites maisons trapues.
Coiffé d’une toque blanche empesée, l’homme pousse devant lui son étal: deux roues et quelques planches, sur lesquelles sont rangées ses gauff’, ses belles gauff’, que lui, pâtissier famélique, confectionne on ne sait où, ni avec quoi. «Avec del grasse ed g’vau»—avec de la graisse de cheval,—dit jalousement 113 la vieille femme qui vend du sucre d’orge à la marmaille.
Le marchand s’arrête devant presque chaque logis dont il va entr’ouvrir la porte. Du seuil, apparaît alors la famille attablée. On voit des hommes aux épaules osseuses, des hommes vidés de graisse, qui promènent sur ces tables des mains énormes, des mains aux gros doigts noueux habitués à s’agripper aux blocs de houille pour les faire basculer. Et il semble, que ce soit dans ces étaux de chair qui harpent les blocs de schiste descellés par la rivelaine, que réside la force musculaire de ces êtres. Car leurs visages blêmes et jaunis, accusent l’épuisante atmosphère des fonds.
Taciturnes, ils ne se préoccupent guère du marchand. C’est la ménagère qui d’un effort paresseux se lève, molle, toute sa chair tassée au derrière, à force de se tenir assise en compagnie des voisines autour des bolées de café, quand les hommes sont descendus au fond. Elle va jusqu’à l’étal et fait son choix, en disant beaucoup de choses inutiles, par besoin de bavardage.
Puis le marchand repart, poussant sa voiturette dont les roues broient mélancoliquement le mâchefer des venelles désertes.
114
—Vlau chés gauff’, chés belles gauff’...
Et la dernière syllabe, poussée sur une note aiguë, ricoche de nouveau aux angles des basses petites demeures, muettes sous la noire menace du haut bâtiment de fer dont la masse pesante les domine.
—Ohé, ch’ l’homme, venez par ichi.
C’est une grande fille qui, d’un courtil, appelle le pâtissier.
Docile, la voiture fait un détour et s’arrête devant la petite clôture de bois goudronné.
Et voici que dans le courtil, deux autres filles apparaissent encore et viennent, auprès de leur sœur, échelonner d’effrontés visages.
Ouvrières du triage, enfants qui grandissent dans le frôlement des centaines de mâles, elles ont un sourire vicieux. Et ce sourire est rendu encore plus équivoque par l’étrange expression des yeux qui brillent entre des paupières restées injectées de charbon malgré les lavages, des paupières formant un large cerne, une meurtrissure de volupté, comme chez les prostituées.
Elles marchandent les gaufres, en criant très haut, par habitude, comme si toute la machinerie ronflante et crissante du triage était encore là, couvrant leurs voix. Espiègles, elles se moquent du pâtissier, et se 115 poussant du coude, pouffent de rire avec des déhanchements canailles. Mais tout à coup, un formidable juron d’homme impatienté éclate. Elles précipitent leur achat et rentrent dans la petite demeure en se bousculant.
La toque blanche empesée s’arrête à droite, à gauche, disparaît, puis paraît à nouveau, continuant de parcourir le village géométrique. Et les portes, un instant entr’ouvertes, montrent partout les mêmes visages d’hommes au teint jauni, faces que l’on dirait de cire, à cause des luisances produites par les rudes débarbouillages au savon. Dans la pénombre des pièces, brillent les mêmes yeux vicieux des petites trieuses, ou ceux des galibots leurs frères, qui déjà peinent aux tréfonds. Partout ce sont les mêmes ménagères alourdies de paresse, et au ras des tables, les chevelures blond filasse, blond étoupe, des enfants de cette race du Nord.
Il semble qu’elles expriment une phrase sur la vie intime de chaque maisonnette, ces portes qui s’entr’ouvrent. Et la phrase se répète, toujours à peu près la même, sans dire ni douleur ni joie, sans dire aisance non plus que pauvreté, mais la morne existence impersonnelle—rouage d’un mécanisme géant—et sur laquelle pèse le grand reflet triste des fonds.
116
Maintenant la toque blanche s’éloigne, gagnant la plaine, la verdure acide des betteraves. Elle ne s’est pas arrêtée dans le quartier des porions, ni au presbytère, car dans ces maisons, on ne mange guère de gaufres qui sont peut-être fabriquées avec de la graisse de cheval.

117
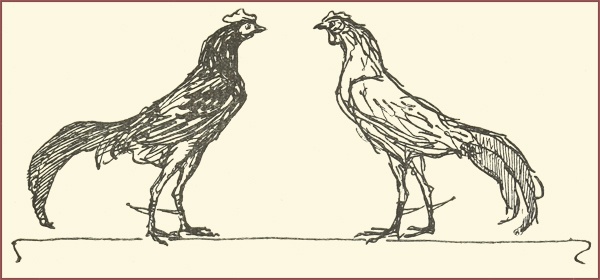
Deux heures viennent de sonner à l’église, au clocher de briques où s’encastre une horloge qui obéit à celle de la fosse.
La vie du coron, parquée sous les toits, recommence à s’éparpiller au dehors. Un mineur, sorti de chez lui, fume tranquillement une longue pipe de terre, en regardant ses pigeons qui roucoulent sur le faîtage des tuiles; un autre bêche son petit courtil quadrangulaire, son jardin étriqué où les légumes poussent mal, salis par une noire rosée de suie que crache dans l’air la gigantesque cheminée et aussi par les poussiers de charbon qui s’envolent du triage. Sur le pas des portes, de grasses ménagères apparaissent et se rapprochent pour des commérages.
118
Puis des groupes d’hommes, dans lesquels se faufilent des enfants, se forment autour des carins: ces poulaillers qui rognent encore un peu le pauvre carré aux légumes.
C’est que tout à l’heure on va faire battre les coqs, là-bas, aux estaminets. Chaque «coqueleur» que des amis ou des voisins accompagnent, choisit en ce moment ses bêtes de combat: de grands coqs hauts sur pattes, musclés, avec des yeux exaspérés et cruels. Il les renferme séparément dans des sacs de toile blanche où leurs cris s’étouffent. Sur son dos il charge un sac, les amis saisissent les autres. Et les voilà qui s’en vont tous, de leur pas traînard, ce pas habitué à suivre sans hâte, dans l’obscurité des fonds, la petite lueur incertaine des lampes.
Bientôt, d’autres mineurs les suivent, ceux-ci portant de grands arcs et des carquois de fer-blanc contenant les flèches qu’ils vont lancer, dans la prairie attenante aux estaminets, vers le faîte d’un haut mât blanc où perche un geai de bois. La flèche, souvent manquera l’oiseau, mais lorsqu’elle retombera, ce sera presque toujours à pic dans une chope de bière ou dans un verre de genièvre...
Il semble à présent que c’est une pente de terrain 119 qui, naturellement, fait couler la population de ce coron du côté où s’alignent les débits de bière et d’alcool.
Aujourd’hui, c’est à l’enseigne Aux Fieux de Sainte-Barbe que l’on fera combattre les coqs.
Le camp adverse est déjà là, venu d’un coron éloigné, en petites charrettes attelées de chiens. Dans les brancards, les bêtes encore exaltées par la furieuse galopade à travers la plaine, ont de longs tremblements convulsifs dans les membres et aboient nerveusement, sur une seule note jetée en un coup de gueule spasmodique d’où gicle une écume qui leur barbouille le poitrail.
Et cette fatigue surexcitée, vibrante, cette fatigue affolée, est plus douloureuse à voir, que l’accablement muet d’un animal tombé sur le flanc.
Les «coqueleurs» étrangers sont dans une cour, au milieu de laquelle, s’élève d’un mètre au dessus du sol, le terre-plein carré où s’entretueront les coqs. Ils ont accroché le long d’un mur, leurs sacs de toile qui s’agitent et se sont assis sur un banc, devant une longue table, pour vider des tournées de genièvre, en attendant les hommes du St-Joseph.
120
Le cabaretier, un gros homme mafflu, au cou apoplectique, saupoudre de sable blanc la plate-forme dont la terre a été battue et nivelée avec soin. Il s’assure encore que le petit grillage formant le champ-clos est suffisamment tendu. Puis il vient trinquer avec les mineurs.
L’un d’eux, a tiré de sa poche une paire d’ergots en acier, des ergots artificiels imaginés à seule fin de rendre plus sûrement mortelles les blessures que se feront les coqs. Le coup porté dans l’œil ira ainsi fouailler le cerveau, le coup porté dans la poitrine, pénétrera jusqu’au cœur ou crèvera un poumon. Sur une pierre, il aiguise encore les pointes de ces sortes de longues aiguilles enchâssées dans des courroies de cuir, où un vide est laissé à l’ergot que la nature n’a point fait assez meurtrier pour ce jeu.
Lentement, sans passion apparente, dans leur lourd patois, ils causent de leur plaisir cruel. Le défi est de cent cinquante francs. La somme serait bonne à gagner. Leurs coqs ne sont-ils pas de bonne race? descendance de champion? Et pourtant ceux du Saint-Joseph en ont de bons aussi... Le cabaretier hoche la tête et invite souvent à trinquer, afin que les verres se vident; lui 121 n’espère qu’une chose, c’est que l’on boira beaucoup dans les deux camps.
L’homme qui aiguise les ergots d’acier ne parle guère, trop occupé à sa barbare besogne, mais la mobilité ardente de ses yeux s’avive, dans sa face pâle, à chaque verre d’alcool.
Parfois, un cocorico solitaire jaillit d’un sac, tandis que sur la route les jappements douloureux des chiens s’apaisent. Et le ciel gris, le ciel morne et inerte, semble regarder cette cour avec une indifférente tristesse.
Ils s’abordent sans gestes et les préparatifs du jeu sauvage commencent.
Agenouillés, les deux coqueleurs bandent tout d’abord, avec de la charpie, le tarse à la hauteur de la protubérance cornée. Afin que le linge qu’ils enroulent soit adhérent, de temps à autre ils envoient dessus un jet de salive qu’ensuite ils étalent avec le pouce. Lorsque les tendons sont ainsi matelassés, ils appliquent la bande de cuir dans laquelle est enchâssé l’éperon.
Chacun alors opère plus lentement, palpe les muscles, étire la patte, la replie, car il doit rechercher la direction favorable à donner à la pointe. Enfin, quand il a certitude de l’avoir trouvée, il fixe la 122 courroie, en se servant d’un fil enduit de poix, qu’il croise et entrecroise sur la charpie. Puis, les deux pattes se trouvant armées, le coqueleur enfonce dans un morceau de liège l’extrémité de chaque éperon, afin que ceux-ci ne le blessent ou ne s’émoussent.
Maintenant, autour de la plate-forme de terre, ils se tassent sans se bousculer, ces hommes habitués à être en troupeau. Ils ont un petit coup naturel de l’épaule pour évoluer dans leurs rangs, comme lorsqu’ils se pressent à la remonte, à la descente, ou à la paie.
Aux angles opposés du terre-plein, deux coqueleurs se sont placés, tenant en main leur bête de combat.
Un signal est donné. Alors, ils enlèvent les morceaux de liège qui préservent les éperons et déposent doucement les coqs dans le champ clos.
L’un est noir, avec des tâches grisâtres, l’autre est fauve, avec des tâches feu. Immobiles, très droits et raidis, tous deux la tête arrogante, se scrutent d’un regard de côté, le regard fixe d’un seul œil et tous deux, en même temps, fientent sans broncher.
Quelques mots en murmure ondulent dans les rangs pressés des houilleurs. Mais, celui qui dirige le combat crie «silence» avec aussi, un juron. Les houilleurs, se taisent, on n’entend plus que le roulement d’un train, 123 très loin dans la plaine, et les voix des archers réunis dans une prairie que cachent les murs de la cour.
Tout à coup, dans un volètement érupté, le coq noir a traversé le parc et foncé sur le coq fauve. Par un bond celui-ci l’a évité, mais lui-même, devenu aussitôt agressif, s’élance avec un large battement d’ailes et de ses deux pattes aux froides luisances d’acier, porte un coup dans le corps de son adversaire.
Les éperons ont dû pénétrer la poitrine, car la bête a éprouvé une sorte de haut-le-cœur. Pourtant elle ne titube point, elle n’a pas cette sorte de vertige qui indique une blessure mortelle.
A présent, têtes baissées, bec contre bec, les plumes du cou dressées en forme d’auréole, les voici qui se fixent, les yeux dans les yeux, comme en une commune hypnose.
Ils vont à droite, à gauche, ils avancent, reculent, et cela avec une fureur concentrée dans ces regards qui paraissent les avoir soudés l’un à l’autre.
Mais ce lien soudain se brise. Ils ont échappé à leur fascination mutuelle. Avec des bonds d’oiseau qui s’envole, ils se ruent l’un contre l’autre, se harpillent du bec et se fouaillent mutuellement la poitrine de leurs pattes. Les éperons s’entrechoquent; les ailes 124 s’ouvrent et se referment comme pour étreindre. C’est un bruissement soyeux de plumes, un sifflement étoupé, auquel se mêle le cliquetis de l’acier.
Après une série de chocs, ils se reprennent à se fixer, ayant toujours quelque chose de magnétique dans le regard et comme s’ils se pénétraient l’un l’autre d’un fluide de haine. Puis, un brusque reflux de rage, les fait se ruer à nouveau dans un ébouriffement, un retroussis de plumes, dont les couleurs luisent, chatoient, s’irisent et semblent s’aviver de toute cette fièvre de fureur.
Autour du parc, les faces jaunies et plus maladives sous le jour terne qui tombe du ciel délavé, forment sur les vêtements noirs du dimanche comme des chapelets de points pâles. Seuls deux petits fantassins, revenus en permission au pays, détonnent dans la note bêtement criarde de leurs uniformes. Et la même attention à suivre le jeu barbare, l’émotion collective, donnent à tous ces visages presque la même expression, avec le même regard immobile et le même froncement des sourcils.
Mais voici que l’on s’agite, on se pousse des épaules. Ceux qui sont debout sur des chaises, au dernier rang, se penchent en avant, et de lourdes exclamations vont 125 en brouhaha. C’est que le coq fauve, après avoir chancelé, après avoir fait quelques pas titubants, vient de tomber.
Et maintenant, c’est l’atroce, qui va se dérouler pour l’inconsciente cruauté de ces hommes.
Sur ce petit corps palpitant et convulsé, le coq demeuré debout, méchamment s’acharne, fait des entrechats qui piquent l’acier au hasard. A ces coups d’éperons, il joint des coups de bec, déchirant la crête qui s’ensanglante et que le blessé secoue par souffrance. Puis, avec des boitillements d’oiseau de proie, des allongements de col d’oiseau rapace, il se met à tourner autour de cette tête qui l’évite. Il tourne avec gaucherie, avec embarras, car sa rage à présent, voudrait éteindre le regard qui y brille encore, et qui lui apparaît, comme le point où s’est réfugiée la vie de ce corps inerte.
Quelques bonds d’essai, puis un autre avec un rapide reflet de l’acier et l’éperon a pénétré dans un orbite, crevant l’œil, dont la substance se met à couler. Mais comme l’arme demeure engagée dans la cavité osseuse, la patte doit faire, pour l’en retirer, des efforts horribles.
A cette douleur suprême le blessé se relève, et dans un dernier jaillissement de vitalité, se met à fuir par 126 le parc, en ronds éperdus, se cognant au grillage, buttant aux angles.
Aussitôt, le coq sombre le poursuit dans cette fuite trébuchante et le bouscule. Pourtant, il semble que lui-même perde ses forces. Lui aussi est pris de vacillements, et à plusieurs fois, ses enjambées se ralentissent dans une boiterie où les éperons le gênent et le font trébucher. Quelque blessure reçue au début du combat, s’aggrave sans doute d’un interne épanchement de sang.
La partie est redevenue incertaine. Il y a des remous dans les rangs pressés, et des mots brefs s’échangent. Puis revient le silence dans lequel expirent des bruits très lointains de la grande plaine rase.
Dans un angle du parc, où leur faiblesse les a fait échouer, ils sont de nouveau bec à bec, mais devenus comme loqueteux car leurs ailes sont tombantes et traînent. Le coq noir, les yeux troubles, presque vitreux, regarde l’autre, sans voir peut-être, et celui-ci le fixe d’affreuse façon avec son orbite vidé. Tout en tâtonnant leur équilibre, ils essaient encore de se porter des coups d’éperons, lançant leurs pattes en demi cercle, sans forces, et en faisant de vains efforts pour bondir. Ils ne s’atteignent guère, mais leurs ergots 127 s’accrochent l’un à l’autre. Alors, pour ne pas tomber, ils se soutiennent sur leurs bouts d’ailes, comme sur des béquilles.
Et voici venue l’agonie.
Ils se sont entraînés tous deux dans la même chute, entremêlant leur plumage. Ce ne sont plus que deux petits tas de plumes immobiles, au-dessus desquels à intervalles qui s’espacent, une aile se met à battre en un grand geste mourant.
L’homme qui dirige le combat proclame alors: Partie nulle.
Aussitôt, toute la masse pressée autour du parc, se désagrège et fourmille dans la cour.
Les coqs sont retirés du champ clos par leurs propriétaires. On retrousse leurs plumes, on examine et juge les blessures. Après leur avoir enlevé les éperons, on les achève en leur cognant la tête contre le mur.
Cependant que les coqueleurs arment de nouvelles bêtes, on se met à boire. Partout, dans la cour, dans le cabaret, les grandes chopes se vident, se remplissent, et les longues pipes en terre s’allument.
Réunis par petits groupes, les houilleurs causent lourdement, dans ce patois empâté qui semble déformer les bouches, les agrandir pour laisser passer les 128 traînements gras des syllabes. Ce ne sont plus là tes loqueteux effrayants, surgis des abîmes souterrains, avec des faces couvertes d’un masque noir immobile, où roule le blanc des yeux. Et pourtant quelque chose de farouche, d’agressif, se dégage encore de ces hommes. Leurs regards ont parfois une acuité étrange: regards aigus où passe de la haine avec un sombre reflet de révolte sourde.
En parlant, quelques houilleurs soudainement s’animent, leurs gestes deviennent saccadés et ils ont des tremblements de mains qui font penser à l’alcool. L’un surtout, long garçon maigre dont le visage est dans sa pâleur coupé de sillons bleuâtres, de tatouages incisés par les éclats de charbon, furieusement élève la voix. Il cause de grèves avec les deux petits soldats devenus pensifs, et ses grands bras véhéments, mettent en joue un fusil imaginaire.
Par de là le mur, on aperçoit le faîte du mât blanc au haut duquel perche le geai de bois. Les flèches des archers, continuent à monter autour de lui comme des fusées, puis virent dans l’air et retombent.
Mais auprès du terre-plein, l’arbitre vient de reprendre sa place, ainsi que, aux angles, deux coqueleurs qui portent les bêtes aux pattes éperonnées.
129
Les houilleurs se hâtent de vider une dernière chope, débourrent leurs pipes, en les frappant contre le talon de leur bottine, avant de les renfermer dans les longs étuis de bois. Les parieurs conviennent d’un dernier enjeu: une tournée de bistouilles ou une pièce blanche. Et de nouveau on entoure le parc en se serrant les épaules.
D’abord, même attitude expectative des deux coqs. Puis le courage défaillant de l’un, devant l’attaque de l’autre qui est forcé de le poursuivre pour l’obliger enfin à lui faire tête et à combattre. Et ce sont encore de larges battements d’ailes, des froissements de plumes, des chocs cliquetants, que suit l’immobilité d’une mutuelle fixité des yeux, pendant laquelle, l’exaspération fait autour des cous se dresser les plumes en forme d’auréole.
Un long temps elles se battent avec rage, les pauvres petites bêtes; avec furie, de leurs ergots, elles se poignardent. Puis, viennent les défaillances, la même douloureuse et triste fin de combat, qui montre toute la cruauté froide, la cruauté lente de ce jeu.
Enfin l’un tombe et expire avec des soubresauts convulsifs. Et sous le ciel gris, devant les hommes blêmes, le coq qui est resté seul debout, jette un 130 lamentable cri de victoire, un cocorico qui gargouille dans le sang de son petit gosier qu’un éperon a transpercé.
Plusieurs parties se sont encore succédées, espacées par le temps nécessaire pour fixer les éperons. Chaque fois, un petit corps frémissant de vie ardente s’est immobilisé lentement dans un larmoiement de plumage.
Le dernier combat a été décisif pour ceux du camp étranger.
L’arbitre monté sur le terre-plein, a proclamé leur victoire et leur a remis les cent cinquante francs de l’enjeu. Ils ont recompté la somme d’écus et se la sont partagée. Puis ils ont offert une tournée générale d’eau-de-vie.
On trinque, et dans quelques gros poings les petits verres tremblotent. Mais voici qu’une dispute brusquement éclate, violente, entre deux parieurs, deux hommes du coron Saint-Joseph.
La face plus pâle encore, les yeux vagues d’un commencement d’ivresse, ils se lancent tout ce que le patois a d’injures, des mots énormes, des mots comme pesants de sens abject. Finalement, l’un donne un coup de poing à toute volée entre les deux yeux de l’autre, 131 qui se met à saigner du nez, la tête penchée en avant, les jambes écartées pour ne pas salir ses vêtements du dimanche. Il regarde couler son sang, très occupé à ne se point salir, mais en même temps il menace d’une voix sourde celui qui l’a frappé. Il parle d’un coup de rivelaine dans les reins, d’une sombre revanche qu’il prendra là-dessous, en quelque coin perdu des fonds.
Les houilleurs restent indifférents à cette rixe. Ceux qui parlent lourdement, d’une voix épaisse, où ceux qui s’animent à leurs propres paroles, ne s’interrompent pas un instant. Quelle violence, quelle brutalité pourraient encore les émouvoir, ces âpres ilotes?...
Maintenant, les coqueleurs étrangers, nouent leurs sacs qui ne s’agitent plus. Ils vont regagner leur lointain coron par les chemins qui serpentent parmi les larges étendues de betteraves, guidés par les noires émergences des terris, par les jalons colossaux des cheminées géantes et la nuit venue, par les incendies des hauts-fourneaux.
Peu à peu, on déserte la cour, où l’homme saignant du nez demeure seul avec un autre houilleur, qui déjà très ivre, le contemple avec une attention profonde et stupide.
Devant le cabaret, les chiens qui somnolaient se 132 redressent en voyant apparaître leurs maîtres et tous se mettent à japper.
Les coqueleurs équilibrent leur poids dans les petites charrettes. Et ce sont des jurons, des coups de pieds aux chiens qui s’impatientent. Puis les casquettes s’agitent.
—Ahue..... diau... hi.....
Les traits se tendent, et voici la file des petites charrettes qui s’ébranle, aux coups de reins en saccades des chiens fous.
Les houilleurs venus sur la route pour assister au départ des camarades, les regardent s’éloigner, puis tous rentrent dans le cabaret.
Au ciel, vers le couchant, une tache fauve vient d’apparaître. Lentement elle grandit, et devient une sorte de lueur qui, s’infiltrant peu à peu dans le ciel compact, révèle un chaos de nues amoncelées. Les contours de gros nuages se dessinent frangés d’or, et entre leurs échancrures, se forment des profondeurs caverneuses, où de sourdes incandescences s’irisent.
Mais le soleil bientôt est las de son effort pour percer ce ciel lourd; la lueur un instant plus vive, s’éteint doucement. Les grands nuages apparus, se soudent, se confondent à nouveau, en l’uniformité 133 d’un gris sévère et triste. Et sur la grande plaine, le jour se meurt dans un crépuscule de cendre.
Là-bas, du dernier estaminet, sort un air de polka que joue un orgue de barbarie. Les sons mélancoliques flottent, ondoient mollement, puis se perdent sur la nudité rase des alentours, comme les vagues se déroulent, s’étalent, et expirent sur la nudité de la grève.
C’est qu’elles tournent à présent les petites trieuses, les filles blondes aux yeux vicieux et bistrés, elles tournent au bras de leurs amoureux.
Lorsque la nuit sera venue, si noire, si épaisse que ses ténèbres donneront au visage la sensation d’un frôlement, quand elle aura enseveli les petites maisons basses et leurs listels de deuil, des couples iront s’étreindre, dans le grand lac d’ombre, où seul brillera comme un astre monstrueux, le fanal électrique de la fosse.

137

Baptême
Les champs sont dénudés; la terre brune de la plaine s’étend en longues ondulations comme une houle du large.
Un vent humide et froid souffle. Le ciel gris tout 138 entier glisse régulièrement comme l’onde d’un fleuve illimité. Et dans ce ciel aqueux, de tous les points de la plaine, les cheminées des houillères, hérissant leurs longs cols, dégorgent des spires de fumées noirâtres qui s’allongent, s’étirent, emportées par le large courant des nues.
A travers les terres labourées, suivant une petite route défoncée par les derniers charrois de betteraves, trois landaus fermés, sombres comme des corbillards, s’en vont au pas. Sur le siège de la première voiture est assis auprès du cocher, un enfant de chœur en surplis blanc et qui tient à deux mains la hampe de métal d’un grand crucifix.
Les trois voitures cahotées mollement dans le chemin boueux penchent d’un côté, s’inclinent de l’autre. Parfois elles disparaissent dans le creux d’une ondulation puis lentement reparaissent un peu plus loin.
Les voici traversant une étendue plane. A droite et à gauche du chemin gras qui se confond avec la terre des champs, les sillons s’allongent parallèles, semblables aux rayures d’un tapis immense.
Soudain une glace du premier véhicule s’abaisse et une tête coiffée d’un chapeau haut de forme émerge de l’intérieur.
139
—Cocher, nous y sommes, arrêtez.
Alors la voiture s’immobilise; l’enfant de chœur saute à bas du siège en faisant un bruit de ferraille avec son grand crucifix et vient ouvrir la portière.
Apparaît un gros curé revêtu du rochet de dentelles avec dessus l’étole dorée. Comme son ventre lui cache le marchepied il tâtonne celui-ci de son soulier à boucle d’argent avant que d’oser faire incliner la voiture sous le poids de son corps. Ensuite descendent très graves trois Messieurs gantés, en pelisses de fourrure et chapeaux de soie.
Des autres landaus sont encore sortis de ces hommes d’important aspect et trois dames. Celles-ci sont d’âge indécis et sont habillées sans aucune élégance mais elles portent aux oreilles, des perles ou des brillants énormes, de ces bijoux ostensibles qui semblent vouloir exprimer le chiffre d’une fortune.
—«Voyez, c’est là-bas», dit l’un des personnages à pelisse en étendant le bras.
Et tout le monde fixe à quelque cent mètres, un point de la terre labourée où des piquets de bois sont plantés en rond.
On se met en marche, l’enfant de chœur portant haut la croix comme pour une procession. Monsieur le curé 140 qui le suit se retrousse comme ces dames dont l’une en relevant sa jupe découvre d’affreux bas de coton blanc. Les Messieurs causent entre eux. Ils causent argent; le vent âpre qui souffle emporte les mots actions, capitaux, hausse, dividende.
Au ciel un vol de corbeaux passe en croassant.
On arrive auprès des piquets de bois. On s’échelonne autour du rond et l’enfant de chœur se penche comme s’il y avait déjà là le mystère d’un grand trou profond.
Alors commence en plein champ une cérémonie étrange.
Le prêtre est entré dans le rond avec l’enfant de chœur. Il a tiré de sa soutane un livre recouvert d’étoffe noire, il s’est mouché dans un large mouchoir à carreaux et a posé sur son nez des lunettes. Puis ayant redressé sa taille d’homme obèse en faisant pointer son ventre en avant il s’est composé une physionomie solennelle. Ses paupières se sont abaissées, son geste s’est fait évocateur.
Les Messieurs se sont tous découverts.
Et voici que la voix du prêtre s’élève comme contrefaite, sur une seule note monotone qui à la fin de chaque période s’abaisse dans une sorte de gémissement doux.
—Nous allons donc procéder au baptême de la 141 nouvelle fosse; nous allons appeler la bénédiction du Dieu tout puissant sur ces lieux où va s’accomplir l’ouvrage difficile et plein de périls. Ah! puissions-nous en invoquant la miséricorde divine, en implorant la sauvegarde de Notre Seigneur, détourner de ces lieux l’Esprit d’Erreur, l’Esprit de Révolte et mettre à jamais l’œuvre à l’abri des catastrophes et de la ruine.
Puis sa voix redevenue naturelle et avec des inflexions patelines:
—Qu’il plaise au parrain et à la marraine d’avancer.
Du groupe un monsieur et une dame se détachent et s’approchent du prêtre qui les place côte à côte comme pour une bénédiction nuptiale.
L’enfant de chœur qui avait abandonné sa croix pour courir jusqu’aux landaus en revient avec des cierges, un goupillon et l’urne à eau bénite.
Le parrain prend un cierge en main, la marraine en prend un autre. On ne les allume point à cause du vent.
Alors la voix sacerdotale commence à psalmodier les Oremus. Les syllabes du latin sonore forment un ronron musical que coupe par instant le timbre suret de l’enfant qui crie les repons.
Les dames ont pris des mines contrites et semblent percluses de dévotion et d’humilité. Un des hommes en 142 pelisses caresse d’un geste distrait la nudité de son crâne chauve où quelques poils frissonnent au souffle de l’air. Un autre détourne un peu la tête pour scruter du regard, à travers son lorgnon d’or, un coron qui là-bas étend la carapace de ses toits de tuiles auprès d’une noire élévation de schiste.
Un instant, le ronronnement sonore s’arrête; le curé tourne les pages du livre en mouillant son pouce. Puis, ses lèvres se reprennent à jeter au vent les paroles sacramentelles, comme s’il voulait éparpiller là tout autour une pieuse semence.
Au loin, un convoi de houille qui sans doute passe sur le pont métallique d’un canal, fait entendre un sourd grondement; après quoi, la sirène d’une houillère, pour quelque signal, se met à beugler tristement.
Tout à coup l’enfant de chœur, qui sournoisement s’était mis les doigts dans le nez, lance un Amen perçant comme un cri d’oiseau et, ayant saisi l’urne qui contient l’eau bénite, présente au curé le goupillon. Alors celui-ci fait avec lenteur le tour des piquets de bois en aspergeant la terre labourée, le sol sous lequel gît l’or noir.
Les assistants ayant reçu pendant l’aspersion quelques gouttes du liquide sacré, chacun d’eux croit convenable 143 de se signer: les dames d’un grand geste croisé, les messieurs en ébauchant un petit signe vague.
La courte cérémonie est terminée. Comme le comédien qui a fini de jouer son rôle, chacun a repris sa physionomie naturelle. Les dames ont quitté leurs mines contrites, les hommes leur attitude à la fois solennelle et respectueuse. Quant au gros curé il a posé sur sa tête une petite calotte, ronde comme sa tonsure, et se frotte les mains en avouant «qu’en vérité le fond de l’air est glacé».
Un cocher vient d’apporter une bannette d’osier dont il retire du vin de champagne et des coupes de cristal. Mais une coupe heurtée se brise avec une petite vibration claire. Aussitôt les trois dames glapissent:—Ça porte bonheur!—Ça porte bonheur!
Enfin comme les bouchons encapuchonnés d’or ont sauté et que le vin mousseux a été servi à la ronde, un des messieurs à mine importante lève sa coupe.
—«Je bois à l’avenir, à la prospérité de notre nouvelle fosse qui va désormais porter le nom de sa gracieuse marraine. Vive la fosse Sainte-Eudoxie».
On choque les coupes et l’on boit: Monsieur le curé, les lèvres tendues, la main gauche appuyée sur sa poitrine pour ne pas salir son étole.
144
Maintenant, les hommes se sont rassemblés en conciliabule et le vent emporte encore les mots capitaux—actions—hausse—dividende. Des lambeaux de phrases s’envolent aussi quand ils élèvent la voix... évidemment, il faut détruire l’action des syndicats... salaires onéreux... faire venir des Belges... l’économie surtout...
Les dames se sont accaparé d’un long jeune homme pâle tout de noir vêtu, d’un aspect sévère,
—Eh bien Monsieur l’ingénieur, quand commencera-t-on les travaux?
—Oh! incessamment Madame. Ils seraient déjà entrepris si nous n’avions eu quelques difficultés quant aux expropriations.
Et ce sont ensuite des questions puériles, des questions ignorantes auxquelles le jeune homme sévère répond avec respectueuse condescendance.
L’une de ces dames s’étonne de ne point voir trace de forage. Elle demande avec inquiétude «si l’on est bien sûr de trouver la houille». L’ingénieur lui fait comprendre que c’est un calcul précis, mathématique, qui a déterminé cet emplacement. Et il ajoute:
—A cent quatre-vingt-quatre mètres le puits rencontrera une galerie d’allongement de la fosse 145 Sainte-Clotilde, cette fosse dont vous apercevez d’ici les cheminées et le coron. Nous prévoyons même qu’à une certaine profondeur il nous faudra traverser une poche d’eau importante; mais cela se fera aisément grâce à notre méthode de congélation. L’eau sera extraite par blocs solides.
Alors la dame rassurée pousse des petits cris d’enthousiasme—c’est extraordinaire—c’est merveilleux.
Une fois encore les coupes sont remplies. On les vide en portant un toast à l’ingénieur qui va exploiter la nouvelle fosse.
Le jeune homme sévère se confond en remerciements balbutiés... très honoré, Monsieur le directeur... distinction... assurance profond dévouement...
L’un après l’autre les messieurs en pelisses lui serrent la main. Et chacune de ces poignées de mains est éloquente. Elle semble exprimer à la fois de la crainte et un grand espoir; elle paraît aussi signifier de façon pathétique une ultime recommandation.
A présent, on s’en va à la débandade, les dames sautant les sillons comme des ruisseaux, le curé en se retroussant si haut, qu’il découvre ses mollets tremblants de graisse. Et la croix portée par l’enfant de chœur, à 146 qui on a versé un fond de bouteille, brimbale à droite, à gauche, titube dans l’air, ayant perdu toute dignité.
Un instant le noir convoi des landaus qui s’éloigne se profile sur l’horizon; puis il disparaît dans le creux d’une large vague de la plaine.
Le vent âpre s’est adouci. Un ample souffle d’air tout tiède d’exhalation humide de la terre passe sur les sillons. Et cela semble un long soupir de tristesse.
Le grand champ labouré a reçu une monstrueuse semaille. Au brûlant soleil des moissons, ses blés ne tendront plus leurs aigrettes d’or. Comme des fleurs colossales, sur lui, le fer et l’acier vont s’élever pesants. Et là-dessous éventrant son tréfonds, s’ouvrira une nuit vorace où râleront de ténébreux parias de la houille.

149

La Jaune
Le garde-mine qui veille, a fait tourner, sur ses gonds crissants, la lourde grille. Un véhicule, une ombre longue, passe entre les bornes de fer, puis s’avance et se perd dans l’immense cour que rend infinie le brouillard où toute chose demeure encore noyée, quoique le petit jour commence à le pénétrer.
Là-bas, accrochées et s’étageant dans le vague, des 150 lueurs bleuissantes révèlent des fragments de baies vitrées ainsi que les courbes élancées d’armatures bientôt évanouies. Une masse, un bâtiment énorme se trouve là, encore invisible et assoupi.
Mais, pourtant, il semble que cela s’éveille, et que pesamment cela remue dans la brume.
Deux yeux de feu se sont ouverts à la base, et leurs regards trouent le brouillard de halos rougeoyants. De sourdes résonances se traînent, répercutées, et ce sont aussi des ébranlements de fer, des tressaillements étranges.
Soudain, un rauque ébrouement de vapeur déchire l’air. Puis, un instant après, dans le calme revenu, s’étend le rythme large, calme et profond, d’une respiration géante.
La clarté blafarde du jour, peu à peu amincit la nappe stagnante du brouillard; des transparences se forment. Alors, lentement, la grande masse noyée émerge par lambeaux rigides.
Comme un mât pointant d’une épave, apparaît d’abord la haute cheminée, puis la silhouette d’un beffroi. Ensuite s’exhausse la sombre, la lourde carrure des toits. Peu après, de la buée, tout un tas noirâtre, anguleux, se dégage.
151
Les armatures des baies vitrées qui apparaissaient par fragments aux lueurs électriques, maintenant éteintes, s’assemblent, se joignent, forment un hall colossal, soutenu au-dessus du sol par un pilotis de fer. D’une longue plate-forme, deux ponts métalliques s’étendent sur des chevalets et n’aboutissant à rien, demeurent allongés dans le vide, comme des bras tendus. Bientôt, reste seule, impénétrable, une profondeur obscure sous les piliers, où les yeux incandescents continuent de rougeoyer avec des clignements.
Auprès de la cale, la rampe de terre durcie aux ruées journalières de milliers de sabots et qui se cabre afin d’atteindre l’étage de la recette, là où s’encagent les houilleurs pour la descente, le véhicule fantôme est arrêté, abandonné par son attelage. C’est une roulotte, basse sur roues et peinte en noir, un noir de deuil, comme un fourgon mortuaire.
De l’intérieur, un homme vient de pousser les volets et d’en accrocher les battants; ses pas vont et viennent, résonnent sur le plancher et il siffle un air doucement. Il semble vaquer aux soins d’un ménage. On l’entend qui remue des bocaux, et range des ustensiles.
152
Mais de la roulotte, sort une odeur affreuse d’hôpital.
En bourgeron huileux, une poignée d’étoupe à la main, un mécanicien, apparu dans l’encadrement d’une porte, examine attentivement le véhicule mystérieux, où l’homme continue de siffloter distraitement, comme chantonne une ménagère à son travail.
Et voici que l’homme a sans doute terminé son ouvrage, car il descend l’escalier de la roulotte et s’assied sur la dernière marche, regardant les coudes sur les genoux, la grande cour vide.
Le mécanicien s’est approché. Il contemple encore un instant, en silence, ce long coffre noir, puis demande enfin:
—Eh bien, ch’ l’homme, quoi que c’est que ch’ l’affaire là?
Sans tourner la tête, ni faire un mouvement, et le regard toujours fixé devant lui, l’autre répond:
—Ça, c’est pour ch’ l’enquête de l’ maladie, l’enquête de ch’ ver intestinal, de «la jaune» quoi.
Le mécanicien hoche la tête et dit qu’il la connaît bien «la jaune», car son frère qui travaillait au fond en est mort. Un solide haveur pourtant, mais que le mal, en moins d’une année, avait épuisé, vidé, rendu quasiment pareil à un squelette. Et le plus triste, c’est 153 qu’il avait traîné encore longtemps ses pauvres os décharnés, avant que de mourir, pendant près de deux ans.
A tout cela, l’autre ne répond rien, indifférent, désintéressé.
Le mécanicien, songeur, répète:
Oui, pendant près de deux ans il les a traînés ses pauvres os!.... Puis il ajoute, après une pose:
—Pour lors, c’est ti qui soigne ch’ boutique?
—C’est mi.
Ils se sont tus. On n’entend plus que la respiration énorme de la machine, dont le geste humain, passe et repasse, régulier, derrière le vitrage d’une baie.
Soudain, l’homme assis sur l’escalier se lève, bourru:
—Vl’à ch’ docteur qu’arrive, va-t-en.
Le mécanicien qui s’était repris à considérer ce coffre, d’où flue une odeur écœurante d’hôpital, lentement s’éloigne.
Un petit monsieur, maigre, en redingote noire et chapeau cylindre, traverse la cour, marchant très vite. Arrivé auprès de la roulotte, il s’écrie tout essoufflé:
—Ah, voyez-vous, j’avais bien cru arriver en retard et manquer la descente. Tout est préparé, n’est-ce pas? les cuvettes? les vases?
154
Et, sans attendre une réponse, il grimpe les degrés de bois.
Depuis un instant, des bruits mêlés et confus, une rumeur de foule, montait de la route qui longe le mur de clôture. Mais comme cinq heures sonnent à une horloge qui surmonte le bâtiment sans étage des bureaux, cette rumeur augmente. On entend des portes se fermer en vibrant, des portes vitrées sans doute, comme en ont les débits de boissons. Et voici que, vêtus comme des forçats, de sarraux et de pantalons en toile grisâtre et presque tous en sabots, les houilleurs apparaissent entre les grilles et envahissent la cour.
Les bras croisés, l’échine pliée en avant comme si déjà sur eux pesait le toit d’une galerie, ils marchent à longs pas, les reins battus par leurs gourdes de fer blanc.
En colonne houleuse, comme des soldats qui ont rompu le pas, ils se dirigent vers le bâtiment d’extraction. Bientôt, ceux qui vont en tête se perdent sous le colosse de fer. Mais un moment après, par une issue qui se trouve auprès de la cale, ils reparaisssent, chacun d’eux portant cette fois sa lampe de fond allumée, ce qui éparpille dans la lumière du jour, de petits points de clarté blafarde. Alors, ils se mettent à gravir la 155 pente de la cale, qui se dresse ainsi que la montée d’un calvaire. Et les petites étoiles funèbres s’éteignent une à une, brusquement aspirées, semble-t-il, par le puits profond, plein jusqu’aux bords de ténèbres visqueuses et mortes.
Le docteur sort de la roulotte, revêtu d’une blouse blanche.
—Le chef-porion n’est donc pas là? interroge-t-il.
—Pardon, Monsieur, me voici, répond un homme vêtu en houilleur, mais la taille droite et les yeux durs, sous le bord rigide de son chapeau de cuir.
—Ah, très bien. En ce cas, je vais commencer. Car sachez, porion, que j’ai parfois des difficultés le premier jour de mon arrivée à une fosse. Beaucoup de ces malheureux refusent de se laisser examiner; ils croient que la compagnie cherche à se débarrasser des hommes malades.
Ils font quelques pas, et, devant eux, défilent les mineurs.
Le teint plus pâle encore au reflet des lampes, ceux-ci jettent des regards inquiets sur la blouse blanche et sur le fourgon.
—Tenez, appelez celui-là, dit vivement le docteur.
156
—Viens ici, Lequien, crie aussitôt le chef-porion.
Le houilleur obéit. Le docteur lui tapote l’épaule pour le tranquilliser.
—Mon ami, demeurez-là à l’écart, j’ai besoin de vous.
Un instant après, son geste désigne encore quelqu’un dans la coulée grise.
—Ah, c’en est un dont je ne connais pas le nom, grogne le porion. Et lui-même va prendre le houilleur par le bras. Mais celui-ci, brutalement se dégage, et farouche, s’élance sur la pente.
Le docteur se reprend à scruter toutes les faces qui passent devant lui. Son regard fouille comme un scalpel les traits ravagés et cherche à découvrir les stigmates du mal.
Là-haut, les berlines grondent sur les dalles de fonte et les cages qui s’accrochent aux verrous, saccadent des coups et des contre-coups fracassants. Par une baie ouverte, passe le ronflement des gigantesques bobines, lorsque de minutes en minutes, elles se lancent dans une giration éperdue qui enroule et déroule les câbles.
Et la ruée des sabots continue de marteler la terre; les échines roulent; et les petites étoiles toujours s’élèvent sur la montée de calvaire.
157
Patient et doux, le médecin a pu enfin décider une vingtaine d’hommes à le suivre, vingt hommes aux traits dépenaillés.
Le porion leur a dit que la journée de travail leur serait comptée, et qu’après l’examen du docteur, ils pourraient rentrer au coron. Alors, à pas traînards, ils sont tous retournés à la lampisterie, remettre leurs lampes à ces crochets matriculés, dont le contrôle, aux jours d’épouvante, marque le nombre des ensevelis.
Maintenant les voici groupés devant la roulotte, dont la porte grande-ouverte, laisse apercevoir l’intérieur, sorte de laboratoire rempli d’objets aux formes bizarres, d’instruments aux cuivres et aux aciers polis qui froidement brillent. Inquiets, ils regardent le docteur manipuler avec une méticuleuse attention son microscope.
—Allons, mes amis, je suis prêt. Qui veut passer le premier?
Les houilleurs murmurent; quelques-uns ont un mouvement de recul. Mais l’un d’eux, bravement, s’avance.
—Ah très bien, très bien! s’écrie le docteur qui le fait aussitôt monter près de lui.
Les autres tendent l’oreille, parce qu’on parle bas au camarade qui secoue la tête. Enfin, les paroles 158 chuchotées ont été sans doute plus persuasives, car le camarade suit le docteur dans une partie de la roulotte que cache un rideau.
Les houilleurs, durant l’attente, échangent entre eux de brèves paroles coupées de silence, de silence respectueux, pour tout ce savoir, toute cette science qui, pour eux, émanent de ces appareils de laboratoire aux formes hétéroclites et retordes.
Assis à l’écart, sur un seau, le gardien de la roulotte, paraît être tout pénétré d’importance et ne considérer qu’avec mépris, ces pauvres êtres au teint jaunâtre, à la maigreur perçant la toile grise de leur uniforme de de forçats. A une question timide, posée par ceux-ci, il a répondu sur un ton sentencieux «taisez-vous». Et, crachant loin, il a continué à fumer une pipe de terre, en regardant par de là l’encombrement des stocks de charbon et des mâts de boisage dressés en faisceaux, la haute et noire élévation de schiste, le terri, sur lequel stationne un train entier de wagons.
Le docteur reparaît seul, tenant en main une spatule d’acier sur laquelle, quelque substance se trouve recueillie. Il s’assied sur un haut escabeau, devant son microscope. Ses doigts nerveux et habiles manient des lamelles de verre, puis il fixe son œil aux lentilles.
159
Le houilleur paraît à son tour, bouclant le ceinturon qui retient ses pantalons de toile. Gauche, embarrassé, n’osant pas faire résonner ses sabots sur le plancher, il se croise les bras et reste debout derrière le docteur.
Un moment s’étant écoulé, celui-ci se tourne vers lui:
—Eh bien, mon pauvre ami, oui, voilà ce que j’avais bien pensé... Vous êtes atteint d’anémie ankylostomiasique. C’est grave. Si vous ne suivez pas un traitement, vos vertiges augmenteront, vos palpitations de cœur aussi et l’œdème se généralisera. Puis la consomption peu à peu vous enlèvera toute force et vous serez obligé de cesser votre travail.
Le mineur a baissé la tête, comme sous une malédiction. Sans lever les yeux, il demande d’une voix sourde:
—C’est y que ça a rapport avec l’ boisson?
—Avec l’intempérance? Mais non, mais non, c’est une maladie que vous avez contractée en travaillant au fond.
Alors le regard du mineur, va au groupe des compagnons qui sont tous immobiles, les bras pendants, les épaules voûtées, pétrifiés par l’attention.
Un silence passe. Il semble que le docteur vient de jeter quelque chose de pesant dans chacune de ces consciences confuses et sombres. Et voici que 160 lentement, pendant ce silence, une même pensée se forme derrière tous ces fronts durs.
Tout à coup, comme poussé par une colère âpre et triste, le houilleur, dans la roulotte, exprime cette pensée commune.
—Ben, ça serait-il l’ Compagnie qui serait responsable de mon incapacité si que je viendrais forcé d’arrêter?
—La Compagnie responsable?... Mais, mon Dieu, dans une certaine limite, oui je pense.... répond le docteur. Enfin, je vais toujours vous signaler pour que l’on vous donne des soins. Quel est votre nom?
Le houilleur longuement regarde le médecin avec méfiance, puis il finit par dire:
—Vasseur François.
—C’est bien, au suivant.
Un autre mineur au visage blême monte dans la roulotte, pour disparaître, lui aussi, avec le docteur, derrière le rideau.
Et la fosse continue de vivre sa vie formidable, en face de ces existences broyées. La machine étend ses pulsations avec une régularité, une puissance implacable; dans le beffroi, les molettes tournent, s’arrêtent, comme obéissant avec précision; la pompe d’épuisement et un tuyau d’échappement râlent en 161 cadence. Là-bas, sur le terri, une locomotive avance avec précaution, comme si elle craignait de dégringoler sur le remblai. Elle s’accroche au long train de wagons et s’en revient lentement en expectorant des jets de vapeur hors de ses poumons d’acier.
Là-dessous, dans l’écrasement des couches profondes, dans la touffeur des fonds où hululent plaintivement les courants venus du jour, a commencé le travail de bagne. A moitié nus, allongés sur le flanc, aveuglés de sueur et la poitrine haletante, les haveurs, péniblement, lancent de biais la rivelaine, pressés par l’étau des roches, tandis qu’autour d’eux, dans les ténèbres lugubres, la mort guette, attentive.
Et il va bientôt arriver au jour, l’or noir que décèlent leurs rivelaines et passer au criblage, car les équipes de trieuses se rendent à leur poste. Celles-ci arrivent, par bandes de trois ou quatre, se donnant le bras, se chuchotant des choses qui les font rire et secouer les plis coquets de leurs béguins de toile bleue.
Auprès de la roulotte, un instant, elles s’arrêtent, mines sérieuses et bouches bées. Mais, de là-haut, le surveillant du triage les cingle d’un coup de sifflet suraigu. Alors, elles s’élancent sur la cale, et, lutines, égrènent encore des rires clairs.
162
Le docteur qui se trouvait de nouveau à son microscope, se penche hors de la roulotte, avec un hochement de tête indulgent pour cet éclat de gaîté, si bon à entendre parmi cet ensemble si désespérément morne des êtres et des choses, qui reflètent mutuellement leur tristesse. Puis, se rasseyant sur le haut escabeau, il s’adresse au houilleur en expectative.
—Non, cette fois je ne trouve rien. Vous n’êtes pas atteint par l’ankylostome, par les mauvaises petites sangsues. Mais en vous auscultant j’ai découvert que vous êtes malade de la poitrine. Il est grand temps que vous vous soigniez; or, vous soigner, c’est ne plus boire, car vous êtes un alcoolique. Oh! inutile de nier... D’abord, vous buvez tous, tous. Il est six heures du matin et pas un de ceux d’entre vous qui m’ont approché, n’avait une haleine qui n’empoisonnât le genièvre. C’est navrant.
Mais à voix basse, comme s’il se parlait à lui-même, le médecin ajoute:
—Maintenant, c’est peut-être votre métier si pénible qui vous y pousse un peu...
Et dans ses yeux passe de la pitié, quelque chose de douloureux et de doux.
L’examen de toutes ces loques humaines continue.
163
Chacun des misérables déchus, des misérables dégénérés au corps évidé, attend le verdict du praticien dans une même attitude harassée, commune à tous. Ceux qui ont été examinés ne s’éloignent pas, ils rentrent dans le groupe. Et le groupe, épaules courbées, attend résigné sous la pluie fine qui, commençant à tomber du ciel gris et sale, ajoute une impression lamentable à cette détresse humaine.
Et toujours la vie de cette chose qui les a brisés, continue de battre invincible entre les murailles de fer, prolongeant son énergie vorace jusqu’aux tréfonds du sol.
C’est fini, les vingt houilleurs pitoyables ont été examinés. Ensemble, ils sont partis, groupe hâve.
A présent, le docteur est seul, songeur devant le livre ou s’alignent des noms avec, en regard, le résultat de l’observation médicale.
Il songe avec tristesse à tout ce que chaque jour il découvre d’affreux, de tares héréditaires aggravées de tares professionnelles, dans ces grands troupeaux dévolus aux fatalités du labeur. Et tout cela lui apparaît encore plus désolant, dans ce pays envoûté par la désespérance d’un ciel éternellement sombre, qui pèse comme un bloc d’ennui.
164
Envoyé dans ce Nord par l’État, afin d’enquêter sur la mystérieuse anémie, il touche en même temps à toutes les plaies. Et il a conscience de l’inanité de son rôle, lui, médecin, alors que le seul remède ne relève que du domaine social. Il hausse les épaules devant cet ouvrage de statistique. Il se demande ce que seront les générations futures de cette race de houilleurs, les petits-fils dégénérés de ces alcooliques, de ces tuberculeux, qu’épuisent encore les larves des fonds.
Et là, près de lui, dans le colosse de fer, résonnent des bruits pressés, trépidants, comme si les féroces impatiences qui mettent en désaccord le travail et la vie, soufflaient leur fièvre aux machines.
Le docteur pousse un soupir et referme le livre. Il se lève, quitte sa blouse blanche et revêt sa redingote. D’un geste distrait, il brosse avec le revers de sa manche son chapeau haut de forme, sans guère y amener un reflet. Puis il descend les degrés de bois et sans se soucier de la pluie fine, roule lentement une cigarette, en suivant du regard les épaisses volutes de fumée noire, qui sorties de la cheminée du bâtiment d’extraction, se déroulent très loin, lentes et lourdes.
Tout en sifflotant son air mélancolique, le gardien maussade a commencé de remettre tout en ordre, dans 165 cette roulotte où se dit—hélas!—une bonne aventure lamentable.
Soudain, un coupé électrique surgit et fait, dans un glissement rapide et doux, une élégante courbe à travers la cour: de la grille à la porte des bureaux où il s’arrête silencieux.
Nu-tête, porte-plume sur l’oreille, un commis s’est précipité à la portière et a salué bien bas un grand vieillard sec et droit. La portière refermée, il l’a suivi, incliné comme s’il portait une traîne.
Et le voici qui reparaît, ce commis, et, toujours empressé, agitant ses manches de lustrine, accourt auprès du docteur.
—Monsieur le directeur général vous prie de passer aux bureaux.
Tranquillement le docteur répond:
—«Je vous accompagne». Mais l’employé affolé par son zèle, devance prestement le médecin, tandis que celui-ci s’en va, lentement, comme si un lourd ennui l’empêchait de se hâter.
Le directeur général est seul dans le bureau de l’ingénieur, où, sur des tables élevées, sont disposés les plans souterrains de la fosse.
166
Debout, il va et vient d’un pas sonore, autoritaire, les lèvres serrées, ce qui fait pointer en avant sa barbe blanche plantée drue.
La taille militairement sanglée en l’habit au revers duquel saigne la rosette d’officier de la Légion d’honneur, le port de tête droit, la démarche roide, sans rien de souple ni d’hésitant, tout en lui indique le commandement, la volonté obéie. Dix-huit mille êtres sont sous les ordres de cet homme et aucun d’eux, n’est individuellement considéré par lui: seule la masse, comme un levier.
On frappe à la porte. D’une voix brève le directeur ordonne:
«—Entrez».
Le docteur est devant lui, gauche et timide un peu, mais avec dans ses bons yeux mélancoliques, une petite flamme claire d’intelligence.
—Docteur, veuillez m’excuser si je vous distrais un instant de vos travaux, mais j’ai à vous adresser une légère représentation.
Il a fait un geste indiquant un siège et tous deux se sont assis. Alors une voix sèche commence de résonner dans la pièce froide et nue.
—L’État, impose aux Compagnies minières un 167 contrôle qui devient de jour en jour plus investigateur. En ce moment, elles le subissent sur une question d’hygiène. Or donc, depuis deux mois, comme médecin délégué, vous enquêtez chez nous afin de situer par diagrammes et rapports statistiques, un mal très vaguement déterminé et auquel, permettez-moi de vous le dire, je ne crois que très peu.
Devant un geste de protestation, la voix devient plus incisive et mordante.
—Oui c’est ainsi, on veut trouver dans ces vulgaires malaises intestinaux que tout simple terrassier connaît, un mal redoutable, épidémique et contagieux, sévissant sur les personnels houillers.
Or, ceci m’indiffère absolument, toutes les Compagnies minières étant également suspectées et soumises à examen. Mais chez elles—et voici le seul point qui m’intéresse—l’enquête n’est pas menée de la même façon qu’elle l’est ici.
Je m’explique. Alors que chez elles on examine dix pour cent des ouvriers, dix sujets pris absolument au hasard, chez nous ces derniers sont choisis, triés; on semble éviter d’avoir à examiner un homme d’aspect robuste. Or, il est évident que chez les sujets débilités par une cause quelconque, on est enclin à trouver 168 aussitôt, les effets morbides de cette fameuse anémie ankylostomiasique. Je crains donc, qu’il n’en résulte un état comparatif, fâcheux pour notre exploitation. Pourquoi user de méthode sélective? J’ai la certitude que ces sangsues microscopiques, auxquelles on a donné un nom pompeux, habitent aussi bien des organismes robustes, sans que ces organismes en souffrent gravement. Que l’on interroge nos porions. Beaucoup, diront qu’ils eurent pendant leurs longues années de fond, à souffrir passagèrement de troubles digestifs et intestinaux, sans que, pour cela, leur constitution en ait été délabrée. Enfin, encore que ces statistiques portent sur un fléau très contestable, je désire que la nôtre ne nous soit point nuisible par comparaison. Vous me comprenez, n’est-ce pas, docteur?
Les yeux froids, immobiles, du directeur restent fixés sur la face triste du médecin, avec une expression de sagacité aiguë, pénétrante, tandis que sa véritable pensée demeure en retrait derrière ses arguments.
Le docteur pousse un soupir et doucement hausse les épaules.
—Mon Dieu, monsieur le Directeur, je ne veux pas m’évertuer à vous convaincre de la gravité d’un mal auquel vous ne voulez pas croire. Je désire seulement 169 vous assurer que la Compagnie ne doit rien craindre de la façon dont je mène mon enquête. Je n’ai point, dans les autres fosses, examiné systématiquement que des hommes d’aspect maladif. Sachez que, dans cette dernière fosse, je pose déjà quelques jalons pour l’enquête ultérieure que je ferai sur la tuberculose; j’examine ici certains rapports, certains faits connexes...
A ce nom de tuberculose le directeur a laissé échapper un petit geste d’impatience, et un pli volontaire, s’est creusé entre ses sourcils. Mais s’étant ressaisi presqu’aussitôt, sa physionomie dure s’est fondue dans un sourire aimable, cependant que sa voix métallique, reprenait cette fois avec une nuance de douceur:
—Voilà qui est très bien, docteur, et je vous remercie de m’avoir éclairé; cette déclaration me suffit; et ne croyez pas, en suite de cette conversation, que j’eusse contre vous quelque suspicion ou sentiment hostile. Non pas; je craignais tout simplement que vous n’usiez envers la Compagnie de quelque sévérité. Je n’ai jamais vu en votre manière d’agir, que le fait d’une conscience absolue apportée dans votre travail, en un mot une admirable probité professionnelle. Et c’est bien là, croyez-le, toute ma pensée. Car, je vais même vous 170 avouer que, le poste de médecin principal étant vacant dans notre Compagnie, il me serait agréable que vous en acceptassiez la charge, après vos enquêtes officielles sur l’ankylostome et la tuberculose.
Au lieu de la petite flamme de convoitise qu’on avait espéré allumer dans les yeux du médecin, quelque chose y brille d’ironique.
Un silence redoutable sépare les deux hommes, un de ces silences qui sont pour l’âme une souffrance, un de ces silences actifs où rien n’est assoupi, où le mépris, la haine, tout ce qui éloigne, tout ce qui brise, travaillent.
Enfin le médecin se lève et dit, lentement, de sa voix calme avec pourtant un pli méprisant aux commissures des lèvres:
—Je vous remercie de cette offre, monsieur le Directeur, mais certaines considérations d’ordre intime m’empêchent de l’accepter.
Subitement, le Directeur a repris sa physionomie dure, impérieuse, et le voici qui s’exprime froidement, sur un ton de réprimande.
—«Mais réfléchissez, docteur. Savez-vous bien que le poste est des plus enviable..... quinze mille.....
171
—Je le sais, Monsieur, et c’est pourquoi je vous remercie encore, d’avoir un instant pensé à moi.
Un «je n’insisterai pas» hautain, a vibré dans la petite pièce froide et nue. Le silence hostile va planer encore. Mais les deux hommes se sont inclinés.
Dehors, la pluie fine a cessé, mais le ciel sombre et bas, pèse toujours sur cette terre. Des locomotives jettent leur cri déchirant; là-bas, un remorqueur, sur quelque canal, semble leur répondre par un long sifflement enroué. Et cela s’étend, et cela meurt, très loin dans les espaces illimités de la plaine.
Le docteur qui a quitté la fosse, marche lentement, les mains croisées sur le dos. Il suit la rue formée d’un côté par le mur clôturant la mine et ses terrains, de l’autre par la file des estaminets que, de distance en distance, coupe un terrain vide, par où on aperçoit le coron, géométrique comme une colonie pénitentiaire.
Il va, songeant à ce pays de richesses et de douleurs, de forces et de misères. Il pense à tous ceux qui sont là, sous lui, dans les profondeurs d’abîmes, luttant contre les forces élémentaires. Et c’est bien une pitié fraternelle qu’il ressent pour eux.
Des faces de houilleurs repassent par son esprit. Il 172 revoit des yeux, brillants dans des pâleurs émaciées, ou encore de ces faces passives figées par l’abêtissement.
Mais le médecin s’arrête; d’un cabaret, sortent de rauques éclats de voix et sur le pas de la porte, deux houilleurs causent en titubant.
Ils sont tous là, ceux qu’il avait puisés dans la coulée grise où brillaient les petites lampes funèbres. Il les reconnaît, il s’approche, et par la porte ouverte les contemple d’un air découragé.
Mais eux l’ont aperçu, leurs yeux hébétés par l’ivresse s’étonnent. Puis c’est brusquement un même élan de haine aveugle, de fureur animale. Des poings se tendent, des bouches se tordent pour hurler des injures et des menaces.
Tout à coup, l’un d’eux se précipite sur la porte et la ferme à toute volée, comme s’il la lançait pour écraser quelqu’un.
Alors lui continue sa route plus lentement, le dos rond, la tête penchée. Et tout autour de lui, grandit cette désespérance qui vient on ne sait d’où... des hommes peut-être... ou bien des choses...

175

Veuve
Le vent gémit; la pluie grelotte contre les vitres. Dehors, la nuit est profonde, mais là-bas, au loin, sur un point de l’horizon de ténèbres, les fours à cokes mettent une lueur d’aurore fantastique.
Par instants, dans la chambre enténébrée où le poêle jette par son œil incandescent une petite clarté solitaire, un long sanglot s’élève et expire dans le silence. Puis, c’est un tressaillement du charbon dans son creuset de fonte, ou bien encore, c’est une braise qui tombe comme une larme. Et l’on n’entend plus que le glissement triste de la pluie sur les vitres et les gémissements du vent.
176
Dans un coin, quelque chose a remué. Une silhouette s’est dressée; elle s’est approchée de la fenêtre. Longtemps elle y demeure immobile, puis elle s’affale et une voix de femme se met à se plaindre doucement, douloureusement.
Un bruit pesant, cadencé, s’approche; une patrouille passe et s’éloigne.
Tout à coup, les plaintes cessent, la femme se lève et s’écrie: «j’y revas». Alors la porte de la chambre s’ouvre, et voilà la femme qui, dans la nuit, sous la pluie glacée, s’en va titubante, comme saoule.
Elle passe devant d’autres maisons accroupies dans le noir, à distances égales. Des lumières clignotent et le vent fait battre des portes, lugubrement, comme si toutes ces maisons étaient abandonnées. Un chien, quelque part, hurle l’angoisse, la mort. Et les tintements sinistres des glas que l’on sonne dans les paroisses, agonisent dans l’air, venus de très loin, à travers les ténèbres.
Mais Elle, ne voit rien, n’entend rien. Elle va toujours, les yeux fixés au dedans d’elle-même, fixés sur trois faces que l’épouvante a immobilisées dans sa mémoire.
—«Oh mon pauvre homme, mes pauvres fieux».
177
Et sa plainte s’en va, tordue par le vent, dont les rafales déferlent sur la grande plaine rase.
Elle grimpe un talus, tombe sur les genoux, se relève. Ses pas s’enfoncent dans la terre détrempée d’un champ; la pluie l’aveugle; mais elle continue à avancer avec obstination dans les épaisses ténèbres.
Apparue soudainement, une grosse étoile électrique, là-bas brille immobile. Et ceci maintenant semble guider cette femme dans l’aveuglement de la nuit.
Elle traverse une route, puis, boitant sur le ballast, franchit une voie ferrée; après quoi elle longe une palissade. Et voici qu’autour d’elle, c’est un enchevêtrement de formes vagues. Elle se heurte à une sorte de muraille; ses mains palpent les angles de gros blocs de houille superposés.
Tout à coup, une ombre surgit devant elle, se silhouettant sur la lueur électrique. Une voix lui crie «On ne passe pas». Alors, elle fait un détour, frôlant des gerbées de mats dressés et se heurtant encore contre des stocks de houille.
Elle marche toujours, elle avance avec des tâtonnements de bête nocturne qui, peureusement, rôde. Et de distance en distance, l’ordre est répété, par des sentinelles invisibles «Passez au large».
178
Sans révolte, elle suit la direction que la forcent à prendre toutes ces voix, qui de l’ombre, durement la repoussent.
Une grille; derrière cette grille, une compagnie d’infanterie, l’arme au pied. En deçà, trois rangs successifs de gendarmes à cheval, botte contre botte, immobiles, silencieux et sombres. Et devant ceux-ci, depuis les poitrails frémissants de leurs chevaux, s’étend une grande masse noire, mouvante, d’où monte une rumeur qui ondoie selon le vent et que parfois domine un cri aigu.
Voici trente heures que le troupeau affolé des femmes se presse contre ce barrage.
Un fanal électrique qui, dans la cour de la fosse, du haut de son gibet, vaguement là-bas, révèle la grande masse tragiquement muette et obscure du bâtiment d’extraction, diffuse jusqu’à cette foule, une lueur qui blêmit les faces crispées, émergeant de l’amas compact des corps.
Les voix des factionnaires ont mené jusqu’ici la pitoyable errante. Et voici qu’à présent, sa plainte se mêle et se confond avec les autres plaintes:—«Oh! 179 mon pauvre homme, mes pauvres fieux». Poussée par son angoisse, elle pénètre dans cette foule aussi avant que cela lui est possible, jusqu’à ce que son élan soit entravé.
Maintenant, elle va demeurer là, à les attendre, comme elle le fit hier, durant toute la lugubre journée, comme elle le fit cette nuit même, avant que ne la prit cette idée impulsive de retourner au coron s’assurer qu’ils n’étaient pas rentrés.
Dépeignée, le visage creux, sa robe dégouttante de pluie et plaquée sur ses os, elle reste clouée sur place, sans entendre autour d’elle les propos déments. D’instant à autre, d’un geste égaré, un geste de folle, elle écarte une mèche de cheveux mouillés, qui retombe sur son front. Et le regard fixe, l’oreille tendue, elle est attentive à tous les bruits qui peuvent venir de la fosse.
Là-bas, dans le grand bâtiment rigide et muet, un marteau frappe à coups égaux; et ce bruit perdu et solitaire grandit encore l’impression de désastre et de mort que donne cette masse désemparée.
Pourtant, son imagination de femme ignorante et simple ne complique pas son angoisse. De la catastrophe, elle n’évoque rien, n’imagine rien. Elle ne se représente 180 pas son mari, ses fils, défigurés, carbonisés ou broyés; ni des monceaux de cadavres noircis, devenus pareils à des blocs de schiste, non plus que d’hurlantes agonies. Elle ne voit point une galerie en feu grésillant des chairs, ni des éboulements mettant des corps en bouillie, ni l’eau des poches éventrées s’entonnant dans les bouches, ouvertes pour un dernier cri d’appel.
Non, elle attend qu’ils viennent à elle, dans leurs sarraux de toile grise, le dos rond, les mains sous les aisselles, leurs gourdes de fer blanc leur battant les reins. Elle attend que ces trois faces qu’elle a toujours présentes devant les yeux, s’animent, et que la voix éraillée du père lui dise: «Nous v’la».
Et puis, de leurs chantiers souterrains et de l’existence qu’ils y mènent, elle ne connaît rien. Cette grille, elle ne l’a jamais franchie. Elle ne fut ni trieuse, ni moulineuse, comme le furent, étant jeunes, beaucoup de femmes de houilleurs; fille de paysans, jadis elle travaillait aux champs. Dans le coron, elle n’a connu que ces départs et ces retours des hommes, ces allées et venues régulières, espacées par un grand vide des heures, pendant lesquelles on voisine et on paresse devant des bolées de café.
Mais quoiqu’elle ne soit guère torturée par de 181 terribles évocations, le silence insolite, le silence funèbre de cette fosse, l’oppresse, lui serre le cœur. Et si elle n’écoute pas les propos désespérés des femmes qui l’entourent, elle attend avec anxiété que cette grande bâtisse lugubrement muette, s’anime d’un peu de vie.
Parfois, elle s’évanouit dans une douloureuse somnolence où elle perd conscience des heures noires, des heures glacées qui se succèdent lentement. Alors, il arrive que les trois faces toujours présentes à son esprit se mêlent au souvenir de la maisonnette vide, dans le coron dépeuplé, au souvenir de simples choses familières, qui là-bas, semblent attendre les absents. Les vêtements de rechange sont placés sur une chaise; le cuvier dans lequel ils devaient se débarbouiller, est près du poêle qu’elle a rallumé; sur la table, il y a une lettre qu’apporta le facteur, et qui est adressée à son fils aîné. Et toutes ces choses prennent dans son esprit, l’étrange aspect que revêtent celles que l’on voit dans un cauchemar.
Puis tout cela disparaît, et elle retombe dans une hébétude profonde, ne vivant plus que pour un bruit de pas, qui pourrait venir de la fosse, de cet inconnu terrible.
182
Tout à coup, une voix, crie «V’la qu’on en remonte encore». Peut-être, par les fissures du barrage, a-t-on aperçu des civières passant au loin, vagues fantômes dans le rayonnement blafard et mourant du fanal électrique.
Aussitôt, la foule a comme un grand spasme. Des femmes se jettent dans les bras l’une de l’autre et s’étreignent en poussant des cris aigus. Il y a des bousculades, des remous. Puis des vagues hurlantes, hérissées de bras, vont déferler contre les poitrails des chevaux. Les mains s’accrochent aux brides, les montures se cabrent, et les voix hurlent.—«Laissez-nous entrer, nous voulons nos hommes.»
Un commandement bref et menaçant retentit: «Refoulez». Alors les sabres ont des reflets qui vacillent, des aciers s’entrechoquent; et le sombre barrage s’ébranle et s’avance. Mais voici qu’une immense clameur s’élève, qui grandit, s’enfle. Et les manteaux noirs, doivent reculer devant un reflux irrésistible de la foule entière, cependant que les chevaux hennissent de peur, en sentant un grand souffle vivant.
De nouveau, les gendarmes sont contre les grilles, immobiles, et serrés botte à botte, solides comme une muraille épaisse.
183
Les malheureuses femmes délirent. Elles lancent des injures aux gendarmes, elles les lapident avec les épithètes—misérables—lâches—assassins—comme avec des quartiers de briques.
«On en remonte», c’est la troisième fois, depuis qu’elles sont massées devant cette fosse, qu’elles entendent ce cri. Et chaque fois leur élan pour franchir les grilles, pour courir là-bas jusqu’au puits, se brise contre le barrage.
Maintenant, elles ne lancent plus d’injures, elles clament—les noms—les noms—donnez-nous les noms...
Et des voix se font suppliantes. Mais rien ne leur répond. Derrière ce barrage de troupe et cette grille, c’est toujours le même sinistre et redoutable silence, de tout ce qu’on leur cache d’horrible.
Alors, tandis que là-bas, le marteau solitaire continue de frapper à coups réguliers, ici, les sanglots et les plaintes, se reprennent à monter de l’amas confus, où la lueur frisante du fanal électrique, vient blêmir des visages de femmes échevelées.
Lorsqu’Elle avait entendu ces mots qui donnèrent un frisson et un spasme à la foule, ses genoux s’étaient 184 mis à trembler, ses mains s’étaient accrochées aux épaules qui étaient devant elle, et elle avait senti son cœur, battre violemment jusque dans sa gorge. Dans cet instant, elle avait eu la soudaine et fugitive vision de son homme et de ses fils s’en retournant avec elle au coron.
Et puis, tout s’était brouillé dans son esprit. Des remous l’avaient entraînée. Pressée entre des épaules et des poitrines, elle avait suivi les grands mouvements de flux et de reflux. Mais aucune révolte, aucune colère, ne lui avaient fait hurler des injures. Elle était restée isolée dans sa propre angoisse et sa douleur sourde. Seulement, à présent que des sanglots et des plaintes s’élèvent, elle se cache le visage dans les mains et se met elle aussi à pleurer et à gémir, ayant peut-être compris, comme les autres, l’affreuse signification de ce grand silence qui continue de planer sur la fosse.
Les heures noires passent, et sans cesse, la pluie qui noie les ténèbres, tombe glaciale, mortelle, sur les épaules qui frissonnent; et toujours, le vent de la plaine rase, passe à grands coups de faux sur toutes ces têtes éperdues, sur toutes ces faces blêmies et crispées.
185
De sa chevelure plaquée, l’eau lui glisse sur la nuque, un froid de glace lui coule dans le dos. Mais elle ne ressent plus rien. Ses jambes, tour à tour flagellent puis se raidissent; sa taille s’affaisse, puis se redresse, mais elle n’a plus conscience de sa fatigue. La foule attend l’aube, comme si le jour qui va paraître, devait amener un nouvel espoir. Elle aussi, attend, avec la résignation d’attendre là toujours, engourdie, tombée dans une profonde torpeur physique.
Elle ne sort même pas un instant de sa prostration, quand une femme, à côté d’elle, prise d’une crise de désespoir, se met à lui serrer le bras et à lui dire en branlant la tête: «Non... non... voyez-vous c’est bien fini... ils ne remonteront plus jamais... jamais.....»

186

Le jour paraît, avec une tristesse de crépuscule. Aucune aurore, aucune teinte claire, ne s’éveillent ni ne s’irisent dans le ciel uniformément sombre; aucun rayon ne peut trouer cette grande loque sale qui, lentement, lourdement, au-dessus de la plaine glisse et qui à l’horizon, semble sur elle, pendre et traîner. Rien ne vibre, rien ne se colore: seule une lividité de plomb, révèle les choses. Et les choses, restent inertes et sans joie.
Dans la cour de la fosse, les chevaux attachés à des piquets, s’ébrouent et frappent du sabot le sol boueux et noir. Des soldats toussent, dans la compagnie d’infanterie qui se tient l’arme prête auprès de la grille fermée. Le long du mur de clôture, entre des faisceaux de fusils, des feux de bivouacs pâlissent. Et le grand bâtiment de fer, grandi par le silence, pèse, morne et 187 tragique, sur le réveil lugubre. Plus rien ne gronde ni ne résonne sous ses grandes nefs sonores et vides. L’arrêt de ses machines, l’arrêt sinistre de sa respiration large et profonde, ont fait de lui un cadavre géant.
Maintenant, plus une civière n’en sort, furtive. Il est terminé, le mystérieux travail de la nuit, et des factionnaires gardent l’entrée du long bâtiment sans étage, dont on a fait une morgue.
Là, sur le froid carrelage dans la pénombre que traversent obliquement des raies de jour blafard tombant des fenêtres, sont alignées cinquante bières béantes. Et sur la blancheur des suaires, se détachent les attitudes suppliciées des cadavres noircis par le feu souterrain: formes confuses et terribles, hérissées de gestes effrayants et pétrifiés.
Il semble que leur torture se perpétue au-delà du trépas et que jamais, ces morts ne s’endormiront, quand leur cercueil sera clos.
La voici venue l’heure redoutée où il va falloir, à celles qui attendent encore un être humain, rendre ces choses tordues, recroquevillées et calcinées.
Là-bas, au-delà du barrage, un grondement, monte menaçant. C’est qu’à présent, les femmes connaissent 188 l’affreuse vérité; elles savent que pas un houilleur ne remontera vivant au jour. Elles exigent furieusement leurs morts. Mais les malheureuses dont la douleur s’exaspère, ignorent encore que là-dessous le charnier est en feu et qu’on ne peut même plus leur promettre d’autres cadavres, que ceux que l’on va présenter à leurs yeux épouvantés.
Des sections d’infanterie et des pelotons de gendarmes, cantonnés dans les terrains vagues de la houillère, viennent encore renforcer les troupes qui encombrent la grande cour. Des ordres se transmettent; les officiers font former à leurs hommes une double haie qui, partant de la grille, va aboutir à la morgue où pénètrent des gendarmes, le pas pesant, et jugulaire au menton.
Derrière les barreaux qui défendent les fenêtres des bureaux, apparaissent par moment, des figures pâles et inquiètes. Et le grand bâtiment inanimé, semble regarder lui aussi la morne animation de cette cour, avec les grands yeux vitreux de ses verrières.
Soudain, des cris vibrants et douloureux, montent vers le ciel funèbre: on vient d’annoncer à la foule, que par petits groupes, elle va enfin avoir le droit de reconnaître les cadavres.
189
Hébétée, étourdie, semblable à une personne qui serait brusquement passée d’une profonde obscurité à une clarté vive, Elle regarde avec des yeux effarés les soldats immobiles et silencieux qui l’entourent.
Un officier lui ordonne. «Suivez le groupe.»
Alors, docilement, Elle suit celles que l’on a laissé pénétrer par le guichet et qui s’avancent, sanglotantes, entre les deux haies de baïonnettes.
A l’entrée de la morgue, d’où l’on aperçoit les cercueils béants, le groupe lamentable a un recul d’épouvante. Puis celle qui marchait en tête du groupe, s’avance, les mains jointes sous le menton, la tête inclinée, dans une attitude de pitié douloureuse.
Une femme tombe lourdement sur les genoux, brisée, et s’appuyant d’une main au rebord d’une bière, s’écrie, la voix chevrotante et lointaine.—Oh! mon Dieu, mon Dieu... est-il possible de nous les rendre comme ça!...
Deux autres, se tenant serrées par le bras, suivent rapidement la ligne des cercueils, le corps penché en avant, les regards avides, cherchant à reconnaître un visage. Arrivées au fond de la longue salle froide et nue, les deux femmes se retournent, s’appuient contre 190 le mur et demeurent là sans bouger, le teint jauni, les lèvres décolorées, le visage contracturé, sans une larme, avec des prunelles fixes de folles.
Ici, comme dans la cour pleine de troupes, Elle, reste hébétée. Mais un des gendarmes qui se tiennent échelonnés derrière les cercueils, s’avance et lui dit. «C’est aux vêtements, qu’il faut essayer de les reconnaître.»
Alors Elle s’agenouille devant une bière, se penche vers le cadavre carbonisé qui, sur le suaire, paraît se tordre encore de souffrance.
Sur le crâne, les cheveux ont disparu, brûlés. Dans la face noircie, les orbites sont vides, et la bouche, n’est plus qu’un trou aux rebords tuméfiés, d’où découle un filet de sanie putride. Le ventre est ouvert, les intestins ont débordé, bouillonnement figé, entre les jambes qui sont demeurées ployées. Pas un lambeau d’étoffe, seules de grosses bottines aux semelles cloutées, chaussent encore les pieds de leur cuir racorni. Après que, les paupières ardentes et les mains fébriles, elle a touché les bottines du mort, elle hausse doucement les épaules et secoue la tête d’un air désespéré et dolent.
Et puis, vers la bière voisine, elle se tourne. Là, sur 191 la forme hideuse, il y a un rappel de vie, rappel étrange et terrifiant. La chair d’une épaule est demeurée blanche, alors que tout le reste du corps est noirci et que le bras attaché à cette épaule se montre ratatiné et tordu comme un cep de vigne.
Elle a saisi un morceau de tricot que la flamme du grisou n’a pas consumé, elle le tourne et le retourne entre ses doigts tremblants. Ensuite, elle palpe un lambeau de velours à côtes, qui entoure encore l’extrémité d’une jambe.
Tout à coup elle se redresse, se couvre le visage de ses mains et gémit: Oh oui, le voilà, c’est lui, c’est mon homme!...
Une sorte d’employé qui tient des feuillets à la main, s’avance vivement.
—Vous l’avez reconnu?...
—Oh oui, Monsieur, c’est lui, c’est mon pauvre homme.
Un sous-officier, qui se trouve là avec des brancardiers, lui demande: En êtes-vous bien sûre?
Mais l’homme aux feuillets intervient, et avec colère dit au sergent: «Allons, c’est bon, fermez donc cette bière et sortez la immédiatement d’ici». Il demande le nom du mort, l’inscrit sur un feuillet; puis, avec de 192 la craie, sur le couvercle de sapin, il moule d’une belle main de comptable ce mot: Reconnu.
Tout le long de la sinistre rangée des cercueils, ce ne sont qu’agenouillements des pitoyables femmes, dont les visages bouleversés et flétris se penchent avides et sans dégoût sur les linceuls souillés, d’où montent des exhalaisons putrides et une puanteur écœurante de chlore.
Et leur douleur est sans contrainte; à leurs soupirs, à leurs gémissements et à leurs sanglots, se mêlent les lourdes exclamations du grossier patois.
Soudain, un officier paraît, consulte sa montre, et dit aux gendarmes: «Les quinze minutes sont passées, faites évacuer la salle.
Quinze minutes! c’est le temps que le service d’ordre a décidé d’accorder à chaque groupe pour reconnaître ces cadavres méconnaissables.
Alors ce sont des hurlements et des cris de révolte. Une malheureuse se débat, s’accroche à un cercueil. Mais les gendarmes, aussitôt s’irritent et emploient la force pour briser ces nerfs de femmes.
Ils se sont rangés, coude à coude, d’un mur à l’autre, et pas à pas, poussant devant eux le troupeau des veuves en larmes jusqu’à une porte de sortie qui se 193 trouve à l’extrémité de la morgue, ils dégagent cette longue salle comme ils le feraient d’une rue, en temps de grève.
Comme un gendarme la poussait, Elle, simplement avait dit:
—J’ai encore mes deux fieux à retrouver. Puis, voyant qu’on ne l’écoutait point, elle avait obéi, baissant la tête, résignée.
D’autres femmes, vont entrer dans cette morgue et, contre les murs froids et nus, vont encore se briser d’autres sanglots.
Dehors, le sergent l’attend avec les brancardiers, qui vont porter jusqu’au coron le cercueil déjà mis sur une civière. Derrière celle-ci, elle se place, comme elle le ferait derrière un corbillard. Et l’on se met en marche: eux d’un pas cadencé et lourd, elle, avec un air brisé de pauvresse.
Les brancardiers passent derrière les troupes. Ils ont reçu l’ordre de quitter la fosse en faisant un long détour à travers les terrains vagues.
A cet instant, des cris s’élèvent, quelques voix furieuses menacent. Des hommes, des houilleurs qui travaillent dans les autres fosses et qui avaient ici un 194 père, des frères, un ami, sont entrés aussi pour reconnaître les cadavres. Et ces hommes tendent le poing aux figures peureuses qui, à l’abri des fenêtres grillagées du bureau, les regardent passer. On entend des coups sourds, un bruit de lutte. Puis, la haie des soldats s’entrouvre pour laisser passer des gendarmes emmenant quatre hommes qu’ils viennent d’arrêter.
Les brancardiers longent le grand bâtiment inanimé. Ils passent devant la montée de terre où, dans la boue, sont restées imprimées les foulées de ceux que jamais plus les cages rapides ne remonteront au jour. Et les voici qui hâtent leur marche, épouvantés, semble-t-il, de passer en cet endroit avec la pauvre femme qui les suit.
Ils traversent des voies ferrées, s’avancent entre des trains entiers de wagons vides et l’encombrement des bois de mine, où sont encore échelonnés des factionnaires.
Sur la gauche, se dresse le terri, la noire colline de schiste, au haut de laquelle une sentinelle va et vient, les regards fixés au loin, du côté des autres fosses... Puis, s’ouvre le grand vide de la plaine. Les pas des brancardiers s’appesantissent dans la terre grasse des 195 champs, le poids du cercueil raidit leur bras. Le sergent qui les conduit, leur ordonne de s’arrêter et de déposer la civière.
Ils se taisent, ils craignent de parler et pour prendre contenance, ils contemplent le ciel sombre qui glisse tout d’une pièce. Et la femme pleure, le regard fixé sur le cercueil.
Là-bas, un paysan travaille à la terre. Il conduit d’un bout à l’autre d’un champ labouré, deux chevaux lents, attelés à une herse. Il marche auprès d’eux, à longs pas réguliers, et leur crie de temps à autre, d’une voix calme, un hue dia qui s’éteint sans écho dans l’espace. Et l’on entend des chants de coqs, qui viennent du lointain paisible, d’un vieux village, si vieux qu’il a pris la couleur de la terre.
De leur pas cadencé ils se remettent en marche; et bientôt apparaît le coron que cachait une ondulation du sol: Village artificiel, sans âme, sans passé, et qui peut-être, n’a comme nom, qu’un chiffre.
Dans une des longues rues parallèles, uniformes et désertes, ils s’avancent et leurs pas crissent sur le mâchefer. Soudain, la femme, dit: c’est ici. Alors, ils pénètrent avec la civière, dans la petite demeure. Sur deux chaises, ils placent le cercueil, après quoi ils se 196 découvrent gauchement. Puis ils s’en vont en se hâtant, comme des gens qui ont encore de la besogne.
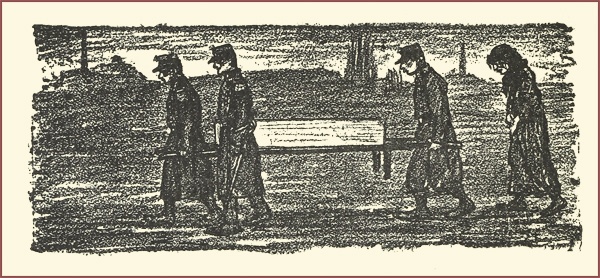
197

Un long temps, elle demeure assise, inerte, auprès du cercueil. Puis, très lasse, se lève et prend un à un, les effets posés sur une chaise, vêtements de rechange que les trois hommes devaient revêtir après s’être débarrassés de leurs loques de fond humides de sueur, maculées de houille et de boue. Elle replie tout cela lentement, soigneusement, et de gros sanglots l’étouffent.
Trois paires de sabots sont rangées près du poêle; elle les pousse sous le lit, aussi loin qu’elle le peut... Ensuite, elle prend la lettre qui se trouve sur la table. Longuement, des larmes plein les yeux, elle relit l’adresse, elle relit le nom de son fils aîné. Mais elle ne déchire point l’enveloppe qui tremble dans sa main et dans un tiroir, elle la glisse.
198
Maintenant, elle va faire à cette chambre une toilette mortuaire. Sur le carrelage, qu’elle veut laver, elle répand l’eau du baquet, dans lequel, ils eussent décrassé leurs torses et leurs faces noircies. Mais elle défaille, ses mains se crispent sur sa poitrine. Depuis deux jours, elle n’a pris aucune nourriture. Et la faim, celle dont la torture fait hurler les bêtes, la pousse à se saisir avidement d’un morceau de pain demeuré sur la table. Elle le dévore avec une voracité inconsciente. Après quoi, elle reprend sa tâche funèbre.
Le carrelage étant devenu net, elle le saupoudre de sable fin. Puis, elle change les rideaux de la fenêtre et ferme le contrevent. Elle accroche aussi le volet de la petite porte vitrée qu’elle laisse entr’ouverte. Alors, dans la demi obscurité, elle continue d’aller et venir, finissant de rendre décente et propre, la petite chambre qu’habite le mort.
Ici, c’est le devoir qui, malgré sa lassitude, la fait encore agir. Car elle n’aurait ni la force, ni le courage de pénétrer dans la pièce voisine, là où couchaient ses deux fils, dans cette chambre dont les lits encore ouverts, gardent l’empreinte de leurs corps.....
Dehors, des hommes passent, marchant au pas. Et des sanglots suivent la civière qui s’éloigne.
199
Seuls, abandonnés sans doute par leur mère qui est à la fosse, deux enfants s’avancent sur le seuil et, curieux, les yeux grands d’étonnement, ils regardent cette longue boîte de sapin, qui fait une tâche blanchâtre dans la pénombre.
Doucement, Elle leur dit:—«Allez jouer plus loin mes petiots». Et les pauvres petits êtres, ignorants des choses de la mort, s’en vont en riant, jouer sur la chaussée.
On heurte à la porte. Le médecin de la compagnie entre. Il est venu au coron pour avertir les veuves qu’il est nécessaire de laisser les cercueils ouverts, afin que les gaz qui se dégageront des cadavres, ne fassent éclater les planches de sapin. Et il ordonne à un ouvrier qui l’accompagne, de déclouer le couvercle de la bière. Pendant ce travail, lui-même ayant sorti de sa poche une fiole, asperge le sol avec un liquide nauséabond. Puis, en se retirant, il dit tout bas, d’une voix doucereuse—«Voyons, ma bonne femme, n’avez-vous donc ni un crucifix à mettre sur le linceul, ni un cierge à allumer auprès du mort? Ces Messieurs de la Compagnie désirent pourtant que tout se fasse de façon convenable. Un prêtre du reste, assistait à la remonte des corps.»
200
Ayant vidé le tiroir d’une commode, elle a retrouvé un vieux chapelet et l’a posé sur le suaire. Ensuite elle a allumé une bougie qu’elle a placée sur un siège, auprès du cercueil. Mais comme elle n’a plus prié depuis vingt ans, elle fait un simple signe de croix. Et maintenant que la chambre est en ordre, elle n’a plus qu’à penser douloureusement en face du mort.
Elle s’est assise dans un coin, les bras croisés, la tête penchée, et les chauds reflets de la bougie, vacillent sur son visage terreux.
Jusqu’à présent, elle a vécu en hallucinée, dans un cauchemar, dans une sorte d’irréel. Mais avec l’immobilité et le silence, elle rentre dans la froide réalité. Et elle ressent seulement à présent, l’impression d’un immense isolement.—Seule, toute seule; la maison est vide; les trois hommes sont morts!...
Des souvenirs lui passent par l’esprit, des petits faits, des détails isolés, l’intonation de leurs voix, même les colères du père; tout cela mêlé, confus.
Alors, elle se met à pleurer lentement.
Et puis, elle pense aussi à la paie qu’ils devaient toucher dans quelques jours, aux dettes, à la misère qui va venir.
Après cela reparaissent encore devant ses yeux, les 201 visages de ses fils, nettement, comme s’ils étaient près d’elle. Et voici qu’elle se reprend à espérer. Peut-être n’ont-ils pas été tués. Son pauvre homme, hélas, lui, il est là; elle l’a reconnu à des lambeaux d’étoffe, à ses souliers, dont l’un est rapiécé. Mais eux, peut-être les remontera-t-on vivants au jour. Elle voudrait retourner là-bas, à la fosse. Pourtant elle pense que ce serait mal d’abandonner le mort.
Alors, dans la nuit de cette chambre empestée par le liquide épandu sur le sol, elle s’endort, elle s’évanouit dans un sommeil pesant, sa respiration oppressée par la lourde atmosphère où déjà se traînent des relents affreux. Et sur le suaire, la bougie jette un rayonnement assoupi qui déplace mollement des ombres.....
Des heures lourdes ont passé, et la petite lueur chaude qui veillait, s’est éteinte après un dernier vacillement. Une sérénité lugubre plane sur le mort et la veuve endormie. Il n’y a que la vie des choses qui se perpétue, mystérieuse, dans le silence et l’obscurité de la chambre. Le bois neuf du cercueil a craqué; une feuille morte, poussée par le vent, a grincé sous la porte; dans la cheminée, de la suie s’est détachée et a fait, en tombant, un bruit grêle sur la tôle du foyer.
202
Mais tout à coup, voici que du dehors, parvient un roulement sourd et des trots de chevaux. Et cela s’arrête devant la petite maison. Un bruit de pas, de sabres traînant sur la chaussée; et la porte s’ouvre toute grande. Dans le carré de clarté, apparaissent des uniformes encadrant un personnage ganté et cravaté de noir, lequel entre et gravement se découvre.
Un officier de l’escorte ayant aperçu la veuve endormie, s’approche d’elle et lui frappant sur l’épaule:—Levez-vous; c’est Monsieur le Ministre.
Elle se dresse, ahurie, tenant dans la main un coin de son tablier.
Aussitôt, le personnage grave commence sur un ton solennel:—«Madame, au nom de la France, au nom du Gouvernement de la République, je viens saluer la dépouille de ce soldat du travail mort au champ d’honneur! Moi-même surmontant l’émotion qui m’étreint.....
Et longuement, s’exhale la douleur officielle.
Dans sa stupéfaction, la malheureuse ne comprend rien; elle n’entend qu’un ronron monotone d’où s’échappent parfois des mots plus sonores: héros obscur... victime des forces élémentaires...
Tous ceux qui entourent le ministre écoutent celui-ci avec un respectueux recueillement.
203
Soudain, il élève la voix et le bras étendu vers le suaire, le voici qui fait vibrer la dernière phrase de ce discours qu’il colporte dans chaque maison endeuillée, répétant dans chacune les mêmes gestes emphatiques, avec une même émotion. Après quoi, M. le Ministre semble, la tête inclinée sur l’épaule, s’abîmer dans une douloureuse contemplation. Mais en réalité, ce n’est là qu’une attitude congruente, car, il tend l’oreille à ce que lui murmure tout bas, la personne qui se trouve à son côté.
Le même officier qui réveilla la veuve, s’approche encore et lui souffle—«Remerciez M. le Ministre.» Mais celle-ci demeure stupide et muette, la face terreuse et le regard terne.
Alors le personnage officiel, ayant jugé suffisant son instant de méditation affectée devant le cercueil, s’incline du côté de la veuve, puis il sort, suivi de son escorte attentive, laquelle a répété militairement le salut adressé à cette femme qui ne paraît pas avoir conscience du grand hommage qui lui est rendu.
Après le départ du Ministre, deux messieurs s’insinuent dans la chambre: «Madame, permettez-nous de prendre une photographie pour notre journal.»
Et les deux messieurs, sans attendre une réponse, dressent sur ses trois pieds leur appareil. Ils changent 204 un peu la position du cercueil, repoussent la table, dérangent une chaise, jugent l’effet de la lumière. Ensuite, l’un d’eux dit: «Mettez-vous auprès du cercueil et tenez sur vos yeux un mouchoir.» Et l’autre ajoute: «Oui, madame, faites comme si vous pleuriez.» Elle, toujours docile, obéit.
—«Ne bougez plus.» Il y a un instant de pose, l’orbite de métal fixe durement la veuve et le cercueil, puis l’appareil fait entendre un bruit sec de déclic. C’est tout; les deux journalistes remercient et s’en vont satisfaits.
Traînant son pas harassé, elle rallume une bougie auprès du mort. Dans son intelligence de pauvre femme ignorante et simple, elle n’a ni compris le ridicule triste de la douleur officielle, ni l’odieux de la seconde visite qu’elle a reçue.
Et la veillée mortuaire reprend. C’est de nouveau le silence, l’arrêt de vie, que les morts propagent de leur néant, autour d’eux.
Le vent s’est remis à souffler et la pluie qui cingle les tuiles du toit leur fait rendre un bruit de chose fêlée.
Soudain, deux heures tintent à la petite église du coron. Les deux coups sonores de l’airain passent, emportés au loin par le vent.
205
Deux heures! Et la voici qui songe, se souvenant que c’est l’heure à laquelle les trois hommes revenaient de la fosse. Elle revoit la table mise, les quatre couverts préparés sur la toile cirée, le grand pot de grès plein jusqu’aux bords de bière qu’elle s’en fut quérir à l’estaminet. Elle les revoit entrant, souillés, mâchurés de houille, avec un masque de suie collé sur la face. Aussitôt ils faisaient leur toilette devant le cuvier, se décrassaient mutuellement le torse et les épaules. Puis ils s’attablaient, lourdement, las, les doigts encore tremblants d’avoir serré le manche de la rivelaine et de s’être agrippés à des blocs de houille pour les basculer. Ils avalaient la soupe goulûment, appuyés à la table, à cause de leurs reins rompus. Et sans causer, ils regardaient devant eux, les yeux fiévreux, encore cernés par la poussière de houille. De temps à autre, l’un d’eux se détournait et, avec une sorte de râle, crachait sur le carrelage un jet de salive noire.
A la fin du repas, dans le bien-être de ce travail chaud que font les aliments dans l’estomac, ils commençaient à parler un peu. Ils causaient de choses qui furent toujours mystérieuses pour elle: du fond, de l’abattage, d’un glissement de la veine...
Quand ils avaient allumé leurs pipes, son aîné 206 allait au carin soigner ses coqs et le père s’endormait au coin du poêle, tandis que son second fils lisait la feuille socialiste.
Quelquefois aussi, il arrivait que le repas n’était point encore prêt quand ils rentraient de la fosse, et cela parce qu’elle s’était attardée à bavarder chez des voisines. Alors, le père avait une grande colère, et ces jours-là il buvait presqu’à lui seul toute la bière du grand pot de grès.
Et voici, en cet instant où ils lui apparaissent encore si vivants, que de nouveau la sensation de solitude infinie la pénètre, lui donnant un vestige où disparaît tout espoir de revoir ses fils: Seule! la maison est vide!... les trois hommes sont morts!...
Tout à coup elle se lève, s’approche du cercueil. Elle veut revoir le cadavre de son mari. Elle écarte le linceul. Alors, devant cette chose affreuse, devant cette forme noire, tordue, fantastique comme une ombre projetée, elle joint les mains et avec un air de pitié et de désolation, secoue doucement la tête. Et des larmes silencieuses, jaillies à la cornée de ses yeux, glissent lentement sur ses joues creuses.
Un dernier regard; elle va replacer le suaire. Mais voici qu’elle aperçoit une chose qui luit à la main 207 crispée au fond du cercueil. Sans répulsion, elle saisit le poignet, soulève le membre raidi et se penche. Ce qui brille est un anneau d’argent, une alliance enfoncée dans la chair grésillée.
Alors, elle pousse un cri d’horreur, et lâchant la main du mort, elle reste droite, la face rigide et blême.
Le vent hulule sous la porte, une larme de cire tombe de la bougie. Dans le silence lugubre, le cercueil fait de nouveau entendre un long et sinistre craquement.
Tout à coup, elle s’affaissa sur les genoux, ses mains lui couvrant le visage; et voici, qu’à voix basse, elle murmure: «Oh! mon pauvre homme! mon pauvre homme! ce n’est donc pas toi qui est là . . . . .
Sans heurter à la porte, un employé de la Compagnie, celui-là même qui présidait à la reconnaissance des cadavres, entre et dit, en déposant un papier sur la table: «Tenez, voilà l’acte de décès.»
Aussitôt elle se précipite et s’accroche à lui:—Oh! monsieur, venez voir, venez voir... Ce n’est pas mon mari que j’ai ramené!
—Comment? Ce n’est pas votre mari? Mais vous avez reconnu le cadavre devant témoins. J’ai fait dresser l’acte de décès. Toutes les formalités sont remplies.
208
—Non, monsieur, bien sûr que ce n’est pas mon mari, vu que cet homme-là il a une alliance et que mon mari n’en avait point.
L’employé, l’air très contrarié, réfléchit un instant. Puis brusquement il fait un grand geste:
—Ah ben, tant pis—gardez-le quand même!
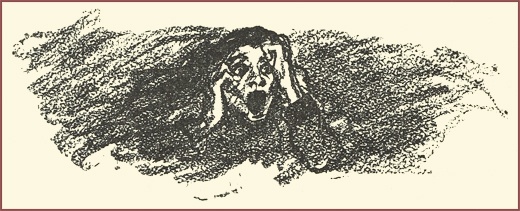
TABLE DES MATIÈRES |
|
| Préface | 5 |
| La Paye | 23 |
| Multitude, Solitude | 75 |
| Train-Tramway | 99 |
| Dimanche | 107 |
| Baptême | 137 |
| La Jaune | 149 |
| Veuve | 175 |
Achevé d’imprimer
le 23 Mars 1907
chez RÉPESSE-CRÉPEL et FILS
à Arras
Au lecteur
Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale. Toutefois, les erreurs typographiques évidentes ont été corrigées. La ponctuation a fait l’objet de quelques corrections.