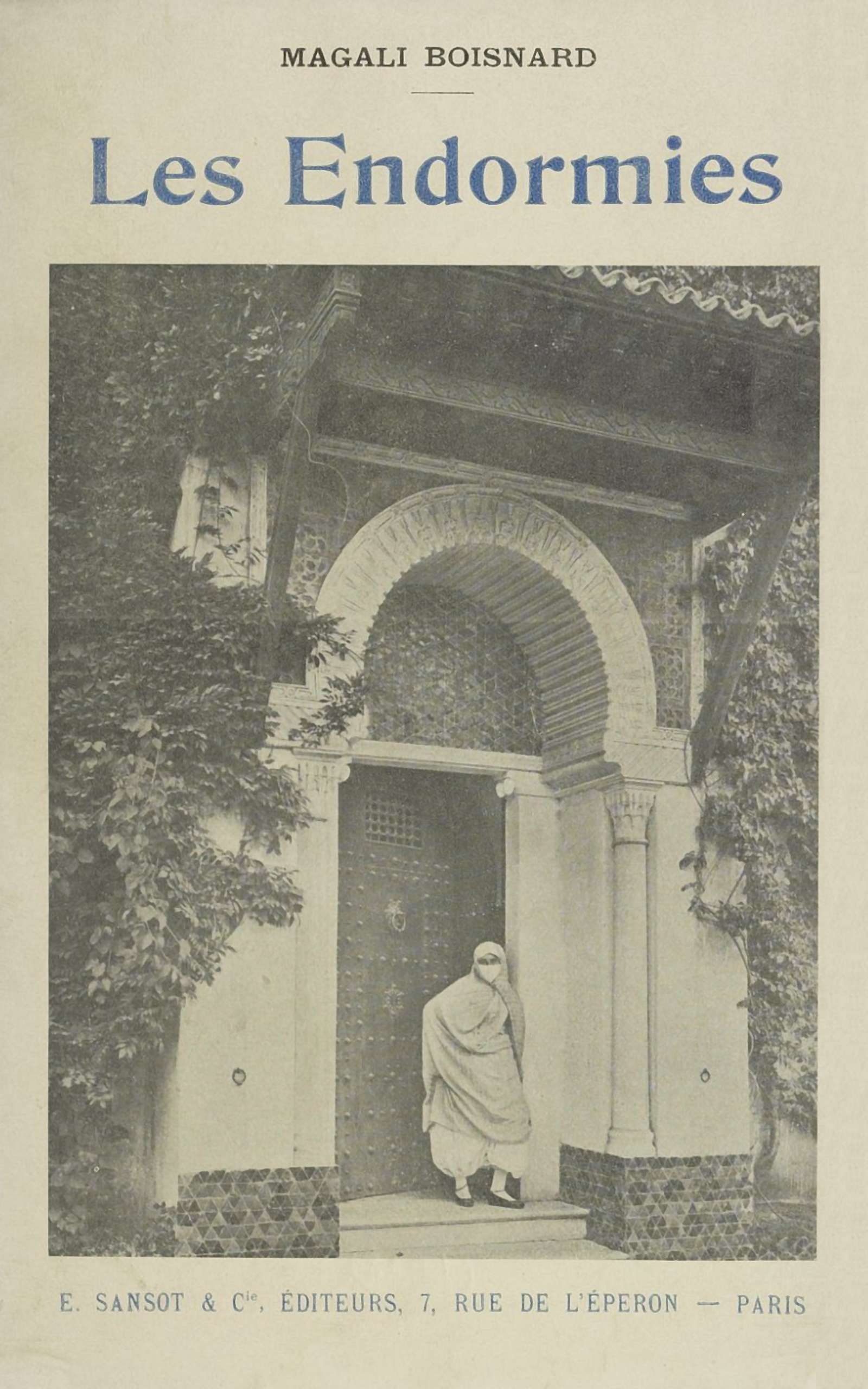
The Project Gutenberg eBook of Les endormies, by Magali Boisnard
Title: Les endormies
Author: Magali Boisnard
Release Date: May 21, 2023 [eBook #70825]
Language: French
Produced by: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
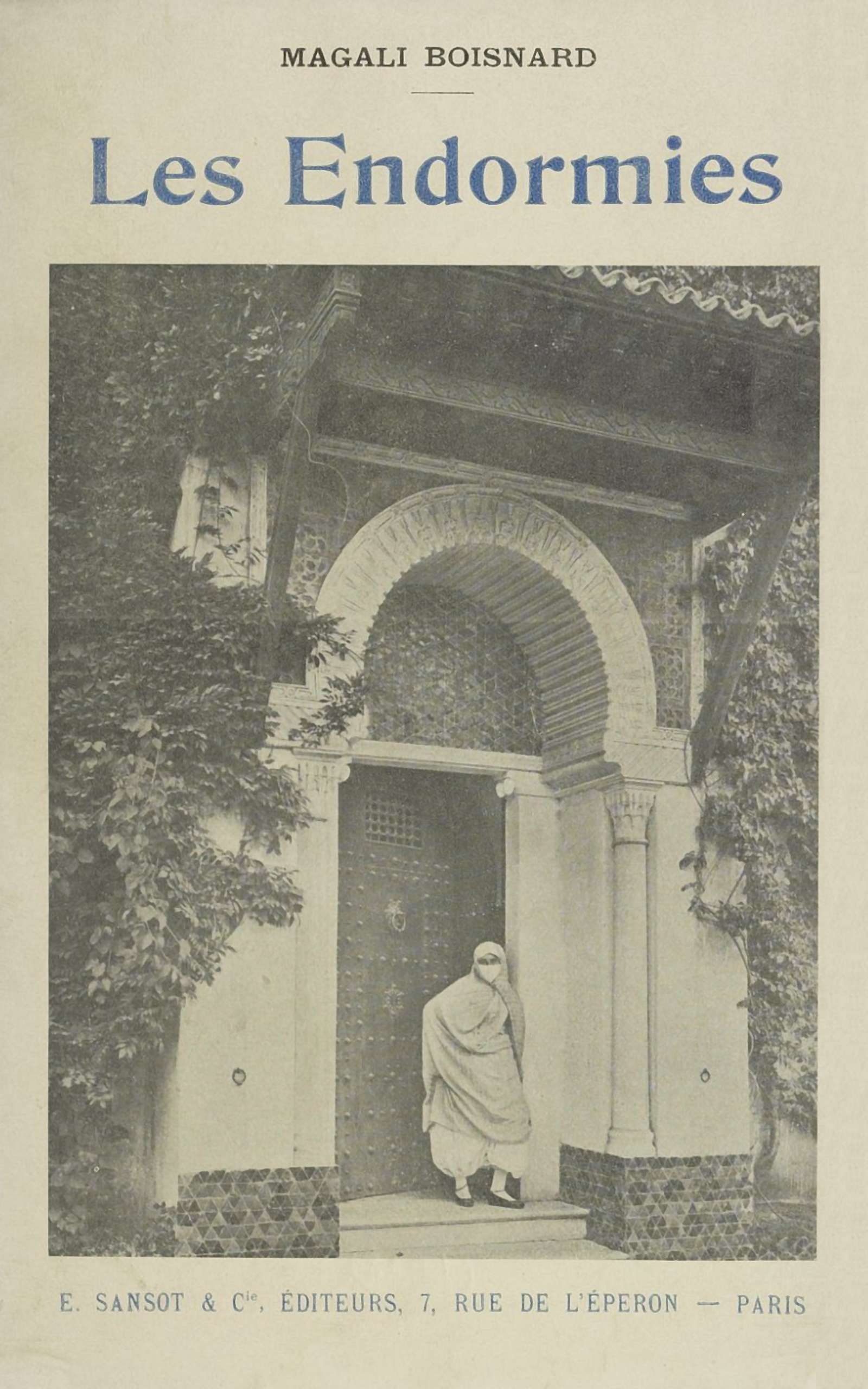
MAGALI BOISNARD
Les Endormies
E. SANSOT & Cie, ÉDITEURS, 7, RUE DE L’ÉPERON — PARIS
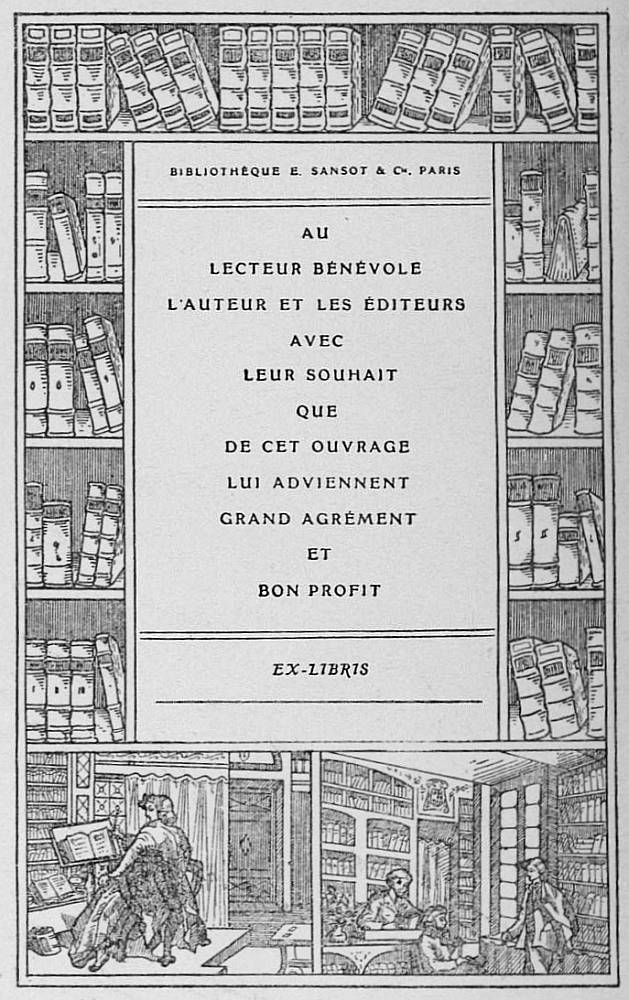
BIBLIOTHÈQUE E. SANSOT & Cie, PARIS
AU
LECTEUR BÉNÉVOLE
L’AUTEUR ET LES ÉDITEURS
AVEC
LEUR SOUHAIT
QUE
DE CET OUVRAGE
LUI ADVIENNENT
GRAND AGRÉMENT
ET
BON PROFIT
EX-LIBRIS
Les Endormies
DU MÊME AUTEUR
La Vandale, roman, E. Sansot et Cie, éditeurs.
Rimes du Bled, poésies, éditions de la Revue Nord-Africaine, Alger.
Évangile, Georges Bridel, éditeur, Lausanne.
Djellali, nouvelle, Akhbar, Alger.
Kaïrouan et les Ruines d’Hadrumète, étude, Société de Géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord.
L’Aurès Barbare, études, Société de Géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord.
Biskra cosmopolite et Touggourt sauvage, étude, Société de Géographie commerciale de Paris, Section tunisienne.
MAGALI BOISNARD
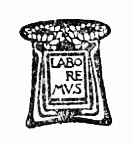
PARIS
BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE D’ÉDITION
E. SANSOT & Cie
7, RUE DE L’ÉPERON, 7
MCMIX
A L’AMI,
Au peintre qui possède la vérité des lumières, des sommets, des palmes vivantes, des saharas morts, des horizons d’Afrique et d’Islam,
A Maxime NOIRÉ
la sincérité de ce livre.
Je vous dirai ceci :
J’ai vu l’âme et le visage des Endormies sous les voiles musulmans. Je suis leur amie.
Les Endormies sont aussi des Enchantées dans l’esprit immobile et ancien, ardent et rétractile, séduisant, instinctif, logique et décevant de l’Islam féminin.
Je connais le foyer où cet Islam existe, l’intégrité de son ambiance retardataire, troublée à peine par un souffle d’Occident, jalousement défendue par les gardiennes de la tradition.
Enfant, j’ai vécu dans celui de la montagne. Ma prédilection, mon indépendance et le hasard de ma vie m’ont fait pénétrer tour à tour la tente et l’intimité de la maison arabe.
Ce livre est une suite de feuillets écrits jour après jour, dans la vérité des choses et des êtres qui sont vivants sous le masque du pseudonyme. Ceux dont je conte les fins et les agonies sont des morts d’hier.
Mon seul rôle fut celui du notateur fidèle qui déroule un fil léger pour relier les épisodes.
Nord-Africaine d’âme musulmane et de cœur gaulois, aux jardins cachés, aux vergers sauvages ou dans le steppe saharien, je n’ai rien inventé. Le destin m’a permis d’y cueillir les olives et les figues douces, les sanguines et les baies épineuses des cactus, les roses violentes sous les dattiers.
Les voici, à vous offertes, simplement, dans une corbeille d’alfa.
M. B.
O mes Frères, je vous investis d’une nouvelle noblesse : vous serez des semeurs de l’avenir.
Frédéric Nietzsche.
C’est un malheur, une perte irréparable qu’un enfant grandisse en dehors de sa vérité propre et qu’il échange son chant naturel contre une cantilène apprise.
Maurice Barrès.
A ses yeux, l’Islam n’était pas seulement une religion, mais tout un système d’organisation sociale, plus facile à concilier avec la civilisation qu’à supprimer ou à remplacer.
Charles Mismer.
« Enterrez la tradition avec la cendre des aïeux. Oubliez l’horizon ancestral et saluez celui que je vous montre. »
Dans l’orientale maison dont la féerie domine un coin d’Alger, une femme aux cheveux gris, au jeune sourire murmure :
— La douceur des blanches arabesques, la somme des patientes et tenaces songeries, tout le rêve enroulé au caprice des découpures du stuc, qui les dira ? Et qui dira l’art étrange des faïences mauresques et la séduction des choses dans l’atmosphère bleue !
Elle caresse une délicate portière aux arachnéennes broderies et transparente en sa finesse, plus transparente à cause de tant de jours passés qui filtrèrent à travers la trame.
Elle dit encore :
— Aux méandres du dessin, je voudrais suivre le fil des intrigues anciennes. Petites mains peintes qui brodèrent longtemps dans le clair-obscur du harem, mains de princesses, mains mortes, je me suis penchée rêveusement sur votre œuvre silencieuse et belle. Tout l’enchantement du poète des roses et le charme de l’habile conteuse sont là ; je relis…
— Combien vous aimez ces choses ! s’écrie Noura Le Gall. Deviendrai-je aussi orientale que vous, moi qui, dans ma famille, ai du sang de prince bédouin ?
— Il n’y a pas deux manières d’être en pays d’Islam, Noura ; on est possédé par l’amour ou par la haine. Des expressions vulgaires déterminent les deux sentiments ; on est « arabophobe » ou « arabophile ». Ceux qui se déclarent « arabojustes » sont probablement ceux qui se définissent mal ou n’osent pas se prononcer.
— Pour moi, amie, j’arrive avec un cœur prêt à l’affection dévouée, mais rebelle à l’engoûment ou à l’inimitié irraisonnée. Je viens accomplir une œuvre de fraternité, de relèvement près de nos sœurs musulmanes. C’était le souhait de mon oncle et j’avais déjà résolu la réalisation avant la mort de celui qui fut mon éducateur.
Elle parle de ce colonel Le Gall que l’Amie a connu au temps où, jeune officier, il ramenait une petite épouse du désert. Il éleva Noura, orpheline, lui imprimant ses idées et poussant le désir d’action de cette vigoureuse jeunesse vers un beau but : le parachèvement de notre conquête nord-africaine par l’assimilation du peuple vaincu. Fort de la preuve qu’était sa femme merveilleusement civilisée, à l’exemple d’un Turc clairvoyant, il affirmait : « — L’Islam a été pendant des siècles, dans son milieu, un instrument de progrès. Souvenons-nous des foyers lumineux que furent Bagdad, le Caire et Cordoue. Aujourd’hui, c’est une horloge arrêtée qu’il s’agit de remettre à l’heure. Nous commencerons par la petite montre de femme, achevait le colonel. Certainement et pour des raisons multiples, les autres se régleront sur elle. »
Il était mort laissant à Noura cette mission et sa foi dans les perfectionnements nécessaires, successifs, des êtres et des races.
Noura libre, maîtresse d’elle-même et de quelque fortune était en Algérie pour accomplir ce vœu.
Sa tante Le Gall l’avait nommée Noura, — lumière. —
— C’est parce que je devais éclairer celles qui sont dans l’ombre. Il y a de la prédestination dans mon cas, disait la jeune fille.
Son impatience était grande de se trouver en contact avec ce monde islamique dont elle n’avait pu étudier qu’à distance la langue, les mœurs, le passé et la vie présente. Pourtant, déjà elle concluait :
— L’Islam stationnaire, — celui du Maroc par exemple, est resté moyen-âgeux ; c’est l’Islam obstiné. Mais il y a un Islam déclinant qui retourne à la primordiale obscurité : c’est celui que nous avons soumis.
Elle répète cela et quelqu’un survient, un familier de la maison qui répond :
— Vous dites bien, ô Noura, et cet Islam je veux aussi le relever ; car c’est un malade qui peut guérir.
— Comment ? interrogea l’Amie.
— En ouvrant des écoles pour une instruction islamique à laquelle s’adapteront nos sciences modernes. Le mouvement nationaliste en Egypte rallume le flambeau du Caire. Nous approuvons sa flamme. Nous arracherons le malade à sa léthargie ; il y est resté trop longtemps et l’erreur est venue, — je répète un mot de Mismer, — l’erreur est venue de ce que l’immobilité apparente de l’Islamisme a été prise pour de l’impuissance. Mes écoles seront aussi féminines que masculines. On y prouvera entre autres choses l’absurdité de croire que Mahomet séquestra les femmes. Il leur devait beaucoup : il témoigna sa reconnaissance en élargissant et en protégeant leur sort. Il fut un civilisateur pour tout le peuple et un sauveur pour ces générations de petites filles que les anté-islamiques enterraient vivantes. Mes professeurs auront pour mission de tuer les préjugés, de provoquer des émules de Safïa, la poétesse, qui chantait ses strophes à Cordoue, de Lobna, docte en science, de Fatma, la bibliophile, de Mériem, maîtresse d’érudition, d’Euldjïa et d’Oum-Hani, les combattantes. Ils enseigneront la vérité du Koran. Pour qu’une société subsiste, il faut que les femmes soient de moitié dans l’action générale. Nous rappellerons aux Musulmanes contemporaines les actes de leurs aïeules lettrées, diplomates, savantes ou guerrières. Nous susciterons en elles l’ambition d’un retour des temps célèbres !
— Ah ! fait Noura, vous êtes plus conservateur qu’évolutionniste. Vous voulez retrouver et éterniser un Moyen-Age à peine rajeuni par quelques nouvelles formules scientifiques qui ne lui ôteront rien du somptueux de ses draps d’or, de l’éclat des armes damasquinées et du son des mandores. Vous êtes une sorte de Mahdi, le moul-es-saa[1], celui qui doit venir pour rendre aux Musulmans leurs anciennes gloires et prendre une revanche sur les Infidèles. Ouvrez votre école ; la mienne sera différente. Lentement, graduellement, elle prétend faire évoluer l’Islam, — féminin surtout, — vers notre conception de la vie. Vous êtes pour la renaissance d’une vieille civilisation ; je suis pour l’acceptation d’une civilisation neuve.
[1] Maître de l’heure.
— C’est vouloir beaucoup, trop peut-être. Cependant, j’aime votre foi en la bonté de votre effort.
— Noura est une volonté qui s’aggrave d’entêtement, dit l’Amie. C’est une forte. Il est possible qu’elle atteigne son but.
La jeune fille souriait, le front haut, illuminé de certitude.
— Je veux dès aujourd’hui entrevoir celles que je dois initier. Mon amie, vous avez promis d’être mon premier guide. Allons.
Elle coiffait ses lourds cheveux d’un chapeau de style sévère et simple.
Et l’Amie proposait au Mahdi :
— Voulez-vous nous accompagner jusqu’au seuil des portes défendues ?
Ils traversaient l’atrium mauresque au velarium blanc. Dans une salle claire, des fillettes indigènes s’appliquaient à perpétuer la tradition des brodeuses de jadis. Elles saluaient leur maîtresse, la « Mâlema », qui leur apprenait l’art de retrouver le jeu des broderies sur l’étamine et la soie. Les doigts s’escrimaient au dessin fantasque et régulier, des doigts courts et fins, aux ongles bombés.
La Mâlema soupira :
— En vérité, Noura, je ne souhaite pas que ces petites créatures, jolies comme des statuettes païennes, deviennent jamais des ressemblances de nos gravures de mode illustrée.
— Elles pourront devenir des ressemblances d’une autre forme de la femme moderne.
— La femme moderne ! Un essai de mélanges et de combinaisons.
— Le résultat est proche de la perfection. C’est une force et une beauté dont la force peut être la beauté, mais dont la seule beauté n’est pas la force.
Ils avaient franchi la porte de vieux bois, clouté de bronze et descendaient des degrés ensoleillés sur quoi penchait l’ombre d’un laurier-rose. La jeune fille reprit :
— Le temps est loin où, perdues dans les plis des robes maternelles, nous n’avions d’autre intérêt dans la vie que l’attente passive ou doucement inquiète du nécessaire mari. Aujourd’hui, nous sommes libres de penser et d’agir selon notre individualité respective. Je ne vous parle pas de celles qui s’acharnent à de ridicules revendications ou s’insurgent contre des choses qui sont la raison d’exister et les conditions d’harmonie de l’Univers. Telle que je l’approuve, la vraie femme ne doit pas, sous un vain prétexte d’indépendance, se détourner de son devoir d’épouse et de mère. Mais, au lieu d’attendre passivement l’heure de ce devoir, elle doit mettre ses années libres au service d’une idée, agir, lutter, le visage tourné vers le lendemain. Et c’est d’elle que pourront naître des hommes et des femmes, non des pantins et des poupées.
L’Amie souriait.
— Voilà bien l’emballement et la volonté de la jeunesse qui croit à la perfection possible !
Mais Noura se tournait vers leur compagnon et elle avait une joie à cause du brun regard du jeune homme, répondant à son interrogation muette. Cela fit qu’elle entendit à peine les paroles mélancoliques de la Mâlema.
— Toute réalisation est une diminution du rêve. Tout accomplissement est la mort du plus beau désir… Moi aussi j’ai voulu une œuvre ; elle n’est pas selon mon vouloir. Je ne peux donner à mes élèves qu’un préservatif contre une misère éventuelle, un secours contre l’oisiveté périlleuse de plus tard. Enfant, puissiez-vous accomplir davantage.
Noura prononça ardemment :
— Je veux me donner toute à cette tâche de provoquer un éveil au foyer arabe, par l’enfant, la jeune fille, la femme. Vieil Islam, tes petites filles feront acte d’annonciatrices en leur exemple efficace, tes petites filles que j’instruirai dans la ferveur de mes élans et de mes enthousiasmes.
Et ce fut la voix persuasive de celui qui marchait près d’elle :
— Vos élans, vos enthousiasmes, c’est l’esprit intérieur, l’intelligence de la vie qui vous prend sur sa grande aile et qui vous porte sur la montagne pour vous montrer les royaumes de la terre. Et vous êtes riche et enivrée de ce spectacle, élue par votre don, capable de goûter le sel de toutes les joies et de toutes les larmes.

Les hauts quartiers de la vieille cité maure, espagnole et turque.
Des ruelles imprévues, déclives ou remontantes, inimaginées en la cité neuve et franque. Ruelles équivoques, aux murs bleus, souillés, aux pavés inégaux qui font penser au lit d’un torrent desséché, aux portes basses, closes ou invitantes, fleuries de prostituées andalouses ou musulmanes.
Au creux des profondes impasses, les murs sont lépreux et nus, troués d’un soupirail louche, sinistre pour les yeux étrangers. Des corniches mi-ruinées, des saillies de pierre et de bois pourri nourrissent la végétation rachitique d’une herbe triste.
Des pans de ciel apparaissent, bizarres par l’inattendu, après les ténèbres moites ou le demi-jour des voûtes. Ciel léger entre l’attouchement irrégulier des balcons murés et penchés, comme prêts à choir avec le fantaisiste soutien de leurs « quouâthan », les petites poutres rondes. Ils ajoutent à toute l’allure titubante des anciens logis.
Quand un peu de soleil tâtonne jusqu’aux pavés visqueux, les choses s’effarent de cette intrusion dans l’humide et nauséabonde pénombre.
Mais toute une originale et merveilleuse poésie vit et chante au cœur des vieux quartiers. Elle est dans les cafés maures aux habitués bavards ou pensifs, dans la boutique des enlumineurs, peintres de coffres et d’étagères, de maïdas et de derboukas[2]. Ils voisinent avec les bruyants marteleurs de cuir fauve et rouge ; avec ces Syriens rusés qui incrustent les bois précieux de nacre blanche ou blonde : avec ceux qui sont habiles à manier la lime en forme d’archet, tandis qu’un engrenage primitif met en mouvement de petites roues vertigineuses, pour tourner et polir la corne noire. C’est la corne dure qui devient les bagues et les bracelets de celles qui n’ont point d’or ni d’argent.
[2] La maïda est une petite table ronde et basse, la derbouka un tambourin en forme d’amphore.
Dans le fond sombre d’une cellule, la face ivoirine d’un taleb[3] émerge, s’absorbe sur des feuillets épais, manuscrits à l’ancre brune, alternée d’encre verte, jaune et rouge ; les commentaires du Koran tracés par le fin calame de roseau d’un lettré de la Mekke.
[3] Lettré.
Et ce sont encore les échoppes où les Marocains et les Soudanais découpent et brodent l’odorant « filali »[4], pour les harnais des étalons de guerre et de fantasia, les bottes rouges des chefs, les coussins où se plaît le repos des femmes.
[4] Cuir rouge et souple.
Des ânes montent et descendent chargés de sacs de céréales ou de couffins débordants de légumes. Des porteurs d’eau, la cruche de cuivre à l’épaule, font retentir l’anneau de fer des portes. Le froc suintant d’un marchand d’huile, effleure les passants. Des Musulmanes circulent pour des achats et des visites, avec un visage uniforme, le visage du voile d’épaisse mousseline blanche qu’éclaire le regard anonyme, provocateur ou langoureux des yeux ombrés. Le cliquetis des anneaux d’argent se mêle au craquement de chaussures neuves dont le vernis luit.
Et des hommes, assis sur les larges bancs des cafés, ou errant en quête d’aventures, invectivent des enfants qui se bousculent avec des chiens rageurs, des chats en fuite…
Noura et son amie s’arrêtèrent devant une porte basse. Leur compagnon les quittait.
Sur les deux femmes, une cordelette tirée par un poids de pierre referma la porte entr’ouverte.
Des escaliers sinuaient dans l’ombre. Sous le rectangle d’une meurtrière, dans un trou lugubre comme un in-pace, on distinguait une créature accroupie, roulant dans un plat noir une farine grise.
— Une abandonnée, expliqua la Mâlema. Sa cellule est trop étroite pour qu’elle puisse complètement s’y étendre.
Les escaliers gravis, elles furent dans une chambre lumineuse. Deux veuves l’habitaient. Anciennes élèves de l’Amie, elles vivaient en brodant des carrés d’étamine, sans valeur grande et qui plaisaient aux touristes Anglais et Teutons.
Elles accueillirent Noura d’une amabilité à fleur de lèvre, peu communicative, à peine curieuse. Cependant elles aimèrent l’entendre parler leur langue et la questionnèrent sur son pays, légèrement, sans envie de le mieux connaître, satisfaites de leur horizon blanc et bleu sur la ville et la mer, à travers la fenêtre taillée en ogive.
Elles trouvaient Noura très belle à cause de ses yeux gris sous les cheveux sombres.
— N’est-elle pas mariée ? disaient-elles. Et pourquoi ? Les jours après les jours prennent doucement sa beauté. Elle les laisse voler des joies à celui qu’elle aimera.
Noura devait entendre souvent exprimer cette pensée ; car, en Islam d’Afrique il n’est qu’un devoir féminin, l’amour, et celle qui le néglige ou s’en détourne est coupable ou folle.
Les femmes s’entretenaient avec la Mâlema ; mais on sentait dans leur causerie une sorte de retenue qui provenait de la présence de Noura. Leurs paroles étaient lentes et douces d’affectueuses métaphores.
— Elles vous aiment, remarquait la jeune fille.
— Autant qu’elles peuvent aimer et il y a longtemps qu’elles me considèrent comme étant presque des leurs.
— Vous avez fait beaucoup pour elles.
— Ce que j’ai pu.
— Oh ! modeste ! Nous savons quelle philanthrope double l’artiste que vous êtes. Votre récompense, c’est de voir votre zèle et votre mérite compris désormais. Vous avez et vous aurez des émules. Les temps sont propices pour toutes les bonnes initiatives humanitaires. Les préjugés de races disparaissent. C’est là le règne de la raison éclairée et le gouvernement algérien lui-même veut que le barbare puisse s’élever jusqu’au civilisé et le vaincu fraterniser avec le vainqueur.
— C’est la meilleure récompense, Noura, cet acheminement vers l’abolition des inimitiés, vers l’amour réciproque des peuples, cette possibilité pour tous de prendre part au banquet d’une vie plus saine et plus large. Une générosité d’âme se généralise dans la multitude et tend à vouloir atténuer toutes les misères, les injustices ou les erreurs commises par la destinée sur un trop grand nombre d’êtres. Le simple geste d’instruire les mains des petites brodeuses, des tisseuses de tapis, des petits peintres de céramiques, ce simple geste suffit pour prouver à la foule musulmane qu’elle est notre sœur, que nous l’aimons, que nous voulons son bien. Et le salaire, si modique qu’il soit, suffit pour éviter bien des douleurs.
— Après l’éducation des doigts viendra celle de l’esprit, dit Noura. Nos Algériens suivront l’exemple des Tunisiens. Leur mentalité s’avivera. Au lieu de silhouettes contemplatives, nous verrons en eux des créatures agissantes. Réjouissons-nous pour l’avenir.
Elles prirent congé des deux femmes indifférentes à l’enthousiasme de la jeune fille.
— Restez avec la paix.
L’Amie conduisit Noura dans d’autres logis. L’ombre de ces retraites embaumées de benjoin, bruissantes de bijoux et de murmures arabes était envahie par de laids et discordants emprunts faits au luxe hétéroclite de notre civilisation ; des armoires à glace, des lits anglais, des glaces dorées, des consoles Empire et tout un ameublement, style Louis XV, incrusté de nacre syrienne.
— Les premiers pas vers l’assimilation, soulignait l’Amie avec une ironie triste.
Elles pénétrèrent dans la demeure d’une noble famille où régnait le culte des ancêtres puissants autrefois, et celui de l’émir des émirs, Abd-el-Kader. Le chef de la maison était malade, gravement, et, en signe de chagrin les meubles pompeux étaient voilés d’étoffes blanches. Les sympathies musulmanes s’affirmaient par d’innombrables visites. Dans la salle des hôtes féminins, plusieurs femmes avaient déjà pris place sur d’étroits matelas et des coussins.
Dès l’entrée, Noura vit une superbe figure. C’était une femme vieille, hautaine et coquette dans le large étalement du pantalon turc. Sous un foulard de soie turquoise, ses cheveux teints de henna flambaient. On sentait qu’elle n’avait pas cessé d’être belle et admirée. Ses longs yeux verdâtres exprimaient une volupté fine, inachevée.
Seule, parmi le groupe, elle dédaigna les deux visiteuses d’une autre race. Son mépris ne se traduisait ni par mots ni par gestes, mais son regard reposait obstinément sur les colonnes de marbre noir de la cour. Il évitait les étrangères comme on évite une chose désagréable qu’il faut oublier puisqu’on ne peut la détruire.
Noura, intuitive perçut cette hostilité.
La Mâlema présentait la jeune fille.
— C’est une nièce de Fatime, fille de Bou-Halim, prince et agha, au delà des montagnes du Djebel-Amour. Fatime est noble, de lignée illustre et religieuse. Elle a été mariée avec un colonel français. Voici Noura Le Gall, mon amie.
L’accueil se fit chaleureux, d’égales à égale. Mais la vieille beauté ne changea pas d’attitude parce que la tante de Noura avait commis un péché, renié les devoirs de son rang et de sa foi en épousant un infidèle malgré la défense que le Koran fait aux filles d’Allah.
Une jeune femme s’assit près de Noura. Et ce furent des questions. Sa tante avait-elle été heureuse ? Etait-elle restée musulmane ? Préférait-elle la France à son pays ? Et combien de cavaliers avait l’agha Bou-Halim ? Les réponses alternaient. Fatime Le Gall avait été heureuse dans l’amour et la paix sous le toit de son mari. Sa religion reconnaissait toujours Allah et elle parlait du Djebel-Amour, des champs d’alfa, de l’horizon de sa jeunesse sans regret et sans désir. Le goum de Bou-Halim était nombreux. Sa fille se souvenait des fantasias des cavaliers, mais leur préférait le galop du cheval de son époux.
La jeune femme dit naïvement :
— Si ta tante vient une fois, tu la conduiras ici pour que nous la voyions.
Elle était curieuse de cette princesse du Sud apprivoisée à l’exil.
Une des visiteuses fit cette supposition :
— Elle doit ressembler à la femme du commandant que j’ai connue. Elle voulait si bien faire croire à son mari qu’elle était devenue française qu’elle ne daignait plus regarder les Musulmans.
Du café circula dans de fines tasses pointillées d’or ; puis, une confiture de pétales de fleurs d’oranger.
Des saluts répétés accueillirent de nouvelles venues. Noura et la Mâlema se retirèrent et se retrouvèrent dans le caprice des ruelles.
La jeune fille résumait ses impressions premières.
Elle souffrait un peu d’avoir, à la faveur de ce simple effleurement d’un monde à conquérir, compris le silencieux dédain, l’amabilité superficielle, comme une forme polie de l’indifférence ou d’un intime et irréductible éloignement.
— Ces femmes sont intimidantes, dit-elle. Elles ne se livrent pas. Elles semblent spontanées et restent bardées de dissimulation.
— C’est assez exact. Elles n’ont le plus souvent qu’une apparence de confiance affable et des retraites brusques de chats indépendants qu’on caresserait à rebrousse-poils.
— Elles comprennent mal l’expression de notre sympathie. Même si notre geste leur plaît, elles se défendent, dirait-on, de l’accepter entièrement. Pour les émouvoir et les prendre, il faudra…
— Beaucoup de tact, de souplesse et de fermeté. Vous saurez agir ainsi, car vous avez un sens très net et très aigu des caractères, un pouvoir d’impressions promptes et subtiles. Le danger sera si ces qualités sont dominées en vous par l’enthousiasme trop grand de l’œuvre entreprise. Il est imprudent de ne considérer que le but ; on ne voit ni n’évite les accidents du chemin.
Devant l’antre d’un forgeron Kabyle, un chacal édenté et nostalgique risqua un glapissement qui grelottait, peureux, une plainte vers le maquis natal où mouraient les bœufs et les chèvres, où l’hyène hoquetait la nuit.
Noura posa ses doigts sur la rude fourrure. Le chacal frissonna, méfiant, et se réfugia dans l’obscurité.
— Voilà ! fit la jeune fille répondant à sa pensée. Mais, avec le temps, on apprivoiserait le chacal…

— A quelle croisade dévouez-vous votre jeunesse et qu’allez-vous prêcher ? demande Claude Hervis, le sculpteur vagabond, plus épris de nomadisme que de labeur.
— L’Émancipation de la Musulmane, répond Noura.
— Pourquoi ? Que lui apportez-vous de préférable à ce qu’elle possède de par l’héritage et la leçon de ses grand-mères ?
— La liberté de l’action, l’élargissement et la clarté de la pensée, la faculté de transformer l’existence végétative en vie active.
— L’objet de votre sollicitude voudra-t-il prendre le chemin indiqué ?
— J’y tâcherai.
— Votre but en somme est d’inoculer le poison du féminisme dans le sang arabe.
Noura relève son front volontaire qui s’appuyait aux faïences mauresques du salon de l’Amie.
Elle riposte :
— Je ne donnerai pas un poison, mais l’élixir d’une vie meilleure.
— Comment savez-vous qu’elle sera meilleure ? Elle ne peut l’être qu’en produisant plus de bonheur et le bonheur est la plus individuelle des questions.
— Le devoir social, c’est la recherche et l’application d’un bonheur commun. Et, malgré ses ennuis, puisque nous parlons de féminisme, l’émancipation de la femme obtient un succès en chacune de ses manifestations.
— Succès de curiosité, comme pour une chose anormale.
Le Mahdi, qui fume des cigarettes sur un divan, intervient.
— Succès de sympathie aussi, dit-il, parce que ces manifestations sont charmantes de juvénile audace, d’une hardiesse d’enfant gâtée, sûre de sa grâce et de son esprit. Et si la sympathie n’exclut pas la curiosité, c’est que tout le féminisme n’est pas encore passé dans les mœurs et qu’il n’a pas fini d’étonner les partisans de l’absolue suprématie masculine.
— Bien, fait Claude, rassurons-nous ; du moment où tout le féminisme sera accompli, imposé, connu, il n’y aura plus ni curiosité ni sympathie et le féminisme en mourra.
Noura souriait. Le sculpteur lui tend une gravure.
— Voyez cet Arabe tel un grand oiseau au repos sur ce rocher.
— Un oiseau ? Sa pose rappelle celle du Penseur.
— Oui, l’allégorie parfaite que fit Rodin de notre humanité convulsivement active, qui s’immobilise tout à coup et songe enfin devant ce que toute sa science, tout son effort, ne purent lui révéler : le lendemain de la mort.
— Elle a du moins trouvé un des secrets du bonheur dans la vie même, toute la vie abondante, énergique, puissamment vécue.
— Question de tempérament. Les satisfactions du contemplatif sont aussi du bonheur. Rapprochez l’œuvre statuaire, cette figure crispée par la tension cérébrale après le labeur des muscles, rapprochez-la du profil de mon Bédouin, tous nerfs détendus, lui, dans l’absolu repos des membres et de la pensée. Il a, celui-ci, la face adoratrice, béate de religion et de rêve immuables. Il est libre de responsabilités cruelles, abolies par le Mektoub.
— Je préfère celui-ci de Rodin.
— Il doit avoir raison, socialement, raille Claude. Mais avoir ainsi raison ne prouve pas qu’on soit heureux.
Une glycine à la floraison profuse étreint la fenêtre du salon turc ; elle l’étreint de ses bras gris enguirlandés de mauve.
Les vitraux sont ouverts sur un horizon marin.
Les angles des moucharabiehs dérobent de curieuses poteries. Des choses précieuses traînent sur les meubles d’art indigène : des étamines bises, d’élégance discrète, harmonieusement brodées de soie violette et pompeuse ; des tissus aux irretrouvables nuances, jonchés de roses ; des voiles poétiques ; des parures orfévrées.
Des chapelets de fleurs d’orange, éclairés d’un géranium s’accrochent aux étagères et se fanent langoureusement, dans la dispersion de leur parfum.
Claude Hervis reprend la parole.
— Je hais les choses rectilignes, déclare-t-il. C’est pourquoi je préfère un douar de gourbis et de tentes à un cube de pierre divisé en cellules et une melahfa[5] à un habit. Cette Afrique m’a pris par son soleil. Elle m’a pris aussi par l’inconsciente primitivité qu’elle garde.
[5] Draperie des femmes indigènes du sud et des Hauts-Plateaux.
— Hervis, fit le Mahdi, vous vivriez facilement d’exaltations de la terre et de la lumière. Cela est grave bien qu’il ne me déplaise pas de vous voir dans cette ferveur. Mais faut-il conseiller la prudence ? Vous m’en voudriez, comme vous m’en voulez de ne pas être toujours très exactement de votre avis, encore que nous ayons plusieurs idées communes.
La jeune fille dit gaîment :
— Nous voici trois âmes sincères possédées d’un même désir d’amélioration pour la race inférieure…
— … qui n’est que la race différente, remarque Claude Hervis.
— Nuance !
— Une nuance suffit pour empêcher l’harmonie de deux couleurs.
— Soit. D’entre vous, lequel triomphera, non seulement dans la race qui nous préoccupe, mais sur les autres concurrents ?
— J’espère que ce ne sera pas celui qui prêche la stérile immobilité ni le retour à l’ignorance initiale.
Le sculpteur répliqua au Mahdi :
— Et ce ne sera pas celui qui rêve un trop bel idéal, la pure logique des gestes humains et le recommencement de temps merveilleux qui sont définitivement révolus.
Noura s’écrie :
— Moi, je réussirai !

— Je n’augurerai point du succès ou de l’insuccès de votre tentative, dit l’artiste à la jeune fille. Elle est hardie. L’Islam féminin, secret, m’est aussi inconnu qu’à ce magazine faisant autorité qui, à propos de documents sur une France coloniale, reproduisait une effigie très parisienne, embobelinée de gaze avec cette suscription : femme Kabyle.
— La vraie Musulmane vous est restée l’énigme.
— Je ne trouve pas sans intérêt ce modèle mystérieux et vous voulez me le dépoétiser.
Ils demeuraient seuls pour poursuivre la discussion commencée et leurs paroles devenaient plus véhémentes.
— Je veux soulever le voile, enlever la peinture barbare qui fige dans l’expression ancienne le visage d’une jeune génération. Dans nos cités neuves et denses, un débris d’édifice antique persiste difficilement…
— On le détruit ou on le replâtre, deux sortes de disparitions.
— Au contact de notre progressive activité, d’un exemple contagieux, quelle que soit sa résistance, le peuple arabe n’existera plus longtemps intact.
— Vous le mettez en présence d’un dilemme grave : s’éteindre ou évoluer.
Un grand rêve fluait dans les yeux de Noura.
— Il évoluera pourvu que soit provoqué avec tact et conviction le mouvement nécessaire. Ses regards s’ouvriront à une nouvelle lumière, ses regards affaiblis dans le crépuscule de l’Islam.
Mais Claude jeta vigoureusement :
— Vous dites « crépuscule » comme vous avez dit « débris » tout à l’heure. Que savons-nous ? Plusieurs ont, depuis des années, proféré ce cri absurde : — « L’Islam se meurt ! L’Islam est mort !… » — Et l’Islam est vivant. Il possède cette supériorité sur les autres cultes : n’avoir point engendré de sceptiques. Où sont ceux de ses fils qui l’ont renié comme beaucoup d’entre nous l’ont fait de leurs croyances ? Où sont ceux qui, ayant paru le négliger momentanément ne lui sont pas revenus avec une âme plus ardente ? Et je vous dis qu’une révolution religieuse trouble nombre d’esprits européens, les pousse vers le théisme de l’Islam, d’un Islam dépouillé du charlatanisme, des commentateurs et des merabtin[6], un Islam dans toute sa simplicité et sa poésie originelles.
[6] Pluriel arabe de marabout.
— Est-ce à dire que nous tendons à déserter notre activité pour l’inertie ?
— Pas tout à fait. Le but de Mahomet ne fut jamais le complet asservissement au fatalisme, ni l’initiation aux sorcelleries. L’interprétation truquée pèche pour le bénéfice d’influence des interprètes. La plus claire et la plus précise des religions peut-elle se vanter d’avoir traversé les siècles sans s’obscurcir et se déformer aux éclaircissements des théologiens ?
Il poursuivit :
— La rhapsodie biblique chante le renoncement dans une incessante aspiration vers l’éternité. La mélopée Koranique rythme les joies terrestres et leur perpétuation dans l’au-delà. Lequel est le plus compréhensible et le plus humainement doux ? Pour aider à bien vivre la vie mortelle, le livre d’Allah, traduisant une pensée évangélique, dicte la résignation sereine devant l’inévitable. De là le mektoub dégénéré.
— Vous êtes musulman, affirma Noura.
— Non. Je rejette toutes les religions. Elles sont l’œuvre des hommes. En adopter une, ce serait condamner le principe essentiel de mon être qui, n’ayant ni dogmes ni formules, ni temples, ni saints, se sent près de son Créateur comme à la première aube du monde. Ma prédilection pour nos Arabes vient de ce que toute notre psychologie exaspérée et exaspérante, affichée dans nos sermons, nos discours, notre littérature, ne les émeuvent pas dans leur manière d’être et de croire. J’aime la logique de leur instinct, leur jubilation devant les vérités naïves et leur rire spontané, pareil à celui des enfants.
Il s’était levé, se penchait à la fenêtre. Le parfum de la glycine entrait. Le crépuscule était sur l’horizon…
Les yeux de Noura s’attachèrent aux broderies fragiles, éparses dans l’appartement. Elle pensa à voix haute :
— Les petites mains se sont émiettées. Les couleurs rares sont perdues. Malgré le désir des artistes et des poètes, le fatal crépuscule est sur l’Islam.
Mais Claude se reprit à parler dans la beauté sacrée des dernières lueurs du jour.
— Long sera le crépuscule ! C’est un jour encore vivace, atténué par la Fatalité, — je ne dis pas le fatalisme, et par la Résignation, — je n’entends pas la soumission.
— Fatalité et Résignation, souligna la jeune fille. La destinée d’une nation tiendrait dans ces deux mots…
Le sculpteur répétait lentement :
— Oui, le jour persiste, pâle près des jours d’antan, mais pas encore moribond. Ses reflets, pour diminués qu’ils soient, appartiennent à la même couleur fondamentale. Et j’admettrai plutôt l’éventualité d’une renaissance que celle d’une disparition.
— J’estime qu’il n’est plus de renaissance possible. L’Orient ne peut plus rien contre l’Occident : il est esclave. Quand la flamme autrefois brillante vacille, falote, c’est que l’huile est épuisée dans la lampe ancienne. A votre avis, le jour persiste ; mais nous devons arracher des esprits à ce jour terne dans lequel, engourdis, aveugles, ils glissent au sépulcre.
— Ah ! ce glissement vers la mort ! Combien se sont accoudés aux balcons de la vieille Europe pour voir finir ce peuple dont l’exode, depuis les frontières sarrasines fut un galop d’épopée légendaire. Ils se sont accoudés semblables à cette figure, — chimère ou démon, — posée à l’un des angles des tours de Notre-Dame. La figure est impressionnante, sinistre et railleuse avec ces cornes tronquées, ses ailes rigides, son menton pointu dans les paumes des mains longues. Depuis des siècles, cela, — qui est une idée, — s’accoude au balcon de pierre et regarde Paris. Un ricanement a laissé son reflet sur la face de granit ; c’était au temps où le démon comptait voir l’anéantissement de la Ville. Le rictus mue en une grimace étonnée, — l’effritement par les rafales et les pluies paracheva l’expression, — le démon est surpris de la survivance de ce Paris qu’il croyait devoir mourir sous les révolutions et les catastrophes. Ainsi s’étonneront ceux qui guettent la fin de l’Islam et qui jettent des clameurs d’épouvante pour un seul mot évoquant le spectre du Panislamisme…

Noura Le Gall allait quitter la maison amie pour une ville de l’Est, blanche au bord de la mer, encore, avec des horizons de montagnes frisées de chênes-liège, de collines historiques, de plaines gonflées de vignes et de céréales, de vallées dont les échos se souvenaient d’avoir retenti aux chants des Barbares, aux hymnes byzantins après le bruit des légions et des randonnées de Jugurtha. Des ponts romains incurvaient leurs arches sur ses rivières, et, sous l’ombre des oliviers millénaires, la terre était lourde de plusieurs passés fameux.
Noura avait choisi cette cité parce que nul zèle jusqu’alors ne s’y était soucié d’une mission française dans les milieux indigènes. Nul n’avait pris soin de ces vaincus dont le sort moral paraissait précaire, la mentalité déchue.
Ses discussions renouvelées avec Claude Hervis n’ôtaient rien à sa conviction plus ferme d’être contredite. Elle escomptait un avenir rémunérateur. Elle entendait battre les ailes déliées ou naissantes des petites émancipées dont l’intelligence serait un jardin pour ses semences et leur précieuse floraison. Mentalement elle organisait et déterminait son logis, le bercail d’un troupeau juvénile aux heures de leçons. Elle songeait aussi à détacher sa tante des landes bretonnes où la veuve restait à cause du souvenir ; elle souhaitait joindre à son influence le prestige de cette Musulmane assimilée ; un bel exemple.
La veille de son départ, elle rencontrait le sculpteur dans les rues arabes.
Il poussait une porte vétuste et grimaçante comme un visage trop ridé.
— Voulez-vous voir le lieu de repos d’un Islam intact, Noura ? Entrez…
… Étrange logis des morts après cette porte plus branlante et vieille, mais pareille en sa forme à celle du seuil des vivants. Saisissante obscurité du couloir mouillé, des marches visqueuses, puis, le jour élyséen sur la terre noire où les tombes décrépites affleurent.
Dans cette clarté propice aux mânes, un figuier étend l’ombre inutile de ses feuilles, étire la convulsion blafarde et désespérée de ses branches tordues traînant sur le sol. L’arbre séculaire est là comme l’unique chose vivante, après un âge qui s’en est allé. Il accomplit sa mission de poésie, fanée ou rajeunie suivant les saisons, sur cette mort cachée au cœur de la ville arabe isolée, — une mort très fière de sa dignité mélancolique, en l’étroite nécropole insoupçonnée.
Des pierres tumulaires sont encore debout. Aux places où s’effritèrent des visages, sous le sol humide et l’humus des feuilles tombées durant les hivers, de petites amphores d’argile perpétuent l’urne funéraire antique.
Les hautes murailles comme pétries d’ombre et de moisissure enclosent l’asile des princes défunts. Elles sont sourdes, épaisses, froides. A travers l’une d’elles, soudain, filtre une rumeur atténuée, comme un vague parler d’âmes… Et la rumeur semble s’éteindre, en murmure de dolente prière… Ce sont les voix des étudiants d’une zaouïa voisine.
Une vieille femme sort d’un cube de pierres et de chaux ternie où, avec elle, s’abritent un linceul et la civière des trépassés. Laveuse des morts et gardienne des sépultures, face à l’horizon de la Mekke, elle commence les rituelles prosternations…
Claude Hervis rêve contre le figuier sans âge. Son profil nerveux et contemplatif exprime la volupté d’une sensation poignante. Il connaît toute la violence de la magie qui, pour lui, émane de ce lieu. Noura la voit sourdre dans les yeux de l’artiste, les yeux qu’elle aime pour leur loyauté pensive. Et, s’exaltant, voulant rompre le charme, elle profère une invocation vibrante :
— O destin, le rire des hommes est suivi des larmes et du dernier sanglot. Mais il en est qui ne connaissent ni rires ni larmes. Ils sont pareils à cette lumière crépusculaire, trop pâle et douce qui nous environne, qui s’éternise et fait paraître lointaine la fin de tout… O Destin, garde-nous de cette lumière car nous désirons vivre passionnément. Qu’importe si la vie en est violente et courte ! Et nous préférons aux clartés blanches l’incendie du soleil, dût-il être suivi d’une nuit aussi prompte et sans étoiles !…
Le sculpteur saisit le bras de la jeune fille :
— Prenez garde ! votre préférence est comme un défi. Vous êtes une sacrilège. Dans cet asile de silence et de repos, vous criez aux fils de cette poussière : — « Enterrez la tradition avec la cendre des aïeux. Oubliez l’horizon ancestral et saluez celui que je vous montre ! » — Vous troublez l’immémoriale prière de cette vieille femme gardienne du sommeil, pour lui faire entendre que ses petites-filles ne lui ressembleront pas. O sacrilège, ne méritez-vous pas un châtiment ?
Noura se libère de l’étreinte et, la main tendue comme pour un serment :
— Je suis venue vers le sommeil et ses gardiennes. La nuit va s’achever ; que l’aurore soit ! Vous toutes les Endormies, que vos yeux s’ouvrent. Voici l’heure du réveil !…
… une atmosphère toujours pleine de désir latent ou d’amour satisfait.
… une âme féminine qui conçoit infiniment la joie des parfums d’encens et d’aromates, une âme librement asservie, avec une volupté animale, au rite primitif de l’amour humain.
Le cavalier imberbe qui galopait dans le soir, — un soir d’ocre et de sanguine, — s’arrêta aux premières tentes de la zmala.
Les chiens hurlaient contre lui. Des femmes se voilèrent qui portaient des draperies roses et des anneaux ciselés dans l’argent massif.
Un homme prononça les paroles de paix qui accueillent.
Le cavalier vint s’étendre devant la tente sultane, son cheval près de lui, rênes traînantes, selon la coutume des Sahariens.
La tente sultane ; un de ces vastes logis mobiles où s’abritent les hôtes, les maîtres, les épouses, les concubines, les enfants, les serviteurs libres et les esclaves. Celle du fils aîné du souverain de la tribu est brune aussi, rayée des mêmes couleurs blanches et rouges, mais plus basse. Une patriarcale et riche simplicité les enveloppe. Autour gravitent les tentes plus humbles des petits parents et des familles tributaires rangées sous la baraka (bénédiction maraboutique) de l’agha Bou-Halim. Et d’autres, nombreuses, augmentent la cité nomade ; celles des pâtres, des serfs rusés qui sollicitèrent et obtinrent la faveur de faire partie de la zmala, pour être exemptés de trop lourdes redevances et payer de leur travail.
Les horizons se décoloraient. L’ombre semblait sourdre de la terre…
Soudain éclata le braîment des ânes, le bêlement des chèvres grelotta. Les troupeaux revenaient du pâturage dans les champs d’alfa. Les femmes allèrent traire les femelles fécondes. Avec des appels gutturaux, les hommes galopaient des juments sans selle ni bride, pour rassembler les retardataires. Des chameliers proféraient le sifflement qui apaise et fait se coucher les dromadaires grognons. Par intervalles, entre tous les bruits montait l’aboiement rauque ou le hurlement prolongé d’un chien, le hennissement d’un étalon, le susurrement d’une voix qui fredonnait.
Scènes des soirs dans les champs encore hantés par des patriarches et des bergers. Halte prolongée en la poésie des premiers siècles. Douceur biblique des gestes et charme des silhouettes dans la beauté grave du paysage !…
Sur ce territoire, sur ces êtres et sur ces choses règne l’agha Bou-Halim dont la zïara, l’impôt koranique, est productive, le goum riche de cavaliers et les affiliés, nombreux tels les grains de sable, une multitude ; car Bou-Halim est deux fois seigneur, chef militaire et religieux, étant prince et marabout.
Bou-Halim règne sur le large horizon des champs d’alfa et sur lui règne la France qui, en échange d’une promesse de loyalisme, lui donna le burnous d’investiture et le titre d’agha.
Mais pour subvenir à l’existence dispendieuse du chef orgueilleux, à ses réceptions aux magnificences orientales et à ses vices européens, une légion de serfs et de vassaux végète misérable, écrasée sous le poids des redevances. Il est des jours où l’usurier ricane, où l’agha ne pourrait rien donner à un derouïche mendiant. Ces jours-là, au sommet de la tente sultane, la houppe de plumes d’autruche est remplacée par du poil de chèvre…
D’une âme contemplative, le petit cavalier savourait la douceur du jour finissant. Et c’était un cavalier pauvre, avec des vêtements usés, des chaussures grossières, un pantalon turc et le turban des nomades.
Il alluma une cigarette et fuma, voluptueusement.
— Le salut sur toi, ô cavalier…
— Et sur toi le salut, petite fille.
Il regardait l’enfant menue aux yeux curieux, déjà savants d’audaces, larges, dans l’ombre bleutée du kehoul mêlé de poudre de corail et de perles fines.
Elle s’assit dans la poussière. Contre elle se tenait un petit métis, en équilibre instable sur des jambes arquées.
— Ton nom ? demanda le cavalier à la fillette.
— Mouni. Et toi ?
— Si Mahmoud Saâdi.
— Si Mahmoud, as-tu jamais été riche ou les usuriers te prirent-ils ton bien ? Qu’as-tu fait de ton bernous ?
— Je l’ai donné à un meddah[7] sur la route.
[7] Poète-improvisateur, barde errant.
— O Si Mahmoud le généreux !… Et que veux-tu ? L’agha est loin d’ici, pour la zïara. Moi je suis la fille de l’agha.
— Sa fille, Mouni ? — Le petit cavalier examinait l’enfant. — Oui, vraiment, dans ta figure je reconnais les traits de Si Laïd, ton frère.
— Mon frère, l’aîné qui est marié !
— Je l’ai vu en Alger.
Il se souvenait.
Ce visage avec plus de finesse, de séduction jolie lui rappelait celui du jeune homme aux yeux cernés par les orgies franques après les débauches arabes. Même ovale, épiderme ambré, narines mobiles comme celles d’un cheval de race, tout ce visage hautain et passionné, avili chez Si Laïd, pur chez l’enfant aux prunelles faites de kehoul et de poussière de soleil.
Si Laïd…
Le produit d’une double influence orientale par naissance, occidentale par contact. Un tyran pour les humbles, un soumis obséquieux devant un maître, un brave, insensément téméraire du moment où éclate la voix de la guerre et que les chevaux galopent dans le vacarme des fusils. Un avide d’honneurs, d’argent, de rubans, hochets des grands enfants masculins. Il est vaniteux et coutumier de gestes prodigues pourvu que son luxe provoque des éblouissements et des jalousies. Sa générosité prend sa source dans son orgueil ; mais sa main ouverte aujourd’hui demain pèsera sur la maigre échine de ses tributaires.
Dans les réunions élégantes où il se montre, le bernous chamarré de croix, le long caftan de velours épais, impérialement améthyste ou grenat, rebrodé d’or, le haut turban des princes nomades, le haïk souple, les bottes rouges et le seroual[8] habillent sa silhouette mince qui paraît grande.
[8] Pantalon bouffant.
Les nuits de bal, des promesses répondent au regard langoureux ou au sourire impertinent de ce fils dégénéré des Grandes Tentes. Le bon exemple des Européens excite sa naturelle perversité. Sa séduction orientale s’aggrave d’un air romantique ou persifleur, étudié. En lui, la belle impassibilité, la fierté sereine de l’Arabe de sang bleu mue en affectation et en snobisme.
Il est de ceux qui disent :
— J’ai trop dansé, ce soir, je suis claqué ! Mais j’ai promis le dernier « pas des patineurs » à une chic petit’ femme. Alors…
De quelle colère gronderait le sculpteur Claude Hervis s’il entendait de telles paroles tomber de ces lèvres sahariennes ? Et comme il crierait à la France, à l’Europe en fringants habits noirs, en uniformes et en froufrous :
— Voilà votre ouvrage, continuez !…
Le grave, c’est que, malgré tout, Si Laïd n’est pas devenu rien qu’un fantoche sans cerveau, à l’exemple de ses jeunes instructeurs.
L’éducation simultanée du bernous et du collège lui fit une mentalité habile.
Si Laïd, impitoyable dans son domaine, insolent avec ses égaux, est flatteur insinuant, ambitieux avec ses vainqueurs et tous ceux qui peuvent distribuer la gloire ou la fortune. Il se déclare définitivement conquis par les dons, les caresses et les avantages de la civilisation. Les optimistes et les assimilateurs croient d’autant mieux à cette conversion qu’il semble faire fi des devoirs koraniques et raille volontiers son peuple.
— Ces sauvages et ces imbéciles ! dit-il en parlant de ses frères.
Mais il ne traduit pas l’intime murmure de sa pensée.
Il lui arrive, — résultat de son instruction, — d’être vaguement sincère, un instant, dans les heures d’effervescence et d’ivresse occidentale, ou d’affecter la sincérité, pour en obtenir récompense et se faire valoir près de ses modèles. Le calme revenu, la nécessité disparue, le mépris et les rancunes justifiées ou inexplicables, tout ce qu’il recèle dans le secret de son esprit, émergent, il est mûr pour les représailles et le fanatisme, dès que les temps seront là et que la victoire décisive n’aura plus à hésiter.
En attendant, sous une livrée de caïd ou d’agha, il sera l’être doublement mauvais, instruit et politique, haineux, vindicatif et mécréant sous le masque noblement religieux ou servile.
Que lui importent les vertus de la France ? Il a lu, il a vu, il en a touché tous les vices. On lui a permis de connaître ou de deviner même les plaies secrètes que son jugement et sa mémoire intéressés élargissent. Si, devant lui, on veut étendre un voile sur les plaies, il aide à disposer harmonieusement les plis et ricane intérieurement : — Nous savons tous ce qu’il y a dessous.
On lui dira que d’autres, que les siens sont pareils ou pires ; mais cela ne répare rien. Quels sont ceux qui s’avouent ou savent exactement la laideur et la gravité de l’ulcère sur leur propre corps ?…
Le petit cavalier pensif, murmurait :
— Tous les chefs marabouts et princes, ne ressemblent pas à Si Laïd. Il en est qui se gardent nobles, résignés, intègres. Mais pour posséder la fidélité fervente et définitive, l’estime entière de ceux-là, il faut être exempt de tout reproche. Or, le bien de l’un est sali ou détourné par le mal de l’autre. Et voyant le Chrétien s’ériger en modèle, le Musulman songe…

Une injure avait jailli de l’extrémité de la Grande Tente ouverte au levant. Mouni s’échappait du côté opposé, et le petit métis qui s’appuyait contre elle, roulait dans la poussière.
Un serviteur s’approcha de l’hôte venu au nom de Dieu.
— Si Mahmoud te salue, dit celui-ci.
— Eh bien, salut à toi, Si Mahmoud, répondit-il, familièrement. Tu veux manger ?
— Et dormir. Je partirai demain. Tu me prêteras un bernous de l’agha ; j’ai donné le mien.
— Ah ! Si Mahmoud, le possédé des esprits ! Entre dans la tente…
Seul dans le compartiment de la maison mobile où sont reçus les hôtes, Si Mahmoud apaise sa faim.
Des sièges européens pareils à des captifs ou à des intrus, des tapis de haute laine bien chez eux, des coussins à la trame régulière et serrée, tissés par les femmes du Djebel-Amour, meublent ce lieu. Un rideau le sépare d’un autre compartiment qu’il est interdit de voir. Contre le rideau pend l’omoplate d’un mouton tué pour la dernière fête sacrée de l’Aïd-el-Kebir. Une sourate protectrice est gravée sur l’os.
Dans la ténèbre, hors des rayons de la bougie allumée, une voix susurre, espiègle.
— Es-tu rassasié ? Louange à Dieu !
— Mouni…
— Chut !
Mouni surgit. La mimique expressive des yeux très grands, des doigts très petits indique la souple cloison.
— Chut ! Elles vont venir là, les quatre femmes et la négresse de mon père, et encore deux Amourïat[9] qui dansent à faire mourir les hommes de désir. Elles vont venir pour le sommeil. Parle doucement.
[9] Danseuses du Djebel Amour.
— Ta mère est avec elles ?
— Non, non. Tu ne sais pas. Ma mère est morte. C’est le poison peut-être. Qui sait !… Ma mère était blanche comme la neige ; c’était aussi la mère de Si Laïd. Mon père la préférait et dormait avec elle les soirs où les Amourïat ne dansaient pas. La négresse le dit.
— Tu l’aimais, ta mère ?
— Je ne sais pas. C’était autrefois. Elle est morte. Et une autre aussi est morte qui était vieille comme mon père, la mère de Fatime. Et Fatime est mariée avec un chrétien, un chef de soldats, en France. Je ne l’ai jamais vue. Maintenant, la préférée, c’est Defla. Mais Ferfouri est jalouse.
Le petit cavalier rêve.
— Pour toi, Mouni, quel destin voudrais-tu ? Celui de ta sœur Fatime, l’amour d’un Français ?
Elle étend ses bras bruns où les anneaux d’argent heurtent les cercles de corne noire et les serpents des orfèvres du Djebel-Amour.
— Puis-je désirer ou connaître ? Tout est l’affaire de Dieu. — Elle regarde l’hôte lourdement. — Tu est si jeune… Et tu galopais bien sur ton cheval fatigué…
Le petit cavalier sourit des yeux de l’enfant. Il sourit mystérieusement. Une douceur féminine émeut son visage. Il y a comme un regret, une gaîté et une pitié tendre dans ses prunelles. Il va répondre ; mais il préfère s’en aller silencieux.
Et le cavalier imberbe prend place près d’un feu de racines sèches, parmi les hommes qui fument en devisant.

Nuit sur les champs d’alfa.
Sous la tente sultane, dans la partie basse et enfumée où chaque négresse esclave a son foyer et ses ustensiles, des femmes veillent.
Ce sont les épouses du seigneur, la Soudanaise, concubine légitime, et les deux Amourïat qui séjournent à la zmala.
Il manque Defla. Elle est allée dormir avec Reïra, la compagne solitaire de Si Laïd. Et, tout à l’heure, Ferfouri a disparu très pâle.
Un feu brûle dans le sol creusé.
L’une des femmes allaite le dernier fils du maître, rejeton misérable du vieillard alcoolique.
Les vêtements souillés et vieux des femmes de Bou-Halim frôlent les brocarts et les soies des hétaïres. Leurs parures sont pauvres près de celles de ces idoles vivantes et peintes, lourdes d’offrandes passionnées. Mais les épouses ne sont pas jalouses des bijoux des danseuses, parce que peu furent donnés par l’agha, et ce ne sont pas là leurs égales. Sous les tentes, pourvu que soient également répartis les dons matériels plus que les faveurs conjugales nul sujet de dissentiment n’existe.
Or, Defla trop favorisée provoqua des plaintes. Elle eut de Bou-Halim des khelkhal d’or massif pour cercler ses chevilles grasses, une chaîne française trois fois enroulée autour de son cou, et un chapelet d’ambre, tandis que les autres ne recevaient qu’un rang de sultanis[10]. Pour que Defla perde le bénéfice des amoureuses générosités du vieil époux, il faut que celui-ci lui préfère une autre amoureuse.
[10] Sequins.
— Ferfouri la très jeune, a dit la Soudanaise dont les avis sont écoutés, et qui acquit une situation privilégiée pour avoir donné au maître un enfant dont les droits sont égaux à ceux des autres devant les lois.
Les femmes se penchèrent, anxieuses, guettant au dehors un bruit léger.
Dissimulée dans la pénombre, Mouni écoutait aussi.
Peu à peu, des servantes noires ou métisses, des concubines d’hier, quittaient leur sommeil, venaient se joindre au premier groupe. Des « kanouns »[11] pleins de braise où fumait du benjoin, circulaient parmi l’étrange aréopage. Sur des coffres violemment enluminés, des bougies brûlaient.
[11] Vases d’argile.
Une forme se coula par l’ouverture de la tente. Ferfouri…
Elle essuya la sueur de son front bombé.
— Hada ma kan, cela est tout.
Elle s’accroupit et, comme ayant froid étendit ses mains sur un kanoun. Elle sentait le cœur battant des autres, l’interrogation muette de leurs yeux. Alors, elle parla, vite :
— Je suis entrée dans la tente de Si Laïd. Elles dormaient. Une bougie fondait sur la table où sont les journaux français. Reïra était couchée dans le lit de fer noir où brille du cuivre, Defla sur le tapis… J’ai rampé comme un serpent. La cervelle du mort pesait dans ma main… Elles ne se sont pas réveillées… Je vous dis que je rampais comme le serpent !… Et j’ai glissé la cervelle sous le coussin où reposait la tête de Defla… Cela est tout…
Elle remit ses mains près de la braise.
Ce fut la voix de la Soudanaise :
— Louange à Dieu, Ferfouri ! Elle dort sur la chose immonde. Par le pouvoir du maléfice, son flanc devient stérile et sans joie, son pouvoir d’aimer est mort.
Celle qui allaitait souleva l’enfant pendu à sa mamelle oblongue.
— Avec Defla est la malédiction ! dit-elle. Vous savez la blancheur de sa peau. Quand l’enfant commença à vivre en moi, je priai : — « Par ta tête, ô Defla, laisse-moi boire ce verre d’eau au-dessus de ton visage, pour que mon enfant soit de ta couleur. » — Elle répondit : — « Fais selon ta pensée. » — Et dites-moi si mon fils est blanc !…
L’être simiesque cria. Elle le recoucha sur ses genoux.
La Soudanaise et Ferfouri échangèrent un regard. De sa poitrine, celle-ci tira un morceau de mousseline pris au turban de nuit de l’agha.
Et Ferfouri mima un désespoir. Ses yeux pleuraient, sa voix gémissait à cause de sa jeunesse sans amour… Et les femmes se lamentèrent sur le malheur de Ferfouri.
La Soudanaise qui savait tous les sortilèges déchira le lambeau de turban en sept lanières.
Il y eut un grand silence.
Elle apporta un vase de terre vernie plein de pétrole et sept piments rouges dans un vase de cuivre. Elle arracha la queue des piments, extirpa habilement les graines.
Cependant, Ferfouri et ses complices avaient noués les lanières à leurs orteils et, les roulant entre leurs doigts en avaient fait sept cordelettes. La Soudanaise prit les cordelettes, les graines de piment, du mounès, — qui est une sorte de résine, — et du djaoui, le benjoin. Elle jeta ces choses dans le pétrole, les retira, en remplit les sept fruits rouges transformés en récipients merveilleux. Elle les referma avec leur queue ; ils redevinrent tels des fruits intacts.
L’enfant pleurait. Sa mère lui mordit le bras. Il n’eut plus que des sanglots étouffés que rythmaient à contre-temps les gestes de l’Incantatrice.
Elle avait fait un trou au milieu du foyer et mis les sept piments dans le feu.
Les femmes balancèrent leur buste en de lentes salutations. Leurs bijoux accrochaient le reflet des braises et des bougies fondantes. Les visages impassibles aux paupières closes s’éclairaient de lueurs farouches, s’estompaient d’ombre où luisaient les dents des négresses suivant le mouvement de va-et-vient. Elles prononcèrent l’incantation dont les mots n’avaient pas de sens pour elles. Entre leurs lèvres serrées passa un sifflement mystérieux…
Et le feu brasilla et crépita bizarrement.
Ferfouri jeta un cri de triomphe.
— O Ferfouri l’heureuse, dit la Soudanaise, vois le cœur de Bou-Halim brûler d’amour pour toi…
En félicitant la petite épouse, l’une des danseuses soupire :
— Hélas ! Bou-Halim est loin d’ici.
Mais la Soudanaise sourit, car elle sait comment on aide les sorcelleries pour les rendre infaillibles.
Et les chiens hargnent… Un réveil brusque, en l’heure inaccoutumée, secoue la zmala. Parmi de dansantes lumières, c’est le retour imprévu de l’agha…
Il s’est étendu dans le lieu clos par les souples tentures.
Les servantes emportent le plateau et la tasse de café vide.
— O Ferfouri, disent-elles, notre seigneur te veut…
Seule devant la braise consumée, Mouni poudre son pied avec la cendre du sortilège et murmure :
— Ah ! Si Mahmoud, si tu étais revenu !…

Des cavaliers sont allés à la rencontre de Si Laïd là où voies ferrées et routes font place aux sentiers arabes.
Et les cavaliers s’étonnent parce que deux femmes vêtues de noir, à la mode chrétienne, accompagnent Si Laïd…
Quelle réminiscence brusque, quel désir impérieux avait saisi la veuve du colonel Le Gall au milieu de son deuil ?
Ce fut comme le réveil d’une puissance intime, d’un démon intérieur que la présence de l’époux avait rendu muet et immobile, que l’amour domptait, mais que la mort libérait soudain et qui secouait impérieusement ses chaînes brisées.
Tous ceux qui connaissaient Fatime Le Gall affirmaient avec son mari qu’elle avait définitivement oublié son esprit musulman. Elle était le modèle dont s’inspirait Noura pour l’œuvre future.
Et Fatime bent[12] Bou-Halim n’avait rien manifesté qui pût faire douter de son assimilation définitive, accomplie par la tendresse et les leçons du colonel. Mais, en cela, elle usait du parfait et presque inconscient talent de dissimulation qui lui venait de ses origines. En elle, silencieuse, persévérante et profonde vivait la souvenance, l’esprit du Sud, de la race et de l’Islam que rien, pas même sa volonté, ne pouvait détruire. Noura quittant la France, le dernier lien de velours tombait. L’âme musulmane de Fatime chantait l’allégresse d’une résurrection.
[12] Fille de…
Et à l’heure du départ de Noura pour la cité choisie, un avertissement bref retenait la jeune fille.
« J’ai besoin de soleil. Je veux revoir ma terre. J’arrive. »
Puis, dès le ponton du débarcadère, Madame Le Gall s’immobilisait devant un jeune homme ganté de gris, stick en main, fin bernous de Sousse relevé sur la veste dorée.
Avant de voir Noura, elle reconnaissait celui-ci, pour l’avoir souvent revu en France.
— Si Laïd, mon frère !
— Fatime, murmurait l’autre.
Le lendemain, la princesse du Sud voulait partir vers la zmala, revoir son père, les tentes familiales et l’horizon de son enfance. Noura l’accompagnait.
— Qu’il soit fait selon ton désir, ô Lella[13] Fatime, avait dit Si Laïd…
[13] Titre de respect, de déférence.
A sa nièce, Madame Le Gall expliqua les raisons de ce désir.
— Depuis ton départ, Noura, tout m’abandonnait à la détresse des larmes. Je n’avais pas voulu te suivre à cause des souvenirs que je voulais garder dans la maison, et ces souvenirs me devenaient hostiles. Les bruits familiers m’obsédaient comme des importuns et des inconnus, bruits de cloches au village ou sonnailles des troupeaux dans la lande. J’ouvrais les albums de ton oncle et je sanglotais sur les photographies de mon pays. Je me mettais à parler arabe ; je n’avais plus conscience des années écoulées, du changement subi ; je redevenais toute une fille des Grandes Tentes et j’écoutais dans mon cœur les murmures de là-bas. J’aurais donné toute la joie pour entendre une chanson du Djebel-Amour ou du Sahara…
Nous comprenons cela, ô Lella Fatime. Nous savons comment les nostalgies se tordent dans les nerfs et bondissent dans le sang. Nous savons la folie qui nous possède avec la souvenance, et comme nous voudrions casser les choses que nous ne pouvons plus aimer ; et comme nous voudrions marcher, oreilles sourdes, prunelles aveugles, dans le seul mirage de notre mémoire et de notre souhait ; et comme nous haïssons « aujourd’hui » parce que notre amour est trop grand pour « hier » révolu et pour « demain » que nous espérons.
Des formes impondérables peuplent notre atmosphère. Nous reconnaissons en nous un être d’autrefois, un revenant victorieux qui annule l’existence de la créature que nous devenions. Nous avons soif des premières eaux dont nous pensions avoir oublié le goût dans l’ivresse d’autres breuvages. Nous tendons les bras vers de lointaines terres où nous voudrions dormir encore, là où se retrouverait encore la première empreinte de notre sommeil juvénile et doux…
Si souvent, dans le brouillard, nous avons imploré un ancien soleil ! Si souvent nos fibres tendues, dans l’énervement de musiques complexes, nous avons appelé le vacarme des musiques barbares, le battement sauvage du tobol, le cri strident, aigre et prolongé de la raïta, le cri qui pénétrait dans notre chair, et le chant de la ghesbâ langoureuse, chalumeau des pâtres, qui, avec le djouak de fin roseau nous faisait pleurer d’amour.
Lella Fatime, âme bédouine transplantée, des âmes franques ont connu la nostalgie au souvenir d’inoubliables Afriques. Et nous savons ce poète qui scandait :
[14] Lucie Delarue-Mardrus.
Les voix européennes ne se taisant pas et nul accent souhaité ne s’élevant d’entre elles, Lella Fatime était partie, franchissant la mer pour cheminer par les voies et par les routes vers les monts abrupts et le désert.
A l’entrée des sentiers, aux champs d’alfa, les deux voyageuses montèrent des mules bâtées avec des tapis.
Madame Le Gall crut revivre sa jeunesse. Elle portait légèrement le poids des années qui se lisaient dans sa taille alourdie, ses traits placides, ses cheveux trop obstinément noirs et ses yeux embués dans leur cerne d’antimoine. Elle parlait français avec la voix chantante, les inflexions câlines des femmes arabes. Mais elle avait repris le langage ancestral pour deviser avec Si Laïd.
Elle se réjouissait de revoir son père qu’elle n’avait rencontré qu’une fois depuis son mariage. Dans une ville du pays breton, il avait vécu un exil momentané que le gouvernement lui imposait pendant que s’apaisait une effervescence constatée dans son aghalik.
Si Laïd avait des yeux de convoitise pour le charme sérieux de Noura, sa taille élancée et robuste, sa claire figure à la bouche volontaire.
Et Noura allait comme un semeur aux plaines ouvertes, avec l’espérance d’y laisser des germes féconds.
Les tentes mirent leurs points sombres dans l’étendue grise et blonde.
Prévenue par un message d’avant-garde, la zmala attendait l’arrivée. Les yous-yous stridèrent pour l’allégresse et la bienvenue.
Au seuil de la tente sultane, Bou-Halim bénit celle qui revenait… Il prononça de sa voix sacerdotale :
— Sois la bien accueillie, trois fois la bien accueillie, ô ma fille, toi et celle qui est avec toi.
Il se tourna vers la foule bédouine :
— Prenez des moutons et des chèvres dans mon troupeau. Tuez-les pour vous et vos familles. Que la zmala entière soit rassasiée, à cause du retour de Fatime.
La foule hurla un alléluïa guttural. Les égorgeurs se ruèrent sur les troupeaux. On entendit des bêlements désespérés et des râles au sourd murmure de la formule rituelle que proféraient les sacrificateurs.
— Bism Allah, au nom de Dieu !
Dans l’intimité de la tente, c’était la réunion familiale. L’agha présidait, figure immobile sous le turban de mousseline bise et de soie. L’expression ne livrait rien des sensations intérieures. Les yeux troubles étaient ceux d’un fumeur de kif et d’un ivrogne. Ils paraissaient éteints et ne sachant plus discerner que l’heure des prières dans l’exaltation ou l’évanouissement des clartés ; pourtant, ils savaient encore choisir parmi les danseuses du Djebel-Amour. Les doigts aristocratiques, aux ongles bombés étaient bien faits pour l’égrènement silencieux du chapelet, au geste machinal et doux, éternisé par l’accoutumance et la foi ; mais c’étaient aussi des doigts rapaces.
Il retenait Lella Fatime près de lui, l’interrogeait sans hâte, l’écoutant dire le deuil passé et la joie présente. Il répétait ce qu’il avait écrit à la nouvelle de la mort du colonel.
— La tombe d’un homme de bien est parfumée comme un jardin.
Noura s’entretenait avec un groupe où Defla et Ferfouri rutilaient, somptueuses à l’égal des Amourïat. Elles se caressaient comme deux amies très tendres et plaignaient Noura et Lella Fatime d’avoir des vêtements sans ampleur ni beauté. Mais elles les trouvaient riches de science pour les choses inouïes qu’elles avaient vues, dont elles avaient vécu et que Noura tentait d’expliquer après les interrogations multiples.
Idoles au cerveau étroit, primitives à la compréhension légère, inaptes à concevoir autre chose que les paysages familiers, les expressions millénaires, immuables, de leur monde ancien, elles définissaient mal les grandes cités cosmopolites, la mer, ce lac immense où les felouques pouvaient voyager pendant des jours et des jours sans voir la terre, et les maisons prodigieuses plus hautes que des palmiers et si vastes…
Elles écoutaient Noura comme on écoute une trop savante musique. Elles la regardaient comme une gravure étrange dont on ne pourrait fixer le sens. Ce qu’elle disait était une révélation, car les maris ou les fils qui connaissent les villes chrétiennes ne savent rien expliquer aux femmes. — « Elles ne comprennent pas, affirment-ils. » — Il arrive qu’on répète les propos d’un spahi ou d’un goumier, amants de passage. Mais peut-on tout croire ? Ils mentent pour séduire.
La Soudanaise enlaça la jeune fille en s’écriant :
— Tes villes magnifiques ne renferment-elles pas d’amoureux ou ceux-ci sont-ils privés de raison qu’ils laissent échapper une fille telle que toi ?…
Bou-Halim jeta un regard autour de lui.
— Mouni ? demanda-t-il. C’est une sœur que tu ne connais pas, Fatime.
On cherchait l’enfant et on la découvrit en compagnie d’autres fillettes, derrière la tente, s’exerçant aux déhanchements lascifs des Amourïat.
A l’appel de la Soudanaise, Mouni ne consentait à venir que vêtue de l’une des tuniques des danseuses. La Soudanaise approuva cette coquetterie. Et Mouni fit son apparition, étrange et jolie, dans les draperies amples qui cachaient ses pieds nus. D’êtres invisibles, les anneaux de ses chevilles tintaient mystérieusement. Une ceinture orfévrée glissait sur ses hanches minces. Sa gorge menue bombait sous les étoffes. Un collier de grains parfumés, à chacun de ses gestes exhalait les senteurs d’un jardin d’Orient.
Un suprême orgueil étincelait sur son visage ardent, attentif et passionné.
Elle baisa sa sœur aînée sur la bouche et sur le front, effleura de ses lèvres la main de Noura et s’accroupit aux pieds de Bou-Halim.
— O Mouni, tu es fraîche comme un fruit et brillante comme une étoile, dit la jeune fille.
— Je t’aime ! répondit Mouni.

« Où je suis, Amie ? Dans une cour intérieure tout ombre et lumière bleutée des murailles. La zmala patriarcale et barbare a quitté les champs d’alfa, — car le temps des grands pâturages est fini, — pour prendre ses quartiers, jusqu’à la saison prochaine, dans une petite bourgade aux maisons de pisé ; des huttes blondes et blanches.
« Je fais ici un sévère apprentissage que je ne compte pas prolonger indéfiniment.
« Avant de risquer mon premier geste d’éducatrice, et pour arriver à être « comprise », j’ai voulu d’abord « comprendre » ce monde d’hier. Sa réalité m’a surprise et son recul devant ma pensée à peine énoncée. Les paupières de celles que je voulais pour mes premières élèves se sont soulevées sur des yeux aveugles devant l’horizon indiqué. Je me suis heurtée à l’absurdité, à l’ironie discrète ; souvent à une inattendue logique ou à cette inertie qui me paraît être une forme gracieuse de l’incompréhension voulue sinon de l’hostilité.
« Claude Hervis se réjouira de l’insuccès de cette tentative ; mais je prendrai ma revanche.
« Je vous citerai quelques-unes des réflexions saisies ou provoquées. Vous jugerez. Celle-ci, de Reïra, la femme de Si Laïd : — « Je n’aime pas mon mari, mais je suis fière d’être à lui, soumise à son caprice même injuste, parce qu’il est le plus beau et le plus généreux parmi les hommes des tentes. » — Ce qui ne l’empêche pas de le tromper avec une légion d’amants. Les Soudanaises aident l’adultère. Sur un reproche discret que je fis, elle justifia ainsi sa conduite : — « La femme a été créée pour l’Amour. Il lui est permis d’être la joie de plusieurs, pourvu qu’elle ne refuse rien au désir de son mari. » — A ce métier, Reïra gagne des bijoux et de l’argent qu’elle dit tenir de sa famille.
« Les seize ou dix-huit ans de Reïra sont déjà trop vieux pour être convaincus qu’il y a mieux à faire en la vie. Trop vieille aussi Ferfouri qui me répond : — « Tu veux te donner tant de peine pour nous ! Ne peux-tu nous laisser dans notre esprit ? Tel qu’il est nous l’aimons. Et pourquoi la chèvre des champs d’alfa souhaiterait-elle d’autres champs ? Qui sait si les herbes y seraient meilleures. Toi tu affirmes sans connaître notre pâturage. » —
« Et les autres dans un sens différent : — « Devenir semblables à toi, à tes sœurs, c’est commencer par s’habiller de choses laides, perdre le goût de l’or et de la soie, nous confondre avec des gens de petite naissance. » —
« J’essayai de défendre notre uniforme. Elles me montrèrent ma tante qui porte le costume de son peuple pour plaire à son père.
— « Vois combien Lella Fatime est plus belle et plus noble ainsi ! »
« Je n’insiste pas près de celles-là ; mais j’ai confiance en la génération jeune et je m’attache à déchiffrer et à capter le cœur de Mouni, cette petite sœur de ma tante… »
Noura interrompit sa lettre ; l’élégante silhouette de Si Laïd s’encadrait au seuil d’une porte.
Il s’approcha, ébauchant une conversation quelconque pour le seul plaisir d’être près de la jeune fille.
Dans un angle de la cour, des négresses préparaient un collier pour Lella Fatime.
L’atmosphère était pleine des parfums combinés de la pure essence de rose, de la résine de genévrier, de mounès, de djaoui et de clous de girofle écrasés avec d’autres grains odorants. Cela formait une pâte précieuse qui avait exigé huit jours de manipulations savantes. Maintenant, les négresses la roulaient en petites boules brunes qu’elles enfilaient sur des brins d’alfa pour les faire sécher. Puis, réunies à l’aide d’un fil de soie verte, alternées avec des perles d’or et de corail, elles seraient la parure enviée, réservée aux femmes de haut rang.
Les négresses chuchotaient en regardant Si Laïd et Noura. Un signe imperceptible les fit taire et disparaître…
— Les heures perdues qui pourraient être consacrées à l’amour nous seront comptées comme des crimes, murmure Si Laïd. Noura, je t’aime ; il faut que tu sois ma « lumière ».
Noura se lève.
— Quelle folie, Si Laïd !
— Pourquoi ?… Certes, l’amour est la pire folie ; mais c’est la seule que l’Univers accepte avec bonheur.
— Je ne suis pas de ta race.
— Ne suis-je pas assez de la tienne ?
Le sourire de la jeune fille répond.
— Et que fait la race, je te prie, Noura ? Je sais que tu ne seras pas mon amoureuse ; mais je veux répudier Reïra qui me trompe et compte dans ma vie moins que mon cheval. Je veux que tu deviennes la reine de ma tente et de ma maison, la plus enviée ici, la plus délicieuse partout, la mère de mes fils et celle dont le sourire me met à genoux.
— Si Laïd, ce sont-là d’inutiles paroles. Mon cœur est sans amour pour toi. J’ai besoin de ma liberté et je serai bientôt loin d’ici. D’autres désirs te guériront de celui que tu dis avoir.
Le fils de Bou-Halim frisa sa moustache, ses narines voluptueuses aspirèrent les parfums épars dans la cour.
— Ecoute, Noura. — Sa voix restait caressante, mais son regard brillait, aigu comme celui d’un oiseau. — Tes yeux n’ont pas voulu m’accueillir avec tendresse. Par Dieu ! Il faut qu’un jour ils me suivent avec des larmes de feu !…
Et il s’éloigna.

Au hasard d’une conversation :
— Ah ! Si Mahmoud Saâdi ! Nous la connaissons, fait Bou-Halim à Noura.
Ils parlaient de cette unique Isabelle Eberhardt, cette jeune femme au talent rare, à l’humeur vagabonde sous le bernous d’un petit taleb et qui, si vigoureusement chantait la chaude chanson du Sud et l’âme bédouine.
Une petite voix balbutie derrière Noura :
— Qu’est Si Mahmoud Saâdi et que dites-vous de lui ?
— C’est toi, Mouni ? Si Mahmoud Saâdi est une Roumïa qui s’habille en cavalier et qui écrit des histoires.
La déception de Mouni est immense. Ce petit cavalier hardi une femme, rien qu’une femme… Les yeux de la fillette flambent comme des herbes sèches. Elle s’en va au bruit ralenti de ses anneaux tintants.
Ce même jour, Noura demandait à Lella Fatime :
— Quand partons-nous ?
— Pas encore, moi du moins. Je jouis. Je suis utile à mon père qui préfère mon avis à celui de Laïd. Naturellement, j’ai plus d’expérience.
Cette prédilection de Bou-Halim faisait la fierté de la femme qui n’avait jamais été qu’un enfant gâté sous la tutelle de son mari.
Elle ajouta :
— Si tes projets te réclament, je comprends que tu ne puisses t’attarder. Dans ce cas, pars ; je te rejoindrai plus tard.
Une crainte étreint la jeune fille, la crainte que sa tante soit trop reprise par l’ambiance du milieu retrouvé. Le deuil y revêtit une imprévue douceur ; il est devenu un calme et tendre regret ouaté de fatalisme dans le présent et le passé. Le temps à venir est baigné de quiétude. L’arbre remis dans le sol natal enfonce-t-il de nouvelles racines dans la tiédeur des terres arabes ?…
Lella Fatime accepte le logis bizarrement meublé, habité à la fois par l’austérité et la licence. Elle accepte la promiscuité des femmes qui trahissent, des hommes brutaux et fantasques, des prostituées professionnelles. Ces dernières sont reçues sans mépris puisque « Dieu les fit naître avec le signe de leur destinée au front », disent les convenances musulmanes.
Madame Le Gall qui sembla jadis se complaire à des discours sages et raffinés, s’intéresse à des bavardages puérils ou scandaleux bruissant dans la vie uniforme des heures tranquilles.
Noura n’osait préciser son sentiment. Elle risqua :
— Après tant d’années comment vous êtes-vous si vite réaccoutumée à cette existence que j’étudie et que je trouve déprimante ?
Le visage de Lella Fatime s’obscurcit :
— Tu ne peux pas comprendre ; tu n’as pas de sang arabe. Et cela fait qu’ici on ne te comprend pas non plus.
— Je le sais.
— Tu réussiras mieux avec les gens du littoral qui ne sont pas des nobles issus de princes et de prêtres. Ils ont moins l’orgueil des coutumes. Pars quand tu voudras. Je ne pourrais t’être d’aucune utilité dans ton installation ; ta volonté brusque s’impatiente de ma douceur lente…
— Ma tante…
Lella Fatime sourit :
— Cela ne nous empêche pas de nous aimer.
Si Laïd s’avançait, avec son regard qui menaçait et sa voix qui caressait Noura. Alors, la jeune fille quitta sa tante et monta sur les terrasses chaudes dans le crépuscule.
Noura réfléchit. Elle revoit la zmala du soir de l’arrivée, la bénédiction de l’agha, la main sacerdotale étendue sur la tête de la Lella Fatime, comme pour la reprendre. Et toute l’ambiance des lieux est complice ; un étrange ensorcellement rôde dans l’air ; l’esprit s’endort, la chair s’émeut dominatrice.
La Franque qui veut être missionnaire en Islam sent l’haleine de cet Islam passer sur elle comme une irrésistible ivresse. Elle est dans une atmosphère toujours pleine de désir latent ou d’amour satisfait, où les gestes ne concourent qu’à la satisfaction de l’instinct. Elle est enveloppée d’une âme éternelle, immense, ancienne et puissante qui joue avec la raison, l’annihile et la perd dans ses replis. Et c’est aussi une âme surtout féminine qui conçoit infiniment la joie des parfums d’encens et d’aromates, une âme librement asservie, dans une volupté animale, au rite primitif de l’amour humain…
Noura hausse son front grave. Elle résistera à la séduction, au langoureux poison de l’Orient. Elle rompra l’arachnéenne et soyeuse trame qu’une magie tisse autour d’elle. Là où Claude Hervis, Lella Fatime, le Mahdi même peuvent succomber, Noura se libère et c’est la victoire de l’Occident.
Une voix frêle chanta dans le soir. Elle chanta une improvisation sur le coursier de quelque bien-aimé, un cheval qui s’appelait Guelbi (mon cœur).
Guelbi ! Guelbi !
O toi le plus beau d’entre les coureurs musulmans !
Allah !
Guelbi ! Guelbi !
Tu es pareil à la gazelle apprivoisée.
Je t’aime, ô toi, Guelbi !
O protégé de Dieu, je t’aime !
Toute la vie tient dans le galop,
Quand le vent sèche la gorge et serre la tête
Comme dans un foulard de soie.
La voix hésita, s’interrompit pour reprendre ardemment :
Je t’aime, ô Guelbi, par Dieu ! je t’aime !
Viens ! je te nourrirai de roses.
Je t’abreuverai d’eau de fleurs d’oranger.
Baise-moi Guelbi !
Ta bouche sera plus douce et légère que celle d’un homme
Pour toucher ma joue.
Guelbi ! Guelbi !
La chanson s’acheva par une plainte enfantine et profonde.
— Ma sœur Mouni, quel chagrin ?
Et Mouni debout, le corps vibrant :
— Je ne resterai pas ici ! Sur la tête de ma mère, je ne resterai pas ici !
— Pourquoi ?
Les yeux de l’enfant eurent une désespérance infinie.
— Mon cœur et ma tête ont suivi le galop du cheval de Si Mahmoud…
— Ah ! Mouni, tu pleures pour cette femme.
— Je ne pleurerai plus. Ai-je pleuré ?… Je chantais pour un cheval que j’aimais une fois, que j’appelai Guelbi. Si Mahmoud est une femme, je méprise Si Mahmoud. Mais je veux partir parce que déjà les hommes d’ici et ceux de la zmala savent que je suis belle. Mon père pourrait me donner à l’un d’eux et, maintenant, je les hais tous !
Le visage de Noura s’illumina :
— Viens avec moi. Je pars demain…
Mouni réfléchit.
— Es-tu musulmane et ne me livreras-tu pas à des chrétiens mauvais ?
— Je ne suis pas musulmane, mais je crois que Dieu est le plus grand et ta sœur fut ma mère un peu.
— Au nom de Dieu, réponds-moi encore ! Penses-tu que la sauterelle puisse vivre comme le grand oiseau ? Tous deux ont des ailes, mais peuvent-ils se suivre ? Te suivrai-je ?
— Oui Mouni.
— Notre seigneur Mohammed te récompense ! Parle à mon père. Emmène-moi.
Et elle baisa Noura sur la bouche…

Une byzantine église rose, fauve et bleue :
NOTRE-DAME D’AFRIQUE…
Elle domine le large de la mer où le jeu des lames courtes et du soleil met les ocelles d’une queue de paon.
Des Arabes viennent au sanctuaire chrétien, conduites par la superstition, la belle croyance au merveilleux que garde l’Orient traditionnaliste.
Au seuil de l’église, elles s’arrêtent. L’aumônier passe, contemplant la mer. Les femmes le regardent, indécises. Mais une vieille élève la voix :
— Ne craignez pas, il connaît les Musulmanes.
Elles entrent…
Et Mouni vêtue d’une robe d’Europe toute neuve, un chapeau abritant son visage doré, ses pieds pris dans des bottines, Mouni échappant à Noura et à l’Amie suit les femmes d’Islam.
Mouni était la conquête de Noura Le Gall. L’influence de Lella Fatime avait pesé sur l’assentiment de Bou Halim.
L’agha consentait, sous condition que Mouni garderait intacte sa croyance et reviendrait au premier signe. Il se séparait facilement de l’enfant, ne s’étant inquiété d’elle que si une rumeur répétait qu’elle était jolie et que les plus riches la voudraient à cause de sa nature ardente qu’observaient et dont s’entretenaient les vieilles colporteuses en choses d’amour.
Pour Noura, Bou-Halim n’avait pas de sympathie, mais une grande estime, appréciant la droiture et la fermeté de son caractère. En accédant à son désir d’emmener sa fille, il jugeait aussi que le beylik français, après le mariage de Fatime, l’instruction de Si Laïd, considèrerait celle de Mouni comme une nouvelle preuve d’un loyalisme digne de récompenses.
Et Mouni depuis le départ s’émerveillait. Ses étonnements n’exigeaient jamais d’explications. Il lui suffisait de jouir. Elle ne demandait pas qu’on définît sa jouissance, une jouissance plus physique que morale. Son corps mince, qu’on voyait tressaillir et vibrer au moindre spectacle ou au moindre attouchement caressant, participait au plaisir, plus que son esprit. La douceur des Européens la ravissait, encore qu’elle les trouvât très curieux de sa personne.
Cette curiosité la rendait fière, d’ailleurs. Elle désirait constamment une main dans ses cheveux et des lèvres sur son visage.
Elle ressemblait à un précieux petit animal apprivoisé, une sorte de chat qui ronronnait avec volupté, mais qu’on prévoyait ne pas devoir abdiquer toute l’indépendance de son tempérament.
Les pèlerines d’Allah en l’église chrétienne, trébuchent contre les bancs pour voir les ex-votos envahissant les murailles. Elles ont des cris de gaîté pour tant de poupées, celluloïd ou porcelaine, qui révèlent le souhait des épouses stériles et la gratitude des maternités réalisées.
Devant l’autel de la Vierge africaine, noire, celles qui viennent pour la première fois murmurent :
— Eïhoua ![15] elle entendra notre langue.
[15] Interjection familière.
Elles déposent leurs offrandes ; d’odorants chapelets de fleur d’orange ; des roses artificielles comme en ont les prostituées maures et espagnoles à l’oreille ou dans le chignon ; et aussi des cierges longs, très minces, verts, jaunes ou rouges, tels ceux qu’on brûle aux tombeaux des saints merabtin ; et encore un morceau déchiré d’un foulard de soie et une cassolette d’argile pleine de braise et de benjoin. La fumée adoratrice voile le visage de la Vierge noire, la même fumée qui, dans les Koubbas, embaume les plis des étendards.
Alors, aux frôlements de leurs pieds nus, les femmes font sept fois le tour de l’autel, selon la formule des vœux.
Mouni, accroupie sur les dalles devant l’idole chrétienne, Mouni est saisie d’une mélancolie langoureuse… Peut-être est-ce à cause de ce jour de grand soleil qui finit, ou parce qu’un vent chaud trouble les feuillages de la colline et que le couchant est si rouge. Peut-être est-ce à cause du benjoin et de tant d’ors brillant sur la Vierge et sur l’autel…
Étrangement profane, le hasard met aux lèvres de l’enfant le murmure d’une chanson des Amourïat :
Mouni pleure des larmes savoureuses…

Claude Hervis poussa Mouni dans le salon où traînaient des écharpes, des voiles, des ceintures et des hennins dorés, des petites vestes turques, étincelantes.
Comme il eût arrangé un modèle, il enveloppa l’enfant d’une aérienne draperie. On ne vit plus la robe européenne et simple dont Noura avait habillé sa conquête. La natte défaite, les longs cheveux de Mouni s’éparpillèrent. La petite coiffure pointue s’inclina sur sa tête ; un voile caressa ses joues et ses pieds nus effleurèrent joyeusement le tapis.
Claude satisfait la ramena dans l’atrium de la blanche maison mauresque.
— Bravo ! dit l’Amie.
Le Mahdi souriait.
Noura fronça les sourcils.
Toute la coquetterie native de Mouni s’avivait au contact des choses belles.
Elle s’écria :
— Que ta robe française était laide, ô Noura !
— Pourquoi l’avoir ainsi affublée ? demanda la jeune fille au sculpteur.
— Vous l’aviez travestie en un inharmonieux fantoche. Je l’ai rendue à son harmonie première. Noura, je vous adresse une prière au nom de notre amitié. Puisque le destin permet ce crime, la transplantation de ce genêt saharien dans votre jardin…
— Soyez un jardinier avisé, interrompit le Mahdi. Le genêt ne doit pas être élagué et dirigé comme un rosier de France. Vous pouvez améliorer son parfum en lui laissant son originalité. Cultivez et transformez l’intelligence de Mouni, mais ne changez pas sa figure.
— C’est à peu près ma pensée, reprit l’artiste. Pour la joie de nos yeux, laissez à la petite idole son manteau coloré. Vous ne prétendez pas supprimer si vite voiles et bernous pour réduire tout un peuple à notre laideur.
— … extérieure, intervint encore la voix du Mahdi.
Et l’Amie :
— Mouni ne s’y est pas trompée ; elle sait où se trouve la beauté.
Noura affirma tristement :
— Un maléfice se cache aux plis de la melahfa. Un charme hostile à notre sagesse rit dans le tintement des anneaux barbares. Ils ont repris ma tante. Ils ont été pour elle comme un poison annihilant le pouvoir de résistance. En laissant Mouni dans l’enveloppement perpétuel du charme, j’ai peur d’un subtil obstacle qui raillera mon effort, l’obligera à se faire plus long et plus énergique.
— Non, dit le Mahdi. Suivant le degré d’assimilation dont est susceptible le cerveau de Mouni, le charme perdra son efficacité. En supprimant ce charme si tôt, vous-même, vous risquez de provoquer un regret. Et si votre élève doit être un exemple qui attire d’autres sujets, il vaut mieux que sa civilisation revête au dehors la tunique primitive, que sa pensée française garde une âme musulmane. L’apprivoisement de ses sœurs sera plus facile.
— Très juste, approuve l’Amie. Et quant à votre tante, Noura, espérons que le charme n’a pas opéré profondément. Si oui, laissez agir la destinée.
Noura secouait sa tête volontaire.
— Je ne suis pas assez fataliste.
— Vous le deviendrez en présence de toute la vie. Vous apprendrez qu’il est fou de lutter ou de s’exaspérer contre elle.
— Je ne m’exaspèrerai pas, mais je la combattrai dans ses injustices et ses anomalies.
Le sculpteur redressa sa haute taille, et les yeux s’attachaient avec douceur sur son visage pensif aux tempes mates où les cheveux grisonnaient. Ses mains s’appuyèrent au dossier du divan arabe ; sous la jeune moustache, les lèvres fines s’entr’ouvrirent pour des paroles graves.
— La vie attaque, blesse, se dérobe ou riposte plus violemment quand nous voulons une revanche. Rien ne sert de guerroyer incessamment contre elle. Se soumettre est mieux. Elle récompense l’acceptation par le repos. Maurice Barrès pense qu’après avoir beaucoup attendu de la vie, de cette brève « promenade qu’il nous est donné d’accomplir à travers la réalité », on voit bien qu’il faudra mourir sans avoir rien possédé que la suite des chants qu’elle suscite dans nos cœurs. — Et n’est-ce point assez de ces chants ? N’est-ce point assez de l’errance et du soleil ?… L’humanité rebelle est discordante. La nature soumise est harmonieuse. C’est une leçon.
Le Mahdi répliqua :
— Pour profiter de la leçon, il faut se rapprocher de la nature, devenir simple. Peu sont disposés à cela. Les derniers simples, de simplicité naturelle, tendent à devenir compliqués.
— Et voilà votre ouvrage, ô leurs éducateurs.
— Claude Hervis, s’écria Noura, comment n’avez-vous pas encore renoncé à toute notre science, nos coutumes, nos vêtements laids, pour la précieuse ignorance, la peau d’ours des primitifs ou le bernous bédouin ?
— Il y a de l’horreur et de la lâcheté dans mon cas. Je redoute et je hais le cancan étonné des oies, le jappement des roquets humains. Cependant, je m’étudie à perdre la faculté de les entendre et je vous convie dans la tente ou sous les palmiers de mon avenir.
— Qui sait s’il restera des tentes et des palmiers ! — Noura ajouta en arabe : — Mouni, mon petit enfant, tu peux reprendre et garder la melahfa.
— C’est à cause de toi !…
Les yeux de Mouni brillèrent sur le sculpteur. Elle s’avança, lui baisa les mains et joua à les envelopper de ses cheveux.

L’au-revoir de Noura Le Gall à ses amis fut une profession de foi.
— Je ne vais pas créer une école, mais ouvrir un calme et laborieux appartement où les enfants d’une autre race s’appliqueront à des choses diverses, concourant à un même but : l’acceptation de parcelles successives de notre civilisation pour, sans heurt, la substituer à celle qui a diminué jusqu’à être une ruine informe.
« J’indiquerai et j’aplanirai le chemin par où les débris viendront se juxtaposer aux édifices de notre savoir, se confondre avec leurs matériaux.
« Je vais prêcher d’exemple, n’insinuer dans la confiance et l’affection, mettre une empreinte sur les âmes jeunes et graduer, selon leur tempérament, les idées qu’elles devront s’assimiler. Je ne veux pas le régime de l’école, mais un enseignement individuel. Au lieu du maître et des élèves, je veux une aînée près de sœurs cadettes. Je supprime la discipline abrutissante qui sévit sur une masse. Ce n’est point l’œuvre du maçon qu’il me faut, c’est l’œuvre du sculpteur ; car l’idéale argile de la pensée a besoin d’être modelée sous différentes formes, suivant les caractères, et c’est une erreur grossière de vouloir la mouler sur un modèle unique, répandu à plusieurs millions d’exemplaires. Cela tue la personnalité, l’initiative, et détermine l’élégante nullité ou le fatal dégoût.
« J’entrerai sans effraction au cœur du foyer, dont l’impénétrabilité empêche toute fusion en ne laissant filtrer qu’à peine, et en la dénaturant, la lumière étrangère à son clair-obscur.
« Je changerai les idoles du sanctuaire et je vous invite à venir un jour saluer la victoire de ses nouveaux dieux. »
— Avez-vous en soulevant le voile, trouvé le mot de l’énigme qu’il cache ?
— Le mot est au-delà du visage obstiné.
La salle claire et bleue ouverte sur la terrasse. Et, dispersées au hasard des petites tables, des coussins ou des banquettes basses suivant leurs occupations, des fillettes arabes.
Voici Mimi, dont l’intelligence est un fruit doux et transparent ; Mimi aux yeux verts, aux sourcils roux, aux joues roses.
Voilà Fafann, semblable à une grosse citadine tunisienne, et, près d’elle, Helhala qui a le nom de la lavande sauvage, la mine d’un écureuil sous la broussaille de ses cheveux teints, échappés d’un petit hennin violet enturbanné d’un rouge foulard.
Cette autre au long visage de cire avec le bleu réseau des veines, c’est Djénèt. Puis, Sadïa à l’honnête figure, aux mouvements paresseux ; Louïz, fille d’un riche colporteur assassiné en Europe ; Fatma, Leïla, R’naïfa, Yamine, les toutes petites ; et Merïem la taciturne au front étroit : et Zorah la douce ; et Richa dont la légèreté porte un nom de plume[16], Richa qui fut un enfant abandonné au seuil d’une koubba et qu’un vieux couple méditatif et heureux adopta. Zoubéïda la blonde est son amie.
[16] Le mot « richa » désigne une plume.
Il manque Borneïa qui a des lèvres épaisses et des prunelles dormantes.
En la présence de ces enfants, qui ont de sept à quatorze années, se résume le premier effort de Noura Le Gall.
Helhala, Merïem et Fafann ont quitté l’école communale pour venir chez la jeune Mâlema.
Fafann disait :
— La salle d’école était noire. Elle sentait le tombeau. On s’asseyait sur des bancs étroits et, souvent, nous cousions des morceaux de chiffon, bons à rien. Nous n’avons pas besoin de savoir coudre comme pour les choses françaises. On aurait mieux fait de nous apprendre à broder des voiles, comme les femmes de Constantine. Maintenant, ma grand-mère m’a appris. Que me font les livres ? Laissez-moi broder des voiles ; les voiles sont beaux !
Et Noura devait se borner à lui montrer le jeu de broderies nouvelles, à développer son goût en lui indiquant comment se compose ou se transforme un dessin.
Helhala ne se rappelait que les punitions encourues de la part des maîtresses qui ne savaient pas parler l’arabe, alors qu’elle, Helhala, ignorait le français.
Mimi la benjamine s’écriait :
— Il n’y a que les enfants sales des gens pauvres qui sont dans l’école ; moi je n’irai jamais !
Richa et Zoubeïda avaient pris leur certificat d’études, brillamment, grâce à cet esprit d’à-propos et cette imperturbable mémoire momentanée qui tient lieu de compréhension à la généralité des enfants de leur race. Aujourd’hui, elles ne se souvenaient de rien. Un rideau était retombé sur leur cerveau du moment où elles avaient quitté l’école pour prendre le voile.
Quant à Djénèt, le visage pâle, elle possédait une mémoire spéciale et passait pour savante parmi ses compagnes. D’avoir suivi quelques leçons de religieuses dans un faubourg, elle conservait des souvenirs d’histoire comme les petits enfants conservent des réminiscences de Peau-d’Ane. Mais la façon dont elle les répétait était celle d’un conteur d’Orient, imaginatif et invraisemblable.
Avant la leçon, une sous-maîtresse installait les enfants, une Israélite très jeune et active que Noura avait choisie pour sa connaissance du parler arabe.
Ce matin-là, Fafann commence la broderie d’un bonnet de bain. Zoubeïda et Sadïa se préparent à reproduire et à enjoliver un dessin d’arabesques que Merïem et Helhala enlumineront. Djénèt, Louïz et Richa étudient un récit à la morale évidente et dont elles devront rendre compte à leur Mâlema. Les trois têtes semblent également absorbées, mais les yeux ne voient rien de la lecture, parce que tout bas Djénèt conte la bravoure des grands-pères des Français, qui s’habillaient avec la peau des ours pour épouvanter les taureaux enragés, et la fabuleuse aventure de Jeanne d’Arc, une géante dont les serviteurs étaient rois et qui avait changé en armée de démons et d’hommes de fer un troupeau de moutons qu’elle conduisait…
Les plus petites et Zorah la douce s’appliquent à des pages d’écriture tandis que l’attention de Mimi suit le doigt de Sarah la sous-maîtresse et les paroles qui l’aident à démêler les mystères de l’alphabet.
— La lettre qui ressemble à une échelle s’appelle H, explique Sarah, et celle qui a la forme du croissant se nomme C.
Peut-être la création et l’organisation de Noura ne sont-elles pas l’idéal de l’enseignement tel que l’entend le progrès. Mais la jeune fille a vite constaté que c’était la seule manière qui ne rebuterait aucun des êtres de caprice et de libre fantaisie qu’elle veut capter.
Il ne s’agit pas d’aller, par doubles étapes à la conquête de brevets qui ne prouvent rien. Le but est meilleur qui consiste à préparer ces enfants à une vie nouvelle et plus large, lentement, en prenant le temps nécessaire.
Noura conçoit plusieurs sentiers dans la plaine, au flanc des montagnes, tous aboutissant à une belle cité. De ceux qui cheminent par ces sentiers, quelques-uns ont le pas vif et léger ; d’autres sont paresseux, trébuchent souvent, mais toutes leurs caravanes doivent entrer dans la cité.
Une saillie de Helhala au visage d’écureuil fait se dresser les têtes et rire les jeunes bouches.
— Ya Sidna Mohammed ![17] encore un jour qui me noircit ! Mes bras sont déjà comme la nuit qui commence. J’étais si blanche quand je tétais ma mère ; j’étais blanche de lait. Maintenant un nègre a pleuré sur moi ou bien c’est le café que je bois. Ya sidna Mohammed ! je ne boirai plus de café.
[17] O notre seigneur Mohammed.
Et la coquette hypocrite lève ses bras très blancs de petite rousse, qui font la jalousie de ses compagnes.
Fafann pose sa broderie pour consulter un morceau d’étamine, vieille et fragile, où sont des modèles de toutes les broderies connues en Orient. Un hasard fit que Noura le découvrit parmi des hardes, chez une femme indigène qui ignorait la valeur de ce chiffon vénérable. Des soies ont conservé l’éclat de leurs couleurs. Elles se serrent brunes et bleues, pour former le dessin qui s’appelle « la citerne de la maison ». Elles s’élargissent en pétales pour ceux qui ont nom « la ceinture du roi » et « le jardin des roses ». D’autres sont « le vol des papillons » ou soulignent des palmiers roides, des mains fatidiques, des cyprès élancés comme des langues de flammes jaunes, vertes ou rouges. Des fils légers forment une sorte de grecque « le dessin de Tunis » pour les brodeuses. Et cette guenille est tout imprégnée des parfums d’un ancien harem…
Noura entra avec Mouni.
Mouni était plus jolie de toute la supériorité qu’exprimait son attitude, supériorité de rang sur ces filles de petite bourgeoisie, et supériorité de science, car il n’était pas une heure où Noura ne fût penchée avec amour sur la culture de sa fleur favorite. Le petit genêt gardait sa parure primitive, les draperies, les anneaux tintants, mais son jardinier se flattait déjà d’avoir changé le goût de son parfum.
Le parler français de Mouni était comme une chanson au rythme parfait. L’ardeur de son sang ne vibrait que dans les mots arabes. Même on eût dit que, finement, au contact de la modération franque, qui dénonçait comme laids et répréhensibles le pur instinct animal, la fougue naturelle d’un tempérament passionné, on eût dit qu’elle dissimulait cette ardeur et les bondissements d’une nature héritée de ses aïeules, les vagabondes et les belliqueuses aux déserts du Hedjaz.
Elle aimait Noura, mais son affection, si tendre qu’elle fût, ne comportait pas de dévouement.
Elle s’écriait parfois, sous une caresse :
— O Noura, ta maison est bonne, ta bouche et ton cœur sont bons. Je suis dans le bonheur. Je t’aime plus que mon âme, ô Noura !
Et pour lui épargner une douleur mortelle, elle n’aurait pas sacrifié ses cheveux. De cela, en dépit de sa sensibilité aiguë, de son pressentiment raffiné, de sa clairvoyance rare, l’éducatrice ne s’apercevait point. A l’égard de la petite créature dont elle faisait son enfant, la tendresse absolue annihilait les facultés d’observation de Noura. Elle ne voyait que la câline souplesse, les yeux purs et le visage heureux de Mouni. La douceur de la voix qui répondait à la sienne suffisait à la persuader des perfections de sa première conquête.
La Mâlema sourit à Sarah et va de l’une à l’autre des élèves. Elle appesantit sa main ferme sur la tête folle de Helhala, redresse l’aiguille de Fafann, clos d’une réprimande les lèvres de Djénèt et vient au secours du crayon de Sadïa.
Puis, prenant un exemplaire du Koran et puisant à la fois dans son esprit et dans des passages du Livre, elle parle pour les âmes attentives. Elle s’exprime en Arabe, résume en Français et interroge dans les deux langues. C’est l’une de ces leçons-causeries durant lesquelles, à la moindre question inquiète révélant quelque obscurité de compréhension, elle s’attarde en explications logiques pouvant pénétrer les pensées enfantines.
Dans les paroles égrenées, la vérité des sourates se mêle à l’expression personnelle de Noura.
« … C’est Dieu qui nous a donné la terre pour premier lit, le ciel pour toiture. Il a fait descendre la pluie des cieux pour produire les fruits dont nous nous nourrissons. Il a mis en nous un cœur, afin que nous aimions les autres créatures et un cerveau qui doit posséder la science ordonnée aux hommes, pour la joie et l’embellissement de la vie. La science est un flambeau qui brille dans l’ombre de la route et de la maison.
— Les ignorants sont-ils toujours sans lumière, ô Mâlema ? interroge Djénèt.
— Ils sont comme des aveugles dont les yeux sont ouverts et ne voient pas. Ils sont comme Zidann le pauvre qui a de grandes prunelles noires et tombe dans la rivière parce qu’il ne peut distinguer la rivière du bon chemin. Ils font le mal parce qu’ils ne savent pas que c’est mal. Ils méconnaissent le bien. Ils se croient de bons musulmans dignes des récompenses d’Allah et ils ne savent même pas toute la loi d’Allah.
— Ils font donc des choses défendues ?
— Certes.
— Et tous les enfants du péché sont punis ?
— Ils sont punis pour avoir négligé de connaître les bienfaits de Dieu et n’avoir pas voulu s’instruire quand ils le pouvaient. Vous qui apprenez à discerner le mal du bien, soyez reconnaissantes à cause de l’intelligence que vous avez reçue. Que ferez-vous en échange ?
— Je donnerais des fêtes pour les pauvres au tombeau de Sidi Ben Drahm ; mais je ne suis pas assez riche, dit Helhala.
— Point n’est besoin d’être riche, petite fille. Vous obéirez à toute la sagesse et cela suffira. Vous pratiquerez la vérité ; vous haïrez le mensonge. Celle qui commet une faute, grave ou légère, est une enfant du péché. Mais pourquoi se tairait-elle et cacherait-elle sa faute ? Dieu la voit et le visage de la coupable l’accuse. Veut-elle garder la faute comme une éternelle brûlure à son front et dans sa mémoire ? Elle avouera ; — le courage et la sincérité rachètent tout. Elle se repentira ; il lui sera pardonné ; elle retrouvera le bonheur.
« Mes petites filles, appliquez-vous à devenir des femmes de bien pour mériter et augmenter la tendresse de vos pères, le respect et le sûr amour de vos maris, la vénération et l’obéissance de vos fils. Devant une femme de bien, les vieillards s’inclinent, le Prophète sourit, les jeunes hommes disent : — « Hamed-ou-Allah[18] si nos épouses et nos filles lui ressemblent. » — La femme de bien est pure d’hypocrisie, de mauvais penchants, de haine, de colère et de médisance. Elle ne dit ni ne fait rien qui ne puisse être révélé. Il n’en résulte jamais pour elle la rougeur de la honte et le mépris des gens honnêtes. Mais toutes ses actions et ses paroles doivent concourir à la paix de son foyer et à sa bonne renommée.
[18] Louange à Dieu.
« Soyez persévérantes dans le travail, patientes dans le chagrin, humbles et généreuses dans l’abondance, afin que le pauvre et le malade se réjouissent par vous. Si la paresse se mêle à l’écheveau de la broderie, au dessin du crayon, aux signes de la plume, la paresse qui a le visage stupide et l’impatience à la bouche grimaçante, nous les chasserons pour ne pas devenir pareilles à elles.
« Surtout, vous connaîtrez l’obéissance aux bonnes paroles. Mes petites filles, que l’obéissance vous soit sacrée. Il est écrit que si vous refusez d’obéir, Dieu vous punira en vous faisant la guerre. Au jour de la résurrection, heureux ceux qui auront obéi !
« Saluez et considérez la vieillesse avec respect. Saluez et considérez tous ceux qui sont plus âgés que vous avec déférence.
« Ne dites pas : — « Nous nous inclinons et nous obéissons devant ceux-là ; mais derrière eux nous aurons le rire méchant, le cœur rebelle. » — Dieu sait et juge ; il voit et entend tout.
« Vous donc, grandissez dans la sagesse qui est une beauté, pour devenir de ces femmes nobles, pures et fidèles qui sont bénies. »

La leçon finie, Noura demandait :
— Pourquoi Borneïa n’est-elle pas venue ?
— Doudouh doit le savoir, répond Mouni. Je l’ai vue parler à la mère de Borneïa.
Du haut de l’escalier blanc, elle se penche sur la cour intérieure, appelant la servante.
— O Mâlema, la mère de Borneïa ne veut plus t’envoyer sa fille. Elle raconte que tes leçons avec le Koran cachent ton désir qui est de convertir les musulmanes à ta religion.
Noura descend l’escalier de faïences vertes, traverse la cour dallée de blanc et noir où s’élargit l’ombre d’une vigne et d’un figuier. Elle franchit l’antichambre obscure où d’épaisses nattes de drinnu sont fraîches aux pieds nus. La voici hors de sa maison mauresque, dans les rues capricieuses de la ville arabe.
Au fond d’une impasse, elle pousse une porte vermoulue.
— Borneïa ! Ya Borneïa !
— Qui es-tu ? gronde une voix mécontente.
— La Mâlema.
— Entre.
Noura est près d’une vieille femme qui lave du linge dans le plat de bois où l’on pétrit la galette et roule le kouskous. La mère de Borneïa se montre, sa fille accrochée à sa gandourah.
— Pourquoi n’est-elle pas venue ce matin ? questionne sévèrement Noura.
— Elle ne voulait pas. Elle a peur de toi.
— Comment n’a-t-elle pas eu peur le premier jour ?
— Elle ira demain.
Noura fixe la mère et dit :
— Borneïa, t’ai-je jamais parlé de ma religion ?
L’enfant secoue négativement la tête. La mère semble ne pas comprendre, bien qu’elle saisisse parfaitement l’allusion.
— Je ne permets point qu’on manque ma leçon suivant son caprice, reprend la Mâlema. Tu sais qu’à moins d’une raison grave on est privé de récompense. En voulant s’instruire, Borneïa m’a fait des promesses d’obéissance et d’assiduité ; les miennes étaient de l’aimer et de la conduire vers le bien. Je les ai tenues ; qu’elle accomplisse les siennes ou je cesserai de la connaître.
— Tu as raison, dit la mère subitement conquise par cette fermeté. Pardonne-lui.
Le lendemain, Borneïa vint à la leçon avec un cadeau de galettes chaudes et une exagération de caresses pour sa maîtresse. Mais les jours suivants on ne la revit plus…
A la faveur de ce petit événement, Noura revécut ses premiers combats et quelques instables victoires.
Les brebis de son troupeau avaient été gagnées une à une, grâce à un tact infini. Il avait fallu s’insinuer dans les familles dont la plupart défendaient jalousement leur intimité. Mais Mouni avait été un heureux prétexte, puis la présence de Lella Fatime revenue du Djebel-Amour. Alors l’accueil s’était fait sans défiance, d’abord par un instinct de race, plus tard par sympathie. Enfin, Noura avait su se faire aimer autant que possible, en aimant beaucoup, sans mièvrerie, en ne dérogeant jamais à la droiture et à la clarté de sa logique.
Cependant, le grand nombre des enfants ne venait à elle que pour obtenir les menus présents dont la Mâlema récompensait leur zèle et leur exactitude. Plusieurs voulaient apprendre par un esprit d’orgueil et d’ambition, pour dominer l’ignorance des autres ; mais ce sentiment même ne persévérait pas et celles qui le conservaient assez longtemps, dès qu’elles avaient atteint une petite moyenne, demeuraient stationnaires, invinciblement aheurtées, ne souhaitant pas acquérir davantage…
Si la Mâlema avait pu donner de l’argent, elle aurait provoqué de nouveaux élans, mais éphémères aussi. Elle comptait quatre exceptions ; Helhala, d’intelligence vive sous sa frivolité, Djénèt, Mouni et une adorable fille de seize ans, Oureïda que les parents empêchaient de suivre les leçons et qu’elle visitait fréquemment. Grâce à ces exceptions, Noura augurait superbement de l’avenir et consolait ses déceptions.
Elle s’attachait à laisser absorber toute sa vie par son troupeau, tous les chers visages dont elle déchirait lentement le voile et qu’elle voyait s’éclairer par son labeur. L’Islam parmi lequel elle évoluait ne la comprenait pas toujours, mais approuvait hautement, sa bonté, son esprit et la pureté de sa vie. C’était beaucoup.
Comme Noura passait devant la porte d’Aziza Dherif, sa voisine, elle la vit s’ouvrir pour une m’lahïa bleu foncé, — cette cotonnade qui est le haïk des femmes ordinaires. La m’lahïa devait envelopper une géante dont la main musculeuse et très blanche, aux doigts peints referma le battant.
Noura poussa la porte à son tour et pénétra dans la cour intérieure. Elle vit la géante aux prises avec Aziza Dherif, Sisann sa fille, et Fatma, une jeune divorcée qui habitait avec elles. Les trois femmes multipliaient les caresses et les agaceries. La m’lahïa tomba laissant voir la somptueuse tunique et les joyaux tapageurs d’une prostituée. Dans la géante, Noura reconnut Sadek, un eunuque familier des logis arabes. On le disait de mœurs infâmes, et les convenances orientales acceptaient sa présence dans la maison des gens de bien comme dans celle d’Aziza Dherif, la digne et la vertueuse.
Sisann et Fatma complimentaient le personnage sur sa parure féminine. Elles se mirent à chanter et il mima la danse des Naïlat, mousmés d’Afrique, courtisanes du désert et des Ziban.
Aziza Dherif accueillait Noura affectueusement. Elle lui présentait une femme que la jeune fille n’avait pas aperçue d’abord, une femme de bonne famille, séduisante en son sourire très doux, en son beau regard intelligent. C’était une sœur de Sliman le spahi qui avait été l’époux d’Isabelle Eberhardt, de Si Mahmoud Saâdi, meddah roumi du Sahara.
La voix du meddah s’était tue. Plus ne galopait son libre cheval dans les sables d’El-Oued la fanatique, aux confins des Chotts ou par la hamada pierreuse, écrasée de soleil, et sur les pistes brûlantes du Figuig. Isabelle était morte, roulée parmi les cailloux du torrent d’Aïn-Sefra.
En apprenant la catastrophe, Mouni avait frappé des mains, joyeuse et vindicative à cause de sa méprise d’enfant. Puis, tendrement triste et pieuse, elle avait jeté vers l’horizon le baiser grave qu’on donne aux tombes musulmanes, un baiser à cause de Si Mahmoud qui aurait pu n’être vraiment que le petit cavalier imberbe qu’elle avait désiré de son premier désir.
La sœur de Sliman parla d’Isabelle.
— Son nom, chez nous était Merïem. Son cheval s’appelait Souf. Elle était savante et de bonne volonté, mais ne savait rien du travail des femmes et préférait bêcher un champ que préparer la nourriture. Voici la bague de mariage que mon frère Sliman lui acheta.
Elle montrait à son doigt un rubis minuscule serti de petites perles.
Et Sliman était mort aussi, récemment, chez sa sœur dont le visage labouré d’égratignures, la gandourah noire, le foulard sombre ajusté comme un béguin de religieuse attestaient le deuil.
Noura conta l’histoire de Borneïa.
Aziza Dherif expliqua :
— On a tort de douter de toi ; mais il faut comprendre. On a peur de voir les enfants devenir tout à fait Français ou un peu chrétiens. Les souris sont tranquilles, elles ne craignent pas ta présence puisque tu as dit : — « Je suis votre amie. » — Mais une planche craque ; elles croient voir le chat derrière toi ; elles rentrent dans leurs trous : tu ne les revois plus.
Elles causèrent encore, à l’écart des rires et des déhanchements de Sadek.
— Tu sais que Fatma est restée quinze jours chez son mari, fit Aziza.
Noura s’étonnait, sachant l’aventure de Fatma. — Citadine, mariée à un homme des champs, quand celui-ci eut la prétention de mettre sous son toit deux co-épouses, elle déclara simplement qu’un fellah n’était qu’un taureau sauvage et qu’elle ne consentirait pas à la polygamie que les gens des villes commençaient à ne plus connaître.
Et Noura avait pensé :
— Sa jeune morale, inconsciemment évoluée, diffère de celle de ses philosophes grand’mères qui disaient : — « Pourquoi celle qui eut son temps d’amour avec son mari ou ses amants se courroucerait-elle de ce que son temps est passé pour eux et que le temps d’une autre est venu ? Elle ne répéterait pas le geste de cette vieille épouse heureuse qui, choisissant pour son propre époux la plus belle jeune fille de la cité, affirmait avec amour : — « Il est le meilleur ; elle est la plus belle ; elle ne devait appartenir qu’à lui. » —
Fatma mélancolique énonçait :
— Tous les hommes sont mauvais.
— Voici, songeait alors Noura, ces citadines commencent vraiment à se rapprocher de notre Europe. Leur mentalité s’avive. Elles sont capables d’éprouver un désenchantement. Il y a perfectionnement du moment que la délicatesse est froissée, le cœur atteint par une déception.
Mais les paroles d’Aziza Dherif renversent l’échafaudage des subtiles déductions. Elles surprennent la jeune fille. Fatma est allée vivre quinze jours chez son mari, pourquoi ? A-t-il répudié ses autres femmes et veut-il se remarier avec la première ?
Elle écoute Aziza dont l’accent fait entendre que toutes les femmes en somme peuvent partager les sentiments de Fatma.
— Maintenant que la loi l’a rendue maîtresse de son corps en supprimant les droits de son mari, Fatma trouve agréable l’amour de ce mari. C’est parce qu’elle le choisit quand il lui plaît, et c’est parce que cela met en fureur les deux épouses légitimes, témoins des prédilections de leur maître pour l’amoureuse libre, qui part ou revient à sa fantaisie.

Les leçons suivies de Noura n’avaient lieu que le matin. L’après-midi, les enfants étaient libres de venir ou de rester chez leurs parents suivant leurs goûts et leurs occupations. Parfois, les mères les accompagnaient. La maison de la Mâlema devenait un lieu de réunion.
Noura disait en arabe des fables de La Fontaine que les petites filles répétaient avec Mouni. Ou bien Lella Fatime étant au piano, Noura entraînait ses ouailles en chantant une ronde populaire du pays français, et les petites voix gazouillaient :
La mélodie facile apprivoisait les oreilles à d’autres sons que ceux des sauvages tympanons.
Un après-midi, la mère adoptive de Richa amena une nouvelle visiteuse.
— C’est ma sœur de Constantine. Son nom est Lella Guemara.
— Tu es la bienvenue dans mon cœur, prononça Noura avec la gravité islamique.
Elle baisait Lella Guemara de trois baisers sur la bouche.
Madame Le Gall survint. La mère de Richa s’écria :
— O Lella Fatime, voici ma sœur Guemara qui est de race noble et qui a la « connaissance des Ecritures » comme un taleb.
Avant la naissance de Guemara, sa mère, veuve et riche, épouse un prince réfugié à Constantine. Guemara était l’enfant de cette union et, pour ne point déroger en la maison de son père, avait épousé un cousin, noble aussi.
Elle laissa tomber sa ferachïa, le haïk de souple lainage blanc qui enveloppe les femmes de qualité, comme la m’lahïa bleue enveloppe les femmes de moindre condition. Elle apparut vêtue de velours violet sur quoi luisaient les bijoux que cisèlent les orfèvres juifs de Constantine. Elle s’incarnait dans une évocation d’un autre âge. Sa figure souveraine était celle d’une impératrice de Byzance. Ses mouvements avaient une ampleur orgueilleuse. Elle s’assit sur les coussins d’un divan très bas. Ses yeux calmes approuvaient les choses orientales qui se joignaient à l’ameublement confortable de la pièce ; les nattes fines, les tentures tissées par des mains bédouines, les aiguières de cuivre, les satins filigranés, les tables basses incrustées de nacre et les grandes amphores kabyles, inspirées de celles de Rhodes ou de Cnide, tandis que des poteries tunisiennes perpétuent la tradition des potiers puniques.
Elle sourit à Noura.
— Ta science et ta beauté sont deux sœurs jumelles.
— Ta beauté est plus grande et ton savoir égale le mien sans doute, répond la jeune fille.
— J’ai étudié sur la planche peinte des tolba[19] et je me souviens de ce que beaucoup ont oublié.
[19] Pluriel de taleb.
La mémoire de Noura confrontait Lella Guemara avec d’autres figures, des figures d’héroïnes anciennes.
La visiteuse parlait avec la calme autorité de ceux qu’on écoute. Elle dit la noble austérité de sa famille constantinoise et comment il avait fallu le mariage de Richa, pour qu’elle pût venir accompagnée de son mari et d’une servante.
Le mariage de Richa, la « petite plume !… »
— Oui, dit la mère adoptive, nous voici pour te l’apprendre. Richa épouse Saïd ben Hamzi.
— Ah ! fait la Mâlema, je ne la verrai plus.
Elle savait la sévérité des coutumes dans l’aristocratique famille des Hamzi ; et que les femmes y naissaient et y mouraient sans avoir franchi le seuil, excepté pour aller au bain, en voiture fermée, glaces dépolies, voilées de doubles haïks. Et ce jour-là le hammam était loué pour elles seules et le personnel composé de leurs domestiques. Même elles n’assistaient à aucune fête féminine dans les koubbas sacrées. Mais jamais elles ne se plaignaient de l’absolue réclusion, la trouvant digne de leur rang. Orgueilleuses, elles défendaient la vieille demeure contre la visite des Roumïas.
— Je ne la reverrai plus… Richa est jeune pour se marier.
— Saïd aussi est jeune et sa mère est mon amie.
Noura appela la « petite plume ».
— Longue et heureuse vie sur toi, aïni[20]. Prends mon présent.
[20] « Mes yeux », terme de tendresse.
Elle mit au bras de la fiancée de treize ans l’anneau d’or qui cerclait le sien.
— Tu ne connais pas celui qui te veut pour femme ?
— C’est défendu.
Mais les yeux de la « petite plume » pétillaient malicieusement. Les moucharabiehs ne sont pas si hermétiquement clos qu’on ne puisse voir à travers. Les voiles ne sont pas si épais qu’on ne puisse, entre les fils de la trame, considérer le visage du jeune homme qui passe.
— Va jouer, Richa, et tâche plus tard, de ne pas oublier tout ce que je t’ai appris.
— Dieu lui accorde un bien pareil au mien ! s’écrie la mère adoptive ; — cinquante années de vie douce avec le même époux !
Lella Guemara reprit la parole.
— Je sais ton œuvre et que tu travailles pour le bien, dans ta pensée, ô Mâlema. La science est bonne ; c’est par la science que je règne dans ma maison ; mais c’est une science selon l’Islam.
— La suprématie sera plus grande encore quand au savoir islamique s’unira la connaissance des choses d’Europe. Les musulmanes de demain ne seront plus des esclaves, des humiliées ou des endormies derrière les murailles et les lourdes portes. Elles auront le droit d’élever la voix pour exprimer leur volonté, toutes, sans exception.
Le sourire de Lella Guemara se fit mince et froid. Sous la politesse exquise, on sentit sourdre l’hostilité.
Elle prononça une phrase du Koran :
— « Le salut de la femme est dans l’humilité aux pieds de son mari. »
— Tu domines le tien, — je le devine. Pourquoi ?
— C’était écrit.
— Ce sera écrit pour toutes. Toutes deviendront les égales du maître d’aujourd’hui.
Lella Fatime intervint :
— L’égalité sera plus difficile à obtenir que la supériorité.
Et Lella Guemara exprima la grande objection, la crainte latente qui faisaient adverses celles qui auraient pu aider à l’évolution morale.
— Quand nous serons toutes savantes, plus de supériorité ; nos maris et nos pères ne préféreront plus l’avis de l’une à l’avis de l’autre. Si mon époux a trois épouses, je serai confondue avec elles, et si pas une tête ne veut se courber la guerre sera dans la maison.
Dans sa maison sévère, elle n’était prépondérante et écoutée qu’en vertu de l’exception. Plusieurs régnaient par leur science amoureuse ; elle était des très rares qui dominaient par le savoir.
Noura répondit :
— Avant longtemps, l’égalité s’imposera comme une loi.
— La loi persuade mal, répliqua la mère de Richa. — Et son sourire se nuançait sur celui de sa sœur. — Nous avons mieux que la justice et que les lois pour obtenir ; nous avons la ruse, l’amour et la vénération de nos fils.
Lella Fatime donna son avis :
— Les bonnes mœurs françaises sont belles et sûres. Elles m’ont assuré un bonheur que la mort seule a pu finir.
— Tous les Roumis ne sont pas le colonel Le Gall.
Lella Guemara parla sentencieuse :
— Le mal est dans tous les peuples ; il est dans le monde depuis les premiers fils d’Adam. Comptez les plaies du cœur musulman et comptez les plaies du cœur chrétien. Dieu est juste ; il n’a pas blessé l’un plus que l’autre. Quel bien résultera-t-il pour nous de ressembler aux Françaises ? Sont-elles parfaites que nous cherchions à les imiter ? Ont-elles moins de péché et moins de mensonge ? Toi, Mâlema, tu pourrais être une merabta[21] si tu devenais musulmane ; tu possèdes la science et un cœur clair. Mais tes sœurs sont-elles tes pareilles ?
[21] Maraboute.
— Beaucoup. Et beaucoup sont meilleures que moi.
— Ne le crois pas ! Elles sont troupeau comme nous, bonnes et mauvaises, et nous savons leur chemin caché dans les rues sombres, les maisons où ne les attendent pas leurs époux.
— Soit. Laissons le péché. Mais, insista la petite Mâlema, il y a parmi vous des femmes de bien qui ont besoin de soleil et d’indépendance, qui souffrent du voile et du logis fermé telle une prison. Elles désirent la liberté.
La voix absolue de l’Arabe certifia :
— Elles désirent avec la bouche seulement. Elles sont comme les enfants qui veulent ce qu’ils n’ont pas, tout ce qui leur serait fatal. Mais on pense et la sagesse revient. L’anneau fut préparé pour le doigt qui le porte ; le doigt était destiné au poids et aux ciselures de l’anneau. Les bijoux arabes vont mal aux Roumïas et les bijoux des Roumïas ne sont pas beaux pour nous.
Des rires enfantins fusèrent dans la cour.
Le front de Lella Guemara devint gravement doux et sombre.
— Il se peut aussi, Mâlema, que tes discours troublent celles qui ignorent la vie et qui n’ont pas assez la conscience ou l’amour de leur race. Tes paroles leur sont pleines de ténèbres ou d’une lumière éblouissante. La science que tu veux pour elles doit être comme un mets pimenté ; la langue le trouve d’abord agréable, mais il la laisse brûlante et altérée. Cependant, s’il en est qui te suivent là où tu veux les emmener, déjà nous leur pardonnons, parce qu’elles reviendront…
— Oui, elles reviendront, dit Lella Fatime sourdement.
Et Noura à la mère de la « petite plume » :
— Maintenant, je sais que si Richa avait été la fille de ton sang, tu ne me l’aurais pas confiée.

« Une brebis de moins encore, dans mon troupeau ; Richa qui va se marier. Elle ne vient plus. Son union étant décidée, virtuellement elle appartient à sa nouvelle famille, et celle-ci, plus traditionnaliste que les parents d’adoption, entend qu’elle renonce complètement au contact de l’infidèle. La petite n’a qu’un gentil regret à mon égard ; elle est contente de devenir femme. Pour moi le regret est plus grand.
« Voilà l’écueil, Amie ; le mariage ; charmant s’il s’accomplissait entre deux êtres également évolués ; triste, dangereux peut-être quand il remet dans la vieille cage l’oiseau qui commençait à voler dans un jardin ouvert. Ce danger n’existera plus dans l’Avenir pour lequel le Présent travaille.
« La jeunesse et la beauté de ma « petite plume » me rassurent un peu sur son sort. Ce qu’elle sait est déjà suffisant pour la préserver de l’ennui et peut-être pourra-t-elle mettre une clarté dans l’ombre de la maison retardataire.
« Ce mariage est très envié dans le monde musulman. L’enfant adoptée a été choisie par la plus noble famille. Et cela ne surprend point puisque, en Islam la femme n’a besoin ni d’argent ni de naissance, mais de charme et de séduction pour espérer une union royale. Les pays de Mahomet ignorent le mélange de l’intérêt, du sot orgueil et de l’amour. Un titre de plus à leur supériorité dans l’esprit du Mahdi et de Claude Hervis.
« Où donc est-il notre Mahdi ? En Egypte ? J’ai reçu des journaux du Caire qui me paraissent avoir été soulignés par sa main. Je vous transcris les paragraphes qu’il impose à mon attention.
« Sans le relèvement moral et intellectuel des populations, le défrichement de l’Afrique n’est pas possible.
« Toutes les dépenses et tous les efforts séculaires auront été faits en pure perte. Sans la sympathie sincère des Musulmans d’Afrique, on n’a devant soi que l’anarchie et la stagnation. Ainsi, que de temps la généreuse France a perdu dans sa marche sur cette voie de paix et de liberté ! Elle n’a fait jusqu’ici que tâtonner et les Algériens sont plus ignorants que jamais.
« Supposons une population africaine reconnaissante et éclairée de la manière que permettent et son génie et ses aptitudes. La France aurait une influence salutaire immense sur l’Islam entier, au lieu de patauger dans les marais pestilentiels de l’assimilation à outrance[22].
[22] Arafate. Le Caire.
« C’est violent, n’est-ce pas ? Tenons compte de l’exagération orientale.
« Notre assimilation n’est pas un marais, mais le lac merveilleux, où doit se plonger notre conquête algérienne et d’où elle sortira semblable à nous.
« J’ai lu encore :
« Plusieurs renaissances partielles se font déjà remarquer. Les idées se purifient peu à peu. Là est la vie ! Si les petits ruisseaux se rencontrent, ils formeront un fleuve splendide et la science Islamique sera ressuscitée. »
« Le Mahdi veut faire couler l’un de ces petits ruisseaux. Mais que pensez-vous de tout cet Islam redressé, formidable dans l’immense Afrique et dans les cinq parties du monde ; car il a des adhérents partout. Ce ne sera plus la France qui le dominera, mais lui qui dominera la France et l’Europe. Les Français qui travaillent à cette résurrection jouent avec le feu ; ils se brûleront les premiers ; ils seront convertis par l’Islam renaissant comme Claude Hervis l’est par l’Islam décrépi.
« Je suis animée d’un chauvinisme trop profond pour prêter mon concours à cette renaissance. Je ne veux pas que ma France éblouie, submergée par la grande marée de l’Orient sur l’Occident, finisse comme une algue saisie par le remous des vagues ou comme un papillon tenté par la flamme. Je ne veux pas qu’on lui prenne ses fils et ses filles ; je prétends au contraire lui donner d’autres enfants.
« Certes la tâche est longue et ardue. Si je n’ai pas le temps de la finir, d’autres l’achèveront. J’aurai préparé la voie, vaincu les premières difficultés. Et les années de contact agissent peu à peu. L’Islam des villes n’est plus l’inviolé, dans la bourgeoisie surtout. Les hommes, employés d’administrations, avides de gains et de faveurs honorifiques, les fils au collège, font que des égratignures atteignent le masque impassible et séculaire incrusté dans la chair musulmane. — Cette classe moyenne est moins aheurtée aux superstitions, aux préjugés de caste et de race que la plèbe ignorante, le sang bleu orgueilleux. Celles qui résistent davantage, ce sont les femmes, en raison même de la facilité relative avec laquelle l’élément masculin accepte l’Europe. Elles se constituent les gardiennes vigilantes de la tradition au foyer.
« A l’exception de quelques portefaix Kabyles et de tirailleurs désapprouvés par leurs parents, le peuple reste intact parce que sans désir, capable d’exister en dépit des plus mauvaises, des plus absurdes conditions d’existence.
« Et l’aristocratie n’est pas atteinte parce que sans vouloir rien expliquer ni discuter, elle se mure dans sa fierté féodale. Elle juge de son devoir et considère comme une question vitale de perpétuer les choses anciennes. Elle se méfie et dissimule, évitant la moindre atteinte à l’immémoriale coutume. Si par nécessité matérielle, un de ses membres entretient quelque commerce avec les Roumis, à cause de cette concession faite au besoin d’argent pour pouvoir un peu des gestes fastueux des ancêtres, les lois d’austère observance redoublent en ce qui concerne le gynécée.
« Puis, je le vois aussi, il y a la peur très grande du « qu’en dira-t-on ». Beaucoup de mes petites enfants se troublent si je leur parle ma langue dans une réunion toute musulmane. Elles supplient : — « Tais-toi, tais-toi. Celles qui nous écoutent ne comprennent pas le français ; elles croiraient que nous disons des choses défendues et cela nous ferait tort. » — Et cette crainte est la barrière dressée contre la liberté de toute innovation, de toute atteinte aux choses admises depuis toujours. Les esprits sont imbus des règles d’une bienséance ancestrale. Le « ce qui se fait » et « ce qui ne se fait pas » sont épluchés, commentés sans répit. On reçoit un eunuque de mœurs dissolues ; on n’autorise pas sa fille à converser publiquement dans une langue étrangère. Cette forme des convenances diffère essentiellement de celle qui nous fut indiquée ; et c’est l’invisible main qui, après un mouvement confiant pour le soulever, serre plus étroitement le voile sur un visage obstiné.
« Mais j’élargirai tant la déchirure commencée que le voile tombera… »

Les portes du gynécée aveuglées d’épais haïks, et, dans l’atrium mauresque, des musiciens menant leur vacarme en l’honneur des mariés, des parents et des hôtes.
Des flambeaux de cire fondent sur les palmes et les fleurs.
Quelques élégantes et les hauts fonctionnaires de la ville, conviés à ce dernier jour des noces de Richa et de Saïd ben Hamzi, sont confinés dans le patio où fleurissent des jasmins et des orangers. Là, les lumières sont plus vives et des lanternes vénitiennes s’accrochent aux branches. Un buffet abondant étale, près des pâtisseries orientales, des confitures et des bonbons turcs, les capuchons dorés des crus mousseux.
Des invitées officielles ont pénétré dans l’atrium. Elles voudraient voir les yeux qu’on sent briller derrière le haïk des portes. Une main indiscrète soulève le rideau ; mais il est brusquement refermé et, sans formules, un gardien éloigne l’audacieuse qui n’a droit ni à l’amitié, ni à l’intimité du harem.
Dans les salles défendues, si nombreuses sont les musulmanes qu’elles s’entassent, confondant leurs brocarts et leurs parures dans une splendide débauche d’étoffes précieuses et de joyaux. Les bougies perdent leur fragile clarté parmi tant d’étincellements.
Lella Fatime est en costume indigène pour flatter ses hôtes. Noura porte une simple robe blanche et Mouni est différente de toutes les jeunes filles aux hennins pointus, de toutes les jeunes femmes coiffées de tiares assyriennes, les corps gaînés de gandourahs longues. Elle n’a qu’une tunique vert pâle et une mousseline soyeuse drapée à la manière du Sud, qui rappelle celle de la Grèce, agrafée aux épaules de fibules berbères, ceinturée d’une écharpe légère. Sous la coiffure basse aux foulards lamés d’argent, son visage doré sourit entre deux lourdes tresses brunes.
Il y a des bavardages puérils et des paroles véhémentes.
Une femme s’écrie :
— Vraiment, je me dispute avec mon mari. Je me disputerai longtemps et mon fils n’ira pas au collège comme son père le désire. Les hommes sont lâches ! Le mien veut cette chose pour flatter ses chefs. Vraiment, il les flatte pour obtenir ce qu’ils ont promis, un petit ruban comme celui que le cadhi met sur son burnous. Par Dieu ! mon fils n’ira pas avec les chrétiens pour apprendre l’ivrognerie et l’oubli de sa religion !
— Moi, avoue une autre, mon mari a tant crié et frappé que j’ai consenti, pour la paix.
Et la première dédaigneuse :
— Tu es de celles qui se laissent battre.
Une jeune fille babilla :
— Il passait sur le cheval de Bakir le M’zabi ; moi, je revenais du bain avec ma dada[23]. Elle n’a pas vu que je regardais, et j’ai su qu’il me voulait.
[23] Nourrice.
Noura intervient.
— Fille de la ruse ! Certes, c’est bien cette marchandise qu’Iblis vend le plus aux femmes. Toutes, vous êtes honnêtement voilées, mais quand un cavalier passe…
— Que dirons-nous de la ruse des chrétiennes ? riposte la malicieuse. Elles portent aussi des voiles ; mais pourquoi commettraient-elles le péché de les soulever au passage d’un amoureux ; les voiles sont transparents et les rendent plus jolies.
Et voici ce que content deux vieilles :
— Elle est divorcée. Son père l’a reprise chez lui parce que son mari la tuait avec le chagrin.
— La folle ! Tout est de sa faute. Quand même un chacal aurait dévoré son cœur elle devait appeler son mari avec une chanson. Elle devait savoir que les hommes aiment l’eau des fontaines et qu’ils haïssent celle qui coule des yeux d’une femme.
Elles se rapprochent d’une fenêtre à croisillons donnant sur le patio, écartent le rideau et regardent la foule européenne.
Noura les rejoint, fixe à son tour ses frères de race et de nom, rués à l’assaut du buffet.
— Comme les Roumis ont faim ce soir…
La petite Mâlema eut à souffrir de l’esprit mesquin, de la turpitude de certaines gens qui sont là, de ceux qui font la vie sottement orgueilleuse, déprimante et disqualifiée, pharisienne ou cyniquement hypocrite.
Dès les premières démarches de Noura, une société peu intelligente, étroite de cœur, non sans reproche mais sans scrupules en beaucoup de gestes répréhensibles, avait aiguisé bec et ongles sur la nouvelle venue. La plupart glosaient sans bien savoir pourquoi. Le reste désapprouvait et condamnait sans comprendre. Les cervelles féminines ne concevaient pas le vœu de cette créature indépendante qui n’avait pas vingt-cinq ans et vouait sa jeunesse à un apostolat imprévu. Les cerveaux masculins en mal de renommée et de jalousie l’accusaient de vouloir faire parler d’elle. D’abord, Noura les crut foncièrement méchants, puis, chez le grand nombre des deux sexes, elle constata surtout beaucoup de vanité stupide, l’absence de toute distinction naturelle et de bonne éducation. Cela fit qu’elle eut de la pitié sans rancune envers ses commentateurs. Seulement, elle défendit sa porte contre les insidieuses curiosités. Cette réserve fut blâmée, soupçonnée. Elle ne s’en soucia point, étant de ces superbes imprudentes qui joignent à la raideur des jeunes et absolues loyautés, l’indifférence pour tout ce qui n’est pas leur beau rêve, leur vibrant enthousiasme et la joie de leur effort. Elle pardonna la calomnie parce que quelques justes compréhensifs la dédommagèrent par de discrets hommages de sympathie et d’estime, et elle dédaigna la sottise.
Parmi des facies équivoques, ce soir, Noura reconnaît encore le citoyen-poète Literas, un journaleux jadis journaliste. Sur l’œuvre de Noura Le Gall, il s’était permis de jouer lourdement, dans les colonnes de sa feuille absurde. A le voir de si près, la Mâlema trouvait la figure blonde, antipathique et vulgaire de ce petit homme comme prédestinée à la gifle et à la cravache qui châtient. Le citoyen-poète Literas était une sorte de vulgaire insolent et de raté fielleux.
Des propos s’échangent entre les vieilles qui connaissent la chronique scandaleuse de la cité chrétienne et musulmane et sont friandes d’aventures.
— Vois cette gazelle, ô Khoudja, ses enfants ne sont pas de la couleur de son mari.
— Et son amie, je sais où elle va pour l’argent dont le sien profite.
Une petite voix au charme inexprimable parle à Noura tandis que le geste de Mouni désigne tour à tour les Arabes et la foule du patio.
— O Noura, combien tu es rare ! Tu ne ressembles pas à ces femmes et tu ne ressembles pas à celles-là. C’est à toi que je veux ressembler, ô Noura.
La Mâlema étreint sa petite conquête ne supposant pas qu’une adorable bouche encore enfantine puisse ne pas dire toute la vérité. Un désir trouble possède Mouni ; elle voudrait ce soir le sort de Richa, et pour échapper au blâme intérieur de son éducation nouvelle, — dont elle exagère l’expression en proportion de son désir, — elle joue ingénuement avec les mots menteurs qui enlacent et dissimulent.
Les musiciens se sont éloignés. On étend un épais tapis dans l’atrium. Des flambeaux brûlent aux quatre coins. Autour, en triple et quadruple rang se placent les femmes plus scintillantes que des idoles hindoues.
La mariée va venir. En cette dernière nuit de fête, elle quitte définitivement la maison paternelle pour celle de son époux.
Il est minuit…
On entend battre la porte de fer de l’entrée, repoussée contre le flot des curieux de la rue… Et voici la stridulation suraiguë du you-you d’allégresse, l’oscillation des flambeaux dans l’antichambre, la houle bruissante, tintante et rutilante des maîtresses de la maison accueillant leur future compagne…
Deux matrones portent un fantôme blanc, si strictement plié dans les haïks qu’on ne saurait préciser sa forme. Il est posé sur le tapis. Les yous-yous se taisent.
C’est fini… La mariée est arrivée.
… O lugubre petit corps sous la pure étoffe plaquée maintenant comme un suaire, petit corps frissonnant et raide, à cause de la volupté préconnue ou à cause de la terreur !… Es-tu la morte blanche que ne pourront plus émouvoir les bonheurs juvéniles ? Es-tu celle qui sortira de ses voiles avec le triomphant visage de l’amour heureux ou celle qui dans l’impuissance et l’horreur souffrira par toute sa chair condamnée ?…
Mais quel étrange souci que le nôtre, ô petite mariée ! Si tu devines ce souci souris sous ton suaire. Souris car tu n’es pas une victime, car tu ignores les raffinements nébuleux de nos sentimentalités et tu ne seras jamais une incomprise, ô petite animale, gourmande des plaisirs de l’instinct !…
Pourtant Noura souffrait et souhaitait pleurer sur Richa…
Les femmes chantèrent, improvisant à leur fantaisie. Elles se répondaient et leur refrain avait des réminiscences de flûte bédouine au large des champs ou de tourterelles sauvages en forêt.
Par intervalles un frisson plus long agitait le corps de la mariée. Alors la mère se penchait, soulevait à peine un coin du linceul et, de bouche à oreille, parlait à la « petite plume ».
L’atmosphère se saturait de parfums. L’atrium brasillait de bijoux et de regards.
Le moment vint où l’on emporta de nouveau Richa pour la dépouiller du suaire. Durant son désespoir simulé selon le rite, on fit sa toilette de noces. On la vêtit de tous les dons du fiancé. Elle fut prestigieuse comme une légende et livrée ainsi à son destin.
Noura qui cache des larmes est revenue près de l’étroite fenêtre à croisillons. Soudain, elle gagne le patio, un cri de bienvenue et d’amitié aux lèvres en cette heure triste.
— Claude Hervis !
Et Claude Hervis abandonne ceux qui l’entouraient pour n’être plus qu’avec le regard, le geste et la voix de Noura.

Noura, Claude et Mouni bavardaient dans du soleil, sur la terrasse.
L’artiste constatait la transformation du petit genêt saharien, écoutait les réflexions pondérées et justes que Mouni mêlait à la causerie. Il finit par dire :
— Noura est un merveilleux jardinier. Je ne reconnais plus la fleur des champs d’alfa. Mais tu es trop française, aujourd’hui, Mouni, ta melahfa ne te va plus.
Mouni se leva silencieusement et descendit près de Lella Fatime.
— Vous lui avez fait de la peine, reprocha Noura.
— Croyez-vous ?… Quel âge a-t-elle ?
— Quatorze ans à peu près.
— C’est une femme pour l’Orient.
— Oui.
— Ne redoutez-vous pas qu’on vous la reprenne, pour la marier ?
— Taisez-vous ! Je ne veux pas songer à cela. Mouni m’aime et la présence de ma tante nous préserve d’un danger immédiat. Le vieux Bou-Halim n’est pas immortel. Lui disparu, les autres ne revendiqueront pas la possession de Mouni.
Des craintes vinrent à l’esprit de Claude Hervis. Il ne les formula pas, ému de la pâleur de la petite Mâlema. Il reprit le sujet qui les passionnait tous deux.
— Avez-vous vraiment commencé à modifier le sens de la vie musulmane ? Avez-vous, en soulevant le voile, trouvé le mot de l’énigme qu’il cache ?
— Le mot est au-delà du visage obstiné. C’est au-delà que je le chercherai.
— Prenez garde ! J’imagine ce visage décevant et plus décevant l’au-delà.
— Ami, quelle chose est plus décevante et périlleuse que la mer ? Et la mer a été conquise et vaincue par le sûr voyage des navires.
— Au prix de combien de naufrages ?
— Qu’importe ! Deux bateaux sombrent ; un troisième reprend la route et arrive au port. Tout s’achète. Il faut savoir payer largement. Il faut savoir mourir pour assurer une conquête et c’est lâcheté que reculer devant le prix qu’il faut y mettre, le sang ou les larmes.
Elle s’animait, la discussion exaltant l’amour de l’œuvre entreprise. La contradiction multipliait son zèle, le rendait triomphant dans une ferveur de volonté.
— Claude, mes petites sœurs musulmanes sont de beaux oiseaux en cage, des oiseaux des tropiques qui paraissent n’avoir d’abord que leurs plumes et qui ont une chanson, expression spéciale de leur pensée. Pour nous, cette pensée est lointaine à l’égal de la poésie primitive et souvent brutale des livres de Moïse. Je me rapproche de la pensée des oiseaux ; je l’admets avec indulgence pour ne la point effaroucher et la connaissant, voir comme on peut la transformer.
— Noura, Noura, vers quelle perfection conventionnelle la conduisez-vous !
— En admettant ; à la seconde génération le conventionnel sera du naturel. Nierez-vous toujours le progrès lent, mais sûr des âges après les âges ? Réfutez l’utilité du raffinement matériel, ô nomade, mais ne refusez pas à notre temps le perfectionnement moral.
Le sculpteur fut ironique. Il cita Nietzsche :
— Le grand résultat que l’humanité a obtenu jusqu’à présent, c’est que nous n’avons plus besoin d’être dans une crainte continuelle des bêtes sauvages, des barbares et de nos rêves.
Il y a un progrès dans un autre sens encore. Nous avons cette supériorité sur les Garamantes que, virtuellement, nos femmes n’appartiennent pas à nos voisins. Cependant, nous aurions des raisons d’être portés à rechercher comme eux la certitude de nos paternités. Nous avons cette supériorité sur les Angiles que notre épousée ne se prostitue pas aux passants la nuit de ses noces ; mais après, pouvons-nous affirmer qu’elle soit, à l’exemple de ces premières aïeules un modèle de sagesse et de pudeur ? Certes, il y a progrès ; nous sommes plus hypocrites.
Mais la jeune fille conseille :
— Laissez donc au mal et au bien, en toutes choses leurs parts respectives. La nature sait les équilibrer. La loi du bien est de progresser sans cesse, de tendre vers le mieux. Même si le mal grandit en proportion, le contraste est utile à la bonne cause. Il me plaît de mesurer la lumière et l’ombre et de trouver si souvent le jour plus long et plus magnifique que la nuit.
— Noura, vous êtes une grande exaltée de la poésie du devoir.
Tout le soleil d’une fin de jour flamba prodigieusement sur l’amphithéâtre des maisons arabes étagées, des verdures de la ville basse et sur les montagnes bleuies ; puis, il décrut. On sentit venir le soir rapide.
Claude Hervis reprenait en arpentant la terrasse :
— Vous comparez les Musulmanes à des oiseaux ; Je les vois mieux dans la souplesse et la beauté des chats depuis que je suis les lignes et les interlignes de vos lettres à notre amie commune. Elles sont des chats qui s’étirent dans la tiédeur des tapis, dorment ou caressent leur fourrure. Se soucient-elles du secret des rayons, des conditions de leur existence et de l’explication des choses ? Elles ne souhaitent que vivre dans leur ignorance, aussi longtemps qu’il se pourra, instinctivement heureuses du bonheur animal qui ne trompe point.
— Les chats et les oiseaux perdent l’instinct des bêtes pour acquérir l’intelligence des hommes. Seulement, ils ont des maîtres geôliers. Beaucoup d’enfants seraient mes élèves sans les pères opposés à l’instruction des filles comme les mères à celle des fils.
— Les pères sont de l’avis du Grec qui disait : — Que savait ma femme quand je l’épousai ? Elle n’avait pas quinze ans et l’on s’était surtout appliqué à tenir ses yeux et ses oreilles dans l’ignorance et à ne pas exciter sa curiosité. N’était-ce point assez qu’elle sût faire un manteau avec de la laine qu’on lui donnait ou distribuer la tâche aux fileuses ses servantes ? —
— Très bien, mais il y a une lacune chez nos Arabes. Leur éducation ne comporte pas ce souci de préserver les yeux et les oreilles des enfants.
Noura avait jugé de la perversité précoce contre quoi elle devait lutter. Fillettes, jeunes filles ou femmes considéraient leur féminité comme un bien utilisable en toute circonstance et qui rapportait de l’argent, des bijoux et du plaisir. Des bouches balbutiantes encore prononçaient des paroles scandaleuses. Un jour Helhala s’était écriée : — « Combien ta taille est mince, ô Mâlema ! Compare-la à la mienne. Certainement, j’ai un enfant. Mais qui dira le nom de son père ? Il y en a tant qui m’ont baisée ! » — Sous la réprimande de sa maîtresse elle éclatait de rire, puis demandait pardon en murmurant : — « Pourquoi me gronder ? Tu sais bien que ce n’est pas vrai. Mais j’aime les hommes, vraiment, Mâlema, je te jure que je les aime ! » —
Noura répondait à Claude :
— Je lutte contre un cynisme naïf. J’en connais qui se donnent pour un rang de perles fausses. Quand je les blâme, elles s’étonnent et les rares sages m’approuvent superficiellement.
— Elles sont nées uniquement pour l’amour charnel, rituel presque en son inconsciente impudeur, dit l’artiste. Elles vivent suivant une conception antique de la femme.
— C’est la faute du maître qui en fait des ilotes. Si le maître voulait et si elles étaient libres…
— Ce serait pire et le maître ne voudra pas.
Il répéta la raison qu’un indigène lui avait donnée : — « Nous ne pouvons pas lâcher nos femmes comme les vôtres. Elles ont trop de soleil dans le sang. Elles ne deviendront libres que le jour où nous cesserons d’aimer leur beauté et notre honneur. » —
— La cage s’ouvrira, affirme l’apôtre de l’émancipation.
— Et après ?… Vous verrez les prisonnières échappées réclamer leur prison. Plusieurs se seront perdues. Celles qui reviendront refermeront elles-mêmes la porte avec la violence de la terreur, de l’impuissance et de la déception. Elles reviendront toujours, à cause d’un mystère de sang et de race et parce que l’esprit des générations d’aïeules revendiquera la paisible réclusion dans la mentalité nouvelle des petites filles.
— Vous parlez comme Lella Guemara, fait Noura : mais cela ne saurait empêcher l’envol, au grand battement des ailes déliées. Pas une nation n’a le droit de garder la femme en éternel état d’infériorité et dans la misère du geste et de l’intelligence. Après l’Europe, l’Orient annihilera la loi de séculaire injustice qui, de la mère des hommes, fait une créature opprimée. Et pourquoi ?
Claude Hervis, avec ce premier historien que fut Moïse, trouvait l’explication dans le crime biblique, le péché de l’Eden.
Noura sourit.
— Soit. Il est temps d’absoudre la coupable. Voici l’heure de la miséricorde et du rachat ; la souffrance a tout expié.

Est-ce Mouni qui vient à table, ses cheveux casquant haut sa tête, un défi et une inquiétude dans les yeux, vêtue d’une robe blanche de Noura, une robe ajustée à sa taille par l’aiguille de Lella Fatime ?
Ainsi, avec son teint doré, elle ressemble à quelque élégante Espagnole de Paris.
— Tu es parfaite ! s’écrie la petite Mâlema.
— O fille de Noura, dit Claude Hervis, vous êtes très belle.
Mouni rayonne, son inquiétude dissipée.
— Désormais, comme Lella Fatime, je porterai tour à tour ma melahfa et des robes pareilles aux tiennes, Noura.
— C’est la réflexion de notre ami Claude qui provoqua cette décision ?
— Oh ! non, répond Mouni, ses longs cils caressant ses joues. Je le désirais depuis longtemps, seulement, je craignais d’être laide et ridicule.
Mais plus tard, à la faveur d’un instant de solitude à deux, elle saisit les mains du sculpteur, comme elle l’avait fait en Alger tandis que sa voix ardente redit :
— C’est à cause de toi.
Pensif, Claude Hervis quitte la maison.
— … Noura, Noura, ma très chère vaillante, vous souffrirez ; c’est une cruelle certitude. Le genêt saharien a gardé son premier parfum, un parfum violent. Il le dissimule sous la senteur douce empruntée aux roses que vous cultivez… Mouni peut porter sa melahfa, car elle n’a pas renié ni perdu l’âme cachée dans ses plis. Et c’est tout l’Orient féminin à l’indestructible survivance qui s’est incarné dans cette enfant, ardent et méfiant, instinctif, secret, logique et impérieux dans ses caprices.

Noura songeait près du calme sommeil de Mouni… La nuit muette l’enveloppait. Des étoiles froides tremblaient dans le ciel uni, que découpait la fenêtre ouverte. Noura songeait…
Des phrases de Claude Hervis et de Lella Guemara lui étaient une obsession. Elles la faisaient triste, tandis que le souvenir du geste de Mouni rejetant ses draperies la rendait joyeuse. Et tout cela mettait dans son esprit le bruit des pensées qui effarouchent le repos.
Noura songeait aux destinées faites d’atavisme.
Elle se penchait sur le sommeil de l’enfant qui était le fruit de son cœur et de son cerveau. Dans l’ombre elle recomposait le charmant visage. Tant de germes de bonne semence avorteraient-ils sous ce front ? Cette argile humaine, ce vase primitif modelé de nouveau avec une idéale conviction reprendrait-il invariablement sa forme barbare ?
Et les autres,… Djénèt, Helhala, Fafann ?…
En vérité, ces retours aux ténèbres ne pouvaient être, pas plus que l’obstination en la forme immuable. Tout se transforme, concourt à une autre œuvre ou se perfectionne. Les dieux s’en vont, les sanctuaires croulent. Les superstitions, les traditions, les croyances merveilleuses se dissolvent dans l’esprit humain. On érige de modernes sanctuaires ; des vérités neuves et des ferveurs récentes s’imposent.
Et si lente ou inconsciente que soit son évolution, aucune génération d’aucun peuple ne peut faillir à l’universel devoir de la marche en avant et de la marche ascendante.
Pascal considérant la suite des hommes pendant des siècles écoulés, conclut bien à un même individu qui subsiste toujours, mais apprend continuellement.
Or, d’avoir seulement effleuré la science, l’esprit perd l’intégrité de sa première expression. Ses manifestations changent. Il provoque de nouveaux gestes et de nouvelles pensées. Il y a là un fait imprescriptible.
Et les plantes qui, parmi d’autres végétations, ne luttent pas pour trouver le soleil, pour croître du côté d’où viennent l’air et la lumière, ces plantes s’atrophient. Elles deviennent blafardes et molles, leur sève endormie de la racine aux rameaux. Les belles brûlures de l’été les épargnent ; les froids de l’hiver les atteignent peu ; elles n’ont ni l’émoi ni l’admirable bondissement de l’avril. Leur somnolence est sans réveil. La fragile vigueur du moindre brin d’herbe écrase leur longue et maladive faiblesse. Elles végètent et meurent en sentant à peine qu’elles cessent de vivre.
Les formes de la vie, — en tenant compte d’une différence de quantité dans les manifestations extérieures visibles, — les formes de la vie sont les mêmes pour les êtres et pour les plantes.
Si le premier apôtre mesurait le chemin parcouru depuis la première doctrine humaine, s’il comptait le nombre des maîtres et des disciples, il aurait un éblouissement…
Ainsi Noura parle aux doutes qui l’effleurent. Ainsi, au bord d’un découragement, comme prête à se perdre, elle se ressaisit fortement et ranime le pouvoir du viatique qu’elle porte : la certitude que nul effort n’est sans cause et sans récompense équitable, sinon dans le présent, du moins dans l’avenir immesuré.

— Venez aux champs d’iris, Noura, venez avec Mouni, dit Claude Hervis.
Le sculpteur s’attardait dans la ville dont le seul charme pour lui était la présence de la petite Mâlema. Même il travaillait un peu, modelant dans l’argile blonde des figures qui ressemblaient à Noura ou à Mouni et qu’il offrait à Lella Fatime.
— Venez aux champs d’iris…
Les champs d’iris sauvages s’étendent au bord du chemin. Et ce sont des champs de lumière où se multipliaient les fleurs mauves et violettes. Leur parfum a le goût des herbes neuves issues de la terre à la première pluie d’automne.
Des bœufs paissent avec des chèvres folles et des agneaux bêlant leur plainte enfantine, troupeaux maigres de l’été aride et des pâturages mouillés.
Mouni marche silencieuse, mince, comme fragile dans son costume roumi. Depuis les noces de Richa, elle a des expressions de petit sphinx qui s’aggravent par instants d’un voluptueux frémissement des lèvres et des narines et de la pesanteur du regard qui flambe.
Devant ce visage, un souci mal défini saisissait Noura. Elle enlaçait la petite.
— Parle, Mouni, je veux toute ta pensée.
— Lis sur ma figure, répondait doucement Mouni.
Et la figure apparaissait toute pure.
Noura insistait :
— Si ton cœur rêve, confie-le moi. Je le préserverai du mauvais désir. Je l’aiderai à réaliser le beau souhait.
— N’as-tu point de souhait toi-même que tu ne vives que pour réaliser le bonheur des autres ?
— Ma petite fille, c’est là la réalisation du mien.
— Tu n’aimes personne ? — La voix tintait différant de l’accent coutumier.
— Es-tu jalouse, Mouni ? J’aime une multitude. Quant à toi, il faut que tu sois la plus heureuse.
— Je le suis.
— Te souviens-tu que tu avais peur de me suivre, là-bas, à la zmala, peur de ne pouvoir voler avec moi ? Je promis de te ramener au premier appel…
— Puisse cet appel ne jamais retentir ! Je n’obéirai pas, Noura ; je préfère la mort ! Mon destin n’appartiendra pas à un Arabe, mais à un Français dont l’amour seul vaudra mon amour.
— Nous chercherons ce Français-là, chérie.
Le chemin s’enfonce parmi des oliviers. Leurs fruits tombent sous le bâton des fellahs. Des femmes, des enfants les recueillent. Entre les racines d’un arbre est couchée une fillette chétive, aux membres raides, la jambe enveloppée de linges blancs où se voit un chiffre d’hôpital.
Noura s’arrête.
— Que lui est-il arrivé ?
C’est le récit de la mère, une grande paysanne sèche, tannée par la misère et le travail.
— Elle jouait avec d’autres enfants. Elle est tombée sous un chariot ; la roue a passé sur sa jambe. On l’a portée à l’hôpital. On m’a renvoyée. Quand elle a été seule, elle a crié. Quelqu’un l’a battue pour la faire taire. Alors elle a eu peur jusqu’à mourir et elle est devenue raide avec les dents serrées. On a vu qu’elle allait laisser « monter son âme » et on me l’a rendue.
— Porte-la au dispensaire, la doctoresse la guérira.
Mais, farouche, la femme déclare :
— Non, je n’irai pas à Sidi-Mansour. Je ne crois plus aux remèdes des chrétiens.
— Voilà le résultat de la nervosité d’une infirmière, souligne Claude Hervis.
Noura caresse l’estropiée.
— Ah ! les femmes des fellahs, murmure-t-elle. Pauvres êtres voués à la longue souffrance, à la misère sans fin. Elles sont telles les animaux qui broutent sous le soleil ou l’ouragan, travaillent, se reproduisent, tombent et crèvent.
— Ce n’est qu’une matérielle souffrance, ô Noura.
— Que fait la qualité de la souffrance si on la souffre avec toute sa faculté de sentir ?
— Il y a bien des heureuses et des soumises sans effort dans le gourbi du fellah.
— Si rares !
— Pas plus que chez nos paysannes ou la femme de nos faubourgs. Combien travaillent autant que vos Bédouines en supportant les mauvais traitements du mari et des fils, sans parler de l’inconduite des filles. Et elles n’ont pas toujours le secours de la passivité fataliste. Messieurs les assimilateurs auraient mieux fait d’entreprendre le relèvement de leurs compatriotes, même au nom d’un socialisme illusoire, avant de vouloir le réveil de l’Islam somnolent.
— Claude, nous savons que l’inégalité des sorts sera difficilement abolie de l’histoire humaine ; mais notre rôle est d’atténuer l’injustice dans toute la mesure d’un devoir fraternel.
Des petits ânes vinrent, bâtés de zenabil[24], pour emporter les olives. Plusieurs avaient le bout des oreilles coupé, dernier vestige peut-être d’une superstition des Mekkois d’avant l’Islam qui, supprimant l’extrémité des oreilles du dixième faon d’une chamelle en faisaient un animal sacré. Il se peut aussi que ce soit une dérision envers les ânes chétifs et méprisés.
[24] Pluriel de zembil, double couffin.
Le chemin qui sinuait sous les oliviers monta au flanc d’une colline. Sous le soleil, des touffes de diss exhalaient un parfum âpre et chaud. Des myrtes, broutés pendant la disette d’août et de septembre, rampaient, fleurissant tout près du sol rouge d’argile éboulée. Aux endroits brûlés par les bergers en quête de pâturages, se convulsaient des buissons de zenboudj, l’olivier sauvage, noircis.
Au sommet, c’était un vieux verger de figuiers stériles. Rome y avait laissé des débris de marbre et des chapiteaux brisés.
Le paysage était la plaine striée de labours récents entre des orges déjà vertes, des coteaux de vignes et de broussailles ; l’Atlas bleu et des montagnes proches, aux cimes frisées poudrées de lumière ; une ville étagée ; la mer mythologique, et dans le creux d’une vallée, bordé de collines pâles, l’argyrose d’un lac.
Des rivières glissaient vers la mer. Des troupeaux cheminaient sur les routes. Des fellahs allaient au marché en carrioles cahotantes, sur des ânes trottinant menu, des mules vives et jeunes entravées pour marcher l’amble, jarrets saignants, et sur des juments maigres à la croupe basse, queue traînante, pâturons fléchissants et sabots sans fers.
Au bord de la plaine deux palmiers esseulés pointaient. On devinait leurs palmes balancées par le jeu des souffles de la terre et de la mer. On devinait l’adorable bruissement qui fit dire aux rêveurs des oasis : — « Les palmes profèrent un soupir d’admiration et de louange à Dieu. »
— J’aimerais une hutte sur ce sommet, dit Claude Hervis, je regarderais la vie face à face, sans crainte. Dans cette solitude et ce silence, j’entendrais bien battre son cœur infini. Le soleil me serait plus cher que la fortune et les myrtes plus doux que les lauriers.
Mouni qui serrait des myrtes dans ses bras jette les fleurs aux mains de l’artiste…
Une chanson s’élève d’entre les oliviers féconds, au pied de la colline. Claude Hervis repousse les fleurs de Mouni.
— Vous gémissez, Noura, sur la misère de la paysanne arabe, vous vous dévouez à l’éducation des recluses musulmanes, et, si vous vouliez faire une confrontation générale de ces orientales et des Européennes prises dans toutes les classes de la société, vous verriez que les plus à plaindre ne sont pas celles vers lesquelles semble devoir aller spontanément la pitié. La femme d’Islam n’est pas une victime ; elle croira l’être quand elle possèdera notre science. Pour elle comme pour nous, ce ne sont pas les coutumes qui blessent, c’est le hasard de la vie. Même notre sœur musulmane a une douleur de moins, celle de l’esprit cultivé jusqu’au dégoût, du cœur raffiné jusqu’au désenchantement. Etant encore à l’abri d’une instruction obligatoire et perfectionnée, elle ne risque pas de devenir une déclassée, une anarchiste, une rebelle qui se brisera contre le mur des traditions long à crouler. Elle ignore l’exaspération cérébrale et l’ivresse de la volonté qui aboutissent au suicide. Or, ces choses fatales résulteront de son assimilation complète, de ce que vous appelez son perfectionnement moral.
— Vous trouvez qu’il vaudrait mieux se borner à une amélioration matérielle, riposte la petite Mâlema. Celle-ci est dépendante de celui-là. De notre raffinement il résulte sans doute une perception plus nette de la souffrance, mais mille manières d’y remédier et le privilège de jouir en proportion. Que craignez-vous donc tant ?
— Je crains que soit douloureux pour la chère Barbare l’apprentissage d’une civilisation qui est le fruit des siècles et de cerveaux innombrables. Elle développe l’individualité jusqu’à la sécheresse et à l’égoïsme. Elle veut tout expliquer et mène au raisonnement ; on discute, on se refuse à l’acceptation de ce que l’on aurait supporté naguère et la nature se venge. Notre perfectionnement s’achève par l’écrasement ou par la chute.
— Alors, selon vous ?…
— Selon moi, le vrai, le seul qui vaille la peine, c’est celui d’où jaillira la précieuse compréhension que la vie et le bonheur peuvent tenir dans l’ombre bleue du gynécée, l’ombre chaude d’une tente au désert, parmi les jardins de palmes et de cactus, sous la melahfa des femmes passives et le bernous du pâtre qui erre une flûte aux lèvres.
Un silence suit les paroles véhémentes.
Puis Noura demande :
— Mouni, que penses-tu de l’idéal de Claude ?
Le plus fin, le plus clair des sourires est aux lèvres de la petite.
— Je pense avec ta pensée, ma Noura.
Et telle est l’expression que l’artiste lui-même n’en peut douter.
O précieux petit sphinx, héritier de toute l’âme antique, des larges yeux muets et de la lèvre énigmatique des belles figures de la vieille Egypte !…

La Bent Fraîchichi, la vieille barde qui a le don d’improvisation et le don de la longue mémoire, chante l’amoureuse complainte. C’est dans la maison de Derdour le généreux.
Noura est assise dans l’auditoire près de la blonde petite épouse du fils aîné, Lalià. Il n’y a pas de très longs mois, Lalià était une jolie Française qu’assiégeaient les danseurs et les prétendants. Une de ses aïeules était Arabe. Une goutte de sang de cette aïeule suscita le dégoût anticipé de la vie d’Occident, eut raison de trois générations de sang gaulois et chrétien et donna la jeune fille à l’amour d’un cousin et à la réclusion joyeusement acceptée. Lalià était heureuse, ne regrettait rien et berçait un enfant musulman contre sa blanche poitrine.
Noura ne pouvait aimer la conversion de la jeune femme. Elle ne l’avait pas révélée à Claude Hervis sachant trop les mots qu’il eût prononcés : — « Nous ne parachèverons jamais une conquête en Islam, car c’est au tour de l’Islam de nous conquérir. »
En revanche, la Mâlema répondait à cet Islam dangereux : — « Pour une que tu m’as prise, je t’en prendrai mille ! » —
Et, dans cette maison même, la conversion de Lalià était rachetée par celle inverse d’Oureïda, sa belle-sœur, qui souhaitait ardemment posséder l’enseignement de Noura.
Oureïda…[25] la rose dont le parfum caché a la vertu d’un philtre rare, Oureïda dont chacun sait le charme et la beauté et que personne n’effleure. Heureux, trois fois heureux l’époux d’Oureïda !
[25] Ce nom de femme est celui d’une rose.
Mais Oureïda ne désire pas d’époux et c’est chose inouïe pour le monde musulman où cette belle fille demain sera considérée comme vieille. Elle redoute des mensonges dans l’amour. Sa pensée profonde se double d’étranges pressentiments. Elle a voulu connaître le français, s’exprime aussi délicatement que Mouni et voudrait apprendre davantage.
Son père s’oppose à ce désir trouvant la science mauvaise pour les femmes. En secret, Noura répond à des questions avides. Oureïda réfléchit beaucoup, avec une obstination maladive et vengeante dont ceux de sa famille ne s’aperçoivent pas. Elle tousse, et dans son regard il y a comme une certitude que sa jeunesse brève s’achèvera dans la mort avant d’avoir connu les joies et les douleurs des autres femmes.
Les charlatans arabes et les docteurs roumis consultés n’ont qu’un geste impuissant.
— « La phtisie. Rien à faire. Les deux tiers des indigènes sont tuberculeux. » — Et Oureïda murmure avec une souriante résignation :
— Je sais bien qu’un ver mange mes poumons. Quand il aura fini, je mourrai.
Elle aggrave son mal en voulant trop apprendre.
La vieille barde continuait sa chanson d’amour.
[26] Crieur public.
C’est la voix d’Oureïda qui répond suivant la chanson.
Bent Fraîchichi :
Oureïda :
Bent Fraîchichi :
Noura quitte la maison de Derdour avec la Bent Fraîchichi et Khadoudja, une humble et maigre créature dont la bonne humeur constante fait la joie des logis où elle fréquente. Si quelqu’un s’étonne de son invariable et joyeuse philosophie, elle dit :
— Je suis vieille, laide et pauvre, mais je possède un trésor, ma gaîté, Dieu soit loué.
Quant à la Bent Fraîchichi, ayant été un jour convaincue de mensonge par Noura, pour lui avoir donné un faux nom, elle avait répondu habilement :
— Tu dis qu’on m’appelle Cherifa bent Fraîchichi et tu m’accuses parce que je t’ai juré me nommer Zoubeïda. Au temps de ma jeunesse, on m’appelait « beurre frais » (Zoubeïda), tant j’étais fraîche et douce. Maintenant, mon nom est « la vieille », (Cherifa). Pardonne-moi d’avoir voulu te dire seulement le nom de ma jeunesse. C’était à cause du beau souvenir.
Brusquement, Khadoudja prit le bras de la petite Mâlema.
— O perle de mon collier, est-il vrai que ton cœur est trouble et gonflé d’amour ?
— Je ne comprends pas cela.
— C’est la Bent Fraîchichi qui parle et elle sait lire entre les hommes et les femmes. Celui qui vient chez toi sera ton amant ou ton époux. La Bent Fraîchichi voit le Roumi sur la terrasse. Elle devine son cœur.
— Vous êtes folles ! Le Roumi est mon ami…
— Folles ? C’est vous les Français qui êtes fous puisque chez vous les hommes et les femmes de bien ne se marient pas. Un jour, les enfants du diable mangeront la France !
— Ce jour-là, nous serons morts depuis longtemps, ô Khadoudja.
— Les enfants du diable s’assiéront sur vos tombeaux.
— Nous ne sentirons pas l’injure.
— Puisqu’elle peut être, vous devriez la sentir dès à présent.
Devant sa maison, la jeune fille croisait Claude Hervis qui en sortait.
— Les premiers asphodèles sont fleuris, Noura. Je viens de saluer Lella Fatime et Mouni en vous apportant des fleurs.

Noura est seule sur sa terrasse… La douceur de ce soir d’automne trop pur l’enivre d’une belle ivresse tendre, forte et sereine.
Et voici qu’elle élève des fleurs vers les étoiles, des fleurs qui reposaient au creux de ses mains…
— … de vous je fais un doux sacrifice aux pensées qui volent, aux désirs qui sont d’une heure, qu’on n’écoute pas, qui s’en vont. Le vent passe… Ah ! le désir, le beau désir, chassé !… Le vent emporte les fleurs de mon offrande vers le lieu de leur destin…
— C’est moi, je reviens, un instant, Noura… sans le vouloir… Une magie est dans l’atmosphère de ce soir. Nous paraissons agir sans causes… Mais les causes ne sont rien… pourquoi jetez-vous mes fleurs ?
Noura tourne son calme et parfait visage vers Claude Hervis. Un sourire de charme exquis entr’ouvre sa bouche volontaire. Il atténue la rude franchise de sa réponse.
— Je ne peux pas les garder, Claude. Elles sont trop éloquentes et je ne dois pas les écouter.
— Pourquoi ? redit-il.
Elle saisit la main de son ami. Son accent est plein du bondissement de son cœur féminin, de son inévitable rêve de jeunesse, de la ferveur de son apostolat et de la certitude du but. Les sentiments impérieux vibrent à travers ses mots.
— Comment cela est-il advenu, ami ? Nous nous aimions de bonne amitié à cause de notre loyauté et, soudain, nos artères battent trop fort. Où chercherons-nous le secret de notre amour ? Dans la contradiction même de nos deux rêves ? Et pourquoi l’expliquer ! Vous m’entendez, Claude, je n’use point des détours vulgaires indignes de notre pensée. Mais, tout apôtre fait à son œuvre le don absolu de son être. J’ai besoin de toutes mes énergies pour atteindre jusqu’à la dernière étape. Je me suis donnée, je n’ai pas le droit de me reprendre pour aller à vous.
Elle poursuit, puisque le sculpteur demeure muet et immobile.
— Je ne saurais point mener ces deux choses de front, en toute intégrité : mon devoir social et mon amour, — dans l’intégrité qui les fait grandes et les justifie envers et contre tout. — Ce ne sont pas là des mots d’un moment. Je pressentais cette minute et j’avais décidé de sa durée. Une femme qui, consciente de sa force et l’utilisant, s’unit à un homme dont l’esprit a des volontés différentes, subit une diminution ou une transformation.
— L’amour ne peut-il remporter cette éclatante victoire, faire librement consentir à cette diminution ou à cette transformation ?
— Non, non, ce serait sacrifier mon œuvre à votre doctrine. Plus une femme semble indépendante et pouvoir dominer, plus elle sera intimement soumise et modifiée par les moindres pensées du bien-aimé.
— Si l’amour était le devoir initial.
— Ah ! comment prétendrait-il être généreusement et loyalement obéi avant tout autre ? Il est le devoir égoïste qui réalise uniquement la joie escomptée par deux êtres et, souvent, il est impuissant pour cette réalisation même. J’obéirai à ses aînés avant de me livrer à lui. Il attendra son heure, s’il croit que son heure puisse sonner après l’accomplissement d’un plus grand devoir.
— Il y a de longs devoirs qui n’ont pas de terme.
— Il y en a…
Et après un silence :
— Vous étiez revenu…
— Pour ce que nous venons de dire, Noura.
Il part, sans qu’elle sache très bien s’il est navré sans espérance, fataliste sans regret ou dans l’attente de l’heure possible.
Et Noura se sent lasse, un peu meurtrie de cette énergie spontanée qui tout à l’heure affermit sa pensée et ses paroles, meurtrie par un voluptueux regret et par son sacrifice voulu.
Mais dans l’intimité de son être bruit une imprécise et tendre espérance.
Pourquoi mon amour trop grand s’il ne doit être qu’un instrument de ruine ? Pourquoi ma volonté si elle est vaine ?
Un matin, Fafann la brodeuse arriva à la leçon avec une jupe de cheviotte rouge, une chemisette rose et ses gros pieds chaussés de souliers jaunes.
Elle avoua avoir tenté de mettre un corset ; mais étouffée, elle avait rendu son buste à sa liberté coutumière.
— Vois, dit-elle, à Mâlema, j’ai gardé l’argent que tu me donnes pour m’acheter ces choses. Je ne m’appelle plus Fafann, mais Fifine. Je resterai toujours ainsi et j’épouserai un Roumi.
— Ta grand’mère approuve Fifine ?
— Elle est un peu aveugle, tu sais bien. Elle n’a pas vu que j’avais quitté ma gandourah. Quand elle le saura, elle criera. Cela m’est égal. Je n’ai pas d’autre famille.
Puis, ce fut le tour de Helhala qui apparut en robe de batiste, un foulard éclatant noué à la créole sur ses cheveux fous. Ce que voyant, les parents de Helhala la marièrent huit jours après.
— Certes, je ne serai pas ainsi pour mes enfants, jura l’écureuil à la Mâlema. Ils seront libres comme des petits Français.
— C’est le commencement, songeait Noura joyeuse.
De nouveaux visages peuplèrent la salle d’étude et mirent à mal la patience de la sous-maîtresse. Parmi, il y eut Aïcha, l’enfant blessée rencontrée au temps des olives. Des remèdes bédouins l’avaient guérie autant qu’il se pouvait. Elle se refusait à lire et vouait son intelligence à la couture ou à saisir les causeries de la Mâlema. Il y eut Beïa, une gamine qui parlait déjà français pour avoir vendu des figues de Barbarie aux portes du marché et bataillé avec les petits porteurs kabyles. Elle était pleine de zèle ; mais dès que la Mâlema sortait, dès que se détournait l’oreille attentive de Mademoiselle Sarah, elle contait à ses compagnes des aventures d’amour.
Il y eut aussi Zleïra à la ronde figure, aux yeux dormants et câlins, aux tendresses profuses ou aux suprêmes indifférences. Sa famille était acquise à Noura. D’origine turque, elle était plus franchement expansive et susceptible d’adapter à sa manière de vivre les choses utiles ou agréables empruntées à un autre peuple. Chez elle, les femmes ne se dérobaient pas aux visiteurs avec la sévérité des autres musulmanes. Comme chez les Arabes, les hommes, maris, fils et parents se mêlaient volontiers aux bavardages du cercle féminin, mais n’affectaient pas de se retirer à l’arrivée d’une personne étrangère.
La famille de Richa, la première petite mariée n’avait pas cette tolérance. Noura avait dû cesser ses visites à son élève devant la froideur des gardiennes et des parentes et en observant la contrainte de la « petite plume ». Celle-ci ne regrettait rien d’ailleurs étant fort aimée de son mari et adulée par sa belle-mère. Elle n’utilisait rien de ce qu’elle avait appris, excepté les réminiscences du bon La Fontaine, qu’elle répétait à satiété sans que son auditoire témoignât la moindre lassitude.
Les jours coulaient lentement. Lentement Noura essayait d’élever le sens et la forme de ses leçons, de leur donner un tour plus exclusivement européen. Elle hésitait devant l’étonnement ou la subite obscurité des cerveaux ; puis tentait de passer outre pour faire franchir à ses enfants une sorte de frontière franco-arabe au-delà de laquelle elles semblaient ne pouvoir aller. Mais sans cesse elle était obligée de revenir en arrière pour recommencer l’élan qui échouait. Et elle s’obstinait, croyant que Mouni du moins avait franchi cette frontière et que les autres suivraient.
Lella Fatime se préparait à un nouveau séjour dans les Grandes Tentes. Le jeûne sacré du Rahmadan, — qu’elle avait accompli rituellement avec Mouni, — et la faiblesse qui en résultait lui avaient fait retarder son départ. Elle parlait d’emmener sa sœur ; mais celle-ci s’y refusait énergiquement.
— C’est assez d’avoir supporté le carême pour lui plaire, disait la petite à Noura. Je ne veux pas retourner là-bas. Mon père Bou-Halim pourrait me garder ou me donner à un sauvage de ses amis.
Quant à Lella Fatime, elle aimait partager sa vie entre sa nièce et sa tribu, la France et l’Islam intact. Elle jouissait profondément dans l’atmosphère ancestrale ; mais il ne lui déplaisait pas de prouver qu’elle savait vivre comme une civilisée.
Claude Hervis restait le commensal irrégulier de la maison. Il avait élu domicile hors la ville, dans une maisonnette de khammès[27] près des champs d’iris et des oliviers.
[27] Cultivateurs.
Dans cet isolement il travaillait peu, dissertait avec quelques porteurs de bernous et savourait sa chère indolence. D’esprit très oriental, avec une infinie patience, il attendait l’heure où, vaincue par l’œuvre impossible ou par l’amour, Noura dirait oui. Jusque-là, il ne permettrait plus à un mot ni à un geste de troubler la grave amitié.
Sa présence était précieuse à Noura ; elle surexcitait son courage pour la lutte. L’incessante contradiction de l’artiste alimentait l’obstination de la jeune fille et le duel les intéressait tous deux. Il leur était arrivé de s’arrêter ensemble au seuil d’un café maure où un lecteur laissait sa voix égale engourdir les auditeurs.
— Islam, vieil homme heureux ! s’écriait Claude. Oh ! bien heureux vraiment puisque en ce siècle il peut encore goûter une satisfaction profonde en écoutant la plus simple histoire. Oh ! le noble vieillard qui sommeille merveilleusement dans l’esprit d’autrefois ! Avons-nous le droit de le réveiller ? Ce n’est point ce réveil qu’attend son rêve. Et toutes nos générosités s’acharnent contre ce vieillard en proclamant que c’est pour son bien.
— Ah ! fit Noura, vous n’êtes pas, vous, parmi les généreux. Je vous préfère le Mahdi, cet autre prêcheur de croisade, qui veut qu’on cesse de regarder l’indigène comme une statue ou une bête. — « Qu’on le considère comme doué de l’ensemble des facultés humaines, dit-il. L’avoir traité autrement a tant retardé le contact utile de deux races en présence. » — J’ajoute : — « Bénis soient les arabophiles que guident non la sensiblerie ou un sentiment d’originale esthétique, — si ceci vous atteint un peu, pardonnez-moi, — mais la vraie sensibilité et la conscience du besoin d’égalité des hommes devant la vie.
— Ces arabophiles et vous, Noura, vous travaillez à une illusion. Vous faites des bulles de savon qui gonflent, paraissent vouloir monter dans les airs et éclatent sans qu’il en reste rien.
— Et cela vous réjouit, homme grave ?
— Cela m’amuse, tant que ce sont des jeux d’enfants. Quand vous voulez changer le jeu en œuvre d’homme, je proteste, sans m’effrayer, car si vous obtenez une victoire, ce n’est qu’une pauvre exception. Une désertion ne prouve pas l’indiscipline d’une armée. Un révolutionnaire n’incarne pas l’esprit d’une république.
Mellouk, le Constantinois, un chanteur et joueur de djouak[28] remplaçait le lecteur dans le café maure. Toute l’âme bédouine passionnée et mélancolique, sauvage et tendre, fantasque et violente, gémissait, criait et roucoulait dans le roseau. Le son s’élevait comme l’appel strident d’un oiseau du désert. Il descendait avec la douceur langoureuse d’une paupière qui se ferme sur des yeux d’amour.
[28] Courte flûte de roseau.
Et Mellouk chantait la ballade populaire de Salah-bey.
La longue complainte se déroulait au battement cadencé des mains.
[29] Pardon.
[30] Sorte de sbire en la circonstance.
Il y eut des larmes dans beaucoup de regards vagues qui semblaient incompréhensifs et que la fumée du café, brûlant dans les petites tasses, embuait. La voix du chanteur s’altéra ; sa figure fut pathétique.
— Nous n’aurons plus de seigneur comme lui, répétait Claude Hervis. La hache de Charles Martel commença à les tuer dans les champs de France ; Noura Le Gall les achève sous le ciel africain. Je vous ai déjà dit que vous mériteriez un châtiment.

— Nous allons au pèlerinage de Lella Mora avec Sisann et Oureïda bent Derdour, dit Aziza Dherif. Donne-nous Mouni.
Mouni se plaignait d’une fièvre qui meurtrissait ses yeux et Noura retenue au logis permettait la promenade.
Un landau emmenait les jeunes filles et leur mentor vers la colline qu’avait sanctifiée Lella Mora la sainte.
Le mal de Mouni s’évaporait au premier souffle de vent, hors de la ville. Elle écartait la ferachïa qu’elle portait pour être semblable à ses compagnes et, la voyant drapée de ses plus fines mousselines, Sisann s’écriait :
— On dirait que tu vas chez un amoureux.
Les yeux étincelants de Mouni heurtaient les prunelles mélancoliques d’Oureïda et le noir regard malicieux de Sisann. Le petit genêt saharien songeait aux prunelles bleues d’un homme qui, pour elle, incarne l’idéal étant à la fois près de sa pensée franque et près de son cœur musulman ; il songeait à Claude Hervis. A un détour de la route on distinguait la maisonnette du sculpteur entre les oliviers.
Sur la colline consacrée où plusieurs femmes étaient déjà réunies, Aziza Dherif et sa fille allumèrent des cierges et commencèrent les prières.
Mouni serra étroitement son voile et sa ferachïa. Oureïda fermait les yeux, indifférente et pâle. Les autres s’absorbaient dans des bavardages ou des prosternations. Mouni s’écarta doucement, franchit un talus et se mit à courir…
Sous les oliviers, Claude Hervis fumait, mêlant à son rêve tranquille l’espoir de voir une âme virile et enthousiaste défaillir, glisser vers la sienne, une belle tête énergique s’appuyer sur son épaule et y demeurer longtemps.
Il avait été profondément conquis par la perfection physique de Noura. La volonté têtue de cette vaillante séduisit le contemplatif, ennemi de l’effort, et l’orgueil masculin trouvait son compte à prévoir qu’un jour cette volonté deviendrait une amoureuse soumission…
Les chiens des gourbis hargnent brusquement, mais sans la colère par quoi ils dénoncent un Européen… L’artiste ne prend pas garde à cette blancheur, une femme, cachée aux plis de la ferachïa…
Sous les oliviers où Claude rêve, la blancheur s’arrête, un voile se lève, Claude voit Mouni. Le visage doré est ardent comme si au lieu de sang une flamme courait sous l’épiderme. Les yeux ruissellent de clarté chaude.
— Que veut dire cela, petite fille ?
— La petite fille est grande.
— La petite fille est grande, mais s’est-elle échappée que je la voie seule ? Et Noura ?
— Elle n’est pas venue.
Mouni détache le voile qui glisse sur son front. Ses longues paupières se baissent sur l’éblouissement de ses prunelles.
— Je me suis échappée, oui, pendant qu’Aziza Dherif et sa fille brûlent des cierges là-haut. Je savais que tu devais être ici, ô frère de ma vie !
Elle parle en arabe avec sa voix passionnée.
La figure du sculpteur est sévère.
— Il faut rejoindre celles qui vous ont amenée, Mouni.
Il ne la tutoie plus et il a envie de la secouer et de la punir comme une enfant désobéissante.
Les longues paupières et les fines narines frémissent. Un murmure chante sur les lèvres :
Et voici Mouni aux pieds de Claude, comme une petite chose blanche, vivante et dangereuse.
— Relève-toi, Mouni, enfant du démon, ô medjnouna ![31]
[31] Possédée des esprits.
Il se fait gravement paternel.
— Vous avez eu la fièvre et le vertige et cela n’est rien ; cela passera avec le soleil d’aujourd’hui. Allez-vous-en vite, petite fille. Aziza Dherif vous cherche et Noura serait inquiète si vous rentriez tard.
Mouni disparaît aux plis de sa ferachïa et s’éloigne, rapide, sans confusion ni rancune, confiante en ce qui doit « être écrit » et s’accomplira suivant le désir de son cœur et la volonté de Dieu.
Et le lendemain étant un vendredi, le jour de la visite des femmes au cimetière :
— O Noura, dit Mouni, laisse-moi aller avec elles.
— Je t’accompagnerai.
— Comme il te plaira.
Sur la pente de la colline qui confine à l’écume des vagues, le cimetière.
La songerie habite le jardin clos de la mort musulmane ; une songerie sans tristesse, plutôt une indéfinissable douceur mauve, presque une joie tranquille. De cet Islam en cendre une sérénité émane.
Là, le visage hypocrite de la mer trop bleue, l’impatience et la rage des houles. Ici, le beau repos de la terre, la vie muette et éloquente des plantes, le luxuriant accueil des treilles et des figuiers. Dans l’herbe il y a de rouges sourires et des regards dorés de fleurs sauvages près des petites têtes frisées des chardons ; tout un épanouissement né du retour de la chair à la poussière…
Oh ! l’angoisse des nécropoles chrétiennes avec leurs perles de clinquant, leurs amoncellements de pierres disparates sous le deuil des cyprès nombreux rigidement alignés, le luxe absurde et pitoyable des caveaux aux pharisiennes chapelles, près des croix effritées sur la fosse commune !
Dans le jardin d’Allah, c’est la rassurante égalité des tombes pareilles, figées dans la forme rituelle et les trois couleurs uniques ; blanc de marbre, azur de faïence, vert de badigeon. A peine, par la dimension des barrières réunissant plusieurs tombeaux d’une même famille, à peine peut-on conclure que tels morts furent plus riches que d’autres.
Et qui consolera mieux l’impuissance humaine que cette similitude des derniers logis parmi les herbes et les feuilles, dans l’enveloppement de la terre en fleur !
Une vivante lumière flambe sur les marjolaines fleuries au milieu des cippes et sur les coupes creusées à même le marbre ou figurées par une petite tasse enluminée prise dans le mortier. Et, peintes ou burinées aussi bien sur les sépultures féminines que sous le turban révélant le tombeau des hommes, ce sont des paroles de foi !
Louange à Dieu !
Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux.
Il n’y a de Dieu que Dieu !
Cela remplace le lugubre « hic jacet ».
Les vieux traducteurs ou copistes musulmans terminent ainsi leurs manuscrits : « … écrit pour l’oubli des temps par le serviteur de son Dieu, un tel… etc… » — Les noms des morts et les formules de foi sont « écrits pour l’oubli des temps. »
Les musulmanes processionnelles ou isolées en leurs mystérieux haïks blancs ou leurs draperies bleues erraient entre les cippes, s’asseyaient familièrement sur les marbres. Elles s’entretenaient des défunts, sans amertume, et de toutes les choses de la vie, sans pudeur. Des enfants épluchaient des arachides en écoutant ce que disaient les femmes. Et celles qui marchaient lentement dans la nécropole aux chemins herbeux évoquaient quelques théories d’antiques en Hellade, sorties du gynécée pour la visite aux tombeaux…
Mouni s’était tout à coup et si bien mêlée à la foule féminine que Noura ne la retrouvait plus ; car, ce jour-là encore elle avait mis ses voiles qui la confondaient avec les autres filles de sa race.
Et Mouni est à genoux sur une tombe abandonnée où des herbes profuses frissonnent. Entre les herbes, elle creuse un trou et enterre sept petites pierres…
C’est un sortilège des tentes. Mouni a pris ces sept pierres en prononçant le nom d’un homme qu’elle croit ou sait amoureux. Les pierres, chauffées au feu et précipitées dans l’eau froide, doivent être ensevelies près des os d’un mort, pour que le sort s’accomplisse. Le cœur de l’homme nommé, désormais sera glacé pour l’objet de son amour…
Noura a retrouvé sa petite fille, qui, la sorcellerie terminée joue avec les herbes qu’elle redresse et sourit à Noura.

Zorah, une autre des petites brebis, à dix ans fut donnée à un homme de cinquante.
Elle revint une fois voir la Mâlema, car son vieux mari était momentanément amoureux de ses caprices. Elle conta comment elle avait trouvé une co-épouse dans le gourbi montagnard que l’époux, gardien d’un domaine, préférait à la maison française construite auprès. Trois enfants infirmes y végétaient et la mère se mourait le corps et le visage dévorés par un mal semblable à la lèpre. Un cousin de la malheureuse était venu, avait voulu l’emmener ; mais le maître s’y était opposé disant cyniquement :
— Qu’elle crève ici.
Zorah et la victime sanglotaient d’épouvante et d’horreur.
— Tu comprends, ô Mâlema, il est fort dans le mal et l’injustice, parce que cette femme n’a ni père, ni frères pour la défendre, parce que le Cadi est loin, et qu’elle ne peut marcher pour aller demander le divorce, et que notre seigneur la tuerait avant qu’elle arrive peut-être. Mais je ne veux pas devenir comme elle. Je suis une enfant ; mais les enfants ont le droit de se défendre et les femmes les aident. Il y a le poison, ô Noura, il y a le poison !…
Noura restait terrifiée par l’exaltation de Zorah la douce.
— Tu ne feras pas cela, petite.
Zorah riait du bout des dents et murmurait :
— Il est assez vieux ; les années de sa vie peuvent finir.
— Tu ne feras pas cela…
— Pourquoi, Mâlema ? Tes leçons disent qu’on ne doit pas être des esclaves malheureuses pour la durée des temps et que la justice sans mensonge, c’est le bonheur pour toutes. Si un malheur empêche la joie, il faut détruire ce malheur.
Et elle suivait son mari qui venait la chercher…
Peu après cette visite, Noura apprit que l’écureuil Helhala avait divorcé, puis abandonné la maison paternelle, pour se joindre à une troupe de cabotins du plus bas étage.
Elle eut un chagrin profond qu’elle ne put cacher à Claude Hervis. Elle lui en révélait les causes tandis qu’il l’accompagnait avec Mouni à un village indigène où l’une des élèves, Beïa, était malade.
Le sculpteur martela :
— La souffrance et l’exaltation des unes, la révolte et la chute des autres, voilà l’aboutissement de vos leçons ! En voulant déchirer le voile, vous faites des victimes et des dévoilées professionnelles !
Mais Noura répliquait serrant la main de Mouni, les yeux brillants de larmes refoulées :
— Je vaincrai la stabilité, l’hostilité et l’excès des choses. Je mesure la beauté et la bonté au dur labeur nécessaire pour les obtenir. Les nouvelles vies s’achètent au prix des douleurs et des risques mortels de la maternité. Je fais une œuvre de mère ; des esprits nouveaux doivent naître de moi. Quelques-uns ne seront pas selon la pure raison et le bonheur pour quoi je les enfante ; grâce et pitié sur eux ! Que leurs frères soient leur rédemption.
Elle ajouta vibrante, douloureuse et virile :
— Je sacrifie sur l’autel de la Vie pour la perfection des êtres. Je vois plus loin, plus haut que l’holocauste et les premiers oracles ; j’attends la dernière réponse des dieux !
Au village indigène, les cactus ont fait charmants les creux sentiers, charmants et sauvages, invisibles à ceux qui passent sur les routes.
Coutumiers de détours illogiques pour le seul amour du bizarre et de l’imprévu, les sentiers aux ombres bleues, aux rayons fauves ont des fins subites dans les verts veloutés de lumière et la sanguine des argiles mouillées.
Et soudain, les feuilles charnues s’écrasent ou hérissent davantage les dards de leur lourde palette contre une étrange maison chaude et flambante. C’est une symphonie en rouge : carmin des abricotiers défeuillés, tordus sur le toit, flamme rouge des vieilles tôles rongées de rouille qui se mêlent au bois, au chaume, à la terre, vermillon des tuiles et pourpre fanées des loques arabes.
Parfois dans la haie des cactus hostiles, s’offre la douceur blonde d’une claie de roseau. Quel sanctuaire dévolu à la famille ou aux divinités cache-t-elle ? Au-delà, ce doit être le secret de quelque paillette annamite ou d’un pauvre temple de la jungle tonkinoise.
Mais des bracelets tintent ; c’est l’argentin cliquetis du bruit féminin de l’Islam.
La frêle barrière tombe.
— Le salut sur vous, ô femmes.
— Et sur toi le salut et sur tes compagnons.
Elles sourient, à peine étonnées de l’invasion qui viole l’ambiance de la cour close de murailles bleues, de verdures chaudes au regard. Elles ne se refusent pas à l’accueil, étant des Berbères-Kabyles avant d’être des musulmanes.
— Quel est celui-là qui t’accompagne ? Ton mari, ton frère ou ton ami ? Et celle-ci n’est-elle point ta sœur ?
— Voici mon ami et ma sœur Mouni, répond Noura. Je suis la Mâlema ; je viens voir Beïa.
On soulève un rideau au seuil d’un étroit logis. Des nattes sur les carreaux lavés, un kanoun avec des braises, une minuscule fenêtre aveuglée de mousseline raide, un chromo accroché à l’envers, ses personnages coloriés posés contre un plafond, comme des mouches.
Sur un étroit matelas et sous une couverture rouge la fièvre brûle Beïa.
Dans la cour Claude Hervis attend que Noura et Mouni aient fini leurs souhaits de guérison à la malade. Des viandes déchiquetées sèchent sur des ficelles tendues. Des enfants simulent des fuites et des apparitions. Des femmes s’immobilisent en des attitudes qui perpétuent tout le rythme, l’harmonie et l’antique idéal des modeleurs de Tanagra.
Celle-ci au profil d’Egypte, est miraculeusement ruisselante de soleil. Claude ne voudrait pas la voir marcher et il l’adore d’être, en cet instant, une lumineuse statue dans l’éblouissement du jour.
Cette autre, sous la treille séculaire penche une amphore avec le geste de Rebecca ; et celle qui revient de la fontaine chante comme la Samaritaine.
Il y a encore une vieille dont les yeux se meurent, un masque où s’est gravé l’ironie du temps. Le sculpteur Nature s’est amusé de cette figure où, jadis, il se plut à parfaire de la beauté. Son pouce a creusé les joues, plissé les paupières, meurtri les lèvres. En tous sens, ses ongles ont griffé ce visage. Et, comme Noura et Mouni reparaissent, la grimace de la bouche lippue raille :
— Oh ! les jeunes, les jeunes aux yeux clairs, aux lèvres fraîches. Voilà comme vous serez, comme vous serez bientôt !…
Mais cela paraît devoir être aussi lointain que la fin de toute lumière. Est-ce que ce jour abondant, vigoureux, aura un soir ?… La belle jeunesse lui ressemble.
Si tentants sont les sentiers dans cette clarté que les trois amis veulent atteindre le faîte de l’éminence où se posa le village.
Ils passent devant une koubba. Des drapeaux ondulent au seuil, des étendards sacrés dont le satin alourdi de franges dorées est toujours frissonnant de baisers innombrables, les baisers de la ferveur reconnaissante et des vœux de l’amour. Au-dessus de la koubba, un caroubier brun aux feuilles dures et métalliques.
Ils vont à travers le village berbère et bédouin. Ils atteignent le sommet où croule un autre sanctuaire, pareil à la maison d’un vivant parmi les cactus, et qui est la demeure d’un mort. Autour, des fleurs et des rayons dansent, des fillettes qui sont les suivantes d’une sultane des djenoun, parées à cause de ce vendredi, un dimanche en Islam. Elles marchent sans chaussures, avec des petits pieds couleur d’orange mûre ou sur des socques tunisiennes hautes, périlleuses incrustées de nacre. Elles ont des voiles prestigieux, des diadèmes de légende. Dans leurs yeux toute l’Afrique ; dans leur sourire, toute la femme ; et, dans leurs gestes, l’Orient souple et câlin…
Le mort qui habite le sanctuaire effrité est un saint du pays Kabyle. L’artiste et Noura qui porte un pain arabe don de Beïa, pénètrent le poudreux refuge de sa poussière. Et voici que quelque chose de vivant se meut dans la pénombre… Une face sans yeux se tourne vers les intrus ; une main s’éclaire, tendue à l’aumône…
— Qui es-tu, revenant ?
— Je suis celui qui n’a rien, le résigné de l’ombre éternelle. Je voudrais manger.
— O mon frère, prends ce pain des jours de fête dont la blanche farine est parfumée d’anis et de coriandre. Sur toi la bonté du Clément.
— Et sur toi ! Il est le plus grand…
Ils sont revenus à la lumière, parmi des narcisses pleins d’abeilles et des lavandes sauvages. La mer est loin, unie au large du ciel. La ville est loin dans la plaine. Les montagnes sont proches, leurs courbes molles offertes comme une couche immense à l’immense repos de la contemplation.
Là-bas, plus bas, tout près, dans la ville, la montagne et les cactus, il y a tant de lassitudes et de souffrances… La douleur de Noura envahit ses yeux, filtre au travers des cils, s’évapore dans la lumière. Une exaltation la possède.
— Oublions ! s’écrie-t-elle. Nous n’avons plus d’esprit ni de cœur. Que nos yeux vivent seulement !
— Que nos yeux vivent, dit Claude Hervis, et notre âme ouverte à la calme, l’indifférente beauté des choses. Souhaitons de réaliser peu à peu le vœu du philosophe :
« Devenir dur lentement, lentement, comme une pierre précieuse et finalement demeurer là, tranquillement, pour la joie de l’éternité. »[32]
[32] Nietzsche.
Mais déjà, du profond de l’âme active de Noura, un reproche monte. Elle se redresse.
— Claude, n’entendez-vous pas la voix koranique qui vous est chère ?
Et voici mon offrande, voici mon cœur gonflé de la joie forte et du renouveau de la terre, ivre des vents qui courent libres, et lourd, précieusement des parfums de la montagne et de mon amour…

Est-ce le souvenir de la beauté de Noura au village des cactus ? Est-ce un incoercible désir de la revoir ? L’absence de la jeune fille se prolonge pour un secours ou un conseil à donner à quelque femme solliciteuse qui s’attarde au seuil ; le crépuscule est devenu la nuit et le sculpteur ne se décide pas à partir. Il attend. Il est penché sur la terrasse pleine de lune émouvante de charme et de pureté. Ses mains et sa tête sont plus brûlantes qu’au grand soleil de l’après-midi…
Son regard plonge dans des cours intérieures de maisons arabes, se complaît à des étoffes luisantes, à des draperies voilant de féminines formes et ses doigts s’incrustent violemment dans ses paumes, parce que dans une des cours, à la lueur légère d’un cierge, un jeune homme caresse une jeune femme en robe dorée…
Un parfum mêlé d’essence de rose et de genévrier dilate les narines de Claude Hervis…
Il se détourne à peine…
Mouni est près de lui, tout contre, les mains croisées sur sa gorge battante, le visage haut, extasié sous le clair de lune, paupières closes, lèvres entrouvertes…
Brusquement, Claude saisit la tête passionnée et sous ses lèvres écrase la bouche de Mouni…
Quelqu’un surgit sur la terrasse, quelqu’un dont ils sentent l’immédiate présence qui les dégrise…
Et tandis que Mouni disparaît avec un regard de volupté et de défi, Noura très droite dit seulement :
— Allez-vous-en, Claude Hervis.

La Bent Fraîchichi parlait :
— Le pied du « mehari » a rencontré le sol qui lui était mauvais. Et le pied du coureur de race s’est usé jusqu’à devenir tendre, impuissant à la marche. La chair et le sang n’étaient plus recouverts que par une peau mince et fragile ; le telhas[33] avait couché celui qui dévorait l’espace sans sources, pendant des jours. Et les gens disaient : « Il ne se relèvera plus. Les sables ne connaîtront plus sa course. » — Mais le maître a voulu guérir le mehari. Il a pris son poignard ; il perce le pied infirme, il le perce là où il est le plus sensible et le plus usé. Le sang coule. Puis, la peau se dessèche et durcit. Le mehari ne sent plus la meurtrissure des pierres. Il marche encore aux chemins du désert… — C’est l’histoire de ton cœur, ma fille. Laisse-le saigner.
[33] Usure du pied des dromadaires qui marchent en terrain dur. Le remède est l’incision de la plante du pied.
Noura écoutait l’allégorie. Elle pleurait des larmes intérieures à cause de Claude Hervis qui était parti, chassé, sans qu’elle eût voulu l’entendre.
— Je sais, je voyais, continuait la vieille barde. Il baisait Mouni. Cela ne l’empêche pas de t’aimer ; mais tu ne l’aimes plus à cause de ce baiser. Alors donne-lui Mouni pour le consoler de l’amour perdu en toi.
Mais Noura renvoyait la bavarde et repassait dans son cœur les mots que Mouni avait prononcés devant le reproche muet de l’attitude.
— Noura, que signifie ce geste inattendu de Claude Hervis. Penses-tu qu’il m’aime et qu’il veuille m’épouser ?
— Non, certes.
— Alors il est fou et je déteste cette folie qui t’a fait de la peine.
Et comme la Mâlema interrogeait avec un sanglot dans la gorge :
— Tu ne l’aimes pas, toi au moins ?
— Oh ! non, par ta tête et mon cou !
La petite se détournait et furtivement pressait la paume de sa main sur ses lèvres, frissonnant d’allégresse au souvenir du baiser reçu.
Des jours ayant passé, Noura parut se réveiller d’un lourd sommeil. Ses paupières se rouvrirent sur son regard énergique. Sa raison était victorieuse de son amour et de son ressentiment. Elle pardonnait à cet homme, — que rapetissait ce pardon, — l’homme qu’elle jugeait désormais devoir toujours succomber à la langueur, à la faiblesse, au caprice impulsif des Orientaux. Cette faiblesse et ce caprice constatés portaient une telle atteinte à l’affection que Noura la forte avait donnée à son ami, qu’elle ne souffrait presque pas de vouloir oublier cette affection. Claude ne pouvait plus lui apparaître comme le dominateur qu’elle avait cru pressentir ; elle ne souhaitait pas le revoir.
Son nom ne fut plus prononcé dans la maison. Une seule fois, Mouni demanda :
— Il y a longtemps que nous n’avons vu ce fou. Reviendra-t-il ?
Noura déchira calmement une lettre timbrée de Biskra et répondit :
— Le pays des sables le prend. J’accepte son au-revoir comme un adieu… Travaillons, chère.
Quand Mouni fut libre, elle courut chez Aziza Dherif.
Celle-ci se lamentait près du lit de l’un de ses fils, un bel éphèbe qui crachait du sang depuis des jours. Au-dessus de la couche miroitait l’image sainte commune aux logis de l’Islam, la monture du Prophète, l’ange à tête de femme, à longue chevelure, aux ailes d’aigle, au corps de lion et aux sabots de chèvre, qui galope vers les mosquées de Médine. La voix dolente du malade gémissait contre Sisann, lui reprochait l’inefficacité d’un remède qu’elle avait offert comme infaillible. Pour le faire elle avait convoqué ses amies. Ensemble selon les formules transmises, elles avaient préparé un baume précieux avec des œufs, du corail pilé et de l’encens que les femmes arabes mâchent comme du bétel. Et le baume appliqué, augmenté de pointes de feu ne soulageait pas le patient.
Dans un recoin de l’antichambre, Sisann boudait contre les gémissements de son frère et l’inquiétude maternelle. Elle retint Mouni.
— Mon frère est malade, n’entre pas. Restons ici ; ma mère est dans la tristesse.
Elles bavardaient un moment, doucement, et Mouni disait enfin pourquoi elle était venue.
— O Sisann, je voudrais aller chez Si Rabah le derouïche. Je te dis ceci, et que ta bouche soit fermée : j’ai besoin de parler au derouïche pour mon cœur ; mais avant, je ferai une prière à Sidi Abd-el-Kader.
— Ah ! exclama Sisann, tu es amoureuse. Je sais cela. Nous irons où tu voudras et Fatma viendra avec nous, à cause des gens qui ne veulent pas qu’on marche dans la rue quand on n’est pas mariée. Quel est ton ami, ô Mouni ? Tu ne le dis pas ? Prends garde que Si Rabah nous raconte sa figure.
— Dépêche-toi, dit simplement Mouni.
Sisann se chaussa, prit son voile et son haïk, sans attirer l’attention de sa mère et invita Fatma à la suivre.
Elles sortirent toutes trois. Leurs fines silhouettes voilées glissèrent comme des ombres vives dans les ruelles. Sisann et Fatma, instruite à son tour du secret de Mouni, se réjouissaient de ce secret.
— La Mâlema le connaît-elle ? demandait la petite divorcée.
— Non, non, ne lui dites rien ! Noura ne comprend pas l’amour.
— C’est une Française ; les Français ne savent pas aimer comme les Arabes.
— Peut-être, murmurait mystérieusement l’enfant de Noura.
Elles étaient devant une porte que Sisann ouvrait sans heurter l’anneau. Dans une cour, sous l’ombre d’un pêcher, des femmes vaquaient à leur facile ouvrage. L’une cousait en forme de gandourah une pièce de soie, le tissu retenu entre ses orteils, l’aiguille dirigée comme une alène de savetier. Une autre appareillait des manches de mousseline et une fillette pétrissait la pâte blanche pour le pain du soir.
Au fond de la cour, le seuil de la mosquée cachée de Sidi Abd-el-Kader. A l’intérieur du sanctuaire, un clinquant de bazar européen s’harmonise naïvement avec une vague tentative d’art oriental. Dans le mystère d’une crypte basse gîte le tombeau du saint.
Mouni s’est prosternée et prie avec les paroles d’une sourate que Claude Hervis citait pour sa poétique perfection :
La prière finie, elles sortent, suivent de nouvelles ruelles et pénètrent dans une autre demeure dont la porte jamais n’est close. Au seuil elles croisent la Bent Fraîchichi.
— Ah ! Mouni, dit celle-ci, j’ai interrogé Si Rabah en prononçant le nom de la Mâlema. Voici sa réponse : « Celui qui l’aime n’aimera jamais une autre femme. Rien ne détachera son cœur de son souvenir. S’il s’est penché une fois sur une autre bouche, c’est comme le voyageur qui s’arrête un moment à l’ombre du jujubier sauvage en attendant celle du palmier. » — Répète cela à la Mâlema.
Elle les quitte en riant des yeux violents et de la pâleur de Mouni.
Dans l’antichambre obscure, une négresse en gandourah jaune est assise sur la margelle d’une citerne et, devant une logette s’étale une vieille courtisane aux traits rusés.
R’naïfa soulève un rideau blanc ; c’est l’ombre douce d’une cellule. Sur un lit de repos, près d’une table basse surchargée de fleurs, un homme est à demi couché, sa figure de Christ rêveur émergeant d’une djellaba marocaine. C’est Si Rabah le derouïche célèbre et souvent emprisonné, qui sait toute chose.
Sisann et Fatma baisent avec une tendre vénération la tête du jeune solitaire au sourire archangélique, au regard malicieux et trop noir.
D’un geste harmonieux et lent, parmi les fleurs, il prend une poudre odorante dont il parfume ses doigts.
— C’est pour celle-ci, dit Fatma montrant leur compagne.
Le devin se recueille, fixe Mouni et prononce :
— Tu n’es pas aimée, ô jeune fille. Tu ignores l’amour arabe et l’amour chrétien te méprise. O jeune fille, le temps de l’amour qui est celui de la beauté passe comme un reflet sur le visage des femmes.
— Quel est le Chrétien dont l’amour me méprise ? questionne Mouni haletante.
— Celui que tu voudrais. Cela est tout. Comprends avec un cœur clair. Ta beauté, ta jeunesse et la vie finiront ensemble.
De charmants baisers, Sisann et Fatma caressent encore le front du derouïche.
Elles emmènent Mouni à travers des groupes d’Européens des deux sexes et de ces Juives qui discrètement brûlent des cierges dans les koubbas.
Dehors, Sisann dit :
— Ton ami est un chrétien, Mouni. Est-ce l’homme aux yeux bleus, aux cheveux bientôt gris ? Que n’aimes-tu plutôt mon frère qui est jeune ? Et le Chrétien imbécile ne t’aime pas…
Les petites dents de Mouni grincent sous son voile.
— Dieu sait tout et Si Rabah n’a jamais menti, affirme Fatma.
Quand Mouni rentra, elle répondit aux questions de Noura :
— J’étais chez Aziza Dherif qui est triste à cause de son fils. Je suis restée avec Sisann.
Sa voix était très calme, ses paupières closes à demi.
— Je voudrais que tu ne sortes jamais sans moi, chérie.
— C’est bien, mais que crains-tu ? Si le mal doit nous atteindre, il se trouvera dans la maison comme dans la rue.
Elle attira Noura vers le piano.
— J’ai le cœur léger. Tu es belle et chère. Je suis heureuse. Chante pour moi.

Le lendemain.
Loin de la ville, aux environs de la koubba de Sidi-Brahim, Noura et Mouni suivent la route qui longe un oued au passé scintillant de paillettes d’or, au présent fétide de boues.
C’est vers le soir. Des souffles troublent les rameaux et plissent l’eau mate. Des parfums essaiment de la terre chaude, des prairies rousses. Un oiseau isolé jette un appel net et sec comme un bruit de taquet.
— Mouni, dit brusquement Noura, pourquoi ne pas m’avoir avoué que tu étais allée chez Si Rabah ?
Mouni tressaille imperceptiblement. La Bent Fraîchichi a parlé.
— Je ne l’ai pas avoué par crainte d’une réprimande. Sisann et Fatma m’ont entraînée. J’étais un peu curieuse du derouïche. Es-tu très fâchée ? Nous avons rencontré la Bent Fraîchichi. Elle a répété des paroles bizarres que Si Rabah aurait dites à ton intention. Il m’a semblé qu’il s’agissait de Claude, qu’il t’aimait… Alors, il était véritablement fou quand il s’est penché sur moi ! Et toi ?…
Une angoisse perce sous la volubilité fiévreuse de Mouni.
— Je ne l’aime plus, si un moment j’ai cru à l’amour qu’il m’offrait, répond lentement Noura. Si Rabah est un charlatan. Nous n’expliquerons pas les caprices de Claude ; nous les jugeons coupables, cela suffit. Mais, ma petite enfant, tu devrais ne rien me cacher de tes actes et de tes pensées.
— Qu’ai-je caché, excepté cette simple chose ?
Elle scande, et Noura s’étonne de sa véhémence : — Louange à Dieu puisque l’indigne que tu aurais pu choisir est loin de notre vie. Tous les Français sont-ils aussi stupides et misérables ? Qu’il soit oublié. Je suis honteuse à cause de mon amitié pour lui.
Elles sont près d’un groupe de gourbis parmi lesquels est celui de Djénèt qui se maria avec l’époux de Helhala la perdue.
Lorsque Djénèt arriva au gourbi, comme Richa était arrivée dans la maison fermée de Saïd ben Hamzi, les crépuscules du printemps étaient beaux de grandes lumières hâtives. Les lumières, plus intenses maintenant, magnifient la misère blonde des champs de l’été.
Dans le gourbi encombré de femmes de petite condition, car Djénèt et son mari étaient eux-mêmes de caste inférieure, muette selon la coutume, paupières closes, elle avait eu une figure si pâle, si différente de celle de Helhala qui l’avait précédée dans le même lieu. Helhala n’était pas restée enlinceuillée. Bravant la critique elle s’était assise près de sa mère ; elle ne parlait pas, mais ses paupières battaient malicieusement et ses lèvres gourmandes riaient.
Djénèt resta passive et immobile.
Durant la « hadjeba », la lune de miel, une tente blanche, abritant exactement la largeur du lit arabe, se dressait à l’écart du gourbi.
Djénèt y vécut ses huit jours d’inaction et ses huit nuits d’amour. Quand le soleil se levait, le mari s’en allait et la mère de l’épousée venait repeindre les lèvres, les joues blêmes, les yeux las, remettait le voile pailleté, renouait les foulards soyeux. Et Djénèt redevenait une idole assise sur le matelas qu’un tapis séparait de la terre, avec, autour d’elle, une cour de femmes et d’enfants.
Les huit jours écoulés, la mère était partie, la petite tente avait été rendue au loueur ; le jeune couple dormit dans le gourbi familial.
Et la belle-mère avait dit :
— Voici le temps de travailler, ma fille.
L’épousée plia sa robe brodée, son voile joli, les mit dans le sendouq[34] de ses noces dont la serrure faisait un bruit de grelot avertisseur chaque fois qu’on l’ouvrait ou le fermait. Elle lava ses mains peintes, s’agenouilla devant la guessâh[35] de bois d’olivier et pétrit la galette quotidienne. Cela fatiguait ses bras minces et elle n’aimait pas toucher la bouse sèche qui alimentait le feu.
[34] Coffre enluminé.
[35] Large plat.
Mais il advint que Djénèt ne sut pas garder le plaisir de son mari. Il se plaignit de la facilité du divorce, de la loi koranique trop favorable pour les femmes et qui lui avait fait perdre Helhala aux malices savoureuses. Il déserta le gourbi souvent. Djénèt fut en butte à l’animosité de ses beaux-parents qui déjà l’aimaient peu parce qu’elle savait des choses qu’eux ne savaient point.
— O Roumïa, disait la belle-mère, ta science française ne t’a pas rendue habile en amour.
Sous les ricanements, Djénèt travaillait davantage, comme possédée du désir de revenir entièrement à ceux de sa race, de racheter l’apostasie de son premier geste et de son intelligence qui s’appliqua hors l’Islam et les coutumes. Après l’amour bédouin, le labeur purifiait Djénèt de son péché…
Noura et Mouni saluent une vieille qui, devant un des gourbis formant le petit douar où vit Djénèt, tourne habilement et exactement l’argile pour en faire des poteries, le tadjin[36] à quatre cornes, le kanoun qui en a trois et la quedra[37] sans anses. Un chien aboie furieusement. Dans les jardins maraîchers s’égrène le tic-tac des norias. Deux jeunes femmes qui bêchent un champ se redressent, belles dans leurs haillons rouges, leurs bras de cuivre appuyés au manche des houes.
[36] Plat pour cuire les galettes.
[37] Marmite.
Djénèt est dans le petit enclos d’épines et de branches où sont parqués des veaux maigres.
Elle tend ses lèvres aux visiteuses.
— Soyez les bienvenues.
Elle étend une peau de mouton pour que la Mâlema et sa compagne puissent s’asseoir et elle reprend son ouvrage, une reprise au bernous de son mari. Suivant les paroles que Noura prononce elle jette un regard peureux vers le gourbi où sa belle-mère écrase des feuilles de henna sous une meule primitive.
— Tu es toujours adroite avec ton aiguille, Djénèt.
— Oui, je me souviens des leçons de Mademoiselle Sarah. Pour le reste j’ai oublié. On oublie ce dont on ne parle plus et je ne peux pas parler ici. Ils ne comprennent rien aux choses de l’Histoire.
— Ton mari me paraissait intelligent.
— L’intelligence des hommes n’aime pas celle des femmes.
Le bruit de la meule cesse et la belle-mère paraît, une cruche sur l’échine. Elle salue à peine, avec de mauvais yeux et va à la fontaine éloignée.
Alors Djénèt parle plus librement.
— Mon mari Touhami obéit à sa mère. Il me rudoie quand elle se plaint, pour rien. Hier j’ai dit : — « Me tueras-tu ? Je veux me sauver dans la montagne. » — Il a répondu : — « Sauve-toi. Quand tu seras au bout du champ, au bord du fossé, je prendrai mon fusil et je viserai bien. » — Tu comprends, Touhami ne craint pas la prison ; il sait qu’on y est nourri et habillé, à l’abri du vent et de la pluie ; il n’y manque que des femmes. — « Peut-être les bons Roumis finiront-ils par en donner aux prisonniers et la prison sera le paradis, dit-il. » —
— Tu n’es pas heureuse, ma Djénèt.
— Non. Je ne suis pas habile comme ma belle-sœur Afsïa qui obtient tout ce qu’elle veut, et son mari ne lui parle qu’avec une langue amoureuse. A quoi sert la science, ô Mâlema ? Elle ne m’a pas donné le bonheur et les gens d’ici affirment qu’elle donne le goût du mal parce que Bouba se prostitue à tous les hommes qui passent, chrétiens ou musulmans.
— Qui est Bouba ?
— Une fille du village de Beïa. Elle a été longtemps dans les écoles françaises et maintenant, elle fait des signes sur sa terrasse près de la koubba de Sidi-Brahim.
C’est la voix de Mouni :
— Djénèt a raison. La science ne donne pas le bonheur.
Comme une eau transparente laisse voir le fond des lacs, la voix transparente laisse voir une âme triste. Elle poursuit :
— Il n’y a qu’un bonheur, l’amour. La science ne donne pas l’amour. Et peut-être l’amour arabe vaut-il mieux que l’amour français. Peut-être les Musulmans mentent-ils moins souvent à leurs désirs que les Chrétiens.
— Mouni, Mouni… murmure Noura, saisie éblouie de certitude après un soupçon.
Mais Mouni se détourne et la mélancolique Djénèt reprend :
— On ne sait pas quand on se marie. C’est pour vous comme pour nous. Il faut patienter. Dieu est avec les patients et je ne divorcerai pas.
Noura prononça avec effort :
— Puissent des enfants te consoler.
— Je ne désire pas d’enfants. Je n’ai ni joie ni fortune, mais dix vaches maigres pour leur héritage. S’ils veulent naître qu’ils soient des fils.
— Des fils qui t’écouteront, que tu élèveras dans l’esprit que j’essayai de te donner, afin qu’ils deviennent les maris dignes des filles civilisées, de femmes telles que toi.
Et Djénèt répond évasivement :
— Je ne sais pas. Cela est loin. L’ignorance est bonne.

Les gourbis disparaissent à peine au détour de la route.
— Mouni, cria Noura, Mouni, je veux la vérité, toute la vérité !
Et dans le cœur de la jeune fille l’espoir et le désespoir se heurtaient, se brisaient misérablement. Elle demandait la vérité et cette vérité fulgurait en elle, poignante. Elle souffrait comme si cette petite créature impassible, immobilisée devant elle, eût agonisé dans les pires tortures.
— Mouni, Mouni, tu l’aimais !…
O figure dorée, chère petite figure de princesse sarrasine, visage muet de Mouni, voici se déchirer brusquement le masque d’orgueil ! Voici paraître l’aveu passionné de l’âme, une douleur exaltée et sauvage, la violence du désir et l’horreur de la déception. O petite idole, tu aimes un mortel et ton châtiment est venu ; mais les lèvres restent si fières dans leur frémissement tragique qu’elles ne profèrent pas un regret. Elles disent simplement :
— Noura, mon cœur me fait mal, mon cœur me blesse, ô Noura. Il est le maître et je ne peux pas le dominer ici. Pour moi, l’ombre même de la maison devient dure et méchante. Cela passera. Cela doit passer quand le souhait n’existe plus, quand la rancune n’a pas pu naître, mais seulement le mépris pour la faiblesse de ceux qu’on croyait forts. Laisse-moi partir, Noura ; Lella Fatime est encore à la zmala, laisse-moi la rejoindre.
Les traits de Mouni étaient plus expressifs que ses paroles, plus expressives la désolation de ses prunelles profondes et sa bouche hautaine douloureusement.
Des mots tremblèrent, arrachés aux entrailles de Noura.
— Si tu pars, tu ne reviendras plus.
— Je reviendrai guérie.
— Mouni bien-aimée, écoute. Attends quelques jours, je préparerai Sarah à me remplacer et je te conduirai là-bas. Il faut que la joie se retrouve…
Le visage doré exprima une déception nouvelle. Vaguement, Mouni avait espéré de Noura une parole qui fût comme une promesse de chercher à ramener Claude pour l’incliner vers Mouni… Et Noura préférait le sacrifice, — Mouni savait que c’était un sacrifice, — de la ramener à la zmala… Ce ne pouvait être par jalousie puisque Noura n’aimait plus… Elle n’aimait plus et si elle avait aimé, Mouni savait qu’elle aurait renoncé à son amour pour la joie de Mouni. La petite saharienne eût bénéficié de cette admirable générosité du caractère de son éducatrice, en ne l’admirant qu’à demi, car elle était incapable d’en réaliser une imitation. Elle avait acquis la faculté de trop de raisonnement et pas assez de froide raison pour admettre le renoncement et la fatalité. Elle souffrait et se révoltait contre l’injustice d’un homme et des choses. Elle haïssait tout l’horizon, toute l’atmosphère des lieux de sa déception. Son impuissance criait en elle, plus violente depuis que l’attitude de Noura lui était comme une preuve que le derouïche n’avait pas menti, que Claude Hervis, tenté un instant, la dédaignait. Du moins, si elle espérait dans l’avenir ! Mais en cette heure aiguë et trouble elle n’avait plus d’espérance…
— Il faut que je m’en aille, Noura, il le faut.
Et voici que la réflexion d’une minute fugace faisait que Noura s’épouvantait. Elle se remémorait le charme des Grandes Tentes ; trop merveilleusement peut-être, il guérirait son enfant.
Elle supplia :
— Ma petite fille, au nom de notre tendresse, je te demande ceci : supporte le chagrin pendant un mois encore, ici. Après, nous partirons. Et il peut advenir tant de choses dans le court espace d’un mois.
Presque inconsciemment la jeune fille dit ces imprudentes paroles dont Mouni s’empare et qui dicte la réponse :
— Je supporterai ces jours, pour toi.
… Il peut advenir tant de choses dans le court espace d’un mois…
Si-Rabah aurait pu mentir.
Et pourquoi Claude Hervis ne préférerait-il pas la frémissante Mouni à la calme Noura ?

Combien tu es retentissante sous la lune, ô ronde et blanche koubba !
Derrière la lourde porte close, comme en une nuit de sabbat, quelles mânes folles mènent leurs tympanons et leur sarabande ?
O mon seigneur Brahim sur qui reposent la bénédiction et le miracle, en ton sépulcre drapé d’étendards, voilà ta poussière émue au vacarme des litanies, au bruit des voix féminines.
Contre le mur arrondi où des niches protègent la clarté vacillante des cierges verts et rouges, voici, en double et triple rangs, toutes tes prêtresses plus belles et parées que les bayadères sacrées de Siva !…
Au dehors, par les chemins s’en vont des bandes faméliques, les pauvres de toutes races et de toutes religions auxquels la généreuse maîtresse de la fête donna la part du mendiant prescrite par la loi divine.
Dans la koubba, c’est un éblouissement de visages superbes, de joyaux, de soies et de velours rebrodés, effleurés de gestes tintants. Une élite féminine et musulmane est réunie. On reconnaît la veuve d’un ingénieur français, délicatement assimilée d’abord puis revenue à tout l’Islam de ses aïeules. Une grosse femme brune mariée à un Européen est venue sans le costume indigène et jure étrangement dans cette foule orientale. Il y a aussi un curieux petit bouffon femelle, commensal des cafés maures la nuit et des lieux mal famés le jour, traînant ses vices et sa difformité de bossue. En dépit de sa honteuse débauche, on invitait la bouffonne, parce qu’elle créait et mimait des danses lascives avec un réalisme audacieux, le langage éhonté de sa figure et de ses gestes.
Et toutes les femmes de tous les âges, les jeunes filles, les fillettes et les petits garçons se passionnaient pour ces danses. Après, ils essayaient de l’imiter.
Cette nuit-là, la fête était donnée par la tante d’Oureïda, pour qu’un miracle sauvât la « petite rose » dont le mal s’était subitement aggravé. Ainsi, la souffrance d’Oureïda se résolvait en joie pour les invitées nombreuses qui, après les condoléances et les souhaits d’usage, étaient tout au plaisir de se retrouver. Tel est l’avantage des fêtes au prétexte pieux : la réunion des amies proches ou lointaines. Là se rencontrent les affections, se font et se défont les mariages, s’édifient ou croulent les réputations.
La cuisine contiguë à la koubba était envahie de servantes. On emportait les plats de kouskous où chaque invitée avait puisé. On préparait les jattes d’eau fraîche et les plateaux de cuivre chargés de tasses de café.
Noura et Mouni conviées se mêlent à la foule d’où s’exhalent le parfum du jasmin, la senteur amère et prolongée de l’essence de rose. Elles s’entretiennent avec des jeunes femmes aux cheveux dénoués sous la tiare assyrienne où l’or des vieilles pièces romaines et arabes, des sultanis et des louis s’unit aux luisances des émeraudes, à la douceur des perles inégales. Sur les joues peintes, de multiples chaînettes tremblent, accrochent les voiles scintillants de fleurs d’argent. Les pieds et les mains sont zébrés de noir, par un raffinement de coquetterie dédaignant le henna commun, et ils se meuvent dans un cliquetis de choses précieuses.
Des fillettes félines et jolies, — plusieurs sont des élèves de Noura, — caressent un derouïche venu du Moghreb et qui fume du kif, béatement.
Noura cause avec Louïz et Merïem mariées comme Richa. Louïz rit et taquine son amie Merïem.
— O Mâlema, voici la plus paresseuse d’entre les femmes ; mais elle a su séduire sa belle-mère et son mari peut gronder en vain ; Merïem n’a jamais tort.
— Voici la plus avare, riposte Meriem. Louïz a hérité de la fortune de son père ; mais son pauvre mari ne connaît pas le poids de ses douros.
— Il m’a prise, à lui de m’entretenir, c’est la loi. Mâlema, pourquoi ne te maries-tu pas ? Tu connaîtrais le paradis avant la mort. Pourquoi n’épouses-tu pas un Musulman ? Plusieurs te veulent. Ils savent voir ta beauté, tandis que les Chrétiens sont aveugles. Si un seul de ces derniers avait des yeux, il viendrait un soir, à cheval, pour te prendre, même malgré toi et t’emporter ! Alors tu saurais comme nous le miel de la bouche, la brûlure bienheureuse d’un baiser.
Elle poursuivait répétant des cajoleries et de ces mots que toutes les femmes de tous les siècles ont aimé entendre aux lèvres des hommes. Naïvement et voluptueusement impudique, elle disait la joie des caresses.
— Avant de me marier, répond Noura, j’aurai peut-être le temps d’instruire tes filles.
— Si leur père veut…
— Et les tiennes, Merïem ?
— Cela m’est égal. Elles pourront apprendre à lire, peut-être, pour faire comme moi. Moi, je lis le journal à mon mari, c’est ennuyeux de lire ; mais mon mari s’amuse et dit que ton beylik est fou.
— Toi, Louïz, que fais-tu de ton instruction ?
C’est Merïem qui réplique :
— Elle s’en sert pour savoir la valeur de ses sultanis.
Contre la barrière qui entoure le sépulcre de Sidi Brahim, quatre êtres étaient accroupis, tassés par l’ahurissement de la misère, quatre êtres copiés sur les sinistres silhouettes que Loti peignit dans l’Inde.
Une larve humaine pendait à la mamelle vidée et flasque d’une femme de vingt ans. Entre les genoux de cette femme, un garçonnet aux admirables yeux de souffrance injuste, d’étonnement douloureux. La tuberculose et le rachitisme déformaient ses jointures, recroquevillaient ses membres où les chairs fondaient en plaies purulentes.
Une fille de quinze ans, sœur de la mère, et dont les bras étaient couturés de cicatrices blafardes, se leva après un long colloque.
La bouffonne venait de mimer avec une passion cynique l’éternelle aventure de deux amants, de la rencontre à l’étreinte. Les femmes surexcitées approuvaient par des applaudissements frénétiques.
Les musiciennes, — joueuses de bendir, de derbouka et de tambourins continuaient le refrain et le rythme sur lesquels la bouffonne avait dansé.
— Je te prie, dit la fille misérable à l’une des belles idoles de la fête, je te prie… Nous sommes entrées, ma sœur et moi, pour un vœu. Prête-moi un foulard ; il faut que je danse afin que Sidi Brahim accepte le vœu.
Le foulard flottant au bout de ses doigts, maladroitement, sans passion, ni grâce elle suivit le battement des musiques aux saccades de ses hanches maigres. Elle ignorait la danse maraboutique, sacrée, qui plaît aux saints. Comme Photine saluant le Messie avec un chant de courtisane, elle faisait ce qu’elle savait.
Noura s’était assise près de la misère de la femme et des petits. Elle apprenait que le mari était en prison, compromis dans une affaire de vol. Sous un gourbi croulant, les abandonnés vivaient d’aumônes.
— Il faut aller au dispensaire ; on soignera cet enfant, dit Noura.
— Je ne sais pas le chemin, répond la femme. Je ne suis jamais allée dans la ville.
Ainsi, hors les remparts à peine, des êtres vivaient et mouraient sans même avoir désiré connaître ce que cachaient ces murailles.
Une voix aiguë s’élève, une de ces voix de tête suprêmement appréciées par les Arabes. C’est celle d’une matrone presque aveugle, mais savante en l’art de chanter. Elle commence un solo dans le silence des instruments et de l’assistance.
Les musiciennes heurtent les peaux sonores chauffées sur les kanouns. Elles reprennent avec une ardeur contenue :
Dans un nouveau silence la soliste dit :
Les tympanons et le chœur scandent le refrain.
Noura écoutait maintenant une créature exquise de charme jeune et de malicieuse séduction qui lui racontait :
— J’ai été mariée une fois, pendant cinq jours, répudiée, remariée un mois après pour la joie. On m’avait donnée à un vieux cheikh et j’aimais mon cousin ; mais je n’osais pas refuser d’épouser le cheikh à cause des cadeaux qu’il m’avait faits. Seulement, pendant les cinq jours et les cinq nuits où je suis restée dans sa maison, je ne lui ai pas permis de me connaître. Dès le premier soir, je simulai la folie et chaque fois que le cheikh voulait me prendre, je devenais comme une panthère furieuse dans la forêt. Alors, le cheikh m’a rendue à mon père. Mon père était fâché à cause de ma réputation. Il criait : — « Que ferai-je de toi ? Qui te voudra désormais ? » — J’ai fait prévenir mon cousin. Il a dit : — « Elle est folle, à mon oncle. Tous les gens le savent. Qui la voudrait ? Donne-la moi, c’est pour te rendre service… » — Tu comprends, ô Mâlema, nous avons bien travaillé pour notre plaisir.
Elle s’éloigne, répondant à un appel des musiciennes qui l’adulent comme toute la féminine assemblée, car elle a la réputation d’être une superbe amoureuse et d’avoir autant d’esprit que d’amour.
Elle entonne une bizarre complainte devenue populaire. C’est l’œuvre d’une prostituée emprisonnée après de hideux scandales et qui rima un poétique plaidoyer de son innocence.
— La chanson de Yamina, murmure l’auditoire.
On chuchote les aventures de la belle, les révoltantes orgies qui furent dénoncées dans cette koubba de Sidi Brahim, les tombes violées par de macabres sorcelleries.
— Tout est vrai, affirme une vieille. Etant déjà menacée de la prison, Yamina a fait voler au cimetière l’œil, la main et un morceau de la cuisse d’une morte. Elle les a fait bouillir, sécher, piler, mélanger à du kouskous que son amant Ali porta comme un cadeau aux juges pour que, l’ayant mangé, ils fussent dans l’impuissance de condamner Yamina. On l’a mise en prison cependant, mais sa peine sera légère.
Enfin les musiciennes commencèrent les litanies saintes.
Le chapelet des noms et des vertus des merabtin s’égrèna.
Soudain, une jeune femme s’élança, — celle-là même qui se refusa au cheikh son époux. — Possédée d’un délire, debout devant l’orchestre, elle s’agitait en mouvements d’abord cadencés qui s’accéléraient jusqu’à la convulsion.
Elle n’avait pu résister à la sollicitation du nom de son saint de prédilection.
Elle dansait, silencieusement enviée par les jeunes filles qui n’ont pas le droit de participer à la danse pieuse. Ses talons nus rythmaient exactement le battement des tambourins, la mélopée des chanteuses. Son visage était nerveusement extatique. Toutes les prunelles s’attachaient à elle. Le derouïche ne fumait plus.
Suivant la cadence, le buste de la danseuse s’inclinait et se dressait. Le geste ailé de ses bras éployait la mousseline des manches larges. Puis, sa tête ballotta, foulards défaits, chaînettes pendantes contre les joues blêmes et mouillées. Un tremblement épileptique la saisit. Elle continua sa danse à genoux et, bientôt, se renversa avec un râle…
Celles qui avaient soutenu ses convulsions épuisées, frottèrent ses tempes avec de l’essence de rose. Elle but un peu d’eau, refit sa toilette avec un soin méticuleux, se pencha sur le kanoun où le benjoin brûlait et, le nom de son saint revenant dans les litanies, dansa encore…
O notre seigneur Brahim, dors d’un sommeil ivre, parmi le poison des parfums, l’ensorcellement du benjoin, le scintillement des joyaux, la litanie des chants et la folie des musiques !… Dors, ô notre seigneur Brahim !…
Les ferveurs trépident dans les fumées bleues… En quel temps et en quel pays cette nuit étrange ? A quels dieux sont dévouées ces vivantes adorations ? A ceux de l’Inde mystérieuse ou à ceux de Babylone et surtout à toi, peut-être, Vénus-Astarté, l’amour… A moins que le Prophète, sous les yeux extasiés du derouïche, ait convié les paradisiaques danseuses autour de ton sépulcre, ô notre seigneur Brahim !…

Le premier rai du soleil levant pénètre dans la koubba, réjouit au seuil de la porte, les deux hommes somnolents, gardiens de l’honneur, de la beauté et des richesses de plusieurs familles.
Le rayon détermine les formes des femmes aveulies dans l’hypnose après l’énervement, ou dans la béatitude du sommeil matinal. Quelques-unes se soulèvent, pâles, paupières épaisses. Des enfants geignent qui s’embrouillent des bras et des jambes, mêlant leurs nudités. Un fou entre, un garçon de seize ans, vêtu d’une seule gandourah déchirée, maculée d’excréments. Dans sa main, quatre brins d’herbes fatidiques. On se détourne de lui, mais nul ne le chasse ; sa disgrâce le fit sacré.
Noura est sortie. Depuis des heures elle étouffait dans l’atmosphère viciée. Elle est sortie le cœur lourd du secret de Mouni, le secret révélé dans le crépuscule de la veille. Et voici ce cœur si triste dans son amour, martyrisé dans ses tendresses, angoissé dans ses espérances, le voici plus pesant d’un poids nouveau, de ce qu’on apprit cette nuit.
Le mari de Zorah est mort, brusquement, sans causes apparentes. La femme qui raconta la chose dit aussi que les deux épouses du défunt avaient été emmenées, la première par ses parents, Zorah par un berger…
Et Noura sait que Zorah a empoisonné son mari…
Elle entend de vieilles paroles de Claude Hervis — « La souffrance et l’exaltation des unes, la révolte et la chute des autres, voilà l’aboutissement de vos leçons. » —
Mouni, Helhala, Djénèt, Zorah…
Ah ! la réalisation de son beau désir, que devient-elle ? Courbée sur la terre ingrate et dangereuse, elle laboure puis sème… Perdue au vent la semence ! Fleurie en floraison mauvaise ! Etouffée par la graine ancienne, germant et se développant malgré le passage du soc.
Richa est retournée aux traditions ancestrales, comme Djénèt, comme Louïz et Merïem qui ont dansé toute la nuit, furieusement, en l’honneur des saints.
Et Mouni voudrait revoir la zmala…
Noura jette un cri de détresse intérieure.
— A moi, Dieu du bien ! S’il est vrai qu’une vie plus parfaite doit nous posséder, si elle n’est pas le but illusoire des souhaits et du travail des êtres d’âge en âge, à moi ! Pourquoi mon amour trop grand, s’il ne doit être qu’un instrument de ruine ? Pourquoi ma volonté si elle est vaine ? O Créateur, détruis ta créature si tu la fis de telle sorte que ses énergies et ses aspirations ne concourent qu’à des douleurs et à des crimes !…
Elle s’est assise sur la margelle d’un abreuvoir, derrière la koubba. Des voitures vont venir qui la ramèneront en ville avec les femmes.
Une vie active s’éveille dans le carrefour où bifurquent cinq routes. Des chariots chargés de fourrage, qui sont comme des meules glissant et oscillant le long des chemins, s’arrêtent, leurs attelages de bœufs ruminant sous le joug.
Des charretiers jurent contre leurs mulets fatigués, arc-boutés sur leurs jambes fourbues, refusant un dernier effort.
Des moutons arrivent en troupeaux, le bouton de la clavelisation à l’oreille, destinés à l’embarquement. Museaux morveux, gris de poussière, au sifflement des bergers, ils bêlent la peur et la lassitude.
A l’ombre d’un frêne, un Kabyle vend des pastèques luisantes. Le soleil monte qui change l’ombre de l’arbre, brûle les pastèques. Alors, patiemment, le marchand prend ses fruits l’un après l’autre et les transporte dans l’ombre nouvelle.
Des vaches maigres, des juments étiques s’abreuvent dans le bassin de la fontaine, puis un poulain jaune, fantastique, bête bâtarde et affamée.
Oh ! puissant ressort d’une nature obstinée ! Avec la lumière croissante, il semble que le visage de Noura a perdu de son souci. La force de sa pensée répond à la muette supplique. Encore une fois, elle espère tout du temps et de la conviction immortelle. Ne subsisterait-il qu’un épi de froment parmi l’ivraie, que cet épi vaudrait l’effort du laboureur et le prix de la semence. La prière matinale de Noura, maintenant est une phrase de Job :
— « Mes espérances descendront jusqu’aux barrières du sépulcre et nous nous reposerons ensemble dans la poussière… »
Une caravane passa… Quelques dromadaires que poussaient des bédouins maigres, la peau tannée par le soleil du Sud et le vent de toutes les errances. Sur les marchés du littoral, les grands sacs de laine rudement tissée et teinte avaient laissé leurs charges de céréales pour se gonfler de produits hétéroclites, pour de nouveaux échanges avec les gens du pays des palmes, les Oasiens sédentaires. Au flanc des dromadaires, les outres d’eau et de semoule, les tamis de crin pris à Tunis, oscillaient. Sur le bât d’une chamelle suitée, un chat dormait blotti parmi des étoffes. Un autre dominait l’amas des piquets et des lambeaux de tentes nomades.
Mêlés aux pattes souples des animaux anciens, des chiens féroces cheminaient, tenus en laisse, et de petits ânes dont l’un portait un vieillard, l’autre un enfant nu, le troisième une femme drapée d’écarlate, allaitant un nouveau-né.
Des adolescents, et des femmes encore suivaient. La plus grande, en guenilles bleues, tête haute, profil puissant sous les tresses et les anneaux barbares, marchait dans la poussière comme Sémiramis, sur les terrasses d’onyx.
Un Bédouin, fils des guerriers numides, prononça une phrase d’amour murmuré et un nom : — « Rekeïa… » Les yeux de la femme altière étincelèrent sous l’orgueilleux abaissement des paupières et elle sourit.
La caravane passa… avec tous les hôtes familiers des logis mobiles, avec des reflets de l’immensité fauve et magnifique des horizons du désert, théorie biblique, comme à la recherche de terres cananéennes.
Heureux celui qui peut s’en aller ainsi, emportant son ciel et sa maison vers le lieu de son désir !…
Et dans ce carrefour, Noura symbolise la France enthousiaste et généreuse regardant vivre ses fils nord-africains, les charretiers de Malte et de Sicile, les Kabyles toucheurs de bœufs, les Bédouins instables et, derrière les murs de la koubba, sur le sol de la conquête, l’Islam virtuellement conquis…

La religieuse, — un parfait visage qui eût pu servir de modèle au Bernin pour sa sainte Thérèse, — la religieuse causait avec la petite Mâlema.
Noura l’avait connue en d’autres temps et l’accueillait, au hasard d’un voyage, avec une petite novice, Kabyle convertie.
— Ah ! disait sœur Bénigne, je suis heureuse de vous voir à la tête de cette mission de relèvement social. Vous souvient-il de la visite que nous fîmes ensemble chez les sœurs blanches de C…? — Vous vous réjouissiez de voir les petits enfants nègres, métis, Kabyles ou Arabes des deux sexes, ayant perdu toute trace d’origine barbare dans leur costume et même sur leur front devenu candide comme il sied à des agneaux de Dieu.
— Je regrettais leur petit nombre et je souhaitais réunir un troupeau considérable.
— Vous avez expérimenté vous-même ce que peut la parole civilisatrice étayée par le bon exemple. Vous avez réussi.
Et Noura répondit doucement :
— Non.
La religieuse sursauta.
— Non, reprit Noura. Avez-vous oublié, ma sœur, que je m’inquiétais d’une expression d’abêtissement et de volupté animale qui couvait dans le regard des jeunes négresses, de la lueur à peine perceptible, mais vivace, qui gîtait dans l’œil des petits musulmans convertis ? Vraiment ils ne chantaient pas les hymnes pieux et naïfs rien qu’avec des lèvres de petits chrétiens ! J’ai acquis cette expérience ; pour réduire à zéro ou à bien peu l’œuvre d’années dévouées et ferventes, pour rendre impuissant et infécond le geste salutaire, il suffit d’une circonstance, d’une influence ou d’un souvenir qui développe brusquement la lueur et l’expression. Savez-vous le formidable pouvoir de survivance de l’héritage des aïeux, de toute la race que chaque être porte en lui ?
— Mais, fit sœur Bénigne, en admettant que beaucoup ploient sous cet héritage, d’autres brisent le joug, se guérissent du mal de la perversité et du mensonge, l’éternel mensonge des musulmans…
— Ma sœur, ma sœur, vous exagérez. Est-ce bien un véritable mensonge ? Je crois plutôt à une dissimulation impassible ou souriante en la forme, dédaigneuse et vengeresse au fond. C’est une sorte d’orgueil dressé sous l’humiliation du vaincu ; une revanche qui consiste à égarer le vainqueur dans des sentiers hors de la vérité. Les Grecs firent d’Ulysse un héros parce qu’il avait le don de dissimulation. Cela n’empêchait pas le geste noble et chevaleresque. Les Arabes ressemblent aux Grecs par plus d’un côté.
— Je ne soutiens rien contre vos déductions et votre science, Noura Le Gall. Mais, pour revenir au premier chapitre de notre discussion, je constate combien fréquemment nos maisons religieuses recueillent d’êtres détachés du grand navire de l’atavisme, ce routinier, et livrés aux vagues du hasard.
— Ils ne se laissent recueillir que parce qu’ils sont des épaves. Un coup de mer, la fantaisie d’une tempête, les jetèrent étourdis hors du grand navire. Quand ils auront repris leurs sens ils rejoindront leur bord.
— Vous êtes fatiguée et triste, Noura. Nombre de ces épaves deviendront de chères petites élues comme sœur Cécile.
Elle se tournait vers la novice convertie qui souriait dévotement.
Sœur Bénigne reprit :
— Vous êtes une pessimiste, ma chère. Ce n’est pas en disant : — « La ville est imprenable. » — qu’on fait des brèches dans les murailles.
Poussée par la contradiction, Noura répliquai :
— J’ai vu ici, trois petites indigènes aller à l’école d’un couvent de votre ordre, trois filles d’un homme lettré, distingué, en apparence ennemi de la routine. Elles étaient vêtues comme des pensionnaires d’un tablier noir au col blanc ; mais elles restaient coiffées d’un petit fez rouge. Ce petit fez étant plus près du cerveau dominera toujours le tablier noir ; c’est le symbole de l’indestructible obstacle.
— A votre tour d’exagérer. Vous arrivez à conclure que nous semons parmi d’irrésistibles ronces. Le Seigneur ne le voudrait pas.
— Nous ignorons le dernier mot de la volonté de Dieu, ma sœur. Se rendre compte ne veut pas dire qu’on a perdu courage. Il faut semer quand même ; c’est l’universel et immémorial devoir des hommes : c’est le geste initial, — conscient ou inconscient, — de toutes les civilisations. Mais la moisson ne dépend pas de nous seuls ; elle est soumise au soleil et à la pluie, à la grêle et à la sécheresse ; elle dépend de Dieu. Semons, sœur Bénigne, semons puisque telle est notre mission terrestre : mais ne concluons pas du fruit des semailles. Nous ne le verrons probablement point. Et pas plus que moi vous ne savez s’il mûrira pour le bonheur humain d’un peuple.
— Bonheur humain ! Que faites-vous du salut des âmes ?
— L’affaire de Dieu.
— Et la nôtre, ma chère… Sœur Cécile, entendez-vous ? De belles conversions sincères et édifiantes ou le simple relèvement moral d’une foule prouveront la bonté de notre ouvrage.
— A mon tour je convertirai les autres, murmura la novice avec onction.
— O petite convertie, songeait Noura, les lumières, les ors, les chants et l’encens qui a l’odeur du benjoin t’exaltèrent ; d’autant mieux que tu avais souffert une enfance misérable. Mais es-tu prise au fond de ta conscience ? Tes sens furent réduits par une volupté mystique ; puis, tu n’es pas une Arabe au sang d’intraitable vagabond ; tu es une Berbère ayant peut-être un aïeul Gaulois. Sois libre quelque jour où un vent chaud soufflera du Sud, où tes yeux et ta peau brûleront… Si la voix d’une raïta sauvage ou de la ghesbâ langoureuse, — du hautbois fanatique et de la flûte pastorale, — se fait entendre qu’adviendra-t-il ?…
La novice au visage d’adoration avait des lèvres qu’on eût plus facilement vouées aux baisers qu’aux prières et ses mains faisaient mieux songer à de frémissantes caresses qu’à l’égrènement du rosaire.
— Ma chère Noura, dit affectueusement sœur Bénigne en quittant la Mâlema, vous êtes dans une période de lassitude. Je sais pour vous un exemple qui agira avec plus d’efficacité que mes paroles. Allez rendre visite à mon amie, la veuve du commandant Soer[38].
[38] Celle dont il s’agit est morte tandis que s’imprimait ce livre. L’auteur veut ici saluer son souvenir de l’expression d’un douloureux regret.
— La touchante héroïne des « Gens de Poudre » d’Hugues Le Roux ?
— Elle-même ; c’est-à-dire, non l’héroïne fantaisiste du romancier, mais une femme de race, simplement exquise.
— J’irai.

La petite gare esseulée au bord d’un lac, la carriole attelée d’une jument jaunâtre, la route qui conduit dans la brousse où vit madame Soer.
Noura, Mouni et un conducteur au parler provençal sont dans la carriole.
Des douars étalent le diss noirci de leurs gourbis. A l’écart d’un troupeau de chèvres, un mulet gris somnole ; de façon mélancolique et cordiale un chien à tous poils hurle contre son museau.
Les collines ont un maquis de lentisques pomponnés de baies rouges, et des lianes épineuses unissent un parfum âcre à l’esprit flottant et doux des narcisses pâles.
Des troncs de chênes-lièges brûlés jalonnent les croupes. Le conducteur conte comment il y avait là des forêts épaisses, vénérables, hantées par les fauves, riches d’écorces. Un jour cinq foyers d’incendie s’allumèrent à la frontière tunisienne. Les flammes chevauchèrent et bondirent avec le sirocco. Le soir, le feu avait dévoré le pays. La forêt est morte ; il reste le maquis repoussé que broutent les chèvres.
Mais, dans un paysage épargné, voici la grandeur des chênes géants aux rudes tuniques passementées de lichens.
Une maison esseulée s’ouvre.
— Je vous attendais, je vous souhaitais même depuis la lettre de sœur Bénigne. Soyez la très bienvenue. Ce n’est point ici un palais. Je ne peux pas vous offrir l’hospitalité ensoleillée de mon pays de palmes et de lumière, pas plus que je ne pourrais retrouver en moi la joie du temps passé, mais mon cœur vous accueille.
Ainsi parle la veuve du commandant Soer. Et Noura s’incline, et Mouni baise les mains de cette fille des Chorfa Fatimites, princesse musulmane sur qui passa le baptême chrétien.
Puis, sous les chênes, madame Soer serrant la main de Mouni et s’appuyant au bras de Noura, ce furent de longues paroles dans l’intimité d’une sympathie spontanée.
Le souvenir du commandant héroïque était évoqué avec le parfait amour des jours enfuis. La créature de rare et délicate exception qu’il avait prise à l’Islam avait su profondément et d’un cœur compréhensif être la femme et la fille qu’il initiait à un monde nouveau.
Mais le malheur était venu ; l’époux dormait dans cet oasis du territoire sahari qu’il créait au temps du bonheur et, après le cruel abandon des palmes chères, la noble veuve vivait en forêt près de sa fille mariée.
Elle avait des larmes et des sourires de réminiscences attendries. La figure brune sous la blancheur des cheveux crêpelés s’altérait ou se détendait. Et c’étaient des choses dites dans un parler pur de grande dame où l’accent arabe ne demeurait que comme une musique.
— Si vous saviez, enfant, combien j’ai étudié dès le premier maître que mon mari me donna ! Pendant que, toujours aux chemins d’avant-garde, il faisait de longues randonnées sahariennes, je m’efforçais d’apprendre vite et beaucoup. Le secret de mon ardeur était dans l’amour, cet amour nuancé de filiale gratitude qu’il avait su m’inspirer. J’ai connu sœur Bénigne. Avec elle je suis devenue chrétienne. C’était la religion qu’il me fallait et qui me rapprochait davantage du monde de mon compagnon… Et mon compagnon a fini son voyage… Il repose près de ma mère la bonne musulmane ; car il est de bons musulmans et, parmi eux, des mères pieuses et justes qui ne se bornent pas à répéter seulement les prières rituelles, mais qui savent instruire leurs filles pour tous les devoirs futurs. Elles savent leur montrer la vie et leur apprennent à y aplanir les routes par l’énergie ou la soumission.
Elle nomma la générale Marmier, — une Arabe aussi, conquise par l’amour, ce conquérant plus souvent victorieux que la simple tendresse ou la raison. Elle s’apitoya sur la misère des Bédouines, mais avec une pitié toute chrétienne et raffinée. Faire des femmes de ces femelles, quel beau, mais grand labeur !
— Je le sais, murmurait Noura.
— Sans doute, vous le savez, chère et courageuse enfant. Ne faiblissez pas. Le bien sera le fruit de votre effort. Nous savons tous ce que sont l’ingratitude et la déception ; pour quelques coupables on ne condamne pas un peuple.
— Et si ces coupables incarnaient l’esprit même du peuple ? Si, pour la cause du bien, on ne pouvait citer à la barre que quelques trop rarissimes exceptions ?
— Ce ne serait pas une raison de ne plus agir. Dans la masse obscure, des exceptions encore attendent la lumière.
Mouni n’avait écouté que les souvenirs de madame Soer. Elle avait découvert avec joie que le commandant avait l’âge de Claude Hervis quand il aima la petite Arabe… Le délai demandé par Noura n’était pas expiré ; Claude pouvait encore revenir… Mouni se pencherait sur la terrasse et guetterait dans les ruelles creuses l’écho des pas reconnus…
Pour Noura, elle emporta de la maison forestière une âme vivifiée. Elle se fit un nouveau serment.
— Je ne veux plus que rien chancelle en moi. Que ma foi dans le bel aboutissement reste entière ! Il se peut que ma vie ne soit pas assez longue pour parvenir ; mais je laisserai le flambeau de mon expérience pour guider ceux qui viendront après moi, avec la possibilité d’appliquer un système plus vaste et plus efficace, dérivé du mien, peut-être. J’accomplis dans les limites de mon champ d’action, de la volonté et de la résistance humaine, mon travail de précurseur et d’annonciatrice. A d’autres appartiendra le soin d’affirmer et de généraliser la doctrine.

Le dispensaire… Une vieille koubba désaffectée, dortoir militaire au temps de la conquête, bien communal et infirmerie aujourd’hui. Une doctoresse y dirige une clinique et donne ses soins aux femmes et aux enfants indigènes.
Noura est allé chercher la malheureuse mère et les petits vus le soir de la fête à Sidi Brahim. Elle les amène à la consultation.
Des clientes et leur glapissante progéniture envahissent la cour.
Par les escaliers accédant à une coupole où s’accroche une vigne séculaire, la Mâlema voit descendre la bouffonne habile en l’art de mimer le poème de la vie. La bouffonne bavarde avec les habituées, très petites bourgeoises, femmes du peuple ou prostituées ; car les filles de bonne maison ne vont point au dispensaire. Avec un esprit aiguisé la bouffonne déchire des réputations.
Noura a présenté ses protégés à la doctoresse et la félicite de l’installation de son infirmerie.
— Ah ! mademoiselle, il y aurait mieux à faire, mais l’argent manque. Enfin, c’est un commencement. Je n’ai que trois malades pour le moment. Le danger c’est que, guéries, elles ne veulent pas partir, étant pour la plupart des abandonnées. Et, puisque j’ai cette occasion de vous entretenir, que je vous dise ; en faisant la leçon aux futures mères de famille que sont vos élèves, persuadez-les de ne pas tuer leurs enfants avec de l’opium. Regardez.
Elle montre un nourrisson comateux étendu sur les genoux de sa mère et dont les yeux ouverts ne voient point.
— Voilà ! s’écrie la doctoresse. Pour que l’enfant ne trouble pas le sommeil maternel on lui donne des décoctions de pavot et, celui-ci devenant insuffisant à la longue, on use de l’opium. Cela d’ailleurs sans la moindre intention mauvaise. Je m’insurge et prêche contre la dangereuse pratique, faisant son procès devant les intéressées, mes confrères et tous ceux dont la bonne volonté veut l’amélioration des musulmans. Le procès ne doit-il pas être gagné ?
— Certes, répond Noura ; mais vous savez combien sont longues les généreuses campagnes.
Elle tressaille. Des mots saisis dans un bavardage la font pâlir. — Oureïda bent Derdour va mourir. —
Elle sort. La maison des Derdour est voisine. Elle heurte à peine, pousse la porte brusquement… L’amertume et l’ombre du deuil anticipé sont déjà dans ce logis.
Dès le seuil de l’appartement où la douleur des femmes est encore silencieuse, Noura ne voit que la marmoréenne figure d’Oureïda.
O « petite rose », pourquoi les jeunes corps sont-ils si débiles qu’ils ne peuvent porter longtemps le poids des âmes lourdes, trop lourdes de sucs nombreux, de parfums essentiels et graves ?
O « petite rose », si tu devais mourir parce que ton âme était comme une aile qui s’ouvre et s’élargit, prête à l’envol sacré, immense ; comme une large fleur épanouie dont les pétales vont essaimer ; comme le fruit mûr et savoureux qui se détache de l’arbre ; ô « petite rose », si tu devais en mourir, pourquoi n’avons-nous su te faire une âme légère, tranquille comme une aile fermée, fraîche comme une fleur à peine entr’ouverte, attachée à l’arbre comme le fruit vert ? Pourquoi n’as-tu pas possédé seulement l’âme de tes aïeules ?
Nous entendons un chant terrible et doux, le chant de la Mort en marche. Elle a préparé les sombres noces de ton printemps. Hélas ! hélas ! hélas ! qu’une saison est courte !… Si un monde s’évanouissait après une seule saison, l’Univers se révolterait. L’Univers se révolterait et les Dieux repentants, devant la juste colère des hommes, ranimeraient le monde.
O Dieux ! ceci est inique ; la fin d’un enfant. Pour nous, la vie de cet être était aussi vaste et précieuse que celle d’un monde : ranimez-le !…
Les Dieux sont sourds. L’Humanité le sait. Elle ne dénombre plus les planètes mortes, les soleils éteints, les âmes enfuies, les corps dissous. La voix de la révolte, la clameur désolée ne couvre pas le chant terrible et doux de la Mort en marche… Elle vient au printemps sans que l’émeuvent les promesses de l’été. Elle vient en été sans entendre les désirs de l’automne.
Elle vient…
Oureïda dormait… Dans ce sommeil elle commençait à mourir.
Noura se pencha, cherchant avec angoisse le souffle léger, puis elle s’assit au bord des tapis sur lesquels reposait son amie et des larmes creusèrent ses joues.
Mais Oureïda ouvrit les yeux. Elle ouvrit les yeux, vit le muet désespoir des femmes de sa maison, l’angoisse de sa mère. Elle sentit les pleurs de Noura sur ses mains… Elle eut cet intraduisible sourire de ceux qui savent et qui acceptent.
— Tu es venue, ô Mâlema, et tu pleures. A quoi cela servira-t-il, je te prie ?… — Elle ébauchait un geste de lassitude. — A quoi sert la science puisqu’elle n’empêche pas de mourir ?…
Elle reprit lentement :
— Le ver qui me rongeait la poitrine a fini… Vous fermerez mes yeux avec des caresses… Vous me laverez doucement. Mes longs, longs cheveux, vous les dénouerez et vous les laisserez dénoués pour qu’ils m’enveloppent dans le tombeau. Vous me mettrez les bijoux des jeunes épousées, la robe neuve de brocart mauve et, sur ma tête un seul foulard aux franges d’argent…
Elle attira Noura contre sa bouche et murmura à la faveur des sanglots :
— Je ne crois plus au Koran, je ne crois pas à l’immortalité ; je n’ai pas voulu d’autre croyance parce que, avant tout j’étais une Arabe fidèle à sa race. Il y avait trop de choses dans mon cœur et dans ma tête ; elles m’ont tuée…
Elle dit encore, et l’effroi fluait dans ses larges prunelles.
— Je n’ai pas peur de la mort ; mais c’est la première nuit dans l’ombre du tombeau qui m’épouvante… Elle doit être si longue et personne ne sera près de moi ! Fait-il froid dans la terre ?… Je m’habituerai…
Oureïda est morte.
Déjà la nouvelle bondit de terrasse en terrasse. Les pleureuses et les ensevelisseuses accourent. Elles accourent pareilles aux corbeaux qu’un cadavre fait voler des quatre horizons…
Elles sont si habiles que prompte est la funèbre toilette. Et voici Oureïda, ses ultimes désirs accomplis, échappant à l’horreur étroite du suaire, enlinceulée d’une robe de brocart et de sa chevelure fabuleuse…
Oh ! la beauté suprême de la plus belle des Endormies pour l’éternité !…
Maintenant, criez, ô pleureuses ! Vous toutes, femmes qui l’aimiez, déchirez vos visages avec frénésie ! Que les pleurs se mêlent au sang des joues lacérées ; qu’ils deviennent des larmes rouges, brûlante offrande à la morte blanche au tendre linceul. Que les déchirures soient profondes, qu’elles flétrissent longtemps votre charme, ô vous qui vivez encore !
Toi, la Bent Fraîchichi, chante selon l’usage, un chant digne d’Oureïda.
La Bent Fraîchichi se livra toute à son inspiration.
[39] Fard noir pour les sourcils.

Deux palmes sèches virent au vent sur un tumulus de terre rouge, au cimetière musulman.
Le monument rituel n’est pas encore édifié sur la sépulture d’Oureïda bent Derdour ; mais la morte a déjà passé sa première nuit redoutée dans le tombeau.
Balancée au pas des porteurs, sur la civière recouverte d’un voile vert que soulevait un cercle de bois, afin de cacher aux regards les formes féminines, on l’a portée accompagnée par une multitude. Une multitude, car sa réputation de beauté, de bonté, de grâce et de sagesse était connue et louée par toute la ville arabe. Les jeunes gens pleuraient de songer qu’elle n’était plus.
Sur le cadavre sans cercueil, suivant la coutume, on a posé deux planches. L’argile a comblé la fosse et les imans ont dit les prières.
Tous les jours, pendant longtemps, à des heures différentes, le père avec ses amis et la mère avec les parentes et les intimes, viendront prier et visiter la tombe d’Oureïda. Ils parleront d’elle et l’oubli n’atteindra pas leur mémoire.
Ce matin, comme Noura Le Gall vêtue de noir franchissait la porte du logis en deuil, un homme l’a croisée dans la pénombre de l’antichambre, un homme au visage pâle et douloureux. Elle a reconnu le père. Il ne l’a pas saluée. Le mari de Lalià, la petite Française, — qui redouble d’amour et d’attentions pour sa femme afin de la consoler un peu, — répondit comme à regret aux paroles de la Mâlema. Ils la jugent coupable.
Et Noura est venue au cimetière, douloureusement.
Elle est seule dans du soleil. L’odeur de la terre fraîchement remuée lui fait mal. L’esprit d’Oureïda entend-il la pensée triste comme un remords ?
— Si je fus pour une part dans ton trouble, dans ton inquiétude et ton incrédulité, pardon « petite rose ». C’est une chose cruelle en vérité que de faire du mal en souhaitant le bien. Claude Hervis, pourquoi n’ai-je pas pris garde à l’avertissement de ce philosophe ? — « Ménagez-le. Laissez-le dans sa solitude. Voulez-vous le briser entièrement ? Il s’est fêlé comme un verre où l’on verse un liquide trop chaud, — et il était d’une matière si précieuse ![40] » —
[40] Nietzsche.
La fêlure s’est élargie jusqu’à la mort… Ah ! le châtiment n’est-il pas plus grand que la faute !…

Avant la leçon, Noura compta ses petites brebis. Il manquait Mimi.
Les leçons étaient plus simples et plus brèves depuis la mort d’Oureïda. Dès la fin de celle de ce jour, Noura fut chez les parents de Mimi.
L’enfant avait un peu de fièvre ; mais elle courut vers la Mâlema.
— Emmène-moi promener. O ma mère, laisse-moi aller avec elle ; je guérirai.
Elles sortaient et rencontraient le père. C’était un lettré. Il tenait un journal et donnait à Noura les dernières nouvelles d’un Maroc sanglant. Après les Beni-Snassen révoltés, les charges de Casablanca qui avaient fait tant de victimes et de héros, les harkas fanatiques des Berabers montaient du Touat et du Tafilalet. Encore une fois le Sud Oranais sentait la poudre et le massacre.
Claude Hervis, dès le début des hostilités avait énoncé son opinion. — « Le premier geste sanglant fut provoqué par la peur, disait-il. Depuis longtemps, la pensée islamique de ceux du Maghreb s’inquiétait de l’envahissement de l’Europe. Elle préconçut l’extermination sous le talon du progrès. Des voix chuchotèrent, un regard provoqua, des voleurs surgirent en quête de rapines. Une heure écrite était là. Le vent des nefras[41], des razzias, le goût du sang et des luttes incessamment renouvelées de sultan à partisan, de maghzen à tribus, grisèrent le peuple et réveillèrent d’autres appétits. Puis, le Maroc moyen-âgeux se méfiait d’un souverain faible et trop moderne ; les grands brigands et les prétendant soufflaient la guerre, promettaient la victoire, l’honneur et le butin. » —
[41] Émeutes.
Devant la lenteur des premières représailles et aux discours de certains quotidiens, souvent, Noura s’était exaspérée dans une belle exaltation chauvine. Elle rêvait insensément d’une chevauchée victorieuse, d’un splendide galop épique de nos cavaliers, avec des armes luisantes, des drapeaux claquants ; un galop qui dispersait les rebelles, les terrifiait et les éblouissait jusqu’à la soumission spontanée, au vertige qui ralliait tous les cavaliers ennemis sous le drapeau tricolore de cette guerrière fantasia.
Noura était trop Française et indépendante pour admettre volontiers les concessions de bon voisinage, l’imbroglio des considérations et des susceptibilités internationales. Les récentes opérations plus libres et les engagements fougueux la rassérénaient. Mais, pour un petit soldat rencontré dans la rue, pensant que demain peut-être il serait là-bas, râlant, poitrine trouée pour avoir obéi au devoir et à l’élan de sa bravoure, une sensation violente et douce étreignait son cœur. Elle vouait une admiration émue, une fraternelle et fière tendresse à ce soldat qui souriait si simple, sans arrière-pensée parmi le va et vient des civils dont il défendait la quiétude. Et elle détestait ces civils de n’être pas soldats et de commenter sans passion les événements meurtriers.
Le père de Mimi, Si Lakhdar parlait avec un accent impersonnel.
— Ah ! ces Berabers, ce sont des lions qui montent du désert.
— Tu te trompes, répliqua la Mâlema, ce ne sont que des chats sauvages.
— Les chats sauvages sont mauvais quand ils sont nombreux.
— S’ils sont las de vivre, les légionnaires, les spahis et les goumiers les attendent.
— Ceux-ci voudront-ils toujours se battre contre des musulmans ?
— Ils se battront parce que leur mère ordonne, la France, dont ils sont devenus les fils.
Les yeux de l’Arabe se firent plus vagues, mais Noura les sentait brûler.
— Les Berabers ne veulent pas la France. Ils préfèrent rester semblables à leurs pères et à leurs mères. Qui a raison ?… Regarde-nous.
La petite Mâlema se redressa.
— Je regarde. Vous êtes heureux. Vous le serez davantage en vous rapprochant encore de nous. Nous vous avons délivrés et consolés de vos chefs turcs. Nous avons dit : — « Vous êtes nos frères. » — Et nous avons agi. Notre Gouvernement a pris souci de vous comme un général de ses soldats favoris. Il savait que vous aviez souffert, il voulait vous faire oublier la souffrance, vous traiter comme des égaux. Le nierez-vous ? Quiconque ne se souvient pas d’un bienfait est indigne de sa religion.
Si Lakhdar eut un sourire ambigu.
— Dieu connaît tout. Il juge et il est miséricordieux. Il en existe comme le Gouverneur de ce temps, comme toi et quelques autres qui sont pour le bien et la justice, — sur eux la bénédiction ! — Ces justes pensent : — « Les musulmans sont des hommes et ils étaient des seigneurs. » — Mais combien hurlent : — « Ce sont des chiens qu’il faut abattre, des serpents qu’on doit écraser. » — Que répondrons-nous à ces chiens d’un autre pays qui sont venus aboyer sur nos terres ?
— Vos terres sont à eux, à nous, comme elles furent à vous ; par droit de conquête. Mais fermez l’oreille aux hurlements stupides et pardonnez, n’y aurait-il qu’un seul juste.
Le père de Mimi avait encore des griefs.
— Vos colons ont pris les pâturages de nos tribus. Les gardes forestiers défendent l’inutile broussaille des forêts. Le procès-verbal étrangle le fellah et les troupeaux ont faim.
Noura savait bien cette plainte quelque peu justifiée, cependant elle répondit :
— C’était le droit du vainqueur de disposer à son gré de la terre conquise. D’ailleurs nous n’avons pas réduit votre bétail à la famine ; il reste des prairies et des maquis. Si nous défendons la forêt, c’est que vous êtes de grands destructeurs contre lesquels on doit sévir. Il suffit du moindre besoin de pâturage nouveau ou d’une rancune pour qu’un incendie s’allume dans une boule de mousseline, arrachée au turban d’un berger, cachée sous des feuilles sèches ; dix mille hectares de forêt flambent et une fortune s’en va en cendre et en fumée.
— Mais tu sais bien qu’il y a des têtes vertes[42] qui mesurent l’avancement au nombre des procès infligés ; mérités ou non, que leur fait cela !
[42] Gardes forestiers.
— S’il y en a, je les déteste et ce ne sont pas des Français.
Si Lakhdar, sa petite fille et la Mâlema avaient gagné la rue haute qui domine la ville et s’achève en route sous des caroubiers.
L’Arabe passait sa main fine sur son visage de citadin dont les traits s’épaississaient. Il caressa sa barbe noire et luisante, examina attentivement une sardoine gravée de son nom et qui formait le chaton d’une bague à son petit doigt.
Il se remit à parler.
— Je te dirai une histoire. Nous avions un champ où pâturaient les troupeaux de mon grand-père et du grand-père de celui-ci. Des hommes vinrent dont les concessions entourèrent nos terres. Peu à peu leurs labours s’étendirent, entamèrent notre domaine. Un jour d’entre les jours, ils eurent envie du domaine entier, — un de ces Roumis était puissant près du beylik, — et le beylik nous dit : — « Allez-vous-en. Vous serez payés. ». — Des années, nous avons attendu l’argent. Les troupeaux sont partis, vendus. Déjà l’usurier avait mangé le poil et la viande ; il a rongé les os. Quand l’argent est arrivé, il était à peine la valeur d’un olivier. Il y avait si longtemps ; le beylik avait oublié le chiffre de sa dette. — Et cette histoire est celle de plusieurs. Ah ! si quand un Gouverneur est bon, il pouvait tout voir lui-même, cela n’arriverait pas. Mais on lui cache la vérité, puis on l’accuse alors qu’il n’est coupable de rien…
Sa voix devint mélancolique.
— Notre noblesse est finie. Mon père qui pouvait avoir des cavaliers est devenu maquignon. Moi je suis taleb. Mes cousins font du commerce avec les chrétiens et les trompent parce qu’ils ont été trompés. Ils n’avaient plus d’argent ; ils se sont faits marchands comme on se fait voleur ; ils sont au rang d’un M’zabi.
Il poursuivit fortement :
— Il y a beaucoup de marchands parmi les chrétiens. Et la France n’a-t-elle pas assez de princes et de soldats que ce sont des marchands qui la gouvernent ? Mais je m’en irai ! Je m’en irai dans le Sud, loin, là où sont les aghas ou des Bureaux arabes avec des chefs qui n’ont peur ni d’un cheval ni de la poudre, des chefs selon nos cœurs. Je préfère obéir au sabre qu’à la balance. Je préfère le salut d’un officier à celui de ton Président de la République. Un officier n’a pas peur de se battre, tandis que ton président se cache dans Paris.
— Si Lakhdar, tu m’offenses, dit froidement Noura.
Il ferma ses paupières à demi. Il eut un accent très doux.
— Je t’ai dit ma pensée comme à un ami. Pardonne-moi de t’avoir offensée.
— Je te dirai aussi ma pensée, reprit Noura. La misère ou la déchéance ne sont pas la faute d’un seul. Il y a trop de paresse et d’ignorance parmi vous ; et pour être belle et riche, la vie exige le travail des hommes.
— Le travail ! Considère les fellahs aux pieds crevassés comme l’argile sèche, aux membres maigres, griffés par les épines du labour.
— Le labour qui ne donne pas de peine et peu de moisson, à fleur de terre, autour des jujubiers sauvages ? Même ils hésitent à user de la charrue française ; il faut plus d’entretien et elle creuse plus profond. Cela changera quand ils auront tous compris et voulu.
— Ecoute, ô Mâlema. J’en connais qui prirent la charrue française. Elle obéissait mal aux mains arabes. Elle coûtait cher de réparations et d’entretien, de harnais pour les bêtes. Le surplus de la récolte était mangé deux fois. Alors, ils revinrent au bois dur ferré d’un peu d’acier, au joug fait d’une branche qui se fixe au garrot des bœufs où sous le ventre des mulets, avec un harnachement qui est un morceau de sac, une corde de laine, des ficelles d’aloès. La charrue cassée, on la répare avec le bois de la broussaille et rien ne mange la récolte en herbe. Et je connais un gros propriétaire arabe, — de ceux qui restent ou qui peuvent racheter des champs ; — il pense comme le fellah.
— Ah ! ton fellah n’est pas qu’un laboureur paisible. Il est pillard et quelquefois assassin.
— Par vengeance. Tous les hommes ont connu la vengeance depuis les premiers fils d’Adam.
— Je vois en tout et surtout le mal de l’ignorance. Le fellah n’a qu’un pauvre labour à cause de l’ignorance ; et il vole et se venge parce que c’est un barbare qui ne sait pas discerner le geste défendu du geste permis.
Il y eut un silence, puis les gazouillements de Mimi qui sautillait dans le bruit fin de ses khelkhal.
Si Lakhdar dit encore :
— Mieux vaudrait apprendre la justice que la science aux hommes.
Ils revenaient vers la ville. Deux tirailleurs les heurtèrent qui parlaient de femmes et empestaient l’alcool.
— Ils sont ivres, s’écria le père de Mimi. Voilà la caserne ! On y oublie les paroles du Livre… Ils sont ivres… Et vous voulez avec le service obligatoire rendre tous nos fils pareils à ceux-là ? Malheur ! N’avez-vous pas peur de la révolte ? Prenez les portefaix, les sans-famille, les Kabyles et les vauriens qui traînent ; faites-en des soldats qui se battront contre le Prophète même ; mais ne touchez pas à nos fils ! Ils demeureront soumis, s’ils l’ont promis ; mais ne comptez pas les obliger à renier la face de leur père ni à tuer celui qui lève le drapeau des batailles d’autrefois. Aaâ ! Puisse la France être forte…
Et Noura les yeux en flamme, une belle colère au visage :
— La France sera toujours assez forte pour écraser tous les étendards verts qui claqueront !…
Ils se séparaient désormais hostiles l’un à l’autre.
Et jamais Noura ne devait revoir Mimi…

« De la part de notre seigneur, le généreux agha Bou-Halim — que Dieu le protège ! — à Noura Le Gall, la Mâlema, — que le salut soit sur elle ! —
« Et ensuite, apprends notre douleur et la volonté de Dieu.
« La volonté de Dieu est prompte comme l’éclair, forte comme le tonnerre et terrible comme la foudre. La volonté de Dieu nous a abattu.
« Notre douleur est comme un précipice d’où notre esprit ne peut remonter. Nos larmes ont formé un lac d’eaux amères. Cependant nous avons accepté la volonté de Dieu, car Dieu aime la résignation.
« Et apprends le deuil et le malheur. Notre fille Fatime, — sur elle la miséricorde et la récompense ! — notre fille chérie a laissé « monter son âme », il y a maintenant trois jours, au coucher du soleil, après la prière du Maghreb.
« Elle voulait repartir pour retourner chez toi et chez notre fille Mouni. Après avoir habité notre maison, elle voulait encore habiter la tienne. Mais Dieu en avait décidé autrement.
« Elle est morte à cause d’une mauvaise fièvre. Le soleil a touché sa tête, son sang s’est empoisonné, son esprit s’est égaré. Elle a parlé à son mari mort et à toi, ô Noura. Elle est ensevelie dans le sépulcre de ses pères, les saints merabtine et les anges l’ont récompensée.
« Et maintenant, il n’est pas une femme dont le visage ne saigne à cause du deuil qui est pour tout le peuple. Et notre cœur ne se consolera pas.
« Elle était pieuse, son conseil était droit, et son rang près de Dieu et des gens magnifiques. Elle était la dame des dames et le flambeau des ténèbres…
« Et ensuite, apprends que tu recevras la visite de notre fils Si Laïd, — que Dieu le protège ! — Son message est de te donner les bracelets de Lella Fatime, pour la mémoire de ton cœur et de tes yeux, — et ensuite de te dire notre affection et notre désir.
« Et le salut sur toi, ô la nièce de notre fille préférée, à Noura Le Gall, la Mâlema, et le salut sur Mouni dans notre cœur.
« Salut. »

Au heurt précis de l’anneau de cuivre, Doudouh la servante ouvre, introduit le visiteur.
Et voici paraître Noura, pâle, si pâle de tant de larmes répandues pour la mort plus cruelle par l’éloignement, pour la brutale épreuve inattendue et pour l’angoisse de ce qui peut advenir encore.
En cet instant surtout, elle donnerait tout au monde pour retrouver, même fugitive, la présence de Lella Fatime, de cette âme si différente de la sienne, mais qui pourtant était son seul refuge familial.
L’expression de Si Laïd est bizarre et ses yeux ne fixent pas Noura. Des reflets troubles passent sur sa figure qu’il voudrait immobile, empreinte de la seule tristesse qui convient à un messager de deuil.
Il a posé sur le piano le paquet qui contient les bracelets de Lella Fatime, ces anneaux d’une chaîne rompue.
La voix de Noura s’élève, frissonnante.
— Si Laïd, parle, fais-moi la grâce de ne pas attendre pour me dire… Quel est le désir de Bou-Halim ?
— Bien. Qu’il soit fait selon votre volonté. Mon père Bou-Halim est vieux. Ses jours sont comptés. Il est malade et gangrené ; sa fin peut venir bientôt. Moi, j’ai levé un goum ; les chevaux reniflaient à l’odeur des batailles marocaines. Un chef n’est vraiment chef que là où on se bat. Je pars. Mon nom sera dans les bulletins de victoire et partout où l’on aura galopé et versé du sang. Mais je peux mourir aussi. Lella Fatime n’est plus. Vous n’êtes pas de notre famille, Noura ; vous avez refusé d’en être. Mon père et moi, nous avons songé au sort de Mouni. Mouni est une femme ; il est temps qu’elle commence sa vie de femme et connaisse un mari ; car il n’est pas bon pour les jeunes filles de demeurer seules et ce n’est pas l’usage en Islam…
Il ajoute doucement :
— Je suis venu chercher Mouni. Mon père l’a promise en mariage à notre parent Cherïef-Soltann.
Noura chancelle. Elle a pressenti le coup terrible ; mais cela n’empêche point qu’elle en soit assommée.
Puis, elle crie désespérément :
— C’est impossible !
Si Laïd raille, conscient de l’étendue de sa revanche.
— Qu’est-ce qui est impossible ?
Les prunelles de la petite Mâlema s’égarent et s’affolent sur une vision lointaine… Les Grandes Tentes, les vieilles et les jeunes épouses, les négresses, les Amourïat, les concubines, les antiques et révoltantes promiscuités… Et Mouni sera là-bas, la proie d’un Bédouin !
— C’est impossible ! Mouni ne voudra pas.
C’est l’ultime espérance.
Une colère marbre la face de Si Laïd.
— Elle voudra. Pourquoi préférerait-elle l’amour de l’un des vôtres à celui d’un homme de sa race ? Je sais qu’on objecte notre polygamie. Mais nous n’avons pas dix maîtresses cachées, et tous nos bâtards sont légitimés, et la négresse fécondée par notre amour ne reste pas une servante ; elle prend rang parmi les épouses ; elle est la « mère de l’enfant ». C’est ce qu’on appelle un exemple de moralité, je crois. Puisse-t-il servir au monde chrétien, ce dépravé hypocrite dont les pères renient les enfants de l’amour.
— Ah ! fait Noura, tu ne me prendras pas Mouni. Elle souffrirait. Je ne veux pas…
Et c’est la voix de Mouni :
— J’ai souffert ici… J’ai tout entendu. Salut à toi, mon frère. Noura, par ton cœur, laisse-moi partir ou je finirai par mourir comme Oureïda.
Mouni est lasse d’avoir vainement espéré, de s’être vainement penchée sur l’ombre des ruelles pour guetter la silhouette attendue. Elle est lasse du vœu stérile qui souhaitait tant de choses dans le court espace d’un mois… Et il n’est advenu que des épreuves.
Elle s’adresse à Si Laïd.
— Je n’épouserai pas Cherïef-Soltann ; mais je veux bien revoir mon père et prier au tombeau de ma sœur.
Sur son petit visage décidé, au souvenir de Lella Fatime les larmes coulent, sans contracter les traits ravissants.
Une folie s’empare de Noura. Elle voudrait se rapprocher de Si Laïd, détruire un peu de la vengeance et de la fatalité en prononçant des mots qui la livreraient au jeune homme. Ainsi, elle ne quitterait pas Mouni… Mais elle se raidit, dans une révolte et une tension éperdue de toutes ses fibres. Elle sent à peine les bras tendres et rebelles qui l’enlacent. Elle entend à peine l’accent caressant et obstiné qui murmure :
— Je reviendrai, mais laisse-moi partir maintenant ou je mourrai à cause du chagrin…
Noura imagine un monstrueux oiseau, un oiseau de proie, envolé, ayant dans ses serres prudentes une palombe grise. Et la palombe est ivre d’espace et ne sait pas quel sera son martyre dans l’aire du ravisseur…
Et puisque Noura ne peut tuer l’oiseau ni retenir la palombe, elle voudrait que la porte soit déjà refermée sur Si Laïd, que déjà Mouni soit livrée à cette revanche du destin arabe…

La colline dont la terre est rouge, dont les roches se creusent et se déforment sous les pluies et les grandes rafales levées sur la mer. La colline où les bleus iris fragiles affrontent le hérissement sauvage des palmiers nains, des lentisques amers.
Près d’une grotte naturelle aux tons d’ocre et de sienne, un sanctuaire sans coupole, badigeonné d’un bleu intense. Au seuil, la tombe d’un saint.
Dans un gourbi de diss et d’épaves jetées à la côte, un Arabe solitaire soupire ou chante des fragments de mélopées qui ne veulent rien dire et n’ont ni commencement ni fin.
Des femmes pieuses donnent une fête au sanctuaire, isolé dans le vacarme des houles ou le silence des rochers. Elles donnent une fête pour le souvenir d’Oureïda bent Derdour auquel s’unit celui de Lella Fatime.
Noura est avec les femmes que sa douloureuse expression rend graves. Elles savent mal la véritable raison de la douleur. La Bent Fraîchichi allégua que ce pouvait être un chagrin d’amour et les autres ne comprennent point qu’on soit amoureuse jusqu’à la souffrance. Elles ne le comprennent point, elles qui subissent ou excitent les passions des hommes, en toute force de malice et de liberté de cœur, ne se donnent pas le souci d’aimer.
Au faîte de la colline, les bras noirs d’un sémaphore rayent un ciel de soie tendre, à la vastité sereine. Une vache brame dans le jour tombant ; des chèvres se poursuivent, troupeau qui regagne un bercail éloigné. Un petit berger achève la chanson de l’Arabe mélancolique.
Noura rêve, assise sur le tombeau du saint merabet. Elle se sent la proie du pire découragement, celui que l’esprit fatigué approuve et justifie.
Elle rêve de vous, ô féminines créatures du suprême Islam. Elle est celle qui, tout éveillée et sans pouvoir magique a pénétré dans votre royaume plein de sortilèges. Elle vous a connues, ô les Enchantées, les Endormies au bercement de la coutume. Elle a vu votre quiétude en le nonchaloir voulu de l’ancestrale tradition qui vous asservit doucement, mollement, par la lente pression de l’habitude séculaire. Et vous êtes depuis des ans si longs dans la perdurée d’anciens parfums, de liens indestructibles ou dont le brisement est dangereux !
Elle a été punie, — savez-vous combien rigoureusement ? — d’avoir osé toucher vos hiératiques et séduisants visages, des visages d’idoles dont on verrait l’âme illusoire à travers les prunelles d’émail… L’âme illusoire ou l’âme dormante… O idoles, chères idoles de jadis et d’à présent, quand on veut vous réveiller cette âme frémit, se dérobe, rétractile, ou se débat et souffre jusqu’à mourir d’avoir essayé de trop vivre. Souvent, elle double son instinct primordial d’une intelligence trouble, d’un mauvais désir, et la petite idole arrachée à la sérénité du temple roule dans la fange…
Et il se peut que le seul salut, ô profanées, soit le retour au sanctuaire, dans l’ombre chaude, le doux clair-obscur musulman parmi les encens attardés…
Mouni est partie hier. Noura partira demain. Mais elle n’ira pas vers les Grandes Tentes hostiles ; elle demeurera dans la ville de ses amitiés, près d’une affection qui sache apaiser son mal et défendre son courage contre l’anéantissement qui le guette après ces heures où elle le sent crouler.
Et elle sera plus près de Mouni quand Mouni voudra revenir vers elle, si Mouni revient…
Si Mouni revient… Oh ! puisse la voix franque, la chanson apprise parler en elle plus haut que la mélopée des champs d’alfa ! Puissent Mouni résister au vœu de son père, repousser l’union projetée et Cherïef-Soltann, qu’on dit d’esprit noble et généreux, admettre la résistance de cet enfant.
La Mâlema parle aux femmes :
— Je suis avec vous pour le souvenir et pour vous dire adieu. Je m’en vais, pour un temps. Je ne sais pas la date de mon retour ; ce sera celle du retour de Mouni. Ma maison est vide depuis son départ et je souffre de ne plus voir le visage de « mon enfant » parmi ceux de vos filles. Les mères doivent me comprendre. Je désire que mes leçons ne soient pas toutes oubliées et que vous me gardiez votre pensée. La distance n’y fait rien ; je serai toujours votre sœur. Vous êtes mes amies et vous savez que je vous aime. Longue vie sur vous ! Soyez récompensées par le bien ; car vous avez pleuré à cause de Lella Fatime et de ma douleur. S’il plaît à Dieu l’absence sera brève et prochain le jour de la réunion.
Et toutes s’écrient :
— S’il plaît à Dieu !…
— Ceux qui dorment ne vivent pas. Guerre à l’hébétude et à l’inertie ! Pour tous les peuples et pour tous les hommes, le droit à la vie de virtuel doit devenir effectif.
— Et si conquérir ce droit effectif mène à la mort ?…
Quand Si Laïd partit avec ses cavaliers, un autre goum revenait de Casablanca. C’était celui qu’avait levé, le premier, Cherïef-Soltann.
Les cavaliers étaient encore ivres de la bataille. Une multitude émue et tumultueuse acclamait leurs noms, une multitude en joie, car des chevaux seuls étaient morts ou perdus et les quelques blessures des goumiers guériraient vite.
Les étalons et les juments bondissaient, mufles baveux, crinières déchevelées ; la clameur triomphale des hommes répondait aux cris d’accueil.
Les terrasses de la bourgade désertique grouillaient de femmes et les yous-yous stridaient excitant le délire de l’enthousiasme. Ils vibrèrent plus suraigus quand les cavaliers défilèrent devant les logis de l’agha Bou-Halim. Ils saluaient le noble Cherïef-Soltann…
Cherïef-Soltann… la sublime et romantique figure d’un Abencérage à la barbe grise, un chevaleresque héros de piété musulmane sans péché, de loyalisme sans calcul ; mentalité rare, dont l’unique souci était la volonté et l’accomplissement du bien dans toute la possibilité humaine et la sublunaire espérance.
Dans la sincérité de son serment de fidélité, depuis des années ce rallié servait la France contre tous les fanatismes.
Cherïef-Soltann appartenait aux temps épiques et à l’ère patriarcale.
Il ne condamnait point, laissant à chacun la responsabilité de ses actes et le soin de les justifier en soi-même. Il ne généralisait jamais ; quelques brebis galeuses ne provoquaient pas en lui la mésestime du troupeau entier. Il attendait tout de la justice divine, confiant en l’équité du Rémunérateur.
Et la voix populaire disait :
— Cherïef-Soltann est un saint aimé du Prophète ; des miracles fleuriront autour de son tombeau.
La renommée de Bou-Halim était celle d’un fanatique et d’un puissant. Il gardait ses partisans par la superstition et la crainte. Mais quand l’impôt religieux devenait pénible à arracher aux serfs, il pensait que si le prestige de Cherïef-Soltann s’alliait à son influence, la zïara serait plus facile et plus abondante. Alors, il jugea utile de rapprocher une parenté lointaine en donnant Mouni pour femme au vieux Cherïef-Soltann…
— Regarde passer ton seigneur, dit la Soudanaise, debout avec Mouni sur une terrasse.
— Mon seigneur ? Jamais ! riposte l’enfant de Noura.
— Es-tu folle ! Quelle part plus belle pourrait être accordée à une femme ?
— Ma pensée n’est pas ta pensée.
— Parce qu’elle n’est plus arabe. Ah ! cette Roumïa t’a fait du mal.
— Tais-toi ! Ta bouche est injuste. Noura m’a appris mon cœur et elle m’est chère comme mes yeux.
— Elle a mis la folie dans ta tête. Prends garde ! Le démon de l’esprit te tourmente !
Les grands yeux de kehoul et de poussière de soleil erraient sur les horizons retrouvés, sur des choses inchangées et pourtant différentes parce que ces yeux qui les considéraient n’avaient plus le regard de jadis. Si légèrement que ce fût, des lumières nouvelles avaient modifié leur manière de voir. Certes, Mouni était restée arabe ; mais elle n’était plus, rien qu’une Arabe. Le lac tranquille avait été troublé ; une liqueur étrangère se mêlait au goût de ses eaux.
La petite princesse revenue parmi ses sujets, d’abord prise aux puériles joies et aux câlineries du retour, avait connu trop de douceur et pas assez souffert ni perdu de jeunesse pour retomber toute, en une soif d’apaisement, au pouvoir du doux et latent fatalisme, de la soumission millénaire. Elle n’accepterait pas le sort et l’amour imposés. Elle prétendait être libre et son idéal avait une forme franque.
Et les terrasses se faisant désertes, elle parlait ardemment à la Soudanaise.
— Quand un grand feu brûlera ma poitrine ; quand il brûlera celui que j’aurai choisi ; quand toutes les chansons seront sur ma bouche ; quand j’irai vers un homme les bras tendus pour lui appartenir, c’est que cet homme n’appartiendra qu’à moi seule ; c’est que je serai seule à posséder son corps et son esprit ! Je ne veux pas être comme les femmes de ma race et de ma religion, les pauvres femmes qui partagent.
— C’est un chrétien que tu veux ?
Mouni les mains croisées sur sa gorge battante, le visage haut, extasié dans le soir, paupières closes, lèvres entr’ouvertes, sent passer en elle le frisson du baiser de Claude Hervis, ce premier baiser qu’elle rendra à un autre peut-être, mais qui ressemblera au sculpteur.
— Je veux un chrétien-musulman, répond-elle.
Le rire de la Soudanaise éclate.
— Un homme pour toi seule, un chrétien ! Il y en a ici. Choisis celui qui n’a pas encore d’épouse. Tu seras à lui seul peut-être, et lui confondra ton parfum avec ceux des Amourïat. Il faut aux bras des femmes plusieurs anneaux, qui soient leur bien légitime et qu’elles transmettent à leurs filles. Il faut plusieurs épouses à l’homme fort et généreux et qu’elles soient les mères légitimes de fils innombrables. Les trois épouses de Cherïef-Soltann t’aimeront, ma fille ; il n’y aura pas de querelle entre vous : Cherïef-Soltann est juste et fait à chacune son droit d’amour.
Elle poursuit avec enthousiasme :
— Nous verrons la magnificence des fêtes. Elles dureront longtemps. Le dernier jour sera le plus beau. Je vois… Regarde avec moi… Tous les cavaliers sont dans la plaine. Quel émir réunit de plus beaux chevaux ! Salut ! Ils attendent la chamelle blanche qui porte l’épousée. Elle vient… Cherïef-Soltann, — sur lui le bonheur ! — a donné pour la chamelle des khelkhal d’argent et des boucles d’or, afin qu’elle soit digne de son fardeau. Le bassour[43] oscille comme aux battements du cœur amoureux. Les nègres esclaves entourent la chamelle. Ils la conduisent avec une chaîne de grand prix. Une escorte protège le bassour bienheureux… Où donc est celui qui veut l’épousée ? Par Dieu ! Le voici qui galope à la tête de son goum. Il livre bataille. L’escorte et les nègres sont terrassés. Ils demandent grâce au nom de la félicité prochaine. La chamelle se couche. Déjà le vainqueur a déchiré les voiles du bassour empanaché de longues plumes. Il saisit Mouni, la jette sur sa selle et l’emporte au galop de son étalon !… Aaâh !…
[43] Palanquin.
La petite princesse raillait :
— Cherïef-Soltann sera bientôt trop vieux pour l’enlèvement de la mariée.
Le lendemain, la petite princesse pleura…
— O Mouni, disait Bou-Halim, ma fille Mouni, entends ceci. Cherïef-Soltann, — Allah le récompense et le fasse victorieux ! — te veut, et moi je veux te donner à lui.
Mouni cambre sa mince stature orgueilleuse.
— Je n’aime pas Cherïef-Soltann, ô mon père, et je ne peux lui appartenir dans l’indifférence.
— Que fait cela ? Il suffit que tu sois soumise. Tu seras sa femme.
— Non. Par ta tête et mon cou !
Le vieux seigneur soulève ses paupières molles. Il considère l’audacieuse, cette
[44] Lucie Delarue-Mardrus.
sous la draperie orientale et les parures, il voit sa révolte et la rébellion de la civilisée. Il sent en lui le déchaînement subit des rancunes muettes et la revanche des concessions faites. Cela le domine et cela est dominé par son âpreté au gain, sa soif et son besoin de richesse. Un grain du chapelet s’écrase entre ses doigts. Sa main s’érige sacerdotale et puissante ; en s’appesantissant sur la tête de l’enfant cabrée, elle vaincra aussi l’esprit roumi qu’il permit à cet enfant de connaître.
— Le châtiment sur toi, Mouni, pour ton audace ! Avant le Mouloud[45] par notre seigneur Mohammed, tu seras à Cherïef-Soltann.
[45] Fête de la naissance du Prophète.
Mouni arrache ses colliers dont les perles s’éparpillent.
— Jamais !
La pensée, le souvenir de Noura l’enlacent et l’étreignent. Ah ! la liberté, la douceur de la maison bleue dans la ville haute ! Comment les a-t-elle quittées pour un caprice et un chagrin de son cœur passionné ? Marchera-t-elle sur ses désirs ardents d’adolescente, sur l’espoir incertain et tenace d’un accomplissement avec Claude ou quelqu’un de semblable à lui ? Encore, si l’homme qu’on lui destine était jeune, séduisant, vigoureux ; mais cette barbe grise…
Elle jette en avant ses mains ouvertes, crispées, dans un geste d’horreur et de dénégation éperdue. Et, dans un sanglot :
— Jamais… Je veux m’en aller, revoir Noura. Plutôt que d’être à Cherïef-Soltann, je le tuerai, comme Zorah tua son mari. Oh ! Noura !…
— La malédiction sur Noura Le Gall ! Elle ne te connaîtra plus.
— Je ne suis pas ta prisonnière, ô mon père.
— Tu te trompes. Tais-toi et obéis.
Mouni profère un cri strident.
Brusquement, le cri qui vibrait s’éteint.
L’enfant désespérée voile son visage d’un pan de sa melahfa, recule et disparaît dans la pièce voisine…
Cherïef-Soltann vient d’entrer.
Il l’a vue. Sa voix interroge en prononçant un nom :
— Mouni ?
— Mouni, répond Bou-Halim faisant place à son hôte.
Le vieil Abencérage sait l’éducation de la petite princesse, comme il sait sa jeunesse et sa beauté. Il comprend, il sourit de son très noble et très clair sourire où flue un regret.
— Elle ne veut pas ?
— Cela n’est rien. Elle voudra. C’est à cause des maléfices de la science et de sa Mâlema. Nous l’en délivrerons.
— Le consentement est mauvais qui se donne avec des larmes. Et j’ai réfléchi. Je te dis ceci, ô Bou-Halim, mon frère et mon ami. Il sied mal à mon âge de prendre une jeune épouse pour, au lendemain des noces peut-être, l’abandonner avec les vieilles femmes et la tentation. Des agitateurs bougent dans les territoires au sud du Figuig. Des harkas montent avec les Berabers. J’irai avec les Français qui les attendent. Je connais le pays ; je servirai contre les aveugles forcenés et leurs merabtine ambitieux. J’ai parlé. Mes actes seront les frères de mes paroles…
Quand Cherïef-Soltann fit ses ablutions pour la prière de l’acha[46] il murmurait :
[46] Dernière prière.
— Honte à l’homme qui fait pleurer les femmes, qui leur fait répandre les larmes de l’amertume ! Celui-là mérite que sa mère elle-même ne pleure pas sur son cadavre.
Puis il dit à sa plus jeune épouse :
— Dénoue tes foulards, ô Nedjma, répands tes cheveux plus longs que la crinière des chevaux du Hodna ; je veux dormir dans tes cheveux.

— Enfant, enfant, êtes-vous responsable de l’accomplissement des destinées ! La tâche des précurseurs, de tous les apôtres prêchant les naissantes doctrines fut pénible et décevante ; mais ceux qui viennent derrière eux poursuivent et achèvent.
— S’ils ne détruisent pas, Amie.
— Non, Noura, car le temps doit faire son œuvre de progrès selon la pensée humaine et la loi sublunaire universelle. Tant pis pour les hommes qui sont les bons retardataires si, jour après jour, les vieilles poésies meurent et si des formules de calme bonheur se perdent… Chère, voyez les chefs qui mènent des pionniers vers le danger des inconnus immenses. Ils subissent les désertions et les morts, mais c’est le deuil de la veille qui achète le triomphe du lendemain.
Dans l’agreste solitude du jardin vierge, autour de la villa turque, l’Amie endormait le mal, pansait la plaie vive de la petite Mâlema. Elles remontaient d’un creux ravin où pullulaient des lierres, où, dans la vasque naturelle de son rocher, une naïade oubliée pleurait pensivement l’eau de sa source aux capillaires.
— Ah ! fit Noura, pourvu que Mouni revienne tout sera bien. Elle ne m’a pas encore écrit. J’ai peur qu’on la retienne contre son gré. J’ai peur, — et c’est atroce, — qu’on la marie là-bas.
— Et si elle agréait ce Bédouin ?
— Impossible ! elle se vouerait à une horrible torture, elle que j’ai façonnée à notre image. J’ai eu le temps pour elle. Mouni n’est pas restée une Arabe comme l’était Richa ma « petite plume ».
— Croyez-vous ? D’après ce que vous m’avez conté, je la trouve bien arabe, dans sa passion, sa dissimulation et sa naïveté en ce qui concerne son amour pour Claude Hervis. Si quelqu’un sait l’aimer selon son désir, elle trouvera le bonheur même aux champs d’alfa et loin de vous.
— Cela ne peut-être, Amie. Et je répète que le danger et la souffrance pour la plupart de celles que nous instruisons, c’est d’être livrées à des hommes, à des familles figés encore dans les anciennes ténèbres. Il faut que soient dissoutes ces ténèbres…
Une vaste lumière éblouit la mer.
L’extrémité d’une allée de cyprès domine le panorama absolu de sérénité.
Noura laisse son amie regagner seule la villa où elles se reposent dans le bon silence ou la persuasion qui émane des choses vivaces, transformées, éloquentes.
Noura contemple le paysage.
La mer jadis ridée par les barques phéniciennes, les rames des galères latines, l’étrave des bateaux corsaires et des navires des reïs, porte à présent des paquebots internationaux. Les uns emmènent les fervents vers Djeddah et la Mekke, d’autres débarquent toute l’Europe sur le rivage nord-africain.
Et parmi les verdures où pointent les cônes des cyprès turcs, l’indolence, l’esprit d’imitation ou le goût perverti des Arabes, habitent des logis sans style, encombrés de laideurs européennes, tandis que l’esthétisme de l’Europe fait surgir de neuves maisons mauresques.
Ne pourrait-on voir en cela un signe de la fusion future des races consentantes ? L’une serait-elle absorbée par l’autre ? L’Europe par l’Islam selon les prédictions de Claude Hervis ; ou les deux éléments se fondraient-ils pour cette nouvelle race africaine que le Mahdi affirmait exister et devoir grandir ?…
— A quoi songez-vous, Noura ?
— C’est vous, Mahdi ? Je songe à ma conquête. J’aimerais savoir quand et comment elle s’achèvera.
— Vous l’avez peut-être mal entreprise. J’userai de métaphores : écoutez. D’une orientale mélopée, vous vouliez faire un morceau de genre, hardi, élevé, sérieux, où détonnaient d’impossibles accords. Les violons ont pleuré…
— Ne chanteront-ils jamais ?
— Ils chanteront, mais une rapsodie mieux appropriée à leur caractère que votre sonate.
Noura joint les mains sur ses genoux ; elle tourne son beau visage affligé vers le ciel éclatant.
— Lequel vaut le mieux du chant barbare et primitif, de la rhapsodie ou de la sonate ? Laquelle vaut le mieux de la tradition, de votre doctrine ou de la mienne ? Il se peut que toutes trois aient tort, soient dangereuses. Il se peut qu’ils aient humainement et doucement raison, que seuls ils aboutissent, les zèles plus simples voués au rapprochement et au relèvement de la femme indigène, par le travail des doigts plus que de l’esprit, les zèles pareils à ceux de notre amie, et celui de ces religieuses qui, elles, sont les médecins des corps malades en même temps que les éducatrices des petites mains. Elles témoignent du dévouement, de l’honneur et de la pureté de la France féminine chez un peuple instruit de nos moindres péchés ; un respect les environne qui rejaillit sur nous tous.
Le jeune homme prend fraternellement le bras de la jeune fille.
— Noura, êtes-vous si désolée que vous renonciez à poursuivre votre rêve, que vous laissiez attenter à son intégrité ?
Noura livre ses yeux à l’affectueux regard du Mahdi.
— Secourez-moi. Je croyais ne jamais faiblir. Je croyais avoir mieux qu’un pauvre cœur de femme ; il a été fort contre l’hostilité, fort contre l’amour ; mais il est atteint dans ses fibres maternelles par la mort, la séparation ; et le voici faible… Dans mes jours d’activité, j’ai dit à mes ouailles nonchalantes : « Evoluez ». Des jours sont venus où j’ai douté de la bonté de ma cause. Toujours j’ai dompté la défaillance ; aujourd’hui je suis impuissante à me reprendre seule.
Elle regarde éperdument au-delà de l’horizon, des sommets bleus, légers dans l’éloignement, comme si elle pouvait voir la steppe au sud du Djebel-Amour…
— Hélas ! qui me dira où se trouve la vérité ? Nous sommes des esprits sans repos. Nous vibrons jusqu’à la douleur. Nous souffrons jusqu’à la volupté. Nous appartenons au vertige de cette vie contemporaine, accélérée, où tout s’ébauche et rien ne s’achève. Nous aimons et nous haïssons si vite que souvent nous savons à peine pourquoi. Nous allons, fébriles, dans un vouloir forcené, vers des buts surélevés et durs. Cependant, au fond des gynécées musulmans des femmes vivent d’instinct, de simple labeur physique et de contemplation. Elles n’ont ni ferveurs cruelles, ni doutes angoissants. Elles disent leurs cinq prières rituelles sans chercher à définir le sens exact de la prière, pas plus que le paradis où « leur âme montera…[47] » Notre race crie en nous ; la leur psalmodie en elles. Leur destinée coule dans une longue somnolence ; la nôtre se précipite en veille trépidante, en effort incessamment renouvelé…
[47] Expression arabe, pour « rendre le souffle, mourir. »
— … jamais stérile, interrompt le brun Mahdi. Je n’aime pas vous entendre parler comme Claude Hervis, chère Noura. Rien n’est stérile. La pierre même enfante la poussière et la poussière est pleine de germes vivants. La vérité, c’est de veiller, d’agir, d’apprendre. A ceux qui savent le devoir d’instruire l’ignorance. Cela, avec une sage habileté, sans ambition ni parti-pris, en examinant la valeur des caractères et leur possibilité d’évolution. C’est un peu ce que vous avez fait, Noura, et moins que ce que vous vouliez faire. Je veux, moi, avec l’appui du Gouvernement, étendre jusqu’aux frontières de ce pays l’influence que vous étiez obligée de restreindre à un cercle étroit qui la rendait inefficace. Nul ne sera condamné à la totalité de la science. De celle que nous mettrons à sa portée, chacun prendra ce qui conviendra le mieux à son tempérament, au développement de ses facultés propres. Le maître n’imposera pas la vocation de ses élèves ; il leur donnera le moyen d’établir des parallèles, de comparer, de juger, d’appliquer nos procédés pratiques à la vie pratique, de choisir et de parvenir. Nous nous garderons de faire des déclassés ou des déracinés ; nous ne toucherons pas aux voiles ni aux turbans, ni à l’essence même des individus. Nous nous contenterons de placer des flambeaux dans les ténèbres, sans vouloir prétendre obliger les éclairés à les porter ou à entretenir la flamme ; il nous suffira qu’ils sachent l’utiliser.
Sa voix tranquille et ferme pénètre Noura d’un chaud réconfort. Des certitudes angoissées, moribondes, se reprennent à vivre devant cette affirmation que ce dont elles se nourrirent n’était pas qu’une utopie, que d’autres possèdent la volonté d’un rêve égal en dévouement social, en esprit français, à peine différent de manière. Aujourd’hui, Noura n’oserait plus discuter l’idéal du Mahdi. Elle écoute avidement et lui s’anime de la sentir offerte à la persuasion de sa parole.
— Ceux qui dorment n’existent pas. Guerre à l’hébétude et à l’inertie ! Pour tous les peuples et pour tous les hommes, le droit à la vie de virtuel doit devenir effectif.
— Et si conquérir ce droit effectif mène à la mort ?
— Pour avoir ouvert les chemins, vous n’êtes pas coupable des accidents. Je vous connais, Noura, vous vous croyez chargée du sang ou des larmes de toutes les victimes. Je dis moi, qu’avoir développé le pouvoir de souffrir est déjà une victoire. Et la grande paix viendra après les batailles. Pour ceux qui s’y renferment et qu’on laissa s’y renfermer l’obscurité se fera pénible. L’orgueil superstitieux sera ruiné ; la noble et intelligente fierté dominera tout. La belle œuvre franco-islamique s’accomplira. Même au Maroc ; les champs lourds d’armes enterrées, éventrées de nouveau, luiront d’autres fers, le fer des charrues et des houes défrichant les terres pour la multiplication du pain !
— Ah ! s’écrie Noura en saisissant le jeune homme par les épaules, merci à vous ! Vous êtes bien réellement le Mahdi, le messie qui sauve, console et persuade. Vous venez de faire un miracle ; je vais reprendre ma tâche ; mais…
Il la comprend et, délicat comme un frère, tendre comme un ami amoureux :
— … Mais tandis que vous rassemblerez votre troupeau avant qu’il ait oublié vos premiers gestes, j’irai vers les Grandes Tentes ; je saurai si « votre enfant » est heureuse, sinon, dussé-je l’enlever, je vous la ramènerai.
Et celui qui veut la renaissance de l’Islam soutenu par la France, et celle qui voudrait mettre des cœurs gaulois dans les poitrines musulmanes, marchent du même pas sous les cyprès…

Encore, la koubba de Sidi Brahim rutile intérieurement et retentit. La fête est pour un nouveau-né, le fils de Louïz.
Dans l’assemblée, la Mâlema retrouve ses brebis éparses, les convie à revenir au bercail et souffre de les sentir sans enthousiasme, sans souvenir presque et sans gratitude. Pourtant elles promettent.
— Nous irons ou nous t’enverrons nos sœurs les petites.
— Moi je n’ai pas de sœur, dit Tounece, une cousine de Zleïra la Turque ; mais je n’entendrai plus les leçons, ô Mâlema. Je te le confie ; je préfère oublier les choses chrétiennes. Elles ne sont pas bonnes pour nous. Elles ne nous donnent rien et fatiguent inutilement notre esprit. Elles sont mauvaises aussi. Vois la Fafann qui s’habillait à la française et gagnait sa vie en brodant, comme sa grand-mère en faisant le kouskous dans les maisons riches.
— Eh ! bien ?
— Elle reçoit les coups de son amant, un chrétien qu’elle devait épouser et qui ne veut pas. Un jour, il la jettera dans la rue ; qui la ramassera ?
Et vindicative :
— Je croyais les chrétiens sans injustice, pareils à toi. Je les croyais sans brutalité et je pensais : « Ils peuvent nous dédaigner. » Mais quand Fafann parle, je me révolte et je cracherais au visage du dernier des Roumis, si, devant moi, il osait dire : « C’est un Arabe, » — comme on dit : — « C’est un porc ». —
Noura abandonna Tounece pour s’asseoir près de Louïz, la mère pâlie et souriante du petit enfant venu au monde il y a huit jours.
Les femmes forment un cercle. L’enfant est sur les genoux d’une matrone qui défait ses langes. La Bent Fraîchichi, la vieille barde, a savamment préparé en pâte épaisse du henna imprégné de vinaigre.
La matrone met une emplâtre de henna sur la tête molle du petit dont la figure ratatinée grimace ; la tête est couverte d’un capuchon de toile. Les mains et les pieds plâtrés de même, disparaissent sous l’enroulement de nombreuses bandelettes et, pendant plusieurs jours, l’enfant sera immobilisé, telle une momie informe, dans les langes étroitement serrés. Quand ses petits membres en sortiront enfin, ils seront si violemment rouges qu’on les croira trempés dans le sang.
Au murmure des invocations, la momie passe de mains en mains et, suivant la coutume :
— Laisse-moi baiser ton fils, dit chaque femme en posant une pièce d’argent sur la poitrine de l’enfant.
Elles formulent des souhaits :
— Dieu le garde jusqu’au jour de la circoncision !
— Que sa part soit enviable et son sort près des princes.
— Que sa mère puisse dire : — « J’ai enfanté dans le bien et mon fils est grand parmi les plus grands ».
Le futur héros est rendu aux bras de la matrone. Celle-ci remet l’argent à la mère, disant la valeur de chaque pièce et le nom de l’invitée qui la donna. Dans une circonstance identique, Louïz devra rendre des sommes semblables. Et le nom de la petite Mâlema est béni, à cause d’une pièce d’or.
La Bent Fraîchichi chanta au claquement de ses mains ridées.
Noura se levait.
— Je vais voir Djénèt avant que la nuit tombe.
Les gourbis étaient peu éloignés de la koubba.
Irrésistiblement par ce chemin, sous les mêmes arbres où Mouni avait avoué son amour, où Noura avait frémi d’une blessure multiple atteignant toutes ses tendresses, le souvenir de Claude Hervis assaillait la jeune fille. Elle revoyait la tête pensive, le bleu transparent et rêveur des yeux. Elle retrouvait les sensations de leur première rencontre, sensations réciproques, malgré les paroles différentes, première sympathie silencieusement échangée, comme il arrive entre les êtres qui doivent s’aimer d’amour ou d’amitié. Aujourd’hui, Noura doutait de la sincérité de cet amour qu’elle avait eu pour l’artiste. Elle pensait qu’elle s’était laissée prendre à l’excitant de la contradiction, au charme des gestes pareils à d’imprécises caresses, à l’enveloppement du désir inexprimé, d’une attention de tous les instants. Et Noura qui ne songeait qu’aux autres, sans répit, avait trouvé doux qu’on songeât à elle… Puis, la folie d’une minute, cette provocation du destin… Noura voyait à l’idole des pieds d’argile ; elle se sentait déchue dans sa ferveur qui ne voulait se prosterner que devant un idéal intègre. Et elle chassait l’idole, et elle étouffait la ferveur.
Il en était résulté en partie la dure épreuve en Mouni, comme une vengeance indirecte du dieu qui se sentait renié. Un reflet de fatalisme effleurant Noura, elle concluait qu’une prénotion des choses l’avait préservée d’une adoration trop profonde pour ce dieu banni de qui un malheur devait naître. C’est pourquoi en sa volonté absolue, son âme exclusive, cabrée contre les compromis, elle avait pu cesser d’aimer.
Le souvenir du Mahdi succéda à celui de Claude. Elle perçut à nouveau le grand esprit de sensibilité qui les avait rapprochés, mettant autant d’éloquence dans leurs silences que dans leurs mots, sous les cyprès. Ils se sentaient unis d’avoir chacun leur but et leurs convictions hors du banal de la vie facile.
Claude Hervis avait pris Mouni ; le Mahdi avait promis de la rendre. Et Noura tendait les bras vers ce messager de bonheur qu’elle espérait…
La petite Mâlema atteint le gourbi de Djénèt. Elle s’effare de voir le visage lacéré de la mère de Touhami.
— Rabbi ! Rabbi ![48] dit la vieille femme. C’est toi, ô Mâlema, et Djénèt est morte. Ce matin mon fils Touhami l’a mise sur une charrette ; il l’a emportée dans la plaine à Bordj-S’mara où sont nos tombeaux.
[48] Mon Dieu !
Noura frissonne, les doigts crispés contre le chaume. Afsïa, la belle-sœur de Djénèt, et une jeune femme aux traits enfantins l’attirent près d’elles.
La belle-mère reprend :
— Djénèt est morte à cause de sa folie. Nous l’aimions, mais elle ne comprenait pas nos cœurs. Elle a voulu tuer l’enfant qui bougeait en elle. Elle s’est tuée avec lui. Cela était la volonté de Dieu.
La jeune femme hoche la tête d’un air entendu.
— Djénèt était sans esprit. Pour moi je ne donnerai pas d’enfants à mon mari. Il est vieux et hier je lui ai dit : — « Je te regarde mourir un peu tous les jours. Quand tu seras fini, j’épouserai un jeune homme et alors j’enfanterai. » — Il ne répond rien. Il m’aime.
Noura s’enfuit, le cœur broyé de douleur et de dégoût. Quelle angoisse est la sienne ! Où marche-t-elle ? Des pierres tombales marquent les étapes… Lella Fatime, Oureïda, Djénèt… Lella Fatime repose au seuil du désert, dans une koubba fanatique. Sur le sommeil d’Oureïda pèsent le marbre uni et les faïences claires. Là-bas, dans la plaine gonflée de blés et d’orges, les chiens affamés du douar, creusent la terre remuée et, comme des chacals, la nuit, dévorent le cadavre de Djénèt…
Noura a regagné sa maison sans se rendre compte de ce qu’elle faisait. Elle se sentait écrasée par le ciel sauvage et rouge du soir, ensevelie par la route pulvérulente. Des mains blanches, squelettiques, se jetaient à sa rencontre. Des intonations de voix lointaines et des expressions de figures défuntes la poursuivaient. Elle entendait l’accent de Claude Hervis.
— O sacrilège…
Et ce qui sanglotait en elle, dans l’égarement de son âme déchirée, murmurait :
— Des larmes, des larmes, du sang et des larmes, rançon des farouches victoires…
Puis, son sanglot balbutia :
— J’ai peur…
Et pour la première fois Noura trembla devant l’avenir.

Doudouh l’impassible aide sa maîtresse à gravir les degrés de la terrasse.
Ce soir, la fièvre qui écrasait Noura est moins forte et l’air est pur, comme plein d’une ineffable clémence après l’incandescente et rude journée.
— Mon livre, Doudouh…
Elle s’étend à demi sur la chaise longue. Dans son visage émacié ses yeux se creusent. Rester seule avec sa pensée l’épouvante et elle feuillette au hasard un recueil de poèmes.
Elle lit et toutes les phrases n’arrivent pas à son cerveau, mais seulement quelques-unes, parce qu’elles sont plus berceuses, mieux harmonisées avec l’air fluide, le ciel vaporeux et bon.
[49] John-Antoine Nau.
Des pleurs très lents et lourds roulent sur le visage pâle.
— Mouni…
Que fait le messager de bonheur, le cher messager attendu ?… Pourquoi ne vient-il pas encore ?…
L’anneau de cuivre heurte la porte.
Un temps… Le cœur de Noura bat si fort et d’une si violente espérance !…
Et Doudouh revient de son pas tranquille, précédant le Mahdi…
— Mouni ?…
Il presse contre ses lèvres les deux pauvres mains frémissantes.
— Noura, chère Noura, c’est le dernier coup. Il vous atteindra cruellement. Je suis ici pour ne pas vous laisser seule chanceler sous la blessure.
— Mouni ?…
— Mariée, depuis trois ou quatre semaines, avec un prince nomade du Sahara constantinois.
— Pourquoi n’est-elle pas morte, dit Noura d’une voix lointaine.
Elle ferme les yeux et son visage est torturé par une inexplicable souffrance.
Le Mahdi garde dans les siennes les mains froides.
— Écoutez, Noura chère, et soyez consolée si quelque chose peut consoler votre affliction. J’ai dû aller jusqu’à la zmala. Mouni était déjà descendue vers les Oasis de l’Oued-R’hir avec son mari. La Soudanaise qui lui servit de mère et Bou-Halim m’ont affirmé qu’elle s’était mariée dans la joie. Comme je m’étonnais qu’elle ne vous eût pas écrit, son père m’a dit qu’elle devait l’avoir fait, mais que les courriers ont pu se perdre. C’est possible. — « Elle n’a rien oublié de l’affection ni des soins de Noura Le Gall, a-t-il prononcé. Tu diras à la Mâlema que ma reconnaissance et mon amitié sont sur elle. » — Suis-je arrivé trop tard ou Mouni a-t-elle simplement suivi, sans regret, sans hésitation, son goût et sa destinée ? Cette dernière conclusion est celle de notre amie. Les Grandes Tentes vantent la félicité de votre enfant et le caractère de son époux.
Un gémissement profond ébranle Noura.
— Mon enfant est perdue…
— Non, Noura. Gardons cette espérance que Mouni, à peine reprise momentanément par un mirage, restera ce que vous l’avez faite, usera de sa séduction doublée de votre intelligence et nous amènera son époux. J’aime à songer qu’elle peut un jour frapper à votre porte…
Noura se redresse et ses prunelles désespérées fixent sans rien voir. Une recrudescence de fièvre heurte ses tempes.
Elle parle avec l’accent du délire.
— Voici ce que j’ai fait… Il y avait de lentes et jolies chenilles aux belles couleurs. Je voulais qu’elles devinssent papillons. Savais-je ce que souffre la chrysalide !… Elle souffre ; on ne se transforme pas sans souffrance… Et tous les papillons ne ressemblent pas à leur chenille. Ce petit gris sans charme est le triste perfectionnement de celle qui rampait avec les nuances d’une fleur tropicale… D’ailleurs le sort des papillons est de vivre peu. Ils se souviennent d’avoir rampé et le vertige de leur vol les tue…
Elle s’exalta :
— O mes sœurs musulmanes aux couleurs chaudes et soyeuses, ne souhaitez pas vos ailes grises, ne souhaitez même pas vos ailes dorées ! Pardon d’avoir voulu vous en donner. Je ne vous tenterai plus. Je n’ai pas su vous garder de la détresse en rêvant pour vous un autre bonheur. Et je vous ai vainement aimées, car vous n’avez pas compris mon amour. Où trouverai-je le pardon et l’oubli de mon erreur ?
Et c’est la voix persuasive :
— Il n’y a pas d’erreur, Noura. La victoire entière n’est que différée. Elle est déjà payée par des morts et par vos larmes ; elle sera. Le temps viendra pour toutes les chenilles d’avoir des ailes et mieux vaut un jour d’envol dans l’air pur, qu’une année dans la poussière ou la boue des chemins. Nous donnerons à nos papillons des ailes vertes qui les porteront longtemps…
La voix et les paroles s’épanchent sur la douleur de Noura, comme une source fraîche dans la désolation des steppes arides…
Malheureuse la main qui t’enleva aux champs d’alfa pour t’initier à d’autres choses, choses décevantes et fatales qui engendrent trop de rêves et chassent les résignations !
Malheureux ceux qui troublèrent ton cœur ancien, le cœur de tes frères aux longs manteaux…
Du moins si ton martyre pouvait sauver de notre zèle une multitude !…
Le chaos des roches dépecées par le vent, déchiquetées par les pluies, crevées, éventrées par les ouad-torrents, égratignées par l’ongle des rafales.
Puis, l’horizon inouï et, sur les palmeraies, le ruissellement splendide des lumières. Les traits d’ombre bleue, les brumes violettes qui striaient un espace fauve et pourpré se précisent, deviennent des oasis vivantes, dans la steppe plate et sans détours.
Mouni assoupie au creux de son bassour, le grand palanquin voilé de souples haoulis[50], empanaché de plumes d’autruches, Mouni se réveille, s’appuie sur Rhadra, son esclave-amie et écarte les tentures. Elle voit le paysage du nouveau désert où elle pénètre et sourit mystérieusement.
[50] Sorte de couvertures.
Depuis des jours, entre chaque halte, elle voyage ainsi au pas mou et régulier de la chamelle claire.
D’autres palanquins sur des dromadaires la précèdent et la suivent, avec des femmes de la zmala, des servantes ou les épouses des cavaliers qui font escorte à Ferhat el Hadj, mari de Mouni.
Et la caravane fastueuse, archaïque et lente, ayant quitté les champs d’alfa, la hamada pierreuse, descend vers les puits jaillissants de l’Oued-R’hir, le mirage des Chotts et les sables ardents du Souf.
En vain, quand l’agha Bou-Halim avait quitté les maisons de terre pour les tentes de poil, en vain Mouni avait cru la paix revenue, tout danger écarté avec le départ de Cherïef-Soltann. Elle ignorait le noble refus du vieux guerrier ; elle croyait à l’indulgence de son père ou tout au moins à un délai.
— Les noces seront quand Cherïef-Soltann reviendra, disait la Soudanaise.
Mouni se flattait d’avoir obtenu sa libération et revu Noura avant ce retour.
Elle avait écrit ; mais la zmala entière était complice de Bou-Halim et, froidement, Bou-Halim avait détruit les lettres.
Alors un pèlerin vint d’un autre sud, un « djouad »[51] qui était riche et allié aux zaouïas puissantes. Il fit un pèlerinage en Oranie, à la koubba d’El-Abiod-Sidi-Cheikh et passa par la zmala en regagnant son pays de l’Est.
[51] Noble.
Il resta longtemps. Bou-Halim connaissait sa famille et ses richesses et, un soir où Mouni priait l’agha de la laisser repartir, celui-ci répondit :
— Vraiment, ton désir se réalise, ô ma fille. Tu partiras, avant la nouvelle lune, avec ton époux Ferhat El Hadj…
Que font les cris à ceux dont l’oreille veut être sourde, ô Mouni !
Que font, à celui qui désire, les yeux meurtris, les lèvres tremblantes et le cœur révolté pourvu que son désir s’apaise à la source souhaitée où il voit transluire la volupté !
Les femmes disaient trop que tu étais frémissante et belle plus qu’aucune fille du Djebel-Amour, et vierge. Elles le disaient trop ; ainsi Ferhat El Hadj le savait…
Et ce fut le jour où les fusils crachèrent toute leur poudre à la face du ciel, le jour où tant de chevaux galopèrent, envolés comme des oiseaux dont les ailes seraient des lambeaux de soie, gonflés de vent comme les voiles des felouques.
La zmala hurlait d’allégresse, trépidait d’enthousiasme parmi le vacarme des détonations et des musiques infernales ; elle hoquetait, repue de diffas pantagruéliques. Et des viandes chaudes fumaient encore sur les brasiers, des entrailles pantelaient au soleil, le kouskous s’éparpillait sous le mufle des chiens.
Les enfants luisaient du miel des pâtisseries ; ils se mouvaient dans un essaim de mouches noires.
Dans la poussière ou sous les tentes, les femmes dansaient, endiablées.
On avait paré Mouni pour les noces, on l’avait parée merveilleusement des dons de l’époux prodigue. Elle était inerte et muette sous l’or, les brocarts, les diamants et les mousselines. Et nul ne s’inquiétait d’un reflet profond qui gîtait dans ses prunelles sous les longues paupières presque closes…
On vit venir la chamelle blanche aux confins de la plaine. Des chevaux se cabraient autour d’elle, de beaux chevaux écumants, blancs ou gris, la crinière teinte de henna, la croupe marquée d’une empreinte de la main fatidique.
On vit Ferhat sur un étalon emporté bondir dans le groupe des cavaliers. Les nègres qui conduisaient la chamelle se prosternèrent. Ferhat éventra le bassour, saisit Mouni, et son cheval ivre galopa vers les tentes…
Combien tu étais brisée par les sanglots secrets, par l’on ne sait quel sentiment complexe de vague espérance, de crainte et de volupté, par ton mutisme et l’inflexibilité qui t’environnait, ô Mouni !… Combien tu étais brisée cette nuit où, t’ayant attachée, pour prévenir ta résistance, on te livra à l’étranger…
Nul n’a connu ta pensée cette nuit-là. Nul n’a plus ouï ta plainte ni ta colère. Tes yeux plus noirs, tes lèvres plus hautaines ne livrent rien…
Maintenant, tu reposes au creux du bassour, sous l’éclat et la pesanteur de tes bijoux.
Au pas dansant de sa jument alezane, Ferhat El Hadj précède la caravane sur le chemin de son pays.
Au large, jusqu’au plus large de l’horizon, c’est l’infini de la steppe, toute la face saharienne ravagée de soleil, toute la liberté qui grise les errants.
Et toi, Mouni, petite captive des chaînettes d’or et des anneaux barbares, tu ne pleures pas sur ta captivité, tu ne veux rien tenter pour y échapper ; et si Noura te faisait signe, là-bas, vers le Nord, tu baisserais tes paupières pour ne pas voir son geste d’appel.
Etrange Mouni, ô toi tout l’Orient et tout l’Islam, malgré l’Europe dont on voulut t’imprégner, tout l’enfant et toute la femme aux impressions fugaces et persistantes, aux sentiments légers et têtus, aux pensées qui semblent si claires et restent indéchiffrables ; petit sphinx étrange !…
Et Mouni ordonne en posant sa tête sur l’épaule de son esclave :
— Répète encore ce que t’a dit le M’zabi.
Rhadra docile parle dans le palanquin.
— Le M’zabi est un marchand de Touggourt. Nous l’avons rencontré ; il marche avec nous depuis deux jours. Il est amoureux et hardi comme un de ces « grands voleurs » qui, pour l’amour, suivent les tentes, seuls avec un cheval ou un dromadaire ; les « grands voleurs » de baisers qui sont habiles à déchiffrer le langage des parfums et des bijoux et qui pour pénétrer dans la tente bienheureuse viennent nus, la nuit, affrontant les chiens et le couteau après la soif et la faim. Le M’zabi dit qu’à El Berd il y a un Roumi vêtu comme un musulman et qui fait des hommes et des femmes avec de la terre. C’est un Roumi grand et bon qui sait toutes les prières du Koran et ne prie jamais bien qu’il jure n’être pas chrétien.
Et Mouni tout bas :
— Je savais bien qu’il était dans ce Sahara, mais je ne savais où le rencontrer. Hamed ou Allah ![52]
[52] Louange à Dieu.
Un vent sec affole d’incandescentes poussières et disperse le refrain des conducteurs de dromadaires.
Qui dira l’œuvre des vents dans l’étendue saharienne ?… Le dessèchement, la mort des arbres et des herbes. La diminution et la fuite des êtres. Les terres végétales emportées par chaque souffle et la gigantesque ossature, le squelette pierreux restant nu sous le soleil.
L’œuvre n’est pas terminée ; il faut une plus saisissante figure à cette partie du monde opposée aux prairies virgiliennes, aux forêts abondamment vivantes de vies innombrables… Les vents se succèdent ; el adjedj qui hennit et les chichilis rugissants, troupeau de lions et de cavales folles. Ils mordent à même le squelette ; ils le cinglent, le fouettent, le griffent ; c’est l’effritement. Le gypse s’éparpille en poudre diamantaire, les pierres teintées d’ocre deviennent sables blonds aux reflets de cinabre parmi les fulgurantes rougeurs des soirs. La destruction est aussi un éblouissement. Le désert est créé…
Pourtant la nature possède un tel pouvoir de reviviscence que des végétations ont pu renaître de cette cendre de choses ; des tamaris grêles broutés par les gazelles et les zeïtas qui fleurissent avec toutes les pâleurs et les violences nuancées de l’améthyste.
La caravane de Ferhat-El-Hadj vint jusqu’au plateau graveleux de Chegga et aux replis sableux où sont les tombes des Oulad-Moulat.
Le passé des Oulad-Moulat est plein d’aventures et de batailles. Les meddahs errants l’ont chanté. Ils étaient les nobles fils de Hillal. Leur goum parcourait l’Oued-R’hir et disputait le trône aux sultans de Touggourt. Le destin passa sur eux et leurs dernières tentes essaimèrent jusqu’au Touat…[53]. Ainsi les vieux nomades se dispersent et meurent, mais ils meurent dans l’intégrité des coutumes.
[53] « Les Oasis sahariennes », A.-G.-P. Martin.
Les tentes de Ferhat-El-Hadj se posèrent sur la falaise de Kef-el-Dour.
O Mouni, soulève le rideau de la tente, tandis que les hommes se détournent pour ne point commettre la félonie de convoiter ce qui n’est pas à eux et d’offenser leur chef par le regard défendu.
Mouni, vois la splendeur d’un immense redoutable, tragique et tentant sur la face blanche, la glace illusoire des Chotts, le velours du sable gemmé, l’ombre imprécise, prometteuse d’ensorcellement dans l’oasis qui existe par l’eau souterraine, l’eau jaillissante que les hommes prennent aux djenoun[54] ténébreux ! Le pays du mirage, le mystérieux Oued-R’hir est devant toi…
[54] Pluriel de djinn.
Là les conquérants arabes, tes ancêtres, s’arrêtèrent jadis. Ils s’arrêtèrent effarés du prodige de l’air, de l’étendue et de la lumière qui créait des spectacles impossibles de réalité en la solitude. Les chevaux pointaient devant la plaine vertigineuse. Ils eurent peur.
— Ceci est vraiment le pays des djenoun, dirent-ils.
Et pour la première fois, ils s’en retournèrent… C’est pourquoi Kef-el-Dour se nomme Rocher du retour.
— Rhadra, dit Mouni, appelle Ferhat-El-Hadj.
L’époux s’avançait, figure ciselée, mince, hâlée, profil busqué et hautain, la bouche sensuelle, les yeux froids, la barbe très noire et fine à la moustache tombante, les mains sèches, le corps maigre et nerveux sous la soie du haïk et les plis légers des burnous de Sousse.
Pareils au visage de cet homme devaient être les visages de ceux dont l’intelligence fut parfois obscure, mais dont les passions formidables, l’énergie démesurée et l’orgueil renversèrent des empires, créèrent des religions et changèrent la face d’un siècle… Pourtant cet homme-ci n’est rien qu’un peu de l’âme musulmane éparse dans les solitudes fauves.
Il n’a pas de sourire en abordant Mouni ; son expression reste sévère et digne ; mais ses yeux brillent et sa voix est basse et très câline.
— Que veux-tu, ô aïni ?
Mouni clôt ses paupières, comme elle a pris l’habitude de le faire devant son mari. Elle étend son bras cerclé des serpents d’or du Djebel-Amour et désignant la ligne des palmeraies lointaines :
— Je te prie, où se trouve l’oasis d’El-Berd ?
— Pourquoi ?
— On dit que les dattes y sont plus douces que dans tout le Sahara et qu’il y a des ânes sauvages. J’aimerais les voir. Y camperons-nous ?
— Bientôt. — Il saisit la petite main. — Et si tu n’es plus une morte contre mon cœur, je ferai capturer pour toi un âne sauvage.

L’heure avant l’ombre.
Des remparts de toub effrités sous la pluie rare, les vents fréquents. Des pans de murs blonds et roses découpés en décor, crénelés par la ruine, grandis et magnifiés par l’ultime lumière…
De longues traînées d’ombre hâtive s’élargissent à terre, aux replis des murailles. Des couleurs prestigieuses, rapides, se succèdent et s’irradient dans la seguïa. Les palmes s’assouplissent, dolentes, lasses d’avoir porté tant de soleil. Des lueurs étranges s’attardent. Le demi-jour nuancé, pâlit. Dans la gravité voluptueuse du soir saharien, on perçoit l’hymne impérissable des soirs splendides.
Les remparts démantelés deviennent imposants comme un débris de vieille Egypte où chanterait cette âme ancienne qui s’attachait aux choses de l’éternité.
Et voici Claude Hervis, sous son manteau bédouin, sortant de sa maison de terre pour errer dans le crépuscule des jardins d’El Berd.
Sa maison est meublée d’un lit en bois de palmier où ne montent pas les scorpions. Elle est peuplée de sveltes Nouras d’argile au profil grave ou aux traits exaltés, de petites Mounis embéguinant de voiles une figure de sphynx, et des formes d’une autre femme au corps nu, robuste et beau, de marbre antique, au front cerclé du « djebin », diadème des femmes du Sud, entre les lourdes tresses qui étreignent le visage.
Ainsi Claude a accepté les suites de ce seul geste qui suffit à séparer sa vie de celle de Noura l’exclusive.
Il n’a pas souffert la vulgaire souffrance des amoureux déçus. Il a compris que Noura droite, sévère en son orgueilleuse et absolue virginité, susceptible en tout ce qui touchait à Mouni, ne lui pardonnerait pas sa folie si brève. Il n’a pas eu le mauvais goût de supplier ni de gémir. Il garde le sentiment très profond et pur voué à la jeune fille ; il le garde sans tourment, comme un culte secret et calme à une inaccessible dont l’énergie et la beauté l’ont ému.
L’artiste fasciné par un primitif Orient a choisi sa vie dans l’ambiance de l’oasis encore inviolée, dans la béatitude, l’ivresse et l’idéale contemplation de l’Islam saharien. Et cette vie qui semble bizarre est rationnelle en somme. Elle a sa part de tendre chimère et sa part d’originale réalité. Elle possède les extrêmes jouissances humaines, de l’immatériel au réel, et elle est légère, sans l’encombrement des superflus qui s’imposent en nécessités.
Aux heures de l’esprit, Noura règne en évocation. Claude Hervis appartient à celle qui incarne le charme blanc d’une vierge franque, les généreux enthousiasmes français et la grâce sculpturale d’une Hellène.
A d’autres heures, c’est la souveraineté de l’Oasienne aux parfums violents, aux soumissions sensuelles.
Et Mouni symbolise le souvenir sans regret, plein de fatalité décisive ; un mot du destin, sans amertume à cause de la sage acceptation.
La ruine blonde, devant la maison de toub, s’anime d’une forme féminine. Telle une inattendue prêtresse venue pour accomplir quelque rite mystérieux, une femme surgit dans des draperies blanches. Elle a des cheveux tressés, lourds de laine, voilés de soie, des yeux immenses de mélancolie inconsciente et de perdition. Ses bijoux luisent de l’éclat doux et atténué de l’argent berbère. Elle descend lentement et se perd dans la palmeraie sombre, à la rencontre du sculpteur.
Les clartés coulent moribondes…
Au-dessus d’un créneau une étoile pointe. Le jour n’est plus.
Voici la nuit saharienne, vivante, unique…
Alors la caravane de Ferhat-El-Hadj atteignit les dunes d’El Berd.
C’était l’heure où les familles s’assemblent pour le repas frugal de kouskous noir, de dattes et de sauterelles, l’heure qui précède celles où les métisses rejoignent leurs amants sous les vignes pendantes comme des lianes, près des puits jaillissants et des seguïat silencieuses.
La caravane avait cheminé par les sentes floconneuses d’efflorescences de sel, au bord du Chott Merouan, puis le long des premières palmeraies et parmi les dunes.
Les réflexions ou les souvenirs des chameliers entrecoupaient de fréquents mutismes.
— … Il avait juré de se venger. Il a glissé comme une vipère. Il a éventré les sacs d’orge mêlant le grain au sable.
— … Le dromadaire marche lentement, mais il est encore debout quand le cheval qui galopait est à terre.
— … Il était dans le palmier, au-dessus de Djilali endormi, et il riait parce que les dattes qu’il volait à Djilali tombaient sur le burnous de Djilali…
— Qui parle de palmiers ? interrompit le M’zabi poussant sa mule près des chameliers. Si vous êtes des gens de ce pays, comment osez-vous en parler, vous qui coupez leur tête et qui les tuez pour vous enivrer de leur sang.
Il disait qu’au M’zab était réprouvée la coutume de décapiter les vieux dattiers pour recueillir la sève qui devient le lagmi[55] fermenté.
[55] Vin de palmier.
Il poursuivait en désignant les jardins où blanchissaient le crâne du dromadaire et l’omoplate du mouton, fétiches protecteurs :
— Le palmier est sacré. Il est pareil à l’homme. Il a une épouse qu’il féconde. Son cœur blanc est comme un cerveau ; la moindre blessure lui donne la mort. Son lif[56] est comme une chevelure. Ses palmes coupées ne repoussent pas plus que les membres coupés. Et c’est l’arbre de la prédilection divine ; il croît en pays musulman.
[56] Bourre.
[57] « Les Palmiers du M’zab », capitaine Charlet.
Les chameliers écoutaient, distraits par les discours du M’zabi aussi bavard sur sa mule qu’autour du feu des haltes.
Et l’oasis d’El Berd fut toute proche avec son avant-garde de palmiers roux, déchevelés sur les dunes que leurs racines fixent dans un réseau de cordelettes.
La caravane s’arrêta. Les dromadaires s’agenouillèrent dans le sable au bruit de leurs grognements sauvages achevés en râles soumis. Les tentes se posèrent encore et, près d’elles, les bassours ressemblèrent à des huttes pomponnées.
Ferhat-El-Hadj s’en alla dans l’oasis, chez le seigneur Amar ben Belkacem dont il devait être l’hôte.
Les palmes sèches et les racines de zeïta flambèrent. Accroupi dans son burnous brun, le M’zabi reprenait ses bavardages.
— Êtes-vous des hommes pieux ? Porterez-vous des offrandes aux zaouïas du pays de Touggourt ? Je sais un mokaddem entre tous. Il est redoutable et il a rendu des palmiers stériles en les regardant. Et c’est un mergoud (endormi). Son père l’ayant engendré mourut. Lui, dormit huit années dans le flanc de sa mère avant de vouloir connaître le jour. Ses ennemis disent qu’il est l’enfant du péché et que son vrai père est un Rouari[58], khammès du défunt. Je le crois plutôt fils d’un esprit. Echangez votre argent contre ses amulettes ; elles sont efficaces.
[58] Métis sédentaires de l’Oued-R’hir.
Le M’zabi se pencha comme pour tisonner le feu ; mais ses petits yeux, entre deux chameliers, observèrent rapidement la tente de Ferhat.
Il reprit sa position première.
— Je vous dirai ce que raconte au café maure un deïra[59] des Ziban. Les Arabes d’autrefois étaient des hommes et des femmes ; ceux d’aujourd’hui ne sont plus que des coqs et des poules…
[59] Cavalier de Bureau arabe ou de Commune mixte.
— Depuis que toi et tes frères vous êtes des Juifs, riposta un chamelier.
— Je brûle ton insulte au feu des djerid[60], répondit paisiblement le conteur en poussant une palme sèche dans les flammes. Mais vos grands-pères valaient plus que vous. Ils avaient de bons chevaux. Ils ont galopé jusqu’en Espagne et failli prendre la France. Un homme, plus fort avec sa hache que toute une armée, les a chassés. Le galop de la défaite est rapide. Quand les Français sont venus dans ce pays, il y avait un grand chef dans le Hodna, un chef musulman. Il portait un sabre long de trois mètres. Il se battait bien. Une nuit, blessé, il revint à sa tente, attacha sa jument au piquet et s’endormit. Une bataille se continuait dans la montagne. Au matin, la jument baissa la tête, creusa la terre avec son sabot et hennit de douleur. Le chef s’élança hors de la tente ; il s’écria : — « Nous sommes vaincus ! » — Et cela était la vérité. Depuis, il n’y a plus ni chefs ni victoires.
[60] Palmes.
Le M’zabi se pencha de nouveau et cette fois son regard saisit le signe d’une main de femme dépassant le bord sombre de la tente de Ferhat.
Il laissa passer quelques minutes, puis se leva, nonchalant et sérieux, pour rejoindre Rhadra sous le couvert des palmiers…
Plus tard, au seuil de sa hutte, Claude Hervis répond au salut du M’zabi et à sa demande :
— Veux-tu que je regarde tes « enfants d’argile » ?
— Entre. Il y a une bougie.
Semblables curiosités sont fréquentes et Claude ne s’inquiète pas de ses visiteurs.
Mais le M’zabi l’appelle, intrigué par une statuette de Noura en longue robe unie.
— Quelle est celle-ci ?
— Que t’importe.
— Une Roumïa, ta sœur ou ton amie ?
Il roule une cigarette entre ses doigts et, prêt à franchir la porte, négligemment :
— Ecoute. Mon amie à moi m’a prié de te dire ce nom : « Noura », « et que tu viennes dans le dernier jardin avant la dune, tout à l’heure. » — Tes « enfants d’argile » sont jolis ; mais les amies vivantes valent mieux. Le salut sur toi.
Il disparaît. Claude stupéfait n’a pas eu le temps de l’interroger.

Le bernous du sculpteur s’immobilisa devant une melahfa bleue comme en portent les métisses. La créature ainsi vêtue, — une enfant presque et si mince, — cachait son visage et ses bras sous un voile blanc. Etait-ce une très jeune fille aventureuse ou une petite épouse adultère ?
La seguïa coulait sans murmure et l’ombre des palmiers était pleine de silence.
— Qui m’a fait venir au nom de Noura ? demanda Claude Hervis.
Le voile tomba. Une main saisit son poignet. Il entendit une voix ardente.
— C’est Mouni.
Il tressaillit, se sentant brusquement ému jusqu’au profond de son âme, et grave, et soucieux comme devant un mystère inquiétant ou un inéluctable péril.
Mouni était là, seule, et comment ? Que signifiait cette présence ?… Les vibrations de la voix reconnue se prolongeaient en lui. Il se crut dans un paysage de rêve, en face d’une apparition qui se volatiliserait bientôt.
Il distinguait à peine le visage passionnément levé vers le sien. Et Mouni fut sur sa poitrine, les bras noués à son cou…
Il la détacha doucement. Il se refusait encore à admettre la stupéfiante réalité.
— Explique-moi…
Elle eut une sorte de frisson.
— Ah ! tu veux savoir avant de m’accueillir.
La petite voix s’exprimait en français, lente, contenue, mais frémissant de passion refoulée.
— Voici l’histoire, depuis un soir plus beau que celui-ci. Le baiser était allé jusqu’à mon cœur. J’ai caché mon secret à Noura, longtemps. Longtemps j’ai attendu le retour. Puis j’ai cru à la parole d’un derouïche et j’ai méprisé votre faiblesse qui ne savait pas fixer le choix de son amour. Vous préfériez Noura peut-être et je vous détestai d’avoir menti en vous penchant sur moi. Mon frère est venu ; c’était écrit ; je suis retournée à la zmala. On m’y a gardée prisonnière. On m’a donnée liée et brisée à Ferhat El Hadj. Il m’emmène chez lui et nous passons la nuit ici, dans la dune.
Il écoutait l’explication, violemment atteint par l’évidence de ces choses jadis pressenties et redoutées pour Noura, pour Mouni.
— Tu es mariée…
Elle crut discerner un reproche dans l’intonation et se révolta.
— Je suis mariée, oui, par ta faute. Tout est de ta faute, tout ! Oh ! qui dira jamais le mal que tu nous as fait, à Noura et à moi ! Tu nous as séparées. J’ai été livrée aux larmes et à la colère, à l’affreuse obéissance sous la force, le silence, la réprobation, la malédiction même. Je portais le souvenir de mes affections et de ta caresse comme une souillure que tous les gens de la zmala voyaient et dont ils me faisaient honte, semblait-il. Pourtant, je ne pouvais me délivrer de ce souvenir. Ma famille m’injuriait. Un jour, je me demandais pourquoi j’étais née parmi les Bédouins puisque je devais avoir des sentiments français. Le lendemain je haïssais toute la France dont les leçons m’avaient changée. Dans la tente amoureuse, je soupirai d’amour à cause de mon sang, et je sentais l’amour impossible à cause de ma pensée. C’était une manière de mourir tous les jours…
Elle s’interrompit haletante.
Au-delà des mots, le navrement de Claude percevait le drame moral et physique. Mouni était demeurée, inévitablement, tout une Arabe voluptueuse et instinctive, et l’empreinte du doigt de l’Europe avait été assez profonde pour détruire la faculté de jouir complètement dans le libre instinct et la volupté facile. De l’enseignement reçu, elle avait surtout retenu le triste don de forger la chimère persistante, de souhaiter saisir l’insaisissable et, en espérant la réalisation du souhait, de se révolter contre les jouissances plus pauvres et plus rudes. Elle avait su souffrir les sensations plus aiguës, par tous ses sens affinés, et elle avait désappris la soumission primitive. Le mal pressenti par Claude devant l’effort de Noura était un fait accompli.
Mouni reprenait impétueuse :
— Une fois, je jetais mes bracelets, je déchirais ma melahfa, je demandais une robe française. On ricanait ou on priait avec des sorcelleries pour chasser le démon qui me persécutait. Alors j’avais peur. Je connaissais les sortilèges, les uns étaient sans pouvoir, mais d’autres réussissaient. S’ils ne me donnaient pas le bonheur pour mon âme d’aujourd’hui, ils me rendraient mon âme d’autrefois. Je redevenais une petite fille, une musulmane pieuse et tranquille. Je baisais les chapelets et des sources fraîches coulaient en moi. Mais l’amour et le souvenir me mordaient encore. Les lèvres arabes, les étreintes dont parlaient les femmes me faisaient horreur. Je criais et je sanglotais de vouloir et d’appeler en vain. J’ordonnais aux enfants de m’avertir quand un chrétien passerait par les sentiers. Je serais partie avec n’importe quel étranger. J’aurais su l’aimer. Mais on se méfiait et les enfants ne me disaient rien. Ferhat est passé… J’ai été à lui dans l’indifférence ; je n’ai pas pu le haïr.
De ses deux mains elle pressa sa gorge battante.
— Claude Hervis, si tu avais su mieux vouloir ! Maintenant, il faut que tu consoles le chagrin. Louange à Dieu qui te fit habiter sur le chemin du pays de Ferhat. Je ne suis plus la « petite fille », souviens-toi ; je sais. Prends-moi ! Prends-moi ! Parce que tu m’avais abandonnée, des brigands m’ont prise ; toi, sauve-moi des brigands !
Elle le tutoyait, vibrante de colère, d’amour, de crainte et d’espérance.
Une minute peut contenir toute l’angoisse, toute la pitié, toute l’impuissance d’un être… Les contractions et les secousses du cœur de Claude Hervis s’étaient harmonisées, aux phrases de cette enfant en qui s’exaspéraient les regrets, le dégoût, la surexcitation qu’il prévoyait quand il opposait ses craintes à l’optimisme de la petite Mâlema. Et Mouni exaltée comme une Européenne, ardente comme l’Orient, ignorant la rigueur des actes accomplis et de leurs conséquences, créature de caprice et de passion ataviques, de juvénile inconscience, de liberté et de volonté apprises, Mouni voulait simplement un enlèvement et l’amour de Claude. Or, clairement, l’artiste sentait cet amour impossible et concevait la folie que serait cet enlèvement de la femme de Ferhat ; car Ferhat revendiquerait ses droits, aurait raison, et une possession vindicative, le martyre ou la mort serait le châtiment de la rebelle.
La destinée ouvrait les yeux de Claude et mettait en lui la sagesse.
Inquiète du silence du sculpteur, Mouni disait :
— Ta surprise est-elle si grande que tu ne puisses me répondre ?
Elle s’exprima soudain dans sa langue arabe et ce fut son chant d’amoureuse.
— O mon ami, parfum de ma poitrine, je t’aime à cause de tant de choses ! Quand mes yeux ont vu la vie, je t’ai vu. On dit que tes cheveux sont gris ; est-ce vrai ? Tes lèvres sont si jeunes que les miennes les rencontrèrent avec délices. Je te porte en moi comme une mère porte l’enfant. J’ai crié ton nom la nuit ; j’ai crié ton nom le jour. Ton fantôme a dormi près de moi… Si ma gorge s’ouvrait comme un livre sacré où sont des mots plus terribles que le tonnerre, et plus doux que le miel et plus embaumés que la rose de Tunis, si ma gorge s’ouvrait tu pourrais lire et tu tremblerais de bonheur. Si mes yeux étaient des étoiles, ils se détacheraient comme tombés du firmament dans tes mains, à cause de tes yeux qui les rendent fous.
— Tais-toi, Mouni, tais-toi.
— Ton souffle m’enveloppe comme un grand vent. Tu croyais : — « La petite fille ignore l’amour. Ses désirs naissent et passent comme la fraîcheur du matin. » — Le soleil s’est levé dans le matin ; il a brillé sans répit ; à l’heure de midi, il éblouissait la terre de son ardeur et le soir, il brûlait comme l’incendie… Le soleil qui s’est levé dans mon cœur me brûle, et je t’aime !
— Tais-toi, Mouni, tais-toi.
L’accent supplie pour que se taisent cette voix et ces mots d’ensorcellement.
Le sculpteur s’est assis, le front dans ses mains et la tête de Mouni roule sur ses genoux.
La petite amoureuse chante toujours.
— Je veux aller avec toi par les longs chemins, les plateaux dévorés par les sauterelles, les champs desséchés et les vergers pleins d’amandes. Mon âme qui me faisait tant de mal est claire et pure comme l’eau de la seguïa. Je l’élève jusqu’à ta bouche. Ne te détourne pas. Bois.
Il la repousse encore.
— Il ne faut plus délirer, Mouni. Tous ces mots fous ne peuvent rien être pour moi.
Dans cette nuit où tout paraît surnaturel, il ploie sous l’empire d’une force plus puissante que sa sensibilité même. Il obéit à un irrésistible « mektoub ». Il est calme et l’atmosphère lui semble suprême, dangereuse et triste où respire Mouni.
— Vous m’avez accusé, dit-il. Les épreuves advenues sont peut-être bien un peu votre ouvrage et Noura a été frappée qui ne le méritait pas. Vous lui avez menti longtemps, ô Mouni. Longtemps près de sa grande âme ouverte et tendre, avide seulement de votre bonheur, vous avez été une petite âme trouble qui dissimulait. Et vous cherchiez à ravir mon affection sans vous préoccuper de savoir si vous ne la voleriez pas à Noura.
Mais Mouni secoue la tête.
— Je ne comprends pas cela. Ai-je menti ? Je ne volais rien ; Noura m’avait dit qu’elle n’aimait pas. Toi, tu nous aimais toutes les deux. Tu devais choisir l’une ou l’autre. J’ai voulu que ce soit moi. Est-il nécessaire de dire toutes ses pensées, de les livrer à chaque question ? J’écoute mon cœur où bruit mon désir ; quand il veut parler mes lèvres s’ouvrent ; s’il veut se taire, elles restent closes ou prononcent des mots qui ne le touchent pas. Je n’ai rien fait de mal. Ma tendresse pour Noura est entière et si Noura souffre, c’est moins que moi ; elle est libre.
Un sentiment complexe bouleverse Claude Hervis. Il voudrait saisir Mouni dans ses bras, la bercer, la consoler, l’endormir comme un père son enfant !… Et il redoute de respirer le parfum d’ambre et de lentisque de la petite princesse, la captive aux nœuds douloureux qu’il ne peut pas délier.
— Mouni, Mouni, vous êtes révoltée contre le sort imposé et je ne puis vous y soustraire. Il y a une effroyable fatalité dans toute cette pénible aventure. Elle nous écrase ; nous en sommes torturés… Mouni, chère petite victime du mektoub et de votre sang arabe empoisonné par le goût de la civilisation, ô Mouni, retrouvez votre raison. Vous guérirez du poison. Vous n’avez pu haïr votre mari, vous l’aimerez ; vous l’aimerez dans vos fils et vous deviendrez vieille et sereine dans la quiétude retrouvée…
Mouni s’est redressée. Elle recule. Ses yeux s’emplissent de rancune et de déception. Cet homme va lui devenir subitement odieux qui répond à son cri éperdu par ces mots de froide et vaine espérance. Injustice et lâcheté ! Sont-ils tous ainsi ceux de France ?
Elle dit avec un inexprimable mépris :
— Comme tu as peur d’être bon et juste, tu n’oses même pas me tutoyer.
— Ah ! exclame Claude, je veux calmer ta tête et tu te refuses à comprendre. Tu veux que je t’emporte ? Viens ! Tout à l’heure ton mari fouillera l’oasis et il t’égorgera chez moi.
— Tu me défendras. Tu le tueras ; tu tueras ceux qui seront avec lui. Et si tu meurs et si je meurs, qu’importe ! Je ressemble à mes grand’mères nomades qui mentent, trahissent et se donnent autant pour l’amour que pour le frisson de savoir le poignard qui guette et qui les trouvera dans un enlacement. Oui, vraiment, je leur ressemble et cela vaut mieux !… Prends-moi !
La voix de Mouni siffle. Son corps mince grandit, les bras tendus.
Mais le sculpteur ne bouge pas. Une force invisible et fatale ploie sa haute taille.
Mektoub, mektoub, éternel ananké, le tout-puissant des heures suprêmes, nous ne sommes rien que les gestes ou les immobiles nécessaires à tes desseins !…
Claude Hervis prononça :
— Je ne veux pas provoquer votre mort ni faire de l’irréparable. Petite enfant de Noura, notre petite sœur, si la résignation vous est impossible, si la coutume de votre peuple vous est trop lourde, nous ne vous abandonnerons pas. Nous chercherons le moyen efficace pour vous libérer. Subissez encore un peu l’épreuve. Notre tendresse affligée va suivre votre vie et nous agirons. Entends-tu, Mouni ?
Mais à présent Mouni l’exécrait et ne voulait plus entendre.
Elle cria :
— Lâche et maudit !
Et ses ongles griffant sa gorge :
— Maudits ceux qui m’ont pris mon cœur arabe ! A la place ils n’ont mis que de la cendre. Qu’elle emplisse leur bouche et les étouffe ! Malheur ! Malheur ! Malheur !…
Claude s’élançait pour étouffer la clameur insensée, imprudente. Mais Mouni s’échappe, fuit… Elle est hors du jardin. Il ne la voit plus…

Mouni trébuche entre les racines des palmiers roux. Sous la clarté stellaire, son visage altéré émerge du voile blanc, et ses prunelles s’élargissent, immenses, et ses lèvres farouches sont gonflées de haine et de mépris.
Elle se hâte, fébrile, sans idée précise sinon rejoindre le lieu d’où elle partit, la tente sombre où Ferhat va revenir en quittant son hôte.
Ferhat…
… Il sort de la tente, Rhadra affectait d’y sommeiller. Brutalement, il a interrogé l’esclave.
— Je ne sais rien, mon seigneur, je dormais. Elle dormait avec moi. Je n’ai rien vu. Je ne sais rien.
— Tu mens !
— Je n’ai rien vu. Je ne sais rien.
— Fille de chienne !
Le talon du maître s’acharnait sur la figure de Rhadra.
— Fille de chienne, « giffa ! »
Rhadra retomba, inerte. Elle était une masse sanguinolente gisant dans l’ombre…
Et Ferhat sort, les yeux fauves, les lèvres retroussées et rageuses sur ses dents brillantes, le cœur bondissant d’amour sauvage et d’effrayante colère.
Les grands astres sahariens luisent éperdument, éclairant la dune.
Ferhat vient à la rencontre de Mouni… Elle l’a vu…
Ils se touchent. Ils s’arrêtent, poitrine contre poitrine, mêlant leurs haleines tragiques, heurtant d’irréductibles regards…
Soudain Mouni s’affaisse… Un jet de sang souille son voile. Une de ses mains s’enfonce dans le sable. Elle soulève son buste poignardé et, la voix stridente :
— Tu ne t’es pas trompé, Ferhat. Si j’étais pour toi comme une morte, c’est à cause de celui que j’ai connu tout à l’heure sous les palmiers…

Venez, maintenant comme un vol de sombres mouches, Oasiens métis nés des esclaves soudanaises ! Venez voir comment les fils de vos pères arabes se vengent de l’adultère.
Femmes qui toutes avez péché, penchez-vous sur le cadavre de celle qui ne fut coupable que du désir inexaucé.
Penchez-vous, les superstitieuses qui devinrent stériles pour avoir été frappées par la queue du lézard des sables ; et vous les fécondes qui mangiez une vipère pour n’enfanter que des fils ; et vous les filles qui allaitez les enfants de vos sœurs, sans avoir failli, parce que vous avez avalé des mouches de cheval ; et vous les sorcières qui violez les sépulcres pour vos sortilèges immondes.
Penchez-vous, les débonnaires, fileuses de laine et tisseuses de haoulis.
Vous toutes, vierges folles des Rouara qui surgissez parmi les roses sahariennes en nocturnes apparitions ; les vicieuses, les passives, les bestiales ; vous toutes au terne sourire, aux dents rongées par le suc des dattes brunes, corps noirs aux plis bleus des étoffes ; vous toutes, animales et simiesques, penchez-vous !
Et toi, presque blanche, aux yeux de perdition, esclave de Claude Hervis, regarde avec elles le cadavre de Mouni, le fragile cadavre que n’émeuvent point les lamentations des suivantes, de celles qui escortaient la petite mariée…
Où sont tes yeux de kehoul et de poussière de soleil, ô Mouni, notre sœur et notre petite enfant ?… Tes glauques prunelles révulsées semblent défier et insulter encore la jalousie meurtrière qui fit de ton corps un crible rouge.
Où sont le charme et la beauté de ton visage doré dans ce masque méprisant et tragique aux lèvres gonflées ?…
Nos pensées sont pareilles à des épines et le remords est en nous comme un fer rouillé dans la plaie vive.
Malheureuse la main qui t’enleva aux champs d’alfa ! Malheureux ceux qui t’initièrent à d’autres horizons où fluent trop de souhaits, à d’autres choses décevantes et fatales qui chassent les résignations. Malheureux ceux qui troublèrent ton cœur ancien, le cœur de tes frères aux longs manteaux…
O notre rebelle, tu étais parmi les précieuses Endormies et nous t’avons réveillée, et te voici morte pour avoir voulu vivre la dangereuse vie de bonheur illusoire offerte par nos promesses…
Du moins si ton martyre pouvait sauver de notre zèle une multitude !…
Les officiers du Bureau arabe, blasés sur ces crimes passionnels fréquents chez les fauves nomades, vinrent pour la justice.
Ils discouraient et interrogeaient devant le petit cadavre.
— Le meurtrier ?
Il est loin. Ses mains lavées dans la seguïa sans murmure, sur sa jument alezane à la longue haleine il galope vers le Djerid tunisien.
— L’amant ?
Pas une bouche ne s’ouvre pour le nommer. Et qui le connaît à l’exception du M’zabi et de Rhadra ? Rhadra qui agonise a fait un geste d’ignorance et le M’zabi ne se soucie pas de se compromettre. Il marmonne :
— Les gens de ce pays sont fous. Ils tuent et ils écrasent la figure des femmes comme ils coupent la tête des palmiers.
Les officiers ont questionné Claude Hervis, avec un sourire pour ses bizarreries connues et une aimable déférence pour sa qualité d’artiste qui fut célèbre, qui pourrait l’être encore. Et, à ces fils d’une civilisation dont il ne veut plus être, Claude Hervis a répondu calmement :
— Je n’ai rien vu. Je ne sais rien.
Une nuit, l’Oasienne accroupie, immobile, l’entendit sangloter. Il pleurait d’apaisement après l’horreur de l’enquête infructueuse, des commentaires finis enfin !
Désormais, le doux corps et l’esprit de Mouni étaient dans la paix, à l’abri du hideux bourdonnement de toutes les mouches humaines.
O notre Mouni, nous scanderons notre hymne funèbre autour de ton sommeil dans le sable blond et chaud.

Ce jour-là, dans la cour, l’ombre du figuier et de la vigne, qui tant de fois avait caressé Lella Fatime et Mouni, était plus légère aux pensées de Noura Le Gall. L’influence du Mahdi guérissait la crise de désespérance. Elle concevait que tout n’était pas vain de ce qu’elle avait tenté, que ses épreuves mêmes seraient fécondes et concourraient mystiquement au bien de l’avenir. Elles seraient les sanglants sacrifices aux dieux mystérieux et jaloux qui défendaient le passé et veillaient sur les Enchantées figées dans leur magique sommeil…
Quelqu’un fut dans la cour, quelqu’un qu’elle n’attendait pas, qu’elle croyait ne jamais revoir ou pouvoir rencontrer dans l’indifférence et dont la présence multipliait les battements de ses artères.
Claude Hervis était debout devant elle, grave et mélancolique, le regard calme, assuré, sur tout son visage une expression décisive.
Il partageait à peine l’émotion qui étreignait Noura. Entre elle et lui, désormais, il sentait le fantôme vaporeux et doré de Mouni.
Il arrivait chargé d’un message cruel ; mais fort de ce message même offert en lugubre preuve pour dessiller les yeux de l’apôtre civilisatrice, pour la rendre juge des misérables résultats de la mission et lui dire : — « Je n’avais pas assez prévu quand j’affirmais que les oiseaux envolés reviendraient frémissants ou lassés vers leur cage. Je n’avais pas prévu ceux qui ne pourraient plus revenir, ayant ouvert des ailes trop grandes, impossibles à refermer, et qui mourraient précipités tôt où tard du haut de leur vol, broyés par les rocs de la terre quittée. »
Les lèvres de Noura s’étaient entr’ouvertes sans qu’elle pût parler. Et soudain, elle frissonna de mieux voir le visage de Claude et tel qu’elle ne l’avait jamais connu dans l’autrefois de leur amoureuse amitié. Elle respira péniblement et l’atmosphère lui sembla lourde de menace.
Cependant, elle articula :
— Pourquoi êtes-vous ici ?
— Des évènements se sont accomplis qui m’ont imposé de revenir. Je ne resterai pas longtemps. Ce que j’ai à vous dire sera bref. Pardonnez-moi si, vous aimant, je vous fais mal encore, si je vous parais dur et sans pitié comme une voix de la fatalité.
Sa main nerveuse s’appuya au figuier. De manière saisissante, il retrouvait près de la jeune fille son attitude du cimetière d’Alger.
— Je suis ici pour Mouni, dit-il.
Noura sursauta.
— Mouni n’est plus avec moi.
— Je le sais. Elle m’a appris la triste aventure.
L’angoisse et la joie luttèrent sur les traits palis de la jeune fille.
— Vous l’avez vue ? Elle est heureuse ?
— Je l’ai vue. Elle est tranquille. Elle n’était pas heureuse.
Les yeux très clairs et bleus et les yeux gris, lumineux se troublèrent comme sous un souffle de désolation.
— Comment pouvait-elle être heureuse ? prononça la voix brève du sculpteur. Vous aviez mis la possibilité de tant de désirs en elle, de tant de souhaits stériles dans l’ambiance où elle devait se mouvoir ! Vous l’aviez préparée pour être la désenchantée de deux races ; parmi ceux d’Europe à cause de la déception de son cœur ; parmi ceux de l’Islam, à cause de l’éducation franque qui engendrait les regrets et la rébellion.
— Claude Hervis, dit Noura blême, vous êtes cruel ou oublieux. La déception de son cœur ne vint pas de moi.
Une ride se creusa au front de l’artiste.
— Elle m’aimait avant mon involontaire et imprudente caresse. Je n’ai rien été qu’un jeton dans le jeu du destin.
Noura fit un effort violent.
— Soit. Ne discutons pas le passé. Que fait Mouni à présent ?
— Elle dort.
— Ah ! Ah !… exclama la jeune fille épouvantée du regard de Claude.
— Mouni est morte.
Il y eut ce silence formidable qui suit les catastrophes, avant que s’élève la clameur des foules. Mais le silence se prolongea et pas un cri n’ébranla la maison.
Noura avait glissé le long de la muraille, écroulée dans les blancheurs de sa robe sur les dalles, elle semblait pétrifiée.
Des minutes coulèrent, mortelles.
Elle passa ses mains sur son visage glacé. Ses yeux fixèrent Claude avec égarement.
— Que faites-vous ici ? Allez-vous-en !…
Il recula. Elle le retint. Et, sourdement :
— Dites-moi comment elle est morte.
Il dit le drame rapide et sa voix s’altérait en répétant des phrases de Mouni. Un sanglot sans larmes déchira sa gorge avec le dernier mot.
— Que Dieu me juge, Noura, je ne pouvais agir autrement que j’ai agi et ce meurtre n’est pas le fruit de mon refus.
Mais elle s’écria, véhémente :
— Coupable, deux fois coupable ! Vous deviez la prendre quand elle venait à vous, l’emporter, la défendre contre ceux qui la tourmentaient. Vous deviez me la rendre si vous aviez pitié d’elle et si vous m’aimiez.
— On vous l’aurait reprise.
— Non ! Une mère sait garder son petit. On l’a assassinée et c’est votre faute. Ce fut un sanglant baiser, Claude Hervis. Oh ! je vous hais !…
— Noura…
— Quel crime est le vôtre ! C’est vous qui l’avez poignardée. Et vous osez venir me dire : — « Le cadavre de ton enfant est là-bas, dans le sable, troué, déchiqueté par le couteau du meurtrier, après que mes gestes et mes paroles ont eu massacré son âme. » — Oui, je vous hais, messager de malheur ! Vous me suppliciez à mon tour et vous me répétez les pauvres mots de l’enfant martyre. Qui donc mit des cendres à la place du cœur de Mouni, ô bourreau qui voulez vous ériger en justicier ?
Sa tête heurta le sol et elle gémissait comme un être à l’agonie.
Alors, l’accent de Claude Hervis vibra, prophétique et large, presque surhumain. Il vibra, plus impérieux que la cruauté de cette heure. Il vibra, irrésistible, terrible et poignant.
— Entendez ceci, ô Noura. Et que tous vos frères de race et de pensée, et que tous les partisans d’un progrès fatal l’entendent. Si vous n’y prenez garde, si vous vous obstinez en votre prodigieux aveuglement, ouvriers insensés de la déception, de la torture et du crime, que la douleur et le sang retombent sur vous. La dernière réponse des dieux après les oracles lamentables, Noura, c’est la mort de Mouni, votre bien-aimée, la plus parfaite et la plus douloureuse à cause de cette perfection même.
Cessez votre funeste croisade. Votre civilisation est gonflée de désespoir. Vos premiers disciples ont péri ; n’en préparez pas d’autres pour les misères morales et le tombeau. Vous avez cru leur donner la richesse du cœur et de l’intelligence ; vous les avez rendus pauvres de bonheur entre les plus pauvres, inaptes aux soumissions qu’exige la vie, cabrés devant le renoncement et l’acceptation des fatalités. Vous avez ouvert les portes du gynécée pour que puissent entrer les vents néfastes de l’Europe blasée, agitée, insatisfaite, vile et ambitieuse, menteuse et profane, l’Europe monstrueuse, cette gouge aux appétits hideux sous un geste glorieux de vieil histrion. Et vous avez déchiré les doux voiles séculaires pour que ces vents soufflètent les fragiles visages. Pitié pour eux. Assez. Que l’esprit de Mouni parle avec moi. Ne vous acharnez plus à votre œuvre de perfectionnement ; c’est une œuvre de destruction. Ecoutez la parole biblique à Caïn ; que ce soit celle de votre conscience : — « Noura, qu’as-tu fait de tes sœurs ?… » —
Noura tremble. Elle se relève lentement et regarde Claude avec terreur.
Il poursuit, ardent et sombre :
— Elles étaient endormies dans le nirvâna de la tradition, et voici l’œuvre de leur réveil…
Il s’interrompt ; c’est Noura qui parle comme hallucinée :
— … Fafann et Helhala sont perdues. Zorah a tué. Oureïda, Djénèt et Mouni sont mortes…
Et le sculpteur :
— Pour celles qui reprirent leur sommeil, Hamed ou Allah ! Elles ont raison en elles et autour d’elles. Qu’elles gardent leurs précieuses figures d’idoles sous le voile. Que tout sacrilège qui tenterait de l’arracher soit châtié ! C’est le symbole d’un dernier culte en ce temps où les temples croulent, où les dieux s’en vont. C’est le voile du dernier sanctuaire parfumé d’encens archaïque.
Grâce pour celui-là !…
Le mot de la fin…
Notre lendemain seul le connaîtra.
Ce soir, notre mémoire rythme la dernière strophe d’un chant de Gœthe.
« Et puisque derrière chaque chant du poète, nous exigeons qu’une moralité gravement chemine, je veux aussi selon cette voie traditionnelle vous avouer ce que ces vers démontrent : En le chemin de la vie nous faisons plus d’un faux pas, et pourtant dans ce monde insensé, il est deux leviers bien puissants sur les actions humaines : à coup sûr le Devoir, — mais encore plus, l’Amour !… »
Noura, alors que tu sombres avec l’effroi de ton erreur, dans le naufrage de ta volonté, voici naître pour toi un amour qui te sauve, voici pour ton front l’épaule du Mahdi…
Tu avais su te faire un devoir ; tu l’avais déifié. Les épreuves tragiques te firent douter de sa sublimité et tu devenais telle une épave errante, une âme sans dieu. Le Messie paraît qui te rend une croyance.
Pour nous, si nous n’approuvons pas le devoir et les dieux de notre prochain, si nous n’aimons pas votre zèle, nous voulons cependant nous incliner devant tout autel qu’érigèrent la sincérité et le noble désir du mieux.
C’est pourquoi nous n’aurons point de blâme pour toi, Mahdi, annonciateur d’un autre matin, pour toi, Noura, crucifiée moralement à cause de ta doctrine, toi qui vas ressusciter pour une mission encore.
Dans l’ombre de la maison où passent des revenantes aux longs yeux, aux petites mains brunes et tatouées, Noura murmure :
— Grâce pour moi, ô mes mortes et mes vivantes. O mes Endormies, si je vous réveille pour la souffrance, grâce, car c’est aussi pour un bonheur possible dans l’avenir. Les premiers convertis sont lapidés. Ceux qui suivent n’endurent que des paroles ; puis, tout le peuple connaît la vérité ; la joie vient pour tous avec la lumière. Grâce pour tous les efforts qui appelleront la clarté.
Dans la ruelle musulmane bruit l’écho des pas du Mahdi…
Claude Hervis, au désert, fleurit de dahnouns et de zeïtas le blond sépulcre de Mouni !
Le mot de la fin… Notre lendemain seul le connaîtra. Et nous préférons ne pas l’entendre, nous qui portons le poids secret, les encens savoureux et la volupté d’une âme ancienne. S’il te plaît, ô Destin, quand parleront les lointains avenirs, nous serons les morts d’un autre passé.
| Pages | ||
| Dédicace | ||
| Préface | ||
| Épigraphes | ||
I. |
— Visages et Paroles | |
II. |
— Les Grandes Tentes | |
III. |
— Sous le Voile | |
IV. |
— La Voie douloureuse | |
V. |
— L’Heure du Doute | |
VI. |
— Mouni | |
VII. |
— L’Heure du Mahdi | |
Imprimerie L. Caillot et Fils, Rennes.
LIBRAIRIE E. SANSOT & Cie, EDITEURS
EXTRAIT DU CATALOGUE
Paul Adam | |
| Le Taureau de Mithra | 1 fr. |
| Le Nouveau Catéchisme | 1 » |
Maurice Barrès de l’Académie Française | |
| Huit jours chez M. Renan | 1 » |
| Quelques Cadences | 1 » |
| Alsace-Lorraine | 1 » |
Jules Bertaut | |
| Chroniqueurs et Polémistes | 3 50 |
| ouvrage couronné par l’Association des Critiques littéraires | |
Henry Bordeaux | |
| Deux méditations sur la mort | 1 » |
| Jeanne Michelin | 1 » |
Roger Le Brun | |
| Corneille devant trois siècles | 3 50 |
Léo Claretie | |
| L’École des Dames | 3 50 |
J. Ernest-Charles | |
| Les Samedis littéraires, 3 vol. à | 3 50 |
Gabriel Faure | |
| Heures d’Ombrie (5e édition) | 3 » |
| ouvrage couronné par l’Académie française | |
Mme Fernand Gregh | |
| Jeunesse (2e édition) | 3 50 |
| ouvrage couronné par l’Académie française | |
André Ibels | |
| Le Livre du Soleil | 3 50 |
Jeanne Perdriel-Vaissière | |
| Celles qui attendent | 3 50 |
| ouvrage couronné par l’Académie française | |
Jean Lorrain | |
| Heures de Corse | 1 » |
Pierre Louÿs | |
| Les Mimes des Courtisanes | 2 » |
F. T. Marinetti | |
| Les Dieux s’en vont, d’Annunzio reste (6e édition) | 3 50 |
Jean Moréas | |
| Paysages et sentiments | 1 » |
Émile Morel | |
| Les Gueules Noires, illustrations de Steinlen, préface de Paul Adam | 5 » |
Alfred Naquet ancien sénateur | |
| L’Anarchie et le collectivisme | 3 50 |
| Le Désarmement ou l’Alliance anglaise | 3 50 |
Péladan | |
| La Dernière Leçon de Léonard de Vinci | 1 » |
| La Clé de Rabelais | 1 » |
| Introduction à l’Esthétique | 1 » |
| La Doctrine de Dante | 1 » |
| De la Sensation d’Art | 1 » |
Hélène Picard | |
| L’Instant éternel (2e édition) | 3 50 |
| ouvrage couronné par l’Académie française | |
| Les Fresques (2e édition) | 3 50 |
Edmond Pilon | |
| Portraits Français, 2 vol. à | 3 50 |
| Le Dernier jour de Watteau | 1 » |
Edouard Rod | |
| Reflets d’Amérique | 1 » |
Laurent Tailhade | |
| Le Troupeau d’Aristée | 1 » |
Hélène Vacaresco | |
| Rois et Reines que j’ai connus | 3 50 |
| Nuits d’Orient | 1 » |
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.