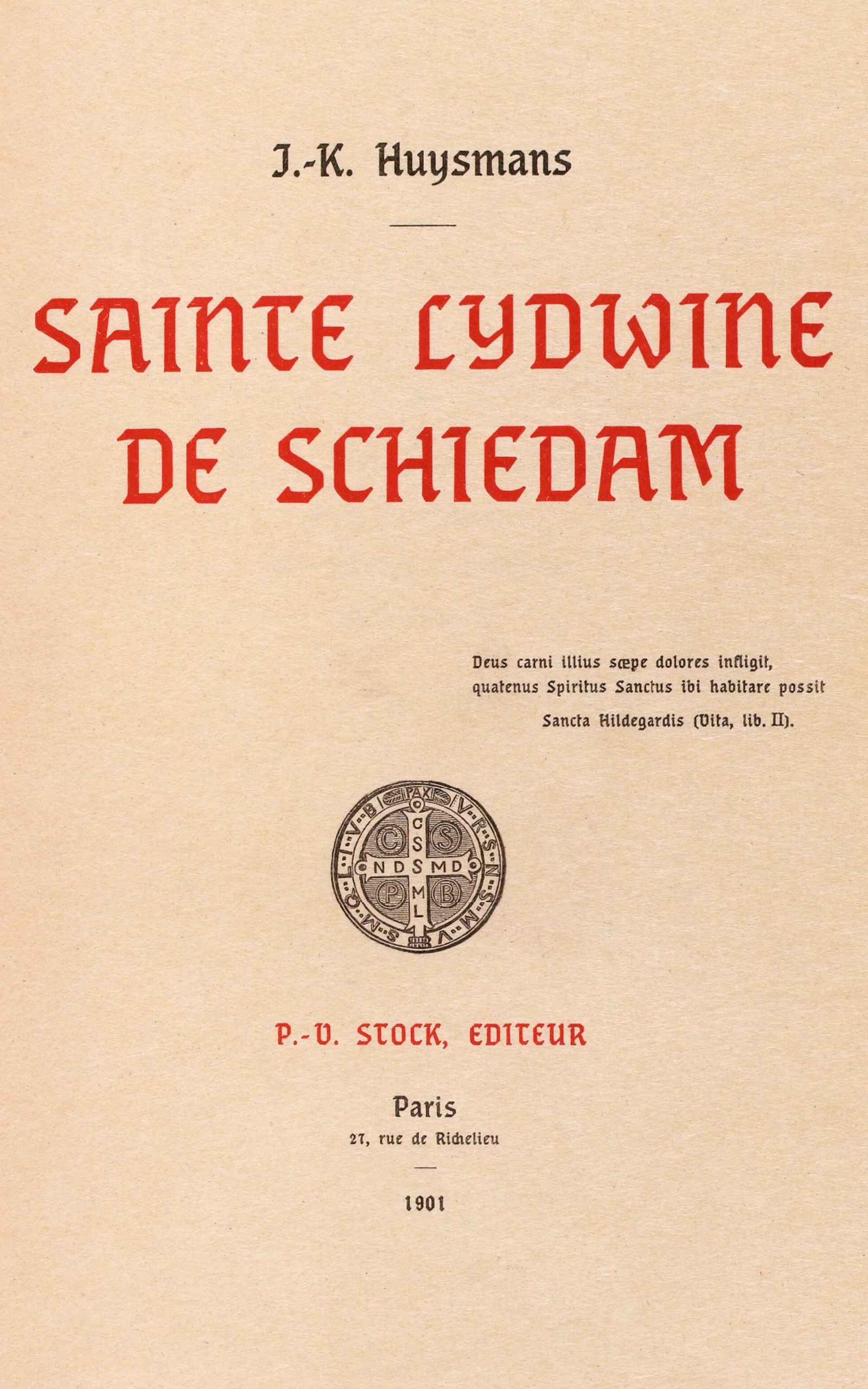
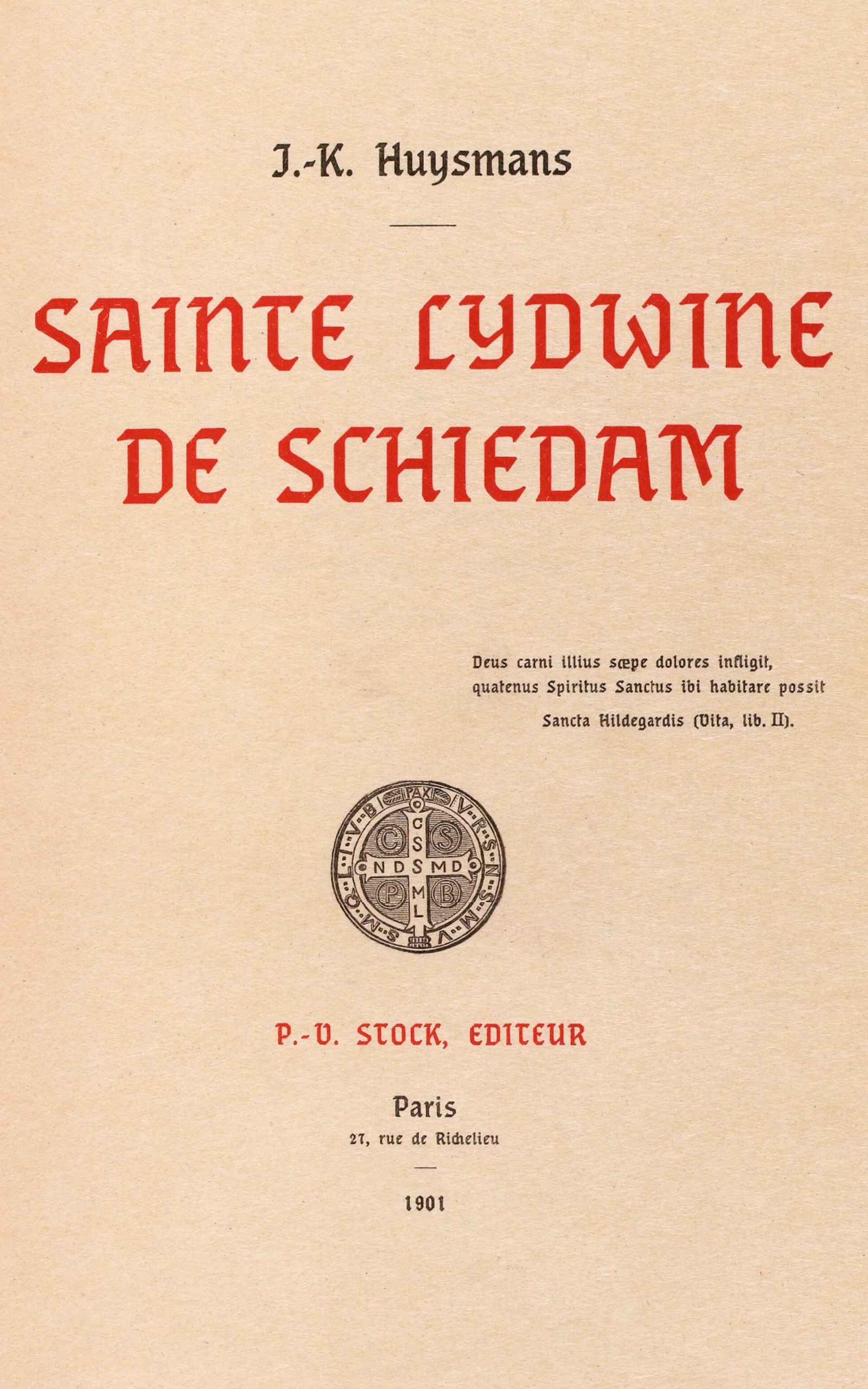
J.-K. Huysmans
Deus carni illius sæpe dolores infligit,
quatenus Spiritus Sanctus ibi habitare possitSancta Hildegardis (Vita, lib. II).
P.-V. STOCK, ÉDITEUR
Paris
27, rue de Richelieu
1901
Cette première édition de Sainte Lydwine de Schiedam a été imprimée à Hambourg par l’imprimerie « Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vorm. J. F. Richter) ».
Les caractères employés ont été dessinés par le graveur impérial M. Georges Schiller ; ces caractères ont été fondus spécialement pour cette édition avec les matrices fournies par l’imprimerie impériale.
Cette édition a été tirée à :
10 |
exemplaires |
sur papier de chine, numérotés de 1 à 10 ; |
80 |
do. |
sur papier de hollande, numérotés de 11 à 90 ; |
1150 |
do. |
sur papier ordinaire, numérotés de 91 à 1240. |
No.
L’auteur et l’éditeur déclarent réserver leurs droits
de traduction et de reproduction pour tous les pays,
y compris la Suède et la Norwège.
Ce volume a été déposé au ministère de l’Intérieur (section de la librairie), en Avril 1901.
Du même Auteur :
En préparation :
| De Tout | 1 volume |
| L’Oblat | 1 — |
A
M. & Mme Léon Leclaire
amis et compagnons
de Schiedam & de Ligugé
affectueusement.
J.-K. H.
La vie de sainte Lydwine a été successivement écrite par trois religieux qui furent, tous les trois, ses contemporains :
Jan Gerlac, son parent, sacristain du monastère augustin de Windesem. Il vécut pendant de longues années, auprès de la sainte, dans sa maison même, et il nous raconte de visu son existence.
Jan Brugman, frère mineur de l’Observance. Il reprit l’histoire de Gerlac qu’il traduisit du teuton en latin et il l’amplifia surtout avec les renseignements que lui fournit Jan Walter de Leyde, le dernier confesseur de Lydwine.
Thomas A Kempis, sous-prieur des chanoines augustins du Mont Sainte Agnès, près de Zwolle ; sa relation est un abrégé de celle de Brugman, mais elle contient des détails inédits qu’il recueillit dans l’entourage de la Bienheureuse, à Schiedam même.
Je note enfin, pour mémoire, un résumé de ces livres, rédigé plus tard, au XVIe siècle, par Surius, et d’anciennes traductions françaises du texte de Brugman, éditées au XVIIe siècle par Walrand Caoult, prêtre, Douay, in-12, 1600 ; par Michel d’Esne, évesque de Tournay, Douay, in-12, 1608 ; par le P. Thiersaut, Paris, in-12, 1637. Quant aux biographies modernes, il en sera question plus loin.
Les monographies de Gerlac et de Brugman ont été imprimées et annotées par Enschenius et Papebroch dans la collection des Bollandistes, les Acta sanctorum.
Jan Gerlac fut un écrivain renommé dont les Soliloques sont encore, au point de vue ascétique, recherchés ; il fut, d’après le témoignage de ses contemporains, un très fervent et un très humble moine ; — Jan Brugman, un ami de Denys le Chartreux, est cité par Wading, dans les Annales de son ordre, comme l’un des prédicateurs célèbres de son siècle ; il l’atteste admirable et par la noblesse de son éloquence et par l’ampleur de ses vertus ; Thomas A Kempis, un des auteurs présumés de l’Imitation de Jésus-Christ, naquit la même année que Lydwine et mourut, en odeur de sainteté, en 1471, après avoir écrit toute une série d’œuvres mystiques dont plusieurs traductions françaises furent tentées.
Ces trois hagiographes sont donc des gens connus et dignes, par leur situation et par leur probité d’âme, d’être crus ; l’on doit ajouter encore que les détails de leurs ouvrages peuvent se contrôler avec un procès-verbal officiel que rédigèrent, après une attentive et minutieuse enquête, les bourgmestres de Schiedam, du temps même de la sainte, dont ils passèrent la vie au crible. Il n’y a donc pas de livres historiques qui se présentent, ainsi que les leurs, dans des conditions de bonne foi et de certitude plus sûres.
Cela dit, il faut bien avouer qu’une histoire de Lydwine est, grâce à eux, un écheveau qu’il est fort difficile de débrouiller. Il est, en effet, impossible d’adopter l’ordre chronologique ; Brugman déclare tranquillement « qu’il jugerait inconvenant de procéder de la sorte » ; sous le prétexte d’être plus édifiant, il groupe les scènes de la vie de la Bienheureuse, suivant la liste de ses qualités qu’il s’apprête à faire ressortir ; avec cette méthode qui est également celle de Gerlac et d’A Kempis, il n’y a pas moyen de savoir si tel événement qu’ils nous rapportent eut lieu avant ou après tel autre qu’ils nous racontent.
Cette façon d’écrire l’histoire était celle, d’ailleurs, de tous les hagiographes de cette époque. Ils narraient, pêle-mêle, des anecdotes, ne s’occupant qu’à classer les vertus, afin d’être à même de tirer à propos de chacune d’elles, un tiroir de lieux-communs qui pouvaient s’adapter, du reste, à n’importe quel saint ; ils entrelardaient ces pieuses rengaines de citations des psaumes, et c’était tout.
Il semble, à première vue, qu’il y ait moyen de remédier à ce désordre, en extrayant et en comparant les dates éparses, çà et là, dans les livres des trois écrivains et en les utilisant, ainsi que des points de repère, pour ponctuer la vie de la Bienheureuse ; mais ce système n’aboutit nullement aux résultats promis. Gerlac et Brugman nous apprennent bien parfois qu’une aventure qu’ils relatent survint aux environs ou le jour même de la fête de tel saint ; l’on peut évidemment, à l’aide de cette indication, retrouver le quantième et le mois, mais pas l’année qu’ils omettent de spécifier ; les dates plus précises qu’ils accusent, Gerlac surtout, n’ont trait bien souvent qu’à des épisodes de minime importance et elles ne concordent pas toujours avec celles de Thomas A Kempis. Très méticuleux quand il s’agit de noter les fêtes liturgiques, celui-ci nous fournit un certain nombre de chiffres, mais comment s’y fier ? Ses dates, dès qu’on les examine de près, sont inexactes ; c’est ainsi qu’il fait mourir une nièce de Lydwine, Pétronille, en 1426, alors qu’il nous la montre assistant chez sa tante à une scène où elle fut blessée, en 1428. L’une des deux dates est par conséquent fausse, la seconde, très certainement, car le chiffre de 1425 donné par les deux autres écrivains paraît, cette fois, certain.
Fussent-elles même toujours d’accord entre elles, ces dates, et justes, qu’il n’en resterait pas moins à emboîter au hasard entre tel ou tel fait datés d’autres qui ne le sont pas ; et ce classement, rien ne l’indique. Quoi que l’on fasse, il faut donc renoncer à la précision chronologique en ce récit.
D’autre part, dans l’œuvre des trois biographes figurent plusieurs personnages qui sont les amis et les garde-malades de Lydwine et aucun renseignement ne nous est laissé sur eux ; ces comparses s’agitent, à la cantonade, viennent d’on ne sait où et finissent on ne sait comme ; enfin, pour aggraver la confusion, trois des confesseurs de la sainte s’appelèrent Jan. Or, au lieu d’ajouter à ce prénom le nom de famille ou de ville qui les distingue, la plupart du temps, les trois religieux n’écrivent que le prénom, si bien que l’on ignore si le confesseur Jan dont il est question à propos de tel ou de tel incident, est Jan Pot, Jan Angeli, ou Jan Walter.
C’est, on le voit, un tantinet, le gâchis. Je ne me flatte nullement de l’avoir élucidé. Je me suis servi, pour condenser cette vie, des trois textes de Gerlac, de Brugman et d’A Kempis, complétant leurs anecdotes les unes par les autres et j’ai rangé les événements qu’ils retracent suivant l’ordre qui m’a semblé être, sinon le plus rigoureux, au moins le plus intéressant et le plus commode.
En sus des histoires de France, d’Angleterre, des Flandres, de la Hollande et autres pays et de la chronologie universelle de Dreyss, j’ai dû consulter pour cet ouvrage une série de volumes dont voici la liste :
Acta sanctorum, aprilis, tomus secundus, pages 270-365, édition des Bollandistes, Palmé, Paris, 1866.
Une traduction anonyme du texte de Brugman, concernant Lydwine, a paru en un volume à Clermont-Ferrand en 1851, puis à Paris, sans date, chez Périsse. Elle est très incomplète et par suite d’une extravagante pudibonderie, volontairement inexacte.
Quant au texte de Gerlac, le plus alerte, le plus vivant des deux, il n’a jamais été translaté du latin en français.
Ven. viri Thoma a Kempis opera omnia, 1 vol. Coloniæ Agrippinæ, apud Joannem Busæum, MDCLX, pages 143-207.
Une traduction de la vie de Lydwine et de Gérard le Grand, extraite de ce livre par le P. Saint-Yves, a été éditée chez Victor Sarlit, à Paris, sans date. — Elle forme le tome VII des Œuvres spirituelles, de Thomas A Kempis.
La Vie de la Très saincte et vraiment admirable Vierge Lydwine, tirée du latin de Jean Brugman, de l’ordre de Saint-François, et mise en abrégé par Messire Michel d’Esne, évesque de Tournay, 1 vol., à Douay, de l’imprimerie de Baltazar-Bellière, au Compas d’Or, l’an 1608.
Ce petit livre, très rare, se borne, en y adjoignant quelques détails personnels, à résumer, en 80 pages, la biographie de Brugman.
Vie de la Bienheureuse Lydwine, vierge, modèle des infirmes, par M. l’abbé Coudurier, Paris, 1 vol., Ambroise Bray, 1862.
Cette biographie, tissée avec les vies expurgées des Acta Sanctorum et celle d’A Kempis, est agrémentée à la fin de chacun de ses chapitres, de pieuses réflexions et de sages conseils. Elle vient d’être rééditée par la maison Victor Retaux, à Paris.
La Flamboyante Colomne des Pays-Bas autrement dict des XVII provinces, 1 vol., Amsterdam, chez Jacob Colom, 1636.
Natales Sanctorum Belgii, auctore Joanne Molano, 1 vol., Duaci, typis viduæ Petri Borremans, sub signo SS. apostolum Petri et Pauli, 1616.
L’Abrégé du Martyrologe ou Hagiologe Belgic, ou recueil des Saincts et Bien-heureux du Païs-Bas, par Bauduin Villot, Binchois, S. J., 1 vol., Lille, chez Ignace et Nicolas de Rache, au Soleil d’Or, 1658.
La Hollande Catholique, par Dom Pitra, O. S. B., 1 vol., Paris, Bibliothèque nouvelle, 1850.
Particularités curieuses sur Jacqueline, duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande, etc., par Léopold Devillers, 1 vol., Mons, Dequesne-Masquillier, 1879.
Principes de Théologie mystique, par le R. P. Séraphin, 1 vol., Paris et Tournai, Casterman, 1873.
Principes de Théologie mystique, par Mgr. Chaillot, 1 vol., Paris, Hervé, 1866.
La Mystique divine, naturelle et diabolique, par Görres, 5 vol., Paris, Poussielgue-Rusand, 1861.
La Mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques et des analogies humaines, par Ribet, 3 vol., Paris, Poussielgue, 1879.
Vie et œuvres spirituelles de saint Jean de la Croix, 4 vol., Paris, Oudin, 1890.
La Vie spirituelle et l’oraison d’après la Sainte Écriture et la tradition monastique, Solesmes, imprimerie Saint-Pierre et Paris, Retaux, 1899.
Les Stigmatisées, par le Dr. Imbert-Gourbeyre, 2 vol., Paris, Palmé, 1873.
La Stigmatisation, par le même, 2 vol., Clermont-Ferrand. Bellet et Paris, Vic et Amat, 1894.
Essai sur le mysticisme spéculatif en Allemagne au XIVe siècle, par H. Delacroix, 1 vol., Paris, Félix Alcan, 1900.
Étude sur les mystiques des Pays-Bas, au moyen âge, par Auger. Collection des mémoires publiés par l’Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts, en Belgique, avril 1882, tome XLVI.
Introduction aux œuvres choisies de Thomas A Kempis, Étude sur la mystique dans les Flandres et les Pays-Bas, par Sigismond Ropartz, Paris, Waille, sans date.
Les Petits Bollandistes, de Mgr. Guérin, 17 vol., plus 3 de suppléments, par Dom Piolin, O. S. B., Paris, Bloud et Barral, sans date.
Les fleurs de la vie des Saints de Ribadeneira, 2 vol. in-fol., Paris, Christophe Journel, 1687.
Dictionnaire des ordres religieux, par le R. P. Helyot, 4 vol., Paris, Migne, 1847.
Tableau historique du monarchisme occidental, par Dom Bérengier, O. S. B., 2e édition, Solesmes, 1892.
Histoire de l’Église, par l’abbé Hemmer, 2 vol., Paris, Colin, 1895.
Dictionnaire des hérésies de Pluquet, 2 vol., Paris, 1764.
Histoire et filiation des hérésies, par l’abbé Morère, 1 vol., Paris, Poitiers, Oudin, 1881.
Essai historique sur l’abbaye de Cluny, par Lorain, 1 vol., Dijon, Popelain, 1839.
L’Abbaye de Mont-Olivet-Majeur, par Dom Grégoire Thomas, O. S. B., 1 vol., Florence, 1881.
Le Ménologe du Carmel, par le R. P. Ferdinand de Sainte-Térèse, carme déchaussé, 3 vol., Société de Saint-Augustin, Bruges et Paris, 1879.
Vies des Saints et Bienheureux de l’ordre de Saint-François, par le R. P. Léon, franciscain, 1 vol., Paris, Bloud et Barral, 1887.
Vie de saint Bruno, avec diverses remarques, par le P. de Tracy, théatin, 1 vol., Paris, 1785.
Denys le Chartreux, par Mougel, 1 vol., Montreuil-sur-Mer, imprimerie de la Chartreuse de Notre-Dame-des-Prés, 1896.
Vie de la Bienheureuse Marie d’Oignies, traduite du latin du cardinal de Vitry, 1 vol., Nivelle, chez l’imprimeur Plon, 1822.
Sainte Brigitte, par la comtesse de Flavigny, 1 vol., Paris, Oudin, 1892.
Sainte Catherine de Sienne, par le Bienheureux Raymond de Capoue, traduction Cartier, 1 vol., Paris, Sagnier et Bray, 1853.
Sainte Françoise Romaine, par Dom Rabory, O. S. B., 1 vol., Paris, librairie catholique internationale, 1886.
Sainte Françoise Romaine, traduite des Acta sanctorum, par un vicaire général d’Évreux, 1 vol., Paris, Périsse, sans date.
Sainte Françoise Romaine, par la comtesse de Rambuteau, 1 vol., Paris, Lecoffre, 1900.
Sainte Colette, par l’abbé Douillet, curé de Corbie, 1 vol., Paris, Bray et Retaux, 1869.
La Bienheureuse Jeanne de Maillé, par Bourassé et Janvier, 1 vol., Tours, Mame, 1873.
Saint Bernardin de Sienne, par Thureau-Dangin, 1 vol., Paris, Plon, 1897.
Saint Vincent Ferrier, par le P. André Pradel, de l’ordre des frères Prêcheurs, 1 vol., Paris, Veuve Poussielgue-Rusand, 1864.
La Vie et les œuvres spirituelles de Catherine d’Adorny de Gennes, 1 vol., Paris, chez Martin Durand, rue Saint-Jacques, au roy David, 1627.
Sainte Catherine de Gênes, Vie et œuvres, par le vicomte de Bussière, 1 vol., Paris, Allard, sans date.
Sainte Térèse, sa Vie écrite par elle-même, traduite par le P. Marcel Bouix, S. J., tome I des œuvres, Paris, Lecoffre, 1884.
Histoire de sainte Térèse (par une carmélite), 2 vol., Paris, Retaux-Bray, 1887.
Vie de sainte Catherine de Ricci, par le P. Bayonne, de l’ordre des Frères prêcheurs, 2 vol., Paris, Poussielgue frères, 1873.
La Vie de sainte Madeleine de Pazzi, par le P. Lézin de Sainte-Scolastique, 1 vol., Paris, Sébastien Cramoisy, 1670.
La Vie de sainte Madeleine de Pazzi, par Fabrizzi, 1 vol., Lyon et Paris, Pélagaud, 1873.
Vie de Marguerite du Saint-Sacrement, par de Cissey, 1 vol., Paris, Ambroise Bray, 1856.
Vie de la sœur Marie Ock, par le P. Albert de Saint-Germain, 1 vol., Tournai et Paris, Casterman, 1886.
Vie de Marcelline Pauper, publiée par le P. Marcel Bouix, S. J., 1 vol., Nevers, imprimerie Fage, 1871.
Anne-Catherine Emmerich, Œuvres, 9 vol., Tournai et Paris, Casterman, sans date.
Anne-Catherine Emmerich, sa Vie, par le P. Schmœger, de la Congrégation du T. S. Rédempteur, traduite de l’allemand, par l’abbé Cazalès, 3 vol., Paris, Bray, 1868.
Anne-Catherine Emmerich, Vie merveilleuse, intérieure et extérieure, par le P. Thomas Wegener, O. S. A., 1 vol., Tournai et Paris, Casterman, sans date.
La Vénérable Anna-Maria Taïgi et la servante de Dieu, Élisabeth Canori Mora, par le P. Calixte, trinitaire déchaussé, 1 vol., Bruxelles, Gœmare, 1871.
Vie de la servante de Dieu, Élisabeth Canori Mora, anonyme, 1 vol., Paris, bureau des Annales de la Sainteté, 1870.
Marie-Claire-Agnès Steiner, Abrégé de la vie du P. de Reus, traduit de l’italien, par Mgr. Constans, 1 vol., Paris, librairie catholique internationale, 1883.
Les Stigmatisées du Tyrol, par Léon Boré, 1 vol., Paris, Lecoffre, 1846.
Les Voix prophétiques, par l’abbé Curicque, 2 vol., Paris, Palmé, 1872.
Mme du Bourg, mère Marie de Jésus, fondatrice de la Congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge, par l’abbé Bersange, 1 vol., Paris et Lyon, Delhomme et Briguet, sans date.
Louise Lateau (figure dans les Stigmatisées du Dr. Imbert-Gourbeyre, déjà citées).
Louise Lateau, Étude médicale, par le Dr. Lefebvre, 1 vol., Louvain, Peeters, 1873.
Vie de la sœur Marie-Catherine Putigny (par une sœur visitandine), 1 vol., imprimerie de Notre-Dame-des-Prés, à Neuville-sur-Montreuil, 1888.
L’on peut encore joindre à la liste de ces ouvrages, les quelques livres que j’ai dépouillés à propos des épidémies et de la condition des lépreux, au Moyen-Age :
Notice historique sur la maladrerie de Voley, par le Dr. Ulysse Chevalier, 1 vol., Romans, 1870.
Les Lépreux de Reims au XVe siècle (par Tarbé), Société des bibliophiles de Reims, 1857.
Les Signes d’infamie au moyen âge, par Ulysse Robert, 1 vol., Paris, Champion, 1891.
Chéruel, Dictionnaire des institutions, mœurs et coutumes de la France, 2 vol., Paris, Hachette, 1870 (voir articles ladres et léproseries dans le tome II).
Dr. Dupouy, Le Moyen âge médical, 1 vol., Paris, Meurillon, 1888.
Dr. Louis Durey, La Médecine occulte de Paracelse, 1 vol., Paris, Vigot frères, 1900.
Est-il utile d’ajouter que dans ce volume au cours duquel défilent les noms d’un grand nombre de célicoles, les expressions « Saint et Sainteté », « Bienheureux et Vénérable », ne sont parfois employées que d’une manière relative et non dans le sens rigoureux que leur assignent les décrets du pape Urbain VIII ; il n’y a donc pas à attribuer une signification absolue à ces termes, lorsqu’ils s’appliquent à des personnages dont la béatification ou la canonisation n’ont pas été officiellement proclamées par les pouvoirs sans appel de Rome. Il ne convient pas davantage de considérer ainsi que des saintes, dans l’acception stricte du mot, les victimes expiatrices dont l’origine céleste des souffrances n’a pas encore été certifiée par l’Église.
L’état de l’Europe, pendant le temps que vécut Lydwine, fut effroyable.
En France, règnent Charles VI puis Charles VII. Lydwine naît l’année même où Charles VI, âgé de douze ans, monte sur le trône. Dans le lointain des âges, les années de ce règne évoquent d’abominables souvenirs ; elles dégouttent de sang et, à mesure qu’elles s’éboulent, les unes sur les autres, elles se dévergondent ; aux lueurs des vieilles chroniques, derrière le transparent poussiéreux de l’histoire, quatre figures passent.
L’une est celle d’un aliéné, au teint hâve, aux joues creuses, aux yeux tantôt ardents et tantôt morts ; il croupit dans un palais à Paris et ses vêtements sont des pacages de vermines et ses cheveux et sa barbe sont des haras à poux. Ce malheureux qui fut, avant qu’il ne divaguât, un être familier et libertin, irascible et débile, c’est le roi Charles VI. Il assiste, maintenant idiot, à la bacchanale enragée des siens.
L’autre est celle d’une intrigante, baroque et vénale, d’une femme impérieuse, bruyamment décolletée et traînant après elle, sous un hennin planté, comme une tête de diable, de deux cornes, une robe historiée et qui n’en finit point ; et elle souffle lorsqu’elle marche, chaussée de souliers à becs de deux pieds de long ; c’est la reine de France, la bavaroise Ysabeau, qui apparaît, grosse des œuvres d’on ne sait qui, près d’un mari qu’elle abhorre.
La troisième est celle d’un bavard et d’un fat dont les dames de la Cour raffolent et qui se révèle, à la fois, cordial et rapace, avenant et retors ; il pressure le pays, draine l’argent des campagnes et des villes et le dissipe en de scandaleuses équipées ; celui-là, c’est le duc d’Orléans, le maudit des peuples, ainsi que l’appelle, en pleine chaire, un religieux de l’ordre de saint Augustin, Jacques Legrand.
La quatrième, enfin, est celle d’un petit chafouin, malingre et taciturne, sournois et cruel, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, qualifié de Jean sans pitié, par tous.
Et tous les quatre se démènent, s’invectivent, s’écartent et se rejoignent, exécutent une sorte de chassé-croisé macabre, dans la débandade d’une nation qui répercute l’insanité d’un roi. La France, en effet, se convulse ; à Paris, ce sont les atrocités de la guerre civile, la dictature des bouchers et des égorgeurs qui saignent les bourgeois, tels que des bêtes ; en province, ce sont des troupes de malandrins qui assomment le paysan, incendient les récoltes et jettent les enfants et les femmes dans le brasier des meules ; ce sont les hordes scélérates des d’Armagnac, la tourbe avide des Bourguignons et ceux-là tendent la main aux Anglais pour les aider à sauter la Manche ; et les voilà, en effet, qui débarquent près d’Harfleur, remontent vers Calais et rencontrent, en chemin, l’armée française, dans le comté de Saint-Pol, à Azincourt. Ils l’attaquent et sans peine abattent, ainsi que des quilles, les files de ces lourds chevaliers emprisonnés comme en des guérites de fer dans leurs armures et huchés sur des chevaux qui demeurent immobiles, les quatre pattes enfoncées dans l’argile détrempée du sol ; et, tandis que la région est envahie, le Dauphin fait assassiner le duc de Bourgogne qui a lui-même fait occire le duc d’Orléans, le lendemain du jour où il s’est réconcilié et a communié de la même hostie, avec lui ; de son côté, la reine Ysabeau, stimulée par ses besoins de luxe, se vend à l’ennemi et oblige le fou qui règne à signer le traité de Troyes ; et, ce faisant, elle déshérite son fils au profit du souverain d’Angleterre devenu héritier de la couronne de France. Le Dauphin n’accepte pas cette déchéance et, trop faible pour résister, il prend la fuite et est proclamé roi par quelques aventuriers, dans un manoir de l’Auvergne ; le pays est scindé en deux camps, trahi par les uns, roué de coups par les autres, rançonné par tous. Il semble que sa dispersion soit proche quand, à quelques mois d’intervalle, le roi d’Angleterre Henri V et le roi de France, Charles VI, meurent ; la lutte n’en continue pas moins entre les deux nations. Charles VII, insouciant et craintif, toujours vu de dos, prêt à décamper, se perd en de basses intrigues, pendant que l’ennemi lui rafle, une à une, ses provinces ; on ne sait plus très bien ce qu’il va rester de la France, quand le ciel jusqu’alors impassible s’émeut ; il envoie Jeanne d’Arc, elle accomplit son œuvre, chasse les étrangers, mène sacrer son misérable monarque à Reims et expire, délaissée par lui, dans les flammes, deux années avant que Lydwine ne trépasse.
Ce sort de la France, à la fin du XIVe siècle et au commencement du XVe, fut donc atroce, et il le fut merveilleusement, car les fureurs humaines ne suffirent point et les fléaux s’en mêlèrent ; la peste noire sévit et faucha des milliers d’êtres ; puis elle disparut pour céder la place au tac, une épidémie singulièrement redoutable, à cause de l’ardeur meurtrière de ses toux ; celle-là s’éteignit à son tour et la peste revint, vida Paris seul de cinquante mille personnes en cinq semaines et s’en alla, laissant à sa suite, trois années de famine ; ce après quoi, le tac surgit encore et acheva de dépeupler les villes.
Si la situation de la France est lamentable, celle de l’Angleterre, qui la torture, ne vaut guère mieux. Aux soulèvements du peuple, succèdent les révoltes des nobles ; on s’égorge dans l’île et l’on s’y noie. Le roi Richard II se rend odieux à tous par ses débordements et ses rapines. Il part pour réprimer les troubles de l’Irlande ; on le dépose et on lui substitue le duc de Lancastre, Henri VI, qui le claquemure dans un cul de basse fosse et le décide, en lui imposant trop de jeûnes forcés, à mourir. Le règne de l’usurpateur se passe à modérer des discordes et à déjouer des brigues ; entre temps, il brûle, sous couvert d’hérésie, ceux de ses sujets qui lui déplaisent et traîne dans des crises d’épilepsie une existence de malade que les manœuvres de son fils, aux aguets de sa succession, désespèrent. Il trépasse à l’âge de quarante sept ans et ce fils connu jusqu’alors comme un pilier de cabarets et un chenapan qui ne fréquentait que les voleurs et les filles, se décèle, dès qu’il monte sur le trône, ainsi qu’un homme froid et cassant, d’une arrogance démesurée et d’une piété féroce. Le pharisaïsme et la cupidité de la race anglaise se sont incarnés en lui ; il préfigure la sécheresse et le bégueulisme éperdu des protestants ; il est, en même temps qu’un usurier et un bourreau, un pasteur méthodiste, avant la lettre. Il rénove la campagne de Normandie, affame les villes, falsifie les monnaies, pend, au nom du Seigneur, les prisonniers, accable de sermons ses victimes ; mais son armée est lacérée par la peste et cette curée qu’il sonne du terroir de France, l’épuise. Il est néanmoins victorieux à Azincourt ; il massacre tous ceux qui ne peuvent se racheter et exige d’énormes rançons des autres et, tandis qu’il agit de la sorte, il se signe, il marmotte des oraisons, il récite des psaumes ; puis il décède au château de Vincennes et son héritier est un enfant de quelques mois. Ses tuteurs, l’un violent et dissolu, maladroit et vénal, le duc de Glocester ; l’autre vaniteux et rusé, le duc de Bedford, ravagent la France, mais ils sont battus à plate couture par Jeanne d’Arc et se souillent à jamais en l’achetant pour la faire périr, après un infâme procès, sur un bûcher.
Et après la France et l’Angleterre, ce sont les Flandres qui, atteintes en plein flanc, gisent, démâtées par les bourrasques.
Leur histoire est intimement liée à la nôtre et elles sont, elles aussi, dévorées par les luttes intestines ; la rivalité commerciale de Gand et de Bruges fait jaillir, durant des années, de ses prairies devenues des ossuaires, des sources de sang.
Gand se décèle ainsi qu’une cité orgueilleuse et têtue, peuplée d’un amas d’éternels mécontents et de pieuses brutes ; avec ses corps de métier, elle est le bivac des jacqueries, le camp dans lequel se ravitaillent les séditions des vilains ; tous les révolutionnaires de l’Europe font cause commune avec elle ; — Bruges semble plus policée et moins opiniâtre, mais sa superbe égale celle de Gand et son âpreté au gain est pire. Elle est le grand comptoir de la chrétienté et elle asservit, avidement, les villes qui l’entourent ; elle est une négociante implacable et à propos d’un canal qui peut avantager l’une de ces agglomérations au profit de l’autre, des haines de cannibales naissent. Le comte de Flandre Louis III dit de Male, tyranneau vaniteux et prodigue, malchanceux et cruel, se heurte à l’entêtement des Gantois et vainement il s’efforce de le briser par des supplices. Leur chef Philippe d’Artevelde marche contre lui, le défait, pénètre dans Bruges dont il tue, de préférence, les plus riches commerçants ; ce après quoi, il saccage les hameaux et spolie les bourgs. La noblesse des Flandres appelle la France à l’aide ; c’est une croisade de castes où le rôle d’infidèles est joué par des tisserands ; Charles VI et le duc de Bourgogne franchissent la frontière, rejoignent, à la tête d’une armée, d’Artevelde à Roosebeke et ils foncent sur les Flamands qui se sont bêtement reliés entre eux avec des chaînes, pour ne pas reculer ; ils les refoulent, les acculent les uns sur les autres, les suffoquent dans un étroit espace, sans même qu’ils puissent résister. Ce fut le triomphe de l’asphyxie, un combat sans blessures, un massacre sans plaies, une bataille pendant laquelle le sang sortit seulement, comme de tonnes qu’on débouche, par les bondes éclatées de visages bleus. D’Artevelde fut, heureusement pour lui, reconnu parmi les morts, car aussitôt après la victoire, les bas instincts se décagèrent ; on pilla les campagnes, l’on trucida les enfants et les femmes ; celles des places qui ne voulurent pas être détruites, se rachetèrent à prix d’or : ce fut la bourse ou la vie ; cette noblesse qui avait tremblé devant la troupe de ces gueux, se montra inexorable ; les Gantois exaspérés recoururent aux Anglais qui débarquèrent mais glanèrent surtout le butin que les Français omirent ; ce malheureux pays devint alors la proie et de ceux qui l’attaquèrent et de ceux qui le défendirent ; mais ni les déprédations, ni les tortures n’amollirent son incroyable énergie. Ackermann a succédé à d’Artevelde et soutenu par un corps d’outre-Manche, il assiège Ypres. Charles VI le déloge et s’empare de Bergues où il ne tolère pas un être vivant, puis, las de ces orgies de meurtres, il conclut pour se reposer une trêve. Sur ces entrefaites, Louis de Male décède et Philippe de Bourgogne hérite, du chef de sa femme, de cette terrible succession des Flandres. Il reprend les hostilités interrompues et les massacres et les incendies se suivent ; la place de Dam est réduite en cendres ; le pays dit des Quatre Métiers n’est plus qu’un amas de ruines ; et comme si ces horreurs ne suffisaient pas, les querelles religieuses viennent se greffer sur cet interminable conflit. Deux papes ont été élus à la fois qui se bombardent à coups de bulles. Le duc de Bourgogne prône l’un de ces pontifes et entend que ses sujets acceptent son obédience ; ceux-ci refusent et Philippe s’irrite, décapite les meneurs du parti qui regimbent ; mais, une fois de plus, les flamands se révoltent ; les églises se ferment, les offices religieux cessent, la Flandre semble frappée d’interdit et le duc, excédé par ces disputes, finit par laisser ce peuple dont il ne peut venir à bout, tranquille ; il se contente, en échange de sa liberté de conscience, de lui extirper des sous.
Telle la situation des Flandres ; si nous passons dans la Hollande même, nous la voyons, elle aussi, bouleversée par d’incessants combats.
Au moment où naît Lydwine, le duc Albert gouverne, en qualité de Ruwaard ou de vice-régent, le Hainaut, la Hollande, la Zélande, la Frise, les provinces réunies sous le titre de Comté du Pays-Plat. Il remplace le véritable souverain, son frère, Wilhelm V qui, après des luttes impies avec Marguerite de Bavière, sa mère, est devenu fou ; et tandis qu’on l’interne, le pays à vif se démène ; une bataille enragée se livre entre les bonnets rouges ou Hoeks et les bonnets gris ou Kabeljauws ; ces deux partis, les Guelfes et les Gibelins des Pays-Bas, s’étaient formés à propos de la guerre entreprise par Wilhelm contre la princesse Marguerite, les uns tenant pour le fils et les autres pour la mère ; mais ces haines survécurent aux causes qui les engendrèrent, car nous les retrouvions, encore vivaces, au XVIe siècle.
Aussitôt qu’il est nommé vice-régent, le duc Albert met le siège devant Delft, dont il mate la sédition, en dix semaines ; puis ce fut une prise d’armes contre le duc de Gueldre et l’évêque d’Utrecht ; ce fut enfin le scandaleux litige d’un père et d’un fils, faisant en quelque sorte pendant à la rivalité de la mère et du fils du précédent règne.
Wilhelm V meurt, et le duc Albert est proclamé gouverneur des provinces ; le pays, fourbu par ces dissensions, s’apprête à souffler un peu ; mais le duc Albert est dominé par sa maîtresse Adélaïde de Poelgeest et il trahit, sous son influence, le parti des Hoeks qui l’avait jusqu’alors protégé. Poussé par ceux-ci, son fils Wilhelm fait assassiner Adélaïde au château de La Haye, puis, craignant la vengeance de son père, il se sauve en France ; mais la Frise se soulève et cette rébellion rapproche le père du fils. Persuadé que le meurtrier est seul capable de commander les troupes, le duc Albert lui accorde son pardon et le rappelle. Il débarque au Kuinder et les saignées commencent. La Frise ruisselle de sang, mais elle ne s’avoue pas vaincue ; l’année suivante elle se révolte derechef, est réduite et elle s’insurge encore, rompt cette fois les armées du duc et le force à souscrire à un traité de paix. L’on dirait d’une Gand hollandaise, rude et tenace.
Cette guerre est à peine terminée qu’une autre éclate ; un vassal, le seigneur d’Arkel se déclare indépendant, au moment où le duc Albert trépasse. Wilhelm VI, qui succède à son père, marche contre le rebelle, conquiert ses châteaux et l’oblige à se soumettre ; mais le duc de Gueldre se mutine à son tour et les Frisons une fois de plus fermentent. Wilhelm à bout de ressources et malade signe avec eux, après qu’ils ont capturé la ville d’Utrecht, un armistice, et décède laissant, avec de nombreux enfants naturels, une fille légitime Jacqueline.
Elle occupe la place de son père et le désordre s’accroît. La vie de cette singulière princesse ressemble à un roman d’aventures. Son père la marie à seize ans à Jean, duc de Touraine, dauphin de France, qui périt, quelque temps après, empoisonné. Elle se remarie sans tarder avec son cousin germain, Jean IV, duc de Brabant, une sorte d’énervé et de niais, qui la dédaigne et vit publiquement avec une autre femme. Elle le quitte et s’enfuit en Angleterre auprès d’Humphrey, duc de Glocester, dont elle s’est amourachée ; elle obtient de l’antipape, Pierre de Lune, un bref qui prononce le divorce entre elle et le duc de Brabant et elle épouse le duc de Glocester. Ils sont à peine unis, qu’il leur faut rentrer précipitamment en Hollande pour en expulser Jean de Bavière, évêque de Liège, oncle de Jacqueline, qui a profité de l’absence de sa nièce pour envahir ses États ; ce prélat est vaincu et se retire. Glocester, qui ne paraît pas très épris de Jacqueline, l’installe à Mons et retourne en Angleterre. Alors la malheureuse se débat dans un lacis d’intrigues ; son oncle, le duc de Bourgogne, en tient les fils ; elle se sent enveloppée de toutes parts ; tous sont contre elle, son oncle, l’évêque de Liège qu’elle a vaincu, son second mari Jean de Brabant, qui capte le Hainaut, alors qu’elle ne peut le secourir et le duc de Bourgogne qui, résolu à appréhender la Hollande, impose les garnisons de ses soudards de la Picardie et de l’Artois, aux villes.
Jacqueline, qui comptait au moins sur la fidélité de ses sujets de Mons, est livrée par eux au duc de Bourgogne ; celui-ci l’enferme dans son palais de Gand où elle reste trois mois, mais elle profite d’un moment où les soldats chargés de la surveiller s’enivrent, pour fuir, déguisée en homme et elle gagne, bride abattue, Anvers et atteint Gouda. Là, elle se croit en sûreté et appelle son mari à l’aide, mais le Glocester a oublié qu’elle était sa femme et il en a épousé une autre. Il refuse d’intervenir. Jacqueline se décide alors à se défendre seule. Elle fortifie Gouda que les troupes de Bourgogne assiègent, elle fait percer la digue de l’Yssel et inonde le territoire pour abriter d’un côté la ville ; puis, elle se porte de l’autre côté au-devant de l’ennemi et le taille en pièces ; mais son triomphe fut de courte durée, car l’année suivante, elle essaie vainement de prendre Harlem d’assaut et ses partisans sont dispersés, tandis que, sur les instances du duc de Bourgogne, le véritable pape déclare que son mariage avec le duc de Glocester est nul et qu’il constitue, en dépit du bref de l’antipape, un adultère.
Alors tous lui tournent le dos ; abandonnée par ceux qui lui étaient demeurés fidèles, elle se résout, pour sauvegarder sa liberté, à demander grâce au duc de Bourgogne et elle conclut avec lui, à Delft, une convention aux termes de laquelle elle le reconnaît comme son héritier, lui cède, de son vivant, ses provinces et s’engage en sus, car son second mari vient de mourir, à ne pas se remarier sans son consentement ; mais elle est à peine libre qu’elle omet ses promesses, car elle tombe amoureuse de Frank de Borselen, stathouder de Hollande, et l’épouse en secret. Philippe de Bourgogne, qui la cerne d’espions, apprend cette union et ne dit mot ; mais il attire de Borselen dans un guet-apens et l’interne à Rupelmonde, dans les Flandres ; puis il fait savoir à Jacqueline qu’il le pendra haut et court si elle ne renonce pas, une bonne fois et sans conditions, à ses droits sur les districts des Pays-Bas. Afin de sauver son mari, elle abdique tous ses pouvoirs entre les mains du duc et se retire avec de Borselen, le seul homme qui paraisse l’avoir réellement aimée, à Teylingen. Là, dans ce donjon, les chroniqueurs la montrent malade et triste, ne parvenant pas à se consoler de sa déchéance, s’amusant à modeler des petites cruches de terre et finissant par s’éteindre de consomption, à l’âge de trente-six ans, trois années après le décès de Lydwine, sans laisser, de ses quatre maris, aucun enfant.
Telle est, en quelques lignes, son histoire. Quelle fut au juste cette étrange Jacqueline ? Sur son compte les avis diffèrent. Les uns la représentent comme une aventurière et une dévergondée, les autres comme une femme tendre et chevaleresque, victime de l’ambition des siens ; elle semble avoir été surtout une impulsive, inapte à résister aux émois de ses sens. Un portrait plus ou moins exact d’elle, inséré dans « La Flamboyante Colonne des Pays-Bas », nous la dépeint sous les traits d’une forte Hollandaise, avenante et commune, d’une virago énergique et hagarde ; et on se la figure en effet assez bien ainsi, impérieuse et versatile, intrépide et toquée, mais au fond brave femme.
En attendant, cette Hollande qu’elle gouvernait devait supporter les conséquences de ses coups de cœur et le pays saccagé par les troupes des Bourguignons, lacéré par les bandes des Hoeks et des Kabeljauws, perdait son sang ; des inondations qui engloutirent des villages entiers achevèrent de le désespérer et pour parfaire le tout, ce fut la peste.
Le reste de l’Europe fut-il mieux partagé et plus heureux ? Il ne le paraît guère.
En Allemagne règne une fastueuse crapule, l’empereur Wenceslas ; celui-là ne dessaoule pas ; il trafique des charges, tandis que ses vassaux s’assomment et, pour avoir la paix, il faut le balayer, lui et ses concubines, dehors.
En Bohême et en Hongrie, c’est la lutte exaspérée des Slaves contre les Turkomans ; puis ce sont les massacres en masse des Hussites ; la vallée du Danube est un immense charnier au-dessus duquel plane la peste.
En Espagne, les indigènes se déciment avec les Maures et c’est une haine sans merci entre les provinces. En Castille, Pierre le Cruel, une sorte de forcené, tue ses frères, son cousin, sa femme Blanche de Bourbon et invente d’épouvantables tourments pour torturer des captifs. En Aragon, Pierre le Cérémonieux vole les biens de sa famille et exerce d’horribles sévices sur ses ennemis. Le maître de la Navarre est un empoisonneur, Charles le Mauvais. En Portugal, un autre Pierre le Cruel, épris de fanfares et de supplices, fait arracher le cœur à des gens qui, après avoir été martyrisés, respirent encore et, atteint d’un accès de vampirisme aigu, il déterre sa maîtresse morte, l’assied, vêtue d’ornements royaux et couronnée d’un diadème, sur un trône et il force tous les seigneurs de sa Cour à défiler devant ce cadavre et à lui baiser la main.
En vérité, la péninsule est un douaire d’épimanes et la démence quasi-débonnaire d’un Charles VI semble presque raisonnable si on la compare aux aberrations de ces possédés-là !
En Italie c’est, avec la guerre civile, la peste ; et dans ce déchaînement de fléaux, des ruffians s’écharpent ; on se bat dans les rues de Rome ; la famille des Colonna et ses séides s’insurgent contre le pape et, sous le prétexte de rétablir l’ordre, le roi de Naples, Ladislas, s’empare de la ville et, après l’avoir pillée, la quitte et revient pour la piller encore ; entre Gênes et Venise, c’est une collision qui aboutit à de féroces représailles ; à Naples, c’est la reine Jeanne qu’on enlève pour l’étouffer entre deux matelas, dans un château de la Basilicate ; à Milan, ce sont les atrocités de factions aux prises ; mais ce qui fut pis encore, ce fut le sort de l’Église devenue soudain bicéphale. Si les membres de son pauvre corps, si les régions catholiques s’étiolaient, malades et à bout de sang, ses deux têtes à elle, qui se dressaient, l’une à Avignon et l’autre à Rome, ne cherchaient qu’à s’entredévorer. Elle était, en effet, dominée par d’effrayants pontifes ; c’était l’époque du grand schisme de l’Occident. La situation du Saint-Siège était celle-ci : le roi de France Philippe le Bel avait autrefois assis sur la chaire de Saint-Pierre l’une de ses créatures, Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux. Après avoir été consacré à Lyon, ce souverain, au lieu de se fixer à Rome, s’était installé dans la principauté d’Avignon ; avec lui commença cette période que les écrivains appellent l’exil de Babylone ; des papes se succédèrent, moururent sans avoir pu se décider à regagner leurs États ; enfin, en 1376, Grégoire XI reprit possession de la ville éternelle et décéda au moment où, dégoûté de l’Italie, il s’apprêtait à retourner en France.
Il trépasse et c’est une suite de pontifes qu’on élit et qu’on rejette. Rome en nomme un et Avignon un autre ; l’Europe se divise en deux camps. Urbain VI, le pape de Rome le plus honnête, mais le plus imprudent et le plus sanguinaire des deux, est reconnu par la Germanie, l’Angleterre, la Hongrie, la Bohême, la Navarre, les Flandres et les Pays-Bas ; l’autre, Clément VII, le pape d’Avignon, est de mœurs plus douces, mais il est dénué de scrupules ; il pratique la simonie, vend les indulgences, brocante les bénéfices, bazarde les grâces. Il est accepté par la France, l’Écosse, la Sicile, l’Espagne. Les deux pontifes guerroient à coups d’interdits, rivalisent de menaces et d’injures. Ils meurent ; on les remplace et leurs successeurs s’excommunient à tour de bras, tandis qu’un troisième pape, élu par le concile de Pise, les couvre, de son côté, d’anathèmes.
Le Saint-Esprit se promène au hasard de l’Europe et l’on ne sait plus auquel de ces pasteurs il convient d’obéir ; la confusion devient telle que même l’entendement des saints se brouille. Sainte Catherine de Sienne tient pour Urbain VI et le bienheureux Pierre de Luxembourg pour Clément VII. Saint Vincent Ferrier et sainte Colette se soumettent, un moment, à l’obédience de l’antipape Pierre de Lune, puis finissent par se rallier à une autre tiare ; c’est le désarroi le plus absolu ; jamais on ne vit chrétienté dans un chaos pareil. Dieu consent à démontrer l’origine divine de l’Église, par le désordre et l’infamie des siens ; il n’est point, en effet, d’institution humaine qui eût pu résister à de tels chocs. Il semble que Satan ait mobilisé ses légions et que les barathres des enfers soient vides ; la terre appartient à l’Esprit du Mal et il bloque l’Église, l’assaille sans répit, réunit toutes ses forces pour la culbuter et elle n’est même pas ébranlée. Elle attend patiemment que les saints que Dieu lui enverra la dégagent ; elle a des traîtres dans la place, des papes affreux, mais ces pontifes de péchés, ces êtres si misérables lorsqu’ils se laissent séduire par l’ambition, par la haine, par le lucre, par toutes ces passions que le Diable attise, se retrouvent infaillibles aussitôt que l’Ennemi s’essaie à détruire le dogme ; le Saint-Esprit que l’on croyait perdu revient et les assiste ; lorsqu’il s’agit de défendre les enseignements du Christ, aucun pape, si vil qu’il soit, ne défaille. Il n’en est pas moins vrai que les malheureux croyants qui vécurent dans l’horreur de ces extravagantes années, crurent que tout allait s’effondrer ; et, en effet, de quelque côté qu’ils se tournent, ils ne voient que des champs de carnage.
Au sud, dans l’Orient chrétien, ce sont les Grecs, les Mongols et les Turcs qui s’exterminent ; au nord, ce sont les Russes qui avec les Tartares et la Suède, qui, avec les Danois, s’égorgent ; et si, regardant plus loin encore, ils franchissent, d’un coup d’œil, les territoires saccagés de l’Europe, s’ils vont jusqu’à la ligne de ses frontières, c’est la fin du monde qu’ils aperçoivent, ce sont les menaces de l’Apocalypse qui sont sur le point de se réaliser. Sur un ciel qui tremble, déchiré par le fouet des foudres, les limites de l’univers chrétien se dessinent en des traits de feu ; les hameaux situés sur les confins des pays idolâtres flambent ; la zone des démons s’éclaire ; Attila est ressuscité et l’invasion des barbares recommence ; dans un tourbillon de janissaires, l’émir des Ottomans, Bajazet, passe, rasant comme un ouragan les campagnes et balayant les villes ; il se précipite à Nicopolis contre les forces catholiques réunies pour lui barrer la route ; il les broie, il va déraciner la chaire de Saint-Pierre et c’en est fait de l’Occident des chrétiens, quand un autre conquérant, le Mongol Tamerlan, célèbre par la pyramide de 90.000 crânes qu’il élève sur les ruines de Bagdad, arrive à fond de train des steppes de l’Asie, se rue sur Bajazet et l’emporte après avoir pilé, en un effroyable combat, ses hordes.
Et l’Europe, épouvantée, assiste à la rencontre de ces deux trombes qui se heurtent et éclatent en l’inondant d’une pluie de sang. L’on peut aisément s’imaginer la terreur des simples gens. Combien parmi ceux qu’épargnèrent les désastres de ces consternantes époques, vécurent, l’âme détraquée et le corps épuisé, par les famines et les paniques ? les danses macabres, les convulsions, les chorées rythmiques et une maladie que les anciens chroniqueurs désignent sous le nom de « la rage de tête » et qui paraît être la méningite, les rendent, lorsqu’elles ne les tuent pas, quasi fous. Avec cela, les vivres manquent et les épidémies sont à l’état endémique, dans les pays ; la peste noire parcourt l’Occident et nulle région n’est indemne ; elle infeste aussi bien l’Italie que la France, l’Angleterre que l’Allemagne, la Hollande que la Bohême et l’Espagne ; elle est le plus redoutable des fléaux de ces siècles, celui que les réservoirs infernaux du Levant versent sans relâche sur la pauvre Europe.
Bientôt, dans ces organismes débilités et dans ces âmes mal étanches que la peur démantèle, Satan s’immisce et l’immondice des sabbats, au fond des forêts, s’affirme. Les forfaits et les sacrilèges les plus exécrables se commettent ; les messes noires se célèbrent et la magie s’atteste. Gilles de Rais trucide de petits enfants et ses sorciers épluchent leurs entrailles, cherchent, dans ces tristes dépouilles, le secret de l’alchimie, le pouvoir de transmuter les métaux sans valeur en or. Le peuple gît effaré et par ce qu’il apprend et par ce qu’il voit ; il appelle une justice, il implore une consolation à tant de maux et tout se tait. Il se tourne vers l’Église et il ne la trouve plus. Sa foi vacille ; dans sa naïveté, il se dit que le Représentant du Christ sur la terre n’a plus rien de divin, puisqu’il ne peut le sauver. Il en vient à douter de la mission des successeurs de saint Pierre ; il n’arrive pas à les concevoir et si humains et si faibles, car il se rappelle ce spectacle déconcertant, l’empereur d’Allemagne Wenceslas, toujours ivre, venant rendre visite au roi de France Charles VI qui délire, pour déposer, à eux deux, un pape. Le Saint-Esprit jugé par un pochard et un dément !
Il n’est donc pas surprenant que, dans une telle débâcle, en sus même des pratiques de la goétie et des sabbats, les hérésies les plus véhémentes ne s’imposent ; elles pullulent d’un bout du monde à l’autre.
En Angleterre, Jean Wiclef, membre de l’université d’Oxford et curé de Lutterworth, nie la transsubstantiation, y substitue la doctrine de rémanence, autrement dit du pain et du vin demeurant, après qu’ils sont consacrés, intacts ; il attaque le culte des saints, rejette la confession, abolit le purgatoire, conspue le pouvoir admis des papes. Son enseignement, qui obtient un succès immense, réunit une foule de forcenés contre l’Église et c’est en vain que deux carmes, Étienne Patrington et Jean Kinningham, luttent, pied à pied, pour les repousser. Wiclef meurt, mais ses disciples, les Lollards, continuent de propager ses erreurs.
Elles pénètrent jusqu’en Bohême avec Jean Huss et Jérôme de Prague. Eux acceptent le dogme de l’Eucharistie, mais à la condition que le sacrement soit administré aux laïques sous les deux espèces ; ils déclarent cependant que les indulgences n’existent pas, que la papauté est une invention des hommes, que l’Église est la synagogue de Satan. Jean Huss fut, ainsi que son élève Jérôme de Prague, brûlé ; mais leurs partisans, dont les désordres du Saint-Siège augmentaient le nombre, incendièrent les chapelles et les cloîtres, égorgèrent les prêtres et les moines ; l’on tenta sans succès de les réduire ; ils se défendirent si bravement que le roi Sigismond finit par traiter avec eux pour terminer la lutte. Alors, ils se divisèrent en sectes de plusieurs sortes : en Thaborites, qui érigèrent la vengeance à l’état de vertu et exaltèrent le bienfait des meurtres ; en Orébites, plus féroces encore, qui dépecèrent les fidèles dans d’affreux tourments ; en Adamites, venus de la Picardie, qui se promenaient nus, pour imiter le premier homme, enfin en sectes moins fanatiques, plus sociables, en Calixtins, c’est-à-dire en fidèles auxquels on accorda de boire au calice, et en Frères bohêmes qui, après avoir nié la Présence réelle, se séparèrent complètement de l’Église.
En Italie, les partis dérivés des vieilles hérésies albigeoises foisonnent ; les restes de ces Fratricelles qui se développèrent si vigoureusement à la fin du XIIIe siècle, renouvellent les ignominies des Adamites et des Gnostiques ; tous prétendent avoir atteint le degré de l’impeccabilité et soutiennent que, dès lors, l’adultère et l’inceste leur sont acquis ; tous refusent de travailler pour être plus certains de demeurer pauvres. On eut beau les détruire par le feu, ils repoussèrent. Saint Jean de Capistran les assaillit sans relâche, mais ses efforts furent inutiles ; ils s’étendirent en Allemagne et la dépravèrent ; et au XVe siècle, on les découvre en Angleterre, mêlés aux Lollards, et se livrant à une propagande enragée, encore activée par les supplices.
Et tandis que les papes les frappent d’excommunications, des confréries de flagellants s’organisent en Allemagne, se répandent dans l’Alsace, dans la Lorraine, dans la Champagne, s’insinuent jusque dans le midi de la France, à Avignon, et ceux-là bannissent la vertu des sacrements, prônent le sang des coups de fouets comme matière valide du baptême, prêchent partout que le pouvoir du Vicaire du Christ, sur la terre, est nul.
Dans cette Flandre où naquit la série d’erreurs connue sous le nom de ce Gauthier Lollard qui les y sema, les extravagances se multiplient. Une béguine, Marguerite Porrette, revivifie, elle aussi, les abominations de la Gnose, en enseignant que la créature anéantie dans la contemplation de son Créateur, peut tout se permettre. Cette femme donnait des audiences, assise sur un trône d’argent et elle se prétendait escortée de deux séraphins, lorsqu’elle s’approchait de la Sainte Table. Elle finit par être grillée vive, à Paris, où elle était venue pour faire des prosélytes ; elle périt en 1310, c’est-à-dire bien des années avant la naissance de Lydwine, mais les disciples qu’elle avait dressés empoisonnaient, du temps de la sainte, le Brabant. Une autre possédée Blommardine ou Bloemardine, morte à Bruxelles en 1336, s’était mise à la tête de la secte et elle soulevait la Flandre du midi et du nord contre l’Église.
Ruysbroeck l’Admirable, l’ermite de la vallée verte, le plus grand des mystiques flamands, la combattit, mais le virus conservé de l’antique Gnose ne s’en infiltra pas moins dans la Belgique et les Pays-Bas. En 1410, alors qu’on le croyait usé, il se redéveloppe tout à coup et l’hérésie reparaît, colportée par des gens qui s’intitulent « hommes d’intelligence ». Un carme défroqué, Guillaume de Hildernissen et un laïque de Picardie, Aegydius Cantoris, la dirigent. Ils sont condamnés, abjurent leurs croyances, mais en 1428, l’on retrouve leurs erreurs plus vivaces que jamais ; elles serpentent en Allemagne et en Hollande, finissent par se fondre avec les débris toujours actifs des Fratricelles et des Lollards qui en viennent à proclamer le règne de Lucifer injustement chassé du Paradis et devant, lui et les siens, expulser à leur tour de l’Éden saint Michel et les anges.
Et rien ne put exterminer les racines de ces impiétés ; les dominicains et les franciscains succombèrent à cette tâche ; les disciples de Ruysbroeck, son fils spirituel Pomerius, Gérard Groot, Pierre de Hérenthals essayèrent de les extirper, mais les souches qu’ils arrachaient devenaient sataniquement fécondes, repoussaient ainsi que ces végétations fongueuses, que cette flore de teigne qui se ramifie dans les égouts, loin du jour.
En dehors même de ce culte, plus ou moins caché, du Démon, il faut encore signaler, dans les Pays-Bas, l’influence de doctrines qui furent pour ce pays ce que les erreurs de Wiclef et de Jean Huss furent pour l’Angleterre et la Bohême ; l’on voit poindre déjà les théories des partisans de la Réforme, avec Jean Pupper de Goch, fondateur d’un couvent de femmes à Malines, qui n’admet que l’autorité des Écritures, nie celle des conciles et des papes, hue le mérite des vœux et décrie les principes de la vie monastique ; — avec Jean Ruchrat de Wesel qui honnit les sacramentaux, contemne l’extrême-onction, répudie les commandements de l’Église ; — avec Jean Wessel, de Groningue, aux œuvres duquel, plus tard, Luther empruntera ses arguments pour contester la valeur des indulgences.
Et ce fut alors que l’Église était sapée par les hérésies, écartelée par de dangereux papes, alors que la chrétienté semblait perdue, que Dieu suscita des saintes pour enrayer la marche en avant du Malin et sauver le Saint-Siège.
Déjà, avant que le schisme d’Occident n’éclatât, Notre-Seigneur avait dispensé à deux d’entre elles la mission de prévenir ses Vicaires qu’ils eussent à abandonner Avignon et à réintégrer Rome.
Sainte Brigitte fut, en effet, dépêchée de Suède pour ramener le Souverain Pontife en Italie. Tandis qu’elle s’évertue à le convaincre, il décède ; un autre le remplace qu’elle investit, et il périt à son tour. Le troisième enfin, Urbain V l’écoute ; il rentre à Rome puis il se lasse de cette ville et retourne à Avignon où il trépasse. Brigitte objurgue son successeur, Grégoire XI, de fuir la France, mais pendant qu’il hésite, elle-même disparaît et ce n’est que, sur les instances d’une autre sainte, Catherine de Sienne, qu’il se détermine à franchir les Alpes.
Sainte Catherine poursuit l’œuvre de sainte Brigitte et s’entremet pour réconcilier le pape avec l’Église, mais Grégoire XI meurt.
Et le schisme se déclare avec les deux papes élus, l’un à Avignon et l’autre à Rome ; la pauvre sainte essaie vainement de conjurer le mal et Dieu la rappelle à Lui, en 1380 et elle quitte ce monde, désolée de cet avenir d’ouragans qui se prépare.
Aussitôt Dieu ordonne dans une vision à une pieuse fille, Ursule de Parme, de se rendre à Avignon, auprès de Clément VII et de l’inviter à abdiquer ; elle part et ce pape, ébranlé par ses sommations, va céder, mais les cardinaux qui l’ont élu s’y opposent ; ils emprisonnent Ursule comme sorcière et elle n’est préservée que par un tremblement de terre qui disperse ses bourreaux, au moment où ils allaient lui appliquer la torture. Dieu la tire du mauvais pas où elle s’est engagée, mais son entreprise échoue. En attendant que d’autres déicoles la suppléent dans cette mission d’aventurière divine et que les saintes qui se préparent soient assez âgées pour prendre la succession de Catherine de Sienne, une tertiaire de saint François, la bienheureuse Jeanne de Maillé, qui a déjà tenté de libérer la France, en parlant, au nom du Seigneur, à la reine Ysabeau et au roi Charles VI, assiège, à son tour, le ciel de suppliques, fait procéder, sous forme de suffrages, à des prières publiques, organise des processions dans les collégiales et les cloîtres pour refréner la décomposition qui s’accélère des papautés aux prises.
Elle remplit, en quelque sorte, un intérim, car elle ne s’immisce pas directement dans le conflit ; elle semble vouée plus particulièrement, d’ailleurs, aux œuvres de miséricorde, aux soins des pestiférés et des lépreux et aux visites des captifs ; la véritable succession de Catherine, elle échoit, le temps venu, à trois saintes : sainte Lydwine de Schiedam, sainte Colette de Corbie et sainte Françoise de Rome, une Hollandaise, une Française et une Italienne.
Sainte Lydwine et sainte Colette naissent en 1380, c’est-à-dire l’année même où sainte Catherine de Sienne s’inanime ; et toutes deux s’efforcent de sauver l’Église, en souffrant mort et passion pour elle ; l’une active, l’autre passive.
Avec des existences absolument différentes, elles présentent cependant des ressemblances ; toutes deux nées de parents pauvres, de jolies deviennent, selon leur désir, laides ; toutes deux endurent sans répit d’épouvantables douleurs ; toutes deux portent les stigmates du Calvaire ; toutes deux, lorsqu’elles meurent, recouvrent la beauté de leur jeunesse et leurs cadavres embaument. Durant leur vie, elles furent dévorées d’une pareille soif de tortures ; seulement Colette reste, malgré tout, valide, car il lui faut parcourir la France, d’un bout à l’autre, tandis que Lydwine voyage, immobile, dans l’au delà, sur un lit ; et chacune d’elles décèle encore cette similitude, qu’elle est une sauvegarde pour sa patrie.
Sainte Colette est, en somme, adjointe à Jeanne d’Arc pour chasser les Anglais ; elle l’aide avec le renfort surhumain de ses larmes. Pendant que Jeanne se charge de la partie matérielle, qu’elle combat à la tête des troupes, Colette commande à la partie spirituelle ; elle réforme les monastères des clarisses, en fait des remparts de mortifications et de prières, jette dans la mêlée les pénitences de ses filles, se pend aux jupes de la Vierge jusqu’à ce qu’elle ait obtenu la défaite des Bedford et des Talbot et le renvoi de l’ennemi dans son île.
De son côté, Lydwine, par la puissance de ses exorations et de ses tourments, protège la Hollande envahie par les routiers de Bourgogne et empêche une flotte d’attaquer Schiedam.
Comme sainte Brigitte et sainte Catherine de Sienne, Colette est appelée à batailler, en personne, par les voies visibles, contre le schisme ; elle intervient avec saint Vincent Ferrier au concile de Constance, et elle essaie encore, quelques années après, d’empêcher, par ses démarches et ses conseils, le concile de Pise de substituer à un pape réel, un intrus. Lydwine ne prit, humainement parlant, aucune part aux tribulations de cette sœur inconnue qui luttait si ardemment contre des cardinaux égarés et de faux papes ; elle n’aurait dû connaître, au fond de son village de la Hollande, les détresses de l’église que par ce que ses confesseurs en surent, mais elle eut certainement des révélations du Sauveur ; en tout cas, l’amas de ses souffrances fut un trésor de guerre où, bien qu’ignorant sans doute qui l’avait rassemblé, Colette puisa, de concert avec sainte Françoise Romaine.
Celle-là fut plus spécialement choisie pour l’assister dans la partie de sa tâche inhérente au schisme.
Plus jeune de quatre ans que Colette et que Lydwine, Françoise était issue d’une famille illustre de Rome et elle s’allia à un seigneur qui comptait parmi ses ancêtres un pape et un saint. Elle différait donc, par son origine, par sa situation de fortune, par sa condition de femme mariée, des deux vierges, ses sœurs ; mais si elle s’écarte d’elles par certains points, elle s’en rapproche par d’autres ou plutôt, elle tient des deux, empruntant à chacune un trait particulier, devenant une succédanée tantôt de sainte Colette et tantôt de sainte Lydwine.
Elle s’assimile à la vierge de Corbie, par son existence active, par sa vocation de manieuse d’âme et de fondatrice d’ordre, par le rôle qu’elle assume dans la politique de son temps, par les combats qu’elle livre au démon qui la roue, elle aussi, de coups ; — à la vierge de Schiedam, par sa guérison miraculeuse de la peste, par son contact perpétuel avec les anges, par ses voyages dans le Purgatoire, en quête d’âmes à délivrer, par sa mission très spéciale d’être une réparatrice des crimes du siècle, une figure victimale de l’Église souffrante.
Par des voies opposées et souvent pareilles, ces trois femmes qui furent, toutes les trois, des stigmatisées, se sont donc mesuré contre les influences infernales de leur époque ; quelle tâche fut plus accablante ! Jamais, en effet, l’équilibre du monde ne fut plus près de se rompre ; et il semble aussi que jamais Dieu ne fut plus attentif à surveiller la balance des vertus et des vices, et à entasser, quand le plateau des iniquités descendait, comme contre-poids, des tortures de saintes !
Cette loi d’un équilibre à garder entre le Bien et le Mal, elle est singulièrement mystérieuse, quand on y songe ; car, en l’établissant, le Tout-Puissant paraît avoir voulu fixer lui-même des bornes et mettre des freins à sa Toute-Puissance. Pour que cette règle s’observe, il faut, en effet, que Jésus fasse appel au concours de l’homme et que celui-ci ne se refuse pas à le prêter. Afin de réparer les forfaits des uns, il réclame les mortifications et les prières des autres ; et c’est là qu’est vraiment la gloire de la pauvre humanité ; jamais Dieu, si respectueux de la liberté de ses enfants que l’on peut compter ceux qu’il priva du pouvoir de Lui résister, jamais Dieu ne fut leurré. Toujours il a trouvé, à travers les âges, des saints qui ont consenti à payer, par des douleurs, la rançon des péchés et des fautes.
Et cette générosité s’explique maintenant pour nous, à peine. En sus de notre nature même qui répugne à la souffrance, il y a encore le Maudit qui intervient pour la détourner du sacrifice, le Maudit auquel son Maître a concédé, dans la triste partie qui se joue, ici-bas, les deux plus formidables atouts, l’argent et la chair. Et ce qu’il abuse, celui-là, de la lâcheté de l’homme qui sait bien pourtant que la grâce du Sauveur suffirait à lui assurer la victoire, s’il essayait seulement de se défendre ! Ne dirait-on pas vraiment qu’après le renvoi d’Adam du Paradis, le Seigneur, sollicité par l’ange rebelle, lui a dédaigneusement accordé les moyens qu’il jugeait les plus sûrs pour vaincre les âmes et que la scène de l’Ancien Testament, de Satan réclamant à Dieu et obtenant de Lui la permission de tâcher de faire succomber, à coups d’épreuves, le malheureux Job, a pu se passer d’abord à la sortie de l’Éden ?
Et, depuis ce temps, le fléau de la balance oscille ; quand il incline trop du côté du Mal, quand les peuples deviennent trop ignobles et les rois trop impies, Dieu laisse se déchaîner les épidémies, les tremblements de terre, les disettes, les guerres ; mais sa miséricorde est telle qu’il active alors le dévouement de ses saints, les assiste, renchérit sur leurs mérites, triche peut-être un peu avec Lui-même, pour que sa justice s’apaise et que l’équilibre se rétablisse.
L’univers serait, sans cela, et depuis quand ! en ruines ; seulement, étant donné les ressources dont le Très-Bas dispose et la faiblesse des âmes qu’il assiège, l’on comprend la sollicitude toujours en éveil de l’Église chargée de dégrever, autant qu’elle le peut, le plateau des péchés, de neutraliser le lest des offenses, en ajoutant sans cesse sur l’autre plateau de nouveaux poids d’oraisons et de pénitences ; l’on s’explique la raison d’être des redoutes de suppliques et des citadelles d’offices que, sur les ordres de l’Époux, elle érige, le bien-fondé de ses cloîtres impitoyables, de ses ordres durs, tels que ceux des Clarisses, des Calvairiennes, des Carmélites, des Trappes, et l’on peut concevoir aussi la somme inouïe de souffrances endurées par les saints, les maladies, les chagrins même que le Très-Haut distribue à chacun de nous pour nous assainir et nous faire participer un peu à cette œuvre de compensation qui suit, pas à pas, l’œuvre du Mal.
Or, la dissolution de la société, à la fin du XIVe et au commencement du XVe siècle fut, nous l’avons dit, effroyable.
Le XIIIe siècle qui, malgré ses conflits et ses tares, nous apparaît, dans le recul des âges, si candide avec saint Louis et Blanche de Castille, si chevaleresque et si pieux avec ses fidèles quittant leurs femmes, leurs enfants, tout, pour arracher le sépulcre du Christ des mains des mécréants ; ce siècle qui connut le pape Innocent III, qui vit saint François d’Assise, saint Dominique, saint Thomas d’Aquin, saint Bonaventure, sainte Gertrude et sainte Claire, le siècle des grandes cathédrales, était bien mort ; la foi s’affaiblissait ; elle allait se traîner pendant deux siècles, pour finir par choir dans ce cloaque déterré du Paganisme que fut la Renaissance.
En résumé, si nous jetons un coup d’œil sur l’état de l’Europe, au temps de sainte Lydwine, nous n’apercevons que des guets-apens de seigneurs cherchant à s’entredévorer, que des guerres de peuples rendus par la misère féroces et par la peur, fous. Les souverains sont des scélérats ou des déments, comme Charles VI, comme Pierre le Cruel, comme Pierre le Cérémonieux, comme Wilhelm V de Hollande, des toquées comme Jacqueline ; d’autres sont des ivrognes luxurieux comme l’empereur d’Allemagne Wenceslas, de pharisaïques gredins comme le roi d’Angleterre ; quant aux anti-papes, ils crucifient le Saint-Esprit, et lorsqu’on les regarde, c’est l’épouvante !
Si c’était seulement tout ! mais il sied de l’avouer encore, pour excéder la patience de Dieu, ceux qui lui furent consacrés, s’en mêlèrent. Le schisme, soufflant en tempête, avait démâté les barques de sauvetage et les bateliers de Jésus étaient devenus de vrais démons. Il n’y a qu’à lire les sermons de saint Vincent Ferrier, leur reprochant leurs turpitudes, les invectives de sainte Catherine de Sienne les accusant d’être cupides et orgueilleux, d’être impurs, leur criant qu’ils vendent à l’encan les grâces du Paraclet, pour se figurer le poids énorme qu’ils ajoutèrent à la balance de Justice, sur le plateau du Mal.
Devant une pareille somme de sacrilèges et de crimes, devant une pareille invasion des cohortes de l’Enfer, il semble probable que, malgré tout leur dévouement et leur bravoure, sainte Lydwine, sainte Colette, sainte Françoise Romaine, eussent succombé sous le nombre, si Dieu n’avait levé des armées pour les secourir.
Ces armées, il est bien possible que jamais elles ne les connurent, pas plus, du reste, qu’elles ne se connurent entre elles, car le Tout-Puissant est le seul maître en cette stratégie et seul, il voit l’ensemble ; les saints sont entre ses mains, ainsi que des pions qu’il place sur l’échiquier du monde, à sa guise ; eux s’abandonnent simplement, corps et âme, à Celui qui les dirige ; ils font sa volonté et ne demandent pas à en savoir plus.
Aussi, n’est-ce que bien longtemps après, lorsqu’on examine les ressources dont le Seigneur disposait et les divers éléments dont il se servit, que l’on parvient à vaguement entrevoir la tactique dont il usa pour vaincre, à telle ou telle époque, les hordes séduites par les mauvais anges.
A cette fin du XIVe siècle, nous ne pouvons que difficilement établir le dénombrement de ces milices qui s’armèrent, sous les ordres du Christ, pour assister Lydwine et les deux autres saintes. Quelques-unes nous sont connues, d’autres resteront probablement à jamais ignorées ; d’autres encore paraissent avoir été plus spécialement occupées à opérer des diversions sur le champ de bataille de l’au-delà.
Sans crainte de se leurrer cependant, l’on peut signaler les troupes engagées en première ligne et s’avançant, sous l’abri de prières des redoutes contemplatives, des forteresses mystiques défendues, en France, par les clarisses de sainte Colette ; en Italie, par les clarisses de sainte Catherine de Bologne et les tertiaires franciscaines cloîtrées de la bienheureuse Angéline de Marsciano ; par les dominicaines réformées, avec l’aide de Marie Mancini de Pise, par la bienheureuse Claire de Gambacorta ; par les tertiaires de saint Dominique qui adoptèrent la clôture, sous l’autorité de Marguerite de Savoie ; par les cisterciennes qu’avait ramenées à leurs strictes observances le pape Benoît XII ; par les sœurs chartreuses qu’exaltait encore le souvenir de sainte Roseline.
Ces troupes d’avant-garde étaient formées par les bataillons des franciscains et des frères-prêcheurs ; — les premiers marchant sous les ordres de saint Bernardin de Sienne qui naquit la même année que Lydwine et remplit une mission analogue à celle de sainte Colette, en redressant les règles fléchies de saint François ; de son disciple saint Jean de Capistran qui le soutient dans cette tâche et combat, plus spécialement, ainsi que le bienheureux Thomas Bellacio de Linaris, les hérésies des Fratricelles et des Hussites ; de saint Jacques de la Marche qui lui est adjoint pour prêcher contre les infidèles ; de saint Mathieu d’Agrigente qui restaure les us réguliers dans les maisons de l’Espagne ; du bienheureux Albert de Sartéano qui fut plus particulièrement chargé de guerroyer contre les schismes ; — les seconds, conduits par saint Vincent Ferrier, le thaumaturge, qui évangélisa surtout les mécréants ; par saint Antoine de Florence qui lutta contre les œuvres de magie ; par le bienheureux Marcolin dont les genoux, à force de traîner sur le sol, étaient devenus ainsi que les bosses rugueuses des vieux arbres ; par le bienheureux Raymond de Capoue, le confesseur de sainte Catherine de Sienne, qui, avec Jean Dominici et Laurent de Ripafratta, stimula la piété ralentie et renoua les coutumes déliées de l’ordre ; par le bienheureux Alvarez de Cordoue qui travailla à l’extinction du schisme et convertit, de même que saint Vincent Ferrier, les idolâtres.
Et ces colonnes, destinées, par la nature même de leur vocation, aux labeurs de l’apostolat, habituées au métier d’éclaireurs, aux rencontres d’avant-poste, s’étendaient en un interminable front de bataille, en tête de l’immense armée du Seigneur dont les deux ailes s’éployaient : — l’une composée par les régiments drus des carmes, commandés par leur prieur général Jean Soreth qui ranima la ferveur déchue des siens et créa l’institut des carmélites ; par saint Antoine d’Offen et le bienheureux Stanislas de Pologne qui périrent martyrisés, l’un et l’autre pour la cause du Christ ; par Jean Arundine, prieur de la maison de Bruges ; Ange de Mezzinghi qui contribua à implanter la réforme de la règle en Toscane ; par Bradley, promu évêque de Dromory, en Irlande, et dont les austérités furent célèbres ; — l’autre, par les masses compactes des augustins, scindés en de multiples observances, et ralliés et réformés, eux aussi, en Italie, par Ptolomée de Venise, Simon de Crémone, Augustin de Rome ; en Espagne, par Jean d’Alarcon qui introduisit les couvents de la stricte obédience, dans la vieille Castille ; les augustines dont le tiers ordre venait de pousser une fleur de Passion, la bienheureuse Catherine Visconti.
Et ces masses, fraîchement exercées, encadraient les détachements plus faibles et insuffisamment armés, des camaldules qui, dans le désordre de leurs rangs, comptaient pourtant un savant religieux Ambroise Traversari et deux saints : Jérôme de Bohême, l’apôtre de la Lithuanie, et l’oblat Daniel ; — des birgittins et des birgittines à peine nés à la vie religieuse et mal préparés au service de campagne ; — des servites dont la discipline fut alors resserrée par Antoine de Sienne et dont le porte-oriflamme était une tertiaire, la bienheureuse Élisabeth Picenardi ; — des prémontrés dont les circaries étaient, ainsi que les couvents de Fontevrault que Marie de Bretagne allait bientôt remanier, si relâchés, que leurs effectifs de secours furent quasi nuls.
Enfin, entre ces deux ailes, derrière la ligne avancée des enfants de saint-François et de saint-Dominique, évoluait la partie résistante, le gros de l’armée, le centre dense et massif de l’ordre le plus touffu du Moyen Age, de l’ordre de saint-Benoît, avec ses grandes divisions : — les bénédictins, proprement dits, dirigés, en Allemagne, par l’abbé de Castels, Othon, qui reprend la partie intégrale de la règle et l’abbé Jean de Meden qui convertit les mœurs dissolues de cent quarante-sept abbayes ; en Italie, par Louis Barbo, abbé de sainte-Justine de Padoue, qui réassujettit aux lois sévères de son cloître de nombreux monastères, parmi lesquels celui du Mont-Cassin, le berceau de l’ordre ; en France, par l’abbé de Cluny, Odon de la Perière, le cellerier Étienne Bernadotte, le prieur Dom Toussaint, un neveu de sainte Colette, qui fut, à cause de ses vertus, comparé à Pierre le Vénérable ; par Guillaume d’Auvergne, cité dans les chroniques comme ayant été un véritable saint ; par le bienheureux Jean de Gand, prieur de saint-Claude, qui s’interpose entre le roi d’Angleterre et le roi de France, pour tâcher de les résoudre à conclure la paix ; — les cisterciens, par le bienheureux Eustache, le premier abbé du Jardinet, par les vénérables Martin de Vargas et Martin de Logroño qui réorganisent les dépôts bernardins de l’Espagne ; — les célestins qui délèguent un de leurs plus saints moines, Jean Bassand, pour être le confesseur de sainte Colette, mais dont les escouades nombreuses et très famées en France, n’en sont pas moins mal entraînées et peu solides ; — les olivétains mieux aguerris et menés à l’assaut par le vénérable Hippolyte de Milan, abbé du Mont-Olivet, par le frère Laurent Sernicolaï de Pérouse, le convers Jérôme de Corse qui mourut en odeur de sainteté, au couvent de San Miniato, à Florence, par le vénérable Jérôme Mirabelli de Naples, par le bienheureux Bernard de Verceil qui fonda deux couvents de l’observance, en Hongrie ; — les humiliés, dans les cloîtres desquels figure une oblate, la bienheureuse Aldobrandesca, illustre par ses miracles, à Sienne.
L’on peut compter encore, dans le contingent de cette armée, une légion d’élite, celle des recluses, de ces femmes qui vécurent la vie érémitique, telle que sainte Colette la pratiqua, elle-même, pendant quatre années, à Corbie, des femmes anachorètes, enfouies dans les solitudes de l’Occident ou volontairement emmurées dans les villes et auxquelles l’on passait, par une lucarne, un peu de pain et une cruche d’eau. Ces noms de quelques-unes de ces célestes sauvages nous sont connus, ceux d’Aliz de Bourgotte, internée dans une celle à Paris ; de la bienheureuse Agnès de Moncada qui, à la voix de saint Vincent Ferrier, s’en fut, ainsi que Madeleine, pleurer les péchés du monde dans une grotte ; de la bienheureuse Dorothée, la patronne de la Prusse, qui se séquestra près de l’église de Quidzini, en Pologne ; de la bienheureuse Julie Della Rena qui s’incarcéra à Certaldo, en Toscane ; de Perrone Hergolds, une stigmatisée, tertiaire de saint François, qui se retira dans un ermitage des Flandres ; de Jeanne Bourdine claquemurée à La Rochelle ; de Catherine Van Borsbecke, une carmélite qui s’écroua dans une sorte de laure contiguë à un sanctuaire près de Louvain ; d’une autre fille du carmel, appelée Agnès, que l’on retrouva, quelques années après la mort de Lydwine, encore enfermée dans un réduit situé près de la chapelle des carmes, à Liège.
Enfin, la fleur des servantes de Jésus, la garde d’honneur du Christ des rangs de laquelle sont sorties — il faut le remarquer — sainte Catherine de Sienne, sainte Lydwine, sainte Colette, sainte Françoise Romaine, la bienheureuse Jeanne de Maillé — les victimes plus particulièrement chères à Dieu, les effigies vivantes de sa Passion, ses vexillaires, les stigmatisées !
En Allemagne, c’est une tertiaire franciscaine la bienheureuse Élisabeth la bonne de Waldsee, et la Clarisse Madeleine Beüttler ; en Italie, c’est une tertiaire de saint François, Lucie de Norcie, une Clarisse Marie de Massa, une veuve, la bienheureuse Julienne de Bologne, une augustine sainte Rite de Cassie ; c’est l’extatique Christine dont le nom nous est conservé, mais sans renseignements, par Denys le chartreux : en Hollande, c’est la dominicaine Brigide et la béguine Gertrude d’Oosten ; et combien perdues dans d’anciennes annales, tombées dans un complet oubli !
A ces troupes actives, l’on peut annexer encore des soldats qui ne furent incorporés dans aucun régiment et firent la guerre de partisans, seuls, de leur côté, tels que le bienheureux Pierre, évêque de Metz et cardinal de Luxembourg, tels que saint Laurent Justinien, évêque de Venise, qui s’infligèrent d’incomparables macérations pour expier les péchés de leur temps ; tels que saint Jean de Kenty, l’apôtre de la charité, en Pologne, saint Jean Népomucène, le martyr de la Bohême, tels que la bienheureuse Marguerite de Bavière, une amie de sainte Colette, et le corps de réserve recruté parmi les volontaires laïques ou prêtres, religieuses ou moines que les razzias diaboliques n’emportèrent point.
Ainsi se peut résumer le bilan de l’armée qui entre en campagne, à la fin du XIVe siècle et au commencement du XVe, sous les bannières du Christ.
Au premier abord, elle semble imposante et décidée, mais quand on l’examine de près l’on s’aperçoit que si les chefs qui la dirigèrent, selon le plan de Jésus, furent admirables, les troupes placées sous leur commandement manquèrent de cohésion, furent irrésolues et débiles ; le gros du contingent était, en effet, fourni par les corps des monastères d’hommes et de femmes et, nous venons de le voir, les désordres et les brigues perturbaient les cloîtres ; les règles agonisaient et la plupart des statuts étaient morts ; les phalanges monastiques étaient par conséquent sans endurance de piété et à peine exercées aux marches de la voie mystique. Il fallut donc, avant tout, refaire les cadres, ramener les religieux et les nonnes au maniement oublié de leurs armes, les équiper à nouveau d’offices, leur réenseigner la pratique des mortifications, leur réapprendre la manœuvre délaissée des coulpes.
Seuls, les chartreux faisaient, dans ce relâchement général, exception. Ils s’étaient divisés en deux camps, au moment du schisme, mais la discipline n’en était pas moins demeurée, dans leurs rangs, intacte. Ils avaient, parmi eux, d’habiles stratégistes et de puissants saints : Denys de Ryckel, dit le chartreux, l’un des plus grands mystiques de l’époque ; Henri de Calcar, le prieur de la chartreuse de « Bethléem Maria », à Ruremonde, le maître de Gérard Groot, l’un des écrivains auquel l’on a parfois attribué la paternité de l’Imitation de Jésus-Christ ; Étienne Maconi, le disciple bien-aimé de sainte Catherine de Sienne ; le bienheureux Nicolas Ribergati, devenu cardinal après avoir été prieur de l’ascétère de Florence ; Adolphe d’Essen, l’apôtre du rosaire, qui fut directeur de la bienheureuse Marguerite de Bavière ; d’autres encore.
Les compagnies Cartusiennes formèrent un noyau de vieux soldats bronzés au feu des batailles infernales et elles servirent d’arrière-garde, abritèrent, avec les remparts de leurs prières, le train de l’armée, couvrirent les garnisons des pupilles, des jeunes recrues qui venaient d’être rassemblées, leur donnant ainsi le temps de se fortifier et de se préparer à la lutte ; parmi ces conscrits qui composèrent des bataillons de renfort, il faut noter la poignée d’oblates de saint-Benoît fondées par sainte Françoise Romaine, et surtout le groupe des nouvelles carmélites dressées au service des places mystiques, par des saintes telles que sainte Angèle de Bohême qui se clôtura dans le monastère de Prague, la vénérable Agnès Correyts, la fondatrice du carmel de Sion, à Bruges ; la vénérable Jeanne de l’Erneur qui créa le monastère de notre-Dame de la Consolation à Vilvorde et fut une des premières filles spirituelles de Jean Soreth ; par la bienheureuse Jeanne Scopelli, supérieure du monastère de Reggio ; par la bienheureuse Archangèle Girlani, prieure de la maison de Mantoue, dont le cadavre incorruptible eut la spécialité de guérir, par son attouchement, les femmes atteintes de chancres à la figure et à la gorge.
Lydwine, elle, ne leva aucune armée, ne fit partie d’aucun corps et elle n’amena à la rescousse des mécréants l’appoint d’aucun cloître ; elle combattit, solitaire, en enfant perdue, sur un lit ; mais le poids des assauts qu’elle supporta fut le plus énorme dont on ait jamais ouï parler ; elle valut une armée à elle seule, une armée qui devait faire face à l’ennemi sur tous les points.
Elle expia, de même que les autres saints de son siècle, pour les âmes du Purgatoire, pour les abominations du schisme, pour les ribotes des clercs et des moines, pour les scélératesses des peuples et des rois ; mais en outre de cette obligation qu’elle accepta de réparer les fautes commises d’un bout de l’univers à l’autre, elle eut encore la charge d’être le bouc émissaire de son pays.
Ainsi que l’observent ses biographes, toutes les fois que Dieu voulait châtier la Hollande, c’était à elle qu’il s’adressait ; c’était elle qui recevait les premiers coups.
Fut-elle la seule, dans la région batave, à supporter la responsabilité des méfaits punis ? ne fut-elle pas aidée dans cette mission spéciale aux Pays-Bas comme elle le fut dans sa mission d’expiatrice du monde, par d’autres saints ? cela semble à peu près sûr.
Les stigmatisées que nous avons nommées, Gertrude d’Oosten et Brigide, n’existaient déjà plus lorsqu’elle commença, par procuration, de souffrir, car l’une était morte en 1358 et l’autre en 1390 ; elles n’intervinrent donc pas dans l’œuvre propitiatoire qu’elle entreprit ; elles la commencèrent, sans savoir qui la finirait et Lydwine fut simplement instituée la légataire plaintive de leurs biens. Elle prit leur succession comme elle avait déjà pris celle d’une sainte qui vécut au siècle précédent, d’une compensatrice dont l’existence présente de singulières analogies avec la sienne, sainte Fine de Toscane ; celle-là passa, en effet, sa vie sur un lit et fut couverte d’ulcères dont le pus exhalait de frais parfums.
Il est impossible d’énumérer les personnes dont les mérites allégèrent, dans la Hollande même, la tâche de Lydwine ; tout ce que nous savons, mais cela nous le savons d’une façon sûre, par les chroniques des monastères de Windesem et du mont sainte-Agnès, c’est que Dieu fit croître à cette époque, dans les provinces septentrionales de la Néerlande, d’admirables semailles mystiques.
Il y eut alors une école d’ascèse pratique, issue des enseignements de Ruysbroeck et elle s’épanouit dans la région de l’Over-Yssel et plus particulièrement à Deventer.
Un homme originaire de cette ville et qui, après avoir été converti par le prieur de la chartreuse de Monnikhuisen, près d’Arnhem, devint, par sa sanctimonie et par sa science, fameux, Gérard Groot ou le Grand, le traducteur de Ruysbroeck, prêchait en ce temps à Campen, à Zwolle, à Amsterdam, à Leyde, à Zuphten, à Utrecht, à Gouda, à Harlem, à Delft et son éloquence embrasait les masses ; les églises ne pouvaient contenir les foules qu’il entraînait et il les haranguait, en plein vent, dans les cimetières ; il opérait d’innombrables conversions et peuplait, avec ses recrues, les abbayes. Il finit par fonder, avec son élève Florent Radewyns, vicaire à Deventer, un institut « de frères et de sœurs de la vie commune » qui poussa rapidement ses racines dans les Pays-Bas et la Germanie. Cet ordre que l’on pourrait qualifier d’un nom qu’il ne porta jamais « les oblats de saint Augustin » fut un véritable centre d’études et de prières. Les hommes habitaient dans la maison de Radewyns et s’occupaient à transcrire les anciens manuscrits de la Bible et des Pères, et les femmes, des sortes de béguines, résidaient chez Gérard et s’adonnaient, en dehors des heures d’oraisons, à des travaux d’aiguille.
Gérard mourut en 1384, à l’âge de quarante-quatre ans, en soignant les pestiférés de Deventer et, après sa mort, fidèles à ses recommandations, Florent Radewyns et les autres frères érigèrent, sous la règle de saint Augustin, un monastère à Windesem ; et ce lieu, qui n’était alors qu’une saulaie, donna naissance en Hollande à quatre-vingt-quatre couvents d’hommes et treize couvents de femmes.
Ces congrégations de « la vie commune » furent, avec les cisterciens et les chartreux qui étaient, les seuls, à observer leurs constitutions primitives dans les Pays-Bas, de véritables réservoirs de suffrages et de pénitences et elles désarmèrent souvent le Seigneur que devait singulièrement irriter la dissolution des autres ordres, car si nous en croyons Ruysbroeck, Denys le chartreux et Pierre de Hérenthals, le dérèglement des moines dans les Provinces-Unies et les Flandres fut affreux.
Il est certain, en tout cas, que l’école mystique de Deventer étaya de ses prières l’œuvre de Lydwine qu’elle connut et aima, car deux des augustins qui en firent partie, Thomas A Kempis, et Gerlac, ont, chacun, écrit une biographie de la sainte.
Et ils nous apprennent qu’elle ne se contenta même pas de se substituer, pour en subir le châtiment, aux crimes de l’univers et à ceux de sa propre ville ; elle consentit encore à prendre à son compte les péchés des gens qu’elle connaissait et les maladies corporelles qu’ils ne pouvaient supporter sans accabler le ciel de reproches et de plaintes.
Cette vorace de l’immolation, elle s’empara de tout ; elle fut en même temps et à la fois l’infatigable danaïde de la souffrance et le vase de douleurs qu’elle s’efforçait elle-même de remplir, sans pouvoir en atteindre le fond ; elle fut la bonne fermière de Jésus, celle qui éprouva les tourments de sa Passion et la charitable suppléante qui voulut, pendant trente-huit ans, acquitter, par la largesse de ses maux, le loyer de santé et les dettes d’insouciance que les autres ne songeaient guère à payer.
Elle fut, en un mot, une victime générale et spéciale.
Cette existence d’expiation, elle serait incompréhensible si l’on n’en avait tout d’abord indiqué les causes et montré le nombre et la nature des offenses dont la réparation fut, en quelque sorte, ici-bas, sa raison d’être.
Ce résumé de l’histoire de l’Europe, à la fin du XIVe et au commencement du XVe siècle, explique le pourquoi de cette exubérance de tortures qui fut, dans les annales des saints, unique. Elles surpassent, en effet, par leur durée, celles des autres élus auxquels fut accordé, avec un supplice souvent assez court, la gloire plus retentissante du martyre.
Lydwine naquit, en Hollande, à Schiedam, près de la Haye, le lendemain de la fête de sainte Gertrude, le dimanche des Rameaux de l’an du Seigneur 1380.
Son père, Pierre, occupait l’emploi de veilleur de nuit de la ville et sa mère Pétronille était originaire de Ketel, un village voisin de Schiedam. Ils étaient issus, l’un et l’autre, paraît-il, de familles qui, après avoir connu une certaine aisance, étaient devenues pauvres. Ces ancêtres de Pierre qui auraient appartenu à la noblesse, étaient de valeureux capitaines, dit A Kempis. Nous ne possédons aucun autre renseignement précis sur leurs lignées ; les historiens de la sainte nous entretiennent seulement du père de Pierre, c’est-à-dire du grand-père de Lydwine, Joannes, qu’ils nous présentent tel qu’un pieux homme, priant nuits et jours, ne mangeant de la viande que le dimanche, jeûnant deux fois par semaine et se contentant, le samedi, d’un peu de pain et d’eau. Il perdit sa femme à l’âge de quarante ans et fut opiniâtrement assailli par le Démon. Sa chaumine subit les phénomènes des maisons hantées ; le Diable la secouait du haut en bas, chassait les domestiques, brisait la vaisselle sans cependant, spécifie assez bizarrement Gerlac, que le beurre contenu dans les pots qui se cassaient, se répandît.
Quant à son fils Pierre il eut de sa femme Pétronille neuf enfants, une fille Lydwine qui fut la quatrième par rang d’âge et huit garçons dont deux nous sont signalés par les biographes, l’un par son nom de Baudouin simplement ; l’autre Wilhelm qui apparaît, à plusieurs reprises, dans l’histoire de sa sœur. Il se maria et eut une fille qui porta le nom de son aïeule Pétronille et un garçon qui s’appela comme son oncle Baudouin.
Si nous citons encore un cousin Nicolas, dont on aperçoit deux fois, le profil, à la cantonade dans ce récit et un autre parent, Gerlac l’écrivain, qui, tout en étant moine, demeura longtemps, sans qu’on sache pourquoi, dans la maison de la sainte, nous aurons donné, je pense, tout ce que les anciens textes nous apprennent sur cette famille.
Le jour où naquit Lydwine, sa mère qui ne se croyait pas sur le point d’enfanter se rendit à la grand’messe ; mais les douleurs la saisirent et elle dut rentrer précipitamment à la maison ; elle y accoucha, au moment même où, en cette fête des Palmes, l’on chantait à l’église la Passion de Notre-Seigneur, selon saint Mathieu. Sa délivrance fut indolore et facile alors que ses précédentes gésines avaient été si laborieuses, qu’elle avait failli y succomber.
L’enfant reçut sur les fonts baptismaux le nom de Lydwine, ou Lydwyd, ou Lydwich, ou Liedwich, ou Lidie, ou Liduvine, nom qui, sous ces orthographes et ces résonnances différentes, dériverait du mot flamand « lyden » souffrir, ou signifierait, d’après Brugman, en langue germanique « grande patience ».
Les biographes observent, à ce sujet, que cette appellation et que le moment même de la fête où la petite vint au monde, furent prophétiques.
Si nous exceptons une maladie dont nous aurons à parler, nous n’avons sur son bas âge aucun détail qui mérite d’être noté. Gerlac, Brugman, A Kempis jettent entre ces premières années et celles qui leur succédèrent d’édifiants ponts-neufs au bout desquels ils remarquent la dévotion de l’enfant pour la Vierge de Schiedam, représentée par une statue dont voici l’histoire :
Un peu avant la naissance de Lydwine, un sculpteur, selon Gerlac et A Kempis, un marchand, suivant Brugman, vint à Schiedam ; il était possesseur d’une vierge de bois qu’il avait sculptée lui-même, ou achetée à un imagier et il se proposait d’aller la vendre à la foire qui se tenait, aux environs de l’Assomption, à Anvers ; cette statue était assez légère pour qu’un homme pût aisément la manier ; cependant, lorsqu’il l’eut déposée dans le navire qui devait faire le trajet entre les deux villes, elle devint subitement si lourde qu’il fut impossible au bateau de démarrer. Plus de vingt marins réunirent leurs efforts pour le tirer du rivage ; le peuple qui assistait à ce spectacle, sur le quai, se moquait de leur impuissance et ne leur ménageait point les quolibets. Piqués au vif, ils s’épuisèrent, puis finirent, n’ayant jamais éprouvé une telle malencontre, par se demander si cette effigie de Madone n’en était pas la cause. Ils voulurent, en tout cas, en avoir le cœur net et le marchand, menacé par eux, d’être précipité à l’eau, dut reprendre la statue qui se refit légère entre ses mains et il la débarqua, aux acclamations de la foule tandis que le bâtiment allégé gagnait le large.
Tous crièrent alors que la Vierge n’avait agi de la sorte que parce qu’Elle voulait se fixer auprès d’eux et qu’il fallait par conséquent la garder. On courut chercher les prêtres de la paroisse et les membres de la fabrique et, séance tenante, ils l’acquirent et la placèrent dans l’église où l’on fonda une confrérie, en son honneur.
Il n’est donc point surprenant que Lydwine, qui fut certainement bercée par cette aventure, dès son jeune âge, ait aimé à prier devant cette statue. Ne pouvant aller la voir, le soir, alors que l’on chantait à genoux devant son autel des cantiques et des hymnes, elle s’arrangeait pour la visiter durant le jour et encore pas aussi souvent qu’elle l’aurait désiré, car sa vie n’était rien moins qu’oisive.
En effet, à sept ans, elle remplissait l’office de servante dans la maison de sa mère et c’est à peine si elle trouvait le loisir de prier et de se recueillir. Aussi, profitait-elle des matinées où Pétronille l’envoyait porter leur repas à ses frères, à l’école pour s’acquitter au plus vite de la commission et se conserver, en revenant, le temps de réciter un ave Maria, dans l’église ; et une fois qu’elle s’était attardée et que sa mère, mécontente, lui demandait quel chemin elle avait suivi, elle répondit naïvement : — Ne me gronde pas, petite mère, je suis allé saluer Notre-Dame la Vierge et Elle m’a rendu, en souriant, mon salut.
Pétronille demeura songeuse ; elle savait sa fille incapable de mentir et d’âme assez pure pour que Dieu la préservât d’illusions, et se plût à s’arrêter en elle ; elle se tut et toléra désormais sans esquisser de trop grises mines, ses légers retards.
Son enfance se passa de la sorte à aider sa mère qui, avec ses huit autres enfants et le peu d’argent que rapportait le métier de son mari, avait bien du mal à joindre les deux bouts. Aussi devint-elle habile ménagère, en grandissant ; à douze ans, elle fut une fillette sérieuse n’aimant guère à participer aux jeux de ses amies et de ses voisines et refusant de se mêler à leurs amusements de promenades et à leurs danses ; elle n’était à l’aise, au fond, que dans la solitude. Sans appuyer, sans préciser encore ses touches, sans lui parler son langage intérieur, sans se montrer, Dieu la liait déjà étroitement, lui laissant obscurément entendre qu’elle n’était qu’à Lui.
Elle obéissait sans comprendre, sans même soupçonner cette voie des angoisses qui s’étendait devant elle et dans laquelle il lui allait falloir bientôt entrer.
Une seule clarté se fit, fulgurante celle-là, le jour où des jeunes gens de la ville la demandèrent en mariage. Elle était alors avenante et bien tournée, douée de cette beauté spéciale aux blondines des Flandres, une beauté dont le charme tient surtout à la candeur des traits, à la gracieuse ingénuité du rire, à l’expression de tendresse sérieuse et cependant toujours un peu étonnée des yeux ; d’aucuns, parmi ces prétendants, étaient dans une condition de fortune et de famille fort supérieure à la sienne. Pierre, son père, ne put s’empêcher de se réjouir de cette aubaine et d’insister auprès de sa fille pour qu’elle se décidât ; mais, du coup, elle se rendit compte qu’elle devait vouer sa virginité au Christ et elle refusa net à son père de l’écouter ; il s’entêta.
— Si vous voulez me contraindre, s’écria-t-elle, j’obtiendrai de mon Seigneur quelque difformité si repoussante qu’elle mettra tous ces épouseurs en fuite !
Et comme Pierre, qui ne voulait pas s’avouer battu, revenait encore à la charge, la mère intervint et dit : voyons, mon homme, elle est trop jeune pour songer au mariage et trop pieuse pour que cet état lui convienne ; puisqu’elle veut se consacrer à Dieu, offrons-la-lui, au moins, de bonne grâce.
On finit par se résigner à ses volontés, mais, elle demeura inquiète de se savoir jolie et, en attendant qu’elle fût, ainsi qu’elle le souhaita, laide, elle sortit le moins possible ; elle comprenait maintenant que tout amour qui s’égare sur une créature est un dol commis envers Dieu et elle supplia Jésus de l’aider à le seul aimer.
Alors, il commença de la cultiver, l’émonda de toutes les pensées qui pouvaient lui déplaire, lui sarcla l’âme, la racla jusqu’au sang. Et il fit plus ; comme pour attester la justesse du mot terrible à la fois et consolant de sainte Hildegarde : « Dieu n’habite pas les corps bien portants », il s’attaqua à sa santé. Cette chair jeune et charmante dont il l’avait revêtue, elle semble tout à coup le gêner et il la coupe et il l’ouvre dans tous les sens, afin de mieux saisir l’âme qu’elle enferme et la broyer. Il élargit ce pauvre corps, lui donne l’effrayante capacité d’engloutir tous les maux de la terre et de les brûler dans la fournaise expiatrice des supplices.
Vers la fin de sa quinzième année, elle n’était déjà plus elle ; alors comme un aigle d’amour, il se précipite sur sa proie et la légende de saint Isidore de Séville et de Vincent de Beauvais sur l’aigle qui suspend ses petits à ses serres et les élève jusque devant l’astre du jour dont ils doivent fixer, sous peine d’être lâchés, le disque incandescent se vérifie en Lydwine ; elle regarde sans ciller le soleil de Justice ; et le symbole de Jésus, pêcheur d’âmes, la redépose doucement dans son aire et, là, son âme va monter et fleurir en une coque charnelle qui deviendra, avant sa sépulture, quelque chose de monstrueux et d’informe, d’on ne sait quoi.
Derrière elle, se profile en une ascendance lointaine, la grande figure de Job, pleurant sur sa couche de fumier. Elle en est la fille ; et les mêmes scènes se reproduiront, à travers les âges, des confins de l’Idumée aux bords de la Meuse, d’irréductibles souffrances endurées avec une inébranlable patience, aggravées par les discussions d’impitoyables amis, par les reproches même des siens, avec cette différence pourtant que les épreuves du Patriarche prirent fin, de son vivant, et que celles de sa descendante ne cessèrent qu’avec sa mort.
Jusqu’à sa quinzième année, Lydwine semble s’être assez bien portée ; ses historiens nous apprennent seulement qu’en bas âge, elle fut atteinte de la gravelle et expulsa de nombreux calculs ; mais ni Gerlac, ni Brugman, ni A Kempis, ne nous parlent des affections infantiles qu’elle put subir ; ce n’est, en somme, que vers la fin de sa quinzième année, que l’amoureuse furie de l’Époux s’abattit sur elle.
Alors, elle eut une maladie qui ne mit point ses jours en danger, mais qui la laissa dans un état de faiblesse qu’aucun des pharmaques prônés par les mires et les apothicaires de cette époque ne parvint à vaincre. Devenue étonnamment débile, elle languit ; ses joues se creusèrent et ses chairs fondirent ; elle maigrit à n’avoir plus que la peau et les os ; l’avenance même de ses traits disparut dans les saillies et les vides d’une face qui, de blanche et rose qu’elle était, verdit, puis se cendra. Ses souhaits s’exauçaient ; elle était cadavériquement laide. Ses prétendants se réjouirent d’avoir été évincés et elle ne craignit plus de se montrer.
Cependant, comme elle n’arrivait pas à recouvrer ses forces, elle gardait la chambre, quand quelques jours avant la fête de la Purification, ses amies la visitèrent. Il gelait, à ce moment, à pierre fendre et la rivière, la Schie, qui traverse la ville était, ainsi que les canaux, glacée ; par ces temps de froidure acérée, toute la Hollande patine. Ces jeunes filles invitèrent donc Lydwine à patiner avec elles ; mais, préférant demeurer seule, elle prétexta du mauvais état de sa santé pour ne pas les suivre. Elles insistèrent, tant et si bien, lui reprochant son manque d’exercice, l’assurant que le grand air lui ferait du bien, que, de peur de les contrarier, elle finit, avec l’assentiment de son père, par les accompagner sur l’eau devenue ferme du canal derrière lequel sa maison était située ; elle s’était relevée, après avoir chaussé ses patins, quand l’une de ses camarades, lancée à fond de train, se rua sur elle, avant qu’elle eût pu se détourner et elle culbuta sur un glaçon dont les aspérités lui brisèrent l’une des fausses côtes du flanc droit.
On la ramena, en pleurant, chez elle et la pauvre fille fut étendue sur un lit qu’elle ne devait plus guère quitter.
Cet accident fit aussitôt le tour de la ville et chacun crut de son devoir d’émettre son avis. Lydwine dut supporter, comme Job, l’intarissable bavardage des gens que le malheur des autres rend loquaces ; quelques-uns cependant plus sages, au lieu de la réprimander d’être sortie, se bornèrent à la plaindre, pensant que Dieu avait eu sans doute des raisons spéciales pour la traiter ainsi. Sa famille, désolée, résolut de tout tenter pour la guérir ; malgré sa pauvreté, elle appela les médecins en renom des Pays-Bas. Ils la droguèrent éperdument et le mal empira ; à la suite de ces traitements, un apostème induré se forma dans la fracture.
Elle souffrit le martyre ; ses parents ne savaient plus à quels saints se vouer, quand un praticien célèbre de Delft, homme très charitable et très pieux, Godfried de Haga, surnommé Sonder-Danck parce qu’il répondait invariablement avec ce mot qui signifie en hollandais « pas de merci » à tous les malades qu’il soignait gratuitement, vint en consultation la voir. Ses idées sur la thérapeutique étaient celles qu’exprima dans son « Opus paramirum » Bombast Paracelse qui naquit quelques années après la mort de Lydwine. Au milieu du fatras plus ou moins incohérent de son occultisme, cet homme étonnant avait saisi la grande loi de l’équilibre divin lorsqu’il écrivait à propos de l’essence de Dieu : « Il faut savoir que toute maladie est une expiation et que si Dieu ne la considère pas comme finie, aucun médecin ne peut l’interrompre… le médecin ne guérit que si son intervention coïncide avec la fin de l’expiation déterminée par le Seigneur. » Godfried de Haga examina donc la patiente et il parla de la sorte à ses confrères assemblés, curieux de connaître son verdict : cette maladie-là, mes très chers, n’est point de notre ressort ; tous les Gallien, les Hippocrate et les Avicenne du monde y perdraient leur renom. Et il ajouta prophétiquement : « La main de Dieu est sur cette enfant. Il opérera des merveilles en elle ; plût au ciel qu’elle fût ma fille, je donnerais de bon cœur un poids d’or égal à celui de sa tête, pour payer cette faveur, si elle était à vendre. » Et il partit, en ne prescrivant aucun remède ; alors tous les médicastres s’en désintéressèrent et elle y gagna, au moins pour quelque temps, de n’être plus contrainte à s’ingérer des remèdes inutiles et coûteux ; mais le mal s’accrut encore et les douleurs devinrent intolérables ; elle ne put rester ni couchée, ni assise, ni debout. Ne sachant plus que faire et ne pouvant s’immobiliser dans la même position, un seul instant, elle demandait qu’on la transférât d’un lit dans un autre, croyant amortir ainsi un peu l’acuité de ses tortures ; mais les secousses de ces déplacements achevèrent d’exaspérer son mal.
La veille de la Nativité de saint Jean-Baptiste, ses tourments atteignirent leur paroxysme ; elle sanglotait sur son lit, dans un état d’énervement affreux ; à un moment, elle n’y tint plus ; les douleurs s’accélérèrent si déchirantes qu’elle jaillit de sa couche et tomba, cassée en deux sur les genoux de son père qui pleurait, assis auprès d’elle. Ce saut fit éclater l’abcès ; mais, au lieu de crever au dehors, il perça en dedans et elle rendit le pus à pleine bouche. Ces vomissements la secouaient de la tête aux pieds et ils étaient avec cela si abondants qu’ils emplissaient des écuelles que l’on avait à peine le loisir de vider à mesure qu’elles débordaient, dans un grand coquemar. Finalement, elle s’évanouit dans un dernier hoquet et ses parents la crurent morte. Elle reprit cependant connaissance et alors la vie la plus sinistre qui se puisse imaginer commença pour elle ; incapable de s’appuyer sur ses jambes et toujours agitée de ce besoin de changer de place, elle se traîna sur les genoux, rampa sur le ventre, s’accrochant aux escabeaux et aux angles des meubles ; brûlée de fièvre, elle fut obsédée par des goûts maladifs et but l’eau sale ou l’eau tiède qu’elle rencontrait et elle la rejetait, tordue par d’affreux cahots. Trois ans se passèrent de la sorte ; pour parfaire son martyre, elle fut abandonnée par ceux qui venaient encore, de temps en temps, la saluer. L’aspect de ses tortures, ses gémissements et ses cris ; le masque horrible de son visage tuméfié par les larmes, mirent les visiteurs en déroute. Sa famille, seule, l’assistait, son père dont la bonté ne se démentit pas, sa mère qui, moins résignée à son sort de garde-malade, s’agaça, et, impatientée de l’entendre toujours geindre, la brusqua.
Le chagrin qu’elle ressentait, en étant déjà si malheureuse, d’être obligée de subir encore des algarades et des reproches aurait sans doute fini par la tuer, si Dieu, qui semblait demeurer jusqu’alors sur l’expectative avec elle, n’était subitement intervenu, lui montrant par un soudain miracle qu’il ne la délaissait point et infligeant, par la même occasion, une leçon de miséricorde à sa mère.
Voici, en effet, ce qui advint :
Un jour, deux hommes se querellèrent sur la place ; après s’être couverts d’injures, ils se gourmèrent et l’un d’eux, tirant son épée, fondit sur l’autre qui, ou désarmé ou moins courageux, s’enfuit ; il aperçut, à un tournant de rue, la maison de Lydwine dont la porte était ouverte et il s’y précipita. Son adversaire qui ne l’avait pas vu entrer, soupçonna néanmoins qu’il s’était réfugié en ce lieu et considérant Pétronille qui le regardait, effarée, sur le seuil, il s’écria, écumant de rage : Où est-il, ce fils de la mort ? n’essayez pas de me tromper, il doit être caché chez vous ! Elle l’assura, en tremblant, que non ; mais il ne la crut pas ; et l’écartant d’un revers de main et proférant les plus terribles menaces, il pénétra jusque dans la chambre de Lydwine et somma la malade de ne pas lui déguiser la vérité.
Lydwine, incapable de mentir, répondit : Celui que vous poursuivez est, en effet, ici.
A ces mots, Pétronille qui s’était glissée derrière l’énergumène ne put se contenir et elle gifla sa fille, disant : Comment, misérable folle, vous livrez un homme qui est votre hôte alors qu’il est en danger de mort !
Cependant le forcené ne voyait et n’entendait rien de cette scène. Il cherchait, en blasphémant, son adversaire devenu invisible pour lui et qui était pourtant, là, debout, devant lui, au milieu de la pièce. Ne le découvrant pas, il s’élança dehors pour retrouver ses traces, tandis que le malheureux décampait, à son tour, d’un autre côté, à toutes jambes.
Lorsqu’ils furent partis, Lydwine qui avait reçu, sans se plaindre, cette correction, murmura : J’ai cru, ma mère, que le fait seul de dire la vérité suffirait à sauver cet homme ; — et Pétronille, admirant la foi de sa fille et le miracle qui l’en avait récompensée, conçut de plus débonnaires sentiments et supporta désormais avec moins de malveillance et d’aigreur les fatigues et les peines que lui causaient les infirmités de Lydwine.
Il convient d’avouer, d’ailleurs, qu’elle avait, pour excuse de ses acrimonies, d’incessants embarras et de harassantes besognes, la brave femme ! car si les infirmités de son enfant lui semblaient excessives déjà, elles n’étaient que bénignes en comparaison de celles qui surgirent.
Bientôt, Lydwine ne put même plus se traîner sur les genoux et s’agripper aux huches et aux sièges ; il lui fallut croupir sur sa couche et ce fut, cette fois, pour jamais ; la plaie qui n’avait pu se cicatriser, sous les côtes, s’envenima et la gangrène s’y mit ; la putréfaction engendra les vers qui parvinrent à se faire jour sous la peau du ventre et pullulèrent dans trois ulcères ronds et larges comme des fonds de bols ; ils se multiplièrent d’une façon effrayante ; ils paraissaient bouillir, dit Brugman, tant ils grouillaient ; ils avaient la grosseur du bout d’un fuseau et leurs corps étaient gris et aqueux et leurs têtes noires.
L’on rappela des médecins qui prescrivirent d’appliquer sur ces nids de vermines, des cataplasmes de froment frais, de miel, de graisse de chapon, auxquels d’aucuns conseillèrent d’ajouter de la crème de lait ou du gras d’anguille blanche, le tout saupoudré de chair de bœuf desséchée et réduite en poudre, dans un four.
Et, en effet, ces remèdes qui exigeaient, pour les préparer, certains soins — car il fut remarqué que si la farine de froment était tant soit peu éventée, les vers ne s’en repaissaient point — la soulagèrent et l’on arriva, par ce moyen, à retirer de ses blessures de cent à deux cents vers par vingt-quatre heures.
A ce propos d’emplâtre façonné avec de la graisse de chapon, les biographes de Lydwine nous racontent cette anecdote :
Le curé de Schiedam était alors un P. André, de l’ordre des prémontrés, détaché de son couvent de l’île Sainte-Marie. Ce religieux était pourvu d’une âme vraiment turpide. Goinfre et rapace, ne songeant qu’à son bien-être, il dut, aux approches du Carême, traiter les recteurs de sa paroisse et il tua des chapons qu’il avait eu le soin préalable d’engraisser. Or, il se présenta à ce moment chez Lydwine pour la confesser ; connaissant les desseins annoncés de cette bombance et l’apport préparé des volatiles, elle lui demanda de lui donner la graisse de l’un d’eux pour la confection de son onguent. Il répondit, avec mauvaise humeur, qu’il ne le pouvait, attendu que ses chapons étaient maigres et que le peu de jus qui en coulerait devait servir à la cuisinière pour les arroser pendant la cuisson. Elle insista, lui proposa même en échange une mesure de beurre égale à celle de la graisse ; il persista dans sa résolution ; alors, elle le regarda et lui dit :
— Vous m’avez refusé ce que je vous quêtais, à titre d’aumône, au nom de Jésus, eh bien, je prie maintenant notre Sauveur pour que votre volaille soit dévorée par les chats.
Et ainsi fut fait ; quand le matin du repas l’on inspecta le garde-manger, l’on y découvrit, en guise de bêtes à rôtir à la broche, des fragments broyés d’os.
Si cette aventure ne rendit point, comme nous le verrons par la suite, ce religieux moins égoïste et moins vil, elle lui valut au moins de se montrer, dans une circonstance analogue, plus sagace et moins chiche, car Gerlac nous narre cet autre épisode :
En sus de ces cataplasmes de fleur de froment et d’axonge, Lydwine se servait quelquefois de tranches de pomme coupées fraîches, pour les apposer sur ses plaies et en rafraîchir l’inflammation. Or, le curé possédait des pommes en abondance, dans son jardin. La sainte lui en réclama quelques-unes pour cet usage. Il commença par rechigner, déclarant qu’il ne savait pas s’il en restait, mais quand il fut rentré chez lui, il se remémora ses chapons perdus et il envoya aussitôt quelques pommes à sa pénitente, en disant : je les lui offre de peur que ce ne soient, cette fois, les loirs qui me les mangent.
Au fond, ces médicaments étaient anodins et ne la secouraient guère. Un médecin du diocèse de Cologne qui avait entendu parler d’elle, peut-être par Godfried de Haga dont il semble avoir été l’ami, parut mieux réussir, bien qu’en fin de compte, il se soit borné à changer, en l’aggravant, la nature du mal. Il lui fit appliquer sur ses foyers purulents des compresses imbibées d’une mixture qu’il préparait, en distillant certaines plantes cueillies dans les forêts par les temps secs, au point du jour, lorsqu’elles sont encore couvertes de rosée. Cette mixture, mélangée à une décoction de centaurée ou de mille-fleurs, sécha peu à peu les ulcères. Ce médecin était un brave homme car, pour être sûr qu’elle ne serait pas privée, s’il mourait avant elle, de son remède, il avait chargé son gendre, un apothicaire du nom de Nicolas Reiner, de lui expédier, après son décès, toutes les fioles dont elle aurait besoin pour fermer ses plaies.
Mais le moment arriva où tous ces palliatifs furent définitivement infidèles, car le corps entier de la malheureuse fut à vif ; en outre de ses ulcères dans lesquels vermillaient des colonies de parasites qu’on alimentait sans les détruire, une tumeur apparut sur l’épaule qui se putréfia ; puis ce fut le mal redouté du Moyen Age, le feu sacré ou le mal des ardents qui entreprit le bras droit et en consuma les chairs jusqu’aux os ; les nerfs se tordirent et éclatèrent, sauf un qui retint le bras et l’empêcha de se détacher du tronc ; il fut dès lors impossible à Lydwine de se tourner de ce côté et il ne lui resta de libre que le bras gauche pour soulever sa tête qui pourrit à son tour. Des névralgies effroyables l’assaillirent qui lui forèrent, ainsi qu’avec un villebrequin, les tempes et lui frappèrent, à coups redoublés de maillet, le crâne ; le front se fendit de la racine des cheveux jusqu’au milieu du nez ; le menton se décolla sous la lèvre inférieure et la bouche enfla ; l’œil droit s’éteignit et l’autre devint si sensible qu’il ne pouvait supporter, sans saigner, la moindre lueur ; elle éprouva aussi des rages de dents qui durèrent parfois des semaines et la rendirent quasi-folle ; enfin, après une esquinancie qui l’étouffa, elle perdit le sang, par la bouche, par les oreilles, par le nez, avec une telle profusion que son lit ruisselait.
Ceux qui assistaient à ce lamentable spectacle se demandaient comment il pouvait sortir, d’un corps si parfaitement épuisé, une telle quantité de sang et la pauvre Lydwine essayait de sourire.
— Dites, faisait-elle, vous qui en savez plus long que moi, d’où peut venir au printemps cette sève dont se gonfle la vigne, si noire et si nue pendant l’hiver ?
Il semblait qu’elle eût parcouru le cycle possible des maux. Il n’en était rien ; à lire les descriptions de ses biographes que j’adoucis, l’on se croirait dans une clinique où défilent, une à une, les maladies les plus terrifiantes, les cas de douleur les plus exaspérés, les crises les plus rares.
Bientôt, en sus de ses autres infirmités, sa poitrine jusqu’alors indemne s’attaqua ; elle se moucheta d’ecchymoses livides, puis de pustules cuivrées et de clous ; la gravelle, qui l’avait torturée dès son enfance et qui était disparue, revint et elle évacua des calculs de la grosseur d’un petit œuf ; ce furent ensuite les poumons et le foie qui se carièrent ; puis un chancre creusa un trou à pic qui s’étendit dans les chairs et les rongea ; enfin quand la peste s’abattit sur la Hollande, elle en fut infectée, la première ; deux bubons poussèrent, l’un sur l’aine, et l’autre dans la région du cœur. — Deux, c’est bien, s’exclama-t-elle, mais s’il plaît à Notre Seigneur, je pense qu’en l’honneur de la sainte Trinité, trois seraient mieux ! — et un troisième abcès lui fouilla aussitôt la joue.
Elle serait morte vingt fois si ces affections avaient été naturelles ; une seule eût suffi pour la tuer ; aussi, n’y avait-il, pour essayer de la guérir, rien à tenter, rien à faire.
Mais la renommée de ces maux réunis si étrangement sur une seule personne qui continuait de vivre, en étant sur toutes les parties du corps mortellement atteinte, s’était répandue au loin. Si elle lui avait amené des empiriques qui avaient parfois aggravé par de douteuses panacées, son état, elle lui valut, par contre, une nouvelle visite de ce brave Godfried de Haga qui l’avait traitée après sa chute.
Il arriva à Schiedam, accompagné de la comtesse Marguerite de Hollande dont il était le médecin, et qui voulait vérifier par elle-même le cas de cette extraordinaire malade dont elle entendait souvent, par les seigneurs de sa Cour, parler. Elle pleura de pitié, en voyant l’aspect inhumain de Lydwine.
Godfried, qui avait jadis pronostiqué l’origine divine de ces maux, ne pouvait que constater l’impuissance de son art à les guérir ; croyant cependant qu’il parviendrait peut-être à soulager la patiente, il lui retira du ventre les entrailles qu’il déposa dans un bassin ; il les tria et remit, après les avoir nettoyées, celles qui n’étaient pas hors d’usage, en place. Son diagnostic fut qu’elle était affligée d’une putréfaction de la moelle qu’il attribua assez bizarrement à cette cause que Lydwine ne salait jamais ses aliments ; il ajouta, en se retirant, qu’une nouvelle maladie, l’hydropisie se produirait à bref délai, et ses prévisions se réalisèrent : l’hydropisie s’attesta dès que les ulcères soignés par les solutions et les compresses du médecin de Cologne se fermèrent. Quand ils ne suppurèrent plus, la malheureuse gonfla et regretta d’avoir échangé, contre un pire, son mal.
Et cet incroyable assaut de calamités physiques, elle l’endura pendant trente-huit années ; elle n’eut, durant ce temps, pas un instant de répit, pas une heure de bon.
Il convient de remarquer maintenant que parmi ces méchéances dont elle souffrit, deux sont comprises dans les trois fléaux venus de l’Orient qui désolèrent l’Europe pendant le Moyen Age : le mal des ardents, une sorte d’ergotisme gangréneux, brûlant ainsi qu’un feu caché les chairs des membres et délitant les os, jusqu’à ce que la mort achevât le supplice ; la peste noire qui, selon l’observation d’un médecin de l’époque, « se déclarait avec fièvre continue, apostèmes et carboncles ès parties externes, principalement aux aisselles et aux aisnes et l’on en mourait en cinq jours ».
Reste donc le troisième fléau qui fit, lui aussi, le désespoir de ces siècles, la lèpre.
Il manque à la série des affections subies par la pauvre fille. Dieu qui, dans les Écritures, et dans les vies des saints, paraît s’intéresser d’une façon particulière au « mesel » ou lépreux qu’il guérit ou dont il emprunte la repoussante image pour tenter la charité des siens, Dieu ne voulut pas imposer à sa pitoyable servante cette dernière épreuve ; et le motif de cette exception qui étonne tout d’abord, on le comprend pour peu que l’on y réfléchisse. La lèpre eût contrecarré les desseins du Seigneur et rendu l’expansion de la sainteté de Lydwine, nulle.
Il faut se rappeler, en effet, que, pendant le Moyen Age, les lépreux, considérés comme incurables, car toute la pharmacopée de ses docteurs, l’ellébore, les bains de soufre, la chair de vipère usités dès l’antiquité déjà, l’arsenic essayé par Paracelse, n’avaient pu parvenir à en guérir un, furent enfermés, par peur de la contagion, dans des hospices spéciaux ou isolés dans de petites maisons, dans des « bordes » qu’il leur était interdit, sous menace des plus dures peines, de quitter. Ils durent même revêtir un costume distinctif, une sorte de housse grise ou d’esclavine, agiter avec une main toujours enveloppée d’un gant une crécelle dite tartavelle pour empêcher les gens de s’approcher. Le lépreux était un paria, mort civilement, séparé à jamais du monde, et on l’enterrait, après son trépas, dans un lieu à part.
La liturgie était pour lui, terrible ; avant de le séquestrer, l’Église célébrait, en sa présence, une messe de Saint-Esprit avec l’oraison « pro infirmis », puis elle le conduisait processionnellement à la cabane qui lui était destinée ou à la maladrerie, s’il en existait une, dans le pays ; on lui lisait les effrayantes prohibitions qui le retranchaient du nombre des vivants, l’on jetait trois pelletées de terre, prises dans le cimetière, sur son toit, l’on plantait une croix devant sa porte et c’était fini du mesel.
Dans certaines contrées de la France, le rituel qui le concernait était plus sinistre encore. Le malheureux féru de la maladie de « Monsieur sainct Ladre » n’entrait à l’église, le jour fixé pour son internement, qu’allongé sur une civière et couvert d’un drap noir, de même qu’un mort. Le clergé chantait le « libera » et faisait la levée du corps. Le lépreux ne se tenait debout qu’une fois arrivé devant le lazaret ou devant la hutte qui devait l’abriter et, là, tête basse, il écoutait la lecture de l’arrêt qui lui enjoignait de ne pas risquer un pied dehors, de ne pas toucher à quoi que ce fût, qui allait jusqu’à lui prescrire de passer sous le vent des personnes saines, si celles-ci venaient par hasard à le croiser.
Les règlements relatifs à la lèpre ont été, à quelques détails près, partout les mêmes. Le Coutumier du comté de Hainaut qui fut, au XIVe siècle, l’une des provinces composant le domaine des Pays-Bas, contient une série d’ordonnances de ce genre. Il est donc certain que si Lydwine avait été atteinte de ladrerie, elle eût été emportée de chez elle et ensevelie, pour ainsi dire, vivante ; elle n’aurait pu recevoir les secours de son père et de sa mère et, après leur décès, de ses neveu et nièce que l’on eût écartés par crainte de la diffusion du mal ; elle fût, dès lors, sans que quiconque l’eût pu visiter, demeurée inconnue et les exemples auxquels Dieu désirait qu’elle servît, seraient à jamais ignorés.
Il faut noter aussi que cette question des soins à lui donner paraît avoir été envisagée d’une façon très particulière par Notre Seigneur. Il l’accabla de tourments, il la défigura en substituant au charme de son clair visage l’horreur d’une face boursouflée, d’une sorte de mufle léonin raviné par des rigoles de larmes et des rainures de sang ; il la mua en un squelette et bomba sur cette consternante maigreur le dôme ridicule d’un ventre rempli d’eau ; il la promut, pour ceux qui ne voient que les apparences, hideuse ; mais s’il accumula sur elle toutes les disgrâces des formes, il entendit que les gardes malades chargées de la panser ne pussent être dégoûtées et lassées de leurs charitables offices, par l’odeur de décomposition qui devait forcément s’exhaler des plaies.
En un constant miracle, il fit de ces blessures des cassolettes de parfums ; les emplâtres que l’on enlevait, pullulant de vermines, embaumaient ; le pus sentait bon, les vomissements effluaient de délicats aromes ; et de ce corps en charpie qu’il dispensait de ces tristes exigences qui rendent les pauvres alités si honteux, il voulut qu’il émanât toujours un relent exquis de coques et d’épices du Levant, une fragrance à la fois énergique et douillette, quelque chose comme un fumet bien biblique de cinnamome et bien hollandais, de cannelle.
Parlant incidemment de Lydwine dans sa biographie de l’admirable sœur Catherine Emmerich qui fut, au XIXe siècle, l’une des héritières directes de la sainte de Schiedam, un religieux allemand le P. Schmœger s’efforce de rapprocher chacune de ses souffrances de celles qu’endurait alors l’Église et il en vient, par exemple, à assimiler ses ulcères aux blessures de la chrétienté lésée par les désordres du schisme, à prétendre que les douleurs de la pierre dont elle pâtit, symbolisèrent l’état de concubinage dans lequel vivaient alors de nombreux prêtres, que les pustules de sa gorge signifièrent les enfants « privés du lait de la sainte doctrine, » etc. La vérité est que ces analogies sont singulièrement tirées par les cheveux et, un tantinet même cocasses et qu’il paraît et plus exact et plus simple de ne rien spécifier et de s’en tenir à cette indication générale que nous avons déjà posée, que Lydwine expia, par des maladies, les fautes des autres.
Mais son âme fut-elle, en cette gaine déchirée, dans ce vêtement troué et mangé par les vers, tout d’abord ferme ? Fut-elle assez fervente, assez robuste pour supporter, sans se plaindre, le poids sans mesure de ses maux ? Lydwine fut-elle, dès que les infirmités la prostrèrent, une sainte ?
Nullement ; les quelques renseignements qui nous furent laissés affirment le contraire ; elle ne ressembla point à ces déicoles qui possédèrent, soi-disant, d’emblée, toutes les vertus sans même s’être infligé la peine de les acquérir ; ses biographes, si vagues sur certains points, ne nous ont pourtant pas leurrés, ainsi que tant de leurs confrères dont les histoires nous présentent des femmes qui n’en sont pas, des héroïnes impeccables mais fausses, des êtres qui n’ont rien de vivant, rien d’humain, en un mot. Elle, s’ébroua devant la douleur et voulut fuir ; quand elle se vit, captive sur un lit, elle pleura toutes ses larmes et fut bien près de tomber dans le désespoir. Comment aurait-il pu en être autrement, d’ailleurs ? Elle n’était pas préparée à gravir en d’aussi terrifiantes étapes la pente du Calvaire. Jusqu’au jour où elle se brisa une côte, la vie avait été pour elle laborieuse et facile ; son enfance ne différa guère de celle de beaucoup de petites filles du peuple que la misère mûrit avant l’âge, car il leur faut, lorsqu’elles s’échappent de la classe, aider leur mère à élever les autres enfants ; elle fut plus heureuse néanmoins que ses camarades d’école et que ses voisines, car elle fut choyée comme pas une, par la Vierge qui condescendit à animer sa statue et à sourire pour lui plaire ; mais Lydwine, qui ne savait pas ce qu’étaient les voies mystiques, ne pouvait croire que ces attentions n’étaient que le prélude d’affreux tourments ; elle s’imagina, naïvement, que ces gâteries dureraient et il en fut d’elle ainsi que de tous ceux dont Jésus saisit l’âme pour la liquéfier dans la forge de l’Amour et la verser, alors qu’elle entre en fusion, dans le moule nuptial de sa croix ; elle allait expérimenter que le mariage de l’âme ne se consomme le plus souvent que lorsque le corps est réduit à l’état de poussier, à l’état de loque ; brusquement, pour elle, les joies du début cessèrent ; dès qu’elle lui eut sevré l’âme, la Madone la descendit de ses bras par terre et elle dut apprendre à chercher sa subsistance et à marcher, sans lisières, seule ; elle suivit, en somme, avant que de pénétrer dans les sentiers extraordinaires, la route commune. Les quatre premières années de ses maladies, elle put se croire vraiment damnée ; toute consolation lui fut refusée. Après l’avoir accablée de coups, Dieu se détourna, ne parut même plus la connaître. Sa situation fut certainement alors celle de tous ceux que les maladies alitent.
Après ces prémices de souffrances qui stimulent la prière, qui font supplier avec l’espoir, sinon d’une guérison immédiate, au moins d’une détente dans l’acuité du mal, le découragement s’impose à ne voir aucun de ses souhaits exaucés et les oraisons se débilitent, à mesure que les misères s’accroissent ; le recueillement s’exclut ; le sort pitoyable que l’on subit absorbe tout ; l’on ne peut plus penser qu’à soi-même et le temps se passe à déplorer son infortune. Ces prières que l’on continue cependant, par un reste d’habitude, par une incitation secrète du ciel, ces prières que l’on jugerait devoir être d’autant mieux écoutées qu’elles sont plus méritoires, car elles coûtent tant ! elles finissent, à un moment de trop grande douleur, par s’exaspérer, par se dresser devant Dieu, comme une sommation, comme une mise en demeure de tenir les promesses de ses Évangiles ; l’on se répète amèrement le « demandez et il vous sera donné », et elles s’achèvent dans la lassitude et le dégoût ; l’à quoi bon s’insinue peu à peu de tant d’efforts et lorsque dans un instant de provisoire ferveur, dans une minute d’adoucissement des crises, l’on veut se remettre à prier, il semble que l’on ne sait plus. Les invocations, à peine lancées du bord du cœur, retombent à plat et l’on croit sentir que le Christ ne se baisse pas pour les ramasser ; c’est la tentation de désespoir qui commence ; et, tandis qu’il tisonne le brasier des tortures, l’Esprit de Malice devient pathétique et plaintif ; il insiste sur la fatigue des vœux réprouvés, sur l’inefficace des oraisons et le malade s’abat sur lui-même, à bout de force.
L’horizon est noir et les lointains sont clos. Dieu dont le souvenir quand même domine n’apparaît plus qu’ainsi qu’un inexorable thaumaturge qui pourrait vous guérir d’un signe et ne le veut pas. Il n’est même plus un indifférent, il est un ennemi ; l’on aurait plus de miséricorde que Lui, si l’on était à sa place ! Est-ce qu’on laisserait ainsi souffrir des gens que l’on pourrait, si aisément, soulager ? Dieu semble être un mauvais Samaritain, un Juge inconcevable. On a beau se dire, dans une lueur de bon sens, que l’on a péché, que l’on expie ses offenses, l’on conclut que la somme des transgressions commises n’est pas suffisante pour légitimer l’apport de tant de maux et l’on accuse Notre-Seigneur d’injustice, l’on prétend Lui démontrer qu’il y a disproportion entre les délits et la peine ; dans ce désarroi, l’on ne tente plus de se consoler qu’en s’attendrissant sur soi-même, qu’en se plaignant d’être la victime d’une inéquitable rigueur ; plus on gémit et plus l’on s’aime ; et l’âme détournée de son chemin par ces quérimonieuses adulations de ses propres aîtres, vague, excédée sur elle-même et finit par s’étendre dans la ruelle, tournant presque le dos à Dieu, ne voulant plus Lui parler, ne désirant plus, ainsi qu’un animal blessé, que souffrir, cachée, dans un coin, en paix.
Mais cette désolation a des hauts et des bas. L’impossibilité de se remonter de la sorte réoriente la pauvre âme, qui ne peut tenir au même endroit, vers son Maître. L’on se reproche alors ses contumélies et ses blâmes ; l’on implore son pardon et une douceur naît de ce rapprochement ; peu à peu, des idées de résignation à la volonté du Sauveur s’inculquent et prennent racine, si le Diable, aux aguets, ne se mêle pas de les extirper, si une visite motivée par la charité et par l’espoir de vous apporter un réconfort ne manque pas résolument son but, en vous rejetant dans des sentiments de regrets et d’envie ; car c’est encore là l’une des tristesses spéciales aux grabataires ; si la solitude leur pèse, le monde les accable. Si personne ne vient, l’on se dit abandonné, lâché par ceux dont l’amitié était la plus sûre et s’ils viennent, l’on effectue un retour sur soi-même, en considérant la bonne santé des visiteurs ; et cette comparaison vous afflige davantage ; il faut être déjà bien avancé dans la voie de la perfection pour pouvoir, en de telles circonstances, s’omettre. Lydwine, que la hantise de ses détresses incitait à se fréquenter, à penser à elle surtout, dut connaître ces alternatives d’âme écorchée, ces douloureux abois.
Ce que nous savons positivement, en tout cas, c’est que lorsqu’elle entendait les rires de ses amies jouant dans la rue, elle fondait en larmes et demandait au Seigneur pourquoi elle était, à l’écart des autres, si durement traitée.
Il faut croire cependant qu’elle était déjà de taille à supporter les plus effarantes des calamités, car Dieu ne tint aucun compte de ses pleurs et, au lieu de l’alléger, il la chargea.
A ses tortures corporelles, à ces tourments de l’âme issus de la pensée toujours ramenée à son propre dessein, ne tarda pas à se joindre l’horreur de la ténèbre mystique. Tandis qu’elle essayait de réagir contre le découragement, elle entrait dans le laminoir de la vie purgative et s’y tréfilait ; ce fut alors, en sus de l’obsession de son impotence, l’aridité de tout son être ; ce fut l’ataxie spirituelle qui fait que l’âme fléchit, incapable d’aller droit, fauche quand elle marche, jusqu’au moment où toutes les facultés se paralysent. Ainsi que l’observe saint Jean de la Croix, Dieu plonge l’entendement dans la nuit, la volonté dans les sécheresses, la mémoire dans le vide, le cœur dans l’amertume. Et ce stade de délaissement intérieur, greffé et comme confondu avec le navrement têtu des maux, Lydwine l’éprouva pendant des années ; elle se crut maudite par l’Époux et put encore allier à ses angoisses l’appréhension que cet état durerait toujours.
Aucune créature humaine n’eût pu résister à de tels assauts si elle n’avait été divinement surveillée et ardemment soutenue ; mais Dieu cacha à Lydwine, pendant cette période d’épuration, son aide ; il lui supprima les consolations sensibles ; il ne lui prêta même pas l’appui d’un prêtre, car ce n’était point, à coup sûr, ce curé de Schiedam, l’homme aux chapons, qui était capable de la secourir dans son dénuement ! il ne paraît pas non plus que le dictame des affligés, que le souverain magistère de l’âme, que la communion lui ait été souvent accordée, car Gerlac et Brugman notent qu’au temps où elle pouvait encore se traîner, ses parents la conduisaient, le jour de Pâques, à l’église où elle s’agenouillait tant bien que mal devant la rampe de l’autel. Plus tard, quand elle fut immobilisée sur sa couche, ils marquent encore que l’esquinancie dont elle était atteinte l’empêchait souvent de consommer les célestes Apparences ; enfin, A Kempis, plus précis, déclare formellement qu’elle ne communiait, lorsqu’elle était saine, qu’à la fête de la Résurrection ; puis, ajoute-t-il, lorsqu’elle ne put quitter sa chambre, elle obtint de recevoir le corps de Notre-Seigneur une fois de plus ; enfin, longtemps après qu’elle fut complètement alitée, on lui porta l’Eucharistie, six fois l’an. A cette époque, on le voit, le Sacrement se distribuait à d’assez rares intervalles, mais n’est-ce pas à cette privation du seul Cordial qui eût été assez puissant pour la ranimer que l’on peut attribuer, en partie, cette anémie spirituelle qui l’accablait ? En résumé, jamais femme ne parut ainsi abandonnée par Celui dont les caresses implorées se résolvaient en d’âpres décevances et de brusques rebuts ; son cas peut sembler, en effet, presque unique. Ces autres saints et les autres saintes connurent évidemment des angoisses pareilles ; ils passèrent comme elle par les épreuves de la vie purgative, mais ils ne la subirent pas pour la plupart, en même temps que l’enfer des tortures physiques ; l’âme était en sang, mais le corps était valide ; il soutenait de son mieux sa compagne, il la promenait au moins telle qu’une enfant malade qu’on berce sur les bras ; il l’emmenait dans les églises, il tentait de tromper ses angoisses en la sortant ; ou bien, c’était le contraire ; l’organisme défaillait mais l’âme était dispose et elle relevait, à force d’énergie, son acolyte ; chez Lydwine, hélas ! l’âme et sa coque étaient à l’avenant ; toutes deux étaient délabrées et inaptes à s’étayer ; elles étaient sur le point de crouler, quand subitement le Seigneur qu’elle croyait si loin, lui affirma, magnifiquement par le miracle de l’homme devenu invisible, qu’il veillait là, à ses côtés, qu’il s’occupait enfin d’elle.
Jugeant que les ténèbres de la pauvre fille avaient suffisamment duré, il les déchirait dans cet éclair de grâce, puis il confiait à un intermédiaire humain, à un prêtre du nom de Jan Pot, le soin de lui expliquer sa vocation et de la consoler.
Qu’était ce Jan Pot qui fut son confesseur en même temps que dom André, le curé de Schiedam ? Gerlac et A Kempis le désignent comme étant cet ecclésiastique qui venait la communier alors qu’elle avait obtenu la permission de consommer le « Mengier de Dieu » deux fois l’an. Il ne paraît pas avoir tenu le curé en une très ample estime, car ce fut lui qui annonça à Lydwine — avec joie, dit Gerlac — que les chats avaient dévoré les chapons. D’où venait-il ? quelle était sa situation dans la ville ? comment connut-il la sainte ? Autant de questions qui subsistent sans réponse nette.
Cependant, si l’on rapproche deux passages, l’un de Gerlac, l’autre de Brugman, relatifs tous deux à la tentation de suicide d’un échevin de Schiedam dont nous parlerons plus loin, l’on pourrait peut-être admettre que Jan Pot fut le vicaire de la paroisse. En tout cas, ce que l’on peut attester, c’est qu’il fut réellement délégué par Dieu pour définir à Lydwine sa mission et la diriger.
Après lui avoir, un jour, débité les lieux communs qui se récitent d’ordinaire aux malades, il conclut simplement :
Ma fille, vous avez trop négligé jusqu’ici de méditer la Passion du Christ. Faites-le désormais et vous verrez que le joug du Dieu des amoureuses douleurs deviendra doux. Accompagnez-le, au jardin des Olives, chez Pilate, sur le Golgotha et dites-vous, que lorsque la mort lui interdira de souffrir encore tout ne sera pas fini, qu’il vous faudra dorénavant, comme une fidèle veuve, accomplir les dernières volontés de l’Époux, suppléer par vos souffrances à ce qui manque aux siennes.
Lydwine l’écouta, sans bien comprendre ce que signifiaient ces mots, elle le remercia de s’être montré si charitable pour elle et quand il fut parti, elle voulut profiter de son conseil et réfléchit ; mais ce fut en vain qu’elle essaya de se représenter les scènes du Calvaire ; elle s’évaguait et ses tourments l’intéressaient plus que ceux de Jésus ; elle tenta de s’arracher à elle-même et, en observant une méthode que Jan Pot lui avait brièvement indiquée pour faciliter la pratique de cet exercice, elle s’efforça de rallier ses pensées et, après les avoir groupées, de les lancer sur la piste du Sauveur ; mais elles se retournèrent et revinrent au galop sur elle ; alors, elle perdit complètement la tête. Quand elle se fut un peu reprise, elle réunit toute sa volonté pour s’appliquer des œillères sur les yeux de l’esprit, afin de s’empêcher de regarder de côté et d’autre et de se contraindre à ne suivre qu’une trace, mais ce procédé n’obtint aucun succès ; l’âme se buta et refusa d’avancer ; bref, cette méditation sur commande l’épuisa, tout en l’ennuyant à mourir ; et elle le confessa très franchement au prêtre lorsqu’il la visita de nouveau.
— Mon père, fit-elle, j’ai voulu vous obéir, mais je n’entends rien du tout à la méditation ; lorsque je m’évertue à considérer les tortures du Christ, c’est aux miennes que je songe ; le joug du Sauveur n’est pas, ainsi que vous me l’assuriez, devenu léger ; ah ! si vous saviez ce qu’il pèse !
Jan Pot ne se montra nullement surpris de cette réponse. Il loua Lydwine de son effort et patiemment lui expliqua que son état de siccité, que son peu d’élan, que ces écarts de l’imagination inapte à cingler vers un seul but, étaient quand même des grâces ; il lui décela sans doute que l’oraison récitée par sujétion est peut-être la plus agréable qui soit à Dieu, puisqu’elle est la seule qui coûte ; il lui dit, avec sainte Gertrude, que si le Seigneur accordait toujours des consolations intérieures, elles seraient nuisibles, car elles amolliraient les âmes et diminueraient le poids de leurs acquis ; et l’on peut croire qu’après ce préambule, il déchira brusquement le voile qui couvrait l’avenir, qu’il lui révéla son rôle de victime sur la terre, qu’il lui précisa le sens de cette phrase de saint Paul « parfaire la Passion du Christ ».
Il lui apprit certainement que l’humanité est gouvernée par des lois que son insouciance ignore, loi de solidarité dans le Mal et de réversibilité dans le Bien, solidarité en Adam, réversibilité en Notre Seigneur, autrement dit, chacun est, jusqu’à un certain point, responsable des fautes des autres et doit aussi, jusqu’à un certain point, les expier ; et chacun peut aussi, s’il plaît à Dieu, attribuer, dans une certaine mesure, les mérites qu’il possède ou qu’il acquiert à ceux qui n’en ont point ou qui n’en veulent recueillir.
Ces lois, le Tout-Puissant les a promulguées et il les a, le premier, observées, en les appliquant à la Personne de son Fils. Le Père a consenti à ce que le Verbe prît à sa charge et payât la rançon des autres ; il a voulu que ses satisfactions qui ne pouvaient lui servir, puisqu’il était innocent et parfait, profitassent aux mécréants, aux coupables, à tous les pécheurs qu’il venait racheter ; il a voulu qu’il présentât, le premier, l’exemple de la substitution mystique, de la suppléance de Celui qui ne doit rien à celui qui doit tout ; et Jésus, à son tour, veut que certaines âmes héritent de la succession de son sacrifice.
Et, en effet, le Sauveur ne peut plus souffrir par Lui-même, depuis qu’il est remonté près de son Père, dans la liesse azurée des cieux ; sa tâche rédemptrice s’est épuisée avec son sang, ses tortures ont fini avec sa mort. S’il veut encore pâtir, ici-bas, ce ne peut plus être que dans son Église, dans les membres de son corps mystique.
Ces âmes réparatrices qui recommencent les affres du Calvaire, qui se clouent à la place vide de Jésus sur la croix, sont donc, en quelque sorte, des sosies du Fils ; elles répercutent, en un miroir ensanglanté, sa pauvre Face ; elles font plus ; elles seules donnent à ce Dieu tout-puissant quelque chose qui cependant lui manque, la possibilité de souffrir encore pour nous ; elles assouvissent ce désir qui a survécu à son trépas, car il est infini comme l’amour qui l’engendre ; elles dispensent à ce merveilleux Indigent une aumône de larmes ; elles le rétablissent dans la joie qu’il s’est interdite des holocaustes.
Ajoutez, Lydwine, que si ces âmes, qui admettent comme leur Créateur d’être châtiées pour des crimes dont elles sont indemnes, n’existaient pas, il en serait de l’univers de même que de notre pays, sans l’abri des digues. Il serait englouti par la crue des péchés, ainsi que la Hollande par le flux des vagues. Elles sont donc à la fois et les bienfaitrices du Ciel et les bienfaitrices de la terre, ces âmes !
Mais alors, ma fille, quand une âme en est à ce point, sa façon de souffrir change. Dieu rapproche, en quelque sorte, les deux sensations extrêmes de la béatitude et de la douleur et elles s’amalgament. Où est l’une et qu’est-il resté de l’autre ? nul ne le sait ; c’est l’incompréhensible fusion d’un excès et d’une défaillance ; et l’âme éclaterait sous cette pression, si le martyre du corps n’intervenait pour lui permettre de reprendre haleine, afin de se mieux réjouir ; en somme, c’est par les marches de la souffrance que l’on fait l’ascension des joies !
A l’heure actuelle, vos aîtres spirituels sont à vif ; mais comprenez-le, vous souffrez parce que vous ne voulez pas souffrir ; le secret de votre détresse est là. Accueillez-la et offrez-la à Dieu cette douleur qui vous désespère et il l’allégera ! Il la compensera par de telles consolations que le moment viendra où vous vous écrierez : mais je le leurre ! il a contracté avec moi un marché de dupe ; je me suis offerte pour expier par les plus terribles châtiments les forfaits du monde et il m’inonde d’un bonheur sans dimension, d’une allégresse sans mesure ; il m’expatrie, il me dépossède, il me débarrasse de moi-même, car c’est Lui qui rit et qui pleure, c’est Lui qui vit en moi !
Quand nous en serons là, je vous répéterai comme maintenant, ma fille, soyez sans inquiétude, Notre Seigneur sait fort bien qu’il s’est prêté à un marché de dupe, mais il n’aime que ceux-là ! Votre mission est claire ; elle consiste à vous sacrifier pour les autres, à réparer les offenses que vous n’avez pas commises ; elle consiste à pratiquer la charité dans ce qu’elle a de sublime et de vraiment divin.
Dites à Jésus : je veux me placer, moi-même, sur votre croix et je veux que ce soit vous qui enfonciez les clous. Il acceptera ce rôle de bourreau et les Anges lui serviront d’aides ; — eh oui, il vous prendra au mot, votre Sauveur ! — on lui apportera les épines, les tarières, les cordes, l’éponge, le fiel, la lance, mais lorsqu’il vous verra, écartelée sur le gibet, suspendue entre ciel et terre, ainsi qu’il le fut sur le bois, ne pouvant encore vous élancer vers le firmament, mais ne touchant déjà plus au sol, son cœur se fondra de pitié et il n’attendra pas que sa Justice soit satisfaite pour vous descendre. De même que Nicodème et Joseph d’Arimathie, il soutiendra votre tête, alors que la Vierge vous couchera sur ses genoux, mais il n’y aura plus de sanglots, Marie sourira ; Madeleine ne pleurera plus et elle vous embrassera, gaiement, telle qu’une grande sœur !
Les yeux de Lydwine se dessillaient ; elle commençait à comprendre les causes de ses incroyables maladies et elle se soumettait, elle agréait d’avance cette mission que le Rédempteur l’appelait à remplir ; mais comment procéder ?
En accomplissant les prescriptions que je vous ai spécifiées, répondit le prêtre, en méditant sans cesse la Passion du Christ. Il sied de ne pas vous rebuter et parce que vous n’avez point réussi, du premier coup, à vous exproprier de vous-même, de renoncer à un exercice qui vous amènera justement, lorsque vous y serez habituée, à perdre votre propre trace pour suivre celle de l’Époux.
Ne vous imaginez pas, non plus, que votre supplice est plus long, plus aigu que celui de la croix qui fut relativement court et, qu’après tout, bien des martyrs en subirent de plus barbares et de plus continus que Notre Seigneur, quand ils furent roués, grillés, déchiquetés avec des peignes de fer, coiffés de casques rouges, bouillis dans l’huile, sciés en deux ou lentement broyés sous le poids des meules, car rien n’est plus faux ; aucune torture ne se peut comparer à celle de Jésus.
Songez au prélude de la Passion, au jardin de Gethsémani, à cet inexprimable moment où, pour ne pouvoir s’empêcher d’être intégralement géhenné dans son âme et dans son corps, le Verbe arrêta, mit, en quelque sorte, en suspens sa divinité, se spolia loyalement de sa faculté d’être insensible, afin de se mieux ravaler au niveau de sa créature et de son mode de souffrir. En un mot, pendant le drame du Calvaire, l’humanité prédomina chez l’Homme-Dieu et ce fut atroce. Lorsqu’il se sentit tout à coup si faible et qu’il envisagea l’effroyable fardeau d’iniquités qu’il s’agissait de porter, il frémit et tomba sur la face.
Les ténèbres de la nuit s’ouvraient, enveloppaient de leurs pans énormes comme d’un cadre d’ombre, des tableaux éclairés par on ne sait quelles lueurs. Sur un fond de clartés menaçantes, les siècles défilaient un à un, poussant devant eux les idolâtries et les incestes, les sacrilèges et les meurtres, tous les vieux méfaits perpétrés depuis la chute du premier homme — et ils étaient salués, acclamés au passage par les hourras des mauvais anges ! — Jésus excédé baissa les yeux — lorsqu’il les releva, ces fantômes des générations disparues s’étaient évanouis, mais les scélératesses de cette Judée qu’il évangélisait, grouillaient en s’exaspérant, devant Lui. Il vit Judas, il vit Caïphe, il vit Pilate, il vit… saint Pierre ; il vit les effrayantes brutes qui allaient lui cracher au visage et lui ceindre le front de points de sang. La croix se dressait, hagarde, sur les cieux bouleversés et l’on entendait les gémissements des Limbes. Il se remit debout, mais, saisi de vertige, il chancela et chercha un bras pour se soutenir, un appui. — Il était seul.
Alors il se traîna jusqu’à ses disciples qui dormaient, dans la nuit demeurée paisible, au loin, et il les réveilla. Ils le regardèrent, ahuris et craintifs, se demandant si cet homme, aux gestes éperdus et aux yeux navrés, était bien le même que ce Jésus qui s’était transfiguré devant eux sur le Thabor, avec un visage resplendissant et une robe de neige, en feu. Le Seigneur dut sourire de pitié ; il leur reprocha seulement de n’avoir pu veiller, et, après être encore revenu, deux fois, près d’eux, il s’en fut agoniser, sans personne, dans son pauvre coin.
Il s’agenouilla pour prier, mais maintenant, s’il n’était plus question du passé et du présent, il s’agissait de l’avenir qui s’avançait, plus redoutable encore ; les siècles futurs se succédaient, montrant des territoires qui changeaient, des villes qui devenaient autres ; les mers même s’étaient déformées et les continents ne se ressemblaient plus ; seuls, sous des costumes différents, les hommes subsistaient identiques ; ils continuaient de voler et d’assassiner, ils persistaient à crucifier leur Sauveur, pour satisfaire leurs besoins de luxure et leur passion de gain ; dans les décors variés des âges, le Veau d’or s’érigeait, immuable et il régnait. Alors, ivre de douleur, Jésus sua le sang et cria : Père, si vous vouliez détourner de moi ce calice ; puis, il ajouta, résigné, cependant que votre volonté se fasse et pas la mienne !
Eh bien, vous le voyez, ma fille, ces tortures préliminaires surpassent tout ce que votre imagination est capable de concevoir ; elles furent si intenses que la nature humaine du Christ se serait brisée et qu’il ne serait pas arrivé, vivant, sur le Golgotha, si des anges n’étaient venus le consoler ; et cependant le paroxysme de ses souffrances n’était pas atteint ; il ne le fut que sur la croix ; sans doute, son supplice physique fut horrible, mais combien il semble indolore si on le confronte avec l’autre ! car, sur le gibet, ce fut l’assaut de toutes les immondices réunies des temps ; les gémonies du passé, du présent, de l’avenir, se fondirent et se concentrèrent en une sorte d’essence corrosive ignoble et elles l’inondèrent ; ce fut quelque chose comme un charnier des cœurs, comme une peste des âmes qui se ruèrent sur le bois pour l’infecter. — Ah ! ce calice qu’il avait accepté de boire, il empoisonnait l’air ! — Les anges, qui avaient assisté le Seigneur au jardin des Olives, n’intervenaient plus ; ils pleuraient, atterrés, devant cette mort abominable d’un Dieu ; le soleil s’était enfui, la terre bruissait d’épouvante, les rocs terrifiés étaient sur le point de s’ouvrir. Alors Jésus poussa un cri déchirant : Père, pourquoi m’avez-vous abandonné ?
Et il mourut.
Pensez à tout cela, Lydwine, et assurez-vous que vos souffrances sont faibles en face de celles-là ; remémorez-vous les inoubliables scènes du jardin des Olives et du Golgotha, regardez le chef dévasté par les soufflets, le chef ébouriffé d’épines de l’Époux, mettez vos pas dans les empreintes des siens et, à mesure que vous le suivrez, les étapes se feront plus débonnaires, les marches forcées se feront plus douces.
Et le brave homme la quitta, après lui avoir encore promis de revenir. Lydwine fut généreuse ; elle se donna de tout cœur, comme une âme de somme, pour porter le faix des fautes ; mais cette oblation n’amortit aucune de ses peines et ne la libéra point. Quand elle voulut s’arrêter, en méditant, aux haltes des stations, elle tituba, semblable à ces gens dont on a voilé les yeux et qui ne peuvent, aussitôt qu’on les a débarrassés de leur bandeau, marcher droit. La route du Calvaire, elle la quittait, une fois de plus, pour s’égarer dans de petits sentiers qui finissaient par la ramener insensiblement à son point de départ, à ses maux. — Dieu la considérait, silencieux, et il ne bougeait pas. — Naturellement elle s’éperdit, crut que Jan Pot lui avait infligé une tâche inaccessible et elle se madéfia et recommença de pleurer. Elle était prête à sombrer dans le désespoir quand Pâques fleurit sur le cycle liturgique de l’an. Alors le bon Pot amena avec lui Notre-Seigneur sous les espèces du Sacrement et il dit :
— Ma chère fille, jusqu’à ce jour, je vous ai entretenue du martyre de Jésus ; je n’ai plus maintenant qu’à me taire, car c’est Lui-même qui va heurter à la porte de votre cœur et vous parler.
Et il la communia.
Immédiatement son âme craqua et l’amour jaillit en une explosion, fusa en une gerbe de feux qui nimbèrent la suradorable Face qu’elle contemplait, au plus profond de ses aîtres, dans la source même de sa personne ; et folle de douleur et folle de joie, elle ne savait même plus ce qu’était son malheureux corps ; les gémissements que lui arrachaient ses tortures disparaissaient dans l’hosanna de ses cris. Ivre, de l’ébriété divine, elle divaguait, ne se souvenant plus d’elle-même que pour penser à lier précipitamment un bouquet de ses souffrances, afin de les offrir, en souhait de bienvenue, à l’Hôte. Puis ses larmes coulèrent durant deux semaines ; ce fut une pluie d’amour qui détrempa enfin ce sol aride et quasi mort ; le céleste Jardinier épandit à la volée ses semailles et aussitôt les fleurs de la Passion levèrent. Ces méditations sur la mort du Rédempteur, qui l’avaient tant harassée, elle ne pouvait plus s’en lasser ; la vue de l’Époux supplicié la ruait hors d’elle, au-devant de Lui. Ce qu’elle enviait actuellement, ce n’était plus la jubilante santé de ses compagnes, c’était la taciturne tendresse de cette Véronique qui avait été assez heureuse pour essuyer le visage ensanglanté du Christ.
Ah ! être Madeleine, être ce Cyrénéen, cet homme à qui fut réservé cet unique privilège, cette unique gloire dont les plus grands des apôtres même furent privés, d’aider le Délaissé à charrier les péchés du monde, avec sa croix, de venir, lui, simple pécheur, au secours d’un Dieu !
Elle eût voulu être, parmi eux, derrière eux, se rendre utile à quelque chose, en passant aux saintes femmes l’eau, les herbes, le bassin, l’éponge, pour laver les plaies ; elle eût voulu être leur petite servante, leur prêter ses plus humbles services sans même être vue ; il lui paraissait maintenant qu’elle appuyait ses pieds dans les pas du Fils, qu’en souffrant, elle s’emparait une partie de ses douleurs et les lui diminuait d’autant ; et elle convoitait de tout lui ravir, lui reprochait d’en trop garder ; elle se plaignait de l’indolence de ses tortures, de la parcimonie de ses maux !
Et, sans cesse, elle ambula, en pèlerine assidue, sur le chemin du Calvaire. Afin d’imiter le Psalmiste qui priait sept fois par jour, elle se créa, pour son usage, des heures canoniales ; elle divisa la journée en sept parts et le drame de la Passion en autant de parts, et elle semblait avoir une horloge dans l’esprit tant elle était exacte à méditer sur le sujet correspondant à l’heure fixée, sans qu’il y eût jamais une minute d’avance ou une seconde de retard.
Et cependant ses tourments corporels croissaient encore. Ses rages de dents étaient devenues si féroces que sa tête tremblait ; les fièvres la minaient, avec des alternances de chaleurs violentes et de grands froids ; quand ces accès atteignaient leurs degrés extrêmes, elle crachait une eau rougeâtre et tombait dans un tel affaissement qu’il lui était impossible de proférer un seul mot et d’entendre parler les gens ; mais, au lieu de s’abandonner, ainsi que jadis, au désespoir, elle remerciait Dieu d’étancher enfin sa soif de tortures.
On lui demandait quelquefois si elle désirait toujours, comme autrefois, être guérie et elle répondait : non, je ne souhaite plus qu’une chose, c’est de ne pas être dénuée de mes désaises et de mes peines.
Et, bravement, elle fit un pas de plus en avant et interpella le Christ.
L’époque du Carnaval était proche ; pensant au surcroît de péchés qu’engendreraient à Schiedam, les ribotes des jours gras, elle s’écria : Seigneur, vengez-vous sur moi du supplément d’offenses que ces fêtes vous infligent ! — et sa prière fut aussitôt exaucée ; elle éprouva une douleur si vive à la jambe qu’elle se tut et n’en quémanda plus. Elle endura héroïquement ce martyre qui ne cessa qu’au jour de la Résurrection et répéta à ceux dont la pitié se déversait sur elle en plaintes, qu’elle agréerait bien volontiers de subir, pendant quarante ans et plus, de telles souffrances, si elle savait obtenir, en échange, la conversion d’un pécheur ou la délivrance d’une âme du Purgatoire.
Après qu’elle fut entrée dans cette voie de la substitution mystique et qu’elle se fut, de son plein gré, offerte pour être la brebis émissaire des péchés du monde, Jésus jeta son emprise sur elle et elle vécut cette existence extraordinaire où les douleurs servent de tremplin aux joies ; plus elle souffrit et plus elle fut satisfaite et plus elle voulut souffrir ; elle savait qu’elle n’était plus seule maintenant, que ses tortures avaient un but, qu’elles aidaient au bien de l’Église et qu’elles palliaient les exactions des vivants et des morts ; elle savait que c’était pour la gloire de Dieu que le parterre odorant de ses plaies poussait d’humbles et de magnifiques fleurs ; elle pouvait vérifier, par elle-même, la justesse d’une réponse de sainte Félicité, injuriée par les railleries d’un bourreau qui se gaussait de ses cris, lorsqu’elle accoucha dans sa prison, avant que d’être livrée aux animaux féroces lâchés en un cirque.
— Que ferez-vous donc quand vous serez dévorée par les bêtes ? disait cet homme.
Et la sainte répliqua :
— « C’est moi qui souffre maintenant, mais alors que je serai martyrisée, ce sera une autre qui souffrira pour moi, parce que je souffrirai pour Lui. »
Il est très difficile d’analyser cette vie si différente des nôtres qu’entremêlent, la plupart du temps, de modiques tortures et de minimes liesses. Nos exultations sont, en effet, ainsi que nos peines, médiocres ; nous vivons dans un climat tempéré, dans une zone de piété tiède où la flore est rabougrie et la nature débile. Lydwine, elle, avait été arrachée d’une terre inerte pour être transplantée dans le sol ardent de la mystique ; et la sève jusqu’alors engourdie bouillonnait sous le souffle torride de l’Amour, et elle s’épanouissait en d’incessantes éclosions d’impétueuses délices et de furieux tourments.
Elle pantelait, se tordait, crissait des dents ou gisait à moitié morte et elle était ravie, au même instant ; elle ne vivait plus, dans un sens comme dans l’autre, que d’excès ; l’exubérance de sa jubilation compensait l’abus de ses peines ; elle le disait très simplement : « les consolations que je ressens sont proportionnées aux épreuves que j’endure et je les trouve si exquises que je ne les changerais pas pour tous les plaisirs des hommes ».
Et cependant la meute de ses maladies continuait à la dilacérer ; elle fondait sur elle avec une recrudescence de rage ; son ventre avait fini par éclater, ainsi qu’un fruit mûr et il fallait lui appliquer un coussin de laine pour refouler les entrailles et les empêcher de sortir ; bientôt, quand on voulut la bouger, afin de changer les draps de son lit, on dut lui lier solidement les membres avec des serviettes et des nappes car autrement son corps se serait disloqué et scindé en morceaux, entre les mains des assistants.
Par un miracle évidemment destiné à certifier l’origine extra-humaine de ces maux, Lydwine ne mangeait plus ou si peu ! — En trente ans, elle ne goûta pas à plus d’aliments qu’une personne valide n’en ingère d’habitude pendant trois jours.
Durant les premières années de sa réclusion, elle consommait pour tout repas, du matin au soir, une rondelle de pomme de l’épaisseur d’une petite hostie que l’on grillait, au bout d’une pincette, devant l’âtre ; et si elle tentait d’avaler parfois une bouchée de pain, trempée dans de la bière ou du lait, elle n’y parvenait qu’à grand’peine ; puis ce fut trop encore de cet émincé de pomme et elle dut se contenter d’une larme d’eau rougie sucrée, stimulée par un soupçon de cannelle ou de muscade, et d’une miette de datte ; elle en vint ensuite à ne plus se sustenter qu’avec ce vin trempé d’eau ; elle le humait plus qu’elle ne le buvait et en absorbait à peu près une demi-pinte, par semaine. Très souvent, comme l’eau de source était à Schiedam assez chère, on lui donnait, faute d’argent pour en acheter, de l’eau de la Meuse ; elle était, suivant le flux ou le reflux de la mer dans laquelle elle se jette près de la ville, salée ou douce ; mais elle préférait qu’on la puisât, au moment du flux, alors qu’elle était amère et saumâtre, parce qu’elle se changeait alors pour elle en la plus savoureuse des boissons.
Seulement, lorsqu’elle fut réduite à ne plus se soutenir qu’avec ce liquide, le sommeil qui était déjà rare disparut complètement ; et ce furent des nuits qui n’en finissaient plus, des nuits implacables, où elle demeurait, immobile, sur un dos dont le derme était à vif. On a compté qu’elle n’avait pas dormi la valeur de trois bonnes nuits en l’espace de trente-huit ans !
Enfin, elle ne s’ingurgita plus rien du tout ; et une velléité de sommeil qui la tracassa et qui n’était, selon ses historiens, qu’une tentation diabolique, s’enfuit à son tour. Une sorte d’assoupissement l’accablait, en effet, chaque fois qu’elle s’apprêtait à méditer la Passion du Christ ; elle luttait en vain contre cette somnolence.
— Laissez là ces exercices et dormez, lui dit Jan Pot, vous les reprendrez après.
Elle obéit et cet état d’irrésistible torpeur cessa.
Cette disette de nourriture et cette constance d’insomnies lui suscitèrent les plus cruelles humiliations et les plus basses injures. Toute la ville était au courant de ce cas singulier d’une jeune fille qui, sans s’alimenter et dormir, ne mourait point ; le bruit de cette merveille s’était répandu au loin ; elle semblait invraisemblable à beaucoup de gens ; ils ignoraient que de nombreux faits de ce genre avaient été relevés dans les biographies de saints qui furent les prédécesseurs ou les contemporains de Lydwine ; aussi, arrivèrent-ils, attirés par la curiosité, chez elle et elle fut explorée sans relâche et soumise à une inquisition de tous les instants ; et ses détracteurs ne furent point quatre, tels que les amis de Job, ils furent légion ! La plupart ne regardaient que cette tête fendue du front au nez, que ce visage craqué comme une grenade, que ce corps dont les chairs en fuite avaient dû être comprimées, ainsi que celles des momies, par des lacis de bandelettes et le dégoût leur venait de tant d’infirmités !
Leur curiosité était déçue. Ils n’avaient découvert que le masque en pièce d’une gorgone, là où ils s’étaient attendus à rencontrer une face plus ou moins avenante qui aurait pu les émouvoir ou une physionomie plus ou moins bizarre dont ils auraient pu se moquer ; ils ne virent que les apparences, ne distinguèrent aucun foyer de lumière sous les vitres en corne de cette lanterne cassée, rangée dans l’ombre, en un coin ; et cependant l’âme rayonnait, embrasée d’amour, car Jésus l’inondait de ses effusions, la dorait de ses lueurs !
Ils se vengèrent de leur désappointement en l’accusant de supercherie. Elle ne gardait nullement la diète ; elle bâfrait lorsqu’elle était seule et buvait, la nuit. Ils la harcelèrent de questions, préparèrent des amorces, tâchèrent de l’amener à se contredire. A tous ces interrogatoires, elle répondait simplement :
— Je ne vous comprends pas ; vous croyez qu’il est impossible de subsister sans le secours d’aucun mets, mais Dieu est bien maître, je présume, d’agir tel qu’il l’entend ; vous m’affirmez que mes maladies auraient dû me tuer, mais elles ne me tueront que lorsque le Seigneur le voudra. Et elle ajoutait pour ceux qui s’apitoyaient hypocritement sur son sort : « je ne suis pas à plaindre, je suis heureuse ainsi, et s’il me suffisait de réciter un ave Maria pour être guérie, je ne le réciterais pas. »
D’autres allaient plus loin encore et brutalement l’injuriaient, criant : ne vous y trompez pas, ma belle, nous ne sommes point votre dupe ! Vous faites semblant de vivre sans nutriment et vous vous nourrissez en cachette ; vous êtes une chattemite et une fourbe.
Et Lydwine un peu surprise de cet acharnement, leur demandait quel intérêt elle pouvait bien avoir à mentir de la sorte, car enfin, disait-elle, manger n’est pas un péché et ne pas manger n’est point un acte glorieux, que je sache.
Embarrassés par le bon sens de ces répliques, ils changeaient alors le mode de leurs attaques et ils lui reprochaient d’être une possédée ; le Démon était seul capable d’opérer de tels prestiges ; et ces simagrées n’étaient que la conséquence d’un pacte ; rares furent ceux qui ne la crurent ni charlatane, ni sorcière, mais qui comprirent ce qu’elle était en réalité, un être victimal, broyé dans le mortier de Dieu, une lamentable effigie de l’Église souffrante.
Peu à peu, pourtant, la vérité s’imposa. Agacés par ces nouvelles contradictoires, les échevins de Schiedam résolurent d’en avoir le cœur net ; ils assujettirent Lydwine, pendant des mois, à une surveillance incessante et ils durent bien reconnaître qu’elle était une sainte dont l’existence absolument anormale ne pouvait s’expliquer que par un dessein particulier du ciel ; et ils le promulguèrent dans un procès-verbal qu’ils scellèrent du sceau de la cité. Ils se réunirent, en effet, le 12 septembre 1421, pour rédiger ces lettres testimoniales qui relatent les épisodes de cette vie : la privation de toute nourriture et le manque de sommeil, l’état du corps mué en un amas répugnant de bribes et amputé d’une partie de ses entrailles alors que l’autre fourmillait de parasites et répandait cependant une bonne odeur, bref tous les détails que nous avons énumérés ; le procès-verbal est inséré tout au long dans le volume des Bollandistes, en tête de la seconde vie de Brugman.
Il aurait pu constater aussi ce trait, avéré par tous les biographes, que les parents de Lydwine conservaient dans un vase les fragments d’os et les languettes de chairs qui se détachaient des membres de leur fille et que ces débris exhalaient de doux parfums.
Des badauds, qui avaient ouï parler de ce prodige, accoururent pour s’assurer de sa véracité, mais Lydwine, que ces visites incommodaient, supplia sa mère d’enterrer ces pauvres dépouilles et pour ne pas la contrister, Pétronille les inhuma.
Il semblait qu’après cette proclamation du bourgmestre et du municipe de Schiedam, Lydwine pût demeurer tranquille ; sa bonne foi était de notoriété publique ; pourtant, quatre années après, lorsque Philippe de Bourgogne, après avoir envahi les Flandres, laissa un corps d’occupation à Schiedam, le commandant de place, qui était un Français, voulut s’assurer par lui-même si les phénomènes attestés par le manifeste de la ville, étaient exacts. Il prétexta le désir qu’il avait de préserver la sainte d’outrages possibles, pour poster chez elle une troupe de six soldats qu’il choisit parmi les plus honnêtes et les plus religieux ; puis, il écarta la famille qui dut aller camper autre part et il prescrivit à ses subordonnés de se relayer, afin de ne pas perdre de vue la prisonnière, jour et nuit, et d’empêcher qu’il ne lui parvînt aucun breuvage et aucun aliment. Ils exécutèrent cette consigne à la lettre, inspectant même les pots d’onguents pour être certains qu’ils ne contenaient point de substances propres à la réconforter ; une veuve, du nom de Catherine fut, seule, admise à la soigner et elle était fouillée alors qu’elle entrait dans la chambre. Ils montèrent ainsi la garde, autour de son lit, pendant neuf jours.
Ils virent, durant ce temps, Lydwine en proie à d’extravagantes tortures, ruisselant de larmes, mais souriant, perdue dans l’extase, noyée dans la béatitude suressentielle, roulée, comme hors du monde, dans des ondes de joie.
Quant à elle, c’est tout au plus si elle s’aperçut de leur présence ; Dieu la ravissait, loin de son logis, lui épargnait le spectacle gênant de ces hommes dont le regard ne la quittait point. Quand leur faction cessa, ils certifièrent hautement que la captive avait vécu, ainsi que l’on dit, de l’air du temps, sans rien prendre.
Cette surveillance ne servit donc qu’à constater, une fois de plus, l’honnêteté de Lydwine et l’authenticité de l’insolite existence qu’elle souffrait.
Vraiment ce luxe d’investigations était bien inutile ; la défiance d’une petite ville aux aguets, la rage d’espionnage de la province suffisaient pour tirer l’affaire au clair. Lydwine n’eût pu avaler une bouchée de pain sans que tout Schiedam ne le sût ; mais si Dieu consentit à ce que ces faits fussent examinés de près et prouvés, ce fut pour qu’aucun doute ne subsistât et que ses grâces ne fussent point reléguées à l’état d’incertaine légende.
Il est à remarquer, d’ailleurs, qu’il agit presque constamment de la sorte. N’en fut-il pas de même, au XIXe siècle, pour Catherine Emmerich et pour Louise Lateau, deux stigmatisées dont les vies présentent plus d’une analogie avec celle de Lydwine ?
Jusqu’alors, c’était surtout sa mère qui l’avait soignée, mais Pétronille tomba malade, à son tour ; elle était usée par l’âge et les soucis d’une existence toujours en alerte pour joindre, dans son pauvre ménage, les deux bouts. Les fatigues que lui imposèrent les infirmités de Lydwine et le chagrin qu’elle ressentit à la voir inculpée de simulacres et de mensonges et injuriée jusque dans son lit l’achevèrent ; elle se coucha et ne se releva plus ; elle conserva sa connaissance et comprenant qu’elle allait mourir elle trembla ; elle se rappela des coquetteries de jeunesse, des décisions ajournées, des heures oisives ou mal employées ; peut-être se reprocha-t-elle aussi d’avoir trop tarabusté sa fille ; toujours est-il qu’elle lui confessa ses transes et la pria d’obtenir du Sauveur son pardon.
Lydwine qui pleurait, à chaudes larmes, en l’écoutant, la consola de son mieux et lui promit de la gratifier, autant que cela dépendait d’elle, des mérites acquis par ses longues souffrances ; elle y mit cette seule condition que la mourante se résignerait à quitter la vie et s’abandonnerait en toute confiance à l’indulgente tendresse du Juge.
Pétronille, qui savait de quelles prébendes de grâces son enfant était pourvue, se rassura et s’éteignit en paix ; mais Lydwine, persuadée qu’elle ne possédait plus rien, puisqu’elle avait tout cédé à sa mère, se hâta de remédier à son dénuement. Elle vendit les meubles et les nippes dont elle pouvait se passer et en distribua l’argent aux pauvres ; puis elle s’avisa que son lit était trop doux et elle s’en débarrassa au profit de son neveu et de sa nièce qui s’installèrent en qualité de garde-malade, auprès d’elle ; elle commanda ensuite que l’on étendît, sur le sol humide de la chambre, une planche ôtée au flanc d’un tonneau et qu’on la recouvrît de paille ; et cette paille qui bientôt se convertit en un abominable fumier fut désormais sa seule couche ; mais il fallut l’y transporter et, malgré les précautions dont on usa, ce fut horrible. On dut la ficeler pour qu’elle ne se séparât point et, en la soulevant, l’on ne put faire autrement que d’arracher les chairs collées au drap.
Elle estima que ce n’était pas encore assez et elle se procura, afin de râper la peau de ses reins à vif, une ceinture en crins de cheval qu’elle ne retira plus.
Elle avait alors vingt-huit ans ; l’hiver commençait, un hiver si long et si rigoureux que les vieillards ne se souvenaient pas d’en avoir jamais enduré un pareil ; il reçut, par excellence, le nom de grand hiver et, ajoute Thomas A Kempis, dans les fleuves devenus fermes tous les poissons périrent. Or cette saison de frimas, elle la vécut dans une pièce sans jour et sans air, privée de feu, vêtue simplement d’une de ces petites chemises de laine que tissaient pour elle les sœurs du tiers-ordre de saint-François, à Schiedam, et enveloppée d’une mauvaise couverture, alors que ses blessures et son hydropisie la rendaient, plus qu’une autre, sensible au froid.
Elle pleurait, la nuit, des larmes de sang qui se coagulaient sur ses joues et, le matin, il fallait détacher de son visage bleui et comme damassé par le gel, ces stalactites ; quant au reste du corps, il était quasi paralysé et ses pieds étaient si roides qu’on devait les frotter et les enrouler de linges chauds pour les ranimer. Elle continuait cependant de vivre dans cet état pire que la mort ; et il n’y avait presque jamais un sou à la maison ! Les quelques personnes charitables qui l’avaient jusqu’alors aidée ne songeaient plus à la secourir ; elle en était réduite à ne même plus avoir de linge pour panser ses plaies ; elle serait littéralement morte de misère et de froid, si un franciscain du nom de Werembold, originaire de Gouda, qui fut, pendant plusieurs années, le recteur et le confesseur des sœurs tertiaires de sainte-Cécile d’Utrecht et le ministre général du tiers-ordre de saint-François, n’était venu la visiter.
Ils se connaissaient, l’un et l’autre, par une vision qu’ils avaient eue, à la même heure, le même jour, alors que l’on célébrait la fête de l’Annonciation ; et, depuis ce moment, ce religieux, qui était un véritable saint, désirait la voir de ses propres yeux.
Il entreprit, à cet effet, le voyage ; il la trouva dans une telle détresse qu’il fondit en larmes, sans pouvoir parler ; il donna ce qu’il possédait, trente gros de Hollande, afin qu’on lui achetât au moins une paire de draps et, indigné par la dureté de cœur des habitants de Schiedam, il monta en chaire et les vitupéra de telle sorte que plusieurs personnes, dont le zèle pour cette œuvre de miséricorde s’était affaibli, se repentirent.
Et il fit plus que de lui assurer pour quelque temps le nécessaire, le brave Werembold, il paracheva les leçons de Jan Pot et l’aiguilla, à son tour, sur les voies mystiques. Il était un habile stratégiste des combats divins ; il savait combien la souffrance est un puissant engrais pour la flore de l’âme et il admirait l’amoureuse astuce du bienfaisant Tortionnaire qui s’arrangeait toujours de façon à ce que les douleurs dont il ne pouvait différer l’envoi, se changeassent, sans tarder, en liesses ; ce durent être de singuliers colloques que ceux de ces deux élus ; si l’on écoute A Kempis, ils s’entretinrent surtout de leur trépas.
Werembold espérait naître à la vie, après Pâques, mais son interlocutrice le déleurra ; elle lui affirma qu’il attendrait jusqu’à la Pentecôte ; effectivement, il décéda, en l’an 1413, la veille de cette fête, le jour de saint Barnabé. Et il fut, à son tour, prophète, en lui déclarant qu’elle devait se résigner à endurer longtemps encore la lamentable aubaine de ses maux, car il lui en restait autant à supporter qu’elle en avait déjà subis ; et elle lui survécut, en effet, vingt ans.
Elle assista, en état de ravissement, à son agonie. Le jour même où il mourut, les sœurs tertiaires de Schiedam annoncèrent à Lydwine qu’elles partaient pour Utrecht afin d’avoir des nouvelles de Werembold qu’elles savaient être malade ; — hâtez-vous, hâtez-vous, dit-elle ; et hochant la tête, elle leur laissa comprendre qu’elles arriveraient trop tard. — Quand elles atteignirent, le soir, Utrecht, elles purent, en écoutant sonner le glas des obsèques, constater que la sainte ne s’était pas trompée.
Après la mort de Pétronille, son mari, le vieux Pierre, son fils Wilhelm et ses deux enfants Pétronille et Baudouin se relayèrent pour veiller Lydwine ; mais la malechance s’en mêla, maintenant que la mère n’était plus.
Des accidents se succédèrent qui assombrirent encore le pauvre intérieur de la sainte ; son père déclinait à vue d’œil ; pendant ce grand hiver, il avait eu le gros orteil du pied droit gelé et il avait dû renoncer à son emploi de veilleur de nuit ; ce fut alors une reprise de misère noire. Il ne voulut pas, par délicatesse, mordre aux quelques aumônes que recevait sa fille et il ne vécut plus que de débris et de rogatons.
Sur ces entrefaites, le duc Wilhelm VI, comte de Hollande, de passage à Schiedam, avec sa femme la comtesse Marguerite et plusieurs personnes de la Cour, entendit parler de la misère du père de la sainte. Il en eut compassion et dit au vieillard :
— Combien vous faut-il pour vivre ici ? Fixez la somme et, en considération des vertus de votre fille, je vous la paierai.
Pierre assura le comte que douze écus à la couronne, monnaie de France, suffiraient largement, par année, à ses besoins.
Wilhelm les lui versa aussitôt ; jugeant ensuite que ces souhaits étaient trop modestes, il s’engagea à doubler, si cela devenait nécessaire, cette rente. Elle fut d’abord fidèlement acquittée, puis comme, chez les gens riches surtout, la générosité très aisément se lasse, le brave homme finit par ne plus rien toucher et il ne se crut pas le droit de réclamer.
En attendant, tandis qu’il profitait de ces courtes aises, il voulut contenter ce désir qu’il n’avait jamais pu réaliser, faute de temps, fréquenter assidûment les églises ; mais il était presque aveugle et si faible des jambes qu’un rien le faisait trébucher ; aussi, quand il était sorti, Lydwine se mourait-elle d’inquiétude ; et elle ne s’alarmait pas à tort, car on le ramassa, un jour, presque asphyxié.
C’était une veille de Pentecôte ; Pierre avait quitté la maison pour aller ouïr les vêpres, quand il rencontra un homme qui lui proposa de se promener hors de la ville jusqu’à l’heure de l’office. Il accepta et ils arrivèrent, tout en devisant, à un lieu nommé Damlaën. Là, tandis que, fatigué, il s’arrêtait, son compagnon se rua sur lui et l’empoignant par les reins, le précipita dans une fosse profonde, pleine d’eau et disparut. Il était en train de se noyer quand un charretier qui longeait la route l’aperçut, le hissa du bourbier et le ramena, dans sa voiture, chez sa fille.
Celle-ci le pensait mort et pleurait, car quelqu’un qui avait entrevu le vieillard, allongé, sans mouvement, dans la carriole, était venu la prévenir en hâte qu’on lui rapportait le cadavre de son père.
Cette aventure, à laquelle les biographes assignent une origine diabolique, consterna la sainte qui s’ingénia désormais à retenir le vieux Pierre à la maison ; mais devenu un peu, tel qu’un enfant, il s’échappait dès qu’il ne se sentait plus surveillé et comme il ne s’éloignait du logis que pour gagner l’église, sa fille n’avait pas le courage de le réprimander.
En somme, il fut pour elle beaucoup plus une cause de soucis qu’un aide ; et son fils Wilhelm ne semble pas, malgré toute sa bonne volonté, avoir été plus apte que lui à la soigner.
Celui-là manqua de la griller vive ; un matin, avant de se rendre à son travail, il pénétra dans la chambre pour s’assurer de l’état de sa santé et il posa la chandelle qu’il tenait allumée sur une planche placée au-dessus de la tête de sa sœur ; puis, il partit, la laissant seule dans la maison, car le père était, de son côté, sorti pour aller assister à une messe ; or, la chandelle culbuta et mit le feu à la paille sur laquelle Lydwine était couchée ; elle méditait la Passion de notre-Seigneur et ne s’en aperçut pas tout d’abord ; mais les pétillements des brindilles qui se tordaient, la tirèrent de son ravissement et, de l’unique main qu’elle avait libre, de la main gauche, elle étreignit les flammes qui, sans la brûler, s’éteignirent. Lorsque son père revint, elle gisait non plus sur une botte de paille, mais sur un tas de cendres.
Ce frère, si imprudent, nous apparaît ainsi qu’un excellent homme, dévoué à sa sœur, mais malheureusement uni à une femme sottisière et méchante qui se croyait probablement, à cause des services que ses enfants prêtaient à Lydwine, tout permis ; la sainte endurait, sans jamais se plaindre, les intarissables bavardages et les ineptes remarques de cette mégère qui ne pouvait ouvrir la bouche sans vociférer et s’exacerbait, à mesure qu’elle hurlait, sans que l’on sût jamais bien pourquoi.
Mais si Lydwine acquiesçait docilement à ce genre d’épreuves, d’autres se résignaient plus difficilement à les accepter, témoin le duc de Bavière qui descendit à Schiedam pour consulter la sainte sur un cas de conscience. Les crimes dont il était coupable et l’apostasie qu’il avait commise en se dépouillant de sa robe d’évêque pour se marier, le tourmentaient sans doute.
Il se fit annoncer sous un nom d’emprunt, mais Lydwine, divinement avertie, ne fut point dupe.
Il était à peine assis auprès d’elle, quand la teigne entra et l’étourdit de ses réflexions saugrenues et de ses cris.
Il s’agaça et s’adressant à Lydwine : Comment, dit-il, pouvez-vous supporter cette harpie ? car lorsqu’elle est là, le séjour de votre maison n’est plus tolérable.
Et la sainte lui répondit en souriant : Monseigneur, que voulez-vous, il sied de souffrir les impertinences et les faiblesses de cette sorte de personnes, ne fût-ce que pour les corriger à force de patience et s’apprendre à soi-même à ne point s’irriter.
En homme pratique, le duc imagina une autre solution ; il acheta, séance tenante, le silence de la créature qui, enchantée d’empocher une somme d’argent, se tut… tant qu’il fut là.
Les garde-malades de Lydwine n’étaient pas en somme, propres à grand’chose ; le père était plus encombrant qu’utile ; le frère, occupé au dehors ; sa femme insupportable ; restaient les deux enfants, Baudouin et Pétronille qui, heureusement, ne ressemblaient pas à leur mère et étaient très attachés à leur tante ; mais ils étaient trop jeunes et d’ailleurs, étant donné la nature des infirmités de la malade, elles ne pouvaient être décemment soignées que par des femmes. Dieu y veilla.
Des voisines pieuses se chargèrent de panser et de changer de linge son pauvre corps ; parmi celles-là figure une femme qui fut l’amie intime de Lydwine et que l’on apercevra souvent dans ce récit.
Qu’était cette Catherine Simon que nous avons déjà rencontrée auprès de Lydwine, alors que celle-ci était gardée à vue par six soldats, et qui finit par habiter tout à fait avec elle ?
Gerlac l’appelle Catherine, femme de maître Simon, le barbier ; Brugman parle, à diverses reprises, d’une Catherine qu’il qualifie tantôt de servante, tantôt de veuve, tantôt de compagne fidèle de la sainte ; Thomas A Kempis désigne Catherine Simon telle qu’une femme de qualité, et il la dit non épouse ou veuve mais fille d’un sieur Simon dont il n’indique pas la profession.
Y a-t-il identité entre ces Catherine et ces Simon ? on peut l’admettre, encore que l’un des traducteurs d’A Kempis distingue deux Catherine différentes, l’une fille de Simon et l’autre veuve d’on ne sait qui.
Il est, en tout cas, certain que cette femme aima et soigna Lydwine comme sa propre fille ; elle la dédommagea des incroyables opprobres et du haineux abandon dont elle fut, de la part du curé de Schiedam, la plaintive victime ; l’homme aux chapons ne devait pas, en effet, tarder à persécuter de la façon la plus atroce, la sainte.
Avant de narrer les déplorables manigances de cet homme, il est bon de répéter, une fois de plus, à propos de ce curé et des autres pénibles prêtres que nous trouverons mêlés à la vie de Lydwine, que l’Église voguait alors à la dérive ; les papes se livraient à des pugilats de bulles ; les monastères pourrissaient sur pied, les hérésies faisaient rage ; l’Europe se dissolvait ; il n’y avait pas de raison pour que la Hollande, d’abord régie par un prince coupable d’un meurtre, puis par l’héroïque farceuse qu’était sa fille, la comtesse Jacqueline, fût, plus qu’un autre pays, épargnée par le Démon ; les avaries d’âme de ses réguliers et de ses séculiers n’ont donc rien qui doive surprendre.
On peut ajouter que Lydwine était singulièrement façonnée aux outrages et acclimatée aux peines ; elle semblait douée du funeste privilège d’attirer chez elle les scélérats et les fous ; d’aucuns venaient la visiter sans motifs, qui la dévisageaient insolemment et ne partaient qu’après l’avoir abreuvée d’injures ; une fois, une énergumène qui l’avait invectivée, s’affola devant son silence et son calme et lui cracha au visage ; il fallut, celle-là, la jeter dehors ; et Lydwine lui envoya un petit présent, en disant à la personne qu’elle chargeait de cette commission :
— Cette chère sœur m’a rendu un grand service, car elle m’a aidé à m’épurer ; c’est moins un cadeau que le paiement d’une dette que je vous serai obligée de lui porter.
Son humilité et sa patience ne se démentaient pas ; elle tolérait les grossièretés de sa belle-sœur et les sévices des intrus, sans broncher ; elle considérait pendant ce temps, Notre Seigneur, couvert de crachats et martelé de coups, et elle le remerciait de lui laisser ramasser les miettes de son supplice. Étendue, telle que Job sur son fumier, elle ne discutait plus comme le Patriarche mais sortait hors d’elle-même et s’en allait rôder sur le chemin du Calvaire ; elle aimait les humiliations, ainsi que d’autres aiment les honneurs ; le révulsif des avanies n’agissait plus ; il devenait nécessaire qu’elle endurât de plus sérieuses abominations que celles qu’elle avait jusqu’alors subies, pour se remettre vraiment à souffrir.
Ce fut Dom André qui s’acquitta de cette tâche.
Lydwine, nous l’avons dit, ne s’approchait des Sacrements qu’à de rares intervalles, durant les premiers temps de ses maladies ; mais, après que ses infirmités se furent accrues, elle éprouva la nécessité de recevoir le corps du Sauveur plus souvent et elle demanda la permission de communier aux principales fêtes de l’année. Le curé de Schiedam, qui était alors un ecclésiastique ou un moine dont nous ignorons le nom, y consentit ; mais bientôt, il disparut, — l’histoire ne nous raconte pas comment — et ce fut le prémontré Dom André qui lui succéda.
Aussitôt qu’il eut pris possession de la cure, Lydwine le pria de la traiter de même que son prédécesseur, mais il la rabroua.
Elle revint à la charge, lui fit remarquer que sa situation était exceptionnelle, qu’elle était l’immolée par procuration d’autrui, que la priver de l’Eucharistie, c’était la priver de toute consolation et de tout secours. Il persista plus brutalement encore dans son refus ; alors, elle put savourer l’amertume de cette vérité que formula, pour les âmes réparatrices, bien longtemps après elle, sa dernière descendante, l’une des stigmatisées du XIXe siècle, la visitandine Marie Putigny, de Metz : « désirer la communion, c’est appeler sur soi la souffrance. »
Ce déni la crucifia et elle pleura toutes ses larmes, sans parvenir à émouvoir cet homme ; elle finit par taire son chagrin, mais — ses garde-malades l’observèrent — lorsqu’une cloche de l’église annonçait le moment de l’élévation à la messe ou qu’une clochette tintait pour prévenir du passage du Viatique, dans la rue, elle se dressait, ardente, sur sa couche, puis retombait et semblait prête à expirer.
Des amis s’entremirent à l’occasion d’une fête solennelle, mais ils n’obtinrent aucun succès ; le curé ne daigna d’ailleurs leur fournir aucune explication ; la vérité est qu’il se butait, qu’il devenait, de jours en jours, plus hostile ; comme il lui fallait bien s’imaginer pour lui-même des excuses à sa conduite, il tâchait de se persuader que Lydwine était une affidée du Démon ; sous prétexte de démasquer ses fraudes et mu, sans doute aussi, par la pensée d’orgueil qu’il allait se montrer plus perspicace que ses confrères, il résolut d’employer un subterfuge qui confondrait Lydwine, en prouvant qu’elle était déshéritée de ce don de voyance des choses cachées que les personnes, un peu au courant de sa vie, lui attribuaient.
En conséquence, il parut s’adoucir et, la veille de la Nativité de Notre-Dame, il confessa la sainte et promit de lui apporter les saintes Espèces, le lendemain.
Elle demeura triste, car un ange lui dit aussitôt : un nouvel orage se prépare ; ce curé te donnera un pain non consacré ; Dieu veut que je te prévienne, afin que tu ne sois pas trompée.
Il arriva donc le lendemain et, devant un certain nombre des amis de Lydwine, il leva l’hostie de la custode et la fit sacrilègement adorer ; puis il communia la malade qui, prise d’un haut de cœur, rejeta l’oublie.
Dom André feignit l’indignation et cria : comment, misérable folle, vous osez vomir le corps de Notre-Seigneur !
— Il m’est aisé de distinguer le corps de Jésus d’un simple azyme, répondit Lydwine. Si cette hostie avait été consacrée, je l’aurais avalée sans la moindre difficulté, mais celle-là ne l’est pas ; toute ma nature s’oppose à ce que je la consomme et, bon gré, mal gré, il faut que je la rende.
Le curé blêmit, mais il paya d’audace, jura que le Rédempteur était bien célé sous ces Apparences et, pour en imposer aux assistants, il voulut retransférer solennellement l’hostie dans son église.
A la suite de cette aventure, Lydwine vécut navrée. Où était donc alors le docte et le pieux Jan Pot ? avait-il quitté Schiedam, à la suite de démêlés avec ce curé ; occupait-il un poste d’aumônier ou de vicaire dans une autre ville ; était-il mort ? les biographes se taisent. — Toujours est-il que ce prêtre, qui eût pu adjuver la malade et même la communier, n’était pas là. — Il avait servi de passerelle entre la sainte et Dieu, sa mission était sans doute terminée et, s’il était encore de ce monde, le Seigneur l’employait probablement à d’autres besognes ; — mais la pauvre Lydwine, dénuée de son assistance, pleura nuit et jour. Elle se retenait pour ne pas sombrer dans le désespoir quand subitement Jésus intervint.
Un jour que, ruminant ses infortunes, elle gémissait, accablée, sur son lit, un ange parut et lui dit :
— Ne pleurez plus, ma sœur, vous allez être consolée de vos peines ; le Bien-aimé est proche, vous le verrez de vos propres yeux.
Elle crut de son devoir de prévenir Dom André, afin qu’il n’imputât point à une menée démoniale la faveur qu’elle s’apprêtait, en priant, à recevoir. Il haussa les épaules et lui rit au nez.
Lorsque tomba le soir, une telle lumière illumina sa chambre que ses parents qui devisaient dans une autre pièce, s’élancèrent chez elle, pensant que le feu se déclarait.
— Soyez en paix, fit-elle, il n’y a point de feu ici et, par conséquent, nul danger d’incendie, laissez-moi seule et ayez bien soin de fermer la porte.
Il était alors entre huit et neuf heures ; dès que ses proches furent sortis, son âme s’appela, se concentra au fond d’elle-même et Dieu l’imbiba jusqu’aux plus secrètes de ses fibres ; ses souffrances l’avaient quittée, ses chagrins n’étaient plus ; son âme s’agenouilla dans sa loque couchée et tendit éperdûment les bras vers l’Époux ; mais ses yeux qu’elle avait fermés s’ouvrirent ; une étoile scintillait au-dessus de son lit et près d’elle, resplendissait, dans sa tunique de feux pâles, son ange.
Il la toucha légèrement et pour quelques instants, ses plaies disparurent ; l’embonpoint et les couleurs de la santé revinrent ; une Lydwine oubliée, une Lydwine perdue, une Lydwine bien portante et fraîche, toute jeune, jaillit de cette chrysalide verdâtre, striée, sur sa paille pourrie, de raies de sang.
Et les anges entrèrent. Ils tenaient les instruments de la Passion, la croix, les clous, le marteau, la lance, la colonne, les épines et le fouet ; un à un, ils se rangeaient, en demi-cercle dans la chambre, ménageant un espace libre autour du lit.
Ils flambaient, revêtus de draperies de flammes bordées d’orfroi en ignition et les bluettes de fabuleuses gemmes couraient sur le feu mouvant des robes ; et, soudain, tous s’inclinèrent ; la Vierge s’avançait, accompagnée d’une suite magnifique de saints, auréolés de nimbes d’or en fusion, enveloppés d’étoffes fluides de neige et de pourpre. Marie, habillée très simplement de flammes blanches, portait dans les tresses incandescentes de ses cheveux des pierreries dont les braises inconnues aux joyaux de la terre, brûlaient en d’éblouissantes lueurs. Toute autre que Lydwine n’eût pu en tolérer le dévorant éclat. Et la Vierge souriait tandis que l’Enfant Jésus arrivait à son tour et s’asseyait sur le bord du lit et parlait tendrement à Lydwine.
Du coup, foulée par l’excès de la joie, l’âme de la sainte se liquéfia ; mais l’Enfant étendit les bras et se transforma en homme ; le visage s’éteignit et se décharna ; les joues se creusèrent de rainures livides et les yeux ensanglantés fuirent ; la couronne d’épines se hérissa sur le front et des perles rouges coulèrent des pointes ; les pieds et les mains se trouèrent ; un halo bleuâtre cerna la marque enfiévrée des plaies et, près du cœur, les lèvres d’une ouverture à vif battirent ; le Calvaire succédait sans transition à l’étable de Bethléem, Jésus crucifié se substituait d’emblée à Jésus Enfant.
Lydwine béait, ravie et navrée ; ravie d’être enfin en présence du Bien-aimé, navrée qu’il fût supplicié de la sorte ; et elle riait et pleurait à la fois, quand les blessures du Christ dardèrent sur elle des rayons lumineux qui lui transpercèrent les pieds, les mains et le cœur.
A la vue de ces stigmates, elle gémit, pensant aussitôt que les hommes concevraient une meilleure idée d’elle et lui témoigneraient plus de déférence et elle cria : « Seigneur, mon Dieu, je vous en supplie, ôtez ces signes, que cela reste entre vous et moi, votre grâce me suffit ! »
« Chose merveilleuse, dit Michel d’Esne, l’évêque de Tournai, tout aussitôt une petite peau couvrit ces plaies, mais la douleur et meurtrissure ou couleur de plomb demeura. » Et, en effet, suivant son désir, la souffrance de ces empreintes divines subsista jusqu’à la fin de sa vie.
Alors, la Vierge prit respectueusement des mains des anges les instruments de la Passion et Elle les lui fit baiser les uns après les autres, et à mesure que sa bouche les avait touchés, ils disparaissaient ; puis Jésus changea encore, redevint enfant, mais il était toujours cloué sur une croix dont la stature avait diminué avec la sienne. Lydwine défaillait de douleur, mais l’Enfant écartelé sourit ; transportée, elle clama : je vous remercie, mon Sauveur, d’avoir daigné visiter votre pauvre servante !
Son père, aux écoutes dans la pièce voisine, fut curieux de savoir à qui elle parlait et il s’approcha, à pas de loups, de la porte. Alors, la Lydwine, jeune et jolie, se replia dans sa chrysalide d’horreur ; les corps glorieux de la Vierge et des anges s’évanouirent, Jésus s’éleva et il commençait à devenir invisible, quand, affligée de son départ, la sainte s’écria :
— Seigneur, si vous êtes réellement Celui que je crois, prouvez-moi, avant de me quitter, que je ne suis pas le jouet d’une illusion ; ne m’abandonnez pas, sans me laisser un indice certain que c’est bien Vous et non un autre qui êtes là !
A ces mots, Jésus revêtit une nouvelle forme et Lydwine aperçut, planant au-dessus de sa tête, une hostie, pendant qu’au même instant une nappe blanche descendait sur son grabat ; l’hostie doucement s’y plaça.
Cependant le vieux Pierre, qui continuait à écouter à la porte sans rien comprendre à ce qui se passait, finit par entrer et s’assit sur le bord de la couche.
— Agenouillez-vous, père, dit-elle, car mon Seigneur Jésus crucifié est là.
Stupéfié le père s’agenouilla et vit, en effet, l’hostie. Il courut chercher ses enfants et Marguerite, Agathe et Wivina, femmes de bien, ses voisines, qui furent saisis de surprise et de peur, en considérant le corps du Christ ainsi tombé du ciel. Tous discernaient une oublie pareille, un peu plus petite que celle dont se sert le prêtre et un peu plus grande que celles réservées aux fidèles ; tous reconnaissaient que sa circonférence était bordée de rais lumineux et qu’au centre se dessinait l’image d’un enfant crucifié qui avait près du cœur une goutte de sang de la grosseur d’un petit pois et des plaies saignantes aux pieds et aux mains ; mais certains détails n’étaient perceptibles que pour quelques-uns ; ainsi, le vieux Pierre et son fils Wilhelm distinguaient cinq blessures et des voisines n’en découvraient que quatre. L’une d’elles, Catherine Simon, remarquait — et ses compagnes, pas — que le sang fluait par l’ouverture du côté et du pied droit, tandis qu’il semblait figé sur les autres points ; enfin, pour la sainte, la céleste oblate se tenait un peu en l’air, alors que pour les assistants, elle reposait, sur la nappe du lit, à plat.
Bien que la nuit fût déjà avancée, Wilhelm alla réveiller le curé, afin qu’il pût examiner de ses propres yeux cette merveille. Il arriva, les mains sales, dit Gerlac, et s’adressant d’un ton rogue à Lydwine :
— Pourquoi vous permettez-vous de me déranger, à cette heure ?
— Mais ne voyez-vous pas ce miracle ? répondit-elle, en montrant l’hostie.
— Je ne vois qu’une imposture du Démon ! s’écria-t-il.
Elle l’assura du contraire.
Il regarda l’apparence de ce pain de très près et y surprenant, comme les personnes présentes, un corps ensanglanté, il demeura pantois ; puis, il recouvra son assurance, ordonna à tout le monde de sortir, ferma la porte et tourmenta Lydwine, l’adjurant, par le jugement de Dieu, de ne jamais parler de ce prodige.
Il pressa sur elle pour lui arracher un serment ; elle refusa et cependant jusqu’au jour où elle fut interrogée par l’Ordinaire, elle se tut.
Le refus de la sainte l’exaspéra.
— En fin de compte, s’exclama-t-il, que prétendez-vous faire de cette hostie ?
Cette question embarrassa Lydwine. Si je la lui remets, pensa-t-elle, il est capable d’en mésuser ; si je la garde, Jésus la quittera sans doute ; elle réfléchissait, quand une inspiration subite la décida.
— Je vous prie de me communier avec, dit-elle.
— Comment, vous demandez à être communiée avec le Diable !
— Non, fit-elle doucement ; ce n’est pas Satan, mais bien mon Seigneur Jésus qui est caché sous l’aspect de ce pain que je vous supplie de me donner.
— Si vous tenez absolument à recevoir le Sacrement, j’irai chercher une hostie dans le tabernacle de l’église, car j’ignore d’où vient celle-ci et, une fois de plus, je vous conseille de ne pas vous y fier.
A la fin, comprenant qu’elle ne céderait pas, il la lui inséra dans la bouche, en murmurant : acceptez donc cette fraude du Démon et pas autre chose ; cependant qu’elle opère en vous selon votre foi. Lydwine l’avala sans peine et, comme les autres oublies consacrées, elle s’infondit en son âme et l’enflamma.
Dom André la laissa, perdue dans l’extase, et retourna, irrité et inquiet, chez lui.
Le lendemain qui était la veille de la fête de saint Thomas, il délibéra avec lui-même sur cette aventure et, craignant qu’elle ne s’ébruitât dans la ville, il résolut de la devancer ; quand les fidèles furent réunis à l’église, il monta en chaire et dit :
— « Mes très chers frères, Lydwine, la fille de Pierre, dont l’intelligence est affaiblie par les maladies, a été leurrée, la nuit dernière, par le Malin ; la tentation dont elle a été la victime fut, à la fois, savante et périlleuse ; je vous demande donc de prier pour elle et de réciter notamment, à son intention, un Pater noster. » Puis il ôta du tabernacle le Saint-Ciboire, bénit les ouailles, et partit pour aller communier Lydwine, suivi de cette foule dont il avait si bêtement éveillé la curiosité.
Au moment de pénétrer dans la maison de la sainte, il se tourna vers les assistants dont le nombre s’était encore grossi pendant la route.
— Sachez, fit-il, que l’Esprit du Mal s’est insinué dans ce logis. Il a déposé chez Lydwine, en lui assurant qu’il contenait le corps du Sauveur, un azyme vide, une simple rondelle de pâte de froment ; voilà ce que je puis vous affirmer et je veux être brûlé vif, si je mens ; mais si cette hostie est une fiction, celle que je lui apporte n’en est pas une. Jésus-Christ y est présent car elle a été transsubstantiée par le magistère du prêtre. Si donc l’un de vous cause de ce qui se passa, la nuit dernière, dans cette demeure, qu’il attribue ces actes à la malice du Déchu qui, pour mieux tromper, se transforme parfois en ange de lumière ; c’est, afin de fortifier cette malheureuse et de la mettre mieux à même de résister à ses illusions, que je lui concède la sainte Eucharistie ; priez donc charitablement pour elle.
Cela dit, il salua les fidèles et s’introduisit, tête haute, chez la malade.
Lydwine avait tout entendu ; elle accueillit Dom André avec sa douceur habituelle mais elle s’exclama :
— O mon père, vous n’avez pas exactement raconté les faits ; non, je n’ai pas été séduite par un piège du Maudit ; et qui le sait mieux que vous, puisque je vous ai averti d’avance que Dieu me préparait cette grâce ? n’avez-vous pas constaté aussi que j’ai absorbé cette hostie sans aucune peine, alors que la moindre parcelle de pain à chanter m’eût étouffée ? enfin, n’êtes-vous pas mon confesseur, celui pour lequel je n’ai rien de secret ; me considérez-vous donc ainsi qu’une fille de perdition ?
Elle se tut, puis elle reprit :
— J’invoquerai néanmoins le Seigneur pour qu’il ne vous impute pas à péché cette conduite.
Il blêmit de rage. Ah çà ! cria-t-il, faut-il, oui ou non, que je vous communie ?
Elle répondit : qu’il soit fait selon votre volonté.
Et il la communia.
Mais, tandis que cet étrange sacerdote se flattait de s’être tiré d’un mauvais pas, en persuadant à ses paroissiens qu’il avait miséricordieusement agi en secourant une possédée, les amis de Lydwine ne se gênèrent pas pour narrer à qui voulut l’entendre le miracle dont ils avaient été les témoins. Ils étaient gens raisonnables et pieux et on les jugeait incapables de mentir ; ce fut dans Schiedam un tolle général contre ce curé dont la malhonnêteté n’était d’ailleurs que trop connue ; et celui-ci, tremblant devant cette multitude ameutée à sa porte, se réfugia dans l’église ; là, il se sentait couvert par l’immunité ecclésiastique ; les magistrats, effrayés de ce mouvement populaire, s’empressèrent de l’y joindre.
— Voyons, dirent-ils, soyez franc, confessez-nous la vérité, afin que nous puissions apaiser les colères qui grondent contre vous.
— Mais, répliqua-t-il, la vérité, je l’ai proclamée, ce matin, lorsque j’ai annoncé aux fidèles que la soi-disant faveur dont se targuait Lydwine, n’était qu’un mensonge et une exécrable tentation ; je n’ai rien à ajouter de plus.
— Bien, demanda l’un des échevins, mais où est l’hostie ?
Il n’osa avouer qu’il l’avait, en la croyant maléficiée, baillée à la sainte et il répondit : Je ne l’ai plus.
— Ah ! et qu’en avez-vous fait ?
Il mentit une fois de plus en déclarant qu’il l’avait consumée.
— Où, dans quel endroit ? montrez les cendres que nous les examinions.
Dom André refusa ; et ne pouvant plus rien en obtenir, les magistrats se retirèrent.
Cependant, comme le tumulte allait croissant et que la fureur du peuple devenait de plus en plus menaçante, ils retournèrent, une seconde fois, à l’église et recommencèrent leur interrogatoire. Ce curé, déconcerté, se coupa ; harcelé de questions, il répondit qu’il s’était débarrassé de l’oublie diabolisée en la noyant.
Ils le serrèrent de près, voulurent connaître la place, le récipient dans lequel il l’avait immergée.
Et, affolé, perdant la tête, il balbutia : Je l’ai enfouie dans un cloaque, afin d’empêcher que le peuple ne se rendît coupable, à cause d’elle, du crime d’idolâtrie.
Quand la foule apprit qu’il avait enterré dans un cloaque une hostie réputée miraculeuse par des gens dignes de foi, elle tempêta et s’apprêta à écharper ce mauvais prêtre, dès qu’il s’échapperait de son refuge.
Les échevins, de plus en plus inquiets de la tournure que prenaient les événements, revinrent, une troisième fois, auprès du curé et l’adjurèrent de ne pas continuer à les berner par des mensonges.
— Réfléchissez, lui dirent-ils, et songez que l’indignation contre vous est telle que nous ne saurions, si vous vous écartiez de cet asile, garantir votre vie.
Dom André baissa le nez, mais il fut impossible de lui extirper un mot.
Alors, les magistrats, après s’être concertés, se déterminèrent à recourir à l’évêque et ils lui dépêchèrent un messager pour l’inciter à venir à Schiedam, afin d’y rétablir l’ordre.
Le ciel, de son côté, avait prévenu par un songe Mgr. Mathias, chorévêque d’Utrecht, duquel dépendait la paroisse de Schiedam, que sa présence y était nécessaire. Il partit, en toute hâte, accompagné de ses grands vicaires et des juges de l’Official. Le curé l’apprit et le peu d’assurance qui lui restait s’effondra. Il envoya, craignant de sortir de l’église, un ami auprès de Lydwine pour l’objurguer d’avoir pitié de lui.
Je reconnais mes torts, convenait-il, mais votre charité me rassure ; veuillez, je vous prie, ne pas me charger devant le tribunal, mais, au contraire, atténuer autant que possible l’importance des griefs qui sont articulés contre moi ; je ne vous le dissimule pas, sans vous je suis perdu.
La bonne Lydwine promit, à condition, bien entendu, de ne pas altérer la vérité, d’alléger le poids des accusations et, dans tous les cas, de demander au prélat de ne point sévir.
L’évêque et sa suite arrivèrent, en effet, chez la sainte, amenant avec eux le curé qui pleurait ; le miracle fut l’objet d’un examen canonique ; puis les témoins à charge de Dom André furent entendus ; lorsque vint le tour de Lydwine, elle manifesta le désir que, par respect pour le caractère sacerdotal dont l’inculpé était revêtu, l’on intimât l’ordre aux laïques de se retirer. L’on acquiesça à sa requête ; mais avant de répondre aux questions précises qu’on lui posait, elle dit :
— Monseigneur l’évêque, j’implore de votre Grandeur deux grâces.
— Parlez, ma fille, répondit Mgr. Mathias, parlez avec confiance, je vous accorderai tout ce qui ne lésera pas l’esprit de justice.
— Je sollicite donc, d’abord, fit-elle, la liberté de m’exprimer ; mon pasteur m’a, en quelque sorte, liée malgré moi par une promesse que je ne crois pas pouvoir enfreindre sans votre permission ; je vous supplie ensuite d’user d’indulgence envers lui, en ne le frappant, ni dans sa personne, ni dans ses biens.
L’évêque la délia d’un serment qu’elle n’avait d’ailleurs pas prêté et il lui promit que, sur le second point, il tiendrait compte de sa recommandation.
Alors elle relata, par le menu, le miracle du Sacrement ; la vue de l’hostie, descendue sur ma couche, a fait naître en moi, dit-elle, l’attrait de la consommer ; aussi ai-je réclamé de Dom André qu’il me communiât avec. Il y a consenti, mais s’il a péché en cela, par trop grande complaisance, c’est ma faute ; moi seule suis coupable ; et c’est très équitablement, Monseigneur, que je vous conjure, pour l’amour de Dieu, de l’épargner.
Quelle fut, au juste, la sentence rendue par l’Official ? Les biographes nous racontent qu’il n’y en eut pas, mais que l’évêque consacra, pour le service de l’autel, la nappe sur laquelle s’était posée l’hostie ; et ils terminent cette histoire par des apostrophes laudatives, félicitant Lydwine de s’être aussi exorablement conduite envers un religieux qu’ils qualifient d’homme plus dur que Nabal et plus cruel que la Lamia.
Ce qui est certain par exemple, c’est que ce triste moine ne fut pas renvoyé dans son couvent ; il demeura curé à Schiedam et dispensa désormais, sans trop rechigner, l’Eucharistie à Lydwine ; mais il le fit sans doute beaucoup plus par crainte de se susciter de nouveaux ennuis que par devoir, car il ne s’amenda guère et ne devint ni moins goinfre, ni plus charitable pour les pauvres, qu’avant. Il finit très mal, d’ailleurs.
Au moment où la peste éclata à Schiedam, Lydwine qui en fut, ainsi que nous l’avons noté plus haut, atteinte, pria le curé de lui apporter le Viatique. Il vint, en tremblant, car il appréhendait la mort et, de peur de la contagion, il fermait la bouche et se tamponnait le nez.
Lydwine s’en aperçut et lui dit
— Soyez tranquille, mon père, mon mal n’est pas de ceux qui se communiquent par l’odorat ou par le goût ; il n’est pas d’origine humaine, du reste.
Dom André, confus, se tut ; puis feignant un courage qu’il n’avait point, il s’écria : Plaise au ciel, Lydwine, que je vive assez pour assister à votre trépas !
— Vous n’y assisterez point, répliqua gravement la sainte ; ce sera moi qui verrai le vôtre et puisque nous en sommes sur ce sujet, écoutez-moi ; mettez au plus vite ordre à vos affaires ; soyez prêt à paraître devant Dieu.
Il fronça le sourcil et, suivant son habitude, se moqua d’elle ; mais quelques jours après, il tomba malade et se rappela la prédiction de sa pénitente. Épouvanté, il députa quelqu’un auprès d’elle pour lui demander pardon de ses railleries.
— Je lui pardonne de tout cœur, répondit Lydwine, mais qu’il ne s’illusionne pas, il est condamné ; dites-lui qu’il se confesse et restitue sans tarder le bien d’autrui qu’il s’est approprié, car la mort le talonne.
Au mot de restitution qui lui fut rapporté, Dom André eut un accès de rage et envoya déclarer à la sainte qu’il n’avait rien à se reprocher, attendu qu’il n’avait jamais rien dérobé.
Elle fut effrayée par la méchanceté et par l’aveuglement de ce prêtre ; néanmoins, elle voulut essayer encore d’une tentative pour le sauver ; elle appela une personne de confiance, lui spécifia les objets volés jadis par cet homme et la dépêcha près de lui pour l’inviter à s’en dessaisir ; mais cette sommation ne fit que l’exacerber et il mourut, la bave aux lèvres, dans une crise de colère contre la sainte.
Le successeur de Dom André à la cure de Schiedam fut un autre prémontré, venu du même monastère de l’île sainte Marie, Jan Angeli, de Dordrecht, Jan fils d’Angeli, dit A Kempis. Celui-là était un paillard, non moins ignorant que son prédécesseur des phénomènes de l’ascèse mystique, mais il avait bon cœur, était complaisant et charitable.
Il commença par ne rien entendre au cas de Lydwine. Parmi ses pénitentes, figurait une jeune fille très dévouée à la sainte. Ils causaient souvent d’elle et toujours il se demandait quel agrément cette jeune fille pouvait bien trouver à demeurer pendant des heures auprès d’une grabataire dont l’aspect l’avait personnellement dégoûté.
Un beau jour, il voulut tirer la chose au clair et il l’interrogea.
Comme elle était très timide, elle n’osa d’abord lui répondre, puis, à la fin, harassée par ses instances, elle ne put s’empêcher de s’écrier : mais si quelqu’un a le droit d’être étonné, c’est moi, mon père, car enfin vous êtes son confesseur ! Comment n’avez-vous jamais rien ressenti de ce que je ressens toutes les fois que je l’approche ?
— Bah ! s’exclama Jan Angéli — qu’éprouvez-vous donc de si extraordinaire lorsque vous êtes en sa présence ?
— Je ne sais, c’est indéfinissable — l’on n’est plus ici-bas, auprès d’elle. Je ne suis pas capable de m’exprimer, mais ce que je puis vous affirmer, c’est que si vous connaissiez cette âme, vous la visiteriez plus souvent !
— Je veux bien être pendu, si je comprends un mot à ce que vous me racontez.
— Eh bien, mon père, vous devez aller chez elle, demain, pour la confesser, regardez sa main et peut-être alors comprendrez-vous.
Le curé se rendit, en effet, le lendemain, à la demeure de Lydwine ; son premier soin fut de chercher à voir la main de la sainte, mais elle était enfouie sous ses couvertures, parce qu’elle ne l’avait pas revêtue, ainsi qu’elle le faisait d’habitude, d’un gant. La vérité est que si quelqu’un en avait examiné de très près la paume, il aurait découvert la marque plombée des stigmates ; or, elle n’avait jamais parlé à personne de ces douloureux sceaux. Une seule femme, la veuve Catherine Simon sans doute, les avait aperçus, et avait pressé Lydwine de questions ; mais celle-ci qui se défendait et d’avouer la vérité et de mentir, gardait le silence. A un certain moment cependant, poussée à bout, elle s’exclama, en serrant joyeusement la main de son amie : ô tête ! ô tête ! — ce qui voulait dire, selon Brugman, taisez-vous, mon secret est à moi !
Toujours est-il qu’elle cachait de son mieux cette main gauche, la seule dont elle pouvait se servir, mais ce qu’elle ne parvenait pas à dissimuler, c’était le parfum têtu d’épices qui s’en exhalait. Il était, selon Gerlac, perceptible au goût et, quand on l’avait respiré, l’on avait en quelque sorte aussi dégusté de célestes friandises dont la saveur rappelait, mais ainsi que de précieux crûs rappellent de fallacieuses vinasses, le bouquet fébrile des girofles, l’ardeur poivrée du gingembre, la candeur fûtée de la cinnamome, de la cannelle, surtout.
Résolu à ne pas s’éloigner, sans avoir contenté sa curiosité, Dom Angeli dit :
— Ma très chère mère Lydwine, veuillez me donner votre main.
Par obéissance, elle la lui tendit et la chambre fut aussitôt embaumée.
— Ah ? s’écria-t-il, pourquoi ne m’avez-vous jamais révélé que vous disposiez des aromates perdus de l’Éden ? et comment ne me suis-je pas rendu compte, moi-même, alors que je vous confessais, que vous étiez une de ces âmes que Jésus se plaît à emplir jusqu’aux bords de ses grâces !
— Souvenez-vous de nos entretiens, mon père, répliqua Lydwine ; je vous ai bien souvent insinué que mes peines n’étaient que la contre-partie de mes joies ; si vous n’avez pas mieux deviné le sens de mes allusions, c’est sans doute parce que Dieu désirait qu’il en fût ainsi.
— Il s’exclama : vos paroles ont été pour moi comme des roses que l’on offrirait à un porc !
Et il était de bonne foi, en se traitant de la sorte car cette odeur qui fluait des doigts de la malade agissait non seulement sur son goût, mais encore elle pénétrait jusqu’au fond de sa conscience et en faisait jaillir le remords d’affreux péchés. Il n’y tint plus et il soupira, en fondant en larmes :
— Écoutez-moi, je sens que le Seigneur m’ordonne de me confier à vous ; j’ai commis des turpitudes sans nom, des fautes horribles.
Il se jeta à genoux, mais pris de vergogne, effaré par l’immondice de désolants aveux, il n’osa se traîner jusqu’au bout de ses accusations et se tut.
D’abord interdite par cette scène, Lydwine avait vite discerné qu’elle seule pouvait avoir assez d’influence sur ce malheureux pour le racheter ; elle vint donc à son aide, lui fractura l’âme et en sortit un péché qu’il célait.
— Voyons, fit-elle, ce péché d’adultère vous le commettez fréquemment ?
Tremblant de honte, il nia, jura que non.
La sainte parut le croire et n’insista pas.
Il partit, gêné par son mensonge et revint.
— Pourquoi, lui dit-elle, brusquement, m’avez-vous menti ? Je vous ai vu et depuis notre entretien, tel jour, à telle heure, à tel endroit, encore en tête à tête avec cette femme ; est-ce vrai ?
Confondu, il s’écria : qui a pu vous révéler ainsi mes méfaits ? et ses larmes l’étouffant il quitta la chambre et se réfugia dans le jardinet attenant à la maison, pour y pleurer à son aise.
Quand il se fut soulagé, il rentra et promit à la sainte de s’amender. Depuis ce moment, il aima réellement Lydwine et elle ne fut pas, on le verra, ingrate.
Ce Jan Angéli, qui n’occupa pas très longtemps la cure de Schiedam, semble d’ailleurs n’avoir tenu qu’une place intérimaire, n’avoir été qu’un passant dans la vie de Lydwine. Un autre prêtre, un saint homme, celui-là, Jan Walter, de Leyde, fut plus spécialement désigné par la Providence pour l’exhorter.
Qu’était ce Walter qui eut trois sœurs germaines, amies et garde-malades de la sainte ? était-il vicaire ou prêtre habitué ou aumônier d’un des couvents de la ville ? appartenait-il à cet ordre des fils de saint-Norbert qui administraient, à cette époque, la paroisse ? fut-il enfin, après la mort du titulaire, promu curé ? je l’ignore ; les historiens nous relatent bien le trépas de Dom Angéli qui eut lieu en 1426, mais ils ne nous parlent pas plus de son successeur que s’il n’avait jamais existé.
D’autre part, Walter a-t-il rempli, auprès de Lydwine, du temps de Jan Angéli, l’office que Jan Pot remplit auprès d’elle, du temps de Dom André ? Oui, Gerlac l’affirme expressément. Lydwine étant décédée en 1433, l’on peut même ajouter qu’il commença à exercer son ministère envers elle, en 1425, car Brugman atteste qu’il fut son confesseur pendant les huit dernières années de sa vie. Ils l’ont donc dirigée ensemble, mais pendant une année seulement, puisque Jan Angéli mourut, comme il vient d’être dit, en 1426.
Ce qu’il est possible d’assurer, en tout cas, c’est que cette haine sacerdotale, qui avait tant torturé Lydwine, se termina avec le décès de Dom André. Elle put recevoir le dictame de l’autel autant de fois que les besoins de son âme l’exigeaient. Jan Angéli et Jan Walter le lui accordèrent même, à une certaine époque, tous les deux jours ; mais quelquefois l’esquinancie dont elle souffrait et les fièvres qui la rongeaient lui desséchaient la bouche et lui contractaient à un tel point la gorge qu’il fallait lui verser de l’eau entre les lèvres pour lui permettre d’avaler l’hostie ; et l’effort de déglutition qu’elle devait faire était si douloureux, qu’elle défaillait presque.
Dieu lui épargna donc les nouveaux tourments de mauvais prêtres ; certes, beaucoup se pressèrent encore autour d’elle, mais ceux-là n’avaient aucune obédience sur sa personne, ceux-là n’avaient le droit, ni de lui nuire, ni de la commander !
Elle avait, au reste, assez de tortures pour être au moins dispensée de celle-là ! car ses maux allaient toujours en s’aiguisant.
Aucune partie de son corps n’était plus saine ; la tête, le col, la poitrine, le ventre, le dos et les jambes lui arrachaient, en se décomposant, jours et nuits, des cris ; seuls les pieds et les mains étaient demeurés presque indemnes et désormais ils furent dévorés par les flammes sourdes des stigmates ; celui de ses yeux qui n’était pas complètement mort mais qui ne tolérait déjà plus aucune lueur, devint encore plus sensible et saigna même dans la pénombre ; il lui fallut se séquestrer derrière des rideaux, gémir, immobile, les plaies avivées, dès qu’on essayait de la remuer pour la changer de linge, par les barbes hérissées des pailles.
Le temps n’était plus où elle pouvait regarder par l’étroite fenêtre, placée en face du lit, un peu de ces ciels charmants des Pays-Bas, de ces ciels d’un bleu étonnamment tendre sur lequel moussent des buées d’argent et floconnent des vapeurs d’or ; les silhouettes des passants, les cimes d’arbres remuées par le vent, les mâts des barques filant sur les canaux voisins, tous ces aperçus de la vie qui circulaient derrière sa croisée et qui parvenaient peut-être à la distraire, avaient, pour la quasi-aveugle qu’elle était, disparu.
L’hiver même, lorsque le firmament lourd de neige descendait jusqu’au faîte des toits et qu’un jour d’eau trouble brouillait les contours des bâtisses et des routes, il lui était jusqu’alors resté cette gaieté intime des choses si particulière en Hollande dans les intérieurs des plus pauvres gens ; elle avait eu, pour se délasser, dans ses moments d’accalmie, le côté plaisant de la grande cheminée devenue vivante avec le froid et si éveillée et si réjouie avec sa crémaillère aux dents de laquelle toujours oscille, dans une spirale de fumée bleue, la marmite qui chante. Et c’était sur la plaque du fond, tapissée de suie, le pétillement des étincelles, les soupirs des sarments, la blanche envolée des peluches, tandis que sous la hotte en saillie dans la chambre, près des tisons écroulés sur les carreaux de l’âtre, les hauts landiers de fer tenaient, au bout de leur tige, sur leur tête arrondie en forme de corbeille, les plats mis au chaud ; et des zigzags de feu sortaient des cendres, accrochaient des paillettes au cuivre des coquemars, tiquetaient de points d’or la panse des chaudrons, éclairaient d’une brusque lumière les ustensiles pendus au mur : les cuillers, les longues fourchettes à deux dents pour piquer la viande dans les pots, les poêles et les écumoires, les lèchefrites, les grils et les râpes, tous les instruments qui figurent dans les plus humbles cuisines de cette époque.
Cette amusette familière des braises, ce cache-cache d’étoiles que tantôt elles allument et que tantôt elles éteignent sur le flanc bombé des vases, ces nuées qui semblent enfermées dans une cage et qui courent pourtant derrière les résilles en plomb des vitres, tous ces misérables riens qui occupent une malade, qui la désennuient pendant quelques secondes, lui étaient dorénavant refusés ; au sortir de l’ébriété divine, c’était le noir et c’était le vide ; la vue d’un charbon qui se consume lui eût troué l’œil comme une pointe de métal rouge ; on dut donc préparer les repas de la maisonnée dans une autre pièce ; ce fut, pour elle, l’abandon même des choses. Cette chambre basse et humide dans laquelle elle gisait en une éternelle nuit, eût constitué pour toute autre que pour elle un séjour suicidaire ; elle était déjà ensevelie dans une tombe et elle n’avait point, en échange, l’avantage de la solitude, car les curieux continuaient d’affluer.
Qu’elles fussent injurieuses ou simplement vaines, ces visites la crucifiaient, car elles la privaient de celle des anges. Elle vivait, en effet, ainsi qu’une sœur, avec eux.
A quel moment entra-t-elle en d’étroites relations avec ces purs Esprits ? Il est impossible de le dire ; elle ne communiquait pas ses secrets, même à ses plus intimes, rapportent ses chroniqueurs ; aussi ne peut-on suivre, ainsi qu’on le fit pour d’autres élus, le pas à pas de sa marche dans les voies mystiques ; la chronologie des grâces qui lui furent imparties n’existe pas ; ce que l’on peut seulement attester, c’est que Dieu lui dépêchait, quand elle souffrait trop, ses anges pour la consoler. Elle leur parlait de même qu’à de grands frères et lorsque, pour l’éprouver, Jésus s’éloignait d’elle, elle les appelait, leur criait, éplorée : où est-il ? comment peut-il m’affliger et n’avoir pas pitié de moi, Lui qui m’a tant recommandé d’être miséricordieuse envers le prochain ; je n’agirais pas, à coup sûr, avec mes semblables, comme il agit avec moi. Ah ! si je disposais envers Lui du pouvoir d’adduction qu’il a sur moi, je l’attirerais dans mes bras, je le ferais pénétrer jusqu’au fond de mon cœur ou plutôt non, c’est moi qui pénétrerais dans le sien et m’y submergerais tout entière !
Et elle les suppliait d’aller le chercher, de l’amener, coûte que coûte, finissait par pleurer en soupirant : je deviens folle, je ne sais ce que je dis !
Et les anges la réconfortaient et lui ramenaient, en souriant, l’Époux. Alors que sa contemporaine sainte Françoise Romaine les contemplait surtout sous l’aspect d’enfants aux cheveux d’or, elle, les voyait sous la forme humaine d’adolescents, marqués au front d’une croix resplendissante, afin qu’elle pût les distinguer des démons auxquels il est interdit, quand ils se travestissent en anges de lumière, d’arborer ce signe. Mais son ange était moins rigoureux que celui de la sainte italienne qui la souffletait, en public, quand elle commettait la moindre faute ; celui de Lydwine partait simplement et ne revenait que lorsqu’elle s’était confessée, lui faisant ainsi comprendre qu’il est impossible de converser avec des hommes ou des femmes, même en étant animé des meilleures intentions, sans choir dans quelque imperfection, sans laisser échapper au moins une parole indiscrète ; aussi, assurait-elle, que si les entretiens ont quelquefois du bon, le silence vaut toujours mieux.
Cette défection de ses célestes confidents, quand ils la trouvaient en compagnie, fut pour elle la cause d’un impétueux chagrin.
Un jour de fête, à l’heure de midi, elle pria son confesseur et l’un de ses parents nommé Micolas qui était venu dîner chez elle, après la messe, de la quitter, afin qu’elle pût rester, seule, pendant trois heures. Nicolas fut se promener, mais le confesseur — dont les trois biographes omettent le nom — revint secrètement à la maison et se posta aux aguets derrière la porte de la chambre de Lydwine. L’ange gardien, que la sainte attendait, parut, mais il se contenta de planer autour du lit, sans s’approcher. Elle lui demanda, peinée, si elle était coupable de quelque péché. — Non, répondit-il, en partant, si je fuis c’est à cause de celui qui t’espionne, là, derrière la porte.
Lydwine se mit à sangloter.
Intrigué par le bruit de ces gémissements, le prêtre sortit de sa cachette et il avoua sa faute ; mais quand elle vit que c’était son confesseur qui avait mécontenté de la sorte son bon ange, elle pleura encore plus amèrement.
— Ah ! mon père, fit-elle, pourquoi vous conduisez-vous ainsi envers moi ; vous doutez donc de ma franchise, puisque vous voulez vérifier, par vous-même, ce que je vous dis ?
Ces relations avec les purs Esprits, qu’elle eût voulu tenir cachées, s’ébruitèrent ; certains faits ne pouvaient, en effet, tarder à être connus ; ceux-ci surtout qui s’étaient passés devant témoins.
Tous les ans, le mercredi après le dimanche de la Quinquagésime, Jan Walter lui apportait les cendres. Or, une année, il ne put se rendre chez elle, à l’heure annoncée ; Lydwine, inquiète, se demandait s’il était indisposé ou s’il l’avait oubliée, quand un ange parut à sa place et la signa. Walter arriva enfin. — C’est fait, lui dit-elle, mon frère ange vous a prévenu. — Walter ouvrait de grands yeux, pensant que sa pénitente devenait folle, mais s’étant penché sur elle, il distingua une croix de poussière très nettement tracée sur le front et il approcha son front du sien, afin de se bénir, lui aussi, avec cette poudre des buis consumés de l’Éden.
Que vous êtes heureuse, ma chère Lydwine ! s’écria-t-il, en joignant les mains ; et elle sourit, lui racontant qu’après la cérémonie, son ange lui avait déclaré qu’en pareil cas, les fidèles agiraient sagement, en se présentant à l’autel avec un cierge allumé auquel pendrait une médaille gravée d’une croix, afin d’énoncer leur foi par la cire, la charité par la flamme et la mortification par la croix.
Un autre jour, une pieuse veuve qui la soignait et qui n’ignorait point que les anges se révélaient à son amie sous une forme sensible, la supplia de lui en montrer un.
Lydwine, reconnaissante à cette femme, qui était très probablement la veuve Catherine Simon, de tant de bons soins, implora le Seigneur et, après s’être assurée que sa prière était accueillie, elle dit à la veuve :
— Agenouillez-vous, ma très chère, voici que l’ange que vous désirez connaître vient.
Et l’ange jaillit dans la chambre sous la figure d’un jeune garçon dont la robe était tissée de fils de feux blancs. Cette femme était tellement enchantée qu’elle était inapte à proférer une seule parole pour exprimer sa joie. Alors Lydwine, réjouie de la voir si contente, demanda :
— Mon frère, voulez-vous autoriser ma sœur à contempler, ne fût-ce que pendant une minute, la splendeur de vos yeux ?
Et l’ange la fixant, cette femme se souleva hors d’elle-même et, durant quelque temps, elle ne fit plus que gémir d’amour et pleurer, sans pouvoir dormir ou manger.
Lydwine disait quelquefois à ses intimes : je ne connais nulle affliction, nul mésaise qu’un seul regard de mon ange ne dissipe ; son regard opère sur la douleur comme un rayon de soleil sur la rosée du matin qu’il évapore. Imaginez-vous donc de quelles allégresses le Créateur inonde ses élus dans le ciel, puisque la vue du moindre de ses anges suffit pour disperser tous les maux et nous dispenser une jubilation qui surpasse de beaucoup toutes celles que nous pouvons, ici-bas, attendre.
Et elle ajoutait : il sied d’aimer et de vénérer ces purs Esprits qui, bien que très supérieurs à nous, consentent cependant à nous protéger et à nous servir ; et, elle-même, donnait l’exemple à ses fidèles en récitant devant eux, cette prière :
« Ange de Dieu et bien-aimé frère, je me confie en votre bénéficence et vous supplie humblement d’intercéder pour moi auprès de mon Époux, afin qu’il me remette mes péchés, qu’il m’affermisse dans la pratique du Bien, qu’il m’aide par sa grâce à me corriger de mes défauts et qu’il me conduise au Paradis pour y goûter la fruition de sa présence et de son amour et y posséder la vie éternelle ; ainsi soit-il. »
Cet ange gardien qu’elle exorait de la sorte, se plaisait à venir la chercher et à l’emmener, en esprit, promener.
Gerlac qui vécut près d’elle remarque, à ce propos, que lorsque l’âme émigra pour la première fois de sa gaine charnelle, Lydwine souffrit de terribles angoisses ; elle suffoqua, se crut sur le point de mourir ; et quand l’âme fut sortie, le corps devint froid, insensible, tel qu’un cadavre.
Mais peu à peu, elle s’habitua à ce détachement provisoire de sa coque et il s’effectua, par la suite, sans qu’à peine elle le sentît. L’itinéraire de ses excursions était généralement celui-ci : l’ange l’arrêtait d’abord devant l’autel de la Vierge dans l’église paroissiale, puis il la guidait dans les jardins en fête de l’Éden, plus souvent encore dans les effrayants dédales du Purgatoire.
Elle souhaitait d’ailleurs de visiter les âmes détenues dans les ergastules de ces tristes lieux ; personne ne leur était plus dévoué ; elle voulait, à tout prix, diminuer leurs tourments, abréger leur captivité, changer leur misère en gloire ; aussi, bien que chacun de ces voyages fût pour elle la cause d’incomparables tortures, suivait-elle volontiers son compagnon, alors qu’il la dirigeait vers cette halte terrible de l’au-delà.
Elle y apercevait des âmes s’agitant au centre de tourbillons de feu et elle passait au travers de ces ouragans de flammes quand l’ange lui indiquait ce moyen de les soulager. Dieu lui exhibait, sous les yeux, le détail des peines infligées à certaines de ces suppliciées ; et elle les voyait, de même que sainte Françoise Romaine, sous une forme corporelle, rôties sur des brasiers, pilées dans des mortiers ardents, déchirées avec des peignes de bronze, transpercées par des broches de métal rouge.
— Quelle est cette âme qui endure cet affreux martyre ? fit-elle, un jour, en se tournant, consternée, vers son guide.
— C’est celle du frère de cette femme qui nous a récemment réclamé des prières pour elle ; demandez qu’elle soit allégée et elle le sera.
Lydwine s’empressa d’adhérer à cette proposition et cette âme fut retirée de la prison particulière où elle pâtissait, pour être internée dans une autre, moins rigide et commune aux âmes qui n’ont à purger aucune peine spéciale.
Quand elle fut revenue de ce voyage, la sœur du défunt la harcela pour connaître le sort de son frère. Lydwine, harassée, lui dit : Si je vous raconte ce que je sais, vous allez perdre la tête. Mais cette femme l’assura qu’elle ne se troublerait pas ; alors la sainte lui narra le changement de geôle de son frère et ajouta : pour le libérer complètement, il vous faut renoncer aux mets délicats dont vous êtes friande ; tenez, vous préparez, pour votre régal, un chapon, eh bien, vous allez vous en priver et le bailler aux pauvres.
Cette femme suivit ce conseil et, à l’aube, le lendemain, elle entrevit une troupe de démons dont l’un, après avoir empoigné le chapon, la gifla, elle et Lydwine avec. Elle eut grand’peur, mais Dieu crut devoir joindre encore à ses transes des douleurs si violentes que la malheureuse cria grâce ; alors Lydwine intercéda auprès du Seigneur, subit à sa place le complément des offenses et l’âme fut enfin dégrevée.
Une autre fois, pendant la nuit de la fête de la conversion de saint Paul, Lydwine regarda, en songe, un homme qui lui était inconnu et qui tentait d’escalader une montagne ; il retombait à chaque effort. Tout à coup, il aperçut la sainte et lui dit : Ayez pitié de moi, portez-moi en haut de ce mont. Elle le chargea sur ses épaules et grimpa péniblement jusqu’à la cime ; là, elle s’enquit de son nom. Il répondit : Je m’appelle Baudouin du Champ ; et elle s’éveilla.
Son confesseur étant venu pour prendre de ses nouvelles, le lendemain, remarqua qu’elle pouvait à peine respirer et était brisée de fatigue. Comme il s’inquiétait de son état, elle lui décela sa vision de la nuit.
Baudouin du Champ ? fit le prêtre, ce nom ne m’est pas absolument inconnu, mais où l’ai-je entendu prononcer ? il scruta vainement sa mémoire. Or, trois jours après, étant allé célébrer la messe à Ouderschie, un village situé à environ deux kilomètres de Schiedam, il apprit que le sacristain s’appelait Baudouin du Champ et était mort, la nuit même où il était apparu à Lydwine. Elle se consumait d’angoisses pour ces âmes, cherchait de tous les côtés à se procurer des messes pour elles, clamait : Seigneur, châtiez-moi, mais épargnez-les ! — et Jésus l’écoutait et la broyait sous le pressoir de ses maux.
Il convient d’observer aussi qu’elle était assaillie de suppliques par ces forçates d’outre-tombe ; tout l’au-delà souffrant la cernait ; elle voyait ces âmes en attente, éveillée et endormie, et ce qu’elles attirèrent sur elle des avalanches de tourments ! celles surtout des mauvais prêtres.
Ceux-là, après leur trépas, furent les plus assidus de ses bourreaux.
L’un d’eux, nommé Pierre, dont la vie n’avait été qu’une sentine, s’était repenti, mais il était mort, avant que d’avoir pu expier, ici-bas, ses fautes. Lydwine, sur les exorations de laquelle il s’était converti, priait très souvent pour son âme dont elle ignorait les fins. Or, douze ans après le décès de cet ecclésiastique, comme elle implorait encore la miséricorde divine pour lui, son ange l’emmena dans le Purgatoire. Là, elle entendit une voix lamentable qui criait au secours du fond d’un puits.
C’est l’âme de cet abbé pour lequel vous avez adressé tant d’oraisons au Sauveur, dit l’ange.
Elle fut navrée de le savoir encore dans cette géhenne.
— Voulez-vous souffrir pour le sauver ? proposa son compagnon.
— Oui, certes ! s’exclama-t-elle.
Alors il la conduisit devant un torrent qui dégringolait, en grondant, dans un gouffre et lui commanda de le franchir. Elle recula, assourdie par le fracas des eaux, épouvantée par la profondeur de l’abîme ; elle haletait, prise de vertige, se retenait pour ne pas s’affaisser ; mais son guide la réconforta ; elle s’élança dans le vide, roula dans le tourbillon des ondes, s’accrochant aux aspérités des rocs et elle finit par s’effondrer, défaillant de fatigue et de peur sur l’autre bord ; alors l’âme de son protégé bondit du puits, et s’envola, toute blanche, vers le ciel.
Elle délivra de même ce malheureux Angeli qui avait été enlevé par la peste, en quelques jours, à Schiedam.
Ainsi que nous l’avons raconté, ce religieux, après s’être confessé avec larmes à Lydwine, était sorti de chez elle, plein de fermes résolutions ; mais il ne tarda pas à écouter encore les rumeurs de ses sens. Lydwine le supplia de changer d’existence, de se séparer de cette femme qui l’induisait au mal, il promettait mais il était si faible qu’il ne pouvait se résister. Enfin, les représentations énergiques de la sainte parvinrent à le délier de son vice ; mais il fut atteint de la peste huit semaines après.
Il se traîna chez Lydwine et lui demanda s’il devait se préparer, par l’extrême-onction, à la mort. — Oui, fit-elle. — Il hésita et attendit ; mais, se sentant plus malade et n’étant plus en état de quitter son lit, il lui dépêcha un messager qui réitéra la question. Cette fois, elle répliqua : qu’il avale un peu de bière et de pain, s’il peut les garder, l’espace d’une heure, il ne mourra pas, sinon… Il suivit cette prescription et pendant trois quarts d’heure, il n’éprouva aucune nausée. Il se croyait déjà guéri, quand, au moment même où sonna l’heure, les vomissements affluèrent.
Il appela en hâte un prêtre, reçut les derniers sacrements et trépassa, le jour même de la Nativité de la Bienheureuse Vierge.
Lydwine, très inquiète pour son âme, pria sans désemparer, s’infligea de studieuses tortures, s’ingénia, par tous les moyens en son pouvoir, à le racheter.
Elle finit par interroger son ange, afin de savoir où il était. Pour toute réponse, il la mena dans un endroit effroyable. — C’est l’Enfer ? fit-elle, tremblante, — Non, c’est le district du Purgatoire qui l’avoisine ; l’Enfer est là, êtes-vous curieuse de le visiter ? — Oh non ! s’exclama-t-elle, effarée par les hurlements, par les bruits de coups, par les cliquetis de chaînes, par les grésillements de charbons qu’elle entendait derrière d’immenses murailles noires, tendues comme d’un rideau de suie. Son compagnon n’insista pas ; il continua de la promener dans les aires des âmes demeurées à mi-chemin.
Un puits sur la margelle duquel un ange était tristement assis, l’arrêta. Qu’est-ce ? dit-elle. — C’est l’ange gardien de Jan Angeli ; l’âme de votre ancien confesseur est enfermée dans ce puits, tenez — et son guide souleva le couvercle. — Une spirale furieuse de flammes s’en échappa et des cris. Elle reconnut la voix de son ami et l’appela. Il jaillit, embrasé, projetant des étincelles ainsi qu’un fer chauffé à blanc et, avec une voix qui n’en était plus une, il la nomma, ainsi que de son vivant, ma très chère mère Lydwine, et la supplia de le sauver.
Cette âme en feu, cette voix inarticulée, la bouleversèrent si fort que sa ceinture de crins qui était pourtant solide éclata et qu’elle revint à elle.
— Ah ! dit-elle aux femmes qui la veillaient et qui s’étonnaient de la voir si frissonnante et si abattue, ah ! croyez-moi, il n’y a que l’amour de Dieu qui puisse me faire descendre dans de tels barathres ; sans cela, je ne consentirais jamais à regarder de si terribles scènes !
Et, un autre jour, alors qu’un bon prêtre disait devant elle, en montrant un vase plein de graines de moutarde : « ma foi, je me contenterais bien de ne pas subir plus d’années de Purgatoire qu’il n’y a de grains dans ce pot », elle s’écria : que racontez-vous là ! Ne croyez-vous donc point en la miséricorde du Messie ? Si vous vous doutiez de ce qu’est ce foyer de tourments, vous ne parleriez pas de la sorte !
Or, cet ecclésiastique mourut quelque temps après et diverses personnes, qui avaient assisté à cet entretien, s’enquirent auprès de Lydwine pour être informées de son sort.
— Il est bien, fit-elle, parce qu’il était un digne prêtre, mais il serait mieux s’il avait eu une fiance plus efficace dans les vertus de la Passion du Christ et s’il avait, de son vivant, plus craint le Purgatoire !
En attendant, elle sut si bien appliquer les mérites de ses souffrances à cet infortuné Angeli, qu’elle parvint à le délivrer.
On la consultait de toutes parts, pour connaître la destinée de certains morts ; mais constamment elle refusait de répondre.
— Vous êtes bien réservée et vous faites bien la renchérie, lui dit une femme ; moi qui vous parle, j’ai souvent causé, avant sa mort, avec un saint qui n’usait pas de tant de manières pour renseigner les gens.
— C’est possible, répliqua Lydwine, il ne m’appartient pas de juger si, en agissant de la sorte, ce saint avait tort ou raison.
Et au même instant, son ange lui apprenait que ce soi-disant élu souffrait dans le Purgatoire, justement pour s’être mêlé de ce qui ne le concernait pas.
Il fallait donc qu’elle fût vraiment incitée par le Seigneur pour qu’elle osât s’immiscer dans de telles questions ; c’était tant pis, dans ce cas, pour les indiscrets, si ses avis, au lieu de les consoler, les alarmaient. Il en fut ainsi pour la comtesse de Hollande ; après le décès de son mari Wilhelm, le bruit courut que Lydwine, trépassée depuis trois jours, venait de ressusciter et avait rapporté de l’autre monde la nouvelle que le comte défunt participait à l’allégresse sans retour des Justes.
La comtesse envoya aussitôt l’un de ses officiers à Schiedam.
— Vous pouvez bien penser, lui dit Lydwine, un peu ahurie par ce message, que si j’étais morte depuis trois jours, je serais à l’heure actuelle inhumée dans une tombe ; quant à l’âme de votre prince, permettez-moi d’estimer que si elle était entrée directement dans le ciel, moi qui suis malade depuis tant d’années, j’aurais peut-être le droit d’être surprise et de pleurer sur la longueur de mon exil ; et j’ajoute que je ne me plains pas.
Dans une autre circonstance, pour déraciner les mauvais instincts d’un déplorable prêtre, elle obtint du Ciel de lui faire contempler l’Enfer. Cet ecclésiastique, Joannès Brest ou de Berst, qui lui avait rendu quelques petits services en s’occupant de ses affaires de famille, fréquentait chez une dame Hasa Goswin ; cette femme tenait table ouverte et attirait de préférence chez elle les prêtres libertins et goulus. Lydwine avait mainte fois exhorté cet ecclésiastique à ne plus mettre les pieds dans ce mauvais gîte, mais il n’avait jamais écouté ses conseils. Cette créature trépassa ; il revint voir la sainte et fut désireux de savoir ce qu’elle était devenue.
— Dieu peut vous accorder la grâce de la regarder, dit tristement Lydwine.
Elle pria et, quelques jours après, ils virent, tous deux, simultanément, Hasa Goswin torturée dans d’épouvantables forteresses par les démons, liée par des chaînes de feu, brisée par d’inénarrables supplices, dans les enfers.
Joannès de Berst fut terrifié ; il promit à Lydwine de changer de conduite ; puis, il se rit de cette vision, se persuada qu’elle n’était que le résultat d’un cauchemar et continua de plus belle à se désordonner. La sainte le réprimanda sérieusement ; découragée, à la fin, elle s’exprima ainsi devant un tiers : je ne puis plus détourner la justice de Dieu de cet homme ; et il tomba subitement malade et il mourut.
Lydwine n’eut malheureusement pas près d’elle, comme la sœur Catherine Emmerich, un Clément Brentano pour noter ses visions dans les rares moments où elle consentait à en parler. Il semble cependant possible, avec les différents détails précisés par ses biographes, de reconstituer le récit de ses voyages dans les territoires de l’au-delà.
Au fond, son concept de l’Enfer, du Purgatoire et du Ciel est identique à celui de tous les catholiques de son temps.
Dieu adapte, en effet, presque toujours, la forme de ses visions à la façon dont les pourraient imaginer ceux qui les reçoivent. Il tient généralement compte de leur complexion, de leur tournure d’esprit, de leurs habitudes. Il ne réforme pas leur tempérament pour les rendre capables de considérer le spectacle qu’il juge nécessaire de leur montrer ; il ajuste, au contraire, ce spectacle au tempérament de ceux qu’il appelle à le contempler ; cependant les saints, qu’il favorise, voient ces tableaux sous un aspect inaccessible à la faiblesse des sens ; ils les voient, intenses et lumineux, dans une sorte d’atmosphère glorieuse que les mots ne peuvent énoncer ; puis, sans qu’ils puissent faire autrement, ils les rapetissent, ils les matérialisent, en essayant de les articuler dans un langage humain et ils les réduisent ainsi, à leur tour, à la portée des foules.
Tel paraît avoir été le cas de Lydwine.
Sa vision de l’Enfer et du Purgatoire, avec leurs donjons à lucarnes grillées, leurs hautes murailles enduites de fuligine, leurs geôles horribles, leur tapage de ferrailles, leurs puits enflammés, leurs cris de détresse, ne diffère guère de celle de Françoise Romaine et nous la trouvons également traduite par tous les imagiers et les peintres de son siècle et de ceux qui l’avoisinent. Elle s’étale sur les portails des Jugements derniers, sur les porches des cathédrales ; elle apparaît dans les panneaux que nous conservent les musées, dans celui de l’allemand Stephan Lochner, à Cologne, pour citer de tous le plus connu.
Ce sont, en effet, les mêmes scènes de tortures dans des milieux pareils ; les damnés hurlent ou gémissent, sont attachés par des chaînes et des menottes, frappés par des diables armés de fourches ; ils rôtissent dans des châteaux dont les fenêtres scellées de barreaux étincellent ; seulement, dans ces attitudes des méfaits punis, les artistes qui n’eurent recours qu’à leur seule imagination, commencent déjà, ainsi que Lochner, — sans le vouloir, — à découvrir, dans ces scènes d’horreur, un côté comique que développeront plus tard, — en le voulant, — alors que la foi sera moins vive dans les Flandres, Jérôme Bosch et deux des Breughel. Quant au Paradis, Lydwine l’apercevait quelquefois, selon une donnée flamande dont usèrent les peintres du XVe siècle, sous l’aspect d’une salle de festin aux voûtes magnifiques ; les viandes y étaient servies sur des nappes de soie verte dans des bassins d’orfévrerie et le vin versé dans des coupes de cristal et d’or. Jésus et sa mère assistaient à ces agapes ; et parmi les élus assis à cette table, Lydwine distinguait ceux qui furent prêtres, de leur vivant, revêtus d’ornements sacerdotaux et buvant dans des calices.
Un jour, relate Brugman, elle reconnut dans l’un de ces christicoles dont le calice était renversé, l’un de ses frères morts, Baudouin ; il avait été destiné dès sa naissance, par leur mère Pétronille, au sacerdoce ; il en avait en effet la vocation, mais il l’avait désertée car, tout en étant un très pieux homme, il s’était assoté d’une femme et s’était marié.
La conception la plus habituelle qu’avait Lydwine de l’Éden n’était cependant pas celle d’une frairie organisée dans un palais ; c’était celle d’un jardin aux pelouses à jamais fraîches, aux arbres restés en fleur, d’un jardin merveilleux dans les allées duquel les Saints chantent la gloire du Seigneur, par l’éternelle matinée d’un radieux printemps.
Elle le parcourait souvent, sous la conduite de son ange qui devisait et priait avec elle et l’enlevait dans les airs, lorsqu’elle ne parvenait pas à se frayer passage au travers de buissons trop élancés de roses et de lys ou de bosquets trop drus.
La description de ce jardin que ses biographes ne nous révèlent que çà et là et par bribes, elle nous est narrée tout au long et montrée dans son ensemble, dans le tableau de peintres qui furent ses contemporains, dans « l’Adoration de l’Agneau » des Van Eyck que détient aujourd’hui l’une des chapelles de l’église de Saint-Bavon, à Gand.
Le panneau central de cette œuvre représente, en effet, le Paradis, sous la forme d’un verger et d’une prairie plantée d’orangers en fruits, de myrtes en fleurs, de figuiers et de vignes ; et ce pourpris s’étend au loin, limité par un horizon pâle et fluide, par un ciel à peine bleuâtre, demeuré en plein jour un ciel d’aube, sur lequel se dressent les beffrois et les clochers gothiques, les aiguilles et les tours d’une Jérusalem céleste, toute flamande. Devant nous, au premier plan, coule la fontaine de Vie dont les jets, en retombant, fleurissent de bulles blanches les grands cercles noirs qui s’élargissent sur l’eau moirée des vasques ; de chaque côté, sur l’herbe étoilée de pâquerettes, des groupes s’assemblent d’hommes agenouillés et debout ; — à gauche, les patriarches, les prophètes, les personnages de l’Ancien Testament qui préfigurèrent ou apprirent au peuple la naissance du Fils, tous gens robustes, endurcis par les prédications du désert, exhibant des peaux tannées par le soleil, comme cuites par le feu réverbéré des sables ; tous barbus et drapés dans des étoffes foncées et tuyautées de longs plis, méditant ou relisant les textes maintenant vérifiés des promesses qu’ils annoncèrent ; — de l’autre, les apôtres agenouillés, boucanés, eux aussi, par tous les climats et délavés par toutes les pluies et derrière eux, debout, des papes, des évêques, des abbés de monastère, des laïques, des moines, les personnages de la Nouvelle-Alliance, vêtus de chapes splendides, tissées de pourpre et brochées de ramages d’or ; les papes coiffés de tiares fulgurantes, les évêques et les abbés de mitres orfrazées, rutilant sous les feux croisés des gemmes ; et ceux-là portent des croix serties d’émaux, incrustées de cabochons, des crosses grénelées de pierreries et ils prient ou lisent ces prophéties qu’ils virent réalisées, de leur vivant. Sauf les apôtres qui sont hirsutes, tous sont rasés de frais et ont le teint blanc ; et ceux qui n’arborent pas le trirègne romain ou la mitre ont le chef ceint d’une couronne monastique ou garni de somptueux bonnets de fourrures, tels que ceux qui couvrirent les riches bourgeois du Brabant et des Flandres, au temps où souffrait sainte Lydwine.
Et, dans l’espace laissé vide, au-dessus d’eux, au milieu de la pelouse piquée de marguerites, bordée, à droite, par un vignoble, à gauche par des touffes gladiolées de lys, un autel sert de piédestal à l’Agneau de l’Apocalypse, un Agneau qui darde dans un calice placé sous ses pieds un jet de sang parti du poitrail, alors qu’en une blanche guirlande, une théorie disséminée de petits anges, tient les instruments de la Passion et l’encense.
Puis, plus haut encore, là où la plaine finit et où les bosquets commencent, deux cortèges disposés, l’un au-dessus des personnages de la Bible, l’autre au dessus des personnages des Évangiles, s’avancent lentement, sortent des halliers d’un vert rigoureux, presque noir et s’arrêtent derrière l’autel, en une sorte d’émoi déférent et d’allégresse craintive ; — à gauche, brandissant des palmes, les martyrs pontifes ou non, les pontifes en tête, coiffés de bonnets étincelants d’évêques, habillés de dalmatiques d’un bleu sourd et somptueux, engoncés dans de rigides brocarts d’où semblent pendre, telles que des gouttes d’eau, des perles ; — à droite, les vierges martyres ou non et les saintes femmes, les cheveux dénoués et couronnés de roses, parmi lesquelles, au premier rang, sainte Agnès avec l’agneau et sainte Barbe avec la tour, toutes habillées de robes de nuances tendres, de bleus expirants, de rose fleur-de-pêcher, de vert moribond, de lilas déteint, de jaune défaillant ; et, elles aussi, ont en main des palmes.
Et l’on se figure très bien Lydwine, mêlée à elles, dans ces vergers, parlant ainsi que son ange à tous ces membres du Commun des Saints, admise comme une amie, comme une sœur, par ces élus qui la reconnaissent pour être l’une des leurs.
On la voit s’agenouillant près d’eux et adorant, elle aussi, l’Agneau, dans ce paysage de mansuétude, dans ce site quiet, sous ce ciel de fête, au milieu de ce silence qui s’entend et qui est fait de l’imperceptible bruissement des prières jaillies de ces âmes enfin libérées de leurs geôles terrestres ; et l’on s’imagine aisément aussi que ces pures femmes aux visages si candides, que ces jeunes moines aux profils de jeunes filles, prenant en pitié la détresse de leur sœur encore écrouée dans sa prison charnelle, s’approchent et la réconfortent et lui promettent de supplier le Seigneur d’abréger ses jours.
Et d’aucuns, en effet — elle le raconta à son confesseur — d’aucuns lui disaient, pour l’encourager à supporter son mal avec patience :
— Considérez notre situation, que nous reste-t-il maintenant de tous les tourments que nous souffrîmes sur la terre, pour l’amour du Christ ? voyez les joies infinies qui ont succédé à de périssables tortures !
Et Lydwine, arrachée de l’extase, se retrouvant dans sa pauvre chaumine, sur sa couche de paille, pleurait du bonheur d’avoir été si bien reçue par les saints du Paradis, mais, si résignée qu’elle fût, elle ne pouvait s’empêcher non plus de pleurer du regret d’être ainsi séparée de l’Agneau et éloignée de ces amis, par ces séries d’années qu’il lui fallait encore vivre.
Ces voyages auxquels la conviait son ange, ne se confinaient pas absolument dans les régions magnifiques ou hideuses de l’au-delà ; très souvent, sans lui faire quitter la terre, il la conduisait, au loin, dans les pays sanctifiés par la mort du Christ ou à Rome pour qu’elle visitât les sept églises, voire même simplement dans les couvents du Pays-plat.
Ainsi que la sœur Catherine Emmerich, elle suivait, en Palestine, l’itinéraire du Rédempteur pas à pas, de la crèche de Bethléem au sommet du Calvaire. Il n’y avait pas un endroit de la Judée qu’elle ignorât. Un jour que son confesseur, qu’elle obtint la permission d’emmener plus tard avec elle, manifestait quelques doutes à propos de la réalité de ces excursions, Jésus dit à Lydwine :
— Veux-tu venir avec moi sur le Golgotha ?
— O Seigneur, s’écria-t-elle, je suis prête à vous accompagner sur cette montagne et à y pâtir et à y mourir avec vous !
Il la prit donc avec Lui et lorsqu’elle retourna dans son lit qu’elle n’avait pas corporellement évacué, l’on aperçut des ulcères sur ses lèvres, des plaies sur ses bras, des déchirures d’épines sur son front, des échardes piquées dans tous ses membres qui exhalaient alors, la poitrine surtout, un parfum très prononcé d’épices.
En la ramenant chez elle, son ange lui avait dit : Le Seigneur veut que vous remportiez avec vous, ma sœur, des signes visibles et palpables, afin que votre directeur sache bien que votre excursion en Terre Sainte n’a pas été seulement imaginaire, mais bien réelle.
Dans une autre pérégrination, alors qu’elle grimpait derrière son guide dans un ravin, elle se démit le pied et, quand elle recouvra ses sens, son pied fut, en effet, luxé et elle en souffrit pendant longtemps.
Il y avait donc un côté matériel dans ces déplacements et elle pénétrait effectivement avec son ange dans les cloîtres, lorsque celui-ci l’y transportait.
Une fois, le prieur du monastère de sainte Élisabeth situé près de Brielle, dans l’île de Voorne, vint la voir et elle lui fit, en causant, une description si exacte et si détaillée des cellules, de la chapelle, de la salle du chapitre, du réfectoire, de la porterie, de toutes les pièces de sa maison, qu’il en béa.
— Mais enfin, s’exclama-t-il, lorsqu’il fut revenu de sa stupeur, vous n’avez jamais pourtant habité chez nous !
— Mon père, répondit-elle, en souriant, j’ai parcouru bien souvent lorsque j’étais en extase, votre couvent, et j’y ai connu tous les anges qui gardaient vos moines.
Ce pouvoir qui semble extravagant de se doubler ou de se dédoubler, d’être simultanément dans deux endroits différents, la faculté de la bilocation, en un mot, qui confondait les contemporains de Lydwine, a été cependant accordée, avant et après elle, à bien des saints.
Brigide d’Irlande, Marie d’Oignies, saint François d’Assise, saint Antoine de Padoue se géminèrent, apparurent en des corps tangibles, là où ils ne se trouvaient point ; la bénédictine Élisabeth de Schonau assista, bien qu’elle fût dans un bourg distant de seize lieues, à la consécration d’une église à Rome ; la présence de saint Martin de Porres fut constatée, en même temps, à Lima et à Manille ; saint Pierre Régalat adorait le Saint-Sacrement dans une ville, tandis qu’il priait, à la même minute, au vu et au su de tout le monde, dans une autre ; saint Joseph de Cupertino causait avec des gens divers, ensemble, à deux places différentes ; saint François Xavier se dimidiait pareillement, sur un navire et sur une chaloupe ; Marie d’Agréda convertissait les Indiens au Mexique tout en siégeant dans son monastère de l’Espagne ; la bienheureuse Passidée se tenait, conjointement, à Paris et à Sienne ; la mère Agnès de Jésus visitait, sans bouger de son couvent de Langeac, M. Olier, à Paris ; l’abbesse bénédictine sainte Jeanne Bonomi fut aperçue, pendant quatre jours, communiant à Jérusalem, alors qu’elle n’avait cependant pas quitté son abbaye de Bassano ; le bienheureux Angelo d’Acri soignait une agonisante chez elle et prêchait, au même instant, dans une église ; le don d’ubiquité fut également dévolu à un convers rédemptoriste, Gérard Majella ; saint Alphonse de Liguori, enfin, consolait les derniers moments du pape Clément XIV à Rome, tandis qu’il séjournait, en chair et en os, à Arinzo.
Et cette grâce du Seigneur ne s’est pas arrêtée aux âges révolus. Elle existe bel et bien de nos jours. Catherine Emmerich, décédée en 1824, en est un exemple et une stigmatisée encore plus près de nous, car celle-là n’est morte qu’en 1885, la visitandine Catherine Putigny, a été vue, doublée à la même seconde, dans son cloître à Metz.
Ce cas de Lydwine n’est donc point un cas isolé ; il n’est pas plus surprenant, d’ailleurs, que les miracles d’autre sorte dont sa vie abonde.
En résumé, ses relations avec les anges furent continuelles ; elle vivait autant avec eux qu’avec les gens qui l’entouraient. Ses liaisons furent-elles aussi fréquentes avec les saintes et les saints ? Évidemment, elle eut avec eux d’étroits rapports, pendant ses voyages dans l’Éden, mais elle ne semble pas, ainsi que tant d’autres déicoles, avoir entretenu sur la terre un commerce suivi avec tel ou tel saint déterminé ; du moins, ses chroniqueurs ne nous en avisent pas. Une fois, nous la rencontrons, contemplant plus spécialement au Paradis saint Paul, saint François d’Assise et les quatre précellents docteurs de l’église latine : saint Augustin, saint Jérôme, saint Ambroise et saint Grégoire ; une autre fois, nous la surprenons recevant la visite chez elle de ces mêmes quatre docteurs qui l’invitent à prévenir Jan Walter qu’il doit décider l’une de ses pénitentes d’Ouderschie à se rendre chez l’évêque ou chez le grand pénitencier du diocèse, afin d’obtenir l’absolution d’un péché réservé qu’il ne peut personnellement lui remettre ; et c’est, je crois, tout.
Au fond, sans négliger le culte auxiliaire de dulie, Lydwine était surtout hantée et possédée par l’Époux qui, du reste, lorsqu’il n’intervenait pas en personne, employait, de préférence aux saints, les anges pour lui servir de truchements auprès d’elle.
Cette impatience qui la tenaillait d’aller rejoindre le Bien-aimé dans le ciel, ne l’empêchait cependant pas d’être la femme la plus attentive aux choses de la terre, la femme la plus charitable pour les pauvres et les affligés.
Elle était réduite à vivre d’aumônes et elle les distribuait ces aumônes aux indigents. Condamnée à ne pouvoir sortir de son lit, elle chargeait la veuve Catherine Simon et ses autres amies de les répartir et leur recommandait d’acheter les poissons les plus fins et de les accommoder avec de fringantes sauces pour réjouir un peu les membres souffrants du Christ.
La veuve Simon, qui s’occupait plus particulièrement de ces emplettes et de ces partages, s’en acquittait avec tant de dévouement qu’après avoir prié Jésus de la récompenser, Lydwine lui dit, un jour, avec un air de joie extraordinaire, lorsqu’elle revint du marché :
— Le Seigneur est content de vous, ma bien chère, désignez la grâce qui vous tient le plus au cœur et j’intercéderai pour qu’elle vous soit accordée.
— Si vous m’obtenez le pardon de mes péchés et la grâce de la persévérance finale, je vous regarderai comme la meilleure des sœurs et des mères, répondit la brave femme. Quant au reste, je l’abandonne à votre charité.
— Vous ne réclamez pas peu de chose, fit la sainte, en souriant, cependant je me charge de présenter votre supplique qui ne peut déplaire à Dieu. Quant au reste que vous abandonnez à ma charité, le Sauveur y pourvoira ; allez donc, de ce pas, à l’église, y prier pour moi.
Et cette femme, qui était entrée, triste et préoccupée, partit joyeuse, sachant bien que l’exoration de son amie serait écoutée.
D’autres fois, la veuve Simon et ses compagnes s’ingéniaient, dans l’intérêt même de la malade, à ne pas strictement lui obéir ; navrées de son propre dénuement, elles s’arrangeaient de façon à prélever sur les sommes qu’elle leur confiait les quelques deniers nécessaires pour subvenir à ses besoins. Elle s’apercevait de ces amicales supercheries et se plaignait.
— Je sais, disait-elle, vos bonnes intentions, mais plût à Dieu que vous eussiez été plus dociles, car ces malheureux que vous avez frustrés seront, un jour, rois dans les cieux et c’est manquer au respect qui leur est dû, que de les faire ainsi attendre.
Elle était, du reste, sagace et prévoyante ; quand elle détenait un peu d’argent, l’hiver, elle salait des viandes et les envoyait, l’été, garnies de petits pois, avec sa bénédiction, aux gueux qu’elle assistait ; d’autres fois, elle offrait des œufs, de la bière, du beurre, du pain, des poissons grillés et, lorsque ses moyens le lui permettaient, elle ajoutait pour les enfants malades un peu de lait d’amande ou de vin. Cette charité si prévenante fut rémunérée par de nombreux miracles.
Un jour, quand on eut retiré de la marmite un quartier de vache salée et quand on l’eut divisé en trente parts pour autant de familles, le quartier se retrouva intact.
— Eh bien, dit-elle à ses intimes ébahis, eh bien de quoi vous étonnez-vous, n’est-il pas écrit, dans les Évangiles, demandez et il vous sera donné ?
Ce prodige fut reconnu par toute la ville et des personnes même à l’aise voulurent par dévotion goûter à ce plat.
Un autre jour, Lydwine, qui manifestait une prédilection pour les gens autrefois riches et tombés, par suite de revers de fortune, dans l’indigence, pour les pauvres honteux, en un mot, chercha vainement comment elle parviendrait à secourir certaines de ces familles ; ses provisions étaient épuisées et sa bourse était vide ; ses protégés mouraient littéralement de faim ; le cas pressait ; elle fit appel à la générosité d’un brave homme et celui-ci mit aussitôt cuire une épaule de porc et la lui apporta.
Cet homme était vraiment miséricordieux, car il était, lui-même, dans le besoin et il se condamnait, en se privant du seul morceau qu’il possédait, à ne manger que du pain. Il ne fut pas peu stupéfié lorsque, retournant chez lui, il vit, pendue dans sa cuisine, une autre épaule de porc beaucoup plus forte que celle dont il s’était dessaisi ; et cependant il jugeait impossible que quelqu’un se fût pendant son absence introduit chez lui.
Une autre fois encore, une mendiante épileptique dont les accès étaient fréquents errait par la ville ; elle fut terrassée par une attaque, en pleine rue, et se traîna, quand elle fut un peu pacifiée, jusqu’à la demeure de Lydwine ; elle bramait de soif et elle but toute la réserve d’eau de la sainte ; mais sa soif n’était pas étanchée. Se souvenant alors qu’il y avait un peu de vin dans le fond d’un pot, Lydwine l’en avisa ; elle se jeta dessus, mais ce fut comme une goutte de liquide sur une pelle rouge. De plus en plus altérée, cette femme suppliait qu’on lui découvrît un breuvage quelconque ; dans l’impossibilité où elle était de la satisfaire, Lydwine lui alloua un denier et cette femme s’en fut, joyeuse, dans un cabaret où elle finit par éteindre, avec des rasades de bière, l’incendie qui la dévorait.
Quelque temps après, la sainte, consumée par la fièvre, voulut à son tour boire ; ne se rappelant plus que la mendiante avait avalé son vin, elle pria son père de lui passer le récipient qui le contenait et il fut aussitôt rempli d’un vin rouge exquis, si bien préparé qu’elle put se dispenser de le couper d’eau ; il dura, de la fête de saint Rémy jusqu’à la Conception de la Sainte Vierge, c’est-à-dire près de deux mois ; à cette époque, la veuve Simon, qui ne connaissait pas ce miracle, fit gracieusement cadeau à son amie d’une cruche de vin ; elle avait choisi le meilleur qui se débitait dans la ville, aussi n’hésita-t-elle pas pour le transvaser, à renverser le pot encore à moitié plein du suc du crû céleste ; et la source de ce précieux cordial fut tarie.
Mais Lydwine ne bornait pas sa charité à des envois d’indispensables mets ; elle veillait aussi à ce que ses clients ne fussent privés de rien et elle se dépensait pour les vêtir.
Un prêtre lui fut signalé qui était dénué d’habits ; malheureusement le drap nécessaire manquait chez tous les marchands de Schiedam. Voyant sa peine, une femme qui l’aimait lui dit :
— Écoutez, j’ai gardé les six aunes de l’étoffe noire que voici, pour tailler une robe à ma fille ; à la rigueur, elles peuvent convenir à l’usage que vous leur destinez, les voulez-vous ?
Lydwine accepta le présent, fit semblant de mesurer l’étoffe, en se servant pour cela de sa bouche et du bras qu’elle pouvait manier ; et le morceau qu’elle serrait entre ses dents s’allongea tant et si bien, qu’il y eut plus de tissu qu’il n’en fallait pour confectionner et le vêtement de l’ecclésiastique et la robe de la fille.
La charité, telle qu’elle la comprenait, devait s’étendre à tout, devancer les besoins, être active et sans réticences.
Un soir que son confesseur et que quelques-uns de ses amis festoyaient ensemble, une voix se leva soudain, une voix douloureuse qui implorait l’aumône. Le prêtre, sans se hâter, ouvrit la porte et ne vit rien. Il s’était à peine remis à table qu’il entendit la même voix. Il sortit derechef et parcourut la rue, elle était déserte ; il rentra et comme, pour la troisième fois, la voix continuait de gémir, il se glissa par une autre issue et s’élança pour surprendre la personne qui le dérangeait ainsi ; mais il eut beau sonder la route, elle était vide !
Troublé par cet évènement, et convaincu qu’il n’était pas la victime d’une farce, il se rendit, après le dîner, avec ses convives chez Lydwine et la consulta.
— O hommes trop lents à écouter l’appel du pauvre, s’exclama-t-elle, c’était un de vos frères, les anges, qui proférait ces plaintes. Il est venu pour vous éprouver, et pour s’assurer si vous n’oubliiez pas le Seigneur dans vos réjouissances. Plût à Dieu que vous eussiez deviné qui il était !
Cette charité extraordinaire avivait encore sa passion des souffrances qui allait, d’années en années, en grandissant. Décharger le prochain de ses maux et les ressentir à sa place, lui paraissait une chose due et parfaitement juste ; si résolue, si impitoyable pour elle-même, elle ne pouvait voir pâtir les autres, sans vouloir aussitôt les soulager.
Elle accomplissait, sans faiblir, cette mission de la suppléance que le Sauveur lui avait confiée ; elle se substituait, ainsi qu’il fut narré, aux âmes du Purgatoire, pour achever de subir leur peine ; elle se subrogeait à la Hollande, à sa ville natale, pour expier par des châtiments leurs démérites.
A un moment, une guerre civile éclata à Schiedam. Comme toujours, au lieu de se défendre, les gens pacifiques s’enfuirent ; la cité risquait fort d’être saccagée par les vainqueurs et cependant l’un des hommes qu’ils poursuivaient et qui s’était, au début des hostilités, réfugié dans un autre hameau, revint et dit à des amis le suppliant de repartir :
— Je n’ignore pas le danger que je cours, mais je sais aussi que les prières de Lydwine me protégeront moi et la ville.
Ces paroles ayant été rapportées à la sainte, elle soupira humblement : je rends grâce au Seigneur qui inspire aux âmes simples une telle confiance en les prières de sa petite servante.
Et elle parvint en effet, — Dieu seul connaît en échange de quels nouveaux tourments ! — à déjouer les brigues et à réconcilier tous ces gens.
Une autre fois, elle dut encore intervenir auprès du Sauveur pour préserver la ville de la destruction qui la menaçait.
Une flotte ennemie qui avait déjà ravagé le littoral des autres provinces parut en face de Schiedam. Lydwine s’offrit en otage à Jésus, le supplia d’assouvir sa colère sur elle et, tandis que tous les habitants s’attendaient à être égorgés, la flotte, malgré ses efforts, malgré le vent qui lui était favorable, reculait au lieu d’avancer et elle finit par disparaître, repoussée, en quelque sorte, par les exorations de la sainte.
Elle était donc le paratonnerre de sa patrie ; mais quand elle avait été crucifiée pour tous, elle souhaitait encore de l’être pour chacun ; elle allait du plus grand au plus petit, du général au particulier ; elle le montra dans une autre circonstance.
Entendant, une matinée, des gémissements dans la rue, elle invita un ecclésiastique assis à son chevet à vérifier qui pleurait ainsi, au dehors. C’est une de vos amies qui est torturée par une rage de dents atroce, dit-il, en rentrant. Lydwine envoya aussitôt ce prêtre la chercher et, du ton le plus naturel, lui proposa d’endurer sa rage de dents, à sa place.
— Vous avez assez d’infirmités, répliqua la brave femme, sans encore vous charger des miennes ; priez seulement Notre Seigneur qu’il me délivre de cette crise.
Lydwine pria ; son amie fut dégrevée sur-le-champ, mais elle, elle souffrit tellement pendant vingt-quatre heures de la mâchoire, qu’elle en hurlait.
Ce transfèrement d’un mal d’une personne à une autre, par la voie de l’oraison, se complétait par un autre phénomène. De ces calamités corporelles accumulées sur une sainte émanaient de salutaires effluences, des propriétés célestes de guérison. Une vertu sortait d’elle, ainsi qu’il est dit du Christ dans les Évangiles ; sa pourriture engendrait la bonne santé pour les autres. C’est ainsi qu’un jour une femme dont l’enfant malade poussait des cris déchirants vint le déposer sur le lit de Lydwine. A peine y fut-il placé que ses maux cessèrent. Elle lui sourit et lui vanta, en des termes qu’il ne pouvait encore saisir, les délices de la chasteté ; et il se remémora ces leçons lorsqu’il grandit ; il les comprit et dès qu’il eut atteint l’âge de raison, il se fit religieux, en souvenir d’elle.
C’est ainsi encore qu’en Angleterre, un marchand qui n’avait jamais entendu parler de la sainte, se lamentait d’être affligé d’un mal de jambe incurable ; une nuit, tandis qu’il se désespérait, il s’endormit et une voix, en songe, lui dit : envoie quelqu’un en Hollande, à Schiedam ; il se procurera de l’eau dans laquelle une vierge du nom de Lydwine se sera lavé les mains et, tu l’appliqueras en compresse sur ton mal qui aussitôt s’évanouira.
Il dépêcha, dès son réveil, un messager à la sainte ; elle lui donna l’eau qui avait servi à ses ablutions et le marchand, dès qu’il en eut imbibé sa jambe, fut, en effet, guéri.
Il convient de remarquer que, dans tous ces miracles, Lydwine eut seulement recours aux obsécrations, car il est bien probable qu’en confiant un peu d’eau à l’anglais chargé de la rapporter dans son pays, elle pria pour la personne qui devait se lotionner avec ; elle était, en somme, plus passive qu’active, c’est-à-dire qu’elle n’agissait pas par elle-même, ainsi que beaucoup d’autres saints qui chassaient les infirmités, avec un signe de croix, un attouchement, une imposition des mains. Elle, s’en remettait à Dieu, le suppliait de l’exaucer ; elle jouait le rôle d’une intermédiaire entre les malades et Jésus et c’était tout.
Une seule exception apparaît dans sa biographie à cette règle qu’elle semblait s’être tracée ; ce fut le jour où une femme qui lui était chère, la veuve Simon peut-être, fut atteinte d’une fistule.
Lydwine l’incita d’abord à visiter les praticiens les plus renommés du pays. Ils furent tous d’accord pour déclarer qu’aucun espoir d’amélioration n’était possible. — Allons au grand médecin, fit alors la sainte. Elle se mit en prières, puis elle toucha doucement avec son doigt la fistule qui disparut.
Son inlassable charité ne se borna pas à des actes matériels, à des aumônes, à des cures, voire même à la suppléance des misères d’autrui ; elle s’exerça aussi dans le domaine spirituel et, là, elle pratiqua, une fois, la substitution mystique à un degré inconnu jusqu’à elle et dont il n’existe pas, je crois, un second exemple, dans les annales postérieures des saints.
Le fait que voici n’est-il pas, en effet, unique ? Je me contente de le raconter, tel qu’il figure dans les vies recueillies par les Bollandistes.
Un homme qui était un vrai scélérat fut assailli de remords, mais il n’osait s’adresser à un prêtre pour renverser devant lui, sa vie. Un jour que la grâce le torturait, il arriva chez Lydwine et, malgré sa résistance, il lui fit un aveu complet et détaillé de ses crimes, en la priant de les endosser et de les confesser à sa place.
Et elle accepta cette substitution d’âme et de personne. Elle appela un prêtre auquel elle confessa les turpitudes de cet homme, comme si elle les avait, elle-même, commises et elle accomplit la pénitence que le ministre lui infligea.
Quelque temps après, le sacripant revint.
— Maintenant, dit-il, que vous avez confessé mes péchés, indiquez-moi la pénitence que je dois pratiquer ; je vous jure que je l’exécuterai.
— Votre pénitence, c’est moi qui l’ai effectuée, répliqua Lydwine ; je vous demande seulement, pour votre mortification, de passer une nuit entière, sans bouger, sur le dos.
Le pécheur sourit, jugeant la coulpe douce et facile ; le soir, il s’étendit dans la position désignée et résolut, ainsi qu’il avait été convenu avec la sainte, de ne se tourner, ni sur le côté droit, ni sur le côté gauche ; mais il ne put s’endormir et cette immobilité ne tarda pas à lui paraître insupportable. Alors il réfléchit et pensa : je me plains et pourtant mon lit est moelleux et je n’ai pas, ainsi que la pauvre Lydwine, les épaules sur de la paille, à vif ; et cependant, elle est innocente, tandis que moi ! Le remords qui l’avait tant angoissé l’étreignit à nouveau ; il se révisa, pleura ses méfaits, se reprocha sa lâcheté et quand le jour eut commencé de luire, il courut se confesser à un prêtre, cette fois, et ce chenapan fut désormais intègre et cet impie devint pieux.
La tâche de Lydwine était d’autres fois moins pénible ; au lieu d’écouter les aveux de débauchés et de gredins, elle recevait les confidences de bonnes et de naïves gens ; tel, un ecclésiastique d’une admirable candeur qui l’aborda pour être éclairé sur l’état de son âme et de celles que son ministère l’obligeait à diriger. Lydwine l’accueillit aimablement mais elle refusa de répondre à certaines de ses questions qu’elle estimait indiscrètes ; persuadé qu’il lui avait déplu, il fut, en sortant de chez elle à l’église et s’agenouilla, en pleurant, devant l’autel de la Sainte Vierge.
Là, il tomba — ce qui ne lui était jamais arrivé — dans le ravissement et il vit une jeune fille s’avançant à sa rencontre, accompagnée de deux anges qui chantaient le « Salve Regina » et il fut empli d’une telle joie que son âme aurait éclaté, si l’extase n’avait aussitôt pris fin.
Dès qu’il eut ressaisi ses sens, il se précipita chez la bienheureuse.
— Eh bien, fit-elle, lorsqu’il entra, le beau temps succède à la pluie, mon père, n’est-ce pas ?
Surpris, il s’écria ; c’était donc vous qui marchiez escortée de deux anges, alors que j’étais prosterné dans la chapelle de la Madone !
Elle sourit, mais se tut.
Telle encore une excellente femme qui, tentée par le démon, sombra, après s’être vainement débattue, dans le désespoir ; ses amis ne parvenant pas à la remonter l’emmenèrent chez la sainte qui lui dit tout bonnement : tenez-vous en paix et attendez.
Quelques jours après, cette femme, projetée hors d’elle-même, se promena, ainsi qu’en un rêve, avec Lydwine dans un fastueux palais et elle y fut saturée de si impérieux parfums qu’une fois de retour sur la terre, les odeurs même les plus délicates lui paraissaient nauséabondes et que le cœur lui levait ; mais ses peines s’étaient évaporées dans le céleste tourbillon de ces senteurs et lorsque l’Esprit de Malice essaya encore de l’investir, elle subit ses assauts, sans fléchir.
Telle enfin une autre femme qui était mariée à une sinistre brute dont les incessantes colères se résolvaient en des dégelées de coups. Patientez, lui répétait Lydwine, alors qu’elle la suppliait d’obtenir par ses prières que ce butor devînt moins rogue ; mais les semaines se succédaient et la malheureuse n’en continuait pas moins à être battue comme plâtre, au moindre mot. Lasse de cette existence, elle résolut de se pendre ; des amis qui survinrent à temps l’en empêchèrent ; alors elle rumina de se noyer dans la Meuse et elle profita d’un moment où son mari était absent et où ses intimes ne la surveillaient pas, pour gagner le fleuve ; mais, chemin faisant, elle réfléchit : Lydwine a toujours été si dévouée pour moi que je ne veux pas cependant mourir sans lui dire adieu ; et elle se dirigea vers sa maison.
A cet instant, Lydwine, entourée de ses garde malades, s’exclama : allez au plus vite ouvrir la porte à celle qui va frapper, car son cœur se fond d’amertume !
Et dès qu’elle eut pénétré dans la chambre de la sainte, cette malheureuse s’affaissa sur les genoux et sanglota.
— Allons, ma bien chère, fit Lydwine, ne songez plus au suicide et retournez chez vous ; le bourreau que vous redoutez s’est changé en le plus affable des époux, je vous l’affirme.
Confiante en cette promesse, la femme, après avoir imploré et reçu la bénédiction de la malade, se rendit chez elle.
Son mari était couché et il dormait ; elle se déshabilla, sans bruit, pour ne pas le réveiller et s’assoupit à son tour ; le lendemain matin, elle trouva un homme souriant qui ne l’injuriait et ne la cognait plus. — Pourvu que cela dure ! pensa-t-elle, mais cela dura. — Ce rustre devenu par miracle si débonnaire, ne dévia plus.
Quelque incommensurable qu’elle fût, la charité de Lydwine n’était pas de celles que l’on pouvait facilement duper. La sainte décortiquait d’un coup d’œil les âmes et elle n’hésitait pas, quand cela lui semblait nécessaire, à les vitupérer ; c’est ainsi qu’elle écala une femme de Schiedam qui cachait sous une écorce de fragile dévotion une infrangible astuce ; celle-là extorquait des aumônes aux familles charitables de la ville et bombançait avec.
La veuve Catherine Simon la rencontra, un matin, dans la rue et, émue par ses plaintes et sachant qu’il n’y avait plus d’argent chez la sainte, la mena chez Jan Walter qui, leurré à son tour par ses pieuses jérémiades, l’aida ; mais, le lendemain, Lydwine, à qui personne n’avait pourtant raconté cette aventure, dit à Catherine :
— Cette créature vous a trompée, ainsi que mon confesseur ; soyez dorénavant plus prudente ; rappelez-vous cette parole des Écritures : il est des gens qui, sous un aspect d’humilité, cèlent des cœurs pleins de fraude et de malice et gardez-vous surtout de croire à tout esprit.
Elle fouaillait sans pitié les hypocrites qui avaient l’aplomb de vanter leurs vertus devant elle ; elle secoua, un jour, d’importance, une intrigante qui se prétendait vierge et affectait des allures outrées de bigote ; or, cette femme avait des relations avec un incube.
— Vous êtes vierge, vous ! s’exclama la sainte.
— Mais certainement que je le suis.
— Eh bien, ma fille, voulez-vous que je vous dise, vingt-cinq vierges de votre espèce danseraient aisément sur un moulin à poivre, répliqua Lydwine, attestant par cette comparaison d’un acte impossible à réaliser, la duplicité de cette papelarde qui n’insista pas d’ailleurs et sortit, furieuse d’être ainsi démasquée. Une jeune fille, qui assistait à l’exécution, fut choquée de cette sévérité et demanda à Lydwine pourquoi elle traitait si durement cette vierge.
— Ne répétez pas ce mensonge du Diable, s’écria la sainte ; cette femme est telle que Dieu la connaît. Quant à sa prétendue piété, il vous est loisible de l’éprouver. Allez chez cette dévergondée et signalez-lui quelques-unes de ses imperfections ; si elle vous écoute patiemment et les avoue, c’est moi qui m’abuse ; si, au contraire, dès les premiers mots, elle fume de colère, vous serez renseignée.
Cette jeune fille tenta l’expérience, mais elle tomba sur une forcenée qui l’agonit d’injures, dès qu’elle voulut lui parler de ses défauts.
Cette malheureuse mourut quelques mois après qu’elle se fut attiré ces remontrances, et comme Lydwine priait pour elle, vous perdez votre temps, lui assura son ange, elle est dans l’abîme d’où l’on ne s’échappe pas.
Une mésaventure de ce genre advint à un sacerdote qui lui dit, un matin : je vous quitte, car il faut que j’aille célébrer la messe.
— Je vous le défends bien, proféra Lydwine.
— Vous me le défendez ! Je serais curieux, par exemple, de savoir pourquoi ?
— Avez-vous donc oublié le péché contre le VIe commandement que vous commîtes hier ?
Il demeura muet et confus.
La sainte ajouta : mettez ordre à vos affaires, car vous mourrez dans trois jours.
Il geignit de frayeur, la supplia d’intercéder pour que son existence se prolongeât.
— C’est impossible, répliqua-t-elle, car il y a trop longtemps que cela dure et la mesure est comble ; tout ce que je puis vous promettre, c’est de prier ardemment pour votre salut.
Ce troisième jour, cet ecclésiastique se leva bien portant et il s’en fut, triomphant et un tantinet narquois, chez la malade.
— Eh bien, fit-il, ai-je la mine d’un homme qui va trépasser aujourd’hui ?
— Ne vous fiez pas à des apparences de santé ; à telle heure, vous ne serez plus, répartit Lydwine.
Et ce décès eut lieu, en effet, ainsi qu’elle l’avait prédit.
Une autre fois encore, elle déclara à une jeune fille, folle de son corps, qu’il lui fallait au plus vite changer de vie. Celle-ci s’engagea à se corriger et ne tint pas sa parole. Bientôt après, elle enfla ; tout le monde la crut enceinte. — C’est une tumeur due à sa corruption, soupira Lydwine ; et la malheureuse expira, sans gésine, après de longues souffrances.
Si elle tançait les femmes et les hommes de la classe populaire ou moyenne, elle réprimandait avec une égale franchise, les grands ; la noblesse, la richesse la laissaient parfaitement indifférente et elle n’épargnait pas plus les princes que les bourgeois et les prêtres. L’un d’eux, dont le nom ne nous a pas été conservé, vint d’un pays assez lointain pour l’entretenir d’un cas de conscience. Il se perdait en digressions, n’osait aborder carrément le chapitre de ses hontes, tournait, comme on dit vulgairement, autour du pot. Très simplement, elle appuya le doigt sur la plaie et, tenaillé par le remords, il pleura.
— Ah ! s’écria-t-elle, vous pleurez, Monseigneur, pour un péché bien moins grave que d’autres dont vous vous êtes également rendu coupable ; et ceux-là, vous n’y pensez même pas, tant votre conscience est aveuglée !
Et, brusquement, elle lui écartela l’âme et il en jaillit d’affreux méfaits qu’elle l’invita à confesser, sans aucun retard ; il écouta ce conseil et bien il fit ; car il fut à peine de retour dans ses États, qu’il mourut.
Parmi ces visiteurs qui se succédaient, du matin au soir, près de son lit, figurait un grand nombre de religieux. Plusieurs des réponses de Lydwine aux interrogations qu’ils lui posaient, ont été notées ; celles-ci, entre autres :
Un moine de Cîteaux, ayant été promu à l’épiscopat, trembla de peur et ne voulut point accepter cette charge ; avant toutefois de résister à ses supérieurs, il s’en fut consulter la sainte. Il biaisa avec elle, disant :
— Ma chère sœur, un de mes frères, ne se jugeant pas les ressources d’esprit nécessaires, refuse une prélature qu’on lui enjoint de recevoir ; l’approuvez-vous ?
Lydwine, qui savait très bien qu’il s’agissait de lui, répliqua :
— Je crains fort que les raisons alléguées par ce frère ne soient des subterfuges ; en tout cas, il est moine, soumis par conséquent à la règle d’obéissance ; s’il ne se décide pas à la suivre, il peut être sûr d’une chose, c’est qu’en cherchant à éviter un péril médiocre, il encourra un danger plus grand.
Le cistercien, mal convaincu, se retira et finalement déclina les honneurs de l’épiscopat ; mais ce refus ne lui fut pas propice, car, ainsi qu’il dut l’avouer plus tard, Dieu le fit passer par des tribulations autrement pénibles que celles qu’il avait résolu de fuir.
D’autres religieux arrivaient aussi qui étaient de ces esprits toujours inquiets, mal partout où ils sont et s’imaginant qu’autre part ils seraient mieux ; Lydwine avait grand’pitié de ces âmes nomades ; elle tâchait de remonter ces malheureux, de les persuader que l’on ne devient pas meilleur, en changeant de place, qu’on emporte son âme avec soi, qu’il n’y a qu’une façon de la lénifier et de la fixer, c’est de l’assujettir à l’obéissance, de la spolier de toute volonté, de la confier humblement à la garde de son abbé et de son directeur ; et quelquefois, elle parvenait à les apaiser, à leur faire aimer cette cellule qui, ainsi que le dit l’Imitation, est vraiment douce quand on la quitte peu et engendre un mortel ennui lorsque souvent on s’en éloigne.
D’autres encore la suppliaient de les préserver des tentations ou d’écarter celles d’autrui ; tel un chanoine régulier appartenant à un monastère, situé à Schonhovie et distant d’à peu près sept lieues de Schiedam. Celui-là doutait de sa vocation qui, aux yeux de ses maîtres, était certaine. Le prieur, le P. Nicolas Wit essayait vainement de le consoler ; mais ni les conseils, ni les objurgations, ni les prières ne le pacifiaient ; le moment vint où ce chanoine se détermina à jeter le froc. Le prieur, désespéré de cette résolution et navré du scandale qui allait en résulter, conduisit cet infortuné chez la sainte.
Elle souffrait, à ce moment-là, le martyre et le moindre bruit la rendait quasi folle ; elle consentit cependant à voir Nicolas Wit, mais à condition qu’il entrerait seul.
— Mon très cher père, lui dit-elle, je vous prie de m’excuser si je prends, la première, la parole, mais j’y suis contrainte par mes tortures qui ne me permettent pas d’entendre la voix des autres et me forcent, moi-même, à peu parler ; le brave religieux que vous avez amené avec vous est durement pressuré par Notre-Seigneur, mais assurez-le que son épreuve sera courte ; qu’il ne perde pas courage et, vous, mon père, continuez à l’adjuver de vos prières.
L’étonnement du prieur fut inexprimable. Il ne savait que répondre. Alors la sainte lui dit : adieu, exhortez bien votre frère à la patience et ne m’oubliez pas devant Dieu.
Et le chanoine fut, effectivement, affranchi de ses obsessions, ainsi qu’elle l’avait annoncé.
Elle excellait à balayer les scrupules, à conforter les malheureux désorbités par l’ingénieuse cautèle du Démon.
A Schiedam, une femme était victime de noises de ce genre ; elle était agitée de la manie des scrupules et égarée à ce point qu’elle ne vivait plus qu’à l’état de vertige et était prête à succomber au désespoir, à tout instant. Le Diable l’affolait, en lui montrant, pendant son sommeil, un écrit mentionnant certain péché qu’elle avait pourtant confessé.
— Tu as beau avoir reçu l’absolution et avoir accompli la pénitence qui te fut imposée, ce péché-là ne peut être pardonné ni dans ce monde, ni dans l’autre, lui criait-il ; de quelque côté que tu te tournes, tu es damnée.
Cette femme se mourait de terreur quand une voix intérieure lui dit : cours chez Lydwine. Elle ne fit qu’un saut chez elle et se rua dans sa maison, comme une bête traquée ; elle s’y éplora, en clamant qu’elle était une âme perdue, une réprouvée.
— Cette cédule dont l’Esprit de ténèbres vous menace n’est qu’un mensonge, affirma Lydwine. Je prierai le Seigneur de la supprimer ; rassurez-vous donc et n’y songez plus.
Et aussitôt qu’elle fut sortie, Lydwine supplia le ciel de dégager des rets infernaux cette malheureuse ; et elle fut, au même moment, ravie en extase, et elle vit la Sainte Vierge arracher des mains de Satan cet écrit et le lacérer.
Elle revint à elle ; les morceaux déchirés de ce parchemin jonchaient son lit ; son confesseur Walter qu’elle fit quérir les examina et la femme fut exonérée.
Une autre histoire étrange est celle d’un des échevins de Schiedam. Il avait pour directeur un chapelain qui célébrait souvent la messe devant lui, Jan Pot, dit Gerlac ; un vicaire de la paroisse, note Brugman qui omet de citer le nom.
Y a-t-il identité entre ce vicaire et Jan Pot ? Je ne vois pas de sérieuses raisons qui empêchent de le croire.
Or, ledit échevin était hanté du désir de se pendre. Jan Pot ayant épuisé tous les moyens dont il disposait pour empêcher ce suicide, recourut à la sainte.
— Il s’agit, en l’espèce, d’une tentation diabolique, assura-t-elle ; voici de quel expédient il vous sied d’user. Après avoir confessé cet homme, vous lui infligerez, comme pénitence, d’avoir justement à se pendre.
— Et s’il le fait ?
— Il s’en gardera bien ; le Malin qui l’incite à se brancher, sous prétexte d’humeur noire, ne le laissera jamais se tuer, par obéissance surnaturelle ; il hait trop le sacrement pour cela !
Encore qu’il eût grande confiance dans les lumières de Lydwine, Jan Pot partit de chez elle, très démâté.
Il préféra tergiverser avec le monomane, mais l’heure vint où il fallut pourtant se décider. La famille de cet homme devait, à chaque instant, lui arracher la corde dont il voulait se cravater. Poussé à bout, Jan Pot suivit les instructions de Lydwine. Vous vous pendrez en expiation de vos péchés, ordonna-t-il, à l’échevin qui retourna, enchanté, chez lui. Il attacha, en hâte, à une solive du plafond, une corde qu’il se noua autour du cou, grimpa sur un escabeau, et il allait s’élancer dans le vide, lorsque, grinçant des mâchoires, les démons crièrent : « ne te tue pas, malheureux, ne te tue pas ! »
En même temps, l’un d’eux cassait le licol tandis qu’un autre empoignait le patient et le jetait entre une énorme malle et le mur ; et le coup fut si violent qu’il resta évanoui, comprimé, pendant trois heures, sans pouvoir reculer la malle et se lever ; à la fin, ses parents qui le cherchaient partout le découvrirent à moitié écrasé dans cette ruelle et quand ils l’en eurent retiré, il bénit le Seigneur et jura bien qu’il était à jamais guéri de cette démence.
Et Brugman ajoute, un peu effaré par la manière dont Lydwine trancha cette situation, la réflexion chère aux catholiques qu’un rien ébroue : « C’est là une de ces actions que l’on doit admirer mais qu’il faut surtout ne pas imiter. »
Si elle était d’audacieux avis et de hardi conseil, elle était aussi singulièrement humble lorsqu’elle était contrainte de résoudre des problèmes qu’elle ne pouvait connaître. Dieu lui donnait alors la science infuse, l’éclairait de telle sorte qu’elle stupéfiait les théologiens acharnés à la confondre.
L’un d’eux en fit l’essai ; c’était un dominicain, professeur de théologie à Utrecht ; il s’arrêta à Schiedam et, après quelques feintes, il dit nettement à Lydwine :
— Je veux que vous m’expliquiez la façon dont les Trois Personnes ont opéré dans le sein de la Vierge Marie l’Incarnation du Verbe.
Surprise, elle se récusa ; mais le dominicain le prit de haut et, d’un ton de commandement, cria : je vous adjure par le jugement du Dieu vivant de répondre, et tout de suite, à ma demande !
Lydwine, effrayée par cette brutale injonction, pleura ; mais, comme malgré ses larmes, ce religieux insistait d’une voix de plus en plus menaçante, elle s’essuya les yeux et répliqua :
— Mon père, pour vous permettre de bien saisir ma pensée, je dois recourir à une comparaison ; j’imagine un corps solaire d’où sortent trois rayons qui se réunissent et se fondent en un seul ; ils sont larges à leur point de départ, mais ils se rapprochent les uns des autres à mesure qu’ils s’en éloignent et s’amincissent si bien qu’ils finissent par s’aiguiser à leur extrémité, en une seule pointe ; cette pointe, elle se dirige vers l’intérieur d’une petite maison ; vous voyez déjà par cette image ma pensée, n’est-ce pas ? néanmoins, pour plus de clarté, je la développerai, si vous le voulez bien ; par le corps solaire, j’entends la Divinité elle-même, par les trois rayons distincts qui s’en échappent les trois Personnes ; par leur sortie tendant au même but l’unité de l’opération à laquelle les trois Hypostases concourent ; par l’extrémité de la pointe le Verbe ; cette pointe qui pénètre dans un intérieur signifie donc l’entrée de Jésus dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie où il prit une partie de son sang, de sorte qu’il y eut en Lui, après qu’il se fut revêtu de la chair, deux natures et une seule Personne, la Personne du Fils.
Le dominicain fut frappé de la lucidité de cette explication et il la quitta, convaincu qu’elle était bien, en effet, animée de l’esprit de Dieu.
Après ce frère-prêcheur qui semble avoir été assez mal embouché, ce fut le tour d’un receveur d’impôts, homme vaniteux et cupide ; celui-là vint avec l’intention de lui soumettre des questions captieuses et de la réfuter.
Familièrement, il l’aborda et commença :
— Je suppose, Lydwine, que vous ayez le Seigneur présent devant vous sur l’autel en l’hostie renfermée dans la monstrance et qu’en même temps vous voyiez le même Seigneur vous apparaître sous la forme visible qu’il eut sur la terre ; auquel des deux rendriez-vous hommage ?
Elle se tut et pleura ; puis, tandis que ce mécréant se flattait de l’avoir réduite au silence, d’un ton singulièrement imposant, elle dit :
— Des personnes doctes et vénérables m’ont parfois harcelée d’interrogations spécieuses, à l’effet de m’éprouver, mais je ne me souviens pas que l’on m’ait encore adressé une sommation plus choquante que celle de ce percepteur dont l’âme ne vénère que les sacs d’écus.
Des témoins, assis dans la chambre, qui savaient que la sainte ne connaissait ni cet individu, ni sa profession, ni son vice, rougirent pour lui, et partirent, pendant que lui-même fuyait, gêné d’être ainsi démasqué devant des tiers, de son côté, seul.
On abusait, d’ailleurs, plus ou moins poliment de sa patience ; sous prétexte qu’elle était de caractère bénin et d’opinion utile, l’on venait pour des vétilles, l’empêcher de souffrir à son aise ; et combien qui la dérangeaient de ses méditations, de ses colloques avec les anges, par simple curiosité pour savoir, par exemple, quand aurait lieu l’avènement de l’Antechrist qu’elle disait devoir être certifié, l’année où il naîtrait, par ce signe que, dans son pays d’origine, trois gouttes de sang découleraient de chaque feuille d’arbre ; ou bien encore pour la consulter sur des cas oiseux tels que celui-ci, présenté par une femme qui s’était introduite chez elle, afin de lui demander s’il valait mieux qu’elle travaillât ou quelle se tournât les pouces.
Et elle avait la complaisance de se retenir de crier quand elle peinait, pour répéter ce que tout le monde sait, que l’oisiveté est un tremplin de vices, que puisque cette femme s’avérait sans fortune mais habile à tisser la laine, elle devait exercer ce métier et vivre honnêtement avec ; seulement, elle ajoutait :
— Au lieu d’entreprendre ce commerce dans l’espoir de gagner de l’argent, il convient de l’entreprendre dans le but d’aider les indigents ; donc, chaque fois que vous acquérerez un lot de toisons, vous en réserverez une pour les pauvres du Seigneur ou, si vous le préférez, vous leur conserverez cinq deniers sur le produit de la vente de chacune de vos étoffes, en souvenir des cinq plaies du Sauveur ; enfin, vous aurez soin de ne pas exploiter la misère des ouvrières que vous embaucherez ; vous les paierez exactement, sans abuser de leur travail, et je vous garantis que Dieu bénira vos efforts.
Cette femme suivit ces avis à la lettre et réalisa d’abord, en demeurant probe, d’enviables gains ; mais vint une année où elle dut se débarrasser de ses marchandises à perte et, pour se rattraper de ses méventes, elle trompa son fournisseur de toisons et de laines, en le frustrant d’une pièce d’or. Ce marchand qui décéda, peu après, apparut à Lydwine, lui révéla le dol de sa cliente, et exigea qu’elle employât la somme dérobée à acheter des cierges et à commander des messes pour le repos de son âme. La sainte fit aussitôt quérir la voleuse qui, stupéfiée de se voir reprocher un larcin que tout le monde ignorait, satisfit aux désirs du défunt et s’amenda.
Quelquefois, ces fâcheux, qui l’importunaient avec leurs requêtes, éprouvaient d’amusants mécomptes ; le résultat de ses prières n’était pas précisément celui qu’ils espéraient ; exemple, ce chanoine qui lui dit :
— Je vous serai obligé d’exorer le Sauveur pour qu’il m’élague de ce qui lui déplaît le plus.
La sainte accepta de prier à cette intention ; peu de temps après, ce chanoine, qui était doué d’une voix magnifique, devint aphone. Il consulta les médecins, usa de tous les gargarismes, de tous les électuaires inventés par la pharmacopée de son temps, ce fut en pure perte ; il ne s’extrayait de la gorge que des râles étouffés ou des sons rauques ; l’un de ses confrères finit par s’écrier, un jour qu’il assistait à une nouvelle réunion d’empiriques : laissez donc cela ; vos sédatifs et vos émollients sont inutiles, la voix tonitruante de M. le chanoine est à jamais perdue !
— Et pourquoi cela ?
— Parce que j’étais avec lui, lorsqu’il pria Lydwine de lui faire retrancher le défaut qui lui nuisait le plus ; or, notre ami tirait un peu vanité de l’ampleur superbe de son chant ; le voilà délivré de cette imperfection ; l’intercession de la sainte a été exaucée ; c’est pour le mieux.
Et il est à croire que cette disgrâce servit à son avancement spirituel, conclut gravement le bon Brugman.
L’on pourrait s’imaginer qu’après des journées passées tout entières à recevoir des visites, des journées qui l’exténuaient, car, au rapport de ses biographes, elle avait le visage en feu, inondé de sueur et tombait en défaillance quand les gens sortaient, Lydwine reprenait haleine et se reposait un peu. Nullement ; elle profitait d’un moment libre, entre deux audiences, pour s’occuper alors de ceux que sa voyance lui montrait, menacés de quelque danger. Elle leur dépêchait un messager ou leur écrivait, pour les prévenir. Ainsi agit-elle envers un négociant qu’elle aimait et qu’elle empêcha de s’embarquer avec des camarades sur l’un des navires alors en partance pour la Baltique.
Mais, dit le marchand, ahuri par ce conseil, si je ne pars pas en même temps que mes compagnons, il me faudra effectuer, seul, ce long et ce périlleux voyage ! — Et comme, sans s’expliquer davantage, Lydwine insistait pour qu’il l’écoutât, — il obéit assez tristement, car tous ses amis se raillèrent de sa crédulité ; cependant, la flottille avait à peine gagné la pleine mer qu’elle fut abordée par des pirates qui la coulèrent bas ; et ceux des passagers qui ne se noyèrent point furent emmenés en captivité. Le protégé de la sainte s’aventura, seul, après, et revint de son expédition sans avoir, pendant l’aller et le retour de la traversée, subi la moindre encombre.
Une autre fois, ce don que Dieu lui avait accordé de la double vue lui permit d’assister de chez elle à la scène que voici :
Un soir, un des plus merveilleux soulauds de Schiedam, un nommé Otger, s’attabla dans une des tavernes de la ville avec d’autres ivrognes ; ceux-ci, après avoir humé de copieuses rasades, s’avisèrent, avant de rouler sous la table, de déblatérer contre Lydwine. A les entendre, elle festinait en cachette et était, à la fois, une hypocrite et une possédée ; bien qu’il eût, ainsi que ses camarades, l’armet échauffé par la boisson, Otger ne put s’empêcher de s’indigner et s’exclama :
— Écoutez, mieux vaudrait nous taire que de calomnier de la sorte une pauvre fille malade, que tout le monde sait être et pieuse et charitable : notre habituelle sottise nous incite à commettre assez de fautes sans encore que nous y ajoutions celle-là !
Cette leçon les irrita et l’un des plus enragés de ces pochards gifla Otger en criant : comment ! toi qui es né et nourri dans le péché, tu as l’aplomb de nous morigéner ? allons, vaurien, file et au plus vite !
— Je reçois ce soufflet sans me venger, fit Otger subitement dégrisé ; je le reçois parce qu’il m’a été donné pour avoir défendu l’honneur d’une sainte ; et il partit.
Lydwine suivait, de son lit, cette scène. Elle envoya chercher Jan Walter, le mit au courant de l’incident et lui dit :
— Demain matin, père, vous vous rendrez, dès la première heure, chez ce brave homme et vous lui répéterez ceci : Lydwine vous remercie de la part de Dieu d’avoir été frappé pour elle ; et elle me charge aussi de vous attester que vous serez récompensé.
— Mais, demanda Otger au prêtre, comment Lydwine a-t-elle pu apprendre un fait qui s’est passé très tard, hier, dans la nuit, et qui n’a pas eu le temps de s’ébruiter ?
— Qu’il vous suffise d’être certain qu’elle l’a appris, répartit Walter ; ayez confiance et vous verrez que sa prophétie s’accomplira.
Ce mystère l’obsédant, Otger pensa souvent à la triste existence de la sainte et la compara à la sienne. Honteux de cette vie qui consistait à s’attabler dans des salles enfumées, devant des tables chargées de fioles et de brocs et là, à s’engouffrer des pintes en compagnie de godailleurs dont les divagations augmentaient à mesure que la cervoise et le vin diminuaient dans les pots, il résolut de rompre avec ses anciens amis et de ne plus fréquenter les cabarets. Cette déshabitude lui fut d’abord pénible. Il errait, désœuvré ; mais il eut le courage de tenir bon et d’appeler le ciel à son aide ; et, secouru par les prières de son amie, il trépassa, après de salutaires épreuves, dans la paix désirée du Seigneur.
Cette faculté que possédait Lydwine de voir à distance avait fini par être admise presque sans conteste, à Schiedam et elle ne contribuait pas peu à lui amener une foule d’intrus qui venaient chez elle, comme l’on va maintenant chez une somnambule.
Nous pouvons encore citer trois cas de ce don de voyance :
Le premier a trait à un duel. La mère de l’un des adversaires se lamentait chez Lydwine, la suppliant de prier pour que son fils ne fût pas tué. Ne craignez rien, répondit la sainte ; les deux ennemis s’embrassent ; aucun combat n’aura lieu. Et effectivement, la réconciliation se scellait au moment même où elle l’annonçait.
Les deux autres concernent des religieux.
Un matin, un augustin, originaire de Dordrecht et qui avait fait quelques jours avant profession dans un couvent de chanoines réguliers d’Eemstein, entra, en traversant Schiedam, chez elle ; elle le salua aussitôt par son nom, lui parla de sa profession comme si elle y avait assisté et alors qu’ébahi, il s’écriait :
— C’est trop fort ! Comment me connaissez-vous ?
Elle lui répliqua simplement : mais, par le Seigneur, mon frère !
Une autre fois, un bourgeois appelé Wilhelm de Haga voulut avoir des nouvelles de son fils disparu, sans laisser de traces, depuis plusieurs mois. Il avait à peine franchi le seuil de sa chambre, qu’elle le saluait, lui aussi, par son nom et, sans attendre qu’il la questionnât, lui disait :
— Apprenez que, par une insigne faveur du Christ, votre fils Henri a été reçu et va prononcer ses vœux à la Chartreuse de Diest.
Ce bonhomme, abasourdi, eût désiré en connaître plus long et il insista pour être renseigné sur l’origine et la certitude de sa double vue.
— De grâce, fit-elle, cessez vos interrogations ; je suis souvent forcée par charité de distribuer à mon prochain les feuilles de mon arbre, mais la racine ne leur appartient pas et doit demeurer dans la terre, cachée ; contentez-vous donc de cette feuille que je vous ai, de mon plein gré, offerte et n’en réclamez pas davantage.
Ces deux derniers faits ont été confiés à Thomas A Kempis par le P. Hugo, sous-prieur du monastère de sainte Élisabeth, près Brielle, qui les tenait, lui-même, des intéressés.
L’on se demande comment, vivant dans un pareil tohu-bohu de monde, la pauvre fille pouvait se recueillir et suivre ce chemin de croix qu’elle s’était si strictement tracé. La vérité est peut-être que l’Esprit Saint parlait par sa bouche, alors qu’elle était, elle-même, absorbée en Dieu, loin des assaillants ; moins sévère que ses anges que ces visites agaçaient, Notre-Seigneur restait près d’elle.
Peut-être aussi faisait-elle, ainsi que sainte Gertrude qui feignait, en pareil cas, de s’assoupir, pour se recouvrer ne fût-ce qu’une seconde, mais ses réelles heures de tranquillité étaient certainement celles de la nuit. Comme elle ne dormait plus et que son logis était enfin vide de clients, elle était libre alors de s’évader hors d’elle-même, de se serrer doucement contre l’Époux, de prendre à son contact une provision de patience et de courage, pour supporter les douleurs du lendemain.
Sa chambre était un hôpital d’âmes toujours plein ; l’on y accourait de tous les points du Brabant et de la Flandre, de l’Allemagne, de l’Angleterre même ; mais si souvent d’inutiles curieux et d’impertinents personnages la persécutaient de leur présence, combien d’infortunés infirmes se pressaient autour de sa couche, combien de gens désemparés par la vie s’agenouillaient à ses pieds !
C’était sans doute là la partie la plus pénible de sa tâche ; il fallait consoler ce pauvre monde, ranimer et tonifier l’âme de tous ces malades venus pour demander à une plus malade qu’eux un réconfort.
C’était près de cette suppliciée qui étouffait ses plaintes, un chœur de gémissements entrecoupé parfois par des exclamations d’impatience et par des cris de colère. Poussés à bout par leurs souffrances, des impotents s’élevaient contre ce qu’ils appelaient l’injustice de leur destinée, voulaient connaître pourquoi la main de Dieu s’appesantissait sur eux et non sur les autres, exigeaient que Lydwine leur expliquât l’effrayant mystère de la Douleur et les soulageât.
Ceux-là la torturaient, car ils étaient des désespérés qui se pendaient après elle et ne consentaient pas à lâcher prise. D’aucuns entendaient qu’elle les guérît et quand elle répondait que cela ne dépendait pas d’elle mais du Seigneur, ils s’entêtaient à ne pas la croire et lui reprochaient de manquer de pitié.
Et ce qu’elle en acceptait pourtant des maladies pour les subir à la place de personnes qui ne lui en savaient souvent aucun gré !
Vous vous tuez pour des gens qui ne le méritent guère, lui répétaient ses amis ; mais elle répliquait :
— Comptez-vous donc pour peu de chose de conserver autant que possible au Sauveur des âmes que le Démon guette ; et d’ailleurs, quel homme a droit d’être rebuté, alors qu’il n’en est pas un seul pour lequel le Fils de la Vierge n’ait versé son sang !
Et elle recevait indistinctement tous les malheureux, se bornant à soupirer, quand ils la quittaient, mécontents : les hommes charnels ne peuvent comprendre combien la vertu se perfectionne dans l’infirmité, combien même, la plupart du temps, elle ne naîtrait pas sans elle.
Gerlac et Thomas A Kempis ne nous renseignent que peu ou plutôt pas du tout sur ces entretiens. Brugman, lui, saisit cette occasion, comme toutes celles qu’il rencontre du reste, pour placer un prêche et attribuer à la sainte une série de rengaines que, manifestement, il invente.
Comment ne point noter, à ce propos, sa rhétorique essoufflée et l’obscure indigence de son latin ! Sous prétexte d’être énergique, il nous sert sans relâche des expressions imagées telles que « les coloquintes et les absinthes de la Passion » ; sous prétexte d’être pathétique, il apostrophe à tout bout de champ Lydwine et nous interpelle ; sous prétexte d’exprimer sa tendresse, il use de tous les diminutifs qu’il peut imaginer. Elle devient, sous sa plume, la petite servante du Christ, la petite femme, la petite pauvresse, la petite plante, la petite rose, la petite agnelle, Lydwinula, la petite Lydwine ! Le moindre document exact ferait beaucoup mieux notre affaire que toute cette afféterie de sentiments ; mais de cela, il faut se contenter ; enfin, en l’absence de conversations saisies sur le vif, il semble cependant possible, étant donné les idées de la sainte, de deviner ce qu’elle répondait à tant de récriminations, à tant de doléances.
A ces femmes qui, en accusant la cruauté du ciel, pleuraient à chaudes larmes sur leurs infirmités ou sur les traverses de leur ménage, elle devait répliquer : lorsque vous êtes en bonne santé ou lorsque votre mari ou vos enfants ne vous tourmentent point, vous ne pratiquez plus. Combien de prêtres, assaillis, pendant des mois, à leur confessionnal, par des troupes de pénitentes consternées, s’en voient, tout à coup, un beau matin, débarrassés ! et point n’est besoin de s’enquérir des causes de ces désertions ; ces femmes s’éloignent du Sacrement, tout simplement parce que leur sort a changé, parce qu’elles ne sont plus malheureuses ; l’étonnante ingratitude de la nature humaine est telle ; dans le bonheur, Dieu ne compte plus. Si toutes ses brebis étaient et fortunées et valides, le bercail serait vide ; il sied donc que, dans leur intérêt même, le Berger les ramène et il n’a d’autre moyen, pour les rappeler, que de leur dépêcher ses terribles chiens de garde, les maladies et les revers.
A ces hommes qui, navrés du déchet de leur santé ou désolés par des calamités de toute sorte, s’irritaient, reprochaient au Créateur leur malechance, elle devait aussi répondre : vous ne revenez à Jésus que parce que vous êtes maintenant dans l’impuissance de continuer vos ripailles et de pressurer, sous couvert de commerce, votre prochain. Vous ne lui apportez que les ruines de vos corps, que les décombres de vos âmes, que des résidus dont personne ne voudrait. Remerciez-le donc de ne pas les rejeter ; vous vous alarmez de souffrir, mais il convient au contraire de vous en aduler ; plus vous pâtirez ici-bas et moins vous pâtirez, là-haut ; la douleur est une avance d’hoirie sur le Purgatoire ; mettez-vous bien dans la tête que la miséricorde du Sauveur est si démesurée qu’elle emploie les plus minimes bobos, les plus minuscules ennuis au paiement des plus inquiétantes de vos dettes ; rien, pas même une migraine n’est perdu ; si Dieu ne vous frappait pas, vous persisteriez à être, jusqu’à l’heure de votre mort, insolvables ; acquittez-vous donc, tandis que vous le pouvez et ne rechignez pas à endurer cette douleur qui est seule apte à refréner vos instincts de luxure, à briser votre orgueil, à amollir la dureté de vos cœurs. Le proverbe « le bonheur rend égoïste » n’est que trop vrai ; vous ne commencez à éprouver de la compassion pour les autres que lorsque vous en avez, pour vous-même, besoin ; le bien-être et la vigueur vous stérilisent ; vous ne produisez des actes vaguement propres que lorsque vous êtes éclopés ou réduits à l’indigence.
Et elle eût pu ajouter, avec l’une de ses futures héritières, la sœur Emmerich : « je vois toujours dans chaque maladie un dessein particulier de Dieu, ou le signe d’une faute personnelle ou d’une faute étrangère que le malade, qu’il le sache ou non, est obligé d’expier — ou bien encore une épreuve c’est-à-dire un capital que le Christ lui assigne et qu’il doit faire valoir par la patience et la résignation à sa volonté sainte. »
Mais combien, parmi ces visiteurs, qu’il fallait convaincre que le Seigneur n’agit pas autrement qu’un chirurgien qui ampute les parties gangrenées et qui torture celui qu’il opère pour le sauver ! combien ne se rebellaient et ne s’épandaient point en des serments d’ivrognes, promettant d’être sages, s’ils étaient guéris ! combien n’en revenaient pas à leur question oiseuse, à leur enquête obstinée : pourquoi moi et pas tant d’autres qui sont plus coupables ? Et elle devait encore leur expliquer que, d’abord, ils n’avaient pas à juger les autres et ignoraient d’ailleurs si plus tard ceux-là ne seraient pas à leur tour durement traités ; ensuite que si Dieu comblait toujours les bons de biens et les méchants de maux, il n’y aurait plus ni mérites, ni profit de foi ; du moment que la Providence serait visible, la vertu ne serait plus qu’une affaire d’intérêt et la conversion que le résultat d’une crainte servile ; ce serait la négation même de la vertu, puisqu’elle ne serait, ni généreuse, ni détachée, ni gratuite ; elle deviendrait une couardise blanchie, une sorte de trafic, une succursale du vice, en un mot. A d’autres visiteurs, à des gens qui n’étaient plus atteints, ceux-là, dans leur organisme, dans leurs moyens d’existence et qui l’abordaient, fous de chagrin, parce qu’ils avaient vu mourir un mari, un enfant, une mère, un être qu’ils idolâtraient, à des hommes qui, après les obsèques de leurs femmes, lui confessaient leur hantise de se jeter dans la Meuse, elle devait, après de consolantes paroles, leur demander :
— Voyons, affirmeriez-vous que celle que vous pleurez est avec les élus, dans le Paradis ? non, n’est-ce pas ; car, sans dénier ses vertus, il est permis de croire qu’elle subit, selon la règle commune, un stage plus ou moins long d’attente, qu’elle séjourne, pour une durée que Dieu seul connaît, dans le Purgatoire.
Ne comprenez-vous pas dès lors que seul, avec vos prières, votre chagrin peut l’en tirer ? ce qu’elle n’a pas eu l’heur de souffrir, elle-même, pour s’épurer, ici-bas, vous le souffrirez à sa place ; vous vous substituerez à elle et vous achèverez ce qu’elle n’a pu terminer ; vous paierez en douleur sa rançon et plus votre douleur sera vive et plus tôt sera soldée la dette contractée par la défunte.
Qui vous dit même que Notre Seigneur, touché par votre bonne volonté et vos suppliques, ne fera pas à votre femme une avance sur votre deuil et qu’il n’antécédera pas sa délivrance ?
Et vous serez alors payé, en retour de vos peines ; votre femme se fera la complice du temps ; elle apaisera l’élancement de vos plaies, elle amortira le regret de son souvenir ; elle ne le vous laissera plus qu’à l’état souriant, qu’à l’état lointain et doux ; ne parlez donc pas de vous suicider, car en dehors de la perte même de votre âme, ce serait la négation absolue de votre amour ; ce serait l’abandon de celle que vous prétendez aimer, au moment où elle se trouve en péril ; vous risqueriez de replonger dans les bas-fonds du Purgatoire celle qui montait déjà à sa surface ; et quant à vous, vous vous priveriez par ce crime de l’espérance de jamais la revoir.
Et, simplement, elle devait conclure : admirez la bonté du Créateur qui fait, en ce cas, souffrir l’un pour affranchir l’autre. Pensez que l’amour humain qui n’est qu’une parodie du véritable amour exclut Dieu bien souvent, qu’il est une forme de l’égoïsme à deux, car pour les gens qui s’aiment vraiment, le reste du monde n’existe pas ; et il est équitable pourtant que cet oubli du Seigneur et que cette indifférence envers le prochain s’expient !
A d’autres, à des malades, à des incurables surtout qui s’écriaient : vous avez guéri une telle, ô ma bonne Lydwine, guérissez-moi ! elle répliquait : mais je ne suis rien, mais ce n’est pas moi qui guéris, mais je ne peux pas ! — et elle pleurait de les voir si acharnés et si tristes. — Elle les suppliait, à son tour, de se résigner, elle soupirait : rentrez en vous-même et réfléchissez ; ne maudissez pas cette douleur qui vous désespère, car elle est la charrue dont le diligent Laboureur use pour défoncer les terres de vos âmes et y semer le grain ; dites-vous que, plus tard, les anges engrangeront pour vous dans les celliers du ciel des moissons qu’ils n’auraient jamais récoltées si le soc des souffrances n’avait déchiré votre pauvre sol ! Les Rogations des infirmes sont les plus agréables qui soient à Dieu !
La Douleur ! à des prêtres, à des hommes plus experts dans les voies du Seigneur et démâtés, eux aussi pourtant, par la bourrasque, elle devait rappeler que ces mots Douleur et Amour sont presque des synonymes, que la cause du mystère de l’Incarnation et du mystère de la Croix est non seulement l’amour de Jésus pour nous et son désir de nous racheter, mais aussi l’amour indicible qu’il porte, en sa qualité de Fils, au Père.
Ne pouvant, ainsi qu’un fidèle sujet, lui donner une marque déférente de cet amour, ne pouvant le glorifier en tant que son supérieur et son maître, puisqu’il est en tout son égal, il résolut de s’abaisser, en s’incarnant, si bien que, tout en demeurant son égal par sa nature divine, il ne l’est plus par sa nature humaine et il lui est dès lors possible de lui rendre des hommages infinis, de lui témoigner sa dilection et son respect, par voie d’anéantissement, de souffrances et de mort.
Si la Douleur n’est pas l’exact synonyme de l’Amour, elle en est, en tout cas, le moyen et le signe ; la seule preuve que l’on puisse administrer à quelqu’un de son affection, c’est de souffrir lorsqu’il le faut, à sa place, car les caresses sont faciles et ne démontrent rien ; dès lors, celui qui aime son Dieu doit souhaiter de peiner pour Lui.
Tel devait être le langage de la sainte ; elle répétait certainement aussi aux âmes plus spécialement désignées pour l’œuvre réparatrice des holocaustes, les leçons qu’elle-même avait apprises de Jan Pot, leur avouait qu’à ce degré d’altitude, les sensations s’égarent, que la souffrance se volatilise aux flammes de l’amour, qu’on la convoite, qu’on l’appelle pour entretenir le bûcher permanent du sacrifice, que Dieu, à son tour, le modère et l’attise ce bûcher, pour tenir l’âme en haleine, qu’il alterne les allégresses et les navrements, que les grâces sont les avant-coureurs des épreuves et que les tribulations ne précèdent que de bien peu les liesses ; et elle certifiait sans doute encore que pour les amoureux du Sauveur, la souffrance proprement dite n’existe plus, qu’elle n’est plus, en tout cas, qu’une sorte de compromis entre deux sensations extrêmes, dont l’une même s’efface, cède le pas à l’autre, à celle de la jubilation et du ravissement.
Et cette vérité dont elle était le vivant exemple, elle a été et elle sera exacte dans tous les temps. Il n’est point de saints qui, depuis la mort de Lydwine, ne la confirment.
Écoutez-les formuler leurs vœux :
Toujours souffrir et mourir, s’écrie sainte Térèse ; toujours souffrir et ne pas mourir, rectifie sainte Madeleine de Pazzi ; encore plus, Seigneur, encore plus ! s’exclame saint François Xavier, agonisant de douleurs sur les rives de la Chine ; je souhaite d’être brisée par les souffrances afin de prouver à Dieu mon amour, déclare une carmélite du XVIIe siècle, la vénérable Marie de la Trinité ; le désir de souffrir est un vrai supplice, ajoute, de nos jours, une grande servante de Dieu, la Mère Marie Du Bourg et elle confie familièrement aux filles de son monastère que si « l’on vendait des douleurs au marché, elle irait vite en chercher. »
Lydwine pouvait donc assurer que l’antidote certain de la souffrance, c’était l’amour ; mais, répondaient les pauvres gens, je n’aime pas ! — Eh ! qu’en savez-vous ? répliquait la sainte ; est-ce que, la plupart du temps, cet état de sécheresse, cette torpeur, ce dégoût même de la prière, issus de la lassitude de vos maux, ne sont pas l’œuvre du Seigneur qui vous éprouve ? Ce n’est pas votre faute à vous, si vous êtes ainsi ; ne vous découragez donc point ; priez quand même vous ne comprendriez pas un mot des oraisons que vous débitez ; harassez Jésus, répétez-lui sans cesse : aidez-moi à vous aimer ! — Vous vous désolez de ne pas sentir encore l’amour s’irruer en vous ? Eh ! mais, pleurer parce qu’on n’aime pas, c’est déjà aimer !
Et elle qui parlait de la sorte ne parvenait pas toujours, elle-même, à se consoler.
Si sainte qu’elle fût, elle n’était pas arrivée au degré de maturité où Dieu la voulait. Il exigeait d’elle plus qu’il n’eût exigé de toute autre ; sa tâche, dont elle ne mesurait pas l’énormité, nécessitait l’emploi d’exceptionnelles vertus et d’extraordinaires peines ; elle était entre les mains du Christ un contre-poids qu’il utilisait pour contrebalancer les crimes de l’Europe et les désordres de l’Église ; elle était une victime réparatrice des vivants et aussi des morts et l’Époux la pressurait, la décantait, la filtrait jusqu’à sa dernière goutte. Il la lui fallait résolument dépouillée, sans dépendance d’elle-même, seule ; et des sentiments humains qu’il tolérait chez les autres, l’irritaient chez elle.
Il avait admis qu’elle déplorât la mort du vieux Pierre, son père, lorsqu’il trépassa, en un mois de décembre, la veille de la fête de la Conception de la bienheureuse Vierge. Il amortit la pesanteur de ce coup, en la prévenant à l’avance et Lydwine avertit à son tour Jan Walter, en le priant de ne pas aller dire, ce jour-là, la messe à Ouderschie, comme il en avait l’intention, afin de pouvoir assister le vieillard à ses derniers moments.
Il consentit encore à ce qu’elle ne fût point victime d’une illusion diabolique qui l’obsédait, car elle voyait son père, après son décès, tourmenté par des démons et il lui dépêcha un ange pour l’aviser que le brave homme était, ainsi qu’il l’avait mérité, dans le Paradis, avec les Justes ; mais il fut moins attentionné, moins patient quand, quelques années plus tard, en 1423, son frère Wilhelm qu’elle aimait tendrement, mourut.
Il commença par la récompenser de sa probité et de son désintéressement. Wilhelm ne laissait en guise d’héritage à ses deux enfants Pétronille et Baudouin, que des dettes. Il était difficile qu’il en fût autrement d’ailleurs. Wilhelm avait succédé à son père dans la petite place de veilleur de nuit de la ville et il devait, avec son modique salaire, élever ses enfants, soutenir Lydwine et son père ; il est également possible que la mégère qu’il avait épousée — et qui décéda sans doute avant lui, car les historiens ne nous en parlent plus, — ait été dépensière et ait réservé pour ses fantaisies le plus gros de son gain. Toujours est-il que Lydwine vendit les quelques objets de famille que son frère avait conservés à titre de souvenirs et en remit l’argent dans une bourse à un sieur Nicolas, son cousin, qui habitait avec elle, en le priant de désintéresser les créanciers.
Qu’était entre parenthèses ce Nicolas dont nous avons cité, une fois, le nom, à propos de l’indiscrétion du confesseur de la sainte, caché dans sa demeure, pour surprendre son ange ? nous l’ignorons ; nous savons seulement que Nicolas s’acquitta de la commission et restitua, à son retour, la bourse vide à Lydwine qui la renversa sur son lit et en tira huit livres, monnaie du pays ; or, cette somme était juste celle qu’elle y avait serrée, pour solder les dettes.
Elle recommanda à son parent de ne pas ébruiter ce miracle et décida que cette bourse s’appellerait la bourse de Jésus ; et la sainte subvint dorénavant avec l’argent qu’elle contenait et qui ne s’épuisa plus aux besoins de ses pauvres ; le jour même de sa mort, cette bourse était encore à moitié pleine.
Mais si Dieu lui fit sentir, à cette occasion, qu’il était content d’elle et la débarrassa pour l’avenir du souci de chercher les subsides nécessaires pour alimenter les indigents, il se fâcha et la punit, en la privant de ses extases habituelles, lorsque, perdant toute mesure, après le trépas de son frère, elle tomba dans un état de prostration et ne cessa de pleurer.
Il estima que ces excès de tristesse refoulaient en elle les appas divins et l’alourdissaient et l’empêchaient de gravir sur le sommet de la voie mystique les derniers sentiers qui Le séparaient d’elle.
Tous les historiens de Lydwine nous narrent à ce sujet, ce curieux épisode :
Longtemps avant la disparition de Wilhelm, Gérard, un jeune homme du diocèse de Cologne, qui ardait du désir de vivre de l’existence des anciens ermites, la visita pour connaître d’une façon sûre si cette hantise qu’il ne parvenait pas à dominer, n’était point une folie de son imagination ou une tentation contre Dieu sommé de le nourrir par miracle dans une solitude inculte. Lydwine dissipa ses doutes sur sa vocation d’anachorète et prophétiquement lui dit :
— Les trois premiers jours de votre arrivée dans le désert, vous pâtirez de la faim, mais ne vous rebutez pas, car le troisième jour, avant le coucher du soleil, le Seigneur pourvoira à notre nourriture.
Confiant en cette promesse, il partit avec deux compagnons ; mais dès qu’ils eurent abordé les plaines de l’Égypte, ceux-ci, épouvantés par la mer de sables qui s’étendait à perte de vue devant eux, rebroussèrent chemin et retournèrent, désabusés, chez eux.
Gérard, plus intrépide, s’enfonça dans les régions isolées du Nil et découvrit, au centre d’un site aride, un grand arbre dans les branches duquel était perchée, ainsi qu’un nid, une cellule formée avec des rameaux et des nattes ; et elle était assez élevée pour que les loups et les autres bêtes sauvages ne pussent l’escalader.
Il s’y installa et, après avoir jeûné, faute d’aliments, pendant deux jours, il fut, selon la prédiction de la sainte, ravitaillé, le troisième, par le Créateur qui lui envoya, comme jadis aux Hébreux, des flocons de manne.
Il vivait, fondu en Dieu, dans cette hutte aérienne et avait atteint les plus hautes cimes de la contemplation, quand un évêque anglais qui revenait d’un voyage en Palestine et d’un pèlerinage au mont Sinaï où il était allé vénérer les reliques de sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, s’aventura avec ses gens dans ces parages.
Surpris d’apercevoir un arbre isolé dans un paysage dénué de végétation, il s’approcha et discernant la cabane logée dans les branches il s’écria :
— Si c’est un serviteur du Christ qui habite ici, je le prie pour l’amour de Jésus, de me répondre.
A cet appel, au nom de Jésus, un être gras, énorme, vêtu de guenilles et effroyablement sale, sortit du lacis des nattes.
L’évêque, déconcerté, regardait cette masse qui ressemblait plus à une colossale bonbonne dont le goulot serait surmonté en guise de bouchon par une vessie de saindoux qu’à un corps et à un visage d’homme. Il commençait à être pris de peur quand la boule de cette face s’irradia en un sourire lumineux d’ange.
— Dites-moi, père abbé, fit le prélat rassuré par ce sourire, depuis combien de temps demeurez-vous dans cet arbre ?
— Depuis dix-sept ans, répondit l’ermite.
— Quel âge aviez-vous lorsque vous avez fui le monde ?
— Dix-neuf ans.
— Et, reprit l’Anglais, avec quoi vous sustentez-vous ? je ne découvre pas trace d’herbes et de racines autour de votre laure et cependant votre obésité est sans égale !
— Celui qui a nourri les enfants d’Israël dans le désert veille à ce que je ne manque de rien, répliqua Gérard.
L’évêque crut qu’il ne s’agissait que de nutriments tout spirituels et il lui demanda s’il connaissait une autre créature humaine qui vivait également sans manger.
— Oui, en Hollande, dans une petite ville appelée Schiedam, une vierge fort infirme vit depuis des années à jeun ; cette vierge s’est élevée à un si haut point de perfection qu’elle me précède de très loin ; nous conversons cependant, de longue date, ensemble dans la lumière incréée ; une chose m’étonne, pour l’instant ; depuis quelques jours, elle ne s’évade plus de la terre et je ne perçois plus, en extase, sa présence ; et elle n’est pas morte pourtant ! Je crois deviner néanmoins, poursuivit Gérard, après un silence, qu’elle s’afflige plus qu’il ne conviendrait de la perte de l’un de ses proches, Dieu le permettant ainsi pour l’humilier ; je pense que c’est à cause de l’intempérance de ses larmes que le Seigneur la prive momentanément de ses grâces ; au reste, lorsque vous retournerez en Europe, si vous passez par les Pays-Bas, allez la voir et posez-lui, de ma part, ces trois questions :
Depuis combien de temps votre ami Gérard s’est-il retiré dans sa thébaïde ?
Quel âge avait-il lorsqu’il adopta ce genre d’existence ?
Pourquoi ne vous rencontre-t-il plus comme autrefois ?
Il n’en fallut pas davantage pour déterminer l’évêque à se rendre, avant de regagner l’Angleterre, en Hollande. A peine débarqué, il courut à Schiedam et se fit conduire par l’hôtelier du bourg chez Lydwine.
Il lui raconta son entretien avec Gérard et la pria de répondre à ses trois questions.
Elle se déroba d’abord, disant par humilité : comment puis-je le savoir, c’est Dieu qui le sait.
Mais le prélat insista, se fâcha presque et elle finit alors par avouer que Gérard résidait depuis dix-sept ans dans son arbre, que lorsqu’il avait conçu le projet de vivre de l’existence des pères du désert, il avait dix-sept ans, mais n’avait pu réaliser son dessein que deux années après, c’est-à-dire à l’âge de dix-neuf ans.
Puis elle se tut
— Vous ne répondez pas à la troisième question ? reprit l’évêque.
Alors elle soupira :
— Hélas ! Monseigneur, je suis obligée de séjourner au milieu de séculiers et, bon gré, mal gré, je suis mêlée aux affaires du monde et c’est à mon détriment ; je suis salie par cette poussière que répandent autour d’eux les gens du siècle ; aussi n’avançai-je que très péniblement dans les chemins de Dieu ; mon frère Gérard n’est pas, heureusement pour lui, dans le même cas. Il habite seul avec les anges ; aucun être terrestre ne le dérange et il peut s’adonner en toute liberté aux spéculations du Ciel ; il est donc bien naturel qu’il me dépasse dans la voie sublime de la vie contemplative et que je ne puisse toujours l’y suivre.
J’ajouterai encore que si je suis si en retard, si lente à le rejoindre, c’est par ma faute ; j’ai trop pleuré la mort de mon frère Wilhelm et Dieu m’a fait reculer de bien des pas.
L’évêque, après qu’il eut ainsi vérifié l’exactitude des renseignements que lui avait fournis l’ermite, bénit Lydwine et se recommanda à ses prières.
Quand il fut parti, elle causa à ses familiers de Gérard ; elle leur apprit que son embonpoint, dû aux qualités nutritives de la manne, était tel que des rouleaux de chairs descendaient de son cou et coulaient en cascades sur son dos ; il ne pouvait ni se coucher, ni s’asseoir, et il était forcé de se tenir constamment agenouillé ou debout dans son arbre ; et lorsqu’il trépassa, en l’an de l’Incarnation 1426, le 2 octobre, elle fut prévenue de son décès par son ange qui l’emmena avec lui, pour rendre les derniers devoirs au défunt.
Elle vit ensuite son âme séparée de son corps et portée par de célestes esprits dans le Paradis ; là, ils la baignèrent dans une fontaine dont l’eau était si pure que l’on en apercevait le fond, à un mille au moins de profondeur.
Le mécontentement de Jésus contre sa pauvre servante ne dura guère et il entérina sa réconciliation par des miracles. L’ange de Lydwine la fréquenta de nouveau et ce furent encore des promenades dans les églises et dans le Paradis ; pendant que son âme voyageait, son corps demeurait insensible ; l’extase l’anesthésiait à un tel point qu’elle fut atrocement brûlée, un jour, sans s’en apercevoir.
Les incendies apparaissent, à trois reprises différentes, dans la vie de la sainte ; ainsi qu’on l’a vu plus haut, par la faute de son frère, le feu grilla, un matin, la paille de son lit. Il consuma, une fois encore, sa couche.
Une après-midi d’hiver, les femmes qui la servaient ne sachant comment la réchauffer, puisqu’à cause de ses yeux l’âtre devait rester mort, imaginèrent de glisser sous sa couverture un vase rempli de braises qu’elles fermèrent avec un couvercle.
Lydwine était, à ce moment, ravie hors du monde ; elles sortirent, pour vaquer à leurs affaires, mais lorsque peu de temps après, elles revinrent, elles odorèrent un fumet de chair grillée et se précipitèrent sur le lit qu’elles découvrirent ; le couvercle s’était défait et les charbons étaient en train de carboniser l’une des côtes de la sainte.
A cet instant, son ravissement cessa.
— O Lydwine, s’écrièrent ses amies, quelle affreuse plaie ! ne la sentez-vous pas ?
— Si, fit-elle, je la sens maintenant, mais je ne souffrais nullement tandis que j’étais avec le Seigneur.
Les braves femmes pleuraient, en se reprochant leur imprudence.
— Ne vous lamentez pas, murmura-t-elle, et bénissez le Sauveur qui m’a si bien absorbée en Lui que je ne me suis même pas doutée que des braises me calcinaient le flanc.
En l’an 1428, un incendie menaça d’être pour elle plus terrible. Peu de semaines avant qu’il n’éclatât, Lydwine s’était exclamée à plusieurs reprises : la colère de Dieu est sur Schiedam ! Et, tout en larmes, elle avouait à ses intimes qu’elle s’était offerte comme victime au Christ qui avait refusé d’accepter son sacrifice.
Que va-t-il advenir ? lui demanda-t-on.
— Un incendie détruira Schiedam ; l’iniquité de cette ville est mûre et l’heure de sa moisson est proche ; je ne puis, hélas ! désarmer le ressentiment du Juste.
Et s’adressant à Catherine Simon, elle ajouta :
— Je sais, ma chère sœur, que vous avez en réserve un certain nombre de planches qui n’ont pas été utilisées dans la construction de la maison que l’on vous bâtit ; donnez l’ordre qu’on les transfère, sans retard, derrière le jardin, ici ; nous les emploierons à édifier un hangar où les sinistrés déposeront les objets qu’ils auront pu sauver du désastre.
Catherine lui obéit ; Lydwine la remercia ; puis, la veille du jour où le feu devait se déclarer, elle lui dit :
— Rappelez-vous votre vœu d’aller en pèlerinage à Notre-Dame de Bois-le-Duc ; réalisez, demain, cette promesse ; partez et revenez au plus vite.
— Mais, s’écria Catherine, vous m’avez annoncé que l’incendie de Schiedam aurait lieu demain ; ce n’est vraiment pas le moment pour moi de m’absenter, car si je m’en vais, je suis certaine de perdre tout ce que je possède !
— Écoutez ce que je vous dis, répartit Lydwine ; le Seigneur ne connaît-il pas mieux que vous ce qui doit vous être profitable ?
Et la veuve Simon qui ne savait pas ne point obtempérer aux injonctions de la sainte, s’en fut à Bois-le-Duc.
Le lendemain était un samedi de juillet, fête de saint Frédéric, évêque et martyr et de saint Arnulphe, confesseur ; c’était la veille du jour où les marins de Schiedam prenaient la mer pour commencer la pêche du hareng. Suivant un vieil usage, ils se réunirent pour célébrer leur départ, par un banquet. Lorsque le repas qui fut long et copieusement arrosé de cervoises et de bières, fut terminé, les cuisiniers laissèrent un fourneau qu’ils croyaient éteint près d’une cloison de roseaux ; vers les onze heures du soir, des étincelles en jaillirent qui embrasèrent la cloison et le feu gagna de proche en proche et se propagea par toute la ville ; il sautait d’une maison à l’autre et comme la plupart étaient en bois, elles flambaient ainsi que des lattes, sans même que l’on pût les secourir. Fouetté par le vent du large il franchissait les espaces vides, rasait, en passant, les jardins et allumait les arbres, dardant dans des tourbillons de fumée les déchiquetures de ses flammes qui aussitôt qu’elles avaient atteint une bicoque ne la lâchaient plus. Elles pesaient sur les croisées qu’elles évidaient et crevaient les portes ; l’on ne voyait plus alors dans une carcasse qui craquait que des solives rouges ; elles se tordaient, se dressaient, à un moment, échevelées de même que des torches, puis retombaient, en une pluie de charbons, en se cassant ; et dans une détonation, la maison se décoiffait et il en fusait une gerbe de flammes qui embrasait la nuit. Il pleuvait des braises et il grêlait du feu ; l’on n’entendait que le ronflement des brasiers, le fracas des poutres qui s’écroulaient, les explosions des barriques dont les cercles cédaient, les cris de terreur de la foule qui fuyait devant ces serpents et ces ailes de feu qui rampaient et volaient de toutes parts.
Il en fut ainsi du commencement à la fin de la nuit ; le lendemain matin, l’église paroissiale, un couvent de religieuses qui y attenait et la majeure partie des rues de Schiedam n’étaient plus qu’un monceau de décombres ; et le feu ne s’apaisait pas. En vain, les habitants, ranimés par la clarté du jour, s’efforçaient de circonscrire le foyer de l’incendie ; il n’en continuait pas moins ses ravages.
A un moment, une traînée de flammes se dirigea vers la demeure de Lydwine ; de braves gens accoururent et voulurent emporter la sainte, mais elle refusa, affirmant qu’elle n’avait rien à craindre. Ils l’abandonnèrent sur sa couche, mais démolirent par précaution la charpente et le plafond de la maison qui étaient en bois et ne laissèrent debout que la pierre des murs. Seulement, comme l’on était au mois de juillet et que le soleil sévissait cruellement, ils durent, voyant les atroces souffrances de Lydwine dont les yeux saignaient à la lumière, jeter une vieille tenture sur les pans de muraille, afin de lui procurer un peu d’ombre. Ce palliatif — qui était bien inutile, du reste, car le feu aurait pu tout aussi bien cinéfier l’étoffe que le bois du plafond et se communiquer à la paille du lit, — n’ayant pas réussi à atténuer les douleurs de la patiente, ils ne surent plus à quel expédient recourir et rétablirent au-dessus d’elle les planches qu’ils avaient détachées et partirent.
Lydwine resta seule pendant toute la journée de ce dimanche ; elle avait la fièvre et rissolait sous ce soleil de plomb ; elle s’arma de patience, pria, invoqua son ange, mais il ne lui répondit pas ; quand tomba le soir, elle crut mourir ; la chaleur concentrée sous les planches et la fumée des ruines que l’on noyait, l’asphyxiaient. N’y tenant plus, elle chercha un bâton qui lui servait d’habitude à attirer ou à repousser les courtines du lit et aussi à frapper des coups quand elle avait besoin d’appeler, mais elle eut beau promener en tous sens, le seul bras qu’elle avait libre, elle ne le découvrit plus.
Elle était sûre pourtant que le fléau ne l’atteindrait pas, qu’elle ne périrait point, suffoquée ainsi, et la peur fut plus forte que la raison ; la nature prit le dessus, le silence de son ange l’accabla, elle défaillit et pleura en songeant qu’elle allait mourir sans l’aide des sacrements, seule, en son coin.
L’énervement issu de la fièvre qui la rongeait accélérait cette panique. A ces détails, l’on peut juger combien, lorsque le Seigneur le veut, les âmes, même les plus avancées dans la voie du sacrifice, errent et vacillent. Au fond, rien n’est plus malaisé que tuer ce que saint Paul nomme « le vieil homme ». On l’engourdit, mais, la plupart du temps il ne meurt pas. Un rien le sort de sa léthargie, et le réveille ; il semble que le Démon arrose, en secret, les anciennes racines et les empêche de jamais se dessécher ; et les premières pousses qu’elles produisent, en silence, dans l’ombre de l’âme, ce sont celles de la vaine gloire, cette ivraie spéciale des êtres privilégiés ! Lydwine était bien éloignée de ce sentiment pourtant, et néanmoins Dieu voulut l’humilier, une fois de plus, en permettant qu’elle doutât de l’efficace de ses prières, qu’elle se cabrât devant le péril et se débattît dans des affres purement humaines !
Mais il ne lui tint pas rigueur de sa faiblesse, comme il lui avait tenu rigueur du chagrin ressenti au décès de son frère, parce que ces transes étaient son œuvre, parce que c’était lui-même qui les imposait à sa pauvre servante ; et la preuve est qu’il s’ingénia aussitôt à la secourir.
L’ange, invisible jusqu’alors, se présenta et posa doucement sur la poitrine de Lydwine un morceau de bois de la longueur d’une aune environ. Elle le saisit et le soulevant avec peine, car il était lourd, elle écarta les rideaux et huma voracement un peu d’air. Le lendemain matin, lorsqu’elle considéra de près ce bâton, elle s’aperçut qu’il était non seulement pesant et rugueux mais encore tordu et comme coupé à même d’un tronc ; et elle ne put s’empêcher de penser que son ange aurait beaucoup mieux fait de lui retrouver son ancienne baguette que de lui apporter cette incommode gaule ; aussi, quand Jan Walter arriva pour savoir comment elle avait passé la nuit, lui confia-t-elle cette branche d’arbre, en le priant de la donner à dégrossir.
Walter visita les menuisiers de la ville, mais leurs outils avaient été brûlés et ils ne pouvaient se charger du travail. De guerre lasse, il s’aboucha avec un tonnelier qui possédait encore une doloire et celui-ci râpa énergiquement le gourdin. Des copeaux embaumés volèrent et sous l’écorce une couleur de cire fraîche apparut.
Ce doit être du cyprès, répondit cet homme à Walter qui l’interrogeait pour connaître de quelle essence d’arbre provenait ce bois ; mais, ajouta-t-il, je n’en ai jamais vu de si parfumé et de si dur.
Puis, tandis que des personnes qui assistaient à cette scène, dans son atelier, s’emparaient des rognures à cause de leur odeur, il dit au prêtre :
— Écoutez, je ne puis avec une doloire équarrir proprement votre bâton ; gardez-le tel qu’il est, cela vaudra mieux.
Walter, ennuyé de ce contre-temps, repartit en quête d’un autre ouvrier. Il finit par en rencontrer un dont tous les instruments n’avaient pas été détruits et celui-là se mit à l’œuvre ; mais il n’eut pas plutôt flairé l’arome du rondin qu’il voulut s’approprier les copeaux, alors que Walter désirait les conserver ; et pour en avoir davantage il aurait avec son rabot aminci le bois de telle sorte qu’il n’en serait plus resté, si le prêtre ne le lui avait enlevé des mains et ne s’était enfui avec.
Il demanda à Lydwine, lorsqu’il lui rapporta la baguette, si elle savait le nom de l’arbre qui l’avait produite.
— Dieu le sait, fit-elle, et moi pas ; mon frère ange ne me l’a point conté.
Plus tard, à la fête de saint Cyriaque, martyr, c’est-à-dire au commencement du mois d’août, l’ange conduisit Lydwine dans les pourpris de l’Éden. Là, il lui reprocha d’avoir si peu estimé son présent — ce dont elle fut très marrie — et il lui montra l’arbre, un cyprès d’une espèce particulière, et la place même à laquelle il avait coupé la branche ; et il lui apprit que cette tige châtierait le Démon et serait pour lui un objet d’épouvante.
Et, en effet, Brugman déclare avoir assisté à ces expériences ; il suffisait d’approcher cette verge d’un énergumène pour lui arracher des cris plaintifs et le faire frémir de la tête aux pieds.
Et, un siècle plus tard, Michel d’Esne, l’évêque de Tournai, ajoutait : « Cela est très vrai, comme j’ai non seulement ouï dire, mais vu de mes yeux ; car j’ai vu des démoniaques crier, grincer des dents et trembler extrêmement devant une petite pièce de ce bois. »
Dès que l’histoire de ce bâton se fut ébruitée, toute la ville processionna chez la sainte pour le regarder et le fleurer ; il continua d’odorer, mais un libertin, amené par la curiosité, chez elle, le toucha et dès lors il cessa d’exhaler son résineux parfum.
La veuve Catherine qui avait terminé son pèlerinage rejoignit sur ces entrefaites la ville et trouva, à la place de son logis, un tas de tisons calcinés et de cendre.
Cette perte la désola ; elle arriva, en pleurant, chez Lydwine.
— Vous voyez, s’écria-t-elle, vous voyez que je n’aurais pas dû m’absenter ; si je ne vous avais pas écoutée, j’aurais peut-être au moins sauvé quelques-unes de mes pauvres affaires !
Mais la sainte sourit.
— O tête, ô tête, s’exclama-t-elle, il y a longtemps que vous souhaitez d’habiter avec moi ; seulement, le sacrifice qui vous coûtait le plus, c’était de vous séparer de cette maison à laquelle vous étiez trop attachée. Maintenant qu’elle n’existe plus, qui vous arrête ? Venez vous fixer ici, et, au lieu de gémir, remerciez Dieu qui a précipité les événements de telle sorte qu’il vous dispense de discuter avec vous-même.
Et Catherine s’empressa, en effet, de résider chez la bienheureuse et jusqu’à l’heure de sa mort, elle ne la quitta plus.
Une autre question serait intéressante à résoudre, celle de savoir comment les Schiedamois qui étaient, pour la plupart, des marins ivrognes sans doute et luxurieux, mais pas plus que les matelots des autres plages, avaient pu attirer si résolument sur eux le courroux du Ciel. Si l’on se réfère à leur attitude, alors que feu André, leur ancien curé, affirma avoir jeté l’Eucharistie dans un amas de boue, l’on constate que ces gens avaient la foi et vénéraient le corps du Sauveur, car ils s’indignèrent et voulurent écharper ce triste sacerdote ; ils n’étaient donc ni des mécréants, ni des déicides. Comment dès lors justifier ce ressentiment du Christ ?
Thomas A Kempis raconte qu’ils avaient bafoué la statue miraculeuse de la Vierge et il cite parmi les délinquants un prêtre et une femme dont la liaison publiquement affichée était un scandale pour le peuple. A quelques détails qu’il précise, il est facile de reconnaître en cet ecclésiastique et en cette gourgandine, ce Joannès de Berst et cette Hasa Goswin dont nous avons déjà parlé ; mais en sus de ce délit, l’on peut, je crois, admettre ceci : qu’en raison même de cette faveur qu’elle obtint de posséder dans ses murs une sainte qui rendait par les miracles qu’elle opérait les grâces de la Providence visibles, Schiedam devait être, aux yeux de Jésus, une ville plus religieuse, plus mystique que les autres, une cité modèle et elle ne fut rien de cela ; Dieu l’épargna, une fois, sur les instances de sa servante, alors qu’une flotte s’avançait pour la détruire, mais elle ne s’amenda point et le Juge, lassé, sévit ; telle est la seule explication qui semble plausible.
Malgré tout, Lydwine ne pouvait s’empêcher de croire que si elle avait été plus pure, elle aurait peut-être été mieux exaucée et cependant elle savait que ses mérites étaient, là-haut, soigneusement comptés.
N’avait-elle pas, quelques années auparavant, un jour qu’elle était en extase, contemplé ce spectacle qui fut montré, d’ailleurs, à beaucoup de saints, de l’Époux tenant une couronne sertie de gemmes ? Elle l’examinait et remarquait que certaines montures étaient vides.
— Les pierres qui manquent s’enchâsseront avec le temps, dit Jésus ; cette couronne est celle que je te prépare.
Lorsqu’elle fut revenue à elle, elle pensa justement que les fleurons inachevés symbolisaient les douleurs qui lui restaient à subir et elle s’apprêta à les endurer.
Faisant alors un retour sur elle-même, humblement elle se repéra ; elle songea qu’elle n’avait jamais offert au Bien-aimé un cœur vraiment affranchi et un esprit dûment désoccupé ; elle se reprocha de ne pas s’être assez exilée de ses volontés, de ne s’être jamais entièrement bannie ; elle s’avoua ne pas s’être assez soigneusement tamisée de la lie de ce monde et elle supplia Jésus de la mettre en mesure d’expier cette avarice d’elle-même, en l’accablant d’injures et de sévices, en la traitant, ainsi qu’il avait été, Lui-même, traité.
Il la satisfit sur-le-champ.
A ce moment, Philippe, duc de Bourgogne, qui revendiquait, par droit d’héritage, au détriment de sa nièce la comtesse Jacqueline, la possession des Provinces-unies, envahit à la tête d’une armée les Pays-Bas et installa des garnisons dans les places. Le 10 octobre, le jour où l’on célébrait la fête des saints martyrs Géréon et Victor, il entra à Schiedam. Il y fut reçu avec de grands honneurs et invité à un festin auquel furent conviés toutes les autorités de la ville et le curé qui était Jan Angeli, encore vivant à cette époque.
A la fin du repas, quatre Picards qui faisaient partie de la maison du duc demandèrent au curé de les conduire chez cette Lydwine dont on leur avait relaté monts et merveilles.
Il y consentit et les accompagna, eux et leurs serviteurs ; mais à peine se furent-ils introduits dans la chambre qu’ils commencèrent à tapager et, comme Jan Angeli les suppliait de se retirer, ils prétendirent qu’il était l’amant de sa pénitente et le poussèrent derrière un petit autel qui avait été dressé dans cette pièce pour y recevoir le corps du Christ, lorsqu’on venait communier la malade.
Il s’y blottit, triste et confus.
On n’y voit goutte, dans cette cambuse ! cria l’une de ces brutes. Il alluma une chandelle, arracha les rideaux et les couvertures du lit et le ventre hydropique de la malheureuse bomba, ainsi qu’une outre, lamentable et nu ; alors ils se tordirent et crièrent qu’elle était enceinte des œuvres de son confesseur !
La nièce de Lydwine, la petite Pétronille, assistait avec le curé à cette scène ; quand on découvrit le corps de sa tante, elle ne put se maîtriser et elle s’élança pour la recouvrir. Ils voulurent l’en empêcher, mais elle leur opposa une telle résistance, qu’ils finirent par l’empoigner et ils la jetèrent contre les marches de l’autel avec tant de violence qu’elle se blessa grièvement à l’aine et aux reins et s’évanouit.
Cette encontre exaspéra ces soudards. Ils qualifièrent Lydwine de paillarde, l’accusèrent d’être mère de quatorze enfants et de se saouler, la nuit ! puis, tandis que celui qui tenait le flambeau éclairait la couche et invectivait la martyre, en hurlant : on va te dégonfler, sale bête ! les autres enfoncèrent leurs doigts dans la peau tendue du ventre qui creva.
L’eau et le sang jaillirent en abondance par trois trous et le lit fut inondé.
Après qu’ils eurent accompli ce forfait, ils sortirent pour se laver les mains, puis rentrèrent et se remirent à l’injurier.
Lydwine, qui n’avait répondu que par des gémissements à ces tortures, les regarda alors et dit :
— Comment ne craignez-vous pas de toucher au travail de Dieu, comment ne craignez-vous pas le châtiment que sa Justice vous prépare ?
Ils haussèrent les épaules et, après une dernière bordée de lazzis et d’outrages, ils s’en furent.
Le curé se précipita aussitôt dehors, pour chercher des secours. Les amies de Lydwine arrivèrent ; elles ranimèrent avec un cordial Pétronille qui dut s’aliter et elles pansèrent les blessures de sa tante et changèrent la paille de sa couche devenue semblable à un fumier d’abattoir, tant elle était trempée de sang !
Le lendemain, le duc de Bourgogne qui ignorait cet attentat partit pour Rotterdam ; mais à peine son armée eut-elle déguerpi de Schiedam, que la nouvelle du crime courut par toute la ville. Ce ne fut qu’un cri d’indignation contre ces bandits. Les échevins se présentèrent chez la malade pour la consoler et lui annoncèrent qu’ils allaient, eux aussi, s’embarquer pour Rotterdam, afin de réclamer au duc la punition de ses gens.
— N’importunez pas le prince à mon sujet, répliqua Lydwine ; Dieu se réserve la vengeance de ce méfait ; déjà l’arrêt de ces infortunés est prononcé.
Et, en effet, la répression qui les attendait ne tarda guère. Celui de ces hommes qui portait le flambeau et avait si grossièrement insulté la sainte fut, à l’instant même où il entrait dans le port de Rotterdam, saisi de vertige. Il erra, comme un fou, sur le pont du bateau et tomba et se fracassa le crâne ; un autre près de Zierikzée se tordit dans des accès de délire et fut abandonné dans une chaloupe où il mourut ; le troisième qui appartenait à l’armée navale fut tué, pendant un combat, par les anglais ; le quatrième enfin qui s’attribuait le titre de médecin, fut frappé d’apoplexie près de Sluse et devint aphasique. Son domestique lui rappela alors son crime et l’interrogea pour savoir s’il n’en éprouvait pas quelque remords. Il fit signe que oui et trépassa.
Après son enterrement, ce serviteur qui était un brave et pieux homme vint à Schiedam pour solliciter, au nom de son maître, le pardon de Lydwine ; et il lui fut accordé, on peut le croire, aisément.
Cette sinistre aventure désola, pendant des années, la sainte.
Elle pleurait non sur les plaies qu’elle avait reçues, mais sur la perversité de ces vauriens que ses prières ne parvenaient pas à sauver ; aussi ne voulait-elle pas qu’on la plaignît de ces sévices.
— Plaignez-vous plutôt, fit-elle, un jour, aux magistrats et baillis de Schiedam qui reparlaient chez elle de cette affaire ; plaignez-vous, car je vous vois menacés d’un péril dont vous ne vous doutez point.
Et, en effet, peu de temps après, ils furent inculpés par le duc de Bourgogne de trahison et menacés d’avoir le cou tranché.
Après ces évènements, l’ange du Seigneur aborda Lydwine et lui dit : votre Époux vous a admise, suivant votre désir, aux tortures de la Passion ; vous avez été injuriée, couverte d’ignominie, dénudée, et vous avez rendu de l’eau et du sang par vos blessures ; soyez heureuse, ma sœur, car la scélératesse de ces Picards va aider à compléter le nombre de pierres qui manquent à votre couronne.
Généralement, Dieu dispense à chacun de ses saints une dévotion spéciale qui s’accorde avec la tâche que chacun d’eux est plus particulièrement chargé d’accomplir ; la dévotion de cette missionnaire de la Douleur qu’était Lydwine, était naturellement celle du chemin de la Croix ; elle la pratiquait, ainsi qu’il fut dit, d’une manière canoniale, divisant en sept étapes, selon le nombre des heures liturgiques, la voie du supplice ; mais cette méditation quotidienne de la Passion, cette ardeur à suivre sur le chemin du Calvaire les vestiges du Christ, ne lui faisaient pas oublier cette autre dilection qu’elle avait eue, toute petite, et qui avait grandi avec elle, la dilection de la Vierge.
Ne la rencontrait-elle pas, chaque jour, d’ailleurs, sur la voie du Golgotha, alors qu’elle en gravissait, en pleurant, la pente ? Notre Dame des Larmes avait toujours un regard pour elle, quand elle l’apercevait, mêlée au cortège des saintes femmes ; mais souvent aussi, Lydwine, repassant les jours de sa vie écoulée, revenant sur la route même de son enfance, pensait à cette Notre-Dame de Liesse dont la statue lui avait si aimablement souri, dans sa chapelle ; et le désir de la revoir, sous la forme de ce bois sculpté qui lui rappelait tant de souvenirs, s’implantait en elle. Sans doute, elle l’avait visitée, depuis, en extase, alors que son ange la déposait devant elle, mais ce n’était pas encore cela ; elle aurait voulu la contempler, là, près d’elle, la choyer de ce qui lui restait de regard, ne fût-ce qu’une seconde.
Ce souhait lui paraissait si parfaitement inexauçable — car comment présumer qu’on ôterait cette effigie de l’église pour l’amener chez elle ? — qu’elle n’osait le formuler ; et, d’autre part, elle n’était pas femme à solliciter un miracle pour la satisfaction d’un caprice !
Mais cette convoitise la hantait quand même ; elle essayait de la repousser comme une tentation, lorsqu’elle fut avertie que la Vierge allait la contenter.
C’était quelques jours avant l’incendie de Schiedam ; et Marie arrangea les choses de la façon la plus simple.
L’église avait été très endommagée par le feu, mais la statue était sauve ; en attendant que l’on réparât sa chapelle, il fallait placer son image dans un lieu convenable et l’on eut l’idée de la transférer dans la chambre même de la sainte où elle fut installée sur le petit autel dressé pour recevoir les saintes Espèces, les jours de Réfection ; et tant qu’elle demeura là, elle sembla à tous ceux qui l’approchèrent plus belle qu’elle n’était en réalité ; elle eut une expression de gaieté et de douceur qu’elle perdit lorsqu’elle fut séparée de Lydwine.
Elle, débordait de joie : mais l’on peut s’imaginer aussi la foule qui fit irruption dans sa chaumine, pour prier la Madone ! Comment Lydwine pouvait-elle endurer ce va et vient et ce piétinement incessant de monde, même en étant enfermée derrière les rideaux de son lit, car cette porte, constamment ouverte, introduisait des rais de jour qui lui eussent crevé l’œil comme des flèches, si elle n’avait été abritée par des courtines ? — La vérité est que ces oraisons qu’elle entendait bruire autour d’elle, la dédommageaient de cette gêne de n’être plus chez elle et la réjouissaient certainement, parce qu’elle pensait que la Mère les agréait et ce fut pour elle un gros crève-cœur lorsqu’on reporta la statue dans son sanctuaire recrépi à neuf.
La Vierge partit, mais elle chargea l’ange gardien de Lydwine de la lui conduire plus souvent, dans le Paradis.
Elle la traitait alors en enfant qu’on gâte, la questionnait et s’amusait de l’ingénuité de ses réponses.
Une nuit, elle lui dit, d’un ton sérieux :
— Comment se fait-il, ma chère petite, que vous soyez arrivée, ici, dans une tenue si négligée ? vous n’avez même pas sur le front un voile !
— Ma chère dame Marie, balbutia Lydwine interdite, mon ange m’a emmenée telle que j’étais ; je n’ai, du reste, à la maison, ni robe, ni voile, puisque je suis toujours couchée !
— Eh bien, proposa en souriant la Vierge, voulez-vous que je vous donne ce voile-ci ?
Lydwine contemplait ce voile que lui tendait la Mère ; elle mourait d’envie de l’accepter ; mais elle craignit de déplaire à Jésus, en contentant son propre désir et elle interrogea du regard son ange qui détourna les yeux.
De plus en plus intimidée, elle murmura : mais il me semble, bonne Vierge, que je n’ai pas le droit de manifester une volonté, et elle implora encore d’un coup d’œil son ange ; il lui répliqua, cette fois, par ces mots qui ne firent qu’accroître son embarras :
— Si vous souhaitez de posséder ce voile, prenez-le.
Elle savait de moins en moins à quoi se résoudre quand la Madone mit fin, en riant, à sa gêne.
— Allons, dit-elle, je vais le placer moi-même sur votre tête, mais écoutez-moi bien ; de retour sur la terre, vous le garderez chez vous pendant sept heures ; ce après quoi, vous le confierez à votre confesseur, en le priant de le fixer sur le chef de ma statue, dans l’église paroissiale de Schiedam.
Et, après cette recommandation, Notre-Dame disparut.
Revenue de son extase, Lydwine se tâta le front pour s’assurer qu’elle n’avait pas été le jouet d’une illusion ; le voile y était ; elle le retira et l’examina. Il paraissait vraiment tissé avec les fils de la Vierge, tant sa trame était fine ; sa couleur était d’un vert d’eau très pâle et il exhalait une odeur à la fois pénétrante et ténue, exquise.
Tout en le considérant, Lydwine s’était si bien absorbée dans ses actions de grâce, qu’elle avait absolument perdu la notion du temps ; elle s’avisa tout à coup que le terme des heures déterminé par Marie pour conserver ce présent, allait expirer.
Aussitôt et bien que le jour ne fût pas encore éclos, elle fit appeler Jan Walter et lui raconta sa vision.
Il palpait, stupéfié, le voile.
— Mais, s’écria-t-il, vous n’y songez pas, la nuit est très noire, l’église est fermée et je n’en ai pas les clefs ; en admettant, du reste, que je puisse y pénétrer, cela ne servirait de rien puisque je ne saurais atteindre dans l’obscurité le sommet de la statue qui domine l’autel et qui est par conséquent très haut ; attendons donc, si vous le voulez bien, que l’aube nous éclaire et j’irai.
— Non, non, répartit la sainte ; l’ordre que j’ai reçu est formel ; ne vous inquiétez pas d’ailleurs de tous ces détails ; l’église s’ouvrira, la lanterne que vous avez allumée pour venir ici vous fournira une clarté suffisante pour découvrir, appuyée contre le mur latéral, au nord du sanctuaire, une échelle ; une fois monté dessus, rien ne vous sera plus facile que de coiffer la statue ; partez donc, je vous en prie, mon père, sans différer.
Walter s’en fut réveiller le sacristain qui lui ouvrit la porte de l’église et il trouva aussitôt l’échelle à la place indiquée par sa pénitente.
— Que voulez-vous faire ? demanda le sacristain étonné de lui voir déranger l’échelle.
— Vous ne pouvez le comprendre maintenant, répliqua le prêtre, mais Dieu vous l’expliquera par la suite.
Cet homme pressé de regagner son lit ne prêta que peu d’attention à cette réponse et s’éloigna.
Walter s’acquitta de la commission, puis il s’agenouilla devant la statue et pria ; lorsqu’il fut sur le point de se retirer, il voulut admirer une dernière fois la délicate élégance de ce voile, mais il n’y était déjà plus. L’ange l’a aussitôt ravi, racontait plus tard Lydwine à la veuve Simon qui l’interrogeait pour savoir ce qu’il était devenu.
Ces relations de la sainte avec la Madone étaient continuelles ; dans ses abominables nuits d’insomnies et de fièvre, alors que la malade se retenait pour ne pas réveiller, en criant, son neveu et sa nièce couchés dans la chambre, elle apercevait soudain, penchée sur son lit, la Vierge qui relevait son oreiller et la bordait ; et elle s’apaisait, heureuse, et remerciait, confuse.
Entendait-elle parfois aussi les douces plaintes de la Mère au Fils ? Car il est impossible de ne pas se figurer la compassion de Marie devant le cumul de tant de maux ! Certes, Celle dont le cœur éclata sous la pression des glaives, savait la nécessité de ces atroces souffrances, mais elle était trop tendre pour ne point avoir pitié du martyre de sa pauvre fille. Et il semble qu’on la voit implorer la miséricorde du Christ qui sourit tristement et lui dit :
— O Mère, rappelez-vous, sur le Calvaire, cette croix qu’en leur satanique orgueil les hommes voulurent créer plus grande que leur Dieu ; rappelez-vous qu’elle fut plus haute et plus large que mon corps qui ne l’a pas emplie ; les bourreaux ont laissé dans ce cadre de bois dont ils m’entourèrent des vides que, seuls, des monceaux de tortures peuvent combler ; et c’est précisément parce qu’il y reste de la place pour souffrir que j’ai donné à mes saints l’irrésistible attrait de l’occuper et d’y achever à leur dépens les tortures de la Passion ; puis pensez que si Lydwine n’expiait pas des fautes dont elle est innocente, une multitude de vos autres enfants serait damnée ! — Mais cela n’empêche que notre fille a, pour cette nuit, assez souffert ; prenez-la donc dans vos bras pour l’endormir aux tourments de la terre !
Et la sainte Vierge dorlotait Lydwine qu’elle remettait, ravie, à son ange pour la promener dans les jardins du ciel.
Une autre fois, pendant une nuit de noël, elle fut brusquement transportée au Paradis et elle y fut, de même que la vénérable Gertrude d’Oosten, cette béguine hollandaise qui l’avait précédée dans la voie des holocaustes, l’objet d’une singulière grâce.
Cette grâce lui avait été annoncée d’avance, mais elle ne l’avait pas révélée à ses intimes. Or, la veuve Catherine Simon qui habitait maintenant avec elle, eut un songe pendant lequel un ange lui décela que son amie recevrait, dans la nuit de la Nativité, un lait mystérieux qu’elle lui permettrait de goûter.
Elle en parla à Lydwine qui, par humilité, répondit évasivement ; mais elle revint à la charge et, lassée par le vague de ses répliques, finit par s’exclamer : Savez-vous, ma mie, que c’est un peu fort que d’oser nier ce qu’un ange m’a appris !
Alors, la sainte avoua qu’elle était, elle aussi, prévenue de ce miracle et elle invita Catherine à se préparer par la confession et la prière à la réception de cette faveur.
Et pendant la nuit de la Théophanie, Lydwine, saisie par l’emprise divine, perdit l’usage de ses sens et son âme s’envola dans l’Éden.
Là, elle fut admise, comme tout naturellement, au milieu d’une nuée de vierges vêtues de blanc, coiffées de fleurs fabuleuses ou couronnées de cercles d’or ponctués de gemmes ; toutes tenaient à la main des palmes et dessinaient un demi-cercle au centre duquel Marie siégeait sur un trône étincelant que l’on eût cru sculpté dans des éclairs solidifiés, dans des foudres durcies ; et des multitudes d’anges se pressaient derrière elles.
Tous ces purs Esprits, Lydwine les contemplait, sous un aspect humain, mais seuls les contours existaient sous la neige plissée des robes ; ces corps glorieux n’étaient emplis que d’une pâle lumière qui fluait des yeux, de la bouche, du front, s’irradiait derrière la nuque en des nimbes d’or ; et de cette foule agenouillée, les mains jointes, des adorations s’élevaient éperdues vers la Maternité de la Vierge, des adorations où le verbe liturgique fusait en une flore de flammes d’un feuillage de senteurs et de chants. De grands séraphins brûlaient, détachant de harpes en feu des perles embrasées de sons ; d’autres tendaient ces coupes d’or pleines d’essences embaumées qui sont les prières des Justes ; d’autres versellaient les psaumes messianiques et chantaient, en des chœurs alternés, de transportantes hymnes ; d’autres enfin, près de l’Archange debout, à la droite de l’autel des Parfums, activaient l’ignition des olibans, tissaient avec des fils de fumée bleue les langes chauds dont ils allaient envelopper, en l’encensant, la nudité frileuse de l’Enfant.
En hâte, ils préparaient, car l’instant de la délivrance était proche, la layette nébuleuse des aromes, l’odorant trousseau du Nouveau-né. Lydwine retrouvait dans le ciel les formules d’adoration, les pratiques cérémonielles des offices qu’elle avait, ici-bas, lorsqu’elle était bien portante, connues ; l’Église militante avait été, en effet, initiée par l’inspiration de ses apôtres, de ses papes et de ses saints, aux joies liturgiques du Paradis ; en une déférente imitation, elle répétait le langage réduit des louanges ; mais quelle différence entre ses émanations et ses chants et les accords vertigineux de ces harpes, la puissance et la subtilité de ces fragrances, le zèle fulgurant de ces voix !
Lydwine écoutait et regardait, ravie ; et à mesure que l’heure de la Nativité s’avançait, les accents de la psallette des anges, les exhalaisons des encensoirs et des coupes, les vibrations des cordes se faisaient plus implorants et plus doux ; et quand l’heure sonna dans les beffrois divins, quand Jésus apparut, radieux, sur les genoux de sa Mère, quand un cri d’allégresse traversa les vapeurs sacrées des thuribules et les rumeurs extasiées des harpes, le lin des chastes tuniques des Vierges s’ouvrit et, en d’intarissables flots, le lait jaillit.
Et la bienheureuse fut traitée de même que ses compagnes ; l’Enfant laissait ainsi comprendre, affirme A Kempis, qu’il les associait à l’honneur de la Maternité céleste ; il signifiait, de la sorte, dit de son côté Gerlac, que toutes les Vierges étaient aptes à nourrir le Sauveur.
La pauvre Lydwine, elle ne se possédait plus de bonheur maintenant ! elle était si loin de sa géhenne mortelle ! — Et, déjà cependant la vision s’effaçait ; il ne restait plus sur un firmament de nuit que l’immense trajectoire de ce lait qu’éclairaient, par derrière, des milliers d’étoiles.
L’on eût dit d’une autre voie lactée, d’une arche de neige saupoudrée d’une poussière d’astres !
L’entrée dans la chambre de Catherine Simon impatiente de voir se réaliser la promesse de son rêve, ramena Lydwine à elle-même et lorsque son amie lui réclama du lait, elle toucha de sa main gauche la fleur de son sein et le lait qui avait disparu avec son retour ici-bas revint et la veuve en but par trois fois et ne put, pendant plusieurs jours, prendre aucune nourriture. Tout aliment naturel lui semblait d’ailleurs, en comparaison de cet extraordinaire suc, de bouquet plat et de saveur fade : et cette scène se renouvela, d’autres années, à cette même époque de Noël.
Brugman assure que le confesseur Jan Walter obtint la même faveur que Catherine et qu’il but de ce lait ; mais Gerlac atteste, au contraire, qu’il ne put joindre en temps opportun sa pénitente et qu’il ne profita point de cette grâce.
Si l’on recense les étonnants miracles dont foisonne cette vie menée en partie double, saturée de souffrances lorsqu’elle se passe sur la terre, débordée de joies lorsqu’elle s’évade dans l’Éden ; si l’on récapitule les exceptionnels privilèges dont le Seigneur combla Lydwine ; si l’on envisage enfin la somme énorme de ses bienfaits, l’on n’est pas loin de croire qu’à force de se dévouer pour les autres, de prier et de pâtir, la bienheureuse avait atteint la cime de la vie parfaite.
Elle n’en était malheureusement pas pour elle encore là ; des échelons n’étaient pas gravis. La terrible remarque sur laquelle saint Jean de la Croix ne cesse d’insister dans la « Montée du Carmel » qu’une attache quelconque, lors même qu’elle ne constituerait que la plus petite des imperfections, obscurcit l’âme et fait obstacle à sa parfaite union avec Dieu, s’appliquait, malgré tout, à elle. Elle s’appartenait encore trop ; elle possédait le déchet d’une qualité, la tare d’une vertu ; elle était trop liée aux siens, elle les aimait trop.
Il sied de dire, à sa décharge, que, si avancée qu’elle fût dans les voies du Seigneur, il lui était bien difficile de se rendre compte par elle-même des limites qu’il lui était interdit de franchir ; à l’âme qui le cherche, le point de repère se montre à peine, car il se dissimule sous les subterfuges les plus avantageux, sous les prétextes les plus vraisemblables.
Dieu ne défend pas, en effet, d’aimer les siens, au contraire ; — ce qu’il défend à ceux sur lesquels il a mis l’épreinte de ses serres, à ceux qu’il désire expulser d’eux-mêmes pour qu’ils ne puissent vivre qu’en Lui, c’est cette incontinence de l’affection humaine qui refoule, en les contrecarrant, ses amoureux desseins ; — mais la pauvre âme qui, sans défiance, s’abandonne à ces excès les rapporte ou croit les rapporter à son Créateur qu’elle entretient constamment de ceux qu’elle aime ; elle le prie pour eux et elle estimerait ne pas remplir son devoir envers Lui et manquer à la charité envers eux si elle n’agissait pas de la sorte. Elle s’imagine en un mot les aimer en Lui et elle les aime autant sinon plus que Lui ; son intention est donc bonne quand elle veut imposer à son maître une association d’amitiés, un partage qui ne tend à rien moins qu’à le bannir de ses propres domaines.
Il y a là une erreur que suscite l’Esprit de Malice, car, ainsi que l’exprime, en des termes définitifs, dans son « Traité de la vie spirituelle et de l’oraison », Madame l’abbesse de sainte Cécile de Solesmes, « le Démon aime les violences, tout ce qui est poussé à l’outrance, même dans le Bien ».
Et c’est le chef-d’œuvre de son art que de détruire une vertu en l’exaltant !
Or, c’est ce qui advint à Lydwine ; elle n’avait pu se dépouiller de cette intempérance de tendresse qui lui avait déjà attiré, lors du décès de son frère, des remontrances. Depuis cette mort, sa dilection s’était accrue pour ses deux petits garde-malades, son neveu et sa nièce, et le Seigneur la frappa, en plein cœur, en lui supprimant Pétronille ; cette jeune fille avait alors dix-sept ans et depuis qu’elle avait été blessée par les Picards, en voulant secourir sa tante, elle boitait et languissait, n’avait jamais pu parvenir, malgré les traitements des meilleurs médecins, à se rétablir.
Une nuit, Lydwine, ravie en esprit, aperçut une procession qui sortait de l’église de Schiedam ; en une lente théorie, cheminaient sur deux lignes, précédés des cierges et de la croix, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges, les saintes femmes, les personnages du Commun des saints ; ils se dirigèrent du sanctuaire vers sa maison, y firent la levée d’un corps exposé à la porte et l’accompagnèrent à l’église.
Et, elle-même, se voyait derrière le convoi, avec trois couronnes ; une sur la tête, et une dans chaque main.
Et le rêve s’évanouit.
Lorsqu’elle eut repris ses sens, Lydwine pensa tout d’abord que cette vision la concernait et qu’elle était le présage de sa fin ; mais elle fut détrompée par Jésus qui lui révéla que ce simulacre se référait à sa nièce et il lui indiqua, en même temps, le jour et l’heure où Pétronille naîtrait au ciel.
Lydwine sanglotait, accablée ; elle réagit pourtant en songeant à l’agonie de celle qu’elle aimait comme une fille et elle s’écria : Ah ! Seigneur, accordez-moi au moins dans ma détresse une grâce ; cette heure que vous me désignez est une de celles où je dois être rongée par cette fièvre qui se rallume, vous le savez, à des heures fixes ; et alors, je ne suis plus bonne à rien, incapable de toute attention, de tout effort ; je vous en supplie, réglez autrement la marche de mon mal, afin que je sois en état d’assister ma pauvre Pétronille, lorsque le moment de me séparer d’elle sera venu.
Jésus exauça cette prière et, au grand étonnement de ceux qui soignaient la sainte, l’accès si précis d’habitude fut anticipé de six heures et sa durée fut moins longue que de coutume.
A peine en fut-elle délivrée, que Pétronille entra en agonie et Lydwine qui la voyait toute tremblante put la soutenir et prier avec elle ; et elle mourut peu après et alla recevoir les trois couronnes que sa tante portait, en son ravissement ; l’une à cause de la virginité de son corps, l’autre à cause de sa chasteté spirituelle, la troisième enfin à cause même de cette blessure que des chenapans de la Picardie lui firent.
Lydwine s’était jusqu’à ce moment roidie contre sa peine ; elle avait écouté, navrée, la sentence du Seigneur, mais elle n’avait pas faibli tant qu’il s’était agi de réconforter sa nièce ; elle avait refoulé ses larmes et adouci par son apparente fermeté les derniers moments de la petite ; mais lorsque celle-ci fut inhumée, sa vaillance tomba ; elle succomba à la douleur et ne cessa de pleurer ; et, au lieu de s’atténuer avec le temps, son chagrin s’aggrava ; elle le cultiva, le nourrit de ses regrets sans cesse présents, se submergea en lui de telle sorte que Jésus, délaissé, se fâcha.
Il ne lui adressa aucun reproche, mais il s’éloigna.
Alors, ce fut ainsi qu’à ses débuts dans la vie purgative, l’angoisse de l’âme prisonnière dans les ténèbres ; rien, pas même le pas furtif du geôlier qui rôde dans les alentours, mais un silence absolu dans une nuit noire.
Ce fut l’in-pace de l’âme enchaînée dans un corps perclus ; forcément, dans cette solitude, elle dut se replier sur elle-même et se chercher ; mais elle ne trouva plus en elle que des ruines d’allégresse, que des décombres déshabitées de joie ; une tempête avait tout jeté bas ; elle ne put devant ces débris de ses aîtres que se susciter l’amer souvenir du temps où l’Époux daignait les visiter ; et ce qu’elle était heureuse alors de servir son Hôte, de s’empresser autour de Lui et comme il payait au centuple ses pauvres soins ! ah ! ce logis que les anges l’aidaient à préparer pour accueillir le Bien-aimé, il en subsistait quoi maintenant ? il avait suffi d’un instant d’inadvertance, d’une minute d’oubli pour que tout croulât !
Elle se tordait de désespoir et, sous la force expansive de la douleur, l’âme se brisa et ce fut affreux.
Cependant, si l’on y réfléchit, cette détresse ne put être la même que celle qu’elle subit lorsqu’elle préluda dans les voies du douaire mystique ; elle s’en rapproche certainement, mais elle en diffère par certains points ; dans la première qui est évidemment cette « nuit obscure » que saint Jean de la Croix a si merveilleusement décrite, il y a, en outre des sécheresses, des aridités, du chagrin issu des dérélictions et du délaissement intérieur, une sorte de peine du dam ; l’on s’imagine, en effet, que cet état durera toujours, que l’abandon du Seigneur est irrémissible ; et cela, c’est épouvantable ; il faut avoir été tenaillé par cette angoisse dont rien ne peut donner une idée, pour se douter de ce que souffrent dans l’Enfer les damnés.
Or, Lydwine avait vu de trop près le Seigneur pour appréhender une telle infortune ; elle se savait assez aimée pour être certaine que son repentir désarmerait le mécontentement de l’Époux ; d’autre part, elle n’était pas non plus, comme à ses débuts, dans l’impossibilité de se recueillir et de prier ; elle se recolligeait sans goût, elle priait sans ressentir de douceurs sensibles, mais elle pouvait quand même, et sans s’éparpiller, prier ; c’était une faible lueur, un rayon bien lointain qui pénétrait dans l’ombre de sa geôle, mais enfin, si pâle qu’elle fût, cette clarté attestait une attention, avérait une pitié, prouvait qu’elle n’était pas complètement répudiée, définitivement omise. Elle était, en somme, dans la situation d’une âme au Purgatoire qui souffre mais attend avec résignation sa délivrance.
Et néanmoins, quelle misérable existence était la sienne ! ses tortures corporelles étaient devenues sans contre-poids ! aucun relais pour les modérer, aucune halte pour les amortir ; littéralement, elles la saccagèrent ; la nature, privée de son soutien supernel, livrée à elle-même, éclata en cris déchirants et Lydwine vomit le sang à pleine bouche.
En vain, Jan Walter qui lui était si dévoué tentait de la consoler ; elle éprouvait une lassitude des conseils, un dégoût de tout. Effrayée de la voir ainsi déprimée, sa fidèle Catherine, installée à son chevet, s’écria, désespérée, un jour : mais enfin, mon Dieu, que se passe-t-il donc ici ?
A ce moment, plus calme, Lydwine répondit :
— C’est à cause de mes péchés que vous me voyez si malheureuse ; j’ai perdu par ma faute tout attrait spirituel, même lorsque je communie. Je n’ai plus, ni ravissements, ni lumière prophétique, ni réconfort, rien. Ce Seigneur ne m’a laissé, pour me soulager, que la faculté de pouvoir méditer, ainsi qu’autrefois, sa vie sans m’évaguer ; mais je n’y découvre plus aucune aise, il me semble que je suis déportée sur une terre de glace, dans une région inconnue que rien n’éclaire et où je ne suis nourrie qu’avec de la myrrhe et du fiel.
Cette épreuve dura cinq mois ; puis, un 2 juillet, fête de la Visitation de la Très-Sainte Vierge, les pans de nuit qui muraient l’âme de la sainte tombèrent ; le jour jaillit à flots et Jésus parut.
Ce ne fut qu’un élan et qu’un cri ; l’âme se jeta, éperdue, à ses pieds et il la releva et la serra tendrement contre Lui. Elle défaillit de bonheur et, pendant près de dix jours, vécut hors d’elle-même, au-dessus du temps, au-delà des images et loin des formes, immergée, comme absorbée dans l’océan de la divine Essence. Si elle n’eût respiré, ses amis l’auraient cru morte.
Mais ce qui les émerveilla plus que tout, ce fut une odeur nouvelle qui s’échappa de ses stigmates et de ses plaies. Cette senteur si particulière, unique dans les monographies des saintes, cette senteur qu’elle seule exhalait depuis des années et qui était telle qu’une quintessence des aromates de l’Inde et des épices du Levant s’évanouit et fut remplacée par une autre et celle-là rappelait, mais épurée, mais sublimée, le parfum de certaines fleurs coupées fraîches. Brugman raconte, en effet, qu’elle expirait, au plus fort de l’hiver, des effluves tantôt de rose, tantôt de violette et tantôt de lys.
Ces émanations moins rares, nous les retrouvons, avant et après Lydwine, chez d’autres saints. Rose de Viterbe qui vécut au XIIIe siècle dégageait en effet l’odeur de la rose et sainte Catherine de Ricci et sainte Térèse qui vécurent au XVIe fleuraient, l’une la violette et l’autre la violette et le lys, symboles de l’humilité et de la chasteté.
Ce changement eut lieu, alors qu’elle s’était entièrement dépossédée et alors que le terme de ses jours était proche ; il semblait que le souffle printanier des floraisons succédant au fumet hivernal des épices conservées et des coques sèches annonçât la fin de son hiver terrestre et l’arrivée de cet éternel printemps dans lequel elle allait, après sa mort, entrer.
Sa chambre embaumait à un tel point que toute la ville défila chez elle pour respirer ce bouquet.
Qu’est cela ? nous n’avons jamais rien humé de pareil, s’écriaient les badauds, et Lydwine répondait :
— Dieu seul le sait ; quant à moi, je ne suis qu’un pauvre être et il m’a fallu bien des châtiments pour me faire comprendre combien j’étais encore sujette aux infirmités de la nature humaine ; louez le Seigneur et priez-le pour moi !
N’est-il pas utile de remarquer, à ce propos, que les hagiologes ne contiennent guère de biographies qui soient plus odorantes que celle de Lydwine ? Je n’en connais, pour ma part aucune où la bénévolence divine s’affirme ainsi, à chaque page. Outre que la bienheureuse était une cassolette vivante, toutes les fois que Notre-Seigneur, que sa Mère, que ses anges venaient la visiter, ils laissaient, en partant, des traces fragrantes de leur passage et les personnes même que Lydwine conduisait avec elle dans le Paradis, y étaient saturées de célestes effluences qui leur enivraient l’âme et en guérissaient les maux.
De toute la famille de Lydwine qui fut nombreuse, il ne restait plus pour habiter avec elle et la veiller qu’un neveu, âgé de douze ans. Des huit frères qu’elle avait, deux étaient morts, Wilhelm, le père de Pétronille et de Baudouin, et cet autre Baudouin dont le nom nous a été révélé par une vision de la sainte. Les six autres étaient-ils aussi décédés ou résidaient-ils au loin ? on l’ignore ; en tout cas, aucun ne nous est signalé comme s’étant jamais occupé de sa sœur.
Baudouin, son neveu, était un petit garçon, sage et pieux, que l’on se figure aisément tel que tant d’enfants du peuple en Hollande, un blondin, un peu massif, avec une face ronde, rendue avenante par de bons yeux ; il menait, en somme, une assez triste existence car, au lieu de jouer avec les gamins de son âge sur la place, il devait demeurer silencieux, dans une chambre, attentif à contenter les désirs d’une malade. Sa tante voulut lui manifester sa gratitude pour son dévouement et ses soins et elle le fit d’une façon singulière ; craignant peut-être qu’il ne fût, quand elle ne serait plus là, tenté par des doutes contre la foi, elle souhaita qu’il ne pût oublier les surprenantes merveilles dont il était le témoin, dans cette maison hantée par Notre-Seigneur, par sa Mère et par les anges, et la grande Douloureuse qu’elle était, pensa que, seule, la souffrance serait assez forte pour frapper l’imagination de l’enfant et y sceller à jamais le souvenir de tant de grâces.
Elle pria, en conséquence, le Sauveur de lui envoyer un accès de fièvre qui ne mît point ses jours en danger, mais qui lui rappelât, par la suite, le temps où il vivait auprès d’elle.
Sa requête fut exaucée.
Un soir, vers la fête de la Nativité de sainte Marie, Lydwine demanda à son neveu qui tenait à la main une cruche de petite bière, de la déposer sur une table, au chevet de son lit. Baudouin obéit et la cruche passa là la nuit. Le lendemain, cette bière s’était changée en un élixir aromatisé avec les fougueuses écorces d’idéales cannelles et les zestes éveillés de fabuleux cédrats. Plusieurs personnes en goûtèrent et cette liqueur les stimula de même qu’un cordial, mais l’enfant, en ayant bu quelques gouttes, fut aussitôt appréhendé par une fièvre qui ne le quitta pas avant la saint-Martin.
Après qu’il eut été rétabli, ce fut le tour de Jan Walter d’être malade ; lui, fut féru d’une fièvre intermittente dont les accès correspondaient à ceux de Lydwine, ce que voyant, l’une de ses sœurs, nommée Cécile, s’enquit auprès de la sainte pour savoir combien de jours cette maladie durerait. — Jusqu’au dimanche de Carême, répondit-elle. — Et Walter recouvra, en effet, la santé, à cette époque. Plus tard, il fut encore atteint d’une affection, mais si grave celle-là, que tous ses amis le crurent perdu, tous, sauf Lydwine qui, après avoir harcelé le ciel de suppliques, obtint sa guérison.
Elle éliminait par ses prières les tortures des autres, mais les siennes augmentaient d’autant. Elle approchait de sa fin. En nous racontant l’histoire de son neveu, Gerlac nous laisse entendre qu’elle eut lieu l’année même de sa mort ; mais Thomas A Kempis antécède d’une année et la reporte par conséquent à l’an 1432.
Ce qui est certain, c’est que ses moments étaient maintenant comptés et Dieu la paracheva dans sa mission de victime réparatrice, en l’écrasant sous une dernière avalanche de maux. Elle n’avait plus une partie du corps qui fût indolore et cependant il découvrit des places de douleurs presque vides et il les emplit. Il la frappa d’attaques d’épilepsie et elle en eut jusqu’à trois par nuit. Avant la première, elle prévint ses intimes pour qu’ils eussent à la maintenir et à l’empêcher de se briser le crâne contre les murs.
C’est très bien, répliquèrent-ils, mais il serait mieux de détourner ces assauts que vous nous annoncez, en suppliant le Seigneur de vous en préserver ; vous avez assez de maladies sans encore y adjoindre celle-là ; mais elle les blâma de juger des volontés de Dieu. Bientôt, aux furies du haut-mal vinrent s’ajouter des crises de démence ; seulement elles furent très courtes ; elles sévirent juste assez pour qu’il fût dit qu’excepté la lèpre, aucune maladie ne lui avait été épargnée ; elle fut encore terrassée par un coup d’apoplexie dont elle se releva, mais les névralgies et les rages de dents ne cessèrent plus ; un nouvel ulcère lui rongea le sein ; enfin, depuis la fête de la Purification jusqu’à Pâques, la gravelle lui suscita des tourments terribles et elle eut de telles contractions de nerfs que ses membres déplacés se mêlèrent ; elle devint quelque chose de bizarre, d’informe d’où dégouttaient du sang et des larmes et d’où sortaient des cris.
Elle souffrait le plus impitoyable des martyres, mais elle embrassait maintenant, dans son ensemble, la tâche qu’elle était chargée d’accomplir.
Jésus lui exhibait, en une épouvantable vision, le panorama de son temps.
L’Europe lui apparaissait, convulsée — comme elle-même l’était — sur le lit de son sol et elle cherchait à ramener, d’une main tremblante, sur elle la couverture de ses mers pour cacher son corps qui se décomposait, qui n’était plus qu’un magma de chairs, qu’un limon d’humeurs, qu’une boue de sang ; car c’était une pourriture infernale qui lui crevait, à elle, les flancs ; c’était une frénésie de sacrilèges et de crimes qui la faisait hurler, ainsi qu’une bête qu’on assassine ; c’était la vermine de ses vices qui la dépeçait ; c’étaient des chancres de simonie, des cancers de luxure qui la dévoraient vive ; et terrifiée, Lydwine regardait sa tête tiarée qui ballottait, rejetée tantôt du côté d’Avignon, tantôt du côté de Rome.
Vois, fit le Christ, et, sur un fond d’incendies, elle aperçut, sous la conduite de fous couronnés, la meute lâchée des peuples. Ils s’égorgeaient et se pillaient sans pitié ; plus loin, en des régions qui semblaient paisibles, elle considéra les cloîtres bouleversés par les brigues des mauvais moines, le clergé qui trafiquait de la chair du Christ, qui vendait à l’encan les grâces du Saint-Esprit ; elle surprit les hérésies, les sabbats dans les bois, les messes noires.
Elle serait morte de désespoir si, pour la consoler, Dieu ne lui avait aussi montré la contre-partie de ce siècle, l’armée des saints en marche ; ils parcouraient sans s’arrêter le monde, réformaient les abbayes, détruisaient le culte de Satan, mataient les peuples et refrénaient les rois, passaient, en dépit de tous les obstacles, dans des tourbillons de crachats et de huées ; et tous, qu’ils fussent actifs ou contemplatifs, souffraient, eux aussi, aidaient à acquitter par leurs oraisons et leurs tortures la rançon de tant de maux !
Devant l’immensité de la dette, elle s’estimait si pauvre ! qu’étaient ses infirmités et ses afflictions en face de cette marée d’ordures ? une goutte d’eau, à peine ; et elle suppliait le Seigneur de ne plus la ménager, de se venger sur elle de ce monceau d’offenses !
Elle savait que le terme de son existence était proche et elle craignait maintenant de n’avoir pas rempli sa mission, d’avoir été trop heureuse ; elle se jugeait une ouvrière improductive qui n’apportait à la ruche des douleurs qu’un infime butin, qu’une faible part ; et cependant, l’infortunée, ce qu’à certains moments, elle était lasse, lorsque, descellée de ses extases, elle retombait dans sa pauvre chambre ! mais des apparitions la réconfortèrent. Un jour qu’elle était dans le ravissement, elle rencontra son grand-père, à la porte du Paradis.
— Ma très douce fille, lui dit-il, je ne puis vous permettre d’entrer dans ce lieu du perdurable repos, car ce serait une calamité pour ceux qui ont besoin de vos services ; vous avez encore des péchés d’autrui à compenser, des âmes du Purgatoire à affranchir ; mais consolez-vous, ma chère enfant, ce ne sera plus long.
Une autre fois, son ange lui désigna un rosier qui avait la stature d’un arbre et qui était couvert de boutons et de fleurs et il lui expliqua qu’elle ne serait libérée de la peine de la vie que lorsque toutes les roses seraient épanouies.
Mais enfin, lui demandèrent Jan Walter et la veuve Catherine Simon : reste-t-il encore beaucoup de boutons à éclore ?
— Toutes les roses sont actuellement ouvertes, sauf une ou deux, fit-elle ; aussi ne tarderai-je pas à vous quitter.
Elle dit également à un prieur des chanoines réguliers qu’elle semble avoir tenu en une particulière estime :
— Je vous serai reconnaissante, mon cher père, de revenir encore me voir après Pâques ; cependant, si Dieu me retirait de ce monde avant votre visite, je recommande mon âme à votre charité, n’est-ce pas ?
Le prieur conclut de cette restriction qu’elle ne chanterait pas l’alleluia sur la terre, à cette époque ; et, elle-même, finit par avouer à ses intimes qu’elle trépasserait pendant le temps Paschal, mais elle ne leur précisa ni le jour, ni l’heure, parce qu’elle voulait s’en aller, seule, sans autre assistance que celle de Jésus.
— Et votre maison, que deviendra-t-elle, après votre décès ?
— Rappelez-vous, fit-elle à ses amis qui lui posaient cette question, rappelez-vous ce que je répliquai à un bon Flamand lorsque, touché de ma détresse, il m’offrit de me bâtir un refuge plus commode ; tant que je vivrai, je n’aurai pas d’autre logement que celui-ci ; mais si, après ma mort, quelqu’un veut convertir cette triste demeure en un hôpital pour les indigents, je prie d’avance le Seigneur de le récompenser.
Ce fut là, elle le savait, une parole prophétique qu’un pieux médecin Wilhelm, le fils de ce brave Godfried de Haga, dit Sonder-Danck, qui l’avait soignée dans sa jeunesse, accomplit, après son trépas. Et à quelqu’un qui, comprenant qu’elle s’attendait à prochainement mourir, l’interrogeait pour connaître si Dieu opérerait des miracles sur sa tombe, elle répartit :
— Je n’ignore pas que des âmes simples s’imaginent que ma disparition s’accompagnera de phénomènes extraordinaires ; elles se trompent absolument ; quant à ce qui doit survenir après mon enterrement, Dieu seul le sait et je n’ai nulle envie d’être renseignée sur ce point. Je désire seulement que mes amis n’exhument pas mes restes avant que trente années ne se soient écoulées depuis le jour de ma sépulture et que mon corps qui n’a pas touché la terre pendant trente-trois ans, ne l’effleure même pas dans sa bière ; je voudrais enfin que mes obsèques se fissent sans aucun retard.
Telles furent ses dernières volontés ; elle les communiqua aux intimes qui l’entouraient ; ils ne doutèrent plus, en l’entendant s’exprimer de la sorte, que sa fin ne fût imminente ; ils en furent plus certains encore, lorsque, les ayant tous réunis autour de son grabat, elle leur dit :
— Je vous conjure de me pardonner les peines que j’ai pu vous causer ; ne me refusez pas ce merci que je sollicite pour l’amour de Dieu ; de mon côté, je le prie et le prierai bien pour vous.
Tous fondirent en larmes, protestant que loin de les avoir jamais offensés, elle les avait, au contraire, grandement édifiés par sa bonté et sa patience.
Enfin, le jour de Pâques fleuries vint. Lydwine sortit de sa réserve avec l’Époux. Il l’inondait de telles délices qu’elle se pencha sur son cœur et murmura : oh ! je suis lasse de vivre, enlevez-moi d’ici-bas, mon Seigneur, enlevez-moi !
Jésus sourit et la Vierge et les douze Apôtres et une multitude d’anges et de saints parurent derrière Lui. Jésus se mit à la droite de Lydwine et Marie à sa gauche ; tout près du Christ, une table jaillit sur laquelle étaient une croix, un cierge allumé et un petit vase ; les anges s’approchèrent du lit et découvrirent la patiente. Alors, le Sauveur prit le petit vase qui contenait l’huile des infirmes et il fit les onctions accoutumées, sans proférer un mot ; les anges la recouvrirent ; Jésus lui plaça le cierge dans la main et posa le crucifix sous ses yeux et il y demeura, visible pour elle seule, jusqu’à sa mort.
Lydwine lui dit alors humblement :
— Mon doux Maître, puisque vous avez daigné vous abaisser jusqu’à la plus misérable de vos servantes ; puisque vous n’avez pas eu le dégoût d’oindre mon malheureux corps avec vos très saintes mains, soyez indulgent jusqu’au bout. Accordez-moi cette dernière grâce de souffrir autant que je le mérite personnellement, afin qu’aussitôt exonérée de la vie, je sois admise, sans avoir à passer par le Purgatoire, à contempler votre suradorable Face.
Et Jésus répondit :
— Tes vœux sont exaucés, ma fille ; dans deux jours, tu chanteras l’alleluia avec tes sœurs les Vierges, dans le Paradis.
Lorsque le soleil fut levé, vers quatre heures du matin, son confesseur Walter la visita. Il avait été ravi en contemplation pendant la nuit et il avait vu Lydwine, rayonnante de joie, parmi les anges ; la chambre embaumait quand il y pénétra.
— Oh ! s’écria-t-il, je sais que votre époux part d’ici, mais ne l’aurais-je pas su, que je le devinerais rien qu’en aspirant ce fleur de l’Éden ! vous a-t-il annoncé votre délivrance ? ne me cachez rien, s’il se peut, chère sœur.
Transportée d’allégresse, elle s’exclama : mes souffrances vont redoubler, mais ce sera bientôt terminé !
Et, en effet, la gravelle et le charbon la supplicièrent, sans aucune trêve ; elle vécut, le lundi de Pâques, dans d’épouvantables affres ; le mardi, elle s’apprêta à mourir et comme sa chambre était pleine de monde, elle dit doucement :
— Laissez-moi seule aujourd’hui avec le petit, — elle désignait son neveu Baudouin, assis près du lit, — si vous êtes mes amis, faites cela pour moi ; soyez sans inquiétude d’ailleurs ; au cas où j’aurais besoin de vous, j’enverrais l’enfant vous prévenir.
Tous crurent qu’elle souhaitait de se recueillir et de prier, en paix et, ne pensant pas que la mort la talonnait, se retirèrent ; Jan Walter s’éloigna, à son tour, et s’en fut à l’église réciter les vigiles des trépassés pour la supérieure du couvent des sœurs Tertiaires qui venait de décéder ; à peine l’eut-il quittée, que l’agonie commença ; elle dura de sept heures du matin à quatre heures du soir ; les vomissements la déracinaient et la jetaient, brisée, sur le carreau ; elle rendait, avec des matières verdâtres, le fiel à pleine bouche ; Baudouin n’avait que le temps de vider la cuvette au dehors et de la rapporter.
— O mon enfant, dit-elle au petit qui pleurait, si le bon Walter voyait ce que je souffre !
Baudouin s’exclama : tante, voulez-vous que j’aille le chercher ?
Elle ne répondit pas ; elle avait perdu connaissance.
Alors, l’enfant terrifié courut à toutes jambes à l’église qui était très peu distante de la chaumière, car l’on pouvait à peine réciter, en allant de l’une à l’autre, trois fois le psaume « Miserere ». Walter se hâta d’arriver et il trouva la sainte inanimée. Il espéra qu’elle n’était qu’insensibilisée par l’extase ; néanmoins il fit quérir toutes les amies de Lydwine qui, ne voulant pas, elles non plus, croire au décès et, ignorant que le Seigneur lui avait, comme à saint Antoine de Padoue, donné, de ses propres mains, l’Extrême-Onction, lui demandèrent de leur faire connaître par un signe si elle ne désirait pas recevoir les derniers sacrements ; mais Lydwine ne bougeait plus ; alors, Walter alluma une chandelle qu’il plaça derrière la tête de la sainte, de peur que la lumière ne lui blessât les yeux, si elle respirait encore et il l’examina de près ; le doute n’était plus possible, elle avait cessé de vivre.
Les femmes éclatèrent en sanglots, mais Catherine Simon qui refoulait ses larmes leur enjoignit de se taire.
— Voyons, fit-elle, si ce que Lydwine m’a souvent prédit, que ses mains se rejoindraient, après sa mort, s’est réalisé.
Son bras droit avait été, en effet, consumé par le feu des ardents et il ne tenait, depuis bien des années, que par un fil. Un chirurgien avait réussi avec un pharmaque de sa composition à le consolider, mais non à le guérir et à le mettre en état de remuer ; il était donc humainement impossible que les deux mains pussent se rapprocher l’une de l’autre et se toucher.
Catherine souleva la couverture et constata que les doigts des deux mains étaient enlacés sur la poitrine ; elle découvrit, stupéfiée aussi, que sa rude ceinture en crins de cheval ne lui ceignait plus les reins, mais qu’elle avait été pliée, sans que les cordons qui l’attachaient eussent été dénoués, et déposée près de ses épaules, par son ange sans doute, sur le chevet du lit.
J’ai palpé cette ceinture, raconte Brugman, j’ai humé le parfum qu’elle exhale et j’affirme que, m’en étant servi dans des séances d’exorcisme, elle s’est révélée d’une puissance irrésistible contre les démons. Quant à moi, atteste, de son côté, Michel d’Esne, « je l’ai maniée de mes propres mains et ai vu par expérience que les diables l’ont en grande horreur et crainte ».
La nuit après la mort, Walter qui, harassé de chagrin, ne parvenait pas à s’endormir, aperçut l’âme de sa pénitente, sous la forme d’une blanche colombe dont le bec et la gorge étaient couleur d’or, les ailes du ton de l’argent, les pattes d’un rouge vif ; et Brugman explique de la sorte le symbolisme de ces nuances : l’or du poitrail et du bec signifiait l’excellence de ses enseignements et de ses conseils ; l’argent des ailes, l’essor de ses contemplations ; l’écarlate des pieds indiquait la marche de ses pas dans les traces sanglantes du Christ ; la candeur du corps allégorisait enfin l’éclatante pureté de la bienheureuse.
L’une des trois sœurs de Jan Walter, qui avaient veillé le cadavre, distingua à son tour l’âme de Lydwine emportée au ciel par des anges et Catherine Simon la vit entrer dans sa chambre, accompagnée d’un grand nombre de déicoles et elle participa au céleste festin des noces.
Toujours, en cette même nuit, elle se montra à de saintes filles qui l’aimaient sans la connaître, habillée de blanc, couronnée de roses par le Seigneur et menée au chant de la séquence « Jesu corona Virginum » qu’entonnèrent les Anges, au-devant de la sainte Vierge qui lui passa autour du cou un collier de gemmes en feu et la serra tendrement dans ses bras.
Le lendemain matin, dès l’aube, Walter se rendit à la maison mortuaire ; il s’agenouilla devant le lit et, le cœur défaillant de tristesse, pleura ; puis il se releva et dit à ses sœurs et à Catherine Simon : ôtez le voile qui couvre le visage de notre amie ; elles obéirent et ce ne fut qu’un cri.
Lydwine était redevenue ce qu’elle était avant ses maladies, fraîche et blonde, jeune et potelée ; on eût dit d’une fillette de dix-sept ans qui souriait, endormie. De la fente du front qui l’avait tant défigurée, il ne subsistait nulle couture ; les ulcères, les plaies avaient disparu, sauf cependant les trois cicatrices des blessures faites par les Picards ; elles couraient comme trois fils de pourpre, sur la neige des chairs.
Tous étaient devant ce spectacle béants et ils odoraient, sans pouvoir se lasser, une senteur inanalysable, si roborative, si fortifiante, qu’ils n’éprouvèrent, pendant deux jours et trois nuits, aucun besoin de sommeil et de nutriment.
Mais bientôt ce fut une foison de visites ; dès que le bruit se fut confirmé que la sainte était morte, non seulement les habitants de Schiedam, mais encore ceux de Rotterdam, de Delft, de Leyde, de Brielle, défilèrent dans la pauvre chambre.
A Kempis évalue à plusieurs milliers le nombre des pèlerins et, avec Gerlac et Brugman, il narre qu’une femme de mauvaise vie ayant effleuré avec son chapelet le cou de la morte, l’on constata après son départ, que les grains du chapelet s’étaient marqués, ainsi que des gouttes de poix, sur la peau, en noir ; pareil fait s’était produit, de son vivant, ajoutent les biographes, car lorsque ses doigts touchaient une main impure, ils se couvraient aussitôt de macules. Walter défendit alors aux visiteurs de frôler avec des objets de piété ou des linges la dépouille de la bienheureuse. Il avait hâte d’ailleurs, pour satisfaire aux vœux de Lydwine, d’inhumer son corps, mais les magistrats de Schiedam s’y opposèrent. « L’on n’osait enterrer le cadavre, dit Michel d’Esne, d’autant que le comte de Hollande avait dit de le venir voir. »
N’est-il pas à observer, à ce propos, que tous les petits potentats de la Hollande fréquentèrent la sainte ? nous avons noté ses relations avec Wilhelm VI, la comtesse Marguerite et avec le duc Jean de Bavière. Philippe, duc de Bourgogne et comte de Hollande, la connut évidemment, lui aussi, puisqu’il se proposait d’assister à ses funérailles. Seule, la légitime souveraine Jacqueline est absente de ce récit. Il est vrai qu’elle vécut constamment évincée de ses domaines par la perfidie de ses oncles, qu’elle erra, chassée d’une province à l’autre, tantôt en prison et tantôt assiégée dans des places fortes ; elle n’ignora vraisemblablement pas l’existence de Lydwine, mais en admettant qu’elle eût pu joindre la sainte, alors qu’elle était encore libre et que ses ennemis n’occupaient pas le territoire de Schiedam, peut-être ne se souciait-elle point de réclamer des conseils ou de recevoir, à l’occasion de ses fallacieux mariages, des avis qui ne pouvaient que très certainement lui déplaire. Toujours est-il que son nom n’est même pas prononcé une fois par les trois historiens.
Pour en revenir à Lydwine, quand Walter apprit le refus des échevins d’autoriser l’enterrement, il s’indigna et voulut passer outre, mais il lui fut enjoint, sous peine de la prison et de la confiscation de ses biens, de ne pas changer le cadavre de place. Force lui fut donc de se soumettre. En attendant l’heure des obsèques, et bien que, malgré sa liaison avec les sœurs tertiaires, Lydwine ne fît pas partie du tiers-ordre de saint François, — car Brugman qui était franciscain n’eût pas manqué de nous en avertir, — on la revêtit d’une robe de laine et d’une ceinture pareilles à celles de ces religieuses ; on la coiffa en outre d’un bonnet de vélin sur lequel étaient écrits à l’encre les noms de Jésus et de Marie ; puis Walter glissa un oreiller de paille sous sa tête et, ainsi qu’elle en avait manifesté le désir, un petit sachet contenant ce qu’elle appelait ses « roses » qui n’étaient autres que les larmes coagulées de sang qu’elle avait tant de fois versées. Walter les détachait, en effet, du visage, lorsqu’il allait, le matin, chez elle et il les serrait avec soin chez lui, dans une cassette.
Elle demeura ainsi exposée, pendant trois jours ; enfin, le duc de Bourgogne ayant avisé les magistrats qu’il ne fallait pas compter sur sa présence, l’ordre d’inhumer fut obtenu.
Le vendredi matin, après un service solennel, célébré sous la présidence du P. Josse, prieur des chanoines réguliers de Brielle, celui-là peut-être qu’elle avait prié de la visiter après Pâques, elle fut enterrée, à midi précis, dans la partie méridionale du cimetière contigu à l’église.
Suivant ses volontés, pour que sa dépouille ne touchât pas la terre, l’on plaqua sur le fond et les parois de la fosse des cloisons de bois, puis on couvrit la tombe d’une maçonnerie en forme de voûte et l’on scella sur le tout, à une hauteur d’environ deux coudées, une grande pierre rougeâtre à l’envers de laquelle furent tracées, avec du cinabre, des croix. L’an d’après, le clergé fit construire sur sa sépulture une chapelle de pierre qui communiqua par une ouverture avec l’église.
Lydwine avait alors cinquante-trois ans et quelques jours ; elle mourut, le 18 des kalendes de mai, autrement dit le 14 avril, jour de la fête des saints martyrs Tiburce et Valérien, l’an du Seigneur 1433, le mardi dans l’octave de Pâques, après vêpres, vers quatre heures.
Les miracles ne tardèrent pas à éclore ; parmi ceux qui sont avérés, nous en citerons trois :
Le premier se produisit à Delft ; une jeune fille qui gardait depuis huit années le lit, avait été abandonnée par les médecins, lorsqu’un jour Wilhelm, le fils de Sonder-Danck qui exerçait ainsi que son père la profession de médecin, lui dit, après lui avoir confessé que son mal était incurable :
— Que sont vos souffrances, en comparaison de celles qu’endura cette bienheureuse Lydwine que traita mon père ? Dieu effectue maintenant par ses mérites de nombreux miracles dans nos contrées. Invoquez-la donc !
La malade se sentit aussitôt incitée à implorer la sainte qui lui apparut et la guérit.
Le second se passa à Gouda. Il existait dans un couvent de religieuses une nonne qui avait une jambe plus courte que l’autre et si contractée qu’elle ne pouvait marcher. Elle avait demandé qu’on la transportât à Delft pour être examinée par ce Wilhelm Sonder-Danck qui avait soigné une autre sœur de ses amies ; mais ses supérieures lui refusèrent la permission de partir. Elle se désespérait, quand Lydwine surgit, pendant la nuit, dans sa cellule et l’invita à engager les moniales de la communauté à réciter, chacune, cinq pater et cinq ave, en l’honneur de Dieu et aussi pour elle ; ce après quoi, on la descendrait, le dimanche suivant, dans la chapelle du cloître où elle recouvrerait la santé ; et il advint, comme elle l’avait prédit ; l’estropiée sortit, joyeuse, et radicalement guérie, de l’église.
Le troisième fut accompli, à Leyde, au profit d’une autre nonne qui avait depuis huit années, au cou, une tumeur cancéreuse de la grosseur d’une pomme. Elle fut autorisée à pèleriner, par mortification, nu-pieds et simplement vêtue d’une robe de laine, sans linge dessous, au tombeau de Lydwine ; elle y alla mais en revint, navrée ; la tumeur n’avait pas disparu. Elle se coucha, suppliant la sainte de ne pas ainsi la dédaigner et elle s’endormit. Au réveil, l’excroissance s’était fondue, le cou était redevenu sain.
Ces miracles, qui ont été dûment constatés et ont fait l’objet d’enquêtes approfondies, ont eu lieu en 1448, sous le pontificat de sa sainteté le pape Nicolas V.
Telle fut la vie de sainte Lydwine de Schiedam ; elle réjouira sans doute les achristes et affligera les nombreux catholiques qui, par tiédeur de foi, par respect humain, par ignorance, relèguent de leur mieux la mystique dans les asiles d’aliénés et les miracles dans le rancart des superstitions et des légendes. A ceux-là, les biographies expurgées des Jansénistes pourraient suffire, s’ils n’avaient, à l’heure actuelle, toute une école d’hagiographes prêts à satisfaire leur haine du surnaturel, en fabriquant des histoires de saints confinés, avec défense de s’en échapper, sur la terre, de saints qui n’en sont plus. N’est-ce pas l’un de ces rationalistes, et non l’un des moindres, Mgr. Duchesne qui, consulté, il y a quelques années, à propos d’une révélation de l’incomparable sœur Emmerich que venait de confirmer une découverte près d’Éphèse, répondit : « je vous ai déjà dit qu’il est impossible d’introduire dans un débat sérieux un livre comme celui des visions de Catherine Emmerich ; l’archéologue se fonde sur des témoignages et non sur des hallucinations. »
Voilà qui proféré par un prêtre est bien ; ce qu’il doit la contemner la Mystique, celui-là !
N’en déplaise aux oracles de ce gabarit, il convient d’affirmer pourtant que, si étrange qu’elle paraisse, l’existence de Lydwine ne se singularise par rien d’anormal et par rien de neuf.
Sans parler des grâces spirituelles et des apparitions de Notre Seigneur et de la Vierge et des entretiens avec les Anges qui abondent dans toutes les vies des Saints et pour s’en tenir simplement aux phénomènes physiques, la plupart de ceux que nous avons divulgués, au cours de ce livre, se retrouvent consignés dans les biographies des innombrables élus qui vécurent avant ou après Lydwine.
Nous avons déjà remarqué, à l’occasion de ce don de l’ubiquité qu’elle posséda, que plusieurs autres célicoles se géminaient et se transféraient, dans des endroits différents, au même instant. Si nous recherchons maintenant quels autres saints et quels autres serviteurs ou servantes de Dieu vécurent ainsi que Lydwine sans autre aliment que l’Eucharistie, nous découvrons, entre beaucoup de ces privilégiés, la vénérable Marie d’Oignies, sainte Angèle de Foligno, sainte Catherine de Sienne, la bienheureuse Élisabeth la bonne de Waldsée, sainte Colombe de Riéti, Dominique du Paradis, la bienheureuse Marie Bagnesi, Françoise de Serrone, Louise de la Résurrection, la Mère Agnès de Langeac, Catherine Emmerich, Louise Lateau et pour signaler, au hasard, deux hommes : le bienheureux Nicolas de Flue et saint Pierre d’Alcantara.
Parmi la foule de ceux qui vécurent aussi sans réfection de sommeil, nous discernons sainte Christine l’admirable, sainte Colette, sainte Catherine de Ricci, la bienheureuse Agathe de la Croix, saint Elpide, sainte Flore ou Fleur, hospitalière de l’ordre de saint Jean ; et j’en passe.
Les plaies devenues des cassolettes de parfums agissant non seulement sur l’odorat, mais encore sur les âmes qu’elles sanctifient, nous les reconnaissons également chez sainte Humiliane, sainte Ida de Louvain, Dominique du Paradis, Salomoni de Venise, la Clarisse Jeanne-Marie de la Croix, Venturini de Bergame, le bienheureux Didée, chez le lépreux Barthole.
La bonne odeur de sainteté après la mort, elle exista chez le pape Marcel, sainte Aldegonde, saint Menard, saint Dominique, sainte Catherine de Bologne, la bienheureuse Lucie de Narni, la bienheureuse Catherine de Racconigi, sainte Claire de Rimini, sainte Fine de Toscane, sainte Élisabeth de Portugal, sainte Térèse, sainte Rose de Lima, saint Louis Bertrand, saint Joseph de Cupertino, saint Thomas de Villeneuve, saint Raymond de Pennafort, chez combien d’autres !
Au nombre des saints dont les corps furent, ainsi que celui de Lydwine, rétablis, après leur décès, dans leur jeunesse et leur beauté, figurent saint François d’Assise, saint Antoine de Padoue, saint Laurent Justinien, sainte Lutgarde, une victime réparatrice, elle aussi, sainte Catherine de Sienne, saint Didace, sainte Colombe de Riéti, sainte Catherine de Ricci, sainte Madeleine de Pazzi, la vénérable Françoise Dorothée, Marie Villani de Naples, sainte Rose de Lima et je pourrais prolonger la liste.
Par contre, Lydwine ne fit point partie du groupe des Myroblites, c’est-à-dire des déicoles dont les cadavres distillèrent des essences et des baumes. Tels ceux de saint Nicolas de Myre, de saint Willibrord, l’apôtre de la Hollande, de saint Vitalien, de sainte Lutgarde, de sainte Walburge, de sainte Rose de Viterbe, de la bienheureuse Mathie de Nazzarei, de sainte Hedwige, de sainte Eustochie, de sainte Agnès de Montepulciano, de sainte Térèse, de sainte Madeleine de Pazzi, de la carmélite Marguerite Van Valkenissen, et je ne les inscris pas tous.
Pour résumer maintenant, en quelques mots, l’existence de cette sainte que l’on ne voit jamais debout et jamais seule, l’on peut dire qu’elle fut peut-être celle qui souffrit le plus, et le moins en paix. Cette infirme du corps devait, en effet, donner des consultations aux infirmes de l’âme ; sa chambre était une clinique des maladies de conscience ; elle y recevait indistinctement prêtres et moines, échevins et bourgeois, patriciennes et bonnes femmes, gens de la plus basse extraction et princes, et elle les opérait et les pansait.
C’était un hospice spirituel ouvert à tout venant ; et Dieu le voulait ainsi pour que les grâces qu’il lui dispensait fussent connues du public, pour que les miracles qu’elle œuvrait, en son nom, fussent visibles.
Sa vocation de guérisseuse des maux corporels fut, si l’on y songe, moindre. Elle fut moins prononcée, en tout cas, que celle de beaucoup d’autres saints ; mais elle présente cette particularité que les maladies ôtées par Lydwine n’étaient pas, la plupart du temps, détruites mais simplement transplantées sur elle.
Au point de vue de l’ascèse même, il faut encore noter que le Seigneur exigea d’elle plus qu’il n’exigea d’autres élus ; elle était déjà parvenue au sommet de la vie unitive et il la replongeait dans la nuit ou plutôt dans le crépuscule de la vie purgative.
Cette division des trois étapes de l’ascension mystique, si distincte chez les théologiens, s’embrouille chez elle. Il n’est plus question de la halte du milieu, du relais illuminatif, mais des deux extrêmes, de la première et de la dernière étape, dans lesquelles elle semble, à une certaine époque, s’être en même temps tenue. Cependant si Dieu l’humilia et la punit, il ne la fit pas descendre des cimes qu’elle avait atteintes. Il enténébra des cimes, et il l’y esseula ; mais quand l’orage fut terminé, elle s’y retrouva, sans avoir perdu un pouce de terrain, indemne.
Elle fut, en somme, un fruit de souffrance que Dieu écrasa et pressura jusqu’à ce qu’il en eût exprimé le dernier suc ; l’écale était vide lorsqu’elle mourut ; Dieu allait confier à d’autres de ses filles le terrible fardeau qu’elle avait laissé ; elle avait pris, elle-même, la succession d’autres saintes et d’autres saintes allaient, à leur tour, hériter d’elle ; ses deux coadjutrices, sainte Colette et sainte Françoise Romaine avaient encore quelques années à souffrir ; deux des autres stigmatifères de son siècle, sainte Rite de Cassie et Pétronille Hergods touchaient à leur fin ; mais de nouvelles semailles de douleurs levaient, prêtes à les suppléer.
En thèse générale, tous les saints, tous les serviteurs du Christ sont des victimes d’expiation ; en dehors même de leur mission spéciale qui n’est pas toujours celle-là, car les uns sont plus personnellement désignés, soit pour effectuer des conversions, soit pour régénérer des monastères, soit pour prêcher aux masses, tous néanmoins apportent au trésor commun de l’Église un appoint de maux ; tous ont été des amoureux de la Croix et ont obtenu de Jésus d’être mis en mesure de lui administrer la preuve authentique de l’amour, la souffrance ; l’on pourrait donc justement avancer que tous ont contribué à parachever l’œuvre de Lydwine ; mais elle eut des héritières plus proches encore, des légataires plus directes, des âmes plus particulièrement indiquées, comme elle-même le fut, pour servir de victimes propitiatoires, d’holocaustes ; et c’est parmi ses consœurs que le Fils blasonna de ses armes, marqua de l’étampe de ses plaies, c’est surtout parmi les stigmatisées qu’il les faut chercher.
Ne sied-il pas d’observer, à ce propos, que toutes ces victimes appartiennent au sexe féminin ?
Dieu paraît, en effet, leur avoir plus spécialement réservé ce rôle de débitrices ; les saints, eux, ont un rôle plus expansif, plus bruyant ; ils parcourent le monde, créent ou réforment des ordres, convertissent les idolâtres, agissent surtout par l’éloquence de la chaire, tandis que, plus passive, la femme, qui n’est pas revêtue d’ailleurs du caractère sacerdotal, se tord, en silence, sur un lit. La vérité est que son âme et que son tempérament sont plus amoureux, plus dévoués, moins égoïstes que ceux de l’homme ; elle est également plus impressionnable, plus facile à émouvoir ; aussi Jésus rencontre-t-il un accueil plus empressé chez elle ; elle a des attentions, des délicatesses, des petits soins qu’un homme, lorsqu’il n’est pas saint François d’Assise, ignore. Ajoutez que chez les vierges, l’amour maternel rentré se fond dans la dilection de l’Époux qui se dédouble pour elles et devient, quand elles le désirent, l’Enfant ; les allégresses de Bethléem leur sont plus accessibles qu’à l’homme et l’on conçoit aisément alors qu’elles réagissent moins que lui contre l’emprise divine. En dépit de leur côté versatile et sujet aux illusions, c’est donc chez les femmes que l’Époux recrute ses victimes de choix et c’est sans doute cela qui explique comment sur les 321 stigmatisés que l’histoire connaît, il y a 274 femmes et 47 hommes.
La liste de ces réparatrices, héritières de Lydwine, elle existe tout au long dans un ouvrage merveilleusement documenté et absolument remarquable, dans « la Stigmatisation » du docteur Imbert-Gourbeyre.
Nous n’en extrairons cependant que celles des patientes dont la vocation de malades expiatrices ne peut être douteuse, celles dont la mission est écrite en toutes lettres, et nous y adjoindrons quelques victimes qui, si elles ne portèrent pas sur leur corps les cachets sanglants du Christ, furent de grandes extatiques et de grandes infirmes dont la vie présente les plus complètes analogies avec celle de Lydwine.
Parmi ces femmes qui, après la mort de la sainte de la Hollande, acquittèrent par des souffrances la rançon des péchés de leur temps et se substituèrent, en étant innocentes, aux coupables, nous trouvons :
AU XVe SIÈCLE.
Sainte Colombe de Riéti, une Italienne, du tiers-ordre dominicain ; celle-là ne fut pas stigmatisée ; chargée par le Seigneur de sommer le Pape, de corriger ses mœurs et d’épurer sa Cour, elle fut soumise aux plus impitoyables investigations et aux pires sévices à Rome ; elle compensa aussi par des maladies inconnues des médecins les forfaits de son époque et mourut à la peine, en 1501.
La Bienheureuse Osanne, la patronne de la ville de Mantoue, une Italienne, tertiaire de l’ordre de saint Dominique ; elle naquit six années après le trépas de Lydwine et à sept ans Jésus lui posa sur l’épaule sa croix et lui prédit une vie de tortures ; sa chambre fut, ainsi que celle de la sainte de Schiedam, un cabinet de consultation pour les affections spirituelles. Les princes, les religieux, les laïques y défilèrent et elle débridait, elle aussi, les plaies des vices, perçait les apostumes des fautes et les pansait ; elle décéda, après une existence de douleurs atroces, en 1505.
Sainte Catherine de Gênes, une Italienne. Elle fut mariée et vécut d’abord de la vie mondaine, puis Jésus jeta sur elle son épreinte et sa conversion eut lieu en coup de foudre comme celle de saint Paul ; modèle des maladies extraterrestres, elle fut, suivant son expression : « déchirée de la tête aux pieds » ; elle endura, de son vivant, les feux du Purgatoire pour sauver des âmes et elle a laissé sur ce séjour des supplices un traité persuasif et surélevé ; elle connut également les affres de la Passion et trépassa en 1510, après une série de macérations et de souffrances dont le détail effraie. Son cadavre subsiste à l’état d’incorruption visible pour tous, à Gênes.
AU XVIe SIÈCLE.
La Bienheureuse Marie Bagnési, une Italienne, du tiers-ordre de saint Dominique, non stigmatisée mais dont la vie semble une copie de celle de Lydwine ; elle souffrit pour réparer les scélératesses des hommes tout ce qu’il est possible de souffrir ; pendant quarante-cinq ans, elle fut tenaillée par des maux de tête, brisée par des fièvres, frappée de mutisme et de surdité ; elle n’eut pas un seul de ses membres qui fut intact, attestent les Bollandistes ; elle mourut de la pierre ainsi que Lydwine, en 1577.
Sainte Térèse, une Espagnole, la réformatrice des carmels, l’inégalable historienne des luttes de l’âme et des combats divins. Son histoire est trop connue pour qu’il soit besoin d’en parler ici ; notons seulement qu’elle fut constamment malade et expia, de même que la sainte des Pays-Bas, pour les âmes du Purgatoire, pour les pécheurs, pour les mauvais prêtres ; elle naquit au ciel en 1582.
Sainte Catherine de Ricci, une Italienne, issue d’une illustre famille de Florence et appartenant à un monastère du tiers-ordre dominicain dont elle fut élue abbesse ; la demande qu’elle adressa à Jésus de subir dans son corps et son âme les châtiments mérités par l’expansion des hérésies et le dérèglement des mœurs fut accueillie ; son existence fut un enfer de maux ; le Seigneur avait sculpté les instruments de la Passion dans ses chairs, affirme la bulle qui la canonise ; elle trépassa en 1590.
Archangèle Tardera, une Italienne, tertiaire de l’ordre de saint François ; elle fut malade pendant trente-six ans et passa les vingt-deux dernières années de sa vie au lit ; sa mission consistait à redimer les offenses des impies ; elle mourut en 1599.
AU XVIIe SIÈCLE.
Sainte Madeleine de Pazzi, une Italienne, carmélite ; elle avait proposé au Sauveur d’endosser les péchés du monde et elle fut prise au mot. Elle vécut toujours malade et dans un état presque permanent d’extase : elle fut douée de l’esprit prophétique et elle a dicté des œuvres spirituelles qui sont des dialogues entre l’âme et Dieu et surtout des apostrophes volubiles, des hourras d’allégresse, des cris enflammés de joie ; elle décéda en 1607.
Pudentienne Zagnoni, une Italienne, fille d’un tailleur de Bologne, tertiaire de saint François. Elle fut, ici-bas, écrasée par des infirmités dont l’origine surnaturelle fut reconnue par les médecins ; elle était, en outre, traînée par les cheveux et rouée de coups par les démons ; elle satisfaisait de la sorte aux iniquités qu’elle n’avait pas commises ; neuf semaines avant qu’elle mourût, les neuf chœurs des anges la communièrent, à tour de rôle ; elle succomba, en 1608.
La Bienheureuse Passidée de Sienne, une Italienne, de l’ordre des capucines ; elle se sacrifia pour désarmer le Seigneur irrité par les impuretés de son temps. En sus de ses maladies qu’aucun remède n’apaisait, elle s’infligea, les jugeant inefficaces, d’épouvantables pénitences ; elle se fouettait jusqu’au sang avec des branches de génévriers et des tiges d’épines et elle étuvait ses déchirures avec du vinaigre salé chaud ; elle marchait dans la neige, pieds nus, ou se mettait des dragées de plomb dans ses chaussures ; elle s’enfonçait dans des tonnes d’eau glacée l’hiver, et, l’été, se pendait, la tête en bas, au-dessus du feu ; elle fut communiée par Jésus, par sa Mère, par les anges et ses extases étaient si fréquentes que le P. Venturi, son historien, écrivait « qu’elles la faisaient bien plus vivre dans le Paradis que sur la terre ». Elle expira, en 1615.
La Vénérable Stéphanie des Apôtres, une Espagnole, carmélite, non stigmatisée ; elle sollicita et obtint du Seigneur l’autorisation de se subroger aux pécheurs ; elle accéléra les détresses d’une santé déjà débile par des jeûnes prolongés, des cilices, des cercles de fer et des chaînes. Elle acheva sa mission purificatrice en 1617.
Ursule Bénincasa, une Italienne, la fondatrice de la congrégation des théatines ; elle para par ses tortures aux dangers qui menaçaient l’église ; son existence fut effroyable ; elle brûlait des flammes du Purgatoire pour exonérer des âmes et l’amour divin l’incendiait de telle sorte qu’il lui sortait une colonne de fumée de la bouche ; en sus de ses maladies propitiatoires, elle fut soumise à Rome aux plus durs traitements et mourut en 1618.
Agathe de la Croix, une Espagnole, tertiaire de l’ordre de saint Dominique ; elle devint par désir d’immolation estropiée et aveugle. Ses chairs, comme celles de Lydwine, tombaient en pourriture sur la paille et elle était aussi consumée par les feux du Purgatoire ; elle décéda en 1621.
Marine Escobar, une Espagnole, la réformatrice de la règle de sainte-Brigitte ; elle fut cinquante ans malade et en passa trente, étendue sur sa couche ; elle exhalait, ainsi que la sainte de la Hollande, les plus délicats parfums. Quand on la changeait de linge, rapporte son biographe, il semblait que celui qu’on enlevait de son corps était un parterre odorant de fleurs ; elle trépassa en 1633.
Agnès de Langeac, une Française, tertiaire de l’ordre de saint Dominique ; elle supporta tous les tourments du Purgatoire pour affranchir des âmes ; elle vécut, infirme, se traînant sur des potences, atténuant par ses maux les méfaits du prochain ; elle mourut en 1634.
Jacqueline du Saint-Esprit, une Française, dominicaine, alitée, toujours obligée de garder la chambre ; elle expira, après d’horribles souffrances réparatives, en 1638.
Marguerite du Saint-Sacrement, une Française, carmélite ; celle-là endura des tortures extraordinaires ; elle souffrit de telles douleurs dans le crâne, qu’après l’avoir vainement piquée avec des clous de fer rouge, les chirurgiens la trépanèrent ; elle n’éprouva aucun allègement de ces sévices ; seule, l’apposition des reliques chassait son mal. Elle expia plus spécialement les offenses faites au Seigneur par le manque de charité des riches ; elle participa au supplice de différents martyrs pendant quinze mois, s’offrit au Sauveur comme victime pour délivrer la France de l’invasion des armées allemandes ; elle termina son sacrifice, en 1648.
Lucie Gonzalès, une Italienne, rongée par les fièvres, n’ayant pas une place sur son corps qui fût saine ; elle racheta plus particulièrement les abominations que commirent en 1647 les révolutionnaires de Naples ; sa vie fut un livre de douleur ; il se ferma en 1648.
Paule de sainte Térèse, une Italienne, du tiers-ordre de saint Dominique, prenait à son compte les péchés des séculiers et des prêtres ; elle vécut couchée et fut, ainsi que Lydwine, communiée de la main du Christ ; elle libéra aussi par ses souffrances les âmes du Purgatoire qui la cernaient de toutes parts ; son décès eut lieu en 1657.
Marie de la Très Sainte Trinité, une Espagnole, tertiaire de saint Dominique ; elle était accablée d’infirmités et réduite, lorsqu’elle n’était pas allongée sur des alèzes, à se traîner sur les genoux ; sa mission piaculaire prit fin en 1660.
Pudentienne Zagnoni, Italienne, Clarisse, qu’il ne faut pas confondre avec sa sœur, la stigmatisée du même nom et du même prénom, citée plus haut. Elle fut, pendant trente-deux ans, malade. Ainsi que Lydwine, elle voyageait avec son ange dans le Paradis et amendait sur son grabat les forfaits du monde ; elle mourut en 1662.
Marie Ock, une Belge, tertiaire carmélite ; elle souffrait des peines appropriées aux excès des personnes qu’elle suppléait dans leur pénitence ; elle purgeait les peines des âmes du Purgatoire et était tannée par les coups, roulée dans les escaliers, plongée dans des puits par les démons. Quand elle n’était pas alitée, elle courait dans les mauvais gîtes pour en retirer leurs hôtesses ; elle fut une des compensatrices les plus fertiles et les plus résolues dont la biographie, vraiment curieuse, est à lire. Elle succomba à la peine, en 1684.
Jeanne Marie de la Croix, une Italienne, tertiaire franciscaine. Constamment malade, torturée par des douleurs atroces dans les reins, elle dut subir les traitements les plus barbares des médecins qui finirent cependant par reconnaître l’origine préternaturelle de ses maux et lui permirent de gémir en paix. Elle reçut l’anneau mystique, épandit de sa personne d’inexplicables parfums, guérit par sa bénédiction les infirmes et multiplia les pains. Elle s’immola plus spécialement pour combattre l’hérésie des protestants et naquit au ciel en 1673.
Marie Angélique de la Providence, une Française, tertiaire carmélite ; elle intercéda plus particulièrement pour les communautés dévergondées et pour les prêtres. Le Seigneur lui indiquait, lui-même, les pécheurs dont il voulait qu’elle neutralisât par ses maladies les offenses ; elle fut une grande adoratrice du saint Sacrement et l’une des victimes sur laquelle s’acharnèrent le plus les démons. Ils la battaient comme tapis, la cognaient contre les murailles, la piétinaient sur le sol ; elle mourut en 1685.
AU XVIIIe SIÈCLE.
Marcelline Pauper, une Française, sœur de la Charité, à Nevers ; celle-là fut une réparatrice des profanations du saint Sacrement et des vols d’hosties ; c’est elle qui disait : « ma vie est un purgatoire délicieux où le corps souffre et où l’âme jouit » ; elle décéda en 1708.
Fialetta-Rosa Fialetti, Italienne, tertiaire de saint Dominique. Son existence ne fut qu’une série de maladies rédemptrices ; elle se termina en 1717.
Sainte Véronique Giulani, Italienne, clarisse ; elle fut une vivante image du Christ en croix. Tandis que les maladies la dévoraient, elle criait : vive la croix toute seule et toute nue, vive la souffrance ! Comme Lydwine elle s’offrait au Seigneur pour acquitter le supplément de péchés que suscitent les godailles des jours gras. Elle eut la transverbération du cœur ainsi que sainte Térèse et l’impression des instruments du Calvaire ainsi que sainte Claire de Montefalco. Elle mourut en 1727.
Sainte Marie Françoise des cinq plaies de Jésus, une Italienne, du tiers ordre de saint François ; sa vie fut un tissu d’infirmités ; elle souffrit de douleurs d’entrailles atroces, de fièvres, de gangrène. De même que Lydwine elle transbordait sur elle-même les maladies du prochain ; elle fut persécutée par sa famille et par son confesseur et communiée par les anges. Douée de l’esprit prophétique, elle annonça longtemps à l’avance la Révolution française et la mort de Louis XVI, mais à la vue des souffrances de l’Église qui lui furent montrées, son cœur éclata et elle supplia le Seigneur de la délivrer de la vie ; sa requête fut accueillie en 1791.
AU XIXe SIÈCLE.
Marie-Josépha Kümi, une Suissesse, dominicaine ; elle fut une victime expiatrice de l’Église, des pécheurs, des âmes du Purgatoire dont elle partagea les tourments ; son corps n’était qu’une plaie ; elle décéda en 1817.
Anne-Catherine Emmerich, une Allemande, augustine, la plus grande voyante des temps modernes et, qui plus est, bien qu’illettrée, une magnifique artiste ; son histoire est trop connue pour qu’il soit besoin de la rappeler ; ses livres sont entre toutes les mains. Constatons seulement que cette stigmatifère fut toujours couchée et qu’elle est parmi les réparatrices celle qui avec Marie Bagnési se rapproche le plus de Lydwine ; elle est son héritière directe à travers les âges ; elle est morte après une vie de douleurs sans nom, en 1824.
Élisabeth Canori Mora, une Italienne, du tiers-ordre des trinitaires déchaussées ; elle amortit surtout la dette des iniquités des persécuteurs de l’Église et trépassa en 1825.
Anna-Maria Taïgi, une Italienne, du tiers-ordre des trinitaires déchaussées ; elle fut saccagée par une série de tortures ; les céphalalgies, les fièvres, la goutte, l’asthme ne lui laissèrent pas un instant de repos ; ses yeux, comme ceux de Lydwine, versaient du sang lorsqu’ils étaient atteints par les moindres lueurs ; elle se sacrifia plus spécialement pour les bourreaux de l’Église ; son holocauste prit fin en 1837.
Sœur Bernard de la Croix, une Française, de la congrégation de Marie-Thérèse, à Lyon ; elle acceptait les tentations des personnes trop faibles pour les supporter et souffrait mort et passion pour elles ; elle mourut en 1847.
Marie-Rosa Andriani, Italienne, du tiers-ordre franciscain ; elle fut, depuis l’âge de cinq ans, une martyre par délégation et le Seigneur aggravait ses tourments, en ne la consolant pas ; elle s’arrachait de la poitrine des os tout chauds et ne fut sustentée, pendant vingt-cinq ans, que par l’Eucharistie ; elle décéda en 1848.
Marie Domenica Lazzari, l’une des stigmatisées du Tyrol ; médiatrice des mécréants, son existence fut une continuelle agonie ; brisée par des convulsions, par une toux opiniâtre, par des douleurs dans le bas-ventre, elle ne fut nourrie, durant quatorze années, que par les saintes Espèces ; sa mort eut lieu en 1848.
Marie de saint-Pierre de la sainte-Famille, une Française, carmélite, non stigmatisée. Elle s’interposa entre Dieu et la France qui était sur le point d’être châtiée ; elle eut gain de cause mais endura le martyre. Elle résumait, elle-même, sa vie en cette phrase : « c’est pour la réparation que j’ai été mise au monde et c’est d’elle que je meurs ». Elle succomba à la peine en 1848.
Marie-Agnès Steiner, une Allemande, Clarisse dans un monastère de l’Ombrie ; elle éprouva, pour le bien de l’Église, les plus cruelles maladies ; elle effluait, comme Lydwine, de célestes aromes ; elle trépassa en 1862.
Marie du Bourg, en religion Mère Marie de Jésus, une Française, fondatrice de la congrégation des sœurs du Saint-Sauveur et de la Sainte-Vierge ; elle fut de même que la sainte de Hollande, une gloutonne de maux ; elle a terriblement pâti pour les impies, pour les possédés et pour les âmes en attente. « Elle est tout occupée à peupler le Ciel et à vider le Purgatoire », disait l’une de ses filles ; elle subit des attaques furieuses de la part des démons et mourut en 1862.
Marie de Moerl, la plus connue des stigmatisées du Tyrol, tertiaire de l’ordre de saint François ; elle expia surtout pour l’Église ; elle était douée de l’esprit prophétique et lisait dans les âmes ; l’abbé Curicque, l’un de ses historiens, narre ce fait qui pourrait figurer dans la vie de Lydwine : un religieux dont elle ignorait jusqu’au nom vint, accompagné de plusieurs personnes, pour se recommander à ses prières ; elle accepta d’invoquer le Seigneur à son intention, mais elle jugea nécessaire de lui signaler un défaut que, lui seul, pouvait connaître et dont il lui fallait à tout prix se débarrasser. Ne voulant point l’humilier devant des tiers, elle prit, sous son traversin, le psautier, l’ouvrit et lui montra du doigt un passage qui visait expressément ce défaut ; puis elle lui sourit doucement et retomba dans l’extase que cette visite avait interrompue ; elle décéda en 1868.
Barbe de saint Dominique, une Espagnole, dominicaine ; elle assuma les péchés du prochain, fut en butte aux assauts du Maudit et mourut, victime de la substitution mystique ; elle offrit, en effet, sa vie au Christ pour la guérison d’une autre religieuse dont l’état était désespéré ; celle-ci recouvra aussitôt la santé et, elle, s’alita pour ne plus se relever ; elle avait à peine trente ans, alors qu’on l’inhuma en 1872.
Louise Lateau, Belge ; son cas est célèbre ; elle vécut toujours couchée, rachetant par ses douleurs les forfaits d’autrui ; pendant douze années, la communion fut son seul aliment. Trop de livres ont été écrits sur cette sainte fille pour qu’il soit utile d’en parler ici ; elle mourut en 1883.
Marie-Catherine Putigny, une Française, visitandine ; elle s’était proposée comme victime réparatrice au Seigneur ; elle souffrit les plus lancinantes tortures pour les âmes du Purgatoire ; elle voyait, de même que Lydwine et que la sœur Emmerich, les tableaux de la Passion ; elle est décédée à son monastère de Metz, en 1885.
La cause de béatification de la plupart de ces femmes a été introduite à Rome ; sans préjuger en rien le jugement qui interviendra pour chacune d’elles, il sied d’espérer que l’origine céleste de leurs vocations et de leurs maux sera reconnue.
L’on remarquera que, parmi ces héritières de Lydwine, il n’en est pas une qui soit issue, ainsi qu’elle, du territoire des Pays-Bas. Il y a des Italiennes, des Espagnoles, des Françaises, des Belges, des Tyroliennes, des Allemandes, une Suissesse et pas une Hollandaise ; et cependant le Dr Imbert-Gourbeyre en cite une, mais sans renseignements assez précis pour nous permettre d’affirmer qu’elle fut une victime expiatrice ; c’est une nommée Dorothée Visser, née en 1820, à Gendringen et qui aurait été étampée des stigmates de la Passion, vers 1843 ; il serait bien désirable qu’un moine ou qu’un prêtre hollandais suivît cette piste et nous montrât, s’il y a lieu, que la succession de Lydwine a été recueillie dans son pays même.
L’on remarquera également la large part qui est faite au XIXe siècle dans cette répartition des donatrices.
Ces listes sont, est-il utile de le dire, très incomplètes ; elles suffisent néanmoins à prouver que l’héritage de Lydwine n’est pas tombé en déshérence et que les desseins de Dieu n’ont pas varié ; son procédé de faire appel à la charité de certaines âmes pour satisfaire aux nécessités de sa Justice demeure immuable ; la loi de la substitution est toujours en vigueur ; depuis l’époque de sainte Lydwine rien n’est changé.
Il faut ajouter qu’à l’heure actuelle, les besoins de l’Église sont immenses ; un vent de malheur souffle sur les régions inabritées des croyants. Il y a une sorte d’affaissement des devoirs, de déchéance d’énergie dans les pays qui sont plus particulièrement les fiefs spirituels du Saint-Siège.
L’Autriche est rongée jusqu’aux moelles par la vermine juive ; l’Italie est devenue un repaire maçonnique, une sentine démoniaque, au sens strict du mot ; l’Espagne et le Portugal sont, eux aussi, dépecés par les crocs des Loges ; seule, la petite Belgique paraît moins cariée, de foi moins rance, d’âme plus saine ; quant à la nation privilégiée du Christ, la France, elle a été attaquée, à moitié étranglée, saboulée à coups de bottes, roulée dans le purin des fosses par une racaille payée de mécréants. La franc-maçonnerie a démuselé, pour cette infâme besogne la meute avide des Israélites et des protestants.
Dans un tel désarroi, il eût peut-être fallu recourir aux mesures abolies d’antan, user de quelques chemises dûment soufrées et de quelques bons bûchers de bois bien sec, mais l’âme poussive des catholiques eût été incapable de souffler sur le feu pour le faire prendre ! puis, ce sont là des expédients sanitaires désuets, des pratiques que d’aucuns qualifieraient d’indiscrètes et qui ne sont plus, en tout cas, d’accord avec les mœurs desserrées de notre temps.
Étant donné alors que l’Église gît sans défense, l’on pourrait s’inquiéter de l’avenir, si l’on ne savait qu’elle rajeunit chaque fois qu’on la persécute ; — les larmes de ses martyrs, c’est son eau de Jouvence, à elle ! — Quand on refoule le catholicisme d’un pays, il s’infiltre dans un autre et revient à son point de départ, après ; c’est l’histoire des congrégations qui, lorsqu’on les chasse de la France, y rentrent quand même, après avoir fondé à l’étranger de nouveaux cloîtres. En dépit de tous les obstacles, le catholicisme, qui semble parfois stagnant, coule ; il s’insinue en Angleterre, en Amérique, dans les Pays-Bas, gagne peu à peu du terrain dans les régions hérétiques et il s’impose.
Fût-il d’ailleurs ligoté et saigné aux quatre veines qu’il revivrait encore, car l’Église détient des promesses formelles et ne peut périr. Elle en a vu d’autres, du reste, et elle doit, tout en peinant, patiemment attendre !
Il n’en est pas moins vrai, qu’au point de vue des offenses divines, des sacrilèges et des blasphèmes, la situation de la France est lamentable. Ce commencement de siècle présente, dans ce pays surtout, cette singularité qu’il est imbibé, saturé comme une éponge de Satanisme et il ne paraît même pas s’en douter !
Dupés par les palinodies d’un fétide renégat, les catholiques ne soupçonnent même point que ce malheureux a plus menti le jour où il déclara s’être moqué d’eux que lorsque, pendant des années, il leur enrobait des documents dont la plupart étaient exacts, dans un excipient d’invraisemblables bourdes !
Il y a dans tous les cas, un fait, indéniable, absolu, sûr, c’est, qu’en dépit des dénégations intéressées, le culte Luciférien existe ; il gouverne la franc-maçonnerie et tire, silencieux, les ficelles des sinistres baladins qui nous régissent ; et ce qui leur sert d’âme à ceux-là est si pourri qu’ils ne s’imaginent même pas qu’ils ne sont, quand ils dirigent l’assaut contre le Christ et son Église, que les bas domestiques d’un maître à l’existence duquel ils ne croient pas ! Si habile à se faire nier, le Démon les mène.
Le XXe siècle débute donc, ainsi que le précédent a fini en France, par une éruption infernale ; la lutte est ouverte entre Lucifer et Dieu.
En vérité, il faut espérer que, pour contrebalancer le poids de tels défis, les victimes d’expiation abondent, et que, dans les cloîtres et que dans le monde, beaucoup de moines, de prêtres et de laïques acceptent de continuer l’œuvre réparative des holocaustes. Certainement, dans les ordres dont le but est la mortification et la pénitence, tels que les calvairiennes bénédictines, les trappistines, les clarisses, les carmélites, pour n’en nommer que quatre, des femmes prostrées sur des lits et dont les maladies déroutent les diagnostics des médecins souffrent pour neutraliser les abominations démoniaques de notre époque ; mais l’on peut se demander si ces couvents d’immolées sont assez nombreux, car lorsque l’on connaît certains détails de bruyantes catastrophes, de celle du bazar de la Charité, par exemple, il est bien difficile de ne croire qu’à des causes matérielles énumérées dans des rapports de magistrats et de pompiers.
Ce jour-là, ce sont, en effet, les femmes vraiment pieuses, les femmes venues non pour arborer des toilettes et s’exhiber, mais pour aider à soulager des infortunes et à faire le bien, des femmes qui avaient toutes ou presque toutes entendu la messe, ce matin-là et communié, qui ont été brûlées vives. Les autres s’en sont tirées. Il semble donc qu’il y ait eu une volonté du Ciel de choisir, dans cette mêlée, les meilleures, les plus saintes des visiteuses, pour les obliger à expier dans les flammes la plénitude sans regrets de nos péchés.
Et finalement l’on arrive à se poser cette question : un pareil désastre aurait-il été évité s’il y avait eu plus de monastères de la dure observance, plus d’âmes déterminées à s’infliger des sacrifices volontaires et à se céder pour subir l’indispensable châtiment des impies ?
L’on ne peut évidemment répondre, d’une façon nette, à une semblable question ; mais ce qu’il est possible d’affirmer, c’est qu’il n’y a jamais eu tant besoin de Lydwine qu’à présent ; car, elles seules seraient à même d’apaiser la colère certaine du Juge et de nous servir de paratonnerre et d’abri contre les cataclysmes qui se préparent !
Je ne me dissimule pas qu’en parlant de la sorte dans un siècle où chacun ne poursuit qu’un but : voler son prochain et jouir en paix dans l’adultère ou le divorce de ses dols, j’ai peu de chances d’être compris. Je sais très bien aussi que, devant ce catholicisme dont la base est la désaccoutumance de soi-même et la souffrance, les fidèles épris de dévotionnettes et abêtis par la lecture de pieuses fariboles, s’exclameront ; ce sera pour eux l’occasion de ressasser, une fois de plus, la complaisante théorie « que Dieu n’en demande pas tant, qu’il est si bon ».
Oui, je sais bien, mais le malheur, c’est qu’il en demande autant et qu’il est néanmoins infiniment bon. Mais il faut le répéter, une fois de plus aussi, il dédommage, ici-bas même, par des joies intérieures, ceux qui le prient, de leurs afflictions et de leurs maux ; et chez les êtres privilégiés qu’il torture, l’outrance des liesses dépasse l’excès des peines ; tous ont dans des corps broyés des âmes qui rayonnent, tous s’écrient comme Lydwine qu’ils ne souhaitent pas d’être guéris, qu’ils n’échangeraient pas les consolations qu’ils reçoivent pour tous les bonheurs du monde. D’ailleurs, les ouailles que l’existence exceptionnelle de ces protectrices effare, auraient tort de s’alarmer ; prenant en pitié leur ignorance et leur faiblesse, Dieu les épargnera plus sans doute qu’il n’a épargné son propre Fils ; il ne cherche pas parmi ceux qu’il n’a point nanti d’âmes bien robustes les poids destinés à rétablir l’équilibre de la balance dont le plateau des fautes descend si bas… De même que personne n’est tenté au-dessus de ses forces, de même personne n’est chargé de douleurs qu’il ne puisse, d’une façon ou d’une autre, tolérer. Il les dose aux moyens de résistance de chacun ; seulement, ceux qui ne souffrent que modérément auraient tort de se trop réjouir, car cette abstinence de tourments n’est ni un signe de validité spirituelle, ni d’amoureuse préférence.
Mais ce livre n’est pas écrit, en somme, pour ceux-là. Il est, en effet, difficile, pour des gens qui vivent en bonne santé, de le bien comprendre ; ils le saisiront mieux, plus tard, lorsque séviront les mauvais jours ; par contre, il s’adresse plus spécialement aux pauvres êtres atteints de maladies incurables et étendus à jamais sur une couche. Ceux-là sont, pour la plupart, des victimes de choix ; mais combien parmi eux savent qu’ils réalisent l’œuvre admirable de la réparation et pour eux-mêmes et pour les autres ? cependant, pour que cette œuvre soit véritablement satisfactoire, il sied de l’accepter avec résignation et de la présenter humblement au Seigneur. Il ne s’agit pas de se dire : je ne saurais m’exécuter de bon cœur, je ne suis pas un saint, moi, tel que Lydwine, car, elle non plus, ne pénétra pas les desseins de la Providence lorsqu’elle débuta dans les voies douloureuses de la Mystique ; elle aussi, se lamentait comme son père Job et maudissait sa destinée ; elle aussi, se demandait quels péchés elle avait bien pu commettre pour être traitée de la sorte et elle ne se sentait pas du tout incitée à offrir de son plein gré ses tourments à Dieu ; elle faillit sombrer dans le désespoir ; elle ne fut pas une sainte du premier coup ; et néanmoins après tant d’efforts tentés pour méditer la Passion du Sauveur dont les tortures l’intéressaient beaucoup moins que les siennes, elle est parvenue à les aimer et elles l’ont enlevée dans un ouragan de délices jusqu’aux cimes de la vie parfaite ! La vérité est que Jésus commence par faire souffrir et qu’il s’explique après. L’important est donc de se soumettre d’abord, quitte à réclamer ensuite. Il est le plus grand Mendiant que le ciel et la terre aient jamais porté, le Mendiant terrible de l’Amour ! les plaies de ses mains sont des bourses toujours vides et il les tend pour que chacun les emplisse avec la menue monnaie de ses souffrances et de ses pleurs.
Il n’y a donc qu’à Lui donner. La consolation, la paix de l’âme, le moyen de s’utiliser et de transmuter à la longue ses tourments en joie ne peuvent s’obtenir qu’à ce prix. Le récepte de cette divine alchimie qu’est la Douleur, c’est l’abnégation et le sacrifice. Après la période d’incubation nécessaire, le grand œuvre s’accomplit ; il sort du brasier, de l’athanor de l’âme, l’or, c’est-à-dire l’Amour qui consume les abattements et les larmes ; la vraie pierre philosophale est celle-là.
Pour en revenir maintenant à Lydwine, il nous faut narrer en quelques lignes le sort qui fut réservé à ses reliques.
Ainsi qu’il fut dit plus haut, les recteurs de l’église de saint Jean-Baptiste de Schiedam édifièrent, en 1434, une petite chapelle sur sa tombe et Molanus ajoute ce détail que cette chapelle fut parée de tableaux dépeignant divers épisodes de sa vie.
Les reliques y furent vénérées, jusqu’au moment où les Protestants devinrent les maîtres de cette Hollande qu’ils n’ont plus quittée. Ils s’emparèrent à Schiedam de la dépouille de Lydwine et les catholiques durent la racheter.
En 1615, le corps fut exhumé sur les ordres du Prince Albert, archiduc d’Autriche et souverain des Pays-Bas et de sa femme Isabelle-Claire-Eugénie, fille de Philippe II, roi d’Espagne et petite-fille de Henri II, roi de France.
Cette princesse, que passionnait la mémoire de Lydwine, fit transférer ses ossements, enfermés en une châsse d’argent, dans l’oratoire de son palais, à Bruxelles.
Un an après, en 1616, une partie de ces restes fut remise, dans un coffret d’ébène et d’argent, aux dames chanoinesses de Mons et confiée à leur garde, dans le sanctuaire de Sainte-Waudru.
Cette illation eut lieu en grande pompe ; une procession solennelle de plus de six cents cierges, à laquelle s’associèrent les magistrats de la cité, les ordres religieux, les prêtres, le peuple, se réunit à l’église Sainte-Élisabeth et accompagna les reliques portées par l’abbé de Saint-Denis jusqu’à la cathédrale de Sainte-Waudru.
Une seconde partie des ossements fut encore concédée par la princesse en 1626, au couvent des carmélites qu’elle avait fondé, en 1607, à Bruxelles ; enfin une troisième partie échut, en 1650, après la mort d’Isabelle, à l’église Sainte-Gudule, dans la même ville. Une note des Bollandistes constate, de son côté, qu’un fragment du corps et que l’un des tableaux de l’église de Schiedam furent impartis, au moment où les hérétiques allaient faire main basse sur ces biens, au supérieur des prémontrés d’Anvers. Ils furent déposés dans la chapelle des saints-Apôtres où ils demeurèrent pendant de longues années ; puis le tableau se détériora et fut jeté au rebut et, quant aux reliques, elles disparurent sans qu’on ait jamais su comment.
A l’heure actuelle, d’après les renseignements que nous avons pu recueillir, aucune trace ne subsiste à Sainte-Waudru et à Sainte-Gudule des dépouilles de Lydwine ; elles auraient été dispersées pendant la Révolution ; seul, le carmel de Bruxelles garde encore son précieux dépôt, mais il en a abandonné une partie, en 1871, pour permettre au moins à la ville de Schiedam de posséder quelques vestiges de sa sainte. La portion la plus considérable de ce présent, les os entiers des deux bras, se trouvent maintenant dans l’église paroissiale de la Visitation, à Schiedam.
Enfin, les jansénistes de cette ville détiendraient, eux aussi quelques détriments, mais ils les cachent et subitement ils n’entendent plus le français, quand on leur en parle.
Peut-être bien que leurs ancêtres ont dérobé un reliquaire dont on pourrait, en déchiffrant le nom ou les armes gravées dans le métal, reconnaître l’origine ; et ils ne se soucient pas d’avoir à s’expliquer sur sa provenance.
Ajoutons, pour parler des honneurs rendus par l’Église à Lydwine, que l’archevêque de Malines, métropolitain de la Belgique, Mgr. Mathias Hovius a, par une lettre pastorale du 14 janvier 1616, autorisé le culte de la bienheureuse dans les Flandres.
Des années s’écoulèrent. Lydwine, dont le culte était antérieur aux décrets du pape Urbain VIII, était comprise au nombre des Béatifiées, mais il lui restait à acquérir le titre définitif de Sainte.
Ce fut, vers la fin du siècle dernier, qu’un prêtre de la Hollande se dévoua à cette cause ; la paroisse de la Visitation de Notre-Dame venait d’être instituée à Schiedam ; son premier curé fut M. l’abbé Van Leeuwen ; il admirait et vénérait Lydwine. Il se mit en campagne et décida l’archevêque de Malines, l’évêque d’Harlem ainsi que les autres prélats des Pays-Bas et la prieure du carmel de Bruxelles, à introduire des instances auprès de Rome pour obtenir la canonisation de la bienheureuse.
Ces instances ont été accueillies et un décret du 14 mars 1890 a élevé Lydwine au rang des saintes ; mais le promoteur véritable de cette cause, l’abbé Van Leeuwen, n’eut pas la joie d’assister à la réussite de ses efforts, car il mourut avant la promulgation de ce décret.
Je songeais dans le train qui nous emportait, mes amis et moi, à Schiedam, à un incunable que j’avais consulté à la bibliothèque de La Haye, la vie de Lydwine, par Joannes Brugman, éditée à Schiedam, aux dépens des maîtres de la fabrique de l’église de saint Jean-Baptiste, en 1493, c’est-à-dire soixante-cinq ans après la mort de la sainte.
Ce volume, mince comme une plaquette, renferme de curieuses gravures sur bois, deux entre autres — l’une représentant Lydwine, debout, vêtue en grande dame du XVe siècle, un long crucifix dans la main droite et dans la gauche la branche de ce rosier dont les boutons prêts à éclore signifiaient les jours qu’elle devait encore, ici-bas, vivre ; et elle considère, en face d’elle, assis sur une chaise de bois, le bon frère mineur Brugman en train d’écrire son livre ; mais il est si attentif et si pressé qu’il ne regarde que son manuscrit et ne voit même pas la sainte — l’autre, montrant Lydwine, plus âgée qu’elle ne pouvait être à ce moment, étendue sur le flanc et ramassée par deux femmes, tandis qu’une troisième demeure immobile, figée par la stupeur, et qu’un homme dessine derrière elle des ronds de jambes, sur la glace ; pour compléter le petit tableau, d’autres patineurs se tiennent par la main, d’un côté, et de l’autre, apparaît un enfantin donjon dessiné en quelques traits.
Ces xylographies qui ont été, au point de vue de l’histoire de la gravure dans les Pays-Bas, longuement étudiées par M. Jules Renouvier, valaient pour moi surtout par leur naïveté, mais elles étaient trop brèves pour suggérer l’aspect des lieux dans lesquels vécut la sainte.
Son souvenir si parfaitement oublié dans toutes les parties du monde et presque ignoré de toutes les villes calvinistes de la Hollande, existait-il au moins à Schiedam ? découvrirai-je dans ce bourg où elle naquit et mourut des traces d’elle, des débris de quartiers de son siècle, la place de sa maison, enfin des documents différents de ceux qu’avaient entassés, pêle-mêle, ses premiers biographes ?
Je ruminais ces réflexions, tout en feuilletant un guide Baedeker qui se débarrassait en quelques lignes dénuées d’enthousiasme de Schiedam et ne citait même pas, bien entendu, le nom de la sainte.
A dire vrai, j’avais retrouvé une Hollande si dissemblable de celle que j’avais parcourue dans mon enfance et depuis, une Hollande reconstruite, aux cités élargies pleines d’avenues et de bâtisses neuves, que je n’augurais rien de ce voyage. N’en serait-il pas de même de Schiedam que je n’avais encore jamais visité ? c’était probable.
D’autre part, ce qu’il nous avait fallu effectuer de marches et de contre-marches pour parvenir à assister dans ces agglomérations protestantes à une messe ! allions-nous encore, dans la patrie de Lydwine, recommencer nos recherches en quête d’un sanctuaire de notre culte ? cela pouvait paraître plausible ; et cependant, mes amis et moi, nous reprenions un peu confiance ; nous savions qu’un pèlerinage très fréquenté existait dans les environs, le pèlerinage des martyrs de Gorcum, c’est-à-dire de dix-neuf fidèles dont onze capucins, deux prémontrés, un dominicain, un augustin et quatre prêtres séculiers qui avaient été pendus, après d’affreux tourments, en 1572, par les Réformés à Gorcum et béatifiés en 1675 et canonisés, en 1867.
Leur souvenir était si vivace dans la contrée, que les pèlerins affluaient toujours pour vénérer leurs reliques. Un courant catholique subsistait donc dans ce pays ; or, Gorcum était situé à peu de distance de Schiedam ; il y avait par conséquent une chance pour qu’à l’aller ou au retour, l’on vînt aussi révérer les restes de la sainte et alors il y avait certainement au moins une chapelle.
La réponse à ces questions ne se fit pas attendre ; à peine débarqués à Schiedam, le soir, nous aperçûmes une vaste église. A tout hasard, nous y entrâmes ; elle était si noire que l’on ne distinguait rien, à deux pas, devant soi ; mais subitement, tandis que nous avancions à tâtons, nous demandant si nous n’étions pas chez des hérétiques, une lueur d’étoile scintilla au bout de la nef ; l’étoile voltigea, puis se fixa à six places différentes, en l’air ; et, dans la lueur qu’épandaient, au-dessus de l’autel, les six cierges, une statue coloriée sortit des ténèbres, une statue de femme, couronnée de roses et près de laquelle se tenait un ange ; le doute n’était pas possible ; comme pour nous rassurer, Lydwine se montrait aussitôt notre arrivée et tandis que nous l’examinions, l’église entière s’alluma et une foule silencieuse l’emplit ; des hommes, des femmes, des enfants, pénétraient par toutes les portes et se serraient dans des rangées de bancs ; l’autel se couvrit de lumières et, pendant que les prêtres arboraient le Saint-Sacrement, de majestueuses tempêtes de louanges jaillirent des grandes orgues et le « Tantum ergo » entonné en plain-chant par des centaines de voix monta dans des nuées d’encens, le long des colonnes, sous les voûtes ; puis après la bénédiction, ce fut le « Laudate » chanté également par l’assistance et, dans l’église qui s’éteignait, de ferventes silhouettes agenouillées, les mains jointes, dans l’ombre.
La bénédiction du Saint-Sacrement ! nous y sommes si habitués en France qu’elle ne nous éveille plus de sensations particulières ; nous nous y présentons, heureux d’offrir une preuve d’affectueuse déférence à Celui dont l’humilité fut telle qu’il voulut naître dans la race la plus vile du monde, la race Juive et qu’il consentit, pour guérir les maladies d’âme des siens, à se rabaisser au rôle de remède spirituel et à se donner sous l’aspect sans gloire d’un cachet de pain ! mais, à l’étranger, alors que, depuis des semaines, l’on vit sans églises où l’on puisse à toute heure entrer, au milieu de personnes dont on ne comprend pas le langage, l’impression d’allégresse, de paix, que l’on ressent à entendre la langue latine de l’Église, à se retrouver subitement dans son milieu de prières, est vraiment exquise.
Il semble que l’on soit un enfant perdu qui reconnaît les siens, un sourd qui recouvre le sens de l’ouïe ; on a envie de presser la main à tous ces braves fidèles qui vous entourent et qui, dans un idiome différent, aiment et croient comme vous ; on se rend compte plus aisément de cette vraie fraternité qui dut unir les premiers chrétiens semés dans la foule des idolâtres.
Ce qui était étonnant, il sied de le dire aussi, c’était, dans ce sanctuaire inconnu, le nombre des hommes qui priaient ; c’était l’ardente ferveur de ces catholiques que l’on voyait si foncièrement, si simplement pieux.
Et une fois retournés à l’hôtel où les excellentes gens qui nous reçoivent sont, eux aussi, des orthodoxes, nous apprenons que Schiedam possède trois églises et que sainte Lydwine est la patronne et la maîtresse absolue de la ville.
Dans cette salle à manger du Hoogstraat où nous sommes si bien à l’aise, chez nous, dans un coin tiède et douillet, des bouffées de souvenirs de famille et d’enfance me remontent, suscitées par le parfum de la pièce, par ce parfum si spécial aux intérieurs du pays et qui est fait de pain d’épice et de thé, de gingembre et de cannelle, de salaisons et de fumures, une exhalaison blonde et tirant sur le roux, une émanation à la fois douce et acérée, très fine, qui me remémore tant d’amicales salles à manger, au moment des légers repas et qui subsiste, sans s’effacer complètement, alors même que la dînette est finie.
Toute la petite et la délicieuse Hollande se lève, ici, pour nous accueillir et nous souhaite, après Lydwine dont elle nous rappelle les célestes effluves, la plus aimable des bienvenues, en ce dialecte odorant, en ce salut d’aromes.
Le lendemain, nous allons visiter les églises et notre surprise de la veille s’accroît ; ce n’est pas un dimanche et beaucoup d’assistants suivent les messes, communient avant ou après le sacrifice, ainsi qu’il est d’usage, ici.
De ces trois églises toujours pleines, deux appartiennent aux dominicains qui, dans un pays protestant, ne peuvent revêtir le costume de leur ordre ; l’une de ces églises, placée sous le vocable de saint Jean-Baptiste, est celle où nous nous sommes introduits, par hasard, hier. Avec le jour, le charme tomberait si la vie de prières qui l’anime ne compensait le peu d’attrait que provoque la banale laideur de sa nef. Soutenue par des piliers à chapiteaux toscans, elle est d’un style chagrin, inclassable, et cette image de la sainte, entrevue dans une échappée d’ombre, est un vulgaire plâtre peint.
L’autre église, dite du Rosaire, est bâtie, mi-partie brique et mi-partie pierre, et éclairée par des vitres vertes ; elle simule assez gauchement le style gothique, mais elle est néanmoins plus allègre que l’autre et plus prévenante ; la chapelle, dédiée à sainte Lydwine, est agrémentée de vitraux sur lesquels figurent différents épisodes de sa vie, et d’une statue achetée dans le commerce et qui n’a rien à voir, de près ou de loin, avec une œuvre d’art.
L’église de beaucoup la mieux est la troisième, l’église paroissiale, desservie, celle-là, par un curé et des vicaires et baptisée du nom de la Visitation de Notre-Dame ; moderne, ainsi que les deux autres, elle imite également le style ogival ; elle est sans élégance et elle est nue, mais elle détient une incomparable chapelle, tout imprégnée de sainte Lydwine dont elle conserve les reliques cédées par les carmélites de Bruxelles.
Cette chapelle qui est presque un minuscule oratoire, à la décrire, serait nulle ; son charme réside en son atmosphère saturée de souvenirs et de grâces et non dans sa coque qui avec ses poutres et ses panneaux de bois blanc paraît temporaire et est, en tout cas, inachevée ; il semble que le terrain ait manqué et qu’on ait emprunté pour la construire la place d’une petite cour ; seulement l’intimité de ce sanctuaire que n’offensent point ces bondieuseries qui gâtent les autres églises, est délicieuse.
Au fond, se dresse un autel très simple, de forme gothique, ornementé de croix et de passiflores et surmonté d’une statue de la sainte debout et à laquelle l’ange remet des roses, une statue inspirée de la statuaire des Primitifs, la seule vraiment convenable que nous ayons encore rencontrée dans ce pays ; et, sur le devant de l’autel, encastré dans la boiserie, un bas-relief de marbre représente encore la sainte, mais couchée, cette fois, et l’ange lui apporte également la symbolique branche.
Malgré son concept classique et son ordonnance un peu prévue, ce bas-relief qui est l’ouvrage de M. Stracké, un sculpteur de Harlem, intéresse ; et tandis que je l’examine de près, je me dis : où ai-je déjà contemplé cette figure couverte d’un bonnet, enveloppée de bandelettes, regardant un crucifix, fixé entre ses deux mains ? et l’héritière de Lydwine, la sœur Emmerich, surgit soudain devant moi, sur son lit, telle que la dessina Clément Brentano et qu’Édouard Steinle la grava ; et j’avoue que je trouve vraiment ingénieuse l’idée de l’artiste qui, ne pouvant consulter aucun portrait authentique de la sainte, s’inspira de l’attitude, des traits pris sur le vif de sa plus parfaite image, de sa sœur en Dieu, pour nous la montrer.
Des tableaux du peintre Jan Dunselman doivent compléter la parure de cette chapelle ; cinq sont déjà en place et trois restent à livrer. Parmi ces toiles qui racontent les principaux évènements de la biographie de Lydwine, l’une nous relate la chute sur la glace, en une langue qui se souvient un peu de celle de Leys ; et ce panneau, avec la petite maison de la sainte, en bois et en briques, la porte à pentures, les fenêtres résiliées de plomb, les groupes des filles qui entourent l’enfant tombée dans la neige, les hommes qui ont froid et flânent, distraits, sans croire à la gravité de l’accident, tandis que, sur la droite, un vieux balayeur sort du cadre, aux cris d’une fillette affolée par la peur, est expertement agencé et alertement peint ; c’est une œuvre moyenne, et observée. Je ne puis cependant me convaincre que la petite Lydwine avait ce nez allongé sous des yeux à fleur de tête et cette bouche commune. Logiquement elle eût dû apparaître, dans ces ouvrages, horrible, car elle était déjà maigre et laide lorsqu’elle se brisa une côte ; mais étant donné que l’artiste n’a pas avec raison, je pense, tenu compte de la vérité historique en cette œuvre — car il aurait fallu du génie pour dégager la splendeur de l’âme de son cercueil de chairs ! — j’aurais voulu alors qu’il imaginât une Lydwine et plus éclairée et plus fine.
Elle fut jolie, belle de corps, d’une taille élégante et sa voix était douce et sonore ; c’est à peu près tout ce que nous apprennent ses monographes ; c’est court, mais enfin ils s’entendent pourtant à la faire plus accorte, plus distinguée surtout que ne la conçut le peintre.
Vraiment, je crois bien que, personnellement, je la vis, un dimanche, parmi les orphelines que les sœurs dominicaines conduisaient, dans cette église même, à la messe ; elle était agenouillée, tendue vers l’autel, égrenant son chapelet ; elle avait de grands yeux d’un bleu avoisinant le vert et, sous le bonnet noir, s’échappaient d’admirables cheveux, de ces cheveux qui, cendrés près des racines, se dorent à mesure qu’ils s’en éloignent ; l’on eût dit d’un écheveau de soie éclairé par un rayon de soleil hivernal ; et la tenue de cette enfant, au teint blanc, à peine teinté de rose sur les joues, aux lèvres de fleur qui s’épanouit alors que commence à la friper le gel, était si modeste, si pieuse, si vraiment confinée en Dieu, que je ne pouvais me persuader que Lydwine eût été différente.
Ainsi que je l’ai dit, aucune image véridique de sa physionomie n’existe ; sur les vingt tableaux marqués par Molanus comme ayant autrefois orné les murs de la chapelle édifiée en son honneur par les recteurs de Schiedam, douze ont été reproduits en un insignifiant format, au XVIe siècle, par le graveur Jérôme Wierix ; ils cernent de médaillons un portrait plus grand de la sainte recevant des mains de son ange la fameuse branche. Il est difficile de créer un type conventionnel, plus redondant à la fois et plus piètre, que celui de cette estampe ; on ne sait si Lydwine est un garçon ou une fille, car elle y grimace ainsi qu’un être hybride dont le nez busque et fend en deux une face privée de menton.
D’autre part, j’ai considéré chez un habitant de Schiedam une très belle gravure de Valdor, du commencement du XVIIe siècle, qui la portraiture ; elle y est plus sensément traitée, mais ce n’est sûrement pas encore elle ; d’autres, médiocres de Pietro de Jode, de Sébastien Leclerc, l’exhibent brandissant une croix, une couronne, ou une tige de rose ou une palme, seule ou accompagnée d’un ange ; une dernière enfin, toute moderne, celle-là, mais assez curieuse, en tant qu’imitation des tableaux des Primitifs, est l’œuvre d’un peintre allemand Ludwig Seitz ; c’est une des mieux ; mais dans celle-là, de même que dans toutes les autres, le visage, plus ou moins persuasif, est inventé.
Il est donc, en somme, permis, puisque rien de certain ne subsiste, de nous la figurer selon nos conceptions d’art et nos appétences de piété.
Et ce dimanche où j’entrevis cette extraordinaire fillette, nous pouvions véritablement nous certifier les premières impressions éprouvées dans cette ville ; les églises débordaient, étaient insuffisantes à contenir la foule des orants ; à la Visitation de Notre-Dame, des gens lisaient leur missel devant les portes laissées ouvertes, au seuil de la rue ; les communions ne décessaient pas ; après les hommes et les femmes, les pensionnats s’ébranlaient ; nulle part, nous n’avions encore constaté une si placide ardeur et j’ajouterai un respect plus absolu de la liturgie, du plain-chant exécuté non par des chantres gagés mais par des personnes de bonne volonté ayant de la voix et s’acquittant consciencieusement de leur tâche, décidées, pour honorer le Seigneur, à très bien chanter.
Cette petite chapelle de sainte Lydwine, dans les heures qui s’attristent, elle émerge de mes souvenirs, si lénitive, si familièrement attendrie ! et comment ne pas me rappeler aussi le cordial et le délicat accueil de son pieux et savant curé, M. l’abbé Poelhekke, qui célébra, un matin, pour nous, la messe à son autel sur lequel il avait voulu exposer, comme en un jour de fête, la châsse des reliques.
Sauf ces ossements et sa mémoire qui resplendit dans cette ville, rien hélas ! ne reste ici de Lydwine, sinon sa plaque tombale ; elle a été ôtée de l’ancienne église désaffectée et muée en un temple protestant et transférée dans la petite chapelle des sœurs dominicaines qui tiennent un orphelinat et font la classe aux enfants du peuple. Cette pierre est sculptée d’une figure âgée et un peu renfrognée de femme, endormie, les mains jointes sur le ventre, et enveloppée, de la tête aux pieds, d’un linceul ; en haut, deux angelots descendent pour lui ceindre d’une couronne le chef et, aux quatre coins, les quatre animaux évangéliques sont gravés dans un cercle.
Cette pierre est très bien conservée ; d’après une note des Bollandistes, les calvinistes l’auraient retournée, non pour la préserver mais pour empêcher les catholiques de s’agenouiller devant ; d’après une autre tradition, au contraire, les protestants, par déférence pour la sainte, faisaient un détour dans l’église afin de ne pas marcher dessus et de ne point l’abîmer. Je ne sais laquelle de ces deux versions est la vraie ; je les donne telles quelles.
Quant à la bâtisse qu’elle occupa, elle est le sujet de nombreuses controverses que nous allons résumer en quelques lignes :
Selon les uns, sa maison aurait été située dans une sente appelée Bogaarstraat ; selon les autres, dans une ruelle dite Kortekertstraat. Il y aurait eu jadis, en cette ruelle, un puits qui guérissait les fiévreux et le bétail malade ; d’après d’anciens documents, à ce signe, l’on reconnaîtrait le gîte de la sainte ; des recherches ont été effectuées dans ce sens, mais le puits n’a pas encore été découvert ; enfin une troisième opinion qui semble la plus accréditée attribuerait sa résidence au Leliendaal, là où s’élève encore un orphelinat protestant, une bâtisse du XVIIIe siècle, flanquée d’un bonhomme et d’une bonne femme sculptés et peints, de chaque côté, en haut de la porte.
Voici, dans tous les cas, l’histoire de la demeure de Lydwine.
Après sa mort, le fils du docteur Godfried de Haga acheta sa maison qui devint ce qu’on appelait « une maison du Saint-Esprit », c’est-à-dire un refuge de femmes pauvres ; puis en 1461, le jour de la fête de sainte Gertrude, cette maison qui renfermait une chapelle fut cédée, avec l’assentiment des bourgmestres et des conseillers de Schiedam, par le collège du Saint-Esprit à une communauté de clarisses ou de sœurs grises de saint François, venues de Harlem. Il y avait dans ce couvent, dit Molanus, un autel dédié à sainte Lydwine et érigé juste à l’endroit où reposait son lit ; et l’on distribuait, tous les ans, le jour de sa fête, aux personnes riches ou pauvres qui se présentaient, un pain blanc.
En 1572, les gueux, après avoir dévasté l’église de saint Jean-Baptiste, démolirent la chapelle du Leliendaal et le cloître fut pillé. Il devint, en 1605, un orphelinat qui fut rasé en 1779, car il tombait alors en ruine, et reconstruit à la même place, c’est-à-dire à la place de la demeure de Lydwine.
Mais ce dernier point est justement celui qui n’est pas admis sans conteste par tous. Je n’ai pas à prendre part à ce débat qui n’intéresse d’ailleurs que les habitants de Schiedam ; je dois ajouter cependant qu’une quatrième opinion me fut exprimée à Amsterdam ; celle-là aurait l’avantage de mettre tout le monde d’accord, la voici : Lydwine aurait habité plusieurs logements et aurait été transportée, après la mort de ses père et mère, au domicile de son frère.
Je ne sais ce que vaut cette allégation dont je ne discerne dans les historiens aucune trace ; elle me suggère cependant une remarque.
Brugman nous raconte que la maison du père de Lydwine était basse et humide, plus semblable à une tombe qu’à une chaumine ; or, je me demande comment dans une bicoque si exiguë, tant de personnes purent camper. Après la mort de son père, son fils, sa femme, ses deux enfants, un cousin nommé Nicolas, l’augustin Gerlac et finalement la veuve Catherine Simon y auraient résidé. Il est fort possible qu’ils n’y aient pas séjourné tous ensemble, au même moment, mais il n’en reste pas moins douteux que ce réduit ait pu être assez grand pour héberger autant d’hôtes. Il y aurait peut-être lieu de croire alors que la maison dans laquelle mourut Lydwine n’était pas la même que celle dans laquelle elle était née et avait vécu les premières années de ses souffrances.
L’emplacement du canal sur la glace duquel elle s’est brisé une côte, est le sujet de moins de débats ; les archéologues semblent d’accord pour désigner une rue qui s’affuble encore du nom de « chemin des boiteux » « Kreupelstraat » ; cette rue était un canal, il n’y a pas bien longtemps encore, car j’ai acquis, à Schiedam même, une photographie prise sur nature et qui le représente ; elle est sans caractère et il est difficile de s’imaginer le lieu exact où se passa la scène relatée par les biographes et peinte sur l’un des tableaux de l’église.
Du temps de Lydwine, il n’existe, en somme, que l’antique église de saint Jean-Baptiste, devenue un temple réformé ; mais la sainte n’y a pas, corporellement du moins, prié, puisque ce sanctuaire, brûlé dans l’incendie de 1428, fut rebâti, en partie, pendant sa vie, et alors qu’elle était alitée et ne pouvait sortir. Cette église, la seule ancienne de Schiedam, est un édifice de brique, surmonté d’une haute tour coiffée d’un petit chapeau rajouté et attifée d’un très puéril carillon ; son intérieur, à ogives, est soutenu par sept piliers à chapiteaux sculptés de feuillages et plafonné de poutres ; sa nef est coupée en deux par un tablier de bois. Au-dedans, ce sont des estrades de distribution de prix ou de foire foraine, des bancs d’œuvre, des amas de bibles. La tristesse de ce sanctuaire souillé, sans autel et sans messes !
Plus que dans cette basilique, plus que dans ces rues que je viens de citer, le souvenir de Lydwine vous hante, alors qu’on erre dans les vieux quartiers de Schiedam, moins réparés et moins remis à neuf ; que de fois, le long de ces canaux ombragés d’arbres et dont les ponts tournent pour laisser filer les bateaux, nous l’avons évoquée, tandis que les grands moulins à vent bénissaient, avec la croix de leurs ailes, la ville ; elles dessinaient le rond d’une croix grecque et me rappelaient le mémorial de cette Passion que finit par méditer si ardemment la sainte ! et, pendant que ces croix silencieuses signaient l’horizon, au loin, un sergent de ville, débonnaire, malgré son casque à pointe et sa petite épée de chasse, surveillait les déchargeurs en vêtements de laine rouge et en culotte courte, qui débarquaient des tonnes sur le quai, les manœuvres qui, devant les distilleries, pompaient la drèche chaude coulant en rigoles de café au lait dans les barques ; et moi, je songeais au père de Lydwine, au bon Pierre, qui avait été l’homme du guet, le sergent de ville de son époque, à Schiedam.
Devant nos pas, les rues d’eaux s’allongeaient, en tournoyant, plantées de moulins du XVIIIe siècle, superbes avec leurs briques culottées, leurs grandes collerettes de bois, leurs petites croisées peintes en vert Véronèse ; leurs ailes parfois sans voiles simulaient alors des lames de rasoirs prêtes à fendre l’air ; et ces moulins apparaissaient géants à côté des tout petits que l’on construit maintenant et qui sont revêtus comme d’une houppelande de peluche grise, habillés comme avec des peaux veloutées de souris.
Et cette minuscule cité s’adorne de coins charmants ; dans les vieux quartiers que traverse la rivière à laquelle elle doit son nom, la Schie, ce sont des lacis de ruelles, bordées par des bâtisses enfumées de briques, dessinant avec l’onde qui les mire d’amusantes courbes, d’antiques masures ajourées ainsi que des séchoirs de mégissiers ou précédées de hautes façades couvertes de grands toits qu’effleurent les mouettes ; et des files de sansonnets perchés sur leurs arêtes, de même que sur des bâtons, chantent.
Subitement, au détour d’une de ces sentes, d’immenses échappées de campagne fuient, des plaines encore coupées par des canaux qui font l’effet de marcher avec les nuages qu’ils réverbèrent. Très au loin, des mâts de navires qu’on ne voit point semblent piqués en terre ; une voile se déplace et, derrière elle, le bras d’un moulin, qu’elle cachait, surgit ; des vaches blanches et tachées d’encre, des moutons, des pourceaux noirs et roses s’aperçoivent, à perte de vue, sous l’infini d’un ciel que rien n’arrête ; et, à regarder ces végétations si fraîches et si vertes, qu’en comparaison de celles-là, les prairies les mieux arrosées de la France, sont jaunes et sèches ; à contempler ce firmament d’un bleu pâle, presque polaire, que bouillonnent des nuées d’argent qui se dore, une très douce mélancolie vous vient.
Ces sites placides, ces étendues taciturnes, ces paysages graves, ont quelque chose de personnel, un je ne sais quoi d’affectueux et de quiet ; le charme de cette nature si spéciale tient, je crois, à cette bonhomie qu’elle dégage, une bonhomie qui sourit, un peu triste, et se recueille.
Comme contraste à ces plaines et à ces petites rues qui s’embrouillent dans d’étroits canaux, à l’autre extrémité de la ville s’épand un fleuve immense, la Meuse ; elle se jette, à cet endroit, dans la mer. Au fond, Rotterdam émerge de l’eau avec ses monuments dressés sur le ciel qui s’illimite ; les petits vapeurs qui assurent le service des côtes fument à l’horizon, tandis que le souffle d’une formidable fabrique de bougies domine tous ces bruits ; le quai est hérissé de grues à vapeur et comblé de tonnes. Ce rappel de la vie moderne, dans le pays de Lydwine, déconcerte et l’on se prend à regretter le temps où de maladroits pêcheurs incendièrent Schiedam, la veille du jour où ils s’embarquèrent sur ces plages alors vides, pour aller pêcher le hareng.
Et, à ce propos d’incendie, ne faut-il pas noter que la sainte qui en subit trois, de son vivant, est ici considérée, même par les protestants, comme une sauvegarde contre les ravages du feu ; il n’existe pas, en effet, d’exemple que lorsqu’une usine d’alcool flambe, celles qui l’avoisinent s’enflamment ; Lydwine est aussi, cela va de soi, invoquée pour la guérison des malades ; l’on prête à la cure un petit philatère d’argent contenant quelques-unes de ses parcelles, pour les faire toucher à ceux qui souffrent et, tous les lundis, à sept heures du soir, on la prie, avant le Salut du Saint-Sacrement, afin qu’elle détourne les fléaux de la ville.
Elle vit, on le voit, à Schiedam où les catholiques la vénèrent et où il sied de dire, pour être juste, que les réformés ne lui sont nullement hostiles ; elle compte des amis à Harlem, mais plus loin, son souvenir s’efface.
Voilà déjà près de douze jours que nous habitons la minime cité et, en sus de son aspect extérieur, nous commençons à connaître ses antécédents et à pénétrer dans sa vie intime.
Schiedam ne fut jamais une grande ville, mais elle fut jadis un bourg prospère. Maintenant elle décline ; les anciennes familles riches sont parties ; son industrie particulière, celle du genièvre du Schiedam qui lui emprunte son titre, est bien déchue, depuis que des villes telles qu’Anvers se sont décidées, elles aussi, à fabriquer les eaux-de-vie de grains. Elle possédait autrefois trois cents distilleries et l’on en compte à peine, à l’heure actuelle, cent vingt. Où sont les bateaux qui arrivaient naguères de Norwège avec leurs cargaisons de grains bleus ? Je n’en ai découvert aucun et je doute un peu que le fruit du genévrier entre désormais dans la confection de cette magnanime liqueur. Elle semble préparée, ainsi que le whiskey d’Irlande et le gin d’Écosse, avec le blé, le maïs et l’orge ; et c’est, par toutes les rues, près des canaux, non l’odeur un peu d’allumette des vrais genièvres, mais la senteur de la farine de lin chaude, de la drèche, des résidus en bouillie de l’orge. On les évacue à la sortie des usines, dans des citernes, le long des quais et, là, des hommes les pompent et les déversent dans des barques, pour servir à la nourriture des bestiaux.
La population de la ville peut se composer de 13.000 réformés, de 10.000 catholiques, de 60 ou de 70 jansénistes et de 200 juifs. Les catholiques y sont donc en minorité, de même que dans la plupart des villes des Pays-Bas ; et c’est sans doute pourquoi ils se serrent si délibérément les coudes et forment une colonie modèle de gens pieux. Un catholique qui ne l’est que de nom et qui ne pratique pas, est rare, ici ; il n’y a décidément rien de tel que d’avoir été persécuté à cause de sa religion, pour vous la rendre chère ; si le calvinisme a décimé les ouailles du Seigneur, il faut avouer qu’il a singulièrement virilisé celles qui lui résistèrent ; le catholicisme néerlandais, tel que je l’observe ici, n’a rien de ce côté efféminé qui s’affirme de plus en plus dans les races latines. Il adore un Christ au corps impartible, en croix, qu’il ne relègue pas, ainsi que trop souvent chez nous, après ses saints.
En un mot, il est un catholicisme simple, un catholicisme mâle ; il convient de déclarer aussi qu’en Hollande, le clergé est excellent ; dispensé de l’éducation subalterne de nos séminaires, alimenté par de fortes études, il n’est pas soumis à ces préjugés qui font de nos ecclésiastiques une classe du monde, à part ; le prêtre hollandais est un homme comme un autre, mêlé, de même que n’importe qui, à la vie commune ; il est plus indépendant que chez nous, mais son existence s’écoule au grand jour et c’est justement parce qu’il n’a rien d’obscur, rien de caché, qu’il impose le respect, même aux cultes dissidents, par la dignité de sa vie, par la ferveur indiscutée de sa foi, par l’honnêteté reconnue de son sacerdoce.
Sa tâche n’est pas des plus faciles. Il faut veiller à la sécurité d’un troupeau parqué au milieu du camp des infidèles et l’accroître, s’il se peut ; mais là, il se heurte à de terribles bornes, car ce n’est que lentement que le Pays plat revient à ses premières croyances ; et il y a un motif pour cela : la défense acharnée du temple, la mise en quarantaine par les protestants des convertis ; il faut donc des cas bien exceptionnels pour qu’un égaré rentre au bercail ; il faut qu’il puisse se passer de l’aide de ses anciens coreligionnaires qui, avec les jansénistes, détiennent l’argent.
Car la richesse est chez ces sectes, chez les jansénistes surtout ; la boîte à Perrette a fait des petits ; ceux-là distribuent, pour les convaincre, d’efficaces prébendes à ceux qui se marient en leurs églises. Il ne siérait pas, sur ce mot de janséniste, de se figurer une religion prolongée de Port-Royal, de chrétiens ascétiques péchant par excès de scrupules. Les disciples de Port-Royal qui furent très intéressants, en somme, ne sont plus ; leurs successeurs sont de honteux hétérodoxes, de troubles protestants ; s’ils pèchent, ce n’est plus par outrance de rigorisme, ce serait plutôt le contraire ; Jansénius s’est marié et Quesnel a, lui aussi, pris femme ; ils sont devenus des Hyacinthe Loyson ; leur hérésie est une hérésie de coffre-fort et de pot-au-feu !
Cette Hollande qui, avec son archevêché janséniste d’Utrecht, est le dernier refuge de ce schisme, cette Hollande qui est surtout un incontestable repaire d’hérétiques, — car, si j’en crois l’annuaire du clergé, elle compterait sur une population approximative de 4.800.000 habitants, 1.700.000 catholiques, soit un peu moins de 35%, — elle a été pourtant une terre sanctifiée, une pépinière dans laquelle la culture monastique fut intense ! les bénédictins, les cisterciens, les prémontrés, les dominicains, les augustins, les franciscains, les croisiers, les alexiens, les chartreux, les antonites, y ont bâti les plus florissants des cloîtres. La Frise avait, à elle seule, 90 monastères et abbayes et, dans la seule province d’Utrecht, dit Dom Pitra, l’on a retrouvé 198 fondations d’ordres. Tout a disparu dans la tourmente.
Dans ce pays de saint Éloi, de saint Willibrord, de saint Wérenfride, de saint Willehad, de saint Boniface, de saint Odulfe, de sainte Lydwine, malgré les persécutions qui s’y révélèrent terribles, le culte catholique s’est quand même maintenu ; il a beau être noyé dans la masse de cette religion réformée suivant la confession de Calvin, il s’étend.
En 1897 un journal hollandais le « Katholicke Werkman » dénombrait ainsi les institutions catholiques des Pays-Bas : 96 maisons de religieux desservant 66 paroisses et instruisant dans les lycées 725 élèves ; 44 maisons de frères, soignant des malades, des aliénés, des orphelins, des sourds-muets, des vieillards, et faisant la classe à 1035 pensionnaires et à 12.120 élèves ; 22 maisons de moniales vouées à la vie contemplative ; 430 maisons de sœurs hospitalières prenant soin de 12.000 orphelins et d’incurables et d’aveugles. On enregistrait, en somme, à cette époque, 592 couvents en Hollande.
D’après une autre statistique parue en 1900 dans le « Residentie-bode », de la Haye, la Néerlande énumérait :
En 1784 : 350 paroisses et 400 prêtres ; en 1815 : 673 paroisses et 975 prêtres ; en 1860 : 918 paroisses et 1800 prêtres ; en 1877 : 985 paroisses et 2093 prêtres ; et, en 1900 : 1014 paroisses et 2310 prêtres.
La progression est lente mais sensible ; l’Église réoccupe, peu à peu, ce sol qui fut sien ; les anciennes semailles engourdies dans cette terre que la Réforme dessécha, lèvent ; l’on entend, dans la région des Tropiques, pousser certains roseaux ; il semble que si l’on écoutait bien dans les Pays-Bas, l’on entendrait les vieux ossements et la poudre de ses très antiques saints bruire.
Ligugé. Fête de sainte Scholastique, 11 février 1901.
Il m’a paru intéressant de rechercher quelle avait été autrefois et quelle est maintenant la situation de sainte Lydwine, au point de vue liturgique.
Voici les quelques renseignements que j’ai pu me procurer :
Dans ses « Natales sanctorum Belgii » Joannes Molanus nous apprend, à la date du 14 avril, que l’on ornait la chapelle et la tombe de Lydwine, non ce jour-là, mais le quatrième jour après Pâques et qu’on célébrait, sur le rit solennel, en son honneur l’office de la Trinité.
De leur côté, les Bollandistes nous ont conservé la séquence « De alma virgine Lydwina » qui se chantait jadis, au temps Paschal, dans la Hollande et les Flandres. Nous en donnons ci-après le texte, avec une traduction, incomplète de quelques strophes, du Cardinal Dom Pitra.
En somme, de l’année 1616, à partir de laquelle fut autorisé le culte de Lydwine, jusqu’à l’année 1892, il n’y eut pas d’office particulier pour la Bienheureuse dans le missel et dans le bréviaire des catholiques des Pays-Bas ; mais, ce qui est plus singulier, c’est qu’un office propre a existé dans l’ancien bréviaire janséniste d’Utrecht et de Harlem.
Je suis parvenu à mettre la main sur ce livre ; j’en extrais, à titre de curiosité, le texte relatif à la sainte et j’y joins une traduction.
Enfin, après la canonisation de Lydwine, un office spécial fut concédé par la sacrée Congrégation des Rites ; il a commencé d’être célébré, à partir de l’année 1892.
Cet appendice en détient le texte en latin et en français.
La messe est la messe « Dilexisti » du Commun des Vierges non martyres, avec l’oraison propre de l’office et l’Évangile selon saint Mathieu « Videns Jesus turbas » qui est l’Évangile de la Toussaint.
SEQUENTIA DE ALMA VIRGINE LYDWINA
SÉQUENCE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE LYDWINE
(Dom Pitra, Hollande Catholique, p. 136.)
OFFICE PROPRE DE LA BIENHEUREUSE LIDUINE
Breviarium ecclesiasticum ad usum Metropolitanæ ecclesiæ Ultrajectensis et cathedralis ecclesiæ Harlemensis accommodatum — pars verna — jussu superiorum, MDCCXLIV.
Festum subsequens in dioccesi Ultrajectensi recitari poterit ad libitum.
DIE XIV MAII
In festo beatæ Liduinæ
virginis
Semiduplex ad libitum
Omnia de communi Virginum non mart. præter sequentia : In I Vesperis et Laudibus.
HYMNUS
Oratio ut infra ad Laudes
AD NOCTURNUM
Invit. Agnum quem sequuntur Virgines, * Venite adoremus, Alleluia. — Apoc., XIV.
Ps. 94. — VENITE
Hymnus ex laudibus de Communi.
Ant. V. RRR.
Lectio de Scriptura occurrente,
tribus in unam redactis.
LECTIO II.
Liduina, virgo Schiedamensis, insignis futura Dominicæ Passionis imitatrix, sæculo decimo quarto in lucem edita fuit, die Dominica Palmarum, ipso sacrificii Missæ tempore, dum Passio Dominici nostri Jesu Christi in ecclesia recitabatur, parentibus pietate magis quam seculari nobilitate conspicuis. Ab infantia, singulari devotione erga Deiparem Virginem ferebatur ; eamque perpetuæ virginitatis proposito imitari studebat. Cumque pater tenellam filiam ad conjugium adhortaretur, ipsa ferventi prece a Deo obtinuit ut in sancto proposito firmaretur, carnis mortificatione id agens, ut species sua, qua placere hominibus posset, periret. Piis conatibus atque gemitibus, opitulatus est Dominus, qui castitatem virginis variis ægritudinibus, tanquam lilium inter spinas, custodivit. Anno siquidem ætatis decimo quinto, cum forte per hiemalem glaciem puella incederet, costulam dextri lateris cadendo fregit, quam læsionem continua series morborum et cruciatum per annos triginta octo secuta est. Febris æstuens, intensus capitis dolor, hydrops, calculus, vermium scaturigo, pulmonum et hepatis per particulas ejectio et quod tandem morbi genus eam non afflixit, omni interim remedio ac requie, sed et ad fundandam humilitatem, animi etiam consolatione destitutam ?
LECTIO III
Post annos probationis quatuor, famulæ suæ misertus Dominus animum ejus sic erexit ministerio Joannis Pot, magnæ pietatis viri, ut omni deinceps in Deo solo fiducia collocata, ex contemplatione Christi patientis tota in amorem Sponsi crucifixi inardesceret, parata jam, si Sponso liberet, immissos cruciatus ad indefinitam annorum longitudinem ferre. Triginta ergo annis continuis lecto tanquam Cruci eam affixit infirmitas, quorum ferme viginti solius capitis ac brachii sinistri imobilitate peregit ; cor ejus interim sacrosancta Eucharistia ad patientiam stabiliente, debili vero stomacho, ut fertur, omnem alium cibum recusante. Donec, cursu peracto, feria tertia, post Pascha absque arbitrio, quod quadrienni prece a Deo postularat, et appropinquante morte, ut ita contingeret, ipsa procurarat, obdormivit in Domino, decima quarta aprilis, anno millesimo quadringentesimo trigesimo tertio, annos nata quinquaginta tres. Variis post mortem miraculis clara, quorum aliqua refert oculatus testis Thomas A Kempis, illico cives suos habuit cultores, erecto in ecclesia sancti Joannis Baptistæ speciali sacello ad annuam ejus memoriam celebrandam, quam nec jussit, nec impedivit Sancta Sedes. Beatæ Liduinæ ædes quam desideravit pauperibus ad refugium deservire, conserva fuit in xenodochium. Ejus reliquiæ, anno millesimo sexcentesimo decimo quinto subductæ fuere Bruxellas sub Mathia Hovio, archiepiscopo Mechliniensi qui ad vota Archiducum Alberti et Isabellæ, edito Pastorali decreto, publicum eis cultum impendi permisit.
AD LAUDES
Hymnus « Ut semper in suis » supra ad I Vesperas
ORATIO
Domine Deus noster, qui beatam Liduinam virginem ab illecebris sæculi præservatam, ad tuæ Crucis amplexum toto corde transire docuisti : concede ut ejus meritis atque exemplo discamus et perituras mundi calcare delicias et Crucis tuæ amore omnia nobis adversantia superare, qui vivis et regnas, etc.
Reliqua omnia de Communi.
Bréviaire ecclésiastique, à l’usage de l’église métropolitaine d’Utrecht et de l’église cathédrale de Harlem — Partie du Printemps, imprimée par ordre des supérieurs, 1744.
La fête suivante pourra être récitée ad libitum dans le diocèse d’Utrecht.
14 MAI
En la fête de la Bienheureuse
Liduine, vierge,
demi-double ad libitum
Tout du commun des Vierges non martyres, sauf ce qui suit aux premières Vêpres et aux Laudes.
HYMNE
Comme toujours Dieu opère des merveilles dans les siens ! c’est au plus profond de la boue du monde qu’il va chercher ce qui doit abaisser la superbe !
Longuement exercée par les maladies, Liduine reconnaît enfin la main qui se dissimulait de Dieu ; elle prend sa croix et se renonce.
O divin changement ! ce calice qui lui donnait des nausées, elle le vide de tout cœur, maintenant que c’est cette main qui le lui présente et elle s’enivre de l’amour de Jésus.
Seigneur qui as uni à tes peines celles de cette vierge, fais que nous supportions pour ton amour nos douleurs.
Père qui as livré pour nous ton Fils au supplice de la Croix, permets à l’Esprit-Saint de pacifier les souffrances de notre chair
Amen.
L’oraison comme plus bas à Laudes
AU NOCTURNE
Invitatoire. « Il est l’agneau que suivent les Vierges » — * Venez, adorons-le. Alleluia — Apocalypse, XIV.
Psaume 94. — Venez, réjouissons-nous devant le Seigneur, etc. Hymne des Laudes, au Commun Antiennes, versets, répons également 1ère leçon de l’Écriture occurrente dont les trois leçons sont réunies en une.
2e LEÇON
Liduine, vierge de Schiedam, qui devait être une insigne imitatrice de la Passion du Christ naquit, au XIVe siècle, le dimanche des Rameaux, à l’heure même où, pendant la messe, l’on récitait à l’église la Passion de Notre-Seigneur. Ses parents valaient plus par leur piété que par leur naissance. Dès son enfance, elle professa une dévotion singulière pour la Vierge, Mère de Dieu, et elle s’étudia à l’imiter, en se consacrant à son Fils par un vœu de virginité perpétuelle. Et comme son père l’exhortait au mariage, elle obtint d’être affermie dans sa pieuse résolution, par la ferveur de ses prières et en pratiquant la mortification de sa chair, d’être délivrée de cette beauté qui pouvait plaire aux hommes. Le Seigneur fut vaincu par la générosité de ses efforts et par ses gémissements. De même qu’il protège un lys, en le plaçant au milieu d’un taillis d’épines, de même il préserva sa virginité, en l’entourant d’un buisson de maux. Elle avait atteint sa quinzième année, lorsque, marchant, par hasard, sur la glace, elle tomba et se brisa une côte du flanc droit. Cette lésion engendra une série de maladies et de tortures qui dura trente-huit ans. Fièvres dévorantes, douleurs de tête aiguës, hydropisie, coliques néphrétiques, parturition de vers, éjection de fragments des poumons et du foie, de quel genre d’affections ne fut-elle pas atteinte ? — et, pendant ce temps, elle demeurait privée de tout remède, sans repos et même, pour bien établir son humilité, sans consolations !
3e LEÇON
Après quatre ans de ce noviciat de douleurs, le Seigneur eut pitié de sa servante et, pour relever son âme abattue, il se servit d’un prêtre d’une grande piété, Jan Pot. Depuis lors, mettant en Dieu seul sa confiance, absorbée dans la contemplation des tortures du Christ et incendiée d’amour pour l’Époux crucifié, elle fut prête à supporter, aussi longtemps qu’il lui plairait, les plus cruels des supplices. Trente années durant, elle fut clouée sur son lit comme sur une croix par les infirmités ; pendant vingt de ces années, elle ne put remuer que son bras gauche et sa tête ; elle puisait dans la Très Sainte Eucharistie la force nécessaire pour se soutenir, car son estomac débile refusait, dit-on, toute autre nourriture. Enfin, la 3e férie après Pâques, sans témoins — par quatre ans de prières elle l’avait demandé à Dieu et, aux approches de la mort, elle-même s’était arrangée de telle sorte qu’elle pût rester seule — elle s’endormit dans le Seigneur, le quatorze avril de l’an mil quatre cent trente-trois. Elle était âgée de cinquante trois ans. Après son décès, de nombreux miracles accrurent sa renommée ; quelques-uns d’entre eux nous ont été rapportés par Thomas A Kempis qui en fut le témoin oculaire ; aussitôt ses concitoyens la révérèrent, en élevant dans l’église de saint Jean-Baptiste une chapelle spéciale pour y célébrer, chaque année, sa mémoire — et ce, sans qu’il y eût approbation ou défense du Saint-Siège. La demeure de la Bienheureuse Liduine, dont elle avait désiré faire un refuge pour les pauvres, fut convertie en hôpital. Les reliques furent transférées à Bruxelles, en 1615, Mathias Hovius étant alors archevêque de Malines. Celui-ci, sur la prière de l’archiduc Albert et de sa femme Isabelle, publia un décret pastoral pour permettre qu’un culte public leur fût rendu.
A LAUDES
Hymne « Comme toujours Dieu opère » — voir plus haut aux premières Vêpres.
ORAISON
Seigneur, notre Dieu, qui préservas des vanités du siècle la Bienheureuse Liduine et lui appris à leur préférer l’amoureuse étreinte de ta croix, accorde-nous, par son exemple et ses mérites, d’apprendre, nous aussi, à fouler aux pieds les délices périssables de ce monde et à surmonter, par l’amour de ta croix, toutes nos adversités. Toi qui vis et règnes, etc.
Tout le reste du Commun.
OFFICE DE SAINTE LIDUINE
CONCÉDÉ AUX ÉGLISES DE LA HOLLANDE, PAR DÉCRET
DE LA SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES
en date du 24 mai 1892
Die XIV aprilis
In festo
B. Liduinæ virginis
Schiedamensis
Pro civitate Schiedamensi
Duplex ij classis
Pro diocœsi Harlemensi
et pro monasterio
Carmelitarum Bruxellensium
Duplex majus
Omnia de communi Virginum non Martyrum, præter sequentia :
ORATIO
Deus qui B. Liduinam virginem admirabilis patientia et charitatis victimam effecisti, tribue, quæsumus, ut ejus exemplo et intercessione, hujus vitæ ærumnas pro tua voluntate perferentes et proximis nostris propter Te succurrentes, æterna gaudia consequi mereamur. Per Dominum etc.
In I Nocturno
Lectiones de Virginibus ut
in Communi
In II Nocturno
LECTIO IV
Liduina virgo Schiedami, in Hollandia, nata est, die Palmarum, ipso tempore quo in oppidi ecclesia inter Missæ sacrificium Passio Domini decantabatur, re quasi jam præsagiente, quam insignis illa Christi pro humano genere patientis futura esset imitatrix. A prima ætate variis virtutibus conspicua, virginitatem perpetuo custodiendam sibi etiam statuit. Quum itaque duodennis, utpote egregiis animi corporisque dotibus instructa, a pluribus honestate ac divitiis præstantibus, in conjugem peteretur, cœlesti tamen quem elegerat Sponso fidelis permansit, Deumque exoravit ut, ne quispiam deinceps conjugium sibi offerret, deformitate potius morbisque afficeretur. Voti compos facta est, eique quintodecimo ætatis anno, infausto casu, dexteri lateris costa contracta est. Mox, per reliquum vitæ tempus, octo nempe et triginta annos tam incredibili morborum et dolorum multitudine atque vi exagitata fuit eosque tam invicto imo lubenti animo toleravit, ut humanæ miseriæ simul et heroicæ patientiæ prodigium æstimaretur. Tota enim mente cœlestia mysteria, Dominicam præsertim Passionem assidue contemplans, quum vel acerbissime cruciaretur, quandoque etiam interna consolatione careret, Deo placide gratias agens, tribulationes augeri sibi magis quam minui optabat.
LECTIO V
Animi demissione, obedientia ac mansuetudine in exemplum prædita atque Dei amore flagrans, eximia etiam proximorum inimicorum, licet et persequentium, dilectione refulsit. Pauperes, ipsa pauper, de sibi erogatis eleemosynis sustentabat ; spirituali qualicumque ope indigentes, omni quo poterat modo abjuvabat, maxime si de homine a vita pravitate convertendo, vel anima e Purgatorio exsolvenda ageretur. Variis insuper prodigiis insolitisque gratiis, diu jam ante obitum late innotuit. Altissimæ, inter alia, contemplationis dono gaudens, multoties in extasin rapta, cœlestibus sæpe apparitionibus familiari imprimis Angeli sui societate honorata, cordium abscondita perspiciens, prophetico spiritu absentia et futura revelavit. Plures mirabili ejus interventu, corporis animæve sanitatem obtinuerunt. Tandem Dei famula, passionibus et meritis cumulata, piissime in cœlum migravit, decimo octavo calendas Majas, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo tertio. Corpus integrum et decorum repertum ingenti hominum concursu tumulatum ; sepulchrum, sacello desuper erecto atque majori loco ecclesiæ conjuncto, multis miraculis claruit.
LECTIO VI
Post duo fere sæcula, sacello ab acatholicis occupato, ob sanctitatis vero et miraculorum famam virginis memoria cultuque perdurante, sacræ ejus reliquiæ Bruxellas translatæ et ab Archiepiscopo Mechliniensi recognitæ sunt. Majorem partem Belgii gubernatrix, Archiducissa Isabella, Carmilitidum discalceatarum conventui Bruxellensi tradidit ; cujus ordinis et conventus moniales, quum deinde per duo iterum cum dimidio sæcula, pretiosum illud depositum fidelissime asservassent et coluissent, Summus Pontifex Pius Nonus, Episcopali Harlemensis rogatu, insignes aliquot B. Liduinæ reliquias, e prædicto monasterio in Virginis natalem urbem, ad parochialem S. Mariæ de Visitatione ecclesiam deferri concessit. Quo facto, crescente in dies erga eam devotione, Episcopi Harlemensis, cujus precibus ceteri Nederlandiæ Episcopi una cum Archiepiscopo Mechliniensi suas libentissime preces conjunxerunt, vota suscipiens summus Pontifex Leo decimus tertius Liduina cultum confirmavit et in ejus honorem Missam celebrari et proprium officium recitari pro Nederlandiæ regno induisit.
In III Nocturno
Lectio sancti Evangelii
secundum Matthæum Lectio VII. — Cap. V.
De homilia S. Augustini
Episcopi
Lib I de sermone Domini
in monte c. IV.
XIV avril
En la fête
de la B. Liduine,
vierge de Schiedam
Pour la ville de Schiedam
Double de 2e classe
Pour le diocèse d’Harlem
et pour le monastère des
Carmélites déchaussées
de Bruxelles
Double majeur
Tout du commun des Vierges non martyres, excepté ce qui suit :
ORAISON
Seigneur qui fis de la B. vierge Lydwine une victime admirable de patience et de charité, permets, nous t’en supplions, que, par son exemple et son intercession, après avoir supporté pour ta volonté les misères de cette vie et secouru en ton Nom notre prochain, nous soyons trouvés dignes de parvenir aux joies éternelles. Par Notre Seigneur, etc.
Au I nocturne
Leçons des Vierges
comme au commun
Au II nocturne
LEÇON IV
La vierge Liduine naquit à Schiedam, en Hollande, le jour des Rameaux, à l’heure même où dans l’église de la ville, pendant le sacrifice de la messe, l’on chantait la Passion du Seigneur ; elle sembla présager ainsi quelle insigne imitatrice elle devait être du Christ souffrant pour le genre humain. Dès son premier âge, elle résolut de garder la virginité perpétuelle et comme, au point de vue spirituel et corporel, elle était douée des plus enviables dons, plusieurs personnes riches et bien famées de la ville, la demandèrent en mariage ; mais elle resta fidèle au divin Époux qu’elle s’était choisi, et pria Dieu, pour éviter les démarches de nouveaux prétendants, de l’affliger de difformités et de l’enlaidir par des maladies. Sa prière fut exaucée ; elle avait quinze ans lorsqu’une chute malheureuse lui brisa une côte du flanc droit. Durant le reste de sa vie, c’est-à-dire pendant trente-huit ans, elle endura un nombre si incroyable de douleurs et de maux, avec tant de courage et de joie, qu’elle fut considérée telle qu’un prodige de misère humaine et d’héroïque patience. Son esprit tout entier s’absorbait dans la contemplation assidue des célestes mystères et surtout de la Passion du Sauveur. Lorsque ses souffrances devenaient plus acerbes, ou bien encore lorsque les consolations intérieures la délaissaient, elle rendait, sans s’émouvoir, grâces à Dieu et souhaitait l’augmentation de ses tourments plutôt que leur diminution.
LEÇON V
Modèle d’humilité, d’obéissance, de mansuétude d’âme embrasée par l’amour divin, elle témoignait à ceux qui l’approchaient et qui étaient devenus ses ennemis et même ses persécuteurs, une affection extraordinaire. Pauvre, elle-même, elle soulageait les pauvres avec les aumônes qu’elle recevait. Quiconque avait besoin d’un secours spirituel était assuré de le trouver près d’elle, surtout s’il s’agissait de la conversion d’un homme de mauvaise vie ou de la délivrance d’une âme du Purgatoire. Longtemps déjà avant sa mort, divers prodiges et d’exceptionnelles grâces l’avaient fait connaître au loin ; douée du don de la plus haute contemplation et fréquemment ravie en extase, souvent favorisée d’apparitions divines, et vivant surtout dans la société familière de son ange, elle pénétrait les secrets des cœurs et révélait prophétiquement le passé et l’avenir. Un grand nombre de personnes obtinrent par sa merveilleuse intercession la santé de l’âme et du corps, Enfin, la servante de Dieu, après avoir accumulé les souffrances et les mérites, s’en alla pieusement au ciel, le dix-huit des calendes de mai, l’an du Seigneur, mil quatre cent trente-trois. Lorsque son corps, rétabli dans son initiale beauté, fut enseveli, il y eut pour assister aux funérailles un grand concours de peuple. Son tombeau sur lequel s’éleva une chapelle que l’on rejoignit à l’église plus spacieuse, fut glorifié par de nombreux miracles.
LEÇON VI
Après environ deux siècles, la chapelle devint la propriété des hérétiques ; cependant l’éclat de la sainteté et les miracles de la vierge avaient conservé sa mémoire et son culte ; ses saintes reliques furent transférées à Bruxelles et reconnues par l’archevêque de Malines. L’archiduchesse Isabelle, gouvernante de Belgique, en donna la plus grande partie aux Carmélites déchaussées de Bruxelles. Les moniales de cet ordre et de ce couvent conservèrent pendant deux siècles et demi et honorèrent avec fidélité ce précieux dépôt. Puis le pape Pie IX, sur les instances de l’évêque de Harlem, permit de transporter, de ce monastère dans la ville natale de la vierge, à l’église paroissiale de sainte Marie de la Visitation, quelques importantes reliques de la B. Liduine. Comme à la suite de cette illation, la dévotion qu’elle inspirait augmentait chaque jour, l’Évêque de Harlem assisté des autres évêques de la Néerlande et de l’archevêque de Malines qui avaient joint très volontiers leurs prières aux siennes, obtint du Souverain Pontife Léon XIII la confirmation du culte de Liduine. La célébration d’une messe en son honneur et la récitation d’un office propre furent également accordées par le Saint-Père au royaume de la Hollande.
Au IIIe nocturne
Lecture du Saint-Évangile
selon Saint-Mathieu
Lecture VII. — Chapitre V.
De l’Homélie de Saint-Augustin,
évêque. — Du sermon du
Seigneur sur la montagne
c. IV.
Imprimée par :
Verlagsanstalt u. Druckerei A.-G. (vorm. J. F. Richter), Hambourg