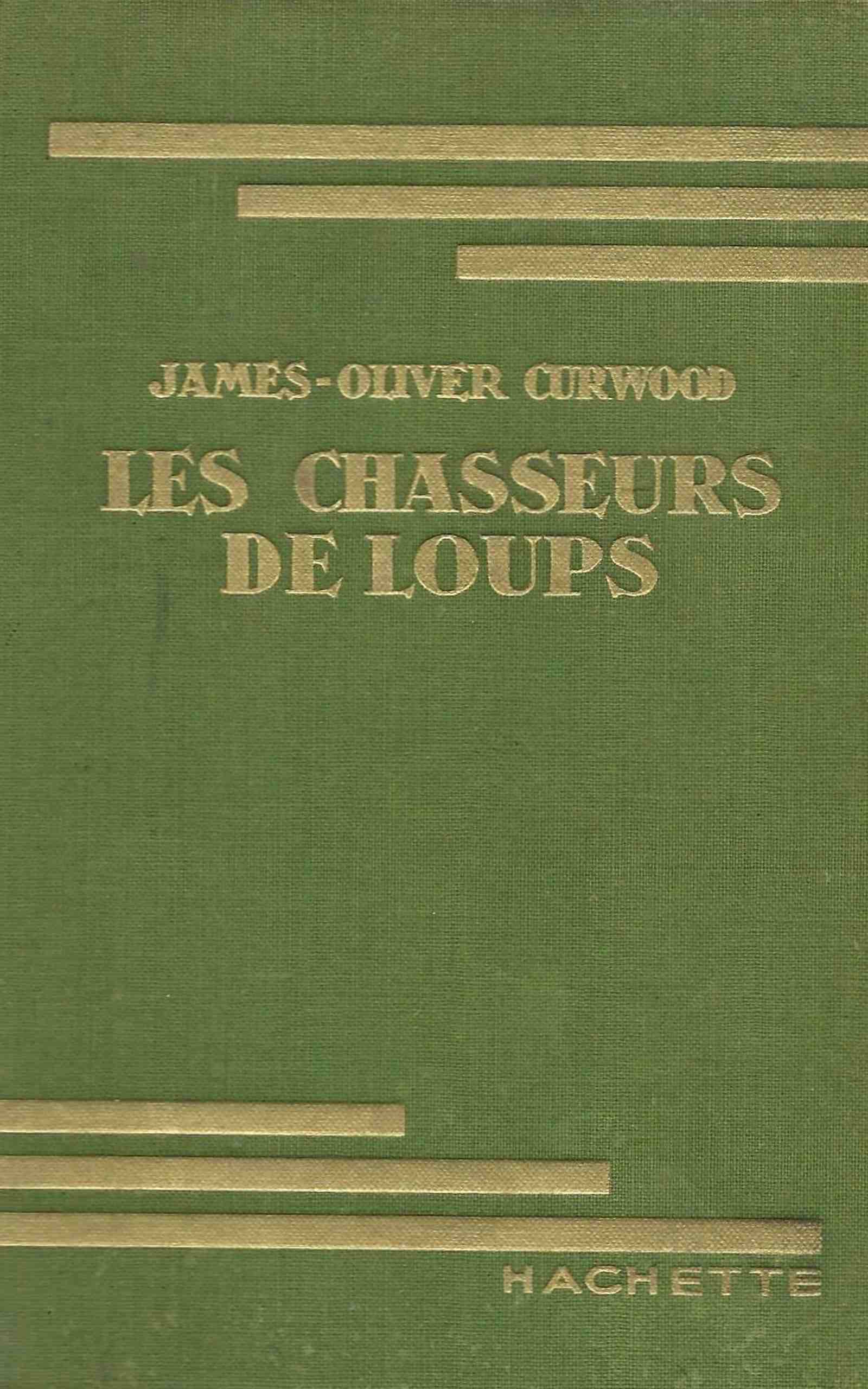
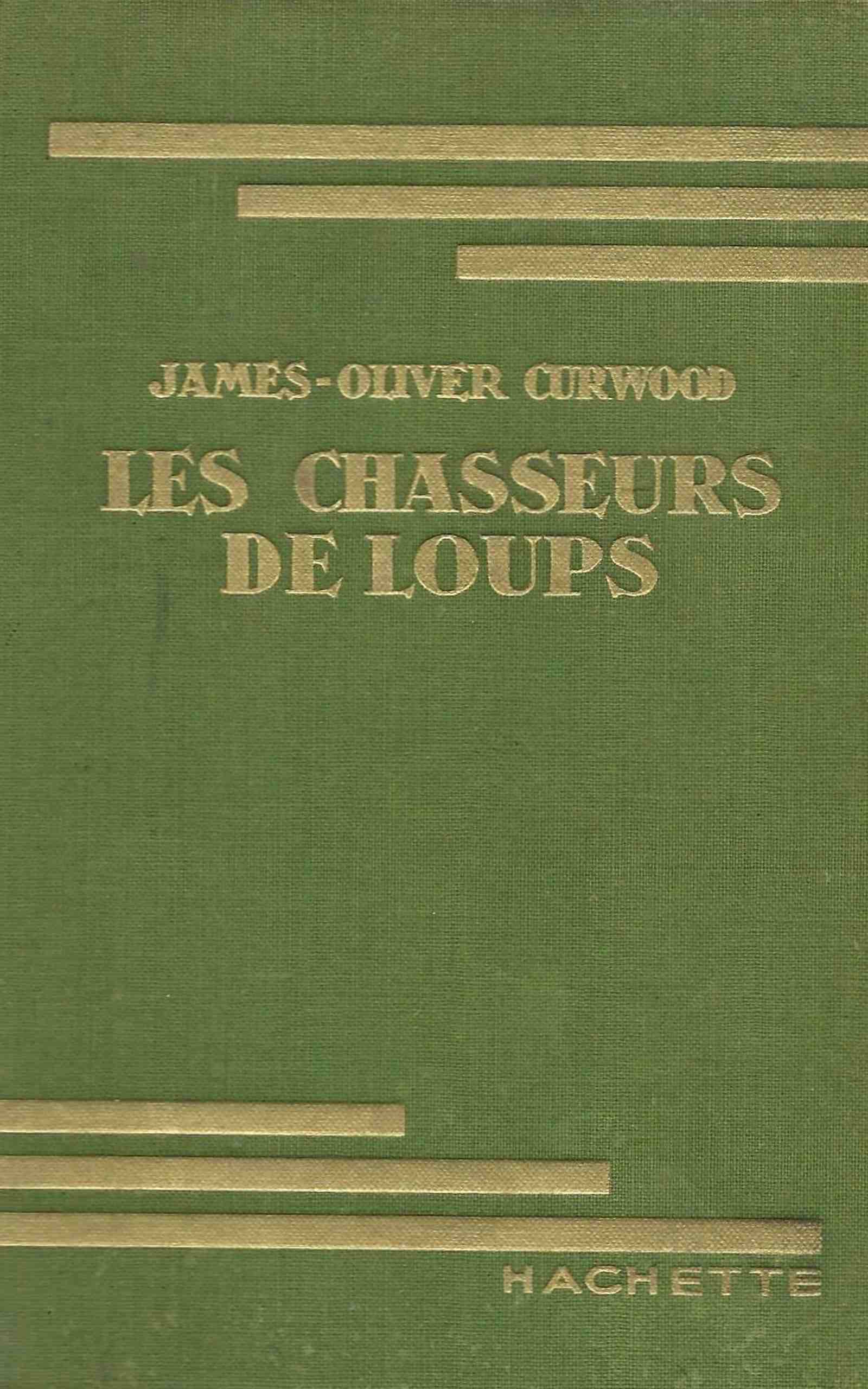
JAMES-OLIVER CURWOOD
HACHETTE
Copyright by Librairie Hachette, 1929.
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation
réservés pour tous pays.
LES CHASSEURS DE LOUPS
A mes camarades du Grand Désert du Nord, à ces compagnons fidèles avec qui j’ai partagé les joies et les peines des longues pistes silencieuses, et spécialement à Mukoki, mon guide Peau-Rouge et ami bien-aimé, en témoignage de ma reconnaissance, je dédie ce livre.
JAMES OLIVER CURWOOD.
Le lourd et froid hiver étendait son premier manteau sur le Grand Désert canadien. La lune se levait, boule rouge mouvante, éclairant d’une faible lueur le vaste silence blanc. Pas un bruit n’en brisait la calme désolation. La vie diurne s’était éteinte et il était trop tôt encore pour que s’éveillassent les voix errantes des créatures nocturnes.
Au premier plan s’estompait, sous la lueur lunaire et à la clarté diffuse de millions d’étoiles, un grand amphithéâtre de rochers, au fond duquel dormait un lac gelé. Sur la pente de la montagne s’élevait la forêt de sapins, noire et sinistre. Un peu plus bas, des mélèzes bordaient le lac de leur muraille, à demi courbés sous le fardeau de la neige et de la glace, qui les écrasait, dans les impénétrables ténèbres. Du côté opposé aux mélèzes, aux sapins et à la montagne, le cirque rocheux s’échancrait vers une plaine blanche infinie, découverte et sans arbres.
Un énorme hibou blanc émergea de l’obscurité, en dépliant son vol. Puis il jeta, d’une voix chevrotante, un hululement doux, qui semblait annoncer que bientôt allait s’ouvrir l’heure mystique des hôtes de la nuit.
La neige, qui avait chu en abondance durant la journée, avait cessé de tomber. Pas un souffle ne passait dans l’air et ses flocons étaient restés accrochés aux plus petites brindilles des ramures. Quoiqu’il ne fît pas de vent, le froid était intense. Un homme qui serait demeuré immobile fût, en une heure, tombé gelé sous sa morsure.
Soudain le silence se rompit. Un cri s’éleva, sonore et lugubre, quelque chose comme une plainte inexprimable, une plainte non humaine, qui, si un homme l’eût entendue, aurait fait battre plus vite le sang dans ses veines et se crisper ses doigts sur la crosse de son fusil. Le cri venait de la plaine blanche et se répercutait dans la nuit. Il se tut ensuite et le silence qui lui succéda à nouveau en parut plus profond. Le hibou blanc comme un gros flocon de neige, s’envola muettement, à tire-d’ailes, par-dessus le lac gelé.
Puis, au bout de quelques instants, le cri plaintif recommença mais plus faible. Un habitué du Grand Désert Blanc, dressant l’oreille et scrutant les ténèbres, n’eût pas hésité à reconnaître la clameur sauvage, de souffrance et d’agonie, d’une bête blessée et à demi conquise.
Lentement, en effet, avec la prudence que doit suivre l’angoisse des longues heures d’une journée de chasse, un magnifique élan mâle s’avançait dans la lumière de la lune. Sa tête superbe, pliant sous le poids de sa massive ramure, se tournait vers le bois de mélèzes qui était de l’autre côté du lac. L’animal reniflait l’air dans cette direction et ses narines se dilataient. Derrière lui, il laissait une coulée de sang. Blessé à mort sans doute et se traînant à peine sur la neige molle qui couvrait la glace, il espérait visiblement trouver dans l’abri des arbres un ultime refuge.
Comme il était près d’atteindre son but, il s’arrêta et rejeta sa tête en arrière, le museau levé vers le ciel, en pointant en avant ses longues oreilles. C’est l’attitude familière aux élans lorsqu’ils écoutent. Et leur ouïe est si fine qu’ils perçoivent, à un mille de distance, le clapotis d’une truite faisant des soubresauts dans l’eau vive. Mais aucun bruit ne troublait le silence, semblait-il, que, de temps à autre, les hululements funèbres du hibou blanc, qui ne s’était pas éloigné. Le puissant animal demeurait cependant immobile et, tandis qu’une petite mare de sang s’élargissait dans la neige, sous son poitrail, il écoutait toujours. Quels sons mystérieux, imperceptibles à l’ouïe humaine, parvenaient donc à ses oreilles effilées ? Quel danger se tenait en embuscade dans la noire forêt de sapins, qu’elles interrogeaient ? Les reniflements avaient repris. Aspirant l’ombre, ils allaient maintenant de l’est à l’ouest, mais se dirigeaient surtout vers le nord.
Ce que l’élan seul, d’abord, entendait, on ne tarda pas à le distinguer. Une lointaine rumeur, à la fois lamentable et féroce, croissait, puis s’évanouissait, puis croissait encore, se faisant de minute en minute plus précise. C’était le hurlement des loups !
Ce que le nœud coulant du bourreau est à l’assassin condamné à mort, ce que les fusils en joue sont à l’espion qui s’est fait prendre, ce cri des loups l’est à la bête blessée, dans le Grand Désert canadien. Le vieil élan rabaissa sa tête et ses larges cornes et, ranimant toutes ses forces, il se mit à trotter, au petit trot, vers la forêt de sapins. Plus éloignée de lui, mais plus dense aussi que le petit bois de mélèzes, il comprenait instinctivement, sous son crâne épais, qu’elle lui serait, s’il pouvait l’atteindre, une plus sûre retraite.
Mais alors… Oui, alors, tandis qu’il cheminait, il s’arrêta à nouveau. Si brusquement que ses pattes de devant fléchirent sous lui et qu’il s’écroula dans la neige. La détonation d’un fusil avait, cette fois, retenti !
Le coup avait dû partir à un mille au moins, à deux milles peut-être. Mais son éloignement n’enlevait rien à la crainte qui avait fait tressaillir le roi du Nord agonisant. Le matin de ce même jour, il avait entendu retentir un pareil bruit, qui lui avait apporté, dans ses parties vitales, une inconnue et profonde blessure. Tant bien que mal, il se remit debout. Il renifla au nord, à l’est, à l’ouest. Puis, retournant sur ses pas, il vint s’enfouir dans la masse glacée des mélèzes.
Après le coup de fusil, le silence était retombé. Il durait depuis dix minutes environ lorsqu’un glapissement rapide déchira l’air, plus proche cette fois. Un autre lui répondit, puis un second, puis un troisième, et ce fut bientôt un chœur à pleine gorge de toute la bande des loups.
Une silhouette d’homme, presque aussitôt, émergea du bois de mélèzes. Le teint de son visage était cuivré, comme celui d’un Indien.
Il avança de quelques yards[1]. Puis se retournant vers l’obscure muraille :
[1] Le yard vaut 0 m. 91 centimètres. (Note des Traducteurs.)
« Venez, Rod, cria-t-il. Nous sommes dans le bon chemin et le campement n’est plus loin. »
Une voix répondit : « Me voici, Wabi. »
Quelques minutes se passèrent et un autre jeune homme, de sang blanc, apparut. Il avait dix-huit ans au plus. De sa main gauche, il s’appuyait sur un gros gourdin. Son bras droit, qui semblait gravement blessé, était enveloppé dans un grand foulard, servant de bandage improvisé. Sa figure était toute égratignée et saignait. L’ensemble de sa démarche indiquait qu’il en était arrivé au dernier degré de l’épuisement.
Il fit encore quelques pas, en chancelant, respirant par saccades. Puis le gourdin glissa de ses doigts sans nerfs et il ne tenta même pas de le ramasser. Conscient de sa faiblesse, il plia les genoux et s’affaissa dans la neige.
Wabi lui tendit la main, pour l’aider à se relever.
« Croyez-vous, Rod, pouvoir continuer ? »
Le jeune homme se remit sur ses pieds.
« J’ai bien peur que non, murmura-t-il. Je suis à bout. »
Et il retomba sur le sol.
Wabi déposa son fusil et s’agenouilla vers son compagnon.
« Nous aurions pu facilement, dit-il, camper ici, en attendant le jour, s’il nous était resté plus de trois cartouches.
— Trois seulement ? interrogea Rod.
— Pas une plus. C’est de quoi abattre deux ou trois loups. Je ne pensais pas, en partant vous chercher, vous trouver si loin. »
Devant Roderick il se plia en deux, comme un couteau de poche que l’on referme.
« Passez vos bras autour de mon cou, dit-il, et tenez-moi bien. »
Wabi se releva avec son fardeau, portant Rod sur ses puissantes épaules.
Il allait se remettre en marche lorsque résonna le cri de chasse des loups, tellement près qu’il s’arrêta, hésitant.
« Ils ont découvert notre piste ! déclara-t-il. Nous ne pouvons songer à les gagner de vitesse. Avant cinq minutes ils seront ici. »
Une vision terrible traversa son cerveau, celle d’un autre adolescent mis en pièces devant ses yeux par les « outlaws » du Nord[2]. Et il frémit. Tel allait donc être le sort de son compagnon, et le sien propre… A moins que… En laissant tomber le blessé de ses épaules et en l’abandonnant, il pouvait fuir encore. A cette pensée, sa face se crispa et il eut un ricanement farouche. Abandonner Roderick ! Ce matin même, n’avaient-ils pas, en une première échauffourée avec les outlaws, fait le coup de feu côte à côte ? Près de lui Roderick n’était-il pas tombé dans la bataille, le bras déchiré ? S’ils devaient, dans un instant, affronter la mort, ce serait encore de compagnie. Ensemble ils mourraient.
[2] Outlaw, hors la loi. (Note des Traducteurs.)
Le parti de Wabi fut rapidement pris. Il regagna, portant Rod, le bois de mélèzes. La seule chance de salut qui s’offrait à eux était de se hisser sur un des arbres et d’y attendre que les loups se fussent dispersés avec le jour. Ils courraient le risque, à vrai dire, de mourir de froid durant ce temps. Ce serait, entre les loups et eux, une lutte d’endurance.
Wabi s’arrêta au pied d’un gros mélèze, dont les branches chargées de neige pendaient jusqu’à terre, et déposa Rod sur le sol. A la lumière de la lune, qui maintenant était haute dans le ciel et brillante, il regarda le jeune blanc qui, les yeux mi-clos et les membres flasques, avait à demi perdu connaissance. Sa figure était d’une pâleur mortelle, et, devant ce visage spectral, le cœur fidèle de Wabi se serra d’angoisse.
Mais, avant même qu’il eût songé comment il pourrait monter le blessé dans son refuge aérien, son oreille, exercée aux bruits du désert, avait tressailli. Les loups arrivaient !
Il les avait devinés, plus qu’il ne les avait entendus. Car, en approchant, les féroces chasseurs avaient tu leurs glapissements. Sans les attendre, témérairement, avec un grand cri, il bondit au-devant d’eux.
Ils n’étaient plus qu’à quelques pieds du bois lorsqu’il arriva pour leur barrer la route. Ils ne formaient qu’un petit groupe, l’avant-garde sans doute. Sans perdre un instant, Wabi mit en joue et tira. Un hurlement de douleur lui apprit que le coup avait porté. Il épaula, une deuxième fois, et visa si bien qu’il vit le second loup sauter en l’air, comme mû par un ressort, et retomber à plat dans la neige, sans même un cri. Les autres alors se dispersèrent, non sans emporter avec eux le cadavre du mort, pour l’aller dévorer un peu plus loin.
Revenu vers Rod, Wabi vit avec satisfaction que celui-ci, surmontant son immense faiblesse, avait repris un peu de vie. Il grimpa dans le mélèze et le tira après lui.
« C’est la seconde fois, dit Rod, que vous me sauvez. La première fois c’était d’une noyade bien réussie. Cette fois, c’est des loups. Je vous dois une fière chandelle ! »
Affectueusement il posa sa main sur l’épaule de son ami.
« Vous me l’avez bien rendu ce matin, répondit Wabi. Si vous êtes ainsi estropié, c’est pour moi. La blessure sanglante m’était destinée. Nous sommes quittes. »
Et les regards des deux jeunes gens se croisèrent en une confiance amie.
Le concert des hurlements avait recommencé. Wabi se hissa jusqu’au faîte de l’arbre pour observer. La horde sortait justement de la forêt de sapins, un peu plus haut sur la montagne, et dévalait sur ses pentes, à toute vitesse, se répandant parmi la neige en multiples points noirs pareils à des fourmis.
D’autres hurlements répondaient à ceux-ci, du côté du lac, qu’une autre bande traversait en courant. Les deux troupes voraces semblaient avoir pour objectif commun le bois de mélèzes et vouloir s’y réunir. Il y avait bien au total, près de soixante bêtes.
Wabi tira Rod, non sans peine, un peu plus haut dans l’arbre. Les deux hommes, avec l’unique cartouche qui restait, attendirent. Rod avait, dans la bagarre du matin, perdu son fusil et ses munitions.
Wabi, cependant, était remonté à son poste d’observation. Il vit bientôt que les deux bandes de loups s’étaient rejointes en effet et encerclaient le bois. Les animaux semblaient en proie à une vive exaltation. Ils venaient de rencontrer la petite mare de sang laissée par l’élan agonisant et relevaient la piste qui lui faisait suite.
« Que se passe-t-il ? » demanda Rod, à mi-voix.
Les yeux noirs de Wabi se dilatèrent et se mirent à briller d’un flamme ardente. Le sang palpitait dans ses veines et son cœur battait à se rompre.
« Ce n’est pas à nous qu’ils en veulent, répondit-il, après un moment de silence. Ils ne nous ont pas pistés, ni flairés, mais une autre proie. C’est notre chance. »
A peine avait-il parlé que les buissons et les branches craquaient à quelques pieds du mélèze et, droit au-dessous d’eux, les deux hommes purent voir une grosse masse d’ombre qui passait au triple galop. Wabi eut le temps de reconnaître un élan mâle, et il ignorait que c’était le même auquel il avait, au cours de la journée, envoyé une balle qui ne l’avait pas immédiatement abattu. Les loups serraient de près la bête, la tête au ras du sol, sur la piste empourprée, avec des cris rauques et des grognements affamés qui sortaient, par instants, de leurs mâchoires béantes.
Ce n’était pas pour Wabi un spectacle nouveau, mais il s’offrait pour la première fois aux yeux de Rod et, quoiqu’il n’eût duré que le temps d’un éclair, il y devait demeurer longtemps gravé. Longtemps Roderick devait revoir dans ses rêves la bête monstrueuse, qui se savait condamnée, fuyant dans la nuit neigeuse en jetant son lourd beuglement d’agonie, et la horde diabolique des outlaws du désert attachée à ses trousses, corps agiles et puissants, corps squelettiques, dont la peau collait sur les os, mais qui demeuraient indomptables et qu’affolaient la proximité de leur proie.
Car il était certain que l’élan succomberait, dans ce duel inégal, et que les loups se gaveraient de lui, jusqu’à la dernière parcelle.
« Et maintenant, dit tranquillement Wabi, nous pouvons redescendre à terre et continuer sans crainte notre chemin. Ils sont trop absorbés pour s’occuper de nous ! »
Il aida Rod à glisser jusqu’au sol, en lui maintenant les pieds. Puis il se courba devant lui, comme il l’avait déjà fait, et le chargea sur son dos.
Ils sortirent du bois de mélèzes et allèrent ainsi durant un mille, jusqu’à un petit torrent, dont la surface était gelée.
« Wabi, dit Rod, reposez-vous et laissez-moi marcher. Je sens que mes forces reviennent. Vous me soutiendrez seulement un peu. »
Tous deux continuèrent à cheminer. Wabi avait passé son bras autour de la taille du blessé. Ils parcoururent ainsi un autre mille.
Ils aperçurent alors, à un tournant de la vallée, une flamme qui brillait, joyeuse, près d’un boqueteau de sapins. Elle était encore distante d’un bon mille, mais il leur semblait qu’ils la touchaient de la main. Ils la saluèrent d’un cri d’allégresse. Wabi, posant son fusil et délaçant son bras de la taille de Rod, joignit ses deux mains devant sa bouche, pour s’en faire un porte-voix, et lança son signal habituel :
« Oua, ou, ou, ou, ou, ou, ou ! Oua, ou, ou, ou, ou, ou, ou ! »
L’appel s’en alla, dans la nuit tranquille, jusqu’au feu. Une forme ombreuse apparut dans la lueur de la flamme et retourna le cri.
« C’est Mukoki ! dit Wabi.
— Mukoki ! » fit Rod en riant, tout heureux de voir que la rude épreuve tirait à sa fin.
Mais, presque aussitôt, Wabi l’aperçut qui chancelait, pris de vertige. Il dut le maintenir à nouveau pour qu’il ne tombât pas dans la neige.
Si, ce soir-là, les regards des jeunes chasseurs, couchés devant le feu de leur campement, sur l’Ombakika gelé, avaient pu percer l’avenir et prévoir toutes les tragiques émotions qu’il leur réservait, alors peut-être auraient-ils reculé et, faisant route en arrière, seraient-ils revenus, sans plus, vers la civilisation. Peut-être aussi le terme heureux qui devait couronner leur longue randonnée les eût-il, en dépit de tout, entraînés en avant. Car l’amour des vibrations fortes est ancré dans le cœur de la robuste jeunesse.
Mais ils n’avaient pas à choisir entre cette double alternative, l’avenir demeurant fermé pour eux. Plus tard seulement, après bien des années écoulées, ils devaient, devant les bûches ronflantes du foyer familial, revoir dans son ensemble le tableau complet des aventures vécues par eux et, les revivant en imagination, y trouver de chers et ineffaçables souvenirs, auxquels ils n’auraient pas voulu désormais renoncer pour tout l’or du monde.
Un peu moins de trente ans avant l’époque où se déroule ce récit, un jeune homme, nommé John Newsome, quittait pour le Nouveau-Monde la grande ville de Londres. Le sort lui avait été cruel. Après qu’il eut perdu père et mère, il s’était vu ruiné et, du petit héritage familial, rien ne lui était demeuré.
Il débarqua à Montréal et, comme c’était un garçon bien éduqué, actif et entreprenant, il se fit rapidement une situation. Le patron qui l’employait lui accorda sa confiance et l’expédia comme agent, ou « factor », à sa factorerie de Wabinosh-House, fort loin vers le nord, dans la région désertique du lac Nipigon, vers la Baie d’Hudson.
Un chef de factorerie est roi de fait, dans son domaine. Au cours de la seconde année de son gouvernement, John Newsome reçut la visite d’un chef Peau-Rouge, nommé Wabigoon. Il était accompagné de sa fille, Minnetaki, dont une ville devait prendre un jour le nom, en hommage à sa beauté et à sa vertu. Minnetaki était alors dans l’éclat naissant de sa jeunesse et la beauté qui brillait en elle s’était rarement vue parmi les jeunes filles indiennes.
Ce fut le coup de foudre pour John Newsome, qui s’éprit sur-le-champ de la divine princesse. Ses visites furent des lors fréquentes au village indien où commandait Wabigoon, à trente milles de Wabinosh-House, dans les profondeurs du Grand Désert Blanc.
Minnetaki ne resta pas insensible à l’amour du jeune factor. Mais leur mariage, rapidement décidé, trouva dès l’abord, devant lui, un gros obstacle.
Un jeune chef indien, nommé Woonga, s’était épris lui aussi de Minnetaki. Celle-ci le détestait dans son cœur. Mais Woonga était puissant, plus puissant que Wabigoon, qui se trouvait sous sa dépendance directe pour les territoires de chasse qu’il avait coutume de fréquenter. D’où nécessité de le ménager. Minnetaki n’osait convoler avec celui qu’elle aimait.
Une violente rivalité s’établit entre les deux soupirants. Un double attentat en résulta contre la vie de Newsome, et Woonga expédia à Wabigoon un ultimatum, lui faisant savoir qu’il eût à lui accorder sa fille. Minnetaki répondit en personne, par un net refus, à cette sommation, et le feu de la haine en devint plus fébrile dans la poitrine de Woonga.
Durant une nuit noire, à la tête d’une troupe d’hommes de sa tribu, il tomba à l’improviste sur le campement de Wabigoon. Le vieux chef fut égorgé, ainsi qu’une vingtaine de ses gens, mais le but principal de l’attaque, qui était l’enlèvement de Minnetaki, échoua. Woonga fut repoussé avant d’avoir pu s’emparer de la jeune fille.
Un messager fut expédié en toute hâte à Wabinosh-House, afin d’apporter à Newsome la nouvelle de l’assaut qui avait eu lieu et de la mort de Wabigoon. Le jeune factor, avec une douzaine d’hommes déterminés, vola au secours de sa fiancée. Une seconde attaque de Woonga tourna nettement à son désavantage et il fut reconduit dans le Désert, tambour battant, avec de lourdes pertes pour les siens.
Trois jours après, Newsome épousait Minnetaki.
A partir de ce moment s’ouvrit une ère sanglante, dont le souvenir devait demeurer longtemps vivace dans les annales de la factorerie. Haine née de l’amour, devenue haine de race, inexpiable et sans fin.
Woonga se mit délibérément hors la loi, avec sa tribu entière, et il commença à exterminer, à peu près jusqu’au dernier, tous les anciens sujets de Wabigoon. Ceux qui purent échapper abandonnèrent leur ancien territoire et vinrent se réfugier aux alentours de la factorerie. Ce fut ensuite au tour des trappeurs engagés au service du factor, d’être perpétuellement traqués, et massacrés dans des embuscades.
Haine pour haine, menace pour menace furent rendues à Woonga et aux hommes de son clan. Et bientôt tous les Indiens, quels qu’ils pussent être, furent, à Wabinosh-House, considérés comme des ennemis. On les tint pour autant d’autres Woonga et, dans la conversation courante, on ne les appela désormais que les « Woongas ». Ils furent décrétés une bonne cible pour n’importe quel fusil.
Deux enfants, cependant, avaient sanctifié l’union de Newsome et de sa belle Peau-Rouge. L’aîné était un garçon qu’en l’honneur du vieux chef, son grand-père, on baptisa Wabigoon et, par abréviation, Wabi. L’autre était une fille, de quatre ans plus jeune, que Newsome avait tenu à nommer, comme sa mère, Minnetaki.
Chose curieuse le sang indien semblait couler, presque pur, dans les veines de Wabi. L’enfant était indien d’aspect, de la semelle de ses mocassins jusqu’au sommet du crâne. Il était cuivré et musculeux, aussi souple et agile qu’un lynx, rusé comme un renard, et tout en lui criait qu’il était né pour la vie du Désert. Son intelligence cependant était grande et surprenait le factor lui-même.
Minnetaki, au contraire, à mesure qu’elle grandissait, tenait moins de la beauté sauvage de sa mère et se rapprochait davantage des allures et de la grâce de la femme blanche. Si ses cheveux étaient noirs comme du jais, et noirs ses grands yeux, elle avait la finesse de peau de la race à laquelle appartenait son père.
Ç’avait été un des meilleurs plaisirs de Newsome de s’adonner à l’éducation de sa femme sauvage. Et tous deux n’avaient qu’un but commun, élever à la mode des enfants blancs la petite Minnetaki et son frère. Ils commencèrent par fréquenter, à Wabinosh-House, l’école de la factorerie. Ils furent ensuite envoyés, deux hivers durant, à celle, plus moderne et mieux organisée, de Port-Arthur, le centre civilisé le plus proche. Les deux enfants s’y montrèrent des élèves brillants.
Wabi atteignit ainsi sa seizième année et Minnetaki sa douzième. Rien, dans leur habituel langage, ne trahissait leur part d’origine indienne. Mais ils s’étaient, sur le désir de leurs parents, familiarisés également avec le langage ancestral du vieux Wabigoon.
Vers cette époque de leur jeune existence, les Woongas se firent plus audacieux encore dans leurs déprédations et leurs crimes. Ils renoncèrent complètement à tout travail honnête et ne vécurent plus que de leurs pillages et de leurs vols. Les petits enfants mêmes avaient sucé avec le lait la haine héréditaire contre les hôtes de Wabinosh-House, haine dont maintenant Woonga était presque seul à se rappeler l’origine. Si bien que le gouvernement canadien finit par mettre à prix la tête du chef Peau-Rouge et celle de ses principaux partisans. Une expédition en règle fut organisée, qui refoula les hors-la-loi vers des territoires plus lointains, sans que Woonga lui-même pût être capturé.
Lorsque Wabi eut dix-sept ans, il fut résolu qu’il s’en irait aux États-Unis, pendant une année, dans quelque grande école. Contre ce projet, le jeune Indien (presque tous le considéraient en effet comme tel et il en était fier) lutta avec énergie, mettant en avant mille arguments. Il avait, disait-il, pour le Grand Désert Blanc toute la passion de sa race maternelle. Toute sa nature se révoltait contre la prison qu’est une grande ville, contre ses rumeurs, son tumulte et sa boue. Non, non, il ne saurait jamais se faire à cette existence.
Alors intervint sa sœur Minnetaki. Elle lui demanda, elle le supplia de partir, d’aller là-bas pour une année, pas plus. Il reviendrait ensuite et lui raconterait tout ce qu’il aurait vu, il lui apprendrait à son tour tout ce qu’il aurait appris. Wabi aimait sa gentille petite sœur plus que tout au monde. Elle fit plus pour le décider que n’avaient fait les parents, et il partit.
Il se rendit à Détroit[3], dans l’État de Michigan, et trois mois durant, il s’appliqua au travail, avec conscience. Mais chaque semaine qui s’écoulait ajoutait au chagrin de son isolement, à ses regrets languissants d’avoir perdu Minnetaki, de n’avoir plus devant lui le Grand Désert Blanc, son libre espace et ses forêts. Chaque journée était pour lui un poids pesant et sa seule consolation était d’écrire, trois fois par semaine, à sa sœur aimée. Trois fois par semaine, encore que le courrier postal ne circulât que deux fois par mois, Minnetaki lui écrivait aussi des lettres non moins longues, où elle le soutenait et l’encourageait.
[3] Détroit, capitale de l’État de Michigan, à 700 kilomètres N.-O. de Washington, est situé à la frontière du Canada et des États-Unis, sur la rivière du même nom, qui fait communiquer ensemble les lacs Huron et Érié. (Note des Traducteurs.)
C’est au cours de sa vie solitaire d’écolier que le jeune Wabigoon lia connaissance avec Roderick Drew.
Comme Newsome, Roderick était un enfant du malheur. Lorsque son père mourut, si jeune était-il encore qu’il n’en avait même pas gardé le souvenir. Sa mère l’avait élevé et le petit capital qu’ils possédaient avait fondu peu à peu. Jusqu’au dernier moment elle avait lutté contre la gêne, afin de maintenir son fils au collège. Maintenant toutes ressources étaient épuisées et Roderick se préparait à abandonner ses études au terme de la semaine en cours. La nécessité devenait son maître farouche et c’est pour vivre qu’il allait falloir travailler.
Le boy décrivit sa peine au jeune Indien, qui s’était agrippé à lui, comme le naufragé à une bouée, et était devenu son inséparable. Et, lorsque Roderick fut rentré chez lui, Wabi alla lui rendre visite.
Mistress Drew était une femme fort distinguée, qui reçut Wabi avec amitié et ne tarda pas à lui porter une affection quasi maternelle. Sous cette influence réconfortante, il trouva moins anguleuse cette odieuse civilisation et son exil lui parut moins amer. Ce changement dans son esprit se refléta dans ses lettres à Minnetaki et il lui fit de la maison amie une description enthousiaste. Mistress Drew reçut de la mère de Wabi d’affectueux remerciements et une correspondance régulière s’établit entre les deux familles.
Dès que Wabi, qui ne connut plus dès lors la solitude, avait terminé sa journée de collège, il venait retrouver son ami, qui rentrait, de son côté, de la maison de commerce où il travaillait. Durant les longues soirées d’hiver, les deux boys s’asseyaient l’un à côté de l’autre, devant le feu, et le jeune Indien commençait à narrer l’existence idéale que l’on mène dans le Grand Désert Blanc. Rod écoutait de ses deux oreilles et, peu à peu, naissait et se développait en lui un irrésistible désir de connaître cette vie. Des plans s’échafaudaient, une foule d’aventures étaient imaginées. Mistress Drew écoutait, en souriant ou en riant, et ne disait pas non à tous ces projets mirifiques. Mais un jour arrive où tout prend fin. Wabi s’en retourna au Grand Désert Blanc, près de sa mère Peau-Rouge et de sa sœur Minnetaki. Les yeux des jeunes gens s’emplirent de larmes lorsqu’ils se séparèrent et Mistress Drew pleura aussi, en voyant partir le jeune Indien.
Le temps qui suivit fut douloureux à l’extrême pour Roderick. Huit mois d’amitié avec Wabi avaient fait surgir en lui comme une seconde nature et il lui sembla, lorsque partit son camarade, que quelque chose de lui-même s’en allait. Le printemps vint, puis l’été. Chaque courrier postal apportait de Wabinosh-House un paquet de lettres pour les Drews et en remportait un de Détroit.
L’automne arriva, et les gelées de septembre commençaient à tourner à l’or et au rouge les feuillages de la Terre du Nord, quand une longue lettre de Wabi suscita, dans le petit home des Drew, une grosse émotion, mêlée à la fois de joie et d’appréhension. Elle était accompagnée d’une seconde lettre du factor en personne, d’une troisième, de la mère Peau-Rouge, et d’un petit post-scriptum de la jeune Minnetaki. Les quatre missives demandaient instamment à Roderick et à Mistress Drew de venir passer l’hiver à Wabinosh-House.
« Ne craignez pas, écrivait Wabi, qu’une perte d’argent résulte pour vous de l’abandon momentané de votre place. Nous gagnerons ici, durant cet hiver, plus de dollars que vous n’en pourrez, en trois ans, récolter à Détroit. Nous chasserons les loups. La région en pullule et le gouvernement donne une prime de quinze dollars pour chaque scalp présenté. Au cours de chacun des deux derniers hivers, j’en ai tué quarante. Et j’estime que la chasse n’a pas été bonne. J’ai un loup apprivoisé qui sert d’affût. Quant aux fusils et au reste de l’équipement, ne vous en tourmentez point. Nous avons ici tout le nécessaire. »
Mistress Drew et son fils délibérèrent durant quelques jours sur cette proposition, avant d’envoyer une réponse à Wabinosh-House. Roderick suppliait d’accepter l’invitation. Il dépeignait la splendeur heureuse du séjour qui leur était offert, la belle santé qu’ils en rapporteraient. De cent façons différentes il présentait ses arguments et plaidait sa cause. La mère était moins enthousiaste. Dans la situation précaire où ils se trouvaient, n’était-il pas imprudent de quitter une situation modeste encore, mais assurée, et qui leur permettait une vie et un confort acceptables en somme. Les appointements de Roderick iraient en augmentant et, cet hiver même, seraient élevés à dix dollars par semaine.
Finalement, Mistress Drew céda. Elle consentait au départ de Rod, tandis qu’elle-même, qui redoutait quelque peu ce lointain déplacement, resterait pour garder le logis. Une lettre en ce sens fut expédiée à Wabinosh-House, en demandant des précisions sur l’itinéraire à suivre.
La réponse arriva trois semaines après. Le 10 octobre, Wabi se rencontrerait avec Rod à Sprucewood, sur la Rivière de l’Esturgeon, qu’ils remonteraient ensuite en canot jusqu’au lac du même nom. Là ils prendraient un billet pour le bateau du Lac Nipigon et ils arriveraient à Wabinosh-House avant que la glace naissante de l’hiver se refermât sur eux.
Les délais étaient courts pour les préparatifs nécessaires et, quatre jours après, Rod quittait sa mère pour monter dans le train qui l’amènerait à Sprucewood. Il y trouva, en débarquant, Wabi qui l’attendait, accompagné par un des Indiens de la factorerie. L’après-midi du même jour, ils commençaient à remonter la Rivière de l’Esturgeon.
Pour la première fois, Roderick s’enfonçait en plein cœur du Grand Désert du Nord.
Assis à l’avant du canot d’écorce de bouleau, avec Wabi tout près de lui, il buvait ardemment la sauvage beauté des forêts, aux essences variées, et des marais miroitants, devant lesquels ils glissaient sur l’eau comme des ombres, au claquement étouffé des rames. Son cœur palpitait d’une émotion joyeuse et ses yeux, sans cesse aux aguets, étaient à l’affût de voir paraître le gros gibier que Wabi lui avait dit fréquenter en grand nombre les rives de l’Esturgeon.
Sur ses genoux était posé le fusil à répétition de Wabi. L’air était vif et piquant, du froid de la nuit, au cours de laquelle il avait gelé. Par moments, des forêts de hêtres, au manteau d’or et d’incarnat, refermaient sur eux leurs masses compactes. D’autres forêts leur succédaient, de noirs sapins, qui descendaient jusqu’aux rives du fleuve. De l’eau des marécages surgissaient des bois de mélèzes.
Cette vaste et solitaire désolation n’allait pas sans une quiétude reposante, dans son mystère. Le silence n’en était troublé que par les bruits épars de la vie du Désert. Des perdrix, en gloussant, s’enfuyaient dans les buissons. Presque à chaque tournant de la rivière, des bandes de canards s’élevaient de l’eau, avec de grands battements d’ailes.
A un moment, Rod, sursautant, entendit parmi les arbustes riverains, à un coup de pierre du canot, un craquement singulier. Il vit leurs branches s’écarter et se plier.
« Un élan ! » murmura Wabi, derrière lui.
A ce mot, un tremblement le saisit et tout son corps frissonna d’émotion attentive. Il n’avait pas encore le sang-froid blasé des vieux chasseurs, ni l’indifférence stoïque avec laquelle les hommes de la Terre du Nord entendent autour d’eux ces multiples bruits des créatures sauvages. Rod, pour le gros gibier, en était à son début. Il n’allait pas tarder à faire connaissance de plus près avec lui.
Dans l’après-midi du même jour, au delà d’un coude de la rivière, que contournait légèrement le canot, une grosse masse de bois mort qui s’en était allée à la dérive, puis s’était butée contre le rivage, apparut tout à coup. Le soleil se couchait, derrière la forêt, dans une lumière jaune ardente, et sur le bois flottant, que ses rayons obliques venaient friser de leur lumière, une bête était posée.
Un cri aigu fusa, malgré lui, des lèvres de Roderick. C’était un ours qui, comme ses congénères aiment à le faire à l’approche des longues nuits d’hiver, chauffait ses membres velus aux feux ultimes de l’astre du jour.
L’animal était pris à l’improviste, et de tout près. Rapide comme l’éclair et se rendant compte à peine de ce qu’il faisait, Rod épaula, visa et tira.
L’ours, non moins prompt, avait déjà commencé à grimper sur la rive. Il s’arrêta un instant, comme s’il allait tomber, puis continua sa retraite.
« Vous l’avez touché ! cria Wabi. Vite, envoyez-lui une seconde balle ! »
Rod tira un second coup, qui parut ne produire sur l’ours aucun effet.
Alors, hors de lui, oubliant qu’il était sur un frêle canot, il sauta sur ses pieds, en un mouvement brusque, et tira un dernier coup sur la bête noirâtre, qui allait disparaître parmi les arbres.
Wabi et l’Indien se portèrent précipitamment à l’extrémité opposée du canot, afin de faire contrepoids. Mais leurs efforts furent vains. Déjà, perdant l’équilibre et ébranlé, par surcroît, par la percussion du fusil, Rod avait culbuté dans la rivière.
Avant qu’il eût disparu sous l’eau, Wabi avait saisi le fusil que Rod tenait encore.
« Ne faites pas de mouvements inutiles, s’exclamait-il, et cramponnez-vous à votre fusil ! N’essayez pas surtout de remonter dans le canot ! Nous passerions tous par-dessus bord… »
L’Indien, sur son ordre, ramena lentement l’embarcation vers la rive. Durant ce temps, Wabi avait peine à réprimer son envie de rire, en voyant émerger la tête ruisselante de son ami et sa mine déconfite.
« Par saint George ! ce coup était élégant pour un néophyte. Vous l’avez eu, votre ours ! »
Rod, en dépit de sa position fâcheuse, se rasséréna à cette bonne nouvelle. Dès qu’il eut atteint la terre ferme, il échappa à l’étreinte de Wabi qui, tout ému encore, prétendait le serrer dans ses bras, et il courut, sous les arbres, après son ours.
Il le trouva sur le sommet du coteau, bien mort, d’une balle qui lui avait traversé les côtes, et d’une autre qu’il avait reçue en pleine tête.
Alors, devant la première grosse pièce qu’il avait abattue, dégouttant d’eau et grelottant de tous ses membres, il jeta vers ses deux compagnons, qui étaient occupés à amarrer le canot, une série de cris de triomphe, qu’on aurait pu entendre à un demi-mille de distance.
Wabi accourut.
« L’endroit, dit-il, est excellent pour camper cette nuit. La chance nous a bien servis. Nous aurons, grâce à vous, un glorieux festin, et le bois ne manquera pas pour le faire cuire et établir notre abri. Voilà qui vous prouve que la vie vaut la peine d’être vécue sur la terre du Nord ! »
Puis il appela le vieil Indien :
« Holà, Muki ! »
Cet Indien était un proche cousin du vieux Wabigoon. Il s’appelait de son vrai nom Mukoki, et on l’appelait, par abréviation, Muki. Il avait été, depuis la tendre enfance de Wabi, son fidèle compagnon.
« Tu vas, Muki, me découper comme il convient ce gaillard-là. Tu veux bien, n’est-ce pas ? Pendant ce temps, je vais préparer le campement.
— Pouvons-nous conserver la peau ? interrogea Rod. C’est mon premier trophée, et dame…
— Certainement que nous le pouvons ! répondit Wabi. En attendant, donnez-moi un coup de main pour installer le feu. Cela vous empêchera de prendre froid. »
Roderick, en effet, dans la joie de ce premier campement, en avait oublié presque qu’il était trempé jusqu’aux os et que la nuit commençait à tomber.
Bientôt une longue flamme crépitante se dégageait de la fumée et jetait, à trente pieds à la ronde, sa chaleur et sa lumière. Wabi apporta du canot le paquet de couvertures et, après avoir fait déshabiller Roderick, l’y enveloppa chaudement, tandis que les vêtements mouillés étaient suspendus près du feu, pour y sécher.
Wabi se mit ensuite à confectionner, au grand émerveillement de Rod, un abri pour la nuit, qui promettait d’être froide. Tout en sifflant allègrement, le boy, ayant pris une hache du canot, se dirigea vers un bouquet de cèdres et commença à couper des brassées de leurs ramures. Rod ne voulut pas demeurer inutile et, liant autour de lui ses couvertures, il alla, silhouette carnavalesque et trébuchante, rejoindre Wabi.
Deux grandes branches fourchues furent d’abord plantées verticalement dans le sol, à huit pieds d’écartement l’une de l’autre. Sur les deux fourches un petit arbre fut posé horizontalement, afin de former l’arête du toit. A droite et à gauche, une demi-douzaine d’autres grosses branches s’inclinèrent vers le sol, en guise de charpente, et sur elles s’empilèrent les ramures de cèdre. Au bout d’une demi-heure de travail, la cabane avait déjà pris forme.
Elle se terminait, en même temps que Muki achevait de dépouiller et de dépecer son ours. D’autres ramures furent étendues sur le sol, pour servir de lits, tout odorantes de résine. Et, tandis que luisait devant lui le grand feu et qu’autour du campement la nuit déserte se faisait plus épaisse et plus noire, Rod songeait que nulles descriptions d’un livre, aucune image dont aucun livre était orné, n’égalaient la présente réalité.
Bientôt de larges tranches d’ours furent mises à rôtir au-dessus des braises rouges, l’arôme du café, dans sa bouillotte, se mêla à la bonne odeur des gâteaux de farine dont le feu faisait grésiller la graisse, sur un petit fourneau, Rod connut alors que ses plus beaux rêves se réalisaient.
Au cours de la nuit, le jeune citadin se plut à écouter, dans la lueur du feu, les palpitantes histoires que contaient, à tour de rôle, Wabi et le vieil Indien. Et l’aube le trouva encore éveillé, prêtant l’oreille au hurlement lointain d’un loup, aux clapotis mystérieux qui montaient de la rivière et à la note perçante du cri des oiseaux de nuit.
Pendant les trois jours qui suivirent, en cours de route, Roderick continua ses expériences.
Par un beau matin glacé, avant que ses compagnons se fussent éveillés, il quitta sans rien dire le campement, armé du fusil de Wabi. Il envoya deux coups de feu à un daim rouge, qu’il manqua, les deux fois. Il s’essouffla ensuite, sans plus de résultat, à la poursuite d’un caribou[4], qui lui échappa en se jetant à la nage dans le Lac de l’Esturgeon, et sur lequel il tira sans effet trois coups à longue distance.
[4] Le cariboo ou caribou est une sorte de renne de l’Amérique du Nord. (Note des Traducteurs.)
Ce fut par un magnifique après-midi que, sur le bateau où ils avaient pris place et qui fendait l’eau calme du Lac Nipigon, le regard perçant de Wabi découvrit le premier les maisons faites de bûches de Wabinosh-House, blotties sur la lisière d’une immense forêt, dont on ne voyait pas la fin.
A mesure qu’ils approchaient, il désignait du doigt, à Rod, joyeusement, les magasins de la factorerie, le petit groupe des maisons des employés, et celle du factor, qui allait s’ouvrir devant lui et l’accueillir.
Lorsque le rivage ne fut plus très éloigné, un canot s’en détacha et vint au devant du bateau. Les deux boys virent un mouchoir blanc s’agiter, pour les saluer. Wabi répondit par un cri d’allégresse et tira en l’air un coup de fusil.
« C’est Minnetaki ! cria-t-il. Elle m’avait bien promis d’épier notre arrivée et de venir elle-même à notre rencontre. »
Minnetaki ! Un petit frisson nerveux courut sur la peau de Rod. Mille fois, Wabi, au cours des soirées passées devant le foyer de Mistress Drew, lui avait dépeint la jeune fille. Toujours il avait associé sa sœur à la conversation, aux projets ébauchés et, peu à peu, sans même s’en rendre compte, Roderick s’était épris d’un amour de rêve pour celle qu’il n’avait jamais vue.
Les deux jeunes gens et Mukoki la rejoignirent aussitôt, dans un canot du bord. Avec un petit cri de joie, et toute rieuse, Minnetaki se pencha vers son frère, pour l’embrasser. En même temps, ses yeux noirs jetèrent, vers celui dont elle avait tant ouï parler, un regard curieux.
Elle avait alors quinze ans et, comme à cet âge toutes les filles de sa race, elle était svelte et élancée, et avait, presque déjà, la taille d’une femme. D’une vraie femme elle avait, inconsciemment, la grâce et les gestes. Un flot de cheveux noirs, légèrement ondulés, encadrait un gentil minois que Rod estima, à part lui, être un des plus aguichants qu’il eût jamais rencontrés. Une lourde tresse retombait sur les épaules de Minnetaki, entrelacée de rouges feuilles automnales.
Elle se dressa dans son canot et sourit à Rod. Il se leva lui aussi, pour lui répondre avec politesse en retirant sa casquette, à la mode des gens civilisés. Un coup de vent, juste à cet instant, emporta la coiffure dans le lac.
Ce fut une explosion de rires, de la part des deux boys et de la jeune fille, et le vieil Indien ne se priva pas de les imiter.
La glace, dès lors, était rompue et, tout en riant au nez de Rod, Minnetaki poussa son canot vers la casquette qui flottait. Elle la repêcha et la tendit au jeune homme, du bout de sa rame.
« Pourquoi, dit-elle, vous couvrir ainsi la tête avant les grands froids ? Wabi en a l’habitude. Moi pas.
— Alors, moi non plus, je ne le ferai pas ! » répliqua Rod, galamment.
Et tous deux, parmi leurs rires, se mirent à rougir. Un équipement de chasse complet attendait le jeune blanc dans la chambre de Wabinosh-House qui lui avait été réservée : un fusil Remington, à cinq coups, d’aspect redoutable, tout pareil à celui de Wabi ; un revolver de gros calibre ; des raquettes à neige et une douzaine d’autres fourniments, indispensables à quiconque se prépare à entreprendre une longue expédition dans le Grand Désert Blanc. Rod, dès la première nuit, essaya son équipement.
Wabi avait pareillement préparé leur itinéraire sur une carte et délimité leur terrain de chasse. Les loups, sans cesse pourchassés dans les environs immédiats de la factorerie, y étaient devenus rares et prudents. Mais, à une centaine de milles au nord et à l’est, sur les terres à peu près vierges, ils pullulaient, exterminant sans relâche élans, rennes et caribous.
C’est là qu’il fallait aller, là que Wabi avait projeté d’établir ses quartiers d’hiver. Il était nécessaire de se mettre en route sans tarder et, au centre des pistes, après les avoir relevées, de bâtir en toute hâte, avant les grosses chutes de neige, la cabane de bûches où les chasseurs s’abriteraient durant les grands froids.
Il fut en conséquence décidé que les jeunes chasseurs, accompagnés de Mukoki, partiraient dans une semaine pour leur expédition.
Roderick employa de son mieux le temps qui lui restait à passer à Wabinosh-House et, tandis que Wabi suppléait, pour les affaires commerciales, à une courte absence de son père, il reçut de la jolie Minnetaki ses premières leçons de vie sauvage.
En canot, le fusil à la main, ou apprenant à lire en sa compagnie les signes mystérieux de la vie des forêts, le jeune homme était vis-à-vis d’elle en perpétuelle admiration.
Lorsqu’il la voyait se pencher sur une piste fraîche, toute palpitante, ses yeux étincelant soudain et luisant comme des braises, son abondante chevelure, emplie des chauds reflets du soleil, venant balayer le sol autour d’elle, elle semblait un adorable et vivant tableau, bien propre à soulever le cœur d’un jouvenceau de dix-huit ans. Cent fois, il prit le ciel à témoin que, de la pointe de ses jolis pieds, chaussés de mocassins, au faîte de sa tête, elle n’avait pas sa pareille en ce monde.
A maintes reprises, il fit part de son sentiment à Wabi, qui acquiesçait avec enthousiasme. Si bien que la semaine n’était pas encore achevée, et déjà Minnetaki et Rod étaient devenus d’inséparables camarades. Ce n’était pas sans quelques regrets que le jeune chasseur voyait poindre l’aurore du jour où il allait s’enfoncer plus avant dans le Grand Désert Blanc.
Minnetaki était d’ordinaire une des premières levées à Wabinosh-House. Mais Rod, le plus souvent, était debout avant elle encore. Certain matin, pourtant, il se trouvait en retard et, tandis qu’il s’habillait et procédait à sa toilette, il entendait, dehors, Minnetaki qui sifflait. Car la jeune fille savait siffler avec une perfection qui excitait son envie.
Lorsqu’il descendit de sa chambre et sortit, Minnetaki n’était plus là. Elle avait disparu dans la direction de la forêt. Il trouva simplement Wabi qui, en compagnie de Mukoki, était en train de lier par paquets provisions et équipements.
C’était un matin radieux, clair et froid, et Rod remarqua qu’une fine couche de glace s’était formée sur le lac, durant la nuit. Une ou deux fois, Wabi se tourna vers l’orée de la forêt et jeta vers elle un cri connu, à l’adresse de Minnetaki. Personne ne répondit.
« Je me demande, dit-il, tout en bouclant une courroie autour d’un ballot, pourquoi elle ne revient pas. Le déjeuner va être bientôt prêt. Rod, allez donc la chercher, voulez-vous ? »
Roderick ne se le fit pas dire deux fois. Rapidement il courut sur le petit sentier qu’il savait être la promenade habituelle de Minnetaki et qui, avant d’entrer sous bois, longeait tout d’abord la grève caillouteuse du lac. Il arriva ainsi à l’endroit où elle amarrait son canot de bouleau et il put constater qu’elle était certainement passée là, il n’y avait pas bien longtemps. La glace, en effet, avait été brisée autour de l’embarcation, que la jeune fille avait dégagée sur une longueur de quelques pieds.
De ce point, le sentier, où des traces de petits pieds avaient laissé leur empreinte, remontait la pente du rivage et gagnait la forêt.
Rod le suivit et, avant de s’engager sous les arbres, il cria, à plusieurs reprises :
« Holà, oh ! Minnetaki !… Minnetaki ! »
Il recommença encore, à appeler, cette fois de toute la force de ses poumons. L’écho resta muet.
L’inquiétude, et un vague pressentiment, mal formulé, lui firent reprendre sa course à travers la forêt, où se continuait l’étroit sentier.
Cinq minutes, dix minutes, il alla, puis appela de nouveau. Même silence. Alors il songea que peut-être la jeune fille avait pris un autre sentier et que lui-même était sans doute allé trop loin dans l’épaisse forêt. Il poursuivit cependant, quelques instants encore, et ne tarda pas à atteindre un endroit où un énorme tronc d’arbre, renversé au travers du sentier, avait lentement pourri et laissé sur le sol un humus mou, épais et noirâtre. Les mocassins de Minnetaki y étaient imprimés comme dans une cire.
Rod fit une pause et devint perplexe. Il écouta, sans faire de bruit ; mais le vent ne lui apporta aucun son particulier. Une seule chose était certaine, c’est qu’il se trouvait maintenant à plus d’un mille de la factorerie et que ni lui ni Minnetaki ne pourraient plus être rentrés pour l’heure coutumière du déjeuner. Malgré son tourment, il ne put s’empêcher, en examinant dans l’humus la marque des pieds de la jeune fille, d’admirer combien ils étaient menus. Il put aussi constater que les mocassins, à l’encontre de l’usage habituel, étaient munis de petits talons.
Il en était là de ses réflexions lorsqu’il sursauta brusquement. N’était-ce pas un cri qu’il venait d’entendre, assez loin devant lui ? Son cœur s’arrêta de battre, son sang devint brûlant et, dans la seconde même, il reprit sa course, avec la rapidité d’un renne.
Il ne tarda pas à atteindre une clairière, qu’un incendie avait trouée dans la forêt.
Au milieu de cette clairière, un spectacle s’offrait à lui, qui le glaça jusqu’à la moelle des os. Minnetaki était là, sa longue chevelure éparse sur ses épaules, les yeux bandés et la bouche bâillonnée, qui marchait dans le sentier, encadrée à droite et à gauche, de deux Indiens, qui l’entraînaient à toute vitesse.
Rod demeura, pendant un court instant, figé d’horreur. Mais rapidement il redevint maître de lui et chaque muscle de son corps se tendit vers l’action.
Depuis une semaine, il s’était exercé avec son revolver, qui maintenant ne le quittait pas. Il le sortit de l’étui. Mais lui était-il possible de tirer sur les deux coquins sans risquer d’atteindre Minnetaki ? La prudence lui interdisait de jouer un pareil risque. Une grosse branche se trouvait par terre, à portée de sa main. Il la ramassa, pour s’en faire un gourdin, et courut de l’avant. Le sol humide amortissait le bruit de ses pas.
Il n’était plus qu’à une douzaine de pieds du groupe tragique, lorsque Minnetaki, en un sursaut désespéré, tenta de se libérer. Un des Peaux-Rouges, dans l’effort qu’il fit pour la maintenir, se tourna à demi et vit le boy qui, plus furieux qu’un démon, fonçait, le gourdin levé. Un rugissement de Rod, un cri de l’Indien, qui avertissait son compagnon, et la bataille commença.
Déjà le gourdin de Rod s’était abattu, comme une massue, sur l’épaule du second Indien, qui s’écrasa sur le sol. Mais, avant que le jeune homme se fût remis en garde, son autre adversaire l’avait saisi par derrière, en une étouffante et mortelle étreinte.
L’attaque improvisée avait laissé libre Minnetaki, qui se hâta d’arracher le linge qui l’aveuglait et la bâillonnait. Plus prompte que l’éclair, elle s’adapta à la situation. Rod et son partenaire avaient roulé par terre et luttaient, en un terrible corps à corps. Le premier Indien, revenu de son étourdissement, commençait à se relever et se traînait vers les deux combattants, afin d’apporter son aide à son camarade.
Minnetaki comprit que c’était, pour son sauveteur, la mort assurée. Sa face blêmit et ses yeux se dilatèrent étrangement. Ramassant, dans un sanglot, le gourdin lâché par Roderick, elle le leva à son tour et, de toutes ses forces, en asséna un coup sur la tête du Peau-Rouge qui luttait avec Rod. Une fois, deux fois, trois fois, le bâton se leva et retomba, et l’homme desserra son étreinte. Le jeune boy, à demi étouffé, respira.
Le combat, pourtant, n’était pas terminé. L’autre Indien avait réussi à se remettre sur ses pieds et, comme la vaillante jeune fille levait, une quatrième fois, le gourdin, une poigne puissante la retint en arrière, et elle sentit qu’elle était prise à la gorge.
Le répit qu’elle avait procuré à Rod n’avait pas été inutile. Il avait pu atteindre l’étui de son revolver et prendre son arme. A bout portant, il pressa le coup sur la poitrine de son adversaire. Il y eut une sourde détonation, un cri de douleur, et l’Indien bascula à la renverse. Ce que voyant, le Peau-Rouge survivant relâcha Minnetaki et, sans demander son reste, déguerpit dans la forêt.
Minnetaki, toute brisée, tant par l’épouvante et l’angoisse que par l’effort surhumain accompli par elle, se laissa tomber sur le sol, comme une masse, en pleurant à chaudes larmes. Rod, s’oubliant lui-même, courut vers elle, lissa ses cheveux en désordre, et la rassura aussi bien qu’il pouvait le faire.
Wabi et Mukoki les retrouvèrent à la même place. Ils avaient perçu le cri d’attaque de Roderick et s’étaient aussitôt mis en route. D’autres cris, échappés à Minnetaki au cours de la bataille, avaient servi de point de repère à leur course. Deux autres employés de la factorerie, en tournée de ronde, ne tardèrent pas à les rejoindre.
L’homme mort fut reconnu pour être un des gens de Woonga. Minnetaki conta qu’elle était encore peu éloignée de Wabinosh-House et que son appel aurait pu être facilement entendu, si les deux Indiens, se jetant sur elle à l’improviste, ne l’avaient pas aussitôt bâillonnée. Par une ruse infernale, ils l’avaient contrainte ensuite à cheminer seule dans l’étroit sentier, chacun d’eux l’y maintenant, à bout de bras, et marchant, à droite et à gauche, sur la mousse. Ses uniques pas s’étaient imprimés sur le sentier, là où le terrain s’amollissait, et quiconque aurait suivi, comme le fit Rod, la piste de la jeune fille devait fatalement penser qu’elle n’avait aucun ennemi avec elle et se promenait en sécurité.
Cette tentative d’enlèvement, l’héroïque intervention de Roderick, la mort d’un des ravisseurs, causèrent à la factorerie une émotion considérable. Il était évident que Woonga en personne devait rôder aux alentours.
La douzaine de familles blanches, installées à Wabinosh-House, résolut d’organiser des battues à vingt milles à la ronde, ce rayon paraissant suffisant pour assurer la tranquillité future de Minnetaki et des autres jeunes filles. Quatre des plus habiles pisteurs de la colonie eurent pour fonction spéciale de relever les traces des hors-la-loi. Wabi, Rod et une vingtaine d’hommes passèrent des jours entiers à fouiller forêts et marais. Le départ des jeunes chasseurs se trouva, de ce fait, momentanément retardé.
Mais les Woongas avaient disparu aussi vite qu’ils s’étaient montrés. On reparla du départ. Pas avant, toutefois, que Minnetaki n’eût promis à Rod et à Wabi d’être désormais plus prudente et de ne plus s’aventurer seule dans la forêt.
Le 4 novembre, un lundi, Rod, Wabi et leur vieux guide Mukoki quittèrent enfin la factorerie et firent face aux aventures qui les attendaient dans le Grand Désert Blanc.
Le froid, maintenant, était devenu plus mordant. Lacs et rivières s’étaient pris profondément et la neige mettait sur le sol son mince premier voile.
Les jeunes chasseurs, qui se trouvaient en retard de deux semaines sur le plan primitif, gagnèrent, à marches forcées, avec leur compagnon, l’extrémité nord du Lac Nipigon et, au bout de six jours, atteignirent le fleuve Ombakika. Là, ils furent arrêtés par une violente tourmente de neige.
Un campement provisoire fut établi. Au cours de cette opération, Mukoki découvrit les premières traces de loups. Alors on décida de rester à cette place, un jour ou deux, afin de tâter le terrain.
Au cours du second jour, Rod et Wabi se séparant de Mukoki, résolurent d’entreprendre, jusqu’à la nuit, une grande tournée, pour explorer le pays un peu loin et à loisir, avant les grosses chutes de neige.
Le vieil Indien demeura seul au campement. Depuis six jours, nous l’avons dit, la petite troupe avait marché sans arrêt et sa seule nourriture avait été du lard fumé et de la venaison en conserve. Mukoki, dont le prodigieux appétit n’avait d’égal que l’habileté qu’il savait déployer pour le satisfaire, résolut d’améliorer le garde-manger, s’il était possible, en l’absence de ses amis.
Outre son fusil, il chargea sur ses épaules deux pièges à loups et partit pour une heure ou deux. Précautionneusement, il glissa le long du fleuve, les yeux et les oreilles alertés à tout gibier éventuel.
Soudain, il rencontra la carcasse gelée d’un cerf, à demi dévoré. Il était évident que la bête avait été tuée par les loups, ce jour même, ou la nuit précédente. Les traces de pattes, marquées dans la neige, firent conclure à l’Indien que quatre loups avaient pris part au meurtre et au festin. Il ne douta pas, avec sa vieille expérience de chasseur, que les loups ne dussent revenir, la nuit suivante, afin d’achever leur ripaille. Il en profita pour poser ses pièges et les recouvrit de trois ou quatre pouces de neige.
Reprenant son chemin, Mukoki découvrit la trace fraîche d’un renne. Pensant bien que l’animal ne couvrirait pas une bien grande distance dans la neige molle, il se mit à suivre sa piste, le plus rapidement qu’il put. Un demi-mille plus loin, il s’arrêtait brusquement, avec un grognement de surprise infinie. Un autre chasseur s’était, lui aussi, mis sur la piste de la bête !
Avec un redoublement de prudence, Mukoki continua à avancer. Deux cents pieds plus loin, une seconde paire de mocassins s’était jointe à la première et, un peu plus loin, une troisième.
Conduit plutôt par la curiosité que par l’espoir de trouver encore sa part de la proie, l’Indien allait toujours de l’avant, silencieux, parmi les arbres. Comme il sortait d’une pousse compacte de jeunes sapins, il fut régalé d’une nouvelle surprise, en trébuchant presque dans la carcasse du renne qu’il pistait.
Un bref examen lui apprit que l’animal avait été tué, il n’y avait pas plus de deux heures. Les trois chasseurs l’avaient éventré, lui enlevant le cœur et le foie, ainsi que la langue, et avaient sectionné et emporté tout le train de derrière, en laissant là le reste du corps et la peau. Pourquoi s’étaient-ils contentés de cette part minime du butin ?
Mukoki se reprit à examiner, au delà, les empreintes des mocassins. Il constata la hâte visible de pas pressés. Les chasseurs inconnus, après avoir prélevé les morceaux les plus délicats, n’avaient pas voulu s’attarder davantage et étaient repartis en courant.
Second objet d’étonnement, et nouveau grognement de l’Indien qui, revenant à la carcasse, dépouilla rapidement de sa peau le train de devant, y enveloppa le meilleur de la chair restante, et, ainsi chargé, s’en retourna au campement.
Rod et Wabi n’étaient pas encore revenus. Il construisit à loisir un grand feu, installa devant, sur une broche, un morceau de rôti, et attendit. Il attendit longuement et la nuit s’était enténébrée depuis longtemps que les deux boys n’avaient pas encore reparu.
L’anxiété s’était emparée de Mukoki et il commençait à craindre un irréparable malheur, lorsqu’il entendit l’appel de Wabi. Il courut, et trouva celui-ci tenant dans ses bras, comme nous l’avons conté au premier chapitre, Rod presque inanimé.
Le blessé fut aussitôt transporté au campement. Lorsque seulement il fut installé dans des couvertures, sous la hutte de branchages, en face du feu joyeux qui le ranimait, Wabi commença à donner quelques explications au vieil Indien.
« Je crains fort, dit-il, qu’il n’ait un bras cassé. Muki, as-tu de l’eau chaude ?
— Est-ce un coup de fusil qu’il a reçu ? » interrogea Mukoki, sans répondre à la demande qui lui était faite.
Et il s’agenouilla à côté de Rod, ses longs doigts bruns se tendant vers le jeune homme.
« Un coup de fusil ? » répéta-t-il.
Wabi secoua la tête.
« Non ! Un coup de gourdin. Nous avons rencontré trois Indiens qui campaient. Ils nous ont invités à partager leur repas. Tandis que nous mangions, sans défiance, ils nous ont attaqués par derrière. Rod a attrapé ce coup et il a, en outre, perdu son fusil. »
Déjà Mukoki avait déshabillé le boy et l’examinait. Le bras gauche était très enflé et presque noir. Du même côté, un peu au-dessus de la taille, une large meurtrissure était apparente. Le vieux guide était un chirurgien de fortune, mais non sans habileté, comme on en trouve dans le Grand Désert Blanc, où l’on n’a d’autre maître que l’observation de la nature. Il établit son diagnostic en pinçant et pressant la chair, en appuyant sur les os, tant et si bien que Rod se mit à pousser les hauts cris. Mais l’examen avait été favorable.
« Pas d’os brisé ! finit par s’exclamer triomphalement Mukoki. Ici (et il désignait la meurtrissure) la plus grande blessure. Presque une côte cassée. Mais pas tout à fait. Ce coup-là avoir coupé à lui la respiration et rendu lui si malade. A besoin d’un bon souper, de café chaud, et le frotter avec graisse d’ours. Alors lui aller mieux. »
Rod, les yeux encore mi-clos, sourit faiblement et Wabi eut un soupir de soulagement.
« Voyez, Rod, dit-il, il y a moins de mal que nous ne pensions. Vous ne donnerez pas tort à Muki. S’il affirme que le bras n’est pas brisé, c’est qu’il ne l’est pas, voilà tout. Laissez-moi vous border dans vos couvertures. Puis hâtons-nous de souper. Ce sera pour vos souffrances la meilleure panacée. Je sens le fumet de la viande. Et de viande fraîche ! »
Mukoki avait sauté sur ses pieds, avec un gloussement de joie, et était retourné en hâte à son rôti. Déjà celui-ci avait pris une belle couleur dorée et le jus qui coulait emplissait les narines de son appétissant fumet. Wabi, selon les prescriptions du vieil Indien, s’occupa à bander les parties blessées du corps de son ami.
A peine avait-il terminé que le festin était prêt. Il apporta à Rod une part de rôti, copieusement servie et accompagnée d’un gâteau de farine de blé, ainsi que d’une tasse de café fumant. Rod se prit gaiement à rire.
« Je suis honteux de me faire servir ainsi, dit-il. Quel tracas je vous donne à tous les deux, tel qu’un gosse impuissant. Et dire que, pour m’excuser, je n’ai même pas le prétexte d’un bras cassé ! En réalité, j’ai une faim d’ours. J’ai manqué de courage, n’est-ce pas Wabi ? Et j’ai pris peur, comme si j’allais mourir ! J’en arrive à regretter que mon bras ne soit pas réellement brisé. »
Mukoki était occupé avec un gros morceau de viande grasse, dans laquelle il avait enfoui ses dents. Il s’arrêta de manger, la figure luisante, et, d’une voix à demi-étouffée :
« Oui, il faut lui beaucoup malade ! Encore beaucoup malade, énormément malade ! Lui plus malade qu’il ne croit…
— C’est cela même, cria Wabi. Excellente chose, la maladie ! »
Et la gaieté commune se répercuta au loin, en grands éclats de rire.
Mais, brusquement, le jeune homme redevint sérieux. Il jeta un regard soupçonneux vers les ténèbres, au delà du cercle de lumière du feu.
« Supposez-vous, interrogea Rod, qu’ils soient capables de nous pourchasser jusqu’ici ? »
Wabi, pour toute réponse, mit un doigt sur sa bouche et les voix baissèrent de ton, prudemment.
Puis Wabi raconta au vieux guide les événements de la journée. Il redit comment, en pleine forêt, à plusieurs milles au delà du lac, Rod et lui avaient accepté d’être les convives des trois Indiens, et l’attaque traîtresse dont ils avaient ensuite été victimes. L’agression avait été si prompte et si imprévue qu’un des Indiens avait pu, dès l’abord, et sans être inquiété, s’enfuir avec le fusil de Rod, sa cartouchière et son revolver. Au cours du combat qui suivit, Wabi avait été terrassé par les deux autres hommes, et c’est en lui portant secours que Rod avait été frappé de deux coups violents, soit par un gourdin, soit par une crosse de fusil. Le but des assaillants était de s’emparer du fusil de Wabi, comme ils l’avaient fait de celui de Rod. Mais le boy avait tenu bon et rien n’avait pu lui faire lâcher son arme. Ce que voyant, et après une courte lutte, les deux Indiens s’étaient rapidement défilés dans les taillis, se contentant de leur première prise.
« Ce sont, je pense, des gens de Woonga, conclut Wabi. Mais je me demande pourquoi ils n’ont pas commencé par nous tuer, ce qui leur eût été facile. Ils ne semblaient pas y tenir autrement ! Peut-être craignaient-ils des représailles des nôtres… »
Wabi se tut et ses yeux reflétèrent le doute qui était en lui.
Ce fut alors au tour de Mukoki de narrer ce qui lui était à lui-même advenu et l’abandon, par des chasseurs inconnus, d’une partie du renne qu’ils avaient tué.
« Cela aussi est curieux, dit Wabi. Je ne crois pas qu’il s’agisse des mêmes Indiens que ceux rencontrés par nous. Mais je parierais qu’ils appartiennent à la même bande. Woonga doit avoir, dans ses parages, une de ses retraites coutumières. Nous sommes tombés dans le guêpier. Le mieux qui nous reste à faire est de décamper le plus tôt possible de cette région.
— Nous ferions de jolies pipes de tir ! » approuva Rod.
Placés tout d’abord, en effet, dans le cône d’ombre de la montagne, ils étaient maintenant, la lune ayant tourné dans le ciel, en plein dans la lumière de l’astre nocturne, tandis que l’autre rive du fleuve s’était au contraire enténébrée.
Un léger bruit se fit entendre, sur ces entrefaites, comme si quelqu’un avait frôlé extérieurement les ramures de la hutte. Il fut suivi d’un reniflement étrange, puis d’un sourd gémissement.
« Silence et écoutez ! » ordonna Wabi d’une voix blanche.
Et il écarta des branches de sapin, afin d’y pratiquer une étroite ouverture, à travers laquelle il coula sa tête.
« Holà, Loup ! murmura-t-il, imperceptiblement. Qu’y a-t-il donc ? »
A quelques pieds de la hutte, près d’un buisson, un animal efflanqué était attaché, qui ressemblait vaguement à un chien. Il était droit, sur ses pattes raides, et les oreilles en arrêt.
En l’examinant bien, on reconnaissait que ce n’était pas un chien, mais un loup adulte, un loup authentique. Capturé jeune, il avait reçu l’éducation d’un vrai chien, mais l’instinct sauvage ne l’avait jamais quitté. Que se rompît le lien qui l’attachait, que son collier lui glissât du cou, et Loup n’aurait fait qu’un bond dans la forêt, afin de rejoindre à jamais les hordes de ses frères.
Pour le quart d’heure, Loup était là, tirant sur sa corde, la gueule entr’ouverte, levée en l’air, écoutant, et des râles intermittents dans la gorge.
« Il se passe assurément quelque chose non loin de nous, dit Wabi, en rentrant sa tête dans la hutte. Qu’en penses-tu, Muki ? »
Un long et lugubre hurlement du loup captif lui coupa la parole.
Mukoki s’était levé, avec l’agilité d’un chat, et, son fusil à la main, se glissa dehors. Roderick, sans s’effrayer, resta couché et Wabi, avec l’autre fusil, suivit Mukoki.
« Restez-là, dans vos couvertures, dit-il à voix basse. Votre lit est dans l’ombre et un coup de feu ne peut vous y atteindre. Ce n’est sans doute qu’une bête quelconque, qui est tombée par hasard sur notre campement. La prudence commande cependant de s’en assurer. »
Dix minutes après, Wabi reparut.
« Fausse alerte ! dit-il en riant gaiement. C’est la première carcasse, rencontrée hier par Muki, qui a, comme il le supposait, ramené à la curée un certain nombre de loups. Loup a senti ses frères et de là vient son émoi. Les pièges posés par Muki nous fourniront, sans doute, notre premier scalp.
— Et où est Muki ?
— Pour plus de sécurité, il monte la garde, dehors, et le fera jusqu’à minuit. Ensuite j’irai le relayer. Il faut se défier des Woongas. »
Rod se retourna, non sans efforts, sur sa couche.
« Et demain ? interrogea-t-il.
— Demain, nous nous en irons ailleurs, cher ami. Si du moins vous êtes en état de voyager… Pendant deux ou trois jours encore nous remonterons le cours de l’Ombakika, et seulement alors nous établirons un campement un peu moins provisoire. Vous pourrez, dès le point du jour, vous mettre en marche dans cette direction, avec Muki.
— Et vous ? fit Rod alarmé.
— Oh ! moi, je reviendrai d’abord en arrière et j’irai ramasser les scalps des loups que nous avons tués. Il y a là pour un mois de vos appointements ! Maintenant, tournons-nous dans nos lits. Bonne nuit, Rod, et dormez à poings fermés ! Il faudra, demain, vous éveiller de bonne heure. »
Les deux boys, épuisés par les événements de cette longue et dramatique journée, ne tardèrent pas à s’endormir profondément. Et, lorsque minuit sonna, le fidèle Mukoki se garda bien d’éveiller Wabi, pour qu’il vînt prendre son tour de garde. Il laissa les heures succéder aux heures et ne se départit point un instant de sa surveillance. Puis, aux premières lueurs du jour, il attisa la flamme du foyer, jusqu’à ce qu’elle fût ranimée, et, recueillant les braises ardentes, il se mit en devoir de préparer le déjeuner.
Wabi, lorsqu’il s’éveilla, le surprit accroupi dans cette opération.
« Je n’aurais jamais pensé, dit-il, et sa bonne figure se prit à rougir d’un peu de honte, que tu me jouerais un pareil tour, Muki ! Ta gentillesse est extrême, mais quand renonceras-tu, mon vieil ami, à me traiter en petit garçon ? »
Sa main se posa affectueusement sur l’épaule de Mukoki et le vieux chasseur, tournant vers lui la tête, le regarda, tout heureux. Une grimace de satisfaction se dessina sur sa rude figure ridée, ravagée par les intempéries, et tannée comme un cuir par les longues années vécues dans le Grand Désert Blanc. Le premier, il avait, sur ses épaules, promené le petit Wabi à travers bois et forêts. Il l’avait fait jouer et en avait pris soin, lorsqu’il n’était encore qu’un enfantelet, et il l’avait initié aux mœurs du Désert. Lorsque Wabi avait été envoyé au collège, nul autant que le vieil Indien, sinon la petite Minnetaki, n’avait souffert de cette séparation. Pour les deux enfants, il était comme un second père, un gardien à la fois et un camarade, attentif et muet. Le contact de la main de Wabi fut pour lui une ample récompense de sa longue veillée et il exprima sa joie par deux ou trois grognements caverneux.
« Vous avoir eu, dit-il, mauvaise journée. Beaucoup fatigué. Moi me porter bien. Veiller, pour moi, meilleur que dormir ! »
Il se redressa sur ses jambes et tendit à Wabi la longue fourchette avec laquelle il triturait la viande sur les broches.
« Occupez-vous de cela, ajouta-t-il. Moi aller voir les pièges. »
Rod s’était éveillé, lui aussi. Il avait entendu la fin de la conversation. De la hutte, il cria :
« Attends-moi une minute, Mukoki. Je t’accompagne. Si tu as pris un loup, je veux le voir.
— Sûrement que j’en ai pris un », ricana Mukoki.
Roderick ne tarda pas à se présenter, complètement habillé et avec une bien meilleure mine que lorsqu’il s’était couché. Il s’étira devant le feu, étendit un bras, puis l’autre, esquissa une grimace de douleur, et annonça à ses compagnons qu’il se sentait aussi dispos que jamais, sauf la souffrance qu’il éprouvait au bras gauche et qui était encore vive. Bref, il se retrouvait à peu près lui-même, comme dit Wabi.
Il partit donc, en compagnie de Mukoki, le long du fleuve, en marchant avec lenteur et précaution. La matinée était grise et morne, et de temps à autre voltigeaient de gros flocons de neige, preuve certaine qu’avant la fin de la journée une nouvelle tourmente neigeuse aurait lieu.
Les pièges de Mukoki étaient peu éloignés et un formidable grognement de contentement ne tarda pas à s’échapper de la poitrine de l’Indien, qui pressa le pas.
Rod l’eut bientôt rejoint. Devant lui une masse noire gisait sur la neige.
« Lui ! » s’exclama l’Indien.
En les voyant arriver, la masse noire s’était animée. Elle se démenait et haletait, en des spasmes d’agonie.
Mukoki examina sa prise.
« Louve ! » expliqua-t-il.
Il prit dans sa main la hache qu’il avait apportée avec lui et s’approcha de l’animal étalé devant lui.
Rod put constater que l’une des grosses pinces d’acier avait happé la bête par une patte de devant, et que la seconde avait enfoncé ses dents dans une patte de derrière. Appréhendé ainsi, le captif ne pouvait rien pour se défendre et il gisait dans un calme sombre, découvrant l’éclat luisant de ses dents blanches, silencieux et apeuré. Ses yeux brillaient, de souffrance fiévreuse et de fureur impuissante, et lorsque l’Indien leva le bras pour frapper, il fut secoué d’un tremblement d’angoisse.
C’était un cruel spectacle et Rod eût senti la pitié monter en lui, s’il ne se fût souvenu, à ce moment, du danger qu’il avait couru la veille et de sa fuite précipitée devant la bande de loups.
En deux ou trois coups rapides, Mukoki acheva l’animal. Puis, avec une habileté spéciale à sa race, il tira son couteau et sectionna lestement la peau, tout autour de la tête de la louve, en passant juste au-dessous des oreilles. Une petite secousse de haut en bas, une autre de bas en haut, une à droite et une à gauche, et le scalp se détacha.
Ce fut si dextrement fait que, sans réfléchir à ce qu’il disait, Rod ne put s’empêcher de s’exclamer :
« Est-ce ainsi, Muki, que tu scalpes les gens ? »
Le vieil Indien leva les yeux vers lui, le regarda pendant un instant, et il ouvrit toute grande sa mâchoire. Quelque chose en jaillit, qui était ce que Rod avait encore entendu, chez Mukoki, de plus proche du rire, tel du moins que le pratiquent les autres hommes. Lorsque Mukoki, en effet, voulait rire, il émettait d’ordinaire un son innomé, une sorte de gloussement, que ni Rod, ni Wabi n’eussent été capables d’imiter, quand ils s’y seraient évertués un mois durant. Mais, cette fois, sa rate se dilatait en plein.
« Jamais scalpé blancs ! Mon père avoir fait cela quand il était jeune. Jamais plus depuis. Moi, jamais ! »
Et le rire, lui rentrant dans la gorge, retourna au gloussement coutumier, qui durait encore lorsque les deux compagnons atteignirent le campement.
Dix minutes, pas plus, furent consacrées à la préparation et à l’absorption d’un déjeuner léger. La neige commençait à tomber sérieusement et, en se mettant immédiatement en route, ils étaient assurés que leurs traces seraient bientôt oblitérées. C’était ce qui pouvait leur arriver de mieux, quant à la poursuite possible des Woongas. Il n’y avait pas à craindre, d’autre part, que Wabi ne pût les rejoindre, puisqu’il avait été convenu qu’ils ne cesseraient de suivre le cours glacé de l’Ombakika. Il les aurait rattrapés avant la chute de la nuit.
Wabi, en effet, n’avait pas, de son côté, perdu de temps. Armé de son fusil, de son revolver et de son couteau de chasse, une hache à la ceinture, il avait gagné l’extrémité du lac, là où s’était déroulé, dans les mélèzes, le duel inégal entre le vieil élan et les loups. Il en trouva le dénouement un peu plus loin, sur la neige, où étaient épars les débris d’un grand squelette, près d’une paire énorme de cornes.
Debout sur ce champ de bataille prodigieux, Wabi eût beaucoup donné pour avoir Rod à le contempler avec lui. Du vieil élan héroïque, ces quelques os étaient tout ce qui restait. Mais la tête et les cornes qui la surmontaient étaient intacts. C’étaient les bois les plus magnifiques que le jeune homme eût jamais trouvés dans le Grand Désert Blanc. Et la pensée lui vint que si ce splendide trophée pouvait être conservé, puis rapporté plus tard en pays civilisé, il lui serait payé cent dollars, si ce n’est plus.
Il était loisible de voir que la lutte avait été chaude. Près du squelette de l’élan était une carcasse de loup, à demi dévorée par les autres loups, et quinze pieds plus loin, il y en avait une seconde, dans le même état. Les deux têtes étaient entières et Wabi les scalpa. Puis il continua la piste.
Là où il se souvenait avoir tiré ses deux dernières cartouches, deux autres carcasses gisaient. A l’orée du bois de mélèzes, il en découvrit une troisième. Sans doute ce dernier loup avait-il été, dans la journée, blessé par lui ou par Rod, et était-il venu mourir en cet endroit, achevé vraisemblablement par ses frères. Un demi-mille au delà, là où la fusillade avait battu son plein, une sixième et une septième carcasse complétaient la collection. Il prit tous ces scalps et s’en revint vers les restes du vieil élan.
La tête de l’animal avait reçu de nombreux coups de dents. Mais, comme il s’y trouve peu de chair, les loups ne s’y étaient pas acharnés davantage. La peau, aux endroits où elle était endommagée, pouvait être recousue habilement et reprisée. Les Indiens de la factorerie excellaient à ce genre de travail.
Mais comment conserver cette tête jusqu’au retour, c’est-à-dire dans plusieurs mois ? Si Wabi la suspendait à une branche d’arbre, il y avait à craindre que les premiers jours tièdes du printemps futur ne la corrompissent. Un autre risque était qu’elle ne fût volée par quelque autre chasseur, qui viendrait à passer.
Wabi n’ignorait pas que les Indiens ont coutume de garder, fort longtemps parfois, dans ce qu’ils appellent des « trous de glace », des têtes gelées de caribous et d’élans. Il était préférable de prendre modèle sur eux. Il traîna donc, non sans peine, l’énorme tête et ses ramures au plus touffu du bois de mélèzes, là où pénétraient rarement les rayons du soleil, et, prenant sa hache, il se mit au travail.
Durant une heure et demie, il brisa sans relâche la terre glacée et y pratiqua une fosse suffisante pour recevoir son précieux trophée. Il tassa au fond, avec ses pieds et avec la crosse de son fusil, une bonne couche de neige. Puis, ayant posé dessus la tête monstrueuse, il remplit la fosse avec de la terre, dont il brisa les mottes, le mieux qu’il put. Il termina l’opération en recouvrant et dissimulant le tout sous une dernière couche neigeuse, écota deux arbres voisins, d’un coup de hache, et reprit le chemin du campement.
« Ce sol, se disait-il à lui-même tout en marchant, ne dégèlera pas avant juin. Sept scalps de loups, à quinze dollars, font cent cinq dollars. Et cent dollars pour la tête, font deux cent cinq au total. C’est, en chiffres ronds, soixante-dix dollars pour chacun de nous trois. Hé, hé ! mon vieux Rod, cela constitue, en vingt-quatre heures, un gain honorable ! »
Cette excursion en arrière avait duré trois heures. La neige floconnait abondamment lorsque Wabi retrouva le campement abandonné et la piste déjà à demi recouverte, laissée derrière eux par Roderick et par Mukoki, celui-ci tirant le petit toboggan sur lequel était chargé le bagage commun.
Courbant la tête sous la blanche et silencieuse avalanche, le boy entreprit de rejoindre au plus vite ses deux compagnons. Si épaisse était la rafale qu’il ne pouvait voir à dix arbres devant lui. La rive opposée du fleuve avait complètement disparu. Temps fait à souhait, pensait-il, pour fuir les Woongas !
Pendant deux heures, il alla de la sorte, infatigable. La trace des pas de ceux qui le précédaient, et dont la marche était plus lente que la sienne, apparaissait de plus en plus fraîche. Preuve évidente qu’il gagnait sur eux. Il fallait, à vrai dire, qu’il connût que ces pas étaient des pas d’hommes. Car la neige les brouillait si bien qu’un étranger aurait pareillement pu croire qu’un élan ou un caribou les avait marqués.
Après la troisième heure, et pensant avoir parcouru au moins dix milles, Wabi s’assit pour se reposer un peu et restaurer ses forces, en mangeant les provisions dont, le matin, il s’était muni. L’endurance de Rod le surprenait. Il estimait que trois ou quatre milles le séparaient encore de Mukoki et du jeune blanc, à moins qu’eux aussi eussent fait halte pour manger. Cette supposition était très probable.
La solitude était, autour de lui, immensément calme. Rien ne troublait le silence. Pas même ne résonnait le gazouillement d’un oiseau-de-la-neige[5].
[5] Snow bird. Espèce de gélinotte ou de poule sauvage. (Note des Traducteurs.)
Assez longtemps, il demeura ainsi, aussi immobile que la souche d’arbre sur laquelle il était assis. Il délassait ses jambes et écoutait. Ce silence exerçait sur lui une fascination étrange. On eût dit que le monde entier s’était évanoui, que même les hôtes sauvages de la forêt n’osaient sortir de leur retraite, à cette heure où le ciel semait, comme avec une main, les blancs flocons inépuisables, dont sans doute, jusqu’à la Baie d’Hudson, le manteau couvrait la terre.
Comme Wabi était là, prêtant l’oreille à ce mutisme universel, un bruit, tout à coup, claqua dans l’air, qui arracha à ses lèvres un cri inarticulé. C’était la détonation, claire et retentissante, d’un fusil. Une autre suivit, puis une autre encore, et une troisième. Coup sur coup, il en compta cinq, successivement.
Que signifiait ceci ? Il sauta sur ses pieds, le cœur battant. La détonation ressemblait à celle du fusil de Mukoki. Et pourtant le vieil Indien n’aurait pas tiré sur du gibier ! Cela avait été expressément convenu.
Rod et Mukoki avaient-ils été attaqués ? L’instant n’était point aux réflexions superflues et Wabi reprit sa course.
Si ses compagnons étaient en danger, il comprenait qu’il n’avait pas une minute à perdre. Mais sans doute arriverait-il trop tard. Aux cinq coups tirés avait succédé à nouveau l’absolu silence, et c’était pour lui une angoisse de plus. S’il y avait eu embuscade, tout maintenant devait être fini. Et, tandis qu’il courait, aveuglé par la neige, le doigt en arrêt sur la gâchette de son fusil, prêt à tirer, il épiait si d’autres bruits de la bataille ne parviendraient pas jusqu’à lui, coups de fusil ou de revolver, ou chant de triomphe du vainqueur.
Il arriva à un endroit où la vallée s’étranglait au point que l’Ombakika gelé, qui n’était plus maintenant qu’un simple torrent, disparaissait complètement sous de grands cèdres, serrés et touffus, qui rejoignaient leurs branches au-dessus de lui.
L’étroitesse de ce couloir rocheux augmentait son aspect sinistre de l’obscurité des cèdres qui s’y tassaient et de la grise pâleur crépusculaire du ciel du Nord où, déjà, en novembre, se mourait le jour.
Instinctivement, avant de s’engager dans ce traquenard, Wabi s’arrêta, pour mieux écouter.
Il n’entendit rien que les battements de son cœur, qui frappait contre sa poitrine, comme un marteau. Ce n’était point la peur qui le retenait, puisque nul danger ne se manifestait, mais l’incertitude même de ce danger, inconnu et possible.
D’un mouvement instinctif et irraisonné, comme l’eût fait un animal, il s’aplatit le ventre sur le sol, pareil à un loup à l’affût, qui cherche à se rendre invisible. Le canon de son fusil était fébrilement braqué vers l’étranglement obscur et mystérieux. A pas de loup aussi, lentement, le péril n’approchait-il pas ? Et, davantage encore, il s’écrasa dans la neige.
Les minutes succédaient aux minutes. Il n’entendait toujours rien. Puis, soudain, résonna, comme un indubitable avertissement, le babillage d’un oiseau-des-élans[6]. Peut-être était-ce simplement un renard errant qui avait dérangé l’oiseau et lui avait fait prendre son vol, ou un renne, ou un caribou, ou un élan même qui l’avaient effrayé. Mais ce chant, aux notes douces et rapides, pouvait aussi, et Wabi ne douta point que ce ne fût le cas, annoncer l’homme !
[6] Moose bird. Ces oiseaux ont l’habitude de venir, lorsque les élans sont au repos, se poser sur leur dos et débarrasser ces animaux de leurs parasites, comme font chez nous les sansonnets avec les bœufs et les moutons. (Note des Traducteurs.)
Reprenant son sang-froid, Wabi se releva cependant et s’engagea sous les cèdres, le long du torrent gelé. Il traversa leur ombre sans encombre, avec d’infinies précautions, et observa, caché derrière une souche, l’espace découvert qui s’étendait au delà. La neige tombait un peu moins serré et son regard percevait les objets assez loin devant lui.
Son émotion était à son comble. Le caquetage d’un écureuil rouge, en partant à l’improviste, tout près de lui, le fit sursauter. Un peu plus outre, il pensa entendre un frottement, dans l’ombre, comme si un fusil avait accidentellement raclé une branche d’arbre.
Tout à coup, il crut apercevoir deux ombres, à peine distinctes, qui émergeaient des ténèbres. De l’une de ses mains, gantées de mitaines, il s’essuya les yeux, humides de la neige qui lui fondait sur le visage, et regarda fixement, avec acuité. Aucun doute, cette fois, n’était possible. Les deux ombres qui avaient fait s’envoler l’oiseau-des-élans approchaient, silencieuses.
Leur silhouette ne tarda pas à se dessiner plus nettement. Il reconnut que c’étaient deux hommes. Ils avançaient avec une précaution extrême, mètre par mètre, rampant à demi sur le sol, comme lui-même tout à l’heure, et semblant s’attendre pareillement à rencontrer un ennemi. Wabi amena son fusil à hauteur de son épaule. Il n’avait pas été vu et la chance était pour lui. Il tenait les deux ombres au bout de son fusil. La mort hésitante dépendait d’une pression de son doigt sur la gâchette.
Son imagination affolée lui dépeignait Rod et Mukoki tombés dans une embuscade et assassinés par les deux Woongas (car il ne doutait plus de l’identité des deux ombres), qui maintenant revenaient en arrière sur la piste, afin de le massacrer lui-même. Oui, oui, c’était bien cela… Et son doigt, imperceptiblement, commençait à presser la détente.
Il allait tirer, lorsque les deux ombres qui n’étaient plus qu’à une vingtaine de yards s’arrêtèrent et, se rapprochant l’une de l’autre, semblèrent se concerter. Wabi rabaissa son fusil et tendit l’oreille, afin d’écouter ce qu’elles disaient.
Les ombres se parlaient à voix basse. Mais tel était le silence que le marmottement de leurs paroles parvenait jusqu’à lui. A un moment, le ton d’une des voix se haussa légèrement, et il entendit :
« All right ! »
Ce n’était certes pas un Woonga qui s’exprimait ainsi. L’inflexion était très pure.
Alors, à son tour, il appela doucement :
« Rod, est-ce vous ? Ho ! Muki… Rod… Muki ! »
Une seconde après, les trois amis étaient réunis, se serrant la main, en silence, à se la briser. La pâleur mortelle de Rod, la tension des traits bronzés de Wabi et de Mukoki disaient suffisamment l’angoisse mutuelle qui venait de les étreindre.
« Vous, tout à l’heure, tirer ? murmura Mukoki.
— Non, je n’ai pas tiré, répondit Wabi, dont les yeux se dilataient d’étonnement. Et vous ?
— Non ! »
Ce seul mot tomba des lèvres du vieil Indien. Mais il contenait en soi tout un monde d’interrogations et d’inquiétudes nouvelles. Les cinq coups de fusil, qui donc les avait tirés ?
Rod et Mukoki avaient supposé que c’était Wabi, comme lui-même avait cru que c’était eux, et ils étaient revenus au-devant de lui, afin de lui porter secours, s’il était nécessaire.
« Moi penser, dit Mukoki, l’ennemi être embusqué là ! »
Et il désigna du doigt le bois de cèdre. Wabi se contenta de secouer la tête.
Ne sachant que conclure, ils demeuraient tous trois à la même place. Un unique cri de loup se fit entendre, à un demi-mille environ vers l’arrière.
« L’animal, dit Wabi, a dû rencontrer une piste d’hommes. Je ne pense pas que ce soit la mienne, car la direction du son n’y est pas. »
Aucun autre bruit ne rompit plus, ensuite, le calme de la nuit tombante. Mukoki se remit en marche et les deux boys le suivirent.
Ils allèrent ainsi, durant un quart de mille. La vallée s’étranglait de plus en plus et le lit glacé du torrent s’était engagé entre de grandes masses de rochers, qui s’amoncelaient en de farouches entassements et formaient comme autant de montagnes escarpées. Il disparaissait peu après entre ces rocs cyclopéens et plongeait sous terre. Il n’y avait pas moyen de passer outre.
Abandonnant le fond de la vallée, les trois compagnons grimpèrent, parmi des blocs erratiques, jusqu’à une crête où, sous l’abri d’un gros rocher, excellente protection contre le vent, qui soufflait à l’opposé, et contre la neige, les restes d’un feu brûlaient encore.
C’était à ce point que s’étaient arrêtés Rod et Mukoki, lorsqu’ils avaient rebroussé vers Wabi, à la suite des cinq mystérieuses détonations.
L’endroit était confortable à souhait et idéal pour camper, après la marche du jour, si fatigante dans la neige molle. Mukoki avait déjà disposé une odorante paroi de ramures de sapin et, près du feu, un gros morceau de venaison, tout embroché, avait été abandonné par le vieil Indien, dans la précipitation de l’alerte.
Les deux boys semblaient ravis et se regardaient, tout heureux, malgré le danger immanent qui pesait sur eux. Ils s’apprêtaient à s’installer pour la nuit dans leur home et commençaient à attiser le foyer. Mais, ayant levé les yeux vers Mukoki, ils furent surpris de son attitude.
Dans une désapprobation muette de la besogne à laquelle ils se livraient, le vieux guide était demeuré debout, appuyé sur son fusil, sans un mouvement.
Wabi, un genou en terre, l’interrogea du regard.
« Pas faire de feu, murmura le vieil Indien en secouant la tête. Pas rester ici. Continuer au-dessus de la montagne. »
Et il tendit son long bras vers le nord.
« Fleuve, dit-il, contourner montagne à travers rochers, puis faire cascades et après grands marais, bon refuge aux élans. Ensuite devenir large et uni à nouveau. Nous, passer par-dessus montagne. Neiger toute la nuit. Matin venir et point de piste pour Woongas. Si rester ici, faire belle piste au matin. Woongas suivre comme diables. Très clair à voir ! »
Wabi se redressa et un amer désappointement se marqua sur son visage. Depuis le matin, de bonne heure, il avait marché, couru même, plus d’une fois. Il ressentait une fatigue suffisante pour risquer, sans regrets, un peu de péril, afin de pouvoir souper et dormir.
Le cas de Rod était pire encore que le sien, quoique sa course eût été moindre. Pendant quelques instants, les deux boys se dévisagèrent, silencieux et tout marris, s’essayant à dissimuler de leur mieux le dépit qu’ils ressentaient de la suggestion de Mukoki. Mais Wabi était trop raisonnable pour s’opposer délibérément à l’avis du vieil Indien. Si celui-ci affirmait qu’il était dangereux de passer la nuit en ce gîte, eh bien ! il fallait l’en croire et dire non eût été folie.
Alors, avec une figure mi-contrite, mi-riante, et réconfortant de son mieux Rod qui en avait grand besoin, Wabi commença à réajuster sur ses épaules son paquet, qu’il avait, en arrivant, jeté sur le sol. Mukoki, de son côté, encourageait le pauvre boy.
« Grimper montagne. Pas très loin marcher. Deux ou trois milles. Aller lentement. Alors campement et bon souper. »
Les quelques bagages qui avaient été déchargés furent réemballés sur le toboggan et les trois compagnons reprirent leur course, se traçant une nouvelle piste sur la cime pittoresque et sauvage de la montagne.
Wabi marchait devant, portant son paquet, ce qui allégeait d’autant le traîneau, et choisissant, pour que passât celui-ci, les meilleurs endroits. Du tranchant de sa hache, il rognait les buissons et les arbrisseaux importuns.
A une douzaine de pieds derrière lui suivait Mukoki tirant le toboggan, auquel Loup était solidement attaché avec une babiche[7]. Roderick, chargé d’un léger paquet, fermait la marche.
[7] Lanière très solide, faite avec de la peau d’élan ou de caribou. (Note des Traducteurs.)
Il était à bout de forces et complètement démoralisé. C’est à peine si, dans les ténèbres, il pouvait, de temps à autre, distinguer de Wabi une silhouette fugitive. Mukoki, plié en deux sous son harnais, n’était guère plus perceptible. Seul, Loup était assez près de lui pour servir de société.
L’enthousiasme du départ avait été long à se refroidir. Mais maintenant, en cette nuit lamentable, la pensée de Rod se reportait à Wabinosh-House, où il souhaitait mentalement d’être encore à côté de Minnetaki lui contant, sur une bête ou un oiseau rencontrés dans la journée, quelque jolie légende. Combien cet entretien aurait eu plus de charme que la situation présente !
Mais la vision de la petite vierge ensorceleuse, où se noyait son rêve, fut soudainement interrompue, de façon désagréable. Mukoki s’étant, pour souffler, un instant arrêté, Roderick n’y prit point garde et continua à avancer. Si bien qu’il vint se jeter dans le traîneau et s’y étala de tout son long. En voulant se retenir, il empoigna le harnais de l’Indien qui, ne s’attendant pas à cette brusque secousse, perdit l’équilibre et culbuta à son tour, par-dessus lui.
Wabi, entendant du bruit, vint voir ce qui advenait et les trouva tous deux dans cette posture comique. Ce fut un heureux accident, car le boy se mit à rire de bon cœur, tout en aidant Mukoki à se dépêtrer de son harnais. Rod se releva ensuite et, secouant la neige qui lui emplissait les yeux, les oreilles et même le cou, joignit son rire à celui de Wabi, et ses idées noires s’envolèrent.
La crête devenait de plus en plus étroite. A leur gauche, tout en cheminant, les trois hommes écoutaient, en-dessous d’eux, la course tumultueuse du torrent, dont le gel n’avait pas encore immobilisé le courant trop rapide. Un précipice était là, qu’ils devinaient sans le voir. D’autres blocs erratiques et des quartiers de rochers, que des cataclysmes préhistoriques avaient semés ou amoncelés, entravaient maintenant leur marche et il ne leur était plus permis d’avancer qu’avec une prudence de tous les pas.
La clameur du torrent augmentait d’intensité à mesure qu’ils marchaient, tandis que Rod voyait se dessiner, à sa droite, une ombre énorme, confuse encore, qui montait dans le ciel, au-dessus d’eux. Un moment arriva où Mukoki et Wabi alternèrent leurs rôles.
« Muki a déjà passé ici, cria Wabi à l’oreille de Rod. Je lui laisse l’emploi de chef de file, car le passage n’est pas sans danger. Au-dessous de nous, le torrent se précipite en une haute cataracte. Écoutez-le. »
Le tumulte de l’eau était devenu si fort, en effet, que la voix de Wabi en était presque étouffée.
L’émotion de Rod était à son comble et il en oubliait sa lassitude. Jamais, dans ses rêves de folles aventures, il n’avait prévu pareille heure. Il écarquillait ses yeux et ses oreilles, et tâchait de percer le paysage, qu’il entendait et sentait autour de lui.
Soudain, dans l’éclair d’une brève accalmie neigeuse, il vit la grande ombre qui, à sa droite, montait dans la nuit s’estomper nettement, et il se rendit compte de leur situation à tous trois. L’ombre était une montagne gigantesque, dont ils n’occupaient nullement le faîte, mais au flanc de laquelle courait le chaînon rocheux qu’ils suivaient. A gauche, le précipice ouvert tombait à pic dans les ténèbres bouillonnantes. Et, comme il heurtait du pied un morceau de bois mort, Rod le ramassa et le lança dans le vide. Il écouta ensuite, pendant une ou deux minutes, mais il n’entendit rien que la clameur titanesque, qui grondait sans trêve. Un frisson lui courut sur l’échine. C’étaient bien là des sensations qui ne traînent point les rues des grandes villes !
Le chaînon rocheux continuait à s’élever. Le jarret, à défaut de la vue, en donnait la perception. Wabi surtout peinait à tirer le toboggan. En dépit de sa fatigue et de sa blessure, Rod voulut lui donner un coup de main et il poussa, à l’arrière.
Une demi-heure durant, l’ascension se continua et le bruit de la cascade diminua d’intensité, puis s’éteignit, Il finit même par n’être plus.
« Halte ! » cria Mukoki.
La caravane était arrivée au faîte de la montagne qui, pour être d’une hauteur respectable, n’était point aussi formidable qu’elle avait d’abord paru à Rod. Wabi jeta à terre son harnais avec un « Ouf ! » de satisfaction, et Roderick poussa une exclamation de joie. Quant à Mukoki, toujours infatigable, il s’enquit aussitôt d’un endroit propice pour camper.
Cette fois encore, un volumineux rocher fournit son abri. Rod et Wabi aidèrent l’Indien à couper des bourrées de sapin, pour confectionner la hutte et les lits, après que la neige du sol eut été soigneusement balayée. Une heure après, tout était terminé et la flamme folâtre crépitait. Des peupliers morts, renversés sur le sol, le meilleur combustible qui se puisse trouver, avaient fourni le bois en abondance.
Les trois compagnons s’aperçurent alors qu’ils étaient affamés et Mukoki fut délégué aux soins de la cuisine. Café et venaison furent bientôt prêts.
La paroi du rocher, faisant office de réflecteur, renvoyait, en la décuplant, la chaleur bienfaisante du feu et sa lueur incandescente. Dans ce rayonnement brûlant, Rod sentit, dès qu’il eut fini de manger, un invincible sommeil s’emparer de lui. Sans pouvoir davantage lutter contre, il se traîna, dormant déjà, vers la hutte, et s’enveloppa dans une couverture, sur son lit de sapin odorant. Quelques minutes après, rien n’était plus pour lui.
La dernière vision consciente de ses yeux mi-clos avait été Mukoki empilant sur le foyer bûches sur bûches, et la flamme qui jaillissait à près de quatre mètres de haut, en illuminant dans la nuit un hallucinant paysage de rocs chaotiques.
C’est une fois couché et ses nerfs se détendant, que Roderick Drew éprouva la répercussion de l’effort excessif accompli par lui, malgré sa blessure, au cours de la journée écoulée.
Des rêves agités et dénués d’agrément vinrent troubler la fièvre de son sommeil. Tandis que Wabi et le vieil Indien, plus cuirassés contre la fatigue et les émotions du Désert, reposaient en paix et dormaient les poings fermés, notre citadin, à plusieurs reprises, se réveilla en sursaut, avec un soupir sourd ou un cri aigu, en s’imaginant qu’il courait un grand danger. Ce n’était qu’en passant sa main sur ses yeux, à demi levé, sur son coude, qu’il se rendait compte que l’aventure où il se débattait n’était qu’un cauchemar.
Dans un de ces sursauts, et comme il se redressait sur sa couche, pour la dixième fois, il lui sembla entendre des pas. Il s’étira les membres, il se frotta les paupières, regarda les formes sombres et immobiles de ses compagnons endormis, et, convaincu qu’il avait rêvé, une fois de plus, il se plongea à nouveau dans les ramures de sapin.
Il lui parut que l’imperceptible bruit recommençait et, comme mû par un ressort, il se dressa du coup sur son séant. Pas de doute possible. Il eût mis sa tête à couper qu’il entendait bien, tout contre la hutte, craquer la neige, sous un pas prudent et doux. Il retint son haleine et prêta l’oreille. Pas un bruit ne rompait le silence, que les éclatements d’un tison dans le feu. Il avait décidément rêvé et il tirait à lui sa couverture, lorsque…
Son cœur cessa de battre. Qui était là ?
Complètement réveillé maintenant, les yeux grands ouverts, tous ses sens tendus vers l’action éventuelle, lentement, avec précaution, il se leva. Les pas et craquement de la neige étaient devenus très distincts. On marchait derrière la hutte. On s’éloignait. Puis on s’arrêtait. La lueur vacillante du feu, à demi éteint, mettait encore son reflet rougeâtre sur le pan du grand rocher.
A cette indécise lumière, Rod vit quelque chose remuer. Une forme obscure rampait sournoisement vers la hutte endormie.
De sa découverte, le boy demeura tout d’abord comme figé. Mais rapidement il songea que les Woongas les avaient suivis ! Ils allaient tomber à l’improviste sur les dormeurs ! Presque en même temps, une de ses mains rencontra le canon du fusil de Wabi. Le froid de l’acier le fit tressaillir.
Il n’avait pas le loisir de réveiller ses compagnons. Le temps même qu’il tirât à lui le fusil, la forme avait déjà grandi, près du rocher, jusqu’à ce qu’elle s’abaissât, prête à bondir. Un halètement de Rod, une détonation qui retentit comme un tonnerre, un cri de douleur, et toute la hutte était sur pied.
« Nous sommes attaqués ! cria Rod. Vite ! Wabi ! Mukoki ! »
Le jeune blanc, à présent, était à genoux, le fusil fumant, toujours en joue, dans la direction du rocher. Là, dans l’ombre ténébreuse, un peu au delà du feu, un corps se tordait, en soubresauts, dans l’agonie de la mort.
La forme efflanquée du vieil Indien était venue s’agenouiller à côté de Rod, le fusil à l’épaule, et, par-dessus leurs deux têtes, Wabi, le bras tendu, braquait son gros revolver, dont le canon étincelait à la lueur du feu.
Après un moment d’attente Wabi chuchota :
« Ils sont partis. »
Rod, dont la voix tremblait d’émotion, répondit :
« J’en ai un. »
Mukoki, écartant les branchages qui formaient la hutte, se risqua dehors, toujours sur le qui-vive. Les deux boys le virent qui contournait le rocher, dissimulé dans son ombre, et qui s’avançait vers la victime de Rod. Lorsqu’il fut près du corps, maintenant immobile, il se courba, puis se redressa, avec un grognement, et lança la dépouille mortelle de leur ennemi dans la clarté du feu.
« Woongas ! Ah ! Ah ! Rod tuer lynx beau et gras ! » cria-t-il.
Rode eut un recul, un peu honteux, et rentra dans la hutte, tandis que Wabi, jetant un long cri, qui se répercuta dans la nuit, allait rejoindre Mukoki.
« Woongas ! Ah ! Ah ! gloussait le vieil Indien. Lynx beau et gras, tiré en plein dans la face. »
Rod émergea de sa retraite et rejoignit ses compagnons, avec une grimace que Wabi compara à celle d’un mouton qui bêle.
« Cela vous va bien, protesta Rod, de vous moquer de moi ! Mais que serait-il advenu si ç’avait été réellement des Woongas ? Par saint George ! si jamais nous sommes de nouveau attaqués, je ne bougerai plus et vous laisserai le soin de les chasser. »
Quoiqu’on le raillât, Roderick était excessivement fier de son lynx. C’était une bête de grosse taille, que la faim avait attirée vers les reliefs du repas et qui, prudemment, inspectait les lieux lorsque le boy avait tiré. Quant à Loup, il s’était prudemment tenu coi, en voyant qu’il ne s’agissait pas d’un homme, mais seulement d’un lynx, qui est, par surcroît, un ennemi-né de sa race.
Mukoki se hâta de dépouiller l’animal, pendant que celui-ci était encore chaud.
« Vous, aller vous coucher, dit-il aux deux jeunes gens. Moi rallumer le feu, puis dormir aussi. »
Cet incident tragi-comique libéra Rod de ses autres cauchemars et il s’endormit plus calme, désormais.
Tard, le lendemain matin, il se réveilla. La neige ne tombait plus et un soleil magnifique brillait au ciel. Wabi et le vieil Indien étaient déjà dehors, en train de préparer le déjeuner, et le gai sifflement de son camarade rappela à Rod que la crainte des Woongas s’était évanouie. Sans s’attarder davantage au lit, il se leva à son tour.
Tout autour du campement, qui était à l’extrême sommet de la montagne, se déroulait un immense et merveilleux panorama. Les arbres, les rochers, toute la montagne elle-même, étaient couverts de deux pieds de neige, blanche et respendissante sous le soleil.
Le Wilderness[8] lui apparaissait dans toute sa grandeur. Aussi loin que pouvait porter la vue, la blanche étendue, mille après mille, se dépliait vers le Nord, jusqu’à la Baie d’Hudson. En un éblouissement béat, Rod embrassait du regard, au-dessous de lui, la ligne des forêts noires, puis plaines, vallonnements et collines, qui se succédaient sans fin, entrecoupés de lacs scintillants, encadrés de sapins, et d’un grand fleuve déroulant son cours glacé. Ce n’était pas le désert sinistre et morne, comme il l’avait cru d’après ses lectures. C’était une splendeur magnifique et variée, dans un décor immaculé. Son cœur palpitait de plaisir, tandis qu’il planait sur cet immense horizon, et le sang lui empourprait la face.
[8] Le Wilderness est un terme générique, intraduisible, qui, comme le Causse, la Brousse, le Maquis, la Pampa, le Steppe, désigne une région particulière et l’ensemble des éléments-types qui la constituent. Le Wilderness, dit aussi le Wild, ou le Grand Désert Blanc, s’étend, dans le Nord canadien, jusqu’au Cercle Arctique et à la Mer Polaire. C’est une région aux vastes solitudes, qui, à mesure qu’elle s’avance vers le nord, se fait plus rude et plus désolée. La partie sud, où évoluent les personnages de ce roman, est pittoresque et accidentée, avec une faune et une flore variées, qui disparaissent, elles aussi, peu à peu, pour faire place ensuite à une terre à peu près morte. (Note des Traducteurs.)
Mukoki était venir le rejoindre dans sa contemplation et, de sa voix gutturale, il lui disait :
« Beaucoup caribous, là, en bas ! Beaucoup caribous ! Plus d’hommes du tout ! Plus de maisons ! Pendant vingt mille milles ! »
Roderick plongea ses yeux dans ceux du vieil Indien qui, lui aussi, paraissait tout ému. Ou eût dit que ses ardentes prunelles cherchaient à percer cet infini, à aller loin, plus loin encore, jusqu’aux postes extrêmes de l’immense Baie d’Hudson.
Wabi s’était joint à eux et avait posé sa main sur l’épaule de Rod.
« Muki, dit-il, est né tout là-bas, au delà de notre vision. Là-bas, lorsqu’il était jeune garçon, il a fait son apprentissage de chasseur. »
Puis, il attira l’attention de son ami sur l’extraordinaire transparence de l’atmosphère et la suppression apparente des distances qui en résultait.
« Voyez-vous cette montagne, pareille à un gros nuage, et que l’on pourrait, semble-t-il, toucher de la main ? Elle est à trente milles d’ici ! Et ce lac, de ce côté, qui vous paraît sans doute à une portée de fusil ? Cinq milles nous en séparent. Cependant, si un élan, un caribou ou un loup venait à le traverser, nous le distinguerions nettement. »
Pendant quelques instants encore, les trois hommes demeurèrent à regarder, silencieux. Puis Wabi et le vieil Indien retournèrent au feu et à la préparation du déjeuner, laissant Rod à son enchantement.
Quels mystères non résolus, songeait-il, quelles tragédies non écrites, quels romans insoupçonnés, quels trésors de dollars et d’or, devait enclore ce vaste Nord ! Pendant un millier, un million de siècles peut-être, il était demeuré inviolé, dans l’étreinte sauvage de la nature. Bien peu d’hommes blancs avaient pénétré ses solitudes, et les races autochtones, qui par endroits les parcouraient encore, y vivaient de la même existence que l’homme préhistorique !
Ce fut presque avec regret que Roderick s’entendit appeler pour déjeuner. Mais il ne bouda point à son appétit et ses rêves romanesques ne l’empêchèrent pas de faire honneur au repas.
Il demanda si l’on allait bientôt se mettre en route. Mais Wabi et Mukoki avaient déjà décidé de ne point prendre la piste ce jour-là et de demeurer au campement jusqu’au lendemain matin. Pour plusieurs raisons.
« Après la neige qui est tombée, lui exposa Wabi, nous ne pouvons plus voyager maintenant que sur nos raquettes. Il vous faut bien cette journée pour apprendre à vous en servir. En outre, la neige a recouvert toutes les traces existantes des animaux que nous chassons. Or, élans, rennes, caribous et, plus encore, les loups et les animaux à fourrure, ne vont pas se mettre en mouvement avant l’après-midi, ou même la soirée. Prendre la piste à cette heure ne nous servirait de rien. Demain, au contraire, nous nous rendrons compte, à loisir, des empreintes que nous rencontrerons et du genre de gibier qu’elles nous annoncent. Si le pays nous semble propice au but que nous poursuivons, alors nous y ferons halte et établirons notre campement d’hiver.
— Et les Woongas ? interrogea Rod. Vous pensez que nous en sommes suffisamment éloignés ? »
Mukoki émit un grognement.
« Woongas ne pas monter sur montagne. Derrière, beaucoup bons pays et giboyeux. Rester là. »
Cent autres questions furent posées par le jeune garçon, au cours du déjeuner, sur les blanches solitudes qu’ils dominaient et où ils s’enfonceraient bientôt. Et chaque réponse ne faisait qu’augmenter son enthousiasme.
Sitôt le repas terminé, il manifesta son désir de commencer son apprentissage des raquettes. Un heure durant, Wabi et Mukoki le pilotèrent dans un sens et dans l’autre, le long de la crête de la montagne, s’arrêtant aux moindres détails, battant des mains lorsqu’il avait réussi un saut exceptionnellement bon, et s’amusant beaucoup aussi lorsqu’il trébuchait dans la neige. A midi, Rod, fort satisfait de lui, trouva que tout allait pour le mieux.
La journée s’écoula fort agréablement. Roderick cependant ne laissa pas de remarquer que, par moments, Wabi semblait sous le coup d’un souci inconnu. Par deux fois, il le découvrit seul, assis sous la hutte, et silencieusement pensif. Il finit par s’en inquiéter.
« Pourrais-je savoir la cause de votre ennui ? interrogea-t-il. Qu’est-ce qui ne va pas ? »
Wabi se redressa et eut un petit rire.
« Avez-vous jamais eu, Rod, un rêve qui survive à la nuit et continue à vous importuner, une fois éveillé ? J’en ai fait un de ce genre, plus tenace que vos cauchemars imaginaires, car, depuis lors, je ne puis m’empêcher d’être inquiet des êtres chers que nous avons laissés derrière nous. Et plus spécialement de Minnetaki. Rien d’autre que cela. C’est se tracasser pour rien, me direz-vous ? Je suis de votre avis. Écoutez ! N’est-ce pas le sifflement de Mukoki ? » Le vieil Indien, en effet, arrivait en courant.
« Venir voir chose plaisante ! s’exclama-t-il. Vite ! Venir voir vite ! »
Rapidement, il emmena les deux boys sur le rebord le plus escarpé de la montagne. Il semblait très excité.
« Caribous ! dit-il. Caribous en train de s’amuser ! »
Et son doigt se tendit vers la pente neigeuse qui dévalait au-dessous d’eux.
A la distance d’un mille environ, qui semblait à Rod beaucoup moindre, sur une petite plate-forme située à mi-côte de la montagne, et qui devait être, en été, une prairie, une demi-douzaine de gros mammifères se comportaient d’une façon bizarre.
Les bêtes étaient des caribous, cet animal merveilleux de la Terre du Nord, aussi commun que le renne au delà du 60e degré de latitude, et dont Roderick avait lu, dans ses livres, tant de mirifiques descriptions. Pour la première fois, il le surprenait dans son ambiance et dans sa vie réelle.
Et, juste à ce moment-là, les animaux s’adonnaient à leur curieux jeu favori, connu, dans les parages de la Baie d’Hudson, sous le nom de « Danse du caribou ».
« Que diable font-ils là ? demanda Rod, tout aguiché. Qu’est-ce qui leur prend ?
— Eux, s’amuser follement », gloussa Mukoki.
Et il tira Rod un peu plus en avant, derrière un rocher qui les dissimulait.
Wabi avait mouillé dans sa bouche un de ses doigts, puis l’avait levé en l’air, au-dessus de sa tête. C’est un procédé commode pour se rendre un compte exact de la direction du vent. Le côté du doigt opposé au vent demeure humide, tandis que l’autre sèche rapidement.
« Le vent, annonça-t-il, est bon pour nous, Muki, et ils ne peuvent nous sentir. La chance est propice à un coup de fusil. Va le tirer. Rod et moi nous resterons ici à vous regarder. »
Tandis que Mukoki s’en retournait en rampant vers la hutte, pour y prendre son fusil, Roderick continuait à se récréer de la vue du spectacle divertissant qui se déroulait au-dessous de lui.
Deux autres animaux avaient rejoint les autres, sur leur plate-forme, et le soleil illuminait les ramures de leurs grandes cornes, tandis qu’ils secouaient leurs têtes, au cours de leurs bouffonnes évolutions. Trois ou quatre d’entre eux se séparant du reste de la troupe, commençaient par se sauver avec la vitesse du vent, comme s’ils avaient eu à leurs trousses leur plus mortel ennemi. A deux ou trois cents mètres, ils s’arrêtaient soudainement et, s’alignant en cercle, faisaient volte-face, comme si la fuite leur avait été de partout coupée. Puis ils se disloquaient et, en une course non moins échevelée, rejoignaient leurs compagnons.
Un autre jeu retenait les regards de Rod, si imprévu et si étonnant qu’il en demeurait tout pantois, un jeu à ce point comique que Wabi, derrière lui, en riait en sourdine. Une de ces agiles créatures, se détachant seule de la troupe, se mettait à tourbillonner tout autour, sautant et lançant des ruades, jusqu’à ce que, finalement, après un dernier bond, elle retombât droit sur ses pattes, sans plus bouger, comme une danseuse de ballet qui a terminé sa figure. Après quoi, le caribou simulait une nouvelle fuite, avec la troupe entière à ses talons.
« Ce sont, dit Wabi, les animaux les plus matois, les plus rapides et les plus amusants du Nord. Si le vent leur est favorable, ils vous flairent du haut en bas d’une montagne, et ils sont capables de vous entendre parler et marcher à un mille de distance… Mais regardez par ici ! »
Il appuya son doigt sur l’épaule de Rod et lui désigna Mukoki, qui se trouvait déjà assez loin et se glissait en tapinois vers les caribous, parmi les rochers et les buissons. Chaque minute le rapprochait davantage de son gibier et Roderick palpitait, admirant l’ensemble du tableau que formaient les muets et folâtres ébats des enfants du Désert, l’avance précautionneuse du vieil Indien, et chaque arbre, chaque rocher du paysage, qui jouaient leur rôle dans le petit drame dont pas une phrase ne lui échappait.
Cinq, dix, quinze minutes passèrent. Les deux boys virent Mukoki s’arrêter et lever le doigt en l’air, pour l’épreuve du vent.
Il s’aplatit ensuite sur la neige et, pied par pied, mètre par mètre, il se coulinait sur les mains et sur les genoux.
« Bon vieux Muki ! murmurait Wabi, tandis que Rod s’impatientait, les mains crispées, se demandant quand Mukoki se déciderait à tirer. Car, maintenant, il n’était plus, semblait-il, qu’à un jet de pierre de la troupe.
— A quelle distance est-il donc encore ? interrogea Rod.
— A trois ou quatre cents yards, dit Wabi. C’est trop loin pour tirer. »
Mukoki finit par n’être plus qu’un point noir sur la neige blanche.
A ce moment, la troupe joyeuse eut la conscience qu’un danger la menaçait. Elle cessa soudain ses ébats et demeura, pendant quelques instants, comme paralysée. La détonation du fusil de l’Indien monta vers les deux boys.
« Raté ! » cria Wabi.
Déjà les huit caribous fuyaient ventre à terre.
Un autre coup, puis un second et un troisième se succédèrent rapidement. Un des fuyards s’abattit sur les genoux, puis se releva et reprit sa course. Un coup encore, le dernier dans le fusil de Mukoki, et la bête blessée tomba à nouveau, tenta une fois de plus de se remettre sur ses pattes, puis s’écroula sur le sol.
« Bonne besogne ! s’exclama Wabi. C’est de la viande fraîche pour le dîner ! »
Mukoki, après avoir déchargé son fusil, s’avança sur l’espace libre, maintenant rouge de sang, où quelques instants avant, s’ébattaient les caribous.
Il tira son couteau de sa gaine et s’agenouilla près de la gorge de l’animal abattu.
« Je vais, dit Wabi, descendre vers lui, pour l’aider un peu. Vous, Rod, restez ici. Vous avez encore les jambes faibles et vous ne pourriez plus ensuite regrimper. Allez un peu aviver le feu. Mukoki et moi nous rapporterons la viande. »
Roderick, resté seul, s’occupa de ramasser du bois pour la nuit et s’exerça sur ses raquettes. Il s’étonnait lui-même de ses progrès et qu’il pût, avec cette étrange et encombrante chaussure, arriver à marcher ainsi, tout naturellement.
Le crépuscule commençait à tomber lorsque Wabi et Mukoki reparurent, chargés de la viande du caribou. On hâta les préparatifs du dîner, car, le lendemain et les jours suivants, on devait se mettre en route avant l’aurore, marcher sans doute jusqu’à la nuit, et il était urgent de s’allonger au lit.
Les trois compagnons étaient aussi impatients l’un que l’autre de commencer leurs exploits cynégétiques. Même Loup, étirant sa personne efflanquée, humait l’air à plein museau, comme s’il eût langui après les émotions des drames où il devait jouer son rôle.
« Si vous en avez la force, dit Wabi à Rod, par-dessus sa tranche de caribou, nous couvrirons dès demain vingt-cinq à trente milles, au cas où cela sera nécessaire. Nous pouvons avoir rencontré notre terrain de chasse à midi, comme il est possible que nous le cherchions deux ou trois jours durant. Dans ce cas comme dans l’autre, ne gaspillons plus notre temps. Hourrah ! L’heure du grand jeu n’est pas loin ! »
Il semblait à Rod qu’il venait à peine de s’endormir, lorsqu’il sentit que quelqu’un le secouait sur sa couche. Il ouvrit les yeux et trouva devant lui la figure rieuse de Wabi, qu’éclairait le reflet d’un bon feu.
« Allons, Rod ! Il est l’heure ! lui dit son camarade. Le déjeuner du matin est chaud, tout notre paquetage est déjà sur le traîneau. Et vous êtes encore là à rêver. A quoi ou à qui ?
— A Minnetaki ! » répondit Rod, avec une franchise dénuée d’artifice.
Il se leva, défripa ses vêtements et lissa ses cheveux ébouriffés. La nuit était noire encore et, ayant consulté sa montre, il vit qu’il était quatre heures du matin. Mukoki avait installé déjà le déjeuner sur une pierre plate, auprès du feu.
Le repas fut bref et la caravane se remit en route. Rod était désolé de la perte de son fusil. Un paradis de chasse allait s’ouvrir à lui et il était désarmé ! Comme il se lamentait de son malheureux sort, Wabi lui offrit l’usage de son propre fusil, un jour sur deux. Le gros revolver passerait de même, respectivement, d’une main à l’autre, et chacun d’eux, en cas de besoin, l’utiliserait de son mieux. Roderick fut tout joyeux de cette solution et Wabi insista pour que ce fût lui qui eût la première jouissance de l’arme bienheureuse.
Au delà des rochers qui jonchaient le faîte de la montagne et une fois sur la pente lisse de la descente, les deux boys s’attelèrent ensemble au traîneau, tandis que Muki marchait en avant pour tracer la piste.
Roderick assistait, pour la première fois, à l’établissement d’une piste et il admirait fort, dans l’aube naissante, l’habileté du vieil Indien. Mukoki, qui était un « pisteur » habile entre tous, effectuait, avec ses raquettes, d’énormes enjambées et, à chacune d’elles, faisait voler en l’air un feu d’artifice neigeux. Le sol, ainsi débarrassé de la neige molle, n’offrait plus qu’un large sentier, à la surface ferme, que pouvaient suivre sans peine Rod et Wabi.
Dès qu’ils furent arrivés à la base de la montagne, et comme ils suivaient, depuis un demi-mille environ, le bas-fond où ils se trouvaient, Mukoki s’arrêta. Lorsque les deux boys l’eurent rejoint, il désigna du doigt une empreinte marquée curieusement dans la neige.
« Élan ! » dit-il.
Rod se pencha pour regarder.
« La trace n’est pas vieille, dit Wabi. L’empreinte n’est pas encore gelée et la neige vient à peine d’y reprendre son équilibre. Les petites mottes glissent encore les unes sur les autres, voyez, Rod ! C’est un gros mâle, un rude compagnon, et il n’y a pas une heure qu’il est passé par ici. »
A mesure que les chasseurs avançaient, les traces d’animaux devenaient de plus en plus fréquentes, trahissant les va-et-vient et l’agitation sauvage de la nuit. Ce fut d’abord la piste d’un renard, qu’ils croisèrent à plusieurs reprises. Ils constatèrent que le petit bandit des ténèbres avait finalement égorgé un gros lapin. La neige était couverte de sang et de poils, et une partie du corps n’avait pas encore été dévorée.
Wabi était demeuré pensif et examinait de près les empreintes.
« L’important, dit-il, serait de savoir de quelle catégorie de renard il s’agit. Cela, nous l’ignorons. C’est un renard, et voilà tout. Toutes les traces de ces animaux se ressemblent, quelle que soit l’espèce. Pécuniairement parlant, la question cependant est capitale. Le renard qui a passé ici représente peut-être une fortune… »
Mukoki gloussa, comme si cette heureuse perspective l’avait déjà rempli d’allégresse.
« Expliquez-vous, Wabi ! interrogea Rod.
— Eh bien ! expliqua Wabi, le camarade est peut-être un renard rouge ordinaire. Il ne vaut alors pas plus de dix à quinze dollars. Si c’est un renard noir, il en vaut de cinquante à soixante. De soixante-quinze à cent, si c’est ce que nous appelons un « croisé », c’est-à-dire s’il est mélangé de noir et d’argent. Et si c’est…
— Un énorme gris-argent… gloussa Mukoki.
— Alors, poursuivit Wabi, sa parure vaut deux cents dollars, si le sujet est ordinaire. De cinq cents à mille, si c’est une bête hors ligne ! Et maintenant Rod, comprenez-vous pourquoi nous aimerions à être fixés sur son identité ? Un argent, un noir ou un croisé mériterait la peine que nous le suivions. Mais il est bien probable que ce n’est qu’un rouge et nous gâcherions notre temps. »
L’éducation de Rod continua à se parfaire. Il vit des traces de loups, qu’on aurait crues être celles de gros chiens. Puis celles, légères, de sabots de cerfs, et celles aussi, très larges, griffes écartées, d’un lynx errant. Mais rien ne le frappa autant que les trous, gros comme sa tête, laissés dans la neige par l’élan. Quelle bête formidable ce devait être ! Il apprit également à distinguer, malgré leur similitude apparente, l’empreinte du sabot d’un petit élan de celle d’un caribou.
Une demi-douzaine de fois, au cours de la matinée, les trois compagnons s’arrêtèrent pour se reposer. A midi, Wabi calcula qu’ils devaient avoir couvert une vingtaine de milles. Rod, quoiqu’il commençât à sentir la fatigue, déclara qu’il était encore bon pour une dizaine d’autres. On dîna.
Puis l’aspect du pays se modifia et celui-ci redevint très accidenté. Une petite rivière, qu’ils suivaient, devint un torrent tumultueux entre ses rives gelées. Les blocs erratiques et les masses rocheuses reparurent, encadrés de collines boisées. A chaque pas, le pittoresque augmentait. Un autre chaînon de montagnes, escarpées et sauvages, apparut vers l’est. Les petits lacs se faisaient aussi plus nombreux, dans leurs criques glacées.
Mais ce qui réjouissait surtout le cœur de nos chasseurs, c’était la fréquence des empreintes probantes de gibier et d’animaux à fourrure. Les endroits faits à souhait pour établir le campement d’hiver abondaient. Ce n’était que l’embarras du choix et les trois compagnons ralentirent leur marche.
Après la dernière ascension, dirigée par Mukoki, d’une colline assez haute qui leur barrait la route, ils firent halte, en poussant un cri joyeux.
Le site était idéal et sa beauté retirée tout à fait inattendue. Au fond d’une cuvette rocheuse, couronnée par l’amphithéâtre majestueux d’une forêt de cèdres, de sapins et de bouleaux, dormait un laquet, minuscule et charmant. A l’une de ses extrémités, s’étendait une petite surface plane qui, en été, devait être une prairie.
Mukoki, sans mot dire, jeta à terre le lourd paquet dont il s’était chargé. Rod fit de même avec le sien et Wabi se déharnacha des courroies avec lesquelles il tirait le toboggan. Il n’y eut pas jusqu’à Loup qui, tirant sur sa lanière, ne plongeât, lui aussi, dans le trou ses yeux avides, comme s’il eût compris, à l’instar de ses maîtres, que le « home » d’hiver était trouvé.
Ce fut Wabi qui, le premier, rompit le silence.
« Comment trouves-tu l’endroit, Muki ? » interrogea-t-il.
Muki gloussa, avec une satisfaction évidente et sans bornes.
« Très joli et bon. Nous avoir là excellent hiver. Beaucoup de bois pour feu. Aucun voisin ! »
Laissant là leurs bagages et Loup attaché au traîneau, les trois hommes descendirent vers le lac.
A peine en avaient-ils atteint les bords que Wabi, s’étant arrêté, tressaillit. Et, montrant du doigt, à ses compagnons, la forêt qui s’étendait sur la rive opposée, il s’exclama :
« Regardez ceci ! »
A demi cachée dans les sapins, était une cabane. On pouvait se rendre compte, même à distance, qu’elle était abandonnée. La neige s’était amoncelée autour d’elle. Aucune fumée ne fusait de son toit. Pas un signe n’y annonçait la vie.
Contournant le lac, les chasseurs se dirigèrent vers cette cabane.
S’en étant prudemment approchés, ils constatèrent qu’elle était déjà ancienne. Les bûches dont elle était bâtie commençaient à s’effriter. Sur sa toiture, des arbustes, semés par le vent, avaient pris racine. Sa construction remontait, sans nul doute, à plusieurs années. La porte, qui était faite de bûches fendues par leur milieu, et qui regardait du côté du lac, était hermétiquement close. Close aussi l’unique fenêtre, qui était orientée de même et que barraient extérieurement des traverses faites avec de jeunes arbres.
Mukoki essaya d’ouvrir la porte, en pesant dessus. Mais elle résista à ses efforts. Il était évident qu’elle était, à l’intérieur, solidement verrouillée.
Il y avait là matière à s’étonner. Comment cette porte pouvait-elle avoir été ainsi bloquée par en dedans, sans qu’il y eût personne dans la cabane ?
Pendant quelques instant, les trois hommes en demeurèrent tout interloqués, prêtant vainement l’oreille.
« Voilà qui paraît étrange, n’est-ce pas ton avis, Muki ? » dit Wabi à voix basse.
Mukoki, agenouillé contre la porte, continuait à écouter, l’oreille collée aux fentes du bois. Comme il n’entendait toujours quoi que ce fût, il se releva et, détachant ses raquettes, les envoya danser en l’air, de deux coups de jarrets. Puis, empoignant sa hache, à sa ceinture, il alla vers la fenêtre.
Après une douzaine de coups, il avait pratiqué dans le volet une petite ouverture. Par elle, le vieil Indien écouta encore, avec défiance. Aucun bruit, toujours. Il renifla. Une atmosphère à la fois moisie et raréfiée, presque suffocante, parvint à ses narines. Il éternua. Puis il recommença à faire, morceau par morceau, sauter le volet.
Quand l’ouverture fut assez grande, il y passa sa tête et ses épaules, et regarda. Mais, dans l’obscurité de la cabane, il ne put d’abord rien distinguer.
« Eh bien, Muki ? » interrogea avec impatience Wabi, qui se tenait derrière lui.
Mukoki demeurait toujours muet. Il était en train d’adapter ses yeux à l’obscurité et il ne grouillait pas plus qu’une pierre, il était aussi silencieux qu’un mort.
Très lentement enfin, avec mille précautions, comme s’il craignait de réveiller quelqu’un qui dormait, il se tira en arrière et reprit pied sur le sol. Lorsqu’il se retourna vers ses deux compagnons, l’expression de sa figure était telle qu’ils ne la lui avaient jamais encore vue.
« Qu’y a-t-il, Mukoki ? » demandèrent-ils.
Le vieil Indien aspira fortement une bouffée d’air frais.
« Cabane… balbutia-t-il. Cabane… Il y a dedans une armée de morts ! »
Rod et Wabi s’interrogeaient du regard, ne sachant d’abord ce qu’ils devaient croire de cette stupéfiante assertion. Le vieil Indien, cependant, continuait à refléter sur son visage frémissant une émotion peu coutumière.
« Une armée de morts, oui ! » répétait le vieux trappeur.
Et, comme il élevait la main, tant pour donner plus de force à ses paroles que pour se débarrasser des toiles d’araignée qui lui emplissaient la figure, les deux jeunes gens virent que cette main tremblait.
Quelques instants après, Wabi passait à son tour sa tête et ses épaules à travers le volet, et regardait comme l’avait fait Mukoki. Les retirant ensuite, il se retourna vers Rod, avec un ricanement étrange et la mine bouleversée. Moins bouleversée cependant que ne l’avait été celle du vieil Indien qui, comme un coup de fusil imprévu en pleine poitrine, avait, le premier, reçu le choc de l’effrayant spectacle.
« Vous aussi, Rod, regardez ! » dit-il.
Retenant sa respiration, Roderick s’approcha de l’obscure ouverture. Son cœur palpitait, non de crainte, mais d’une émotion mystérieuse et mal formulée. Son appréhension n’en était pas moins si forte qu’il eut comme un recul, au moment d’introduire sa tête à travers le volet.
Lorsque cela fut fait, lui non plus, tout d’abord, ne vit rien. Il n’y avait que du noir dans la cabane. Puis il lui sembla que l’ombre se dissipait et il commença à distinguer le mur opposé. Une table dessina ensuite, au milieu de la cabane, sa masse mal équarrie. Et, près de la table, il y avait quelque chose en tas, de mal défini. Sur ce quelque chose était une chaise renversée, qu’une espèce de loque recouvrait à demi.
Les yeux de Rod continuaient à voyager dans la cabane. Dehors, Wabi et Mukoki l’entendirent qui poussait, puis réprimait un cri d’effroi. Ils le virent qui se cramponnait des mains à la brèche ouverte dans le volet. Il regardait, comme fasciné.
Presque à portée de son bras, s’appuyait contre le mur intérieur, ce qui, voilà quelque cinquante ans, semblait-il, avait été un homme vivant. Ce n’était plus, maintenant, qu’un simple squelette, un objet à la fois terrible et risible, dont les orbites vides s’éclairaient tristement du rais de lumière qui filtrait dans la cabane, dont la bouche grimaçait, tordue dans une vie spectrale, et tournée vers Rod à travers l’ombre.
Roderick se laissa retomber. Il était tremblant et pâle.
« Je n’en ai vu qu’un… » murmura-t-il, en allusion à l’exclamation de Mukoki.
Wabi, qui était redevenu maître de lui, donna, en riant, deux ou trois tapes dans le dos de Rod, pour lui réconforter les esprits, tandis que Mukoki se contentait de grogner.
« Vous avez mal vu, Rod ! dit Wabi, d’un ton moqueur. Vos nerfs vous auront empêché de regarder assez longtemps. Par saint George ! Il n’y en a pas un d’entre nous qui n’en ait frissonné. Allons, je vais ouvrir ! »
Le jeune Indien s’infiltra à travers le volet et Roderick, qui avait pareillement repris son sang-froid, se hâta de le suivre. Tandis qu’extérieurement Mukoki pesait à nouveau sur la porte, de tout son poids, Wabi, de l’intérieur, attaqua le bois avec sa hache. La porte céda tout à coup, et si soudainement que le vieil Indien culbuta à sa suite et s’aplatit sur le sol.
Un flot de lumière pénétra dans la cabane. Instinctivement, les yeux de Rod se portèrent vers le squelette qu’il avait aperçu du dehors. Il était appuyé contre le mur, dans l’attitude ancienne d’un homme qui dormirait. A côté de ce premier et funèbre occupant, un second squelette était, tout de son long, étendu sur le plancher. Près de la table et de la chaise renversée, un petit tas d’ossements paraissait provenir de quelque animal.
Rod et Wabi s’approchèrent, un peu plus près, du squelette qui était adossé au mur et se mirent à l’examiner, tandis que Mukoki, agenouillé, se penchait sur le second squelette.
Soudain, le vieux trappeur poussa une exclamation de surprise et les deux jeunes gens s’étant tournés vers lui, le virent qui leur désignait, de l’index, un objet, par terre, parmi les os.
« Couteau ! dit-il. Lutte. Lui, tué ! »
Le manche pourri par le temps, le tranchant rongé par la rouille, mais toujours droit là où son possesseur l’avait planté dans la chair et dans les os de sa victime, un long couteau, à forte lame, était plongé jusqu’à la garde dans la poitrine de ce qui avait été jadis un être humain.
Rod s’était agenouillé près de Mukoki et était redevenu livide. Ses dents se desserrèrent, pour demander :
« Qui… a fait cela ? »
Mukoki eut un gloussement amusé et indiqua d’un signe de tête, la chose lugubre adossée au mur.
« Lui ! »
D’un même mouvement, les trois hommes revinrent vers le premier squelette. Un de ses longs bras était appuyé sur ce qui fut un seau, et avait passé à travers les cercles de fer qui en avaient seuls subsisté. La main de ce même bras crispait les os de ses doigts sur une écorce enroulée, qui semblait provenir d’une ancienne bûche de bouleau. L’autre bras s’était détaché et était tombé près du squelette, que Mukoki, de ce même côté, inspecta avec soin.
Sa curiosité ne tarda pas à être contentée par la découverte qu’il fit d’une courte entaille, qui avait pénétré de biais dans les côtes.
« Celui-ci mort à cette place, expliqua-t-il. Un coup de couteau dans les côtes. Mauvaise façon de mourir. Beaucoup souffrir et mourir lentement. Mauvaise façon d’être frappé.
— Brr… dit Rod, en frémissant. Sortons d’ici. On est asphyxié. On dirait que l’air de cette cabane n’a pas été renouvelé depuis un siècle. »
Mukoki, en s’en allant, ramassa un crâne, parmi le tas d’ossements qui était près de la chaise.
« Chien, grogna-t-il. Porte verrouillée, fenêtre fermée. Les hommes luttent. Tués tous deux. Chien mourir de faim. »
Tandis que les trois chasseurs remontaient vers l’endroit où Loup gardait le toboggan, Rod, laissant trotter son imagination, reconstituait la terrible tragédie qui, voilà bien longtemps, s’était déroulée dans la vieille cabane. Il revoyait les deux hommes vivant cette heure mortelle, où tous deux se livrèrent ce combat sauvage. Il croyait les voir lutter, les entendre se provoquer, à chaque reprise. Il croyait assister au double coup qui, simultanément, avait tué l’un, tout net, et envoyé l’autre, le vainqueur, comme un bolide, agoniser contre le mur. Et le chien ? Quel avait été son rôle dans la bataille ? Puis, qu’était-il devenu, solitaire et affolé, souffrant la faim et la soif, bondissant contre les parois de son tombeau muré, jusqu’à ce qu’il se tordît lui aussi, sur le sol, et mourût à son tour ? Cet atroce tableau brûlait le cerveau de Roderick. Élevé dans la convention d’une ville, il n’en avait jamais conçu la possibilité même. C’était l’émotion majeure qu’il eût encore vécue, exception faite de l’agression contre Minnetaki, à Wabinosh-House.
Pour Mukoki et Wabi, au contraire, la bataille des squelettes, si elle les avait d’abord fortement troublés, n’était plus déjà qu’un incident comme un autre de leur existence aventureuse.
Mais ce qui, surtout, tracassait Rod, c’était de savoir le pourquoi de la tragédie. Pourquoi, oui, ces deux êtres s’étaient-ils ainsi entre-tués dans la cabane close ? Quelle était la clef du mystère ? Il l’aurait, en vérité, payée un bon prix.
La grimpade terminée, Rod se réveilla à des réalités plus précises. Wabi était déjà en train de s’atteler au toboggan. Il était d’excellente humeur.
« Cette cabane, s’exclama-t-il comme Rod le rejoignait, nous tombe du ciel à point nommé ! Nous aurions eu cinq semaines au moins de travail pour en construire une. C’est ce qu’on appelle avoir de la chance !
— Comment, demanda Rod, nous allons vivre là-dedans ?
— Vivre là-dedans ? Je le pense bien. La cabane est trois fois grande comme celle que nous aurions bâtie. Je me demande même pourquoi les deux camarades l’ont faite d’une pareille dimension. Qu’en penses-tu, Mukoki ? »
Mukoki hocha la tête. Les tenants et aboutissants de cette histoire dépassaient évidemment sa compréhension.
Équipements et provisions furent bientôt amenés à la porte de la cabane.
« Procédons d’abord au nettoyage, annonça gaiement Wabi. Donne-moi un coup de main, Muki, veux-tu, pour ramasser tous ces os. Rod, durant ce temps, pourra s’amuser à flairer dans les coins et peut-être découvrira-t-il quelque chose d’intéressant. »
Roderick accepta volontiers le rôle qui lui incombait, car sa curiosité inassouvie n’avait fait que croître.
« Pourquoi ? Oui, pourquoi se sont-ils tués ? » mâchonnait-il entre ses dents.
Il commença donc ses recherches. Sous la chaise renversée, qui était faite de petits sapins cloués ensemble, il y avait un tas innommable et poussiéreux, qui s’effrita sous ses doigts. Mais, un peu plus loin, il découvrit deux fusils. Ils étaient d’un modèle très ancien et aussi longs que Rod lui-même.
« Ces fusils proviennent de la Baie d’Hudson, dit Wabi. De semblables on se servait avant que mon père fût né. »
Roderick, le cœur battant, continuait son exploration. Accrochés à l’un des murs, il trouva les restes de ce qui avait été des vêtements : un fragment de chapeau, qui tomba en pièces sitôt qu’il y eut porté la main ; des loques poudreuses et informes, véritables guenilles. Sur la table, il y avait des casseroles rouillées, un seau en fer-blanc, une bouilloire de fer battu et des restes d’anciens couteaux, des fourchettes et des cuillères. Puis encore, à l’un des bouts, un objet qu’il prit dans sa main et qui offrait une résistance suffisante pour s’être bien conservé et ne point s’émietter, lorsqu’il y toucha.
Rod reconnut que c’était un petit sac en peau de daim, ficelé à l’un de ses bouts, et fort lourd. Les doigts tremblants d’émotion, il dénoua la ficelle, à demi décomposée, et une poignée de quelque chose qui ressemblait à des cailloux noirâtres tinta sur la table. Il poussa un cri aigu, en appelant ses compagnons.
Wabi et Mukoki venaient d’aller décharger dehors une brassée d’ossements. Ils arrivèrent près de lui.
« Voyez ceci, dit-il.
— On dirait du plomb, opina Wabi.
— Du plomb… A moins que ce ne soit de l’or ! »
Les cœurs se mirent à battre.
Wabi, prenant un des cailloux, l’emporta sur le seuil de la porte, à la lumière du grand jour. Puis, sortant de l’étui son couteau de poche, il l’enfonça dans l’énigmatique objet. Avant même que Rod se fût penché sur l’entaille, la voix du jeune Indien s’éleva, claironnante.
« C’est une pépite d’or ! s’exclama-t-il.
— Et c’est pour elle qu’ils se sont battus ! » cria Rod, tout heureux de savoir.
Le plaisir d’avoir enfin percé le mystère qui le lancinait l’emporta tout d’abord pour lui sur l’intérêt de la découverte, considérée en elle-même.
Mais Wabi et Mukoki étaient dans une excitation sans pareille. On eût dit qu’ils étaient devenus fous. Le petit sac fut complètement retourné. Puis la table fut débarrassée de tout ce qui l’encombrait. Les coins et recoins de la cabane furent scrutés à nouveau, avec une ardeur délirante. Rod, aiguillonné par l’exemple, se mit de la partie. Sans proférer une parole, les trois hommes, debout, agenouillés, ou à plat ventre, étaient à chercher, chercher, chercher encore. Telle est l’attirance de l’or vierge. Telles sont les étincelles qu’il fait jaillir du feu latent et fébrile qui brûle pour lui dans le cœur de tout homme. Chaque guenille, chaque tas de poussière, chaque débris méconnaissable fut examiné, trié, tamisé, éparpillé. Les trois chercheurs ne s’arrêtèrent qu’au bout d’une heure, sans avoir rien trouvé, âprement désappointés.
« C’est tout ce qu’il y a ! » dit Wabi, en se décidant à desserrer les lèvres.
Il reprit, après un silence :
« Nous allons vider entièrement la cabane et, demain, nous arracherons le plancher ! On ne sait pas ce qu’il peut y avoir dessous. De toute façon, il nous faut un plancher neuf. La nuit commence et, si nous voulons nous aménager un gîte décent, il faut nous remuer. »
Tous les détritus furent, sans perdre une minute, balayés et sortis. Lorsque la nuit fut complètement tombée, les couvertures étaient déjà déroulées, les divers paquets et les provisions empilés dans un des coins de la cabane, en aussi bon ordre que sur un bateau. Ce fut l’expression même dont se servit Rod.
Un énorme feu fut aménagé extérieurement, devant la porte restée ouverte, et, quand il flamba, sa chaleur et sa lumière emplirent l’intérieur du « home », devenu tout à fait confortable. Une paire de chandelles compléta la fête et acheva de donner l’impression d’un chez-soi idéal. Le souper, servi par Mukoki, prit une allure de festin. Au menu : caribou rôti ; haricots froids, que le vieil Indien avait cuits au dernier campement ; gâteau de farine et café chaud. Nos trois chasseurs s’en pourléchèrent, comme s’ils n’avaient pas mangé depuis huit jours.
La journée avait été remplie de trop d’émotions pour que, le repas terminé, ils se retirassent immédiatement sous leurs couvertures, comme ils en avaient l’habitude. N’étaient-ils pas, d’ailleurs, arrivés au terme de leur longue marche ? Le plus fatigant était accompli. Il n’y avait plus devant soi, pour le lendemain, de pénible randonnée. Leur expédition s’annonçait sous d’heureux auspices et ils allaient pouvoir se livrer en paix au plaisir des sports d’hiver. Il leur était désormais permis, dans une bonne cabane, de bavarder le soir à leur aise.
Rod, Wabi et Mukoki ne s’en firent pas faute, cette nuit-là. Pendant de longues heures, ils causèrent, assis sur le seuil de la porte, devant le feu crépitant qu’ils attisaient. A vingt reprises, la conversation fut ramenée sur la tragédie de la vieille cabane. Vingt fois, les trois amis soupesèrent, dans la paume de leur main, les petites pépites, dont l’ensemble pouvait bien représenter une demi-livre environ. L’aventure était maintenant facile à reconstituer. Les deux hommes-squelettes avaient été jadis des prospecteurs d’or, qui s’étaient aventurés dans ces solitudes glacées, alors interdites aux blancs. Ils avaient découvert les pépites, qu’ils avaient ensuite soigneusement renfermées dans le sac de peau de daim. Puis, l’heure du partage venue, tous deux prétendant peut-être à leur unique possession, ils s’étaient disputés et une altercation violente avait suivi, qui avait abouti à la bataille des couteaux. Mais où et comment avaient-ils découvert cet or ? La question était plus malaisée à résoudre. Il n’y avait dans la cabane aucun outil de mineur, pic, ni pelle, ni creuset. Les trois amis en discutèrent jusqu’à minuit. Ils finirent par tomber d’accord que les constructeurs de la cabane n’étaient point des prospecteurs de métier et qu’ils avaient, par simple hasard, découvert le petit trésor pour lequel ils s’étaient entre-tués.
Dès les premières lueurs de l’aube, les trois hommes, après avoir absorbé le léger déjeuner du matin, entreprirent d’arracher le vieux plancher de la cabane. Une par une, les lattes de sapin furent enlevées et placées en pile, comme bois à brûler. Lorsque le terrain fut mis à nu, on le retourna avec une petite pelle, prise dans les bagages. Toutes les mousses parasites furent grattées. Si bien qu’à midi il ne restait pas un pouce de sol à explorer. Décidément, il n’y avait plus d’or.
Une détente s’ensuivit dans les esprits. L’idée de trouver une fortune cachée fut abandonnée. C’était déjà, au surplus, une gentille aubaine que les quelque deux cents dollars que représentaient les pépites.
Rod et Wabi ne songèrent plus qu’aux joies saines et variées que leur promettait la chasse, et aux trophées qui viendraient s’ajouter bientôt aux huit scalps de loups et au lynx. Mukoki commença à couper des rondins de cèdre vert, pour renouveler le plancher, et à les écoter.
Tout en alignant sur le sol, en les clouant et en bouchant, à force, les interstices du bois avec de la mousse, Rod sifflait joyeusement, et tant siffla-t-il qu’il en prit mal à la gorge. Wabi fredonnait les bribes d’une chanson Peau-Rouge, à l’allure sauvage. Mukoki se parlait à lui-même, ou élevait la voix, avec volubilité. Le plancher fut terminé aux chandelles et un poêle de fer, apporté sur le toboggan, fut incontinent monté dans la cabane, à la place de l’ancien foyer en pierres plates, à moitié écroulé, que les hommes-squelettes y avaient laissé.
Le souper y fut cuit, ce soir-là, et, le repas terminé, Mukoki installa sur le feu une grande marmite, qu’il remplit de graisse et d’os de caribou.
Rod lui demanda quelle sorte de soupe il cuisait. Pour toute réponse, il ramassa une demi-douzaine de pièges d’acier et les laissa tomber dans la marmite.
« Il faut, dit-il, pièges sentir bon, pour renard, loup, chat-pêcheur, et aussi martre… Tous venir quand piège sent bon.
— Si vous ne trempez pas les pièges, expliqua Wabi, neuf bêtes sur dix, et le loup plus qu’aucune autre, se méfieront et dédaigneront l’appât. L’odeur que l’homme laisse à l’acier, en le manipulant, les écarte. Après le trempage, au contraire, ils ne sentent plus que la graisse, qui les attire. »
Le « home » des trois chasseurs, dès cette seconde nuit, avait pris bon aspect. Il ne restait plus à établir, à l’aide de cloisons, trois chambres pour chacun d’eux. C’était un travail que l’on exécuterait à temps perdu. Il fut convenu qu’ils se mettraient en route au point du jour, chargés des pièges, et à la recherche d’une piste, en ouvrant l’œil principalement sur les traces de loups.
Par deux fois, au cours de la nuit, Roderick fut réveillé par un léger bruit. C’était Mukoki qui allait ouvrir la porte de la cabane.
La seconde fois, il se souleva dans ses couvertures et, s’appuyant sur ses coudes, il observa le vieil Indien.
La nuit était resplendissante et un flux de clair de lune ruisselait sur le campement. Rod pouvait entendre Mukoki glousser et grogner, comme se parlant à lui-même. A la fin, sa curiosité l’emporta et, s’enroulant dans ses couvertures, pour ne point avoir froid, il alla rejoindre l’Indien sur le seuil de la porte.
Le regard levé de Mukoki semblait perdu dans l’espace. Le globe lunaire se trouvait au zénith, juste au-dessus de la cabane, et, comme le ciel était sans nuage, il faisait clair à ce point que l’on distinguait nettement tous les objets sur l’autre rive du lac.
Le froid était non moins vif et Rod en sentait déjà les picotements sur sa figure. Il se demandait ce que pouvait fixer ainsi, sur l’empyrée, la vue de Mukoki, à moins que ce ne fût la magnificence même de la nuit.
« Qu’est-ce qu’il y a, Mukoki ? » interrogea-t-il.
Le vieil Indien rabaissa vers lui son regard et demeura un instant sans rien dire. Il était visible qu’une sorte de joie mystérieuse l’absorbait tout entier. Elle se peignait sur tous ses traits.
« Nuit de loups ! » murmura-t-il.
Il se retourna vers Wabi, qui dormait toujours.
« Nuit de loups ! » répéta-t-il.
Et il se glissa comme une ombre vers le jeune chasseur.
Rod observait ses mouvements avec un étonnement croissant. Il le vit qui se penchait sur Wabi, le secouait par les épaules, pour le réveiller, et il l’entendit qui répétait, une fois de plus :
« Nuit de loups ! Nuit de loups ! »
Wabi s’éveilla et s’assit sur son séant, tandis que Mukoki s’en retournait vers la porte. Il s’était complètement vêtu et équipé, et déjà, armé de son fusil, il sortait et se glissait dans la nuit.
Wabi avait rejoint Roderick et ils aperçurent tous deux la forme sombre de Mukoki qui filait à toute allure sur la glace du lac, puis gravissait la colline opposée et se perdait au delà, dans le blanc désert du Wilderness.
Rod, ayant sur ces entrefaites regardé Wabi, il vit que les yeux de son camarade étaient étrangement dilatés et que, devenus fixes comme ceux, tout à l’heure, du vieil Indien, ils reflétaient un trouble intérieur intense. Puis muettement, Wabi alla vers la table, alluma une chandelle et s’habilla.
Il revint alors vers la porte ouverte, encore mal remis de ce trouble mystérieux, et siffla haut. A ce sifflement, Loup, qui avait à peu de distance de la cabane son abri, répondit par un hurlement gémissant.
Dix fois, vingt fois, Wabi recommença à siffler, sans que fît écho le sifflement de Mukoki. Voyant que son attente était vaine, il s’élança sur le lac, le traversa avec une rapidité égale à celle du vieil Indien, gravit la colline, sur une autre rive, et interrogea du regard la blanche et brillante immensité du Wilderness, qui se déployait sous ses pieds. Mukoki avait complètement disparu.
Il s’en revint vers la cabane, où ronflait le poêle que Rod avait rallumé. Il s’assit à côté, en tendant vers la chaleur ses deux mains bleuies par le froid.
« Brr… dit-il, tout grelottant, c’est une nuit qui n’est pas bénigne ! »
Il s’était mis à rire, en regardant Roderick, qui ne savait quelle contenance tenir, mais dont la physionomie demeurait quelque peu effarée devant ce qui se passait.
« Dites-moi, Rod, interrogea Wabi, est-ce que Minnetaki ne vous a jamais conté, au sujet de notre vieux guide, une singulière histoire ?
— Non. Rien de particulier. Rien de plus que ce que j’en sais par vous-même.
— En ce cas, écoutez-moi. Une fois, il y a longtemps de cela, Mukoki a été en proie, je ne dirai pas absolument à un accès de folie, mais à quelque chose qui y ressemblait fort. Je n’ai jamais pu me faire, sur ce point, une opinion nette. Oui ou non, a-t-il été vraiment fou ? Je balance encore. Mais les Indiens de la factorerie sont pour l’affirmative. Quand il s’agit de loups, prétendent-ils, Mukoki, parfois, perd la raison.
— Quand il s’agit de loups ?
— Oui. Et il a pour cela un sérieux motif. C’était au temps où vous et moi nous venions au monde. Mukoki possédait alors une femme et un enfant. Ma mère et les gens de la factorerie content que, pour cet enfant surtout, sa passion était grande. Il en abandonnait la chasse, le plus souvent, aux autres Indiens et, durant des jours entiers, il demeurait dans sa hutte, à jouer avec le « popoose »[9], à lui apprendre mille choses. Si, par hasard, il s’en allait chasser, emportant ficelé sur son dos le marmot piaillant et déjà grand, c’était un des Indiens les plus heureux parmi ceux qui venaient à la factorerie, quoiqu’il fût certainement un des plus pauvres.
[9] Nom que les Indiens donnent aux jeunes enfants. (Note des Traducteurs.)
« Un jour, comme il s’était présenté avec un petit ballot de fourrures, qu’il avait presque exclusivement échangées pour des objets destinés à l’enfant (c’est ma mère qui me l’a raconté), il décida, car il était tard, de passer la nuit près de nous. Je ne sais quoi le retarda et il remit de vingt-quatre heures son départ. Ne le voyant pas revenir, sa femme s’inquiéta. Elle prit sur son dos le « popoose » et partit avec lui à sa rencontre. »
Un hurlement lugubre du loup captif coupa la parole à Wabi, durant un moment. Puis il reprit :
« Elle marcha ainsi, assez longtemps, sans le voir venir. Que se passa-t-il exactement ? Sans doute, disent les gens de la factorerie, elle glissa, tomba et, dans sa chute, se blessa. Toujours est-il que, le lendemain, lorsque Mukoki se remit en route à son tour, il rencontra sur la piste son cadavre et celui de l’enfant, à demi dévorés par les loups. A compter de cette date tragique, Mukoki ne fut plus le même. Oubliant son ancienne paresse, il devint le plus renommé chasseur de loups de la région. Il quitta sa tribu, vint s’installer à la factorerie et, dès lors, ne nous quitta plus, Minnetaki et moi. Parfois, à intervalles assez éloignés, lorsque la lune brille comme aujourd’hui, dans la nuit claire, et que le froid mord, sa raison semble vaciller. — « C’est, dit-il, une nuit de loups. » — Personne alors ne peut l’empêcher de sortir, ni tirer de lui une parole. A personne, lorsqu’il est dans cet état d’esprit, il ne permet de l’accompagner. Ce soir, il va de la sorte parcourir des milles et des milles. Il ira droit devant lui, sans rebrousser chemin, jusqu’au terme inconnu de sa course folle. Puis, quand il sera de retour, il semblera aussi sain d’esprit que vous et moi. Si vous lui demandez d’où il vient, il vous répondra vaguement qu’il est sorti pour voir s’il n’y avait pas quelque coup de fusil à tirer… »
Rod avait écouté avec une attention infinie. A mesure que Wabi déroulait le fil de la dramatique histoire de Mukoki, il se sentait pris pour le vieil Indien d’une immense pitié. Ce n’était plus pour lui, maintenant, un demi-sauvage, à peine frotté d’un peu de civilisation. C’était un frère humain, dans toute la force du terme. Des sanglots montaient dans sa poitrine oppressée et, à la lueur vacillante de la chandelle, des larmes brillantes humectaient ses yeux.
« Son habileté à chasser les loups, continua Wabi, confine à la sorcellerie. Chaque jour de sa vie, depuis près de vingt ans, il a fixé sur eux sa pensée. Il les a étudiés à fond et il en connaît plus, à lui tout seul, sur cette bête, que tous les chasseurs réunis du Wilderness. Chaque piège qu’il pose capture un loup. Personne n’en saurait faire autant. Rien qu’aux traces laissées par tel animal, il peut vous apprendre à son sujet mille choses curieuses, dont vous ne vous douteriez jamais. Un instinct presque surnaturel l’avertit si la nuit qui vient est une « nuit à loups ». Un effluve qui passe dans l’air du soir, un je ne sais quoi qui est dans le ciel ou dans la lune, l’aspect même du Wilderness, toute une ambiance susceptible à peine lui enseigne que les loups, dispersés par monts et par vaux, se réuniront en bandes, cette nuit-là, et que le soleil, à son lever, les trouvera se chauffant à ses clairs rayons, sur la pente des collines. Si Muki nous a rejoints, vous verrez, demain, commencer pour nous un sport peu banal et comment Loup, lui aussi, s’acquitte du travail qui lui est dévolu. »
Il y eut quelques minutes de silence, tandis que la flamme ronflait dans le poêle, chauffé au rouge. Les deux boys étaient assis l’un près de l’autre, regardant et écoutant le feu. Rod tira sa montre. Il était à peine minuit. Pourtant tous deux ne songeaient pas à reprendre leur sommeil interrompu.
« Loup est une bête tout à fait curieuse, disait Wabi. Sans doute, Rod, vous devez penser qu’il n’est qu’un dégénéré, un être servile et traître à sa race, digne de tous les mépris, lorsqu’il se retourne contre ses anciens frères et les attire à la mort. Il ne mérite point ces reproches. Il a, comme Mukoki, ses raisons, et qui sont bonnes, pour agir comme il le fait. Les animaux, comme les hommes, ont leurs rancœurs et leurs vengeances. Avez-vous remarqué qu’il lui manque la moitié d’une oreille ? Si vous lui renversiez la tête et lui tâtiez la gorge, vous y trouveriez la marque d’une profonde cicatrice. Et si, promenant la main sur son train de derrière, vous palpiez la chair, sous le poil, vous constateriez qu’en arrière de la cuisse gauche il y a un trou gros comme le poing. Mukoki et moi, nous avons capturé Loup dans un piège à lynx. Ce n’était alors qu’un menu louveteau, que Mukoki jugea devoir être âgé de six mois environ. Il était, le pauvre, en triste état ! Tandis qu’il était pris dans le piège et impuissant à se défendre, trois ou quatre membres de son aimable tribu s’étaient jetés sur lui et avaient tenté de s’en faire un petit lunch. Nous étions arrivés juste à temps pour mettre en fuite ces fratricides. Nous recueillîmes et gardâmes le louveteau, après lui avoir recousu la cuisse et la gorge, et nous l’avons apprivoisé. Vous verrez demain soir comment Muki lui a appris à s’acquitter de sa dette envers les hommes. »
Après avoir encore bavardé deux heures durant, Rod et Wabi soufflèrent la chandelle et retournèrent à leurs couvertures.
Rod fut une bonne heure à se rendormir. Il se demandait où était Mukoki, ce qu’il faisait et comment, dans son accès de demi-folie, il retrouverait sa route dans le Grand Désert Blanc.
Puis des rêves agitèrent son sommeil. Il revoyait la mère Indienne dévorée par les loups, avec son enfant. Et, tout à coup, cette image avait fait place à celle de Minnetaki, tandis que les loups s’étaient mués en Woongas, qui se jetaient sur la jeune fille.
Il fut tiré de son cauchemar par une série de coups de poings que Wabi lui donnait dans le côté. Il rouvrit les yeux, regarda Wabi dans ses couvertures, qui lui montrait quelque chose du doigt et, au bout du doigt, il vit… Mukoki, qui était paisiblement en train de peler des pommes de terre.
« Hallo, Muki ! » cria-t-il.
Le vieil Indien releva les yeux et regarda Rod, avec sa bonne grimace coutumière. Ses traits ne portaient aucune trace de sa folle équipée nocturne. Mais, gaiement, il dodelinait de la tête et, aussi tranquille que s’il venait de sortir du lit, après une bonne nuit de repos, il préparait le déjeuner du matin.
« Il faut se lever, conseilla-t-il. Grand jour de chasse ! Beaucoup de beau soleil aujourd’hui. Nous trouver loups sur montagnes, beaucoup de loups ! »
Les deux boys culbutèrent de leurs couvertures et commencèrent à s’habiller.
« A quelle heure es-tu rentré ? demanda Wabi.
— Maintenant, répondit Mukoki, en montrant le poêle et les pommes de terre épluchées. Maintenant, juste, pour rallumer le feu. »
Wabi regarda Rod en clignant de l’œil et, comme Mukoki se penchait sur le fricot :
« Qu’as-tu fait, cette nuit, Muki ? » interrogea-t-il.
Mukoki grogna :
« Grosse lune. Temps clair. Aurais pu tirer. Voir lynx sur colline. Voir trace loups sur piste en foule. Mais pas tiré. »
Ce furent toutes les explications que les deux boys purent obtenir de l’Indien sur l’emploi de sa nuit.
On se mit à table et, à un moment, tandis que Mukoki était allé fermer la porte du poêle, dont la chaleur était excessive, Wabi, poussant Rod du coude, lui dit à mi-voix :
« Vous voyez si j’avais raison. Il a bien été flairer les pistes ! »
Puis, à voix haute :
« Ne penses-tu pas, Muki, que nous devrions nous partager l’ouvrage de cette matinée ? Il me semble qu’il y ait, sauf avis contraire, deux directions dans lesquelles nous pourrions aller poser nos pièges. L’une qui suit, vers l’est, le chaînon rocheux dont cette crique est formée ; l’autre qui va vers le nord, à travers les ondulations de la plaine. Est-ce ton opinion ?
— Bon ! approuva le vieux trappeur. Vous deux aller au nord. Moi suivre la crête. »
Mais Roderick s’exclama vivement :
« Non, non ! Je suivrai la crête avec toi et Wabi prendra la plaine. C’est toi que j’accompagne, Mukoki ! »
Flatté de cette préférence du jeune blanc, Mukoki grimaça, gloussa et se mit à parler, avec plus de volubilité, des divers projets qui avaient germé dans sa tête. Il fut finalement convenu que l’on se retrouverait dans la cabane, assez tôt dans l’après-midi pour pouvoir se reposer avant la nuit, au cours de laquelle l’Indien paraissait persuadé que s’ouvrirait la chasse aux loups.
Rod remarqua que le loup captif n’avait pas eu à manger, ce matin-là, et il en devina facilement la raison.
Les chasseurs se partagèrent les pièges, qui étaient de trois dimensions différentes. Il y en avait cinquante petits pour les visons[10], martres et autres bestioles à fourrure ; quinze, un peu plus forts, pour les renards, et autant, de grande taille, à l’usage des lynx et des loups. Wabi prit dans son équipement vingt petits pièges, quatre à renards et quatre grands. Rod et Mukoki se chargèrent des autres. Ce qui restait de viande de caribou fut pareillement réparti entre les trois chasseurs, pour servir d’appât.
[10] Sorte de putois du Canada, dont la fourrure est brune et brillante. (Note des Traducteurs.)
Tous ces préparatifs étaient terminés avant l’aube et le soleil émergeait seulement de l’horizon, sur le Wilderness, lorsqu’on se mit en route.
Ainsi que l’avait prévu Mukoki, c’était une splendide journée qui s’annonçait, un de ces jours très purs et sans nuages, au froid mordant, où selon la croyance des Indiens, le Grand Créateur du monde prive de soleil le reste de l’univers, afin de faire luire toute sa splendeur sur leur terre sauvage.
Lorsqu’ils furent au sommet de la colline qui faisait face à leur cabane, les trois hommes s’arrêtèrent, pendant quelques instants, et Rod contempla au loin, muet d’admiration, l’immense paysage étincelant. Puis on se sépara.
Rod et Mukoki n’avaient pas marché pendant cinq minutes que l’Indien indiqua à son compagnon un tronc d’arbre mort, qui était tombé en travers d’un petit torrent. Sur ce pont improvisé, la neige était battue de menues empreintes. Mukoki les examina, et, tout de suite, déchargea son ballot.
« Vison ! » dit-il.
Puis, ayant suivi la piste jusqu’à une jonchée d’autres arbres abattus par le vent :
« Toute une famille vivre ici. Trois, peut-être quatre, peut-être cinq. Bâtir ici « maison de trappes ».
Jamais encore Rod n’avait vu disposer de pièges à la mode du vieil Indien. Sur la piste, un peu au delà du torrent, il construisit, avec des branches, un petit abri, pareil à une maisonnette. Il y plaça ensuite un morceau de viande de caribou et, un peu en avant, il installa son piège, soigneusement dissimulé avec un peu de neige et brindilles de bois. En vingt minutes, Mukoki avait édifié deux de ces abris et posé deux pièges.
Comme ils se remettaient en route, Rod demanda :
« Pourquoi, Muki, construis-tu ces petites maisons ? »
L’Indien expliqua :
« Beaucoup de neige souvent tomber en cette saison. Bâtir petite maison pour préserver pièges de la neige. Si pas faire cela, falloir toujours surveiller pièges et déterrer eux de la neige. Quand vison sentir viande, lui entrer dans maison et forcé de passer sur trappe. Bon pour petits animaux. Pas bon pour lynx. Quand lui voir maison, tourner autour, autour, autour, et puis partir. Lynx intelligent et rusé coquin. Loup et renard aussi.
— Que vaut un vison ? interrogea Rod.
— Cinq dollars, pas plus. Sept, huit dollars, si très beau. »
Au cours du prochain mille, six autres pièges semblables furent posés. La crête rocheuse que suivaient les deux chasseurs s’élevait de plus en plus et le regard de Mukoki s’allumait d’un feu qui trahissait une autre préoccupation que celle des petites bêtes à fourrure. Sa marche se faisait lente et prudente, et, quand il parlait à Rod, ce n’était qu’un simple murmure qui filtrait de ses lèvres. Rod lui répondait dans la même gamme.
Tous deux s’arrêtaient, de temps à autre, fouillant du regard les vastes espaces qu’ils dominaient et tâchant d’y découvrir des traces de vie. Chemin faisant, ils posèrent deux pièges à renards, dans deux coulées qui trahissaient ostensiblement le passage de ces animaux.
Un peu plus loin, dans un ravin sauvage encombré d’arbres écroulés et de masses rocheuses, ils rencontrèrent une piste de lynx et deux pièges furent installés, l’un à l’entrée du ravin, l’autre à son issue. Mais il était visible que, même au cours de ces opérations, l’esprit de Mukoki était ailleurs.
Ils avançaient de front, à une cinquantaine de yards l’un de l’autre, Rod se tenant avec soin sur la même ligne que Mukoki et imitant sa circonspection. Soudain, le jeune homme entendit un appel sourd de son compagnon et il vit celui-ci l’appelant par de grands gestes, qui trahissaient un frénétique enthousiasme. Il se hâta de le rejoindre.
« Loup ! » murmura Mukoki.
Rod aperçut dans la neige un certain nombre d’empreintes, assez semblables à celles d’un chien.
« Trois loups ! continua l’Indien, dont la jubilation était extrême. Sortis de bonne heure, ce matin, de leur retraite. Venus se chauffer quelque part, au soleil, sur la montagne. »
Maintenant, ils suivaient la piste des loups. Ils ne tardèrent pas à y rencontrer le reste d’une carcasse de lapin. Des empreintes de renard se mêlaient, alentour, à celles des loups. Mukoki posa encore un piège. Puis ce furent des marques de chat-pêcheur et l’Indien y alla d’un nouveau piège.
Des pistes de cerfs et de caribous se croisaient en tous sens, mais Mukoki n’y prêtait point attention.
Bientôt les empreintes d’un quatrième loup se mêlèrent aux précédentes, puis celles d’un cinquième, qui avait rejoint la bande. Une demi-heure après, une autre piste de trois loups coupait à angle droit celle que suivaient les deux chasseurs, et se dirigeait vers la plaine et ses bois. La figure de Mukoki en était toute convulsée de joie.
« Multitude de loups ! s’exclama-t-il. Ici, là, partout ! Bon endroit pour chasse de la nuit ! »
La crête rocheuse s’abaissa ensuite vers un bas-fond où serpentait un ruisseau gelé. Les traces de vie abondaient, faisant battre le cœur de Rod et bouillir son sang. La neige, par places, était littéralement hachée de sabots de rennes. Des pistes couraient en tous sens et des poils étaient restés accrochés à l’écorce d’une vingtaine de petits sapins, contre lesquels les bêtes s’étaient frottées.
Le glissement de Mukoki sur la neige était étrange, impressionnant presque. Les brindilles mêmes des buissons qu’il traversait se courbaient sans bruit sur son passage et Rod, ayant par mégarde heurté d’une de ses raquettes une petite souche d’arbre, le vieil Indien en leva les mains au ciel, de réprobation et d’horreur pour une telle maladresse.
Un bref arrêt de Mukoki et un signe à Rod, qui le suivait, apprirent au jeune homme qu’un gibier était en vue. L’Indien s’accroupit sur ses raquettes et, lorsque Rod l’eut rejoint, il lui passa son fusil. Puis ses lèvres, presque muettement, ébauchèrent ce seul mot :
« Tirez ! »
Rod avait pris le fusil, d’une main fiévreuse. Avec un tremblement émotif, il vit, à une centaine de yards devant lui, un daim mâle, magnifique, qui broutait, aux branches d’un noisetier, quelques feuilles épargnées par l’hiver et à demi desséchées. Un peu plus loin étaient deux femelles.
Le jeune boy prit son aplomb. Le daim se présentait de flanc, le cou tendu et la tête levée, en une position idéale pour un beau coup de fusil, à l’arrière de la patte de devant, point vital entre tous. Rod visa et tira. En un bond spasmodique, l’animal tomba mort.
Tandis que Roderick en était encore à constater l’heureux effet de sa balle, Mukoki avait rapidement couru vers le gibier abattu. Le boy, lorsqu’il le rejoignit, le trouva agenouillé devant la victime, encore palpitante, et tenant en main un bidon à whisky, de la contenance d’un quart environ. Le vieil Indien, sans autre explication, enfonça son coutelas dans la gorge de l’animal et remplit le bidon de sang fumant.
Lorsque seulement il eut terminé, il souleva le bidon, d’un air de grande satisfaction, et dit :
« Sang pour loups ! Loups aimer sang. Grosse chasse ce soir. Pas de sang, pas d’appât véritable ! Et pas de loups abattus ! »
Mukoki semblait s’être départi maintenant de sa précédente gravité. Il était évident qu’il considérait comme accomplie la besogne de la matinée.
Il éventra le daim, il prit le cœur et le foie, découpa un quartier de viande. Tirant ensuite de son équipement une longue lanière, il en lia l’extrémité au cou de l’animal, jeta en l’air l’autre bout, par-dessus une branche d’arbre, et, avec l’aide de son compagnon, hissa ce qui restait du daim à plusieurs pieds au-dessus du sol.
« Si nous empêchés de venir ce soir, lui garanti de loups », expliqua-t-il.
Une dernière exploration du bas-fond amena les deux chasseurs à l’endroit où le sol se relevait, vers une pente couverte de gros blocs, et clairsemée de grands sapins et de bouleaux. Ils arrivèrent ainsi devant un énorme rocher qui attira aussitôt l’attention de Mukoki. Se hisser à son sommet était impossible sur presque toutes ses faces. D’un côté seulement, on pouvait tenter l’ascension, en s’aidant des branches d’un sapin qui était voisin. Le rocher se terminait par une petite plate-forme, comme on pouvait le voir d’en bas, et Mukoki gloussa, tout heureux :
« Bon endroit pour poser appât ! Ce soir attirer ici les loups. »
La montre de Rod marquait près de midi. Tous deux, les chasseurs s’assirent pour manger les sandwichs qu’ils avaient apportés. Après quoi, ils reprirent le chemin du retour. Au delà du bas-fond, ils atteignirent la route qu’ils avaient faite à l’aller, en coupant droit vers la cabane. Le terrain était terriblement accidenté et chaotique. Par endroits, une muraille abrupte, semblable à un rempart, surplombait à pic des précipices vertigineux.
Comme ils passaient ainsi au-dessus d’une crique, profonde de près de cinq cents pieds, où bondissait, l’été, un petit torrent, gouffre obscur et sinistre où ne pénétraient point les rayons du soleil, Mukoki s’arrêta, à plusieurs reprises. S’accrochant prudemment à un arbuste, il se pencha au-dessus de ce ravin apocalyptique, le scruta du regard et, quand il se releva, expliqua :
« Au printemps, abondance d’ours, là-dedans. »
Mais ce n’était point aux ours que Rod était en train de songer. L’idée de l’or avait à nouveau surgi dans son cerveau. Ce ravin mystérieux ne détenait-il pas le secret emporté dans la tombe, il y avait cinquante ans, par les deux squelettes de la cabane ?
Le noir silence enclos entre les parois de ce puits de l’abîme, cette désolation, qui évoquait celle d’un paysage lunaire, les obscures retraites de ce ravin où plongeaient ses yeux avides, tout, dans ce lieu maudit, semblait se rapporter à la tragédie du passé et lui avoir servi de théâtre. Le mot du secret qui le tourmentait, Rod en était convaincu, se trouvait là.
Cette idée ne le quitta plus, tandis qu’il suivait Mukoki. Sous l’empire de cette obsession, qu’il était impuissant à chasser, il alla prendre le bras du vieil Indien et lui dit :
« C’est dans ce ravin, Mukoki, que les pépites d’or ont été découvertes ! »
De cette heure, était né dans la poitrine de Roderick Drew un imprescriptible désir. Volontiers, il eût désormais abandonné, durant tout l’hiver, les joies et les profits de la chasse, pour se mettre à la poursuite de cet ignis fatuus[11], ce « feu dément » qui dévore l’homme, à tous les âges, et qui est la soif de l’or. Les squelettes de la cabane, lorsqu’ils étaient des hommes, avaient découvert une mine d’or, et cette mine n’était pas loin. Pour le premier or qu’ils avaient trouvé, fruit de quelques jours de travail, ils s’étaient battus et entre-tués. Voilà ce que ne cessait de se répéter Roderick Drew.
[11] En latin dans le texte. (Note des Traducteurs.)
Mukoki avait eu une grimace significative, accompagnée d’un haussement d’épaules prodigieux, lorsque Rod avait émis l’idée que le gisement d’or était situé dans le fond du ravin diabolique. Aussi gardait-il ses réflexions pour lui-même et le retour fut silencieux.
Taciturne comme tous les hommes de sa race, Mukoki ne parlait guère, si on n’entamait la conversation. Rod, de son côté, se demandait par où il pourrait réussir à descendre, dès qu’il en aurait l’occasion, dans l’abîme sinistre, afin de l’explorer en détail. Il ne doutait point que Wabi ne fût prêt à l’accompagner dans cette aventure. Au besoin, il la tenterait seul. Une brèche quelconque devait forcément exister dans l’abrupte muraille.
Lorsque les deux compagnons arrivèrent à la cabane, ils y trouvèrent Wabi, déjà rentré. Le jeune boy avait posé dix-huit trappes et tué deux perdrix des sapins. Les oiseaux étaient vidés pour le dîner, et le menu s’augmenta d’une tranche de daim.
Pendant les préparatifs du repas, Rod raconta la découverte du ravin mystérieux et le projet qu’il avait ébauché. Mais Wabi l’écoutait d’une oreille distraite. Ses préoccupations semblaient être ailleurs. Par moments, il demeurait immobile, les mains enfoncées dans la profondeur de ses poches, et paraissait ruminer, soucieux.
Finalement, tandis que Rod et Mukoki vaquaient aux menues occupations de la table ou du poêle, il sembla se réveiller de sa rêverie, tira de sa poche une douille de cuivre jaune et la tendit au vieil Indien.
« Vois ceci, Muki, dit-il. Mon intention n’est pas de provoquer parmi nous quoi que ce soit qui ressemble à une inutile panique. Mais voici ce qu’aujourd’hui j’ai rencontré sur ma piste. »
Mukoki se saisit de la douille, d’un geste aussi brusque que si elle eût été une autre pépite d’or, récemment découverte. La douille était vide. En bordure du cuivre, on lisait très distinctement, et il lut :
« 35 Rem. »
Il ajouta :
« Eh bien ! ceci être…
— Une douille de cartouche du fusil de Rod ! » acheva Wabi.
Mukoki avait froncé le sourcil.
« Aucun doute n’est possible, reprit Wabi. C’est une douille pour Remington du calibre 35, à chargement automatique. Il n’y a, dans toute cette région, que trois fusils de ce type. J’en ai un, Mukoki a l’autre. Vous avez, Rod, perdu le troisième dans votre bataille avec les Woongas ! »
La venaison, durant ce dialogue, commençait à brûler et Mukoki se hâta de la retirer du feu, pour la servir sur la table.
« Alors, déclara Rod, après un silence, cela veut dire que les Woongas sont sur nos traces ?
— C’est la question que je me suis posée, toute la journée, répliqua Wabi. La preuve est faite qu’ils ont, contrairement aux prévisions de Mukoki, passé de ce côté de la montagne. Je ne pense pas cependant qu’ils connaissent où nous sommes. La piste était à peu près à cinq milles de cette cabane. De deux jours au moins elle était vieille. Trois Indiens, chaussés de raquettes, l’avaient tracée, et elle se dirigeait vers le nord. J’en déduis qu’ils étaient, sans doute, en simple expédition de chasse et qu’après avoir décrit un cercle vers le sud, ils s’en sont retournés à leur campement coutumier. Je ne pense pas qu’ils s’en viennent plus loin. »
Wabi expliqua comment il avait constaté que la piste, à un moment donné, revenait sur elle-même et ce fut un soulagement évident pour Mukoki. Secouant la tête en signe d’approbation, il en conclut, lui aussi, que leurs ennemis n’iraient pas plus outre.
L’humeur des trois compagnons n’en fut pas moins assombrie et leur gaîté se refroidit. Et pourtant l’éventualité de ce péril possible ajoutait un nouveau ragoût, qui n’était point sans agrément, aux émotions prévues de leur expédition.
Lorsque le repas fut terminé, une sorte de plan de campagne fut aussitôt ébauché. Il fut convenu qu’on ne s’en tiendrait pas à une défensive, toujours désavantageuse. Si, un jour ou l’autre, une piste fraîche de Woongas se présentait, on se lancerait à leur poursuite et les trois amis commenceraient eux-mêmes la chasse à l’homme.
Le soleil venait de disparaître vers le sud-ouest, derrière le lointain horizon, lorsque les deux boys et Mukoki quittèrent à nouveau la cabane.
Loup n’avait rien eu à manger depuis la nuit précédente. La férocité de la faim augmentait la flamme de ses yeux et la nervosité de ses mouvements. Mukoki eut soin de le faire remarquer à Rod et à Wabi. Il semblait couver la bête du regard.
La nuit rapide avait, de ses ténèbres, complètement enveloppé le Wilderness, lorsque tous trois atteignirent le bas-fond où ils retrouvèrent le daim suspendu à son arbre.
Rod fut commis à la garde des armes et du bagage, tandis que Wabi et le vieil Indien se mettaient en demeure de hisser le daim sur le gros rocher et sa plate-forme. Ils y parvinrent non sans peine et le jeune citadin commença à comprendre le plan de Mukoki.
La longue lanière, toujours attachée au cadavre de l’animal, fut jetée du rocher vers un bouquet de cèdres qui lui faisait face, et sur deux desquels trois plates-formes furent aussitôt aménagées à l’usage des trois chasseurs. Ceux-ci pouvaient y installer commodément leur embuscade, et même s’asseoir, sans danger aucun et bien cachés par les branches. Ce travail accompli, une autre préparation suivit, que Rod observa avec un vif intérêt.
Mukoki avait sorti de son vêtement, où il le tenait bien au chaud contre son corps, le bidon rempli de sang. Il en répandit un tiers environ, tant sur la neige qui était au pied du rocher que sur la paroi même du gros bloc. Il en versa le reste, goutte à goutte, sur diverses pistes, qu’il fit rayonner dans plusieurs directions.
Loup avait accompagné ses maîtres au cours de cette opération et, comme la lune ne devait pas se lever avant trois heures encore, les trois chasseurs établirent un feu, à l’abri du rocher. Ils y firent quelques grillades, afin de passer le temps, puis bavardèrent quelque peu.
Il était neuf heures lorsque l’astre des nuits émergea du Grand Désert Blanc. Cette grande aube de la nuit septentrionale exerçait sur Rod une fascination chaque soir renouvelée. Le globe ardent et pourpre semblait ramper tout d’abord sur la crête des forêts et des collines, splendeur palpitante, qui s’allumait au-dessus de la terre désolée, dans la pureté sereine d’un ciel que ne voilaient ni brume ni nuage. Si rapide était son mouvement qu’on croyait voir, dans l’au-delà, marcher ce globe, à l’œil nu. Puis, à mesure qu’il montait, la couleur de sang dont il était teint s’évanouissait, pour faire place, peu à peu, à une douce lumière, qui tenait le milieu entre l’argent et l’or. Alors seulement, l’univers s’illuminait sous le soleil nocturne.
Lorsque cet instant fut arrivé, Mukoki fit signe aux deux boys de le suivre, et ils regagnèrent, avec Loup, leur embuscade.
Le loup captif fut alors attaché, avec une forte lanière, à un petit sapin, au pied du gros rocher qui portait à son sommet le cadavre du daim. En l’air, il huma l’odeur du daim ; sous ses pattes, il flaira les caillots du sang répandu par Mukoki dans la neige. Ses mâchoires s’ouvrirent et se refermèrent, dans un grognement.
Rod et Wabi qui l’observaient, cachés près de là, derrière un tronc d’arbre, le virent qui se démenait ensuite, dans une agitation toujours croissante. Raide sur ses pattes, les narines pointées en avant, il semblait recueillir le vent en tous sens.
Son dos était hérissé et son nez s’élargissait. Ce sang dans la neige, cette bête morte sur le rocher, ce n’était plus la nourriture habituelle que lui offraient les hommes. L’instinct sauvage de Loup se réveillait et il se croyait retourné en pleine chasse, comme ses ancêtres.
A un moment donné, il parut faire un retour sur lui-même et, se souvenant de ses maîtres, se remémorant sa domesticité coutumière, il regarda en arrière, vers les cèdres. Mais ses maîtres avaient disparu. Il ne les voyait, ni ne les entendait plus. Il renifla vers eux. Puis, bientôt, il reporta son attention passionnée vers le sang et l’odeur du daim.
Allant et venant au bout de sa longue lanière, il rencontra sur la neige, qui craquait sous ses pattes, d’autres taches de sang, et il tenta de suivre plus loin la piste rouge tracée par Mukoki. Furieusement, il tirait sur la lanière qui le retenait captif et, comme un chien irrité, il tentait vainement de la ronger, oubliant qu’elle était assez solide pour résister à l’emprise de ses dents. Les chasseurs entendaient ses gémissements, qui se terminaient en une brève et hurlante chanson.
Et, tout autour du petit sapin auquel il était attaché, il courait, de plus en plus excité, avalant des gorgées de neige sanglante, qui lui dégouttait des mâchoires. Il se retournait ensuite vers le rocher et vers son gibier, qu’il ignorait être mort ou vivant, tout assoiffé de carnage et frémissant du désir atavique de tuer, tuer, tuer !
En un dernier effort pour se libérer et briser son lien, et reprendre sa liberté joyeuse et sauvage, il fit un bond frénétique. Puis, voyant son impuissance, il retomba sur la neige, pantelant et pleurant, désespérément.
Il s’assit ensuite sur son derrière, au bout de sa lanière, et vers le ciel il tourna sa tête éclairée par la lune. Son museau se balança, à angle droit avec ses épaules hérissées, et peu à peu, comme un chien d’Esquimau, il commença sa « hurle à la mort ».
Puis, le sourd et lamentable gémissement se mit à croître en durée, en volume et en force, jusqu’à ce qu’il éclatât en un long appel sinistre, qui s’élevait par-dessus plaines et montagnes, et s’en allait au loin faire retentir les échos. C’était maintenant le cri de ralliement du loup, la grande clameur de chasse qui, comme la sonnerie de bataille du clairon, appelle à la proie les maigres et gris bandits du Wilderness, les éternels affamés du Grand Désert Blanc.
Par trois fois, cet appel monta dans la gorge du loup captif, et déjà les trois chasseurs s’étaient hâtés d’aller se percher dans les cèdres.
Dans son émotion, Rod en oubliait la morsure du froid, devenu intense. Ses nerfs se tendaient, et son regard interrogateur se promenait sur l’immensité blanche et mystérieusement belle, qui s’étalait sous le ciel, toute baignée de clair de lune. Plus calme était Wabi, mieux renseigné que lui sur ce qui allait arriver.
L’appel féroce, en effet, avait été entendu de tout le Wilderness. Ici, au bord d’un lac silencieux dans son hivernale prison de glace, c’était un daim qui se mettait à trembler d’effroi. Ailleurs, par delà les montagnes, c’était un formidable élan mâle qui dressait sa tête branchue et dont les yeux jetaient déjà des éclairs de bataille. Un peu plus loin, un renard, à l’affût d’un lapin, interrompait momentanément son guet. Et, partout, les frères de race de Loup s’étaient arrêtés sur leurs pistes, tournant la tête et tendant les oreilles vers le signal connu, venu jusqu’à eux.
Une première réponse perça le silence qui, lorsque Loup s’était tu, était retombé, lugubre, et comme anxieux. Le cri était parti à un mille environ. La bête, captive au bout de sa lanière, s’assit à nouveau sur son derrière et renvoya un autre appel, dont l’intonation particulière disait qu’il y avait du sang sur la neige et une bête blessée à achever.
Les trois chasseurs demeuraient toujours immobiles et muets. Mukoki avait épaulé son fusil et semblait pétrifié. Wabi, après s’être solidement arc-bouté le pied contre le tronc de son arbre, avait posé son fusil sur son genou, prêt à le mettre en joue. Rod, avait, à son tour, pris le gros revolver et, pour mieux viser, en avait appuyé le canon sur la fourche d’une branche, où reposait son bras.
Une autre voix, qui arrivait de l’est, ne tarda pas à répondre à la précédente, qui avait retenti vers le nord. Rod et Wabi entendirent Mukoki émettre sur son arbre un gloussement de concupiscence. Loup, de son côté, sans plus se perdre en vains efforts de délivrance, mettait toute sa frénésie inassouvie dans les appels réitérés qu’il lançait aux quatre coins de l’horizon. Et de plus en plus nombreuses arrivaient les réponses. De plus en plus proches aussi.
Soudain, il y eut un glapissement tellement rapproché que Wabi saisit Rod par le bras.
« Il n’y a plus longtemps à attendre… » murmura-t-il.
A peine avait-il parlé qu’une forme efflanquée apparut, suivant une des pistes rouges et courant rapidement vers Loup.
Les deux animaux réunis se turent pendant un instant, et le nouvel arrivant, ayant humé l’odeur du daim, vint buter contre le rocher. Alors il joignit ses hurlements à ceux de Loup, comme pour appeler à son secours la meute de ses frères.
Ceux-ci surgissaient de partout, du sommet des collines et des arbres du bas-fond. Une horde glapissante et affolée de faim, d’une vingtaine de têtes, entoura le rocher où se trouvait, hors de sa portée, la proie tant désirée. Les loups, se bousculant entre eux, sautaient en l’air, puis retombaient sur le sol, essayant en vain de grimper vers le gibier tentateur, si proche cependant.
L’attitude de Loup s’était, peu à peu, étrangement modifiée. Couché sur le ventre, haletant et comme prêt à joindre ses bonds à ceux de ses frères, il s’était graduellement calmé devant l’évidence de l’inutilité de ses efforts. L’homme avait repris sur lui son emprise et il s’était souvenu de ce qui s’était déjà passé dans de semblables circonstances. La haine de sa race l’avait à nouveau envahi et il attendait placidement le drame inévitable qui allait se dérouler devant lui.
Ce fut Mukoki qui fit entendre, en guise d’avertissement, un premier et faible sifflement, et Wabi se hâta d’épauler.
Lentement, le vieil Indien, sans quitter son fusil, tira sur la lanière dont l’extrémité était attachée au cadavre du daim, qu’il amena de la sorte jusqu’au rebord du rocher. Un mouvement de plus, et le daim culbutait au milieu de la horde.
Comme des mouches qui s’abattent sur un morceau de sucre, les bêtes affamées se ruèrent sur leur proie, s’écrasant et se battant entre elles, pour y mieux mordre. Alors Mukoki, d’un sifflement strident, donna le signal de tirer dans le tas.
Quelques secondes durant, les ramures des cèdres flamboyèrent d’une auréole d’éclairs, qui semaient la mort au-dessous d’eux, et les détonations assourdissantes des deux fusils et du gros Colt étouffèrent les cris de douleur des loups.
En cinq secondes, un total de plus de quinze coups avait été tiré, et cinq autres secondes ne s’étaient pas écoulées que le grand et beau silence blanc de la nuit était retombé sur le Wilderness. Tandis que les survivants s’étaient enfuis, la mort muette était au pied du rocher, à peine interrompue par le faible râle des loups blessés, gisant sur la neige.
Dans les cèdres, résonna le déclic métallique des armes que l’on rechargeait. Puis Wabi prononça :
« Je crois que nous avons fait de la belle besogne, Mukoki ! »
Mukoki répondit en descendant de son arbre, et les deux boys l’imitèrent.
Devant le rocher, cinq corps étaient immobiles. Un sixième se traînait encore, à quelques pas. Mukoki l’abattit d’un coup de hache. Un septième loup avait fui un peu plus loin, en laissant derrière lui une traînée de sang. Lorsque Rod et Wabi le rejoignirent, l’animal en était à ses dernières convulsions.
« Sept ! s’exclama Wabi. C’est un des meilleurs tirs que j’aie jamais réussis. Cent cinq dollars en une nuit. N’est-ce pas, Rod, que ce n’est point mal ? »
Ils revinrent en tirant le loup derrière eux.
Ils retrouvèrent Mukoki debout dans le clair de lune, le regard braqué vers le nord, et aussi raide qu’une statue.
En les voyant, il pointa son bras vers l’horizon et, sans tourner la tête :
« Voyez ! » dit-il.
Dans la direction indiquée, les deux boys aperçurent une flamme fuligineuse et rougeâtre qui, sous la clarté blafarde du clair de lune, étendait au loin sa sombre lueur sur le Wilderness. On la voyait monter et grandir, et son intensité augmenter, comme un sinistre incendie qui eût déversé des torrents de feu sur plaines et forêts.
« C’est un sapin qui brûle ! dit Wabi.
— Un sapin qui brûle ! » acquiesça le vieux trappeur.
Et il ajouta :
« Le signal de feu des Woongas ! »
Wabi et Mukoki contemplaient sans mot dire le sapin enflammé, qui ne paraissait pas, à Rod, être éloigné de plus d’un mille. Le silence de ses deux compagnons parut au jeune homme un mauvais présage.
Dans le regard de Mukoki une lueur étrange brillait, semblable à celle qui darde au fond de la prunelle des fauves, lorsque leur fureur est prête à éclater. Le visage de Wabi s’était empourpré de sang et, par trois fois, Rod le vit tourner, vers les yeux de Mukoki, des yeux dont la flamme ne pronostiquait non plus rien de bon.
De même que dans le cerveau de brute du loup captif, les anciens instincts de chasse et de liberté sauvage s’étaient tout à l’heure réveillés, de même aussi, dans l’âme du vieil Indien et dans celle, plus jeune, de Wabi, qui n’avait dans ses veines qu’une moitié de sang blanc, remontait lentement l’atavisme de la race. A travers la peau cuivrée de leurs visages, Rod lisait jusqu’au plus profond de leurs cœurs. Il comprenait que la haine de l’antique ennemi, le Woonga, longtemps comprimée, avait ressurgi en eux. L’occasion se présentait de l’assouvir et ils ne la laisseraient pas s’échapper.
Pendant cinq minutes encore, le grand sapin continua à projeter des gerbes d’étincelles. Puis la flamme tomba et la carcasse de l’arbre ne fut plus qu’une tour de braise. Mukoki regardait toujours, muet et farouche. A la fin, Wabi rompit le silence.
« A quelle distance est-il de nous, Muki ?
— A trois milles », répondit sans hésiter le vieil Indien.
— En quarante minutes, nous pouvons couvrir cette distance.
— Oui. »
Wabi, alors, se tourna vers Rod.
« Vous pourrez, n’est-ce pas, retrouver seul votre chemin jusqu’à la cabane ?
— Je ne dis pas non. Mais si vous partez en expédition, je vous accompagne. » Mukoki éclata d’un rire rauque et il prit un air désappointé.
« Non ! dit-il avec gravité et en remuant la tête. Non pas aller là-bas ! Le sapin éteint dans cinq minutes. Nous pas trouver le campement des Woongas. Mais faire, en marchant par là, bonne piste à voir par eux au matin. Meilleur attendre. Nous trouver un jour leur piste, et alors tirer ! »
Cette décision de Mukoki, de ne pas, ce soir-là, pousser plus loin l’aventure, fut pour Rod un immense soulagement. Ce n’était pas qu’il craignît la bataille et il n’eût point été fâché d’ouvrir le feu sur les hors-la-loi qui lui avaient volé son fusil. Mais la froide réflexion des hommes de sa race lui représentait aussi que les Woongas pouvaient être évités, avec quelque prudence, et qu’il était plus sage, en poussant au contraire vers le Nord, de continuer en paix à poser des pièges. Mieux valait, pour l’instant, sacrifier son fusil. Et surtout cette diversion de la chasse à l’homme contrecarrait les plans qu’il ne cessait de mijoter, pour découvrir de l’or.
La « Mine des Squelettes », comme il l’avait lui-même baptisée, absorbait uniquement sa pensée. Un combat avec les Woongas, c’était la fuite éventuelle vers une autre région. Wabi lui-même en convenait, car l’ennemi pouvait être supérieur en nombre. C’est là ce que Rod ne voulait pas, à tout prix.
Wabi et Mukoki se mirent à scalper les sept loups et ce qui restait de la carcasse du daim fut abandonné à Loup, pour qu’il s’en rassasiât.
Il était deux heures de la nuit lorsque les trois compagnons rentrèrent à la cabane. Le poêle fut allumé et, comme de coutume, on causa des événements du jour écoulé, de ceux aussi qui se préparaient peut-être pour les jours suivants.
Rod ne put s’empêcher de faire un retour en arrière et de songer à la joie paisible avec laquelle ils s’étaient installés ici, il y avait si peu de temps ! Le site était idéal et ils croyaient fermement que nul péril des Woongas ne les menaçait plus. Maintenant, au contraire, ils savaient qu’ils pouvaient être exposés, d’un moment à l’autre, à lutter pour leur vie, à abandonner cette calme retraite.
La conversation fut une sorte de petit conseil de guerre. Il fut décidé que la vieille cabane serait, dès le lendemain, aménagée pour supporter un siège, que des meurtrières seraient percées sur toutes ses faces, que les barres de fermeture de la porte et des volets seraient remplacées par de plus fortes, qui permettraient de se barricader solidement en cas d’attaque. Il fut convenu, en outre, qu’un des trois chasseurs resterait toujours à monter la garde, tandis que les deux autres iraient poser et relever les trappes.
Le lendemain, ce fut Rod qui fut laissé de garde. Le temps, qui était toujours splendidement ensoleillé, avait quelque peu dissipé les appréhensions de la nuit. Le jeune boy eut la bonne fortune de tuer un bel élan, qui grimpait sur la colline neigeuse, de l’autre côté du petit lac. Puis, en attendant le retour de ses compagnons, il se remit à ruminer ses projets personnels.
Les grosses neiges d’hiver ne s’étaient pas encore accumulées, ainsi qu’il avait pu le constater, dans le gouffre sombre qu’il s’était promis d’explorer. Il était prudent de ne pas attendre les grandes tempêtes, qui ne manqueraient pas d’y entasser les blancs flocons et le rendraient inaccessible. Il avait, d’autre part, tiré de la cachette où on l’avait déposé, dans le mur de bûches, le petit sac de peau de daim, et il en avait sorti les pépites d’or.
Il remarqua qu’un frottement quelconque les avait admirablement polies, et en avait adouci et arrondi tous les points saillants. Lorsqu’il était au collège, Rod avait toujours eu un faible pour l’étude de la minéralogie et de la géologie. Il savait que l’eau courante avait seule été capable de donner aux pépites ce beau poli, et il en conclut qu’elles avaient certainement été trouvées dans le lit d’une rivière, ou sur ses bords. Cette rivière devait être le torrent du ravin mystérieux. Il en était fermement persuadé.
Lorsque Mukoki et Wabi rentrèrent, le soir, ils apportaient avec eux, le premier un renard rouge et un vison, le second un chat-pêcheur, dont l’aspect rappela plutôt à Rod celui d’un chien à peine adolescent. Malheureusement, de nouvelles pistes suspectes avaient été à nouveau découvertes par Mukoki. Le vieil Indien avait retrouvé les débris du sapin brûlé et, tout autour, il avait relevé les traces de raquettes de trois Indiens, que le signal de feu semblait avoir réunis. Leur piste s’en allait ensuite, avec de nombreux crochets, vers une destination inconnue et, à un endroit, avait croisé la ligne des pièges.
La conclusion en fut que, pour la relève des pièges, les chasseurs désormais ne se sépareraient plus, mais seraient toujours deux.
La semaine qui suivit fut plus calme et fort fructueuse. Plus de traces de Woongas. Les fourrures recueillies, ajoutées aux scalps de loups, commençaient à représenter une petite fortune qui serait, si nul accident n’arrivait, rapportée à Wabinosh-House au premier printemps.
Il en fut de même durant une quinzaine encore et Rod songeait avec bonheur au petit home où, à des centaines de milles de là, sa mère l’attendait et, chaque jour, priait pour lui. Il rêvait aussi, plus d’une fois, aux jours et aux nuits, dont il faisait le décompte, et qui le séparaient du retour à la factorerie, près de Minnetaki.
L’heure arriva cependant où Rod put mettre à exécution son projet, qui lui tenait au cœur, d’explorer le ravin. Mukoki et Wabi n’étaient pas partisans de cette tentative, qu’ils estimaient chimérique. Aussi Roderick décida-t-il d’agir seul.
Ce fut à la fin de décembre. C’était le jour de garde de Wabi, et Mukoki, qui semblait avoir oublié les Woongas, était parti à la relève des pièges. Rod se munit de vivres, prit le fusil de Wabi et une double provision de cartouches, s’arma en surplus d’un couteau, passa une hache à sa ceinture, et joignit à son ballot une bonne couverture.
Ainsi équipé, il se mit en route et Wabi riait, du seuil de la cabane, en le regardant s’en aller.
« Je vous souhaite une bonne chance, Rod ! cria-t-il gaiement, en lui faisant de la maison un dernier signe d’adieu.
— Si je ne suis pas de retour ce soir, répondit Roderick, ne vous tournez pas le sang à mon sujet, vous autres ! Si l’affaire s’emmanche bien, je camperai sur les lieux, afin de reprendre mes recherches, dès le lendemain matin. »
Rod, lorsqu’il fut sur place, passa sans tarder sur la crête opposée du ravin. Il avait constaté en effet, la première fois, qu’aucune descente dans le gouffre n’était possible du côté où il avait cheminé. En suivant cette crête, encore inexplorée, il ne courait d’ailleurs aucun danger de se perdre. Le ravin lui serait un guide constant.
A son grand désappointement, il trouva que les murailles méridionales de l’abîme étaient aussi abruptes que celles du nord et, deux heures durant, il chercha en vain la plus petite fissure par où s’insinuer et pouvoir descendre.
La crête commençait à se boiser et Rod rencontrait, presque à chaque pas, des traces de gibier. Mais il n’y prêtait guère attention. Ce qui l’intéressa davantage, ce fut de constater que les arbres se rapprochaient de plus en plus du précipice, qu’ils finirent par surplomber. Le jeune homme vit qu’en s’attachant à une branche, avec les longues lanières de ses raquettes, et en s’aidant des mains, il pouvait tenter la descente.
Son espoir, cette fois, ne fut point déçu et, après un difficultueux quart d’heure, essoufflé mais triomphant, il était au fond du ravin.
Au-dessus de lui, il était dominé d’un côté par la forêt, de l’autre, par de noires murailles. A ses pieds coulait le petit torrent auquel son rêve de l’or avait assigné un rôle prépondérant. Le torrent était gelé par endroits ; dans d’autres, la rapidité de son cours l’avait dégagé de la glace.
Roderick, allant de l’avant, s’avança vers la partie la plus resserrée du gouffre, vers celle où, d’en haut, il avait si avidement plongé ses regards. Là, ne descendait plus le soleil. Là, tout était sombre, sinistre et silencieux, comme un sépulcre. Il sembla au boy, dont le regard était intensément alerté, que l’esprit des deux morts gardait le seuil de ce monde enchanté et le trésor qu’il recélait.
Il continua pourtant à avancer. Le couloir qu’il suivait devenait de plus en plus étroit. Les hautes murailles se resserraient encore au-dessus de sa tête et l’obscurité s’épaississait autour de lui. Nul autre bruit que celui, monotone, du torrent, qui éclaboussait les rochers de son écume. Pas un bruissement d’arbre ou de buisson, pas un chant d’oiseau, pas un caquetage d’écureuil. Tout était ici profondément mort. Par moments seulement, Rod entendait, tout là-haut, passer un souffle de vent, dont pas une bouffée ne descendait jusqu’à lui. La neige amortissait le bruit même de ses pas. Il avait, sur son dos, accroché ses raquettes.
Tout à coup il sursauta. Une dégringolade de pierrailles tomba près de lui, avec bruit qui, dans le silence ambiant, ressemblait à celui d’une avalanche, et un grand coup de vent lui souffleta la figure. Il s’arrêta, fit le geste d’épauler. Mais ce n’était qu’un gros hibou, qu’il avait dérangé dans son trou.
Roderick se remit à suivre le cours du torrent. A chaque instant, il s’arrêtait pour ramasser, dans son lit ou sur la rive, des poignées de cailloux ou des galets. Il les examinait, le cœur battant, dès qu’un rayon de lumière, venu d’en haut, le lui permettait. Et, s’il croyait voir luire dans la pierre une autre lueur, il palpitait… Il ne trouvait rien toujours, cependant. Mais sa foi ne sombrait pas. Sa conviction ne faisait que croître, au contraire. L’or était ici, quelque part !
C’était un je ne sais quoi, invisible, inexplicable et mystérieux, qui, flottant dans l’air, le conduisait. Et sa marche était si légère, si impalpable elle-même, comme s’il eût craint d’éveiller sous ses pas son plus mortel ennemi, qu’il aperçut à l’improviste devant lui, tout près, une chose vivante qui, ne l’ayant pas encore entendu, ne paraissait pas effrayée. C’était un renard. Avant que la bête n’eût découvert sa présence, il avait visé et tiré.
Le coup fut répercuté, comme un tonnerre, par tous les échos de l’abîme. Un grondement formidable roula dans les ténèbres spectrales, renvoyé de muraille en muraille, et reprenant à mesure qu’il s’éteignait. C’était terrible à ce point que Rod en frissonna par deux fois et qu’il demeura comme cloué au sol jusqu’à ce que le dernier écho se fût évanoui.
Alors seulement, il s’approcha du renard gisant sur la neige. Ses yeux, qui s’étaient habitués peu à peu à l’obscurité de cet enfer et avaient fini par y trouver comme une vague lumière, purent voir que le renard n’était pas rouge. Qu’il n’était pas gris non plus. Il était…
Non, Roderick ne se trompait pas. Son cœur donna dans sa poitrine un coup de tampon. L’épaisse et splendide fourrure de la bête sanglante sur laquelle il se penchait avait des reflets gris et comme métalliques.
Et, dans l’abîme solitaire, s’éleva une joyeuse clameur humaine :
« Un renard argenté ! »
Pendant plusieurs minutes, Rod contempla sa proie qui remuait encore. Puis il lui donna le coup de grâce et la ramassa. D’après ce que lui avaient dit Wabi et Mukoki, la soyeuse fourrure de cet animal valait plus, à elle seule, que toutes celles qui s’étaient entassées déjà dans la cabane.
Sans le dépouiller, de crainte d’abîmer la peau, il joignit le renard à son ballot et reprit son exploration.
Les murs de rochers qui l’emprisonnaient se rejoignaient presque au-dessus de sa tête, formant, par moments, comme un tunnel peuplé d’ombres. Fasciné par l’indéniable grandeur du site, Rod en oubliait la fuite du temps. Mille après mille, il poursuivait sa piste infatigable. Il en oubliait de manger. Une fois seulement, il s’arrêta pour se désaltérer. Et, quand il regarda sa montre, il fut étonné de s’apercevoir qu’il était trois heures de l’après-midi.
Il était maintenant trop tard pour songer à retourner au campement. Dans une heure, la nuit viendrait ajouter ses ténèbres à celles du ravin. Au premier endroit propice, Rod fit halte, jeta à terre son ballot et s’installa un abri sous un creux de roches. Il ramassa des branches mortes, en quantité suffisante pour alimenter son feu jusqu’au jour, puis s’occupa de son souper. Il avait apporté avec lui une petite bouillotte et bientôt l’appétissant parfum d’un café brûlant se mêla à celui d’un aloyau d’élan, en train de rôtir.
Sous le ciel étoilé, dont une bande mince apparaissait au-dessus de l’étroit ravin, une froide solitude enveloppait le jeune aventurier, tandis qu’il mangeait.
Le bruit d’un rôdeur sauvage de la nuit, qui passait sur le rebord du précipice, lui crispa les nerfs sous la peau. Ce n’était pas qu’il eût peur. Il ne voulait pas avoir peur. Mais, dans ces lieux que personne avant lui n’avait foulés, sinon peut-être un demi-siècle avant, bien d’autres que lui eussent senti frissonner leur âme.
Afin de chasser ses pensées moroses, il se mit à rire tout haut. Mais son rire lui fut renvoyé par l’écho, comme une moquerie amère, qui s’égrenait de rocher en rocher. Ce n’était plus qu’un spectre de rire et Rod se recroquevilla, sans réitérer, plus près de son feu.
Le jeune homme n’avait pas dans le surnaturel une croyance exagérée. Mais surnaturel, tout ne l’était-il pas ici et, en dépit de sa fatigue, Rod ne pouvait trouver le sommeil. De ses yeux, vainement, il s’efforçait de chasser la vision des deux squelettes, tels qu’il les avait découverts dans la vieille cabane. Il songeait que ces squelettes, au temps où ils étaient des hommes, et bien des années avant qu’il ne fût né, avaient dû fouler le sol de ce même ravin. Au même torrent que lui ils avaient bu, ils avaient escaladé les mêmes rochers, campé peut-être là où il campait. Comme lui, ils avaient tendu leurs oreilles de chair dans le silence sinistre, ils s’étaient réchauffés à la flamme vacillante de leur feu, dont le reflet dansait sur ces mêmes murailles. Et, ce qu’il n’avait pas encore trouvé, ils l’avaient trouvé. De l’or !
L’angoisse qui étreignait la gorge de Rod devint à ce point douloureuse que si, d’un coup de baguette magique, il avait pu se trouver transporté soudain, sain et sauf, près de ses deux compagnons, il n’aurait pas eu le courage, maintenant, de dire non.
Comme il continuait à écouter, il entendit, bien loin derrière lui, un cri plaintif, quelque chose comme un appel suppliant :
« Allo… Allo… Allo ! »
On eût dit une voix humaine qui le hélait. Mais Rod n’ignorait pas que c’était le cri du réveil nocturne du « hibou-homme », comme le nommait Wabi. L’écho apportait jusqu’à lui l’appel doux et le multipliait, si bien qu’une foule de voix spectrales semblait murmurer à son oreille, à travers l’ombre :
« Allo… Allo… Allo ! »
Le boy, déconcerté, prit son fusil et le posa sur ses genoux. C’était là un réconfort sans pareil. Il le caressait de la main et l’envie lui prenait de parler au canon d’acier. Ceux-là seuls qui se sont enfoncés dans les solitudes désertiques du Wilderness peuvent savoir tout ce qu’est pour l’homme un bon fusil. Il est l’ami fidèle, de chaque heure du jour et de la nuit, toujours obéissant à celui qui lui commande, lui procurant sa nourriture et expédiant la mort à ses ennemis. C’est un chien de garde qui ne trahit jamais. C’est la sécurité au chevet du dormeur. Tel était pour Rod son fusil. Il le cajolait amicalement, avec sa mitaine, de la gueule à la crosse, et, quoiqu’il eût décidé de veiller toute la nuit, il finit par s’endormir en le serrant dans ses bras.
Il était fort mal posé pour dormir, à moitié assis, à moitié replié sur lui-même, les pieds tournés vers le feu, sa tête pendant sur sa poitrine et lui comprimant l’estomac. Aussi son sommeil était-il singulièrement agité, ses craintes prenant corps dans ses rêves. Par moments, il parlait tout en dormant, laissant tomber de ses lèvres des paroles inintelligibles, sursautant comme s’il allait se réveiller, mais s’affaissant à nouveau, cramponné toujours à son fusil.
Ses visions parurent prendre ensuite une forme plus définie. Il se retrouvait sur la piste du retour et arrivait à la vieille cabane. Il était seul. La fenêtre était grande ouverte, mais la porte demeurait hermétiquement close, comme le jour où ses deux camarades et lui avaient débouché en face d’elle, pour la première fois.
Prudemment, il s’approchait. Lorsqu’il était près de la fenêtre, il entendait à l’intérieur de la cabane un bruit… un bruit étrange. On eût dit un cliquetis d’ossements.
Pas à pas, il s’avançait et regardait. Le spectacle qui s’offrait à lui le glaçait d’épouvante ! Deux énormes squelettes luttaient, en une étreinte mortelle. Il écoutait le bruit, clic, clic, clic, de leurs os qui s’entre-choquaient. Il voyait luire, entre les phalanges de leurs doigts, la lame de leurs couteaux, et il comprenait qu’ils se battaient pour la possession d’un objet posé sur la table. Ils l’atteignaient, l’un ou l’autre, alternativement, mais aucun d’eux ne parvenait à s’en emparer.
Le cliquetis des os devenait plus violent, le combat plus féroce. Sans trêve, les couteaux se levaient et retombaient. Alors un moment arrivait où l’un des deux squelettes titubait en arrière et s’écroulait lourdement sur le sol.
Le squelette vainqueur se balançait sur ses tibias, en un équilibre instable, et, tout en chancelant, parvenait à la table, où il agrippait, entre les os de sa main, le mystérieux objet.
Tout trébuchant, il allait ensuite s’appuyer contre le mur de la cabane, en élevant en l’air, d’un geste victorieux, ledit objet, et Rod pouvait voir que c’était un rouleau d’écorce de bouleau.
A cet instant, un tison du feu de Rod éclata, avec un bruit pareil à la détonation d’un petit revolver, et le jeune homme se dressa, comme mû par un ressort, ouvrant tout grands ses yeux et tremblant.
Quel songe affreux avait été le sien ! Il ramena vers lui ses jambes ankylosées et rechargea le feu, en tenant toujours d’une main son fusil.
Un songe affreux, oui vraiment ! Il regarda autour de lui, sa prison de nuit et de rocher, mais la pensée de son cauchemar ne cessait pas de le hanter. Toujours il se répétait à lui-même :
« Quel effroyable songe ! Effroyable… Effroyable… »
Lorsque son esprit se fut un peu calmé, il s’arrêta à nouveau devant le foyer et regarda la flamme joyeuse qui se ranimait. Sa chaleur et sa clarté le ragaillardirent. Il constata qu’il était trempé de sueur. Il retira sa casquette et se passa la main dans les cheveux et sur le front, qui étaient tout humides.
Puis, plus froidement, il tenta de rappeler dans sa mémoire les différentes phases de son rêve.
Elles ne lui apparurent pas une à une, comme il se produit d’ordinaire. Mais, tout de suite, la souvenance lui revint, aussi soudaine qu’un coup de fusil, du rouleau de bouleau que la main levée d’un des squelettes tenait dans ses doigts sans chair.
Et, presque aussitôt, une seconde réminiscence lui revint. Lorsque ses compagnons et lui avaient enterré les deux squelettes, l’un de ceux-ci tenait effectivement dans sa main un morceau d’écorce de bouleau !
Ce rouleau d’écorce ne contenait-il pas le secret de la mine perdue ?
N’était-ce pas aussi pour la possession de ce rouleau, et non pour celle du petit sac de peau de daim, que les deux hommes avaient combattu et trouvé la mort ?
Roderick avait oublié, en une seconde, et sa solitude, et sa peur nerveuse. Il ne songeait plus qu’à la « clef » imprévue que lui avait apportée son rêve. Wabi et Mukoki avaient vu, comme lui, l’écorce de bouleau dans la main du squelette. Mais ils n’y avaient pas, non plus, prêté autrement attention. Tous trois avaient pensé que ce n’était là qu’un simple copeau, ramassé dans la lutte par la main crispée d’un des deux combattants, lorsqu’ils avaient roulé à terre, dans leur corps à corps.
Rod se souvenait à présent qu’ils n’avaient trouvé dans la cabane aucune autre écorce de bouleau, ce qui n’aurait pas manqué si les deux hommes avaient fait, pour allumer leur poêle, une provision de ce genre de bois. Son rêve ne semblait point le tromper.
Il continua à entretenir son feu, en attendant avec impatience le lever du jour. A quatre heures du matin, dans la nuit noire, il fit cuire son déjeuner et prépara son ballot, en vue du retour. Puis il attendit qu’une étroite bande de lumière apparût au faîte du ravin, où elle s’infiltra faiblement, dessinant à peine, dans l’ombre, les contours des objets.
Rod ne tarda pas davantage et il reprit, à rebours, sa piste de la veille. Il la suivit avec la même prudence qu’à l’aller, scrutant de l’œil les rochers et la neige. Il avait, en venant, rencontré de la vie. Il pouvait en découvrir encore, autant sinon plus.
Le jour grandissait rapidement, mettant un vague clair-obscur dans les ténèbres du ravin. La marche de Rod s’en accéléra. Il calculait qu’en ne s’attardant pas pour le moment à d’autres investigations, il arriverait au camp vers midi. Immédiatement il pourrait, avec ses compagnons, déterrer le squelette. Si réellement le rouleau de bouleau contenait le secret de l’or ignoré, il leur serait loisible de revenir au ravin avant que des chutes de neige plus importantes ne l’eussent rempli et rendu inaccessible.
A l’endroit où il avait tué le renard argenté, Rod s’arrêta un instant. Il se demandait si les renards avaient coutume de voyager par couples et il regrettait de ne s’être point mieux documenté sur ce sujet, près de Wabi ou de Mukoki. Il vit distinctement, à quelque distance de lui, le trou du rocher d’où la tête était sortie, et la curiosité le poussa à faire un crochet jusqu’à cet endroit.
Quelle ne fut point sa surprise en apercevant, sur la piste même de l’animal, l’empreinte d’une paire de raquettes !
Quiconque avait passé là l’avait fait depuis son passage à lui et depuis celui du renard. La marque des pattes de la bête était en effet recouverte par celle des raquettes. Quel était cet inconnu ? Était-ce Wabi ou Mukoki, venus au-devant de lui. Mais comment alors ne les avait-il pas rencontrés ?
Il examina de plus près les empreintes. Elles différaient, en long comme en large, de celles de Wabi et de Mukoki, autant que des siennes propres. Elles ne pouvaient provenir que d’un étranger.
Mais cet étranger avait-il découvert sa présence ? Le boy demeurait les yeux et le fusil en arrêt. Il continua a suivre cette nouvelle piste durant une centaine de yards. Là, l’inconnu s’était arrêté, ainsi que Rod s’en aperçut au piétinement de la neige. Sans doute était-ce pour écouter et épier lui-même… Toujours est-il qu’à partir de cet endroit la piste revenait dans la direction de celle du jeune blanc, qu’elle rejoignait bientôt et avec laquelle elle se confondait désormais.
Rod ne doutait plus qu’un de ces Woongas de malheur ne fût encore passé là. Peut-être l’Indien était-il en embuscade, derrière quelque rocher, prêt à tirer sur lui. Il n’y avait pourtant d’autre solution possible que de continuer à avancer. C’est le parti auquel il se résolut.
Les empreintes bifurquaient à nouveau. Les raquettes de l’inconnu s’étaient orientées vers la gauche, dans la direction d’une fissure étroite, ouverte dans la muraille. Le fusil en arrêt, Rod fit de même. Son étonnement fut grand de constater que cette fissure se prolongeait dans la roche, comme une véritable brèche, large à peine de quatre pieds, et qui se relevait, en pente rude, jusqu’au sommet de la crête qui bordait le ravin. L’inconnu avait passé par là et escaladé la brèche, après avoir enlevé ses raquettes.
Ce fut un soulagement pour Rod. Par cette fente presque invisible, le mystérieux ennemi s’en était allé, sans plus s’occuper de lui.
Mais toutes ces allées et venues des hors-la-loi, dans un aussi proche rayon du campement, ne laissaient pas, à la fin, d’être inquiétantes. En dépit de l’optimisme revenu de Wabi et de Mukoki, Rod ne pouvait s’empêcher de trouver inexplicables tous ces mouvements sournois et dérobés. Il avait l’esprit délié, très intuitif, et savait aller au bout des conséquences qu’il convenait de tirer des faits, même lorsque ceux-ci manquaient encore de précision.
Il ne pouvait y avoir pour lui aucun doute. Les hommes à peau rouge connaissaient leur présence, à tous trois, dans la vieille cabane. Et, s’ils ne s’étaient jamais montrés, s’ils n’avaient jamais dérangé ni levé une trappe, ce n’était qu’une raison de plus de se méfier.
Rod, cependant, était résolu, peut-être à tort, de garder pour lui ses soupçons. Il croyait sincèrement que Wabi et Mukoki, par leur éducation même, étaient plus aptes que lui à voir clair en toutes ces choses et plus compétents des lois, des mœurs et des périls du Wilderness.
Un peu avant midi, Roderick arrivait au-dessus de la dépression de terrain où se trouvait, au bord du petit lac, la vieille cabane.
Il avait joyeuse mise, car, à défaut de l’or, il rapportait du ravin, dans son ballot, une palpable petite fortune, qui était la peau du renard argenté. Le fardeau en paraissait plus léger à ses épaules et il s’amusait d’avance de la surprise de Mukoki et de Wabi.
Comme il s’approchait de la cabane, il prit la contenance d’un homme las et une figure désappointée. Il y réussit fort bien, en dépit de sa secrète envie de rire. Wabi, qui l’attendait sur le seuil de la porte l’accueillit avec une moue moqueuse et Mukoki le salua par un de ses gloussements familiers.
« Ah ! Ah ! cria Wabi, en feignant de le toiser de la tête au pieds, voici Rod ! Voulez-vous, cher ami, nous montrer au plus vite ce fameux trésor ? »
Mais, en dépit de son persiflage, on lisait sur son visage la joie de voir rentrer son camarade.
Rod jeta à terre son ballot, d’un mouvement découragé, et se laissa tomber lourdement sur une chaise, comme s’il était au dernier degré de l’épuisement.
« Il faut, Wabi, dit-il, que vous ayez l’obligeance de me défaire ce paquet. Je suis trop las, quant à moi, et je meurs d’inanition. »
Wabi, croyant que c’était sérieux, de railleur devint pitoyable.
« Je vous crois sans peine, Rod. La fatigue se lit sur vos traits et vous semblez vraiment à demi-mort de faim. Hé, Muki ! veux-tu, en toute hâte, mettre à cuire le bifteck du dîner ? »
Mukoki s’empressa de bousculer bouillottes, grils et casseroles. Tandis que Rod s’asseyait devant la table, Wabi lui donna dans le dos une tape affectueuse et se mit gaîment à fredonner une bribe de chanson, tout en découpant des tranches de pain.
« Oui, vraiment, dit-il, il me plaît de vous voir de retour. Je commençais à m’inquiéter. En votre absence, nous avons eu, Mukoki et moi, une abondante récolte de nos pièges. Nous avons rapporté ici un renard croisé (cela fait le second) et trois visons. Et vous, avez-vous tiré quelque chose ?
— Pourquoi ne regardez-vous pas dans mon ballot ? »
Wabi se tourna vers le paquet.
« Il y a quelque chose là-dedans ? demanda-t-il, à la fois curieux et méfiant.
— Mais voyez donc vous-mêmes, mes petits ! s’exclama Rod, oubliant, dans son enthousiasme, la comédie qu’il jouait. Je vous ai toujours affirmé que le ravin contenait un trésor ! Eh bien, il y était. Et je l’ai trouvé. Regardez plutôt dans le paquet, si le cœur vous en dit ! »
Wabi laissa choir son couteau et alla vers le ballot. Il le toucha du bout du pied, le soupesa de la main et regarda Rod à nouveau.
« Ce n’est pas une plaisanterie ? interrogea-t-il.
— Pas le moins du monde. »
Et, tournant le dos à la scène, Rod commença à enlever son veston de chasse, aussi froidement que si c’eût été pour lui l’acte le plus ordinaire d’apporter au camp des renards d’argent.
Il se retourna seulement lorsque Wabi poussa un cri aigu, à moitié étouffé, et il le vit qui tendait la bête aux regards ébahis de Mukoki.
« Est-ce un bon ? demanda Rod.
— Une splendeur ! » murmura Wabi.
Mukoki avait, à son tour, pris l’animal et il l’examinait, d’un air de connaisseur.
« Très beau, dit-il. A la factorerie, lui valoir cinq cents dollars. A Montréal, trois cents de plus. »
Wabi fit un pas vers Rod et, lui tendant la main :
« Serrez-moi ça ! » dit-il.
Et, tandis que tous deux se donnaient une solide poignée de mains, il vira vers Mukoki :
« Vous êtes témoin, Muki, proclama-t-il, que ce jeune gentleman n’a plus rien d’un apprenti. Il a tué un renard d’argent. Il a, faisant cela, accompli en un jour la besogne de tout un hiver. Je tire mon chapeau bien bas devant vous, Mister Drew ! »
Un afflux de sang au visage de Roderick témoigna de son plaisir.
« Et ce n’est pas tout, Wabi ! » ajouta-t-il.
Ses yeux brillaient intensément, tandis que Wabi lui serrait toujours la main dans la sienne.
« Vous ne voulez pas dire, j’imagine, interrogea le boy, que vous avez trouvé… »
Rod lui coupa la parole.
« Non, je n’ai pas trouvé d’or. Il y en a cependant là-bas, je le sais. Mais je possède désormais la clef du secret. Vous vous souvenez comme moi que celui des deux squelettes qui était ici, accoté contre le mur, tenait dans les os de ses doigts une écorce de bouleau ? Eh bien ! c’est cette écorce qui nous donnera, j’en ai la foi, la clef de la mine d’or. »
Mukoki s’était approché et écoutait Rod avidement. Wabi semblait moitié sceptique, moitié convaincu.
« C’est possible, après tout ! dit-il. On peut toujours voir. »
Il alla vers le poêle et en retira le bifteck à moitié cuit. Rod renfila sa grosse veste, reprit sa casquette, et Mukoki s’arma de sa bêche et d’une pelle. Il y avait eu, entre les trois compagnons, une tacite entente de remettre à plus tard le dîner.
Wabi était silencieux et pensif, ce qui prouvait à Rod que sa suggestion ne l’avait pas laissé indifférent. Quant aux yeux de Mukoki, ils brasillaient comme le jour où les premières pépites avaient été découvertes.
Les squelettes n’avaient été enfouis qu’à une faible profondeur, dans la terre gelée, à l’orée du bois de cèdres, et Mukoki les ramena rapidement au jour. Un des premier débris qui apparut fut la main crispée sur le rouleau d’écorce de bouleau. Ce fut Rod qui s’agenouilla pour le dégager.
Avec un frisson au contact des froids ossements, il brisa les doigts. Un de ceux-ci craqua, avec un bruit sec, et lorsqu’il se releva, ayant accompli sa tâche macabre, en tenant le rouleau d’écorce, Rod était livide. Les squelettes furent aussitôt recouverts de terre et les trois compagnons revinrent à la cabane.
Ils se rassirent autour de la table, toujours silencieux, tant était grande leur émotion, et commencèrent à dérouler l’écorce. Celle-ci avait séché et s’était recroquevillée avec le temps ; elle était presque aussi mince et dure qu’un rouleau d’acier. Pouce à pouce, elle fut dépliée, avec de petits craquements intermittents, qui semblaient une timide protestation contre le sort qu’on lui faisait subir. Elle formait une bande ininterrompue d’environ dix pouces de long, sur six de large.
Cette bande, au début, demeurait blanche. Après avoir cédé, elle résista.
« Attention ! » murmura Wabi.
Et, de la pointe de son couteau, il décolla les parties encore cohérentes.
« Il n’y a rien, il me semble… » dit timidement Roderick.
Deux ou trois pouces furent encore déroulés et une marque noire apparut, dont il était difficile de comprendre la signification et d’où partait une ligne, qui se continuait dans la partie roulée.
A ce moment, le reste de l’écorce céda brusquement et la fameuse clef se déploya tout de son long sur la table, sous l’aspect d’une carte-plan ou du moins de ce que les trois chasseurs supposèrent en être une.
C’était plutôt une sorte de diagramme, assez grossier, composé de lignes droites ou crochues, avec, çà et là, un mot en partie effacé, qui lui servait de commentaire. D’autres mots étaient devenus complètement illisibles.
Mais ce qui frappa le plus, tout d’abord, l’attention du trio, ce furent plusieurs mots, tracés d’une écriture cursive sur l’uniforme croquis, et qui étaient nettement distincts.
Roderick lut tout haut :
« John Ball, Henri Langlois, Peter Plante. »
En travers du mot John Ball, un large trait noir avait été tiré, qui l’avait presque entièrement biffé, et, à l’extrémité de la ligne formée par les trois signatures, un autre mot français était écrit, entre parenthèses. Mot que Wabi traduisit aussitôt :
« Mort. »
Et il ajouta, avec un soupir indigné :
« John Ball mort. Les deux Français l’auront tué ! »
Sans répondre, Roderick s’était penché sur la bande et y promenait son doigt tremblant. Le premier mot qui accompagnait le diagramme était totalement inintelligible. Du suivant on ne distinguait qu’une lettre, qui n’en apprenait pas plus long.
Rod continua son examen. Arrivé au point où un trait transversal, plus large et crochu, sectionnait le trait principal, deux mots étaient demeurés très distincts :
« Deuxième cascade. »
Puis, un demi-pouce plus loin, en lettres dispersées, on lisait :
« T…….. c..c..e. »
« Cela, dit Rod, signifie : Troisième cascade ! »
Là cessaient les traits du dessin. Au même endroit, entre celui-ci et les trois signatures, plusieurs lignes d’écriture se devinaient. Mais il était impossible d’en rien déchiffrer, tellement l’encre en avait pâli. Ces lignes, cependant, donnaient, à n’en pas douter, la clef même du mystère de l’or perdu.
Rod releva les yeux et l’excès du désappointement se peignit sur son visage. Il savait maintenant que, dans ces lignes annihilées par le temps, était enclos le secret d’un grand trésor. Mais il n’en était toujours pas plus avancé. Tout ce qu’il lui était donné de connaître, néanmoins, c’est que, quelque part dans les vastes solitudes du Wilderness, il y avait trois cascades. En un endroit imprécis, entre la seconde et la troisième, l’Anglais et les deux Français avaient découvert de l’or.
Où cela ? Et où étaient les cascades ? Rod n’en avait pas rencontré dans le ravin et il n’y en avait point non plus dans les environs de la vieille cabane. Le terrain avait été maintes fois exploré en tous sens par les trois compagnons, au cours de leurs randonnées de chasse et de la pose de leurs pièges.
Tout à coup Wabi, qui regardait Rod et semblait réfléchir, prit la bande de bouleau dans ses mains et la considéra de plus près. A un moment sa figure s’anima :
« Par saint Georges, s’écria-t-il, il nous faut peler cette écorce ! Regarde un peu, Muki. Rien n’est plus facile, n’est-ce pas ? »
Et il tendit la bande au vieil Indien. Puis il expliqua à Rod :
« L’écorce de bouleau est composée de couches successives, chacune d’elles aussi fine que le plus fin papier. L’encre a dû pénétrer plusieurs de ces pelures. Si nous parvenons à enlever la couche supérieure, celle qui est au-dessous nous apparaîtra, j’imagine, avec une écriture aussi fraîche qu’il y a cinquante ans. »
Déjà Mukoki, s’étant rapproché de la lumière de la porte, s’était mis au travail et, avec sa bonne grimace, les deux boys l’entendirent qui criait :
« Bien peler ! »
Une pellicule, infiniment ténue, commençait en effet à se soulever. Une demi-heure durant, il s’appliqua à sa tâche délicate, tandis que Rod et Wabi le contemplaient avec admiration. Lorsqu’il se redressa, sa tâche était terminée.
Rod et Wabi, ayant reçu la bande de ses mains, poussèrent un long cri de joie. Les mots incomplets pouvaient maintenant se lire à merveille. Là où il n’y avait auparavant que trois lettres, apparaissait comme Rod l’avait deviné : Troisième cascade. Tout à côté était le mot cabane. Et plusieurs lignes d’écriture l’avoisinaient, que Rod lut à haute voix :
« Nous, John Ball, Henri Langlois et Pierre Plante, ayant trouvé de l’or à la troisième cascade, nous décidons, par le présent acte, de nous associer pour l’exploitation de cet or. Nous nous engageons à oublier nos querelles passées et à travailler de compagnie, avec une bonne volonté et une honnêteté mutuelles, avec l’aide de Dieu.
Signé : John Ball, Henri Langlois, Peter Plante. »
Dans la partie supérieure du graphique il y avait encore d’autres mots, moins distincts, mais que Rod parvint cependant à déchiffrer. C’est là, du coup, que son émotion fut à son comble. La parole lui resta collée au gosier et ce fut Wabi, dont le souffle haletant lui brûlait la joue, qui lut :
« Ici, cabane et extrémité du ravin. »
Mukoki, après avoir entendu, à demi-étourdi de tant d’imprévu merveilleux, s’était repris à songer au dîner et avait remis sur le feu la poêle et le bifteck d’élan.
« Eh bien ! reprit Wabi, au bout d’un instant, vous avez, Rod, trouvé votre mine d’or ! C’est bien du petit torrent qui est dans le ravin qu’il s’agit. Vous voilà maintenant un homme riche !
— Notre mine d’or, voulez-vous dire, corrigea vivement le jeune homme. Nous sommes trois, nous aussi, et nous prendrons tout naturellement, dans notre association, les places respectives de John Ball, d’Henri Langlois, de Pierre Plante. Ils sont morts. L’or est à nous ! »
Wabi s’était remis à examiner la carte de bouleau.
« Il me paraît réellement impossible, dit-il, que nous ne trouvions pas l’endroit. Les indications fournies sont aussi claires que la lumière du jour. On suit le ravin et, à une distance donnée, on rencontre une première cascade. On continue, et le torrent, devenu plus important, fait un second saut. Une cabane est là, et l’or n’est pas loin. »
Il revint vers la porte, avec l’écorce, et Rod le rejoignit.
« J’ai beau chercher, dit Wabi, je ne trouve aucun renseignement concernant la distance. Combien de milles, Rod, estimez-vous avoir parcourus dans le ravin ?
— Une dizaine au moins.
Et vous n’avez vu aucune cascade ?
— Aucune. »
A l’aide d’une brindille de bois, Wabi repéra la longueur comparative qui séparait les divers points indiqués sur le graphique.
« Je ne doute pas, dit-il, que cette carte n’ait été tracée par John Ball. Vous remarquerez que tout ce qu’il y a d’écrit l’a été par la même main, sauf les signatures de Langlois et de Plante, qui ne sont qu’un affreux griffonnage. Ball, au contraire, écrivait bien et paraît avoir été un homme de bonne éducation. N’est-ce pas votre avis ? Il serait étonnant, dès lors, qu’il n’ait point, dans son tracé, tenu compte des distances. Or, l’espace qui est entre la première et la seconde cascade est moitié moindre de celui qui sépare celle-ci de la troisième. Ceci est voulu, évidemment. »
Rod approuva.
« D’où nous conclurons, dit-il, qu’une fois trouvée la première cascade, nous pourrons évaluer, approximativement, les autres distances.
— Parfaitement, reprit Wabi.
— J’ai parcouru le ravin durant dix milles. Admettons que nous trouvions la première cascade à quinze milles. La seconde, d’après notre graphique, serait à vingt milles au delà, la troisième à quarante milles plus loin. Ce qui nous donne un total de soixante-quinze milles environ. »
Wabi estima que c’était bien raisonné. Puis il se gratta la tête, d’un air perplexe.
« Admettons vos chiffres, dit-il. Cascade troisième, cabane et gisement d’or de soixante-quinze milles d’ici. Mais alors, par saint George ! pourquoi les trois hommes étaient-ils dans cette cabane où nous sommes, avec seulement une poignée de pépites en leur possession ? L’or ne leur aurait-il pas joué un méchant tour et n’auraient-ils trouvé, en tout et pour tout, que le contenu du petit sac de peau de daim ?
— C’est une objection, avoua Rod, qui a sa valeur… »
A ce moment, Mukoki, qui retournait le bifteck dans la poêle, éleva la voix :
« Peut-être, dit-il, eux aller à la factorerie pour ravitaillement. »
Wabi tressauta.
« Tu as trouvé, Muki, l’explication du problème ! Tout finit, à la longue, par se débrouiller. »
Il se tut une minute et reprit :
« Je puis certainement me tromper, mais voici, à mon sens, comment l’aventure peut, dans son ensemble, se reconstituer. Ball et les deux Français ont, primo, découvert, par hasard ou autrement, le gisement d’or. Et ils ont travaillé le sol jusqu’à épuisement de leurs vivres. Secundo, un petit ou un gros trésor, nous l’ignorons exactement, a été réuni par eux. Comme les vivres font défaut, il est convenu que les deux Français iront se ravitailler à la factorerie. Wabinosh-House était, à cette époque, le poste le plus rapproché auquel ils pouvaient s’adresser. Avant de partir, ils assassinent Ball, afin de s’approprier ultérieurement sa part. Tertio, ils partent en n’emportant avec eux que juste assez d’or pour payer les marchandises dont ils ont besoin. Il pouvait être imprudent, en effet, d’exciter la convoitise d’autres aventuriers qui se rencontreraient avec eux à la factorerie. Quelques pépites passeraient inaperçues. Arrivés à cette cabane, ils y font halte. Plante ou Langlois, l’un des deux, médite alors de se débarrasser de son compagnon, comme il avait été fait de Ball, et de s’approprier, à lui seul, et le graphique et la mine, et le sac de pépites, et la possession finale du trésor mis en réserve. Ils se battent et se tuent mutuellement. Et voilà !
— Bravo ! fit Rod. Vous avez, Wabi, un esprit admirable.
— Et le trésor amassé par eux, nous le trouverons aussi, enterré sans doute quelque part près de la troisième cascade ! »
Les deux boys furent interrompus dans la construction de leurs châteaux en Espagne par Mukoki.
« Dîner prêt ! » appela-t-il.
Rod jusque-là, n’avait pas encore parlé de la piste mystérieuse, rencontrée par lui dans le ravin. Le rouleau de bouleau avait accaparé tout l’intérêt des trois compagnons.
Cette fièvre une fois calmée, et tout en mangeant, le jeune homme conta les étranges allées et venues du Woonga, quelque espion, pensait-il. Mais il n’insista pas sur les craintes qui le tourmentaient, sur ce chapitre. Autant valait laisser Wabi et Mukoki à leur béate quiétude. Ils étaient, en réalité, assez incapables de l’expliquer. Le fait que les Woongas, dans un but qui paraissait énigmatique, semblaient avoir, autant qu’eux trois au moins, le désir d’éviter une rencontre, de ne se trouver jamais sur leur piste, et ne les avaient jamais attaqués de face ou dans quelque embuscade, si souvent facile à dresser ; toute cette passivité apparente de l’ennemi, qui pourtant rôdait autour d’eux, était anormale au premier chef. Cependant, la quiétude présente semblait suffisante à Wabi et à Mukoki. Peut-être songeaient-ils qu’il serait suffisant de s’alarmer lorsque le danger se préciserait.
Le récit de Rod ne souleva pas une émotion particulière et des préparatifs immédiats furent envisagés, pour aller à la découverte des trois cascades.
Il fut convenu que ce voyage d’exploration serait confié à Mukoki, dont l’endurance était supérieure à celle des deux boys et la marche plus rapide. Dès le lendemain matin, il partirait, avec une provision de vivres. Rod et Wabi, en son absence, s’occuperait des pièges.
« Il nous faut tout au moins, déclara Wabi, trouver la première cascade, avant de revenir à la factorerie. Nous aurons ainsi une quasi-certitude de la réalité de nos déductions. Mais si, réellement, cent milles nous séparent du but final, nous devrons renoncer à aller quérir notre or en cette saison. Nous retournerons tranquillement à Wabinosh-House et y préparerons tout à loisir une nouvelle expédition, avec des provisions renouvelées et les outils convenables. Cela ne pourra se faire qu’au printemps prochain, après la fonte des neiges et les inondations qui la suivent.
— C’est bien ce que je me suis dit, répliqua Rod. Mais je ne serai plus, alors, près de vous. Vous savez que j’ai une mère, Wabi, et qu’elle est seule ! »
Et ses yeux se mouillèrent légèrement.
« Oui, je comprends, dit Wabi, en posant sa main sur le bras de son camarade.
— Ses fonds doivent être en baisse, à cette heure. Peut-être est-elle ou a-t-elle été malade. Il faut tout prévoir…
— Et vous devez retourner près d’elle, après avoir réalisé le prix de vos fourrures, acheva affectueusement Wabi, en formulant pour Rod sa pensée. Je pourrai même vous accompagner dans ce petit voyage. Croyez-vous qu’il lui serait agréable de me revoir ?
— Si je le crois s’exclama Rod. Mais elle vous aime autant que moi, Wabi ! Elle battrait des mains en vous apercevant ! Mais parlez-vous sérieusement ?
— Je ne promets rien, d’une façon ferme. Ce que je veux seulement vous dire, c’est que j’irai, si je le peux.
— Et toi, Mukoki ? Veux-tu venir aussi ? »
Le vieil Indien grimaça, gloussa et grogna, mais ne souffla mot.
Wabi répondit pour lui.
« Il tient trop, dit-il, à rester près de Minnetaki. Il est son authentique esclave, vous le savez, Rod. Non, non, Mukoki n’ira pas, je le parierais. Il demeurera à la factorerie pour veiller sur ma sœur, pour avoir soin qu’elle ne se perde pas, ne se blesse pas, ou ne soit pas à nouveau enlevée par les Woongas. Eh ! Mukoki ? »
Mukoki remua sa tête de haut en bas, avec une grimace heureuse. Puis il alla vers la porte de la cabane, l’ouvrit et regarda dehors :
« Neige ! cria-t-il. Neige comme vingt-cinq mille diables ! »
C’était le plus énergique des jurons qu’avait l’habitude de proférer le vieil Indien et il n’en usait que dans les circonstances importantes.
Rod et Wabi firent chorus avec lui. Jamais encore le jeune citadin n’avait vu une tempête de neige pareille à celle qui se préparait. L’heure était arrivée de la grande chute annuelle du Nord, qui ne manque jamais aux pays arctiques. Elle avait été, cette année, en sensible retard.
Les flocons tombaient, doucement, lentement, sans encore un souffle d’air qui les agitât. C’était comme une blanche et muette marée, impénétrable à l’œil, si dense qu’elle semblait étouffer l’atmosphère et suffoquer la respiration.
Rod étendit la paume de sa main et, en un instant, elle fut recouverte d’un épais coussin. Il avança un peu, et ce n’était plus déjà qu’une ombre spectrale, à peine perceptible à ses compagnons. Lorsqu’il rentra dans la cabane, au bout d’une minute, il apportait sur lui toute une charge de neige.
L’avalanche neigeuse continua sans interruption durant l’après-midi, et pendant la nuit pareillement. Vers le matin, Rod entendit le vent, qui s’était élevé, siffler et hurler dans les arbres voisins et contre les murs de la vieille cabane. Il se leva et ranima le poêle, tandis que Wabi et Mukoki dormaient encore.
Il tenta d’ouvrir la porte. Elle était bloquée. Il poussa les volets de la fenêtre et un plein baril de neige s’abattit sur lui. Aucune lueur de jour n’était encore visible.
En se retournant, il aperçut Wabi assis sur ses couvertures et qui riait sous cape à l’aspect de son camarade ahuri et consterné.
« Qu’est-ce qui se passe donc en notre pauvre monde ? demanda Wabi, avec un gros soupir. Serions-nous ensevelis sous la neige ?
— J’espère que non, répondit Rod, en jetant vers le poêle qui ronflait un regard inquiet. Enseveli, Wabi…
— En tout cas, nous ne le sommes pas complètement. Si j’en crois ce bon feu, le sommet de la cheminée émerge encore ! »
Mukoki s’éveilla à son tour et s’étira les membres. Et, comme un rugissement formidable passait sur la cabane :
« Vent souffler très fort ! dit-il. Tout à l’heure souffler plus fort ! »
Rod repoussa dans un coin, avec une pelle, la neige introduite par lui et barricada à nouveau les volets, tandis que ses compagnons s’habillaient.
« En voilà pour une semaine, après cela, à déterrer nos pièges, déclara Wabi. Mais le Grand Esprit, qu’adore Mukoki et qui envoie à son pays toutes sortes de bénédictions (celle-ci en est une), sait seul quand cessera la tourmente. Elle peut durer une semaine. Ce n’est pas l’occasion d’aller chercher notre cascade !
— Il nous reste la ressource de jouer aux dominos, suggéra Rod, dont le front s’était rasséréné. Je me souviens justement d’une certaine partie que nous avons laissée en plan à Wabinosh-House et que nous n’aurons qu’à reprendre. Mais croyez-vous sincèrement qu’il n’a pas neigé suffisamment, hier après-midi et cette nuit, pour recouvrir cette cabane ?
— Ce serait déjà fait, expliqua Wabi, si la cabane ne se trouvait, avec le lac qui lui fait face, dans une dépression du terrain, ouverte à ses deux bouts, et où souffle un courant d’air perpétuel qui empêche la neige de s’accumuler. Mais si l’avalanche continue, nous serons, dès ce soir, sous une petite montagne.
— Et nous ne serons point étouffés là-dessous ? » balbutia Rod.
Wabi se prit à rire joyeusement, devant la naïve frayeur du jeune citadin, et une salve de gloussements de Mukoki, en train de découper des tranches de caribou, lui fit écho.
« Neige, très bonne chose vivre dessous ! » affirma sentencieusement le vieil Indien.
Et Wabi donna des explications plus circonstanciées.
« Fussiez-vous, Rod, sous une véritable montagne de neige qu’il vous serait possible de vivre. A moins, bien entendu, que vous ne fussiez écrasé sous son poids. La neige est amalgamée d’air respirable. Mukoki a été pris, une fois, sous un éboulement de neige et il y est demeuré enseveli, sous trente pieds d’épaisseur, dix heures durant. Il avait là un nid du calibre d’un simple tonneau. Et, quand nous l’avons délivré, nous l’avons trouvé aussi calme et à son aise que s’il eût été dans son lit. La neige a un autre avantage ; c’est de tenir chaud. Nous n’allons plus avoir besoin de brûler beaucoup de bois. »
Après le déjeuner, les deux boys rouvrirent le volet et Wabi fit, avec sa pelle, dégringoler peu à peu la neige qui obstruait la fenêtre. A la troisième ou quatrième pelletée, un gros bloc céda tout d’un coup et, par cette cheminée artificielle, la clarté du jour apparut. Les deux boys avaient de la neige jusqu’à la taille. En levant les yeux, ils virent la tempête tourbillonner toujours dans le ciel.
« La neige arrive à hauteur du toit… dit Rod, qui continuait à n’être qu’à moitié rassuré. Dieu bon, quelle tourmente !
— Et maintenant, dit Wabi, nous allons rire ! Rod, êtes-vous de la partie ? »
En parlant ainsi, il avait rampé à travers la fenêtre, dans la cavité neigeuse, et tentait de se hisser dehors. Une nouvelle masse de neige céda brusquement, laquelle tomba en plein sur Rod qui suivait.
Rod en fléchit les genoux. Il se débattit, pour se dégager, et ne put retenir un cri. Wabi, qui était arrivé à l’air libre se pencha sur le trou et se mit à s’esclaffer. Son ami était tout à fait grotesque, avec ses yeux clignotants, ses oreilles et sa bouche pleines de neige, et ses habits enfarinés.
« Hum ! Hum ! Hum ! » lui cria Wabi, qui en riait aux larmes.
Rod, cependant, s’était secoué et, en se tortillant de droite et de gauche, comme un poisson, il s’était remis à grimper. Wabi lui saisit les bras et le tira dehors. Mukoki suivit ensuite.
Profitant d’une accalmie dans la tempête, les trois compagnons s’avancèrent dans la neige molle. En se retournant, ils virent le monticule que formait la cabane et d’où pointait un bout de cheminée fumante.
Rod fut stupéfait du spectacle qui se déroulait autour de lui. La neige avait tout nivelé. Les menus plis du sol avaient disparu. Plus un rocher n’émergeait. Seuls, les arbres, entièrement emmitouflés d’une blanche carapace, bosselaient encore, çà et là, l’immensité blanche.
Il en fut comme anéanti. Maintenant seulement le Grand Désert Blanc lui apparaissait. Qu’allaient-ils devenir désormais ? Où trouveraient-ils même une bête à tuer et à manger ?
Lorsque le trio eut réintégré la cabane, Wabi rassura son camarade.
« Dans toute la zone, dit-il, où sévit la tempête, vous ne trouveriez pas, à cette heure, une seule créature en train de circuler. Tous les élans, tous les rennes, tous les caribous, les renards et les loups sont ensevelis sous la neige. Et, plus la neige est épaisse sur eux, plus ils auront chaud et s’en trouveront bien. C’est une aimable pensée qu’a eue là le Créateur de faire, pour eux, naître le bien de l’excès du mal. Dès que cette crise atmosphérique aura cessé, le Wilderness s’éveillera à nouveau à la vie. L’élan, le renne et le caribou se lèveront de leur lit de neige et recommenceront à grignoter les branches des sapins. Une croûte dure se formera sur la neige molle et, comme les renards, les lynx et les loups, les plus petites bestioles se remettront à trottiner et à se dévorer entre elles. Si les derniers torrents sont congelés, tous ces animaux lècheront la glace ou mangeront de la neige, en guise d’eau. Dans la neige encore ils se creuseront, avec leurs pattes, de chaudes cavernes, qui remplaceront pour eux la mousse estivale des bas-fonds, l’abri des buissons et des feuilles mortes. Enfin, les gros quadrupèdes, élans, rennes et caribous, en piétinant et en tassant sous leurs sabots de grandes surfaces de neige, s’établiront à eux-mêmes des sortes de corrals, où ils se rassembleront en grands troupeaux et se battront de compagnie contre les loups, en attendant le printemps. Croyez-moi, Rod, la vie pour toutes ces bêtes ne sera pas si mauvaise que vous le pensez. »
Jusqu’à midi, les trois chasseurs travaillèrent à creuser devant la porte une tranchée. Mais la tempête reprit, dans l’après-midi, interrompant leur besogne et la rendant inutile. Il n’y eut ainsi, pendant trois jours, que d’intermittentes accalmies.
Avec l’aurore du quatrième jour, tout s’apaisa, le ciel s’éclaircit et le soleil apparut.
Tellement aveuglant fut son éclat, que Rod, comme tous ceux qui ne sont point accoutumés au Wilderness, en put craindre une ophtalmie. Les cristaux de neige scintillaient comme autant de points électriques, lui brûlant douloureusement les prunelles.
Tandis qu’il s’aguerrissait, en compagnie de Wabi, Mukoki, le second jour, quitta la cabane, pour se mettre en quête de la première cascade. Rod lui avait indiqué l’étroite fissure, qui permettait de parvenir sans peine au fond du ravin.
Les deux boys, durant ce temps, s’occupèrent de repérer les pièges et de les déterrer. C’était un travail ardu et la perte était, en moyenne, d’un piège sur quatre.
Deux journées y furent employées et, lorsqu’à la fin de la deuxième, Wabi et Rod s’en revinrent à la cabane, à l’heure du crépuscule, ils comptaient bien retrouver Mukoki les attendant.
Mais le vieil Indien n’était pas de retour. Une journée encore passa, puis une autre, qui était la quatrième depuis son départ. En quatre jours, Mukoki pouvait parcourir près de cent milles. Rien ne lui était-il arrivé ? Rod songea plusieurs fois aux Woongas, embusqués peut-être dans le ravin. Mais, comme de coutume, il garda pour lui ses réflexions.
Quoique le rendement des pièges, depuis quatre soirs, eût été excellent (le manque de nourriture rendait les animaux moins défiants et un loup, deux lynx, un renard rouge, huit visons avaient été capturés), les deux boys ne quittèrent pas la cabane, de tout le jour. Une angoisse leur serrait le cœur, en songeant à Mukoki.
Leur crainte était vaine. A la tombée du jour, ils aperçurent une forme qui apparaissait de l’autre côté du lac, sur le sommet de la colline. C’était Mukoki. Ils lui envoyèrent leur joyeux salut et, sans prendre même le temps de chausser leurs raquettes, ils coururent à sa rencontre. Quelques minutes après, tout le monde était réuni.
Le vieil Indien souriait, d’un air bonhomme, et à l’ardeur interrogatrice des yeux des deux boys il répondit :
« Trouvé cascade. Cinquante milles d’ici. »
On s’en revint à la cabane et Mukoki s’effondra sur un siège, épuisé de fatigue. Rod et Wabi l’aidèrent à se déchausser et à enlever ses vêtements de route. Une pincée supplémentaire de café fut jetée dans la bouillotte.
« Cinquante milles ! répétait Wabi. La randonnée a été rude, mon pauvre Mukoki ! »
Un peu reposé, Mukoki expliqua :
« Oui, beaucoup trompé pour distance. Cinquante milles avant première cascade. Beaucoup moins de neige tombée par là. Petite cascade, pas plus haute que cabane. »
Rod avait repris le diagramme de bouleau.
« En ce cas, dit-il, en tenant compte des distances relatives de cette carte, nous ne sommes pas à moins de deux cent cinquante milles de la troisième cascade. »
Mukoki gloussa :
« Baie d’Hudson ! »
Wabi sursauta.
« Alors, le ravin ne continue pas vers l’est ? dit-il.
— Non, répliqua Mukoki, faire coude et tourner droit vers le nord.
— Écoutez-moi, mes petits ! déclara Wabi. Si le ravin et le torrent se dirigent au septentrion, ils aboutissent fatalement à la Rivière Albany. Or cette rivière se déverse dans la Baie de Jacques, qui n’est elle-même qu’une des échancrures profondes de la Baie d’Hudson. Cela revient à dire que notre mine d’or nous attend au cœur même du Wilderness, dans sa partie la plus inhospitalière et la plus rude, vers l’extrême Nord canadien. Toutes nos autres suppositions tombent du coup. Atteindre ce point est l’affaire d’une longue et aventureuse, et tout autre expédition, la plus hardie que nous puissions tenter.
— Hourrah ! cria Rod. Hourrah ! Voilà qui n’est pas pour nous effrayer. Ce sera pour le printemps prochain ; n’est-ce pas, Wabi ?
— Topez-là ! C’est entendu.
— Ravin s’élargir au delà des premières cascades, intervint Mukoki, et torrent devenir navigable. Faire canot d’écorce de bouleau et naviguer dedans.
— Encore mieux, alors ! conclut Wabi. Ce sera un voyage magnifique[12]. »
[12] Cette expédition vers la mine d’or est contée dans un autre roman de l’auteur, intitulé : Les Chasseurs d’Or. (Note des Traducteurs.)
Dès le lendemain, Mukoki recommençait à relever ses trappes. Vainement les deux boys lui conseillèrent de se reposer un peu. Il répondit que ses jointures s’ankyloseraient s’il demeurait seulement un jour sans remuer.
Au cours des deux semaines qui suivirent, les soins du « trapping » absorbèrent entièrement le temps et la pensée des deux chasseurs. Le temps était redevenu idéal.
Cela faisait plus de deux mois écoulés depuis le départ de Wabinosh-House et Rod commençait à compter les jours qui le séparaient encore de la piste du retour. Wabi avait calculé qu’ils possédaient une valeur totale de seize cents dollars en fourrures et en scalps de loups, et deux cents dollars en or. Le jeune citadin était donc assuré de s’en revenir près de sa mère avec une part de six cents dollars, qui équivalaient au salaire d’une année de son ancienne place.
Il ne cacha pas non plus à Wabi son ardent désir de retrouver Minnetaki. Wabi était heureux de voir ce penchant pour sa sœur se développer chez Rod et il s’amusait fréquemment à l’en taquiner. Rod, en réalité, caressait le secret espoir que Minnetaki mère, l’Indienne, autoriserait sa fille à l’accompagner avec Wabi, à Détroit, où il savait que sa mère à lui prendrait rapidement en affection la belle petite fille du Nord.
Une troisième semaine s’écoula encore. Il avait été décidé qu’elle serait la dernière et que, dans huit jours, ils reprendraient la direction de Wabinosh-House, où ils arriveraient vers le 1er février. Roderick ne contenait plus sa joie.
Un de ces derniers jours, Rod et Mukoki étaient partis en chasse, en laissant Wabi au campement. Rod s’était élevé, dès son départ, sur le sommet d’une des crêtes voisines, tandis que Mukoki se tenait à mi-côte, sur le versant opposé.
Au fait de la crête, Rod s’arrêta, en regardant autour de lui le paysage, qu’il dominait. Il distinguait nettement Mukoki, qui allait sur la neige, pareille à un petit point noir. Vers le nord, le Wilderness infini s’étendait à perte de vue, avec son ordinaire fascination. Vers l’est, à deux milles environ, quelque chose remuait, qu’il supposa être un élan ou un caribou. A l’ouest était, ou plutôt devait être la vieille cabane.
Un cri d’horreur involontaire s’échappa soudain de sa poitrine, et un second suivit.
Là où il pensait trouver la cabane s’élevait une épaisse colonne de fumée. Le ciel en était obscurci. Il lui sembla, en même temps, percevoir des coups de fusil.
Quoiqu’il sût bien que l’Indien n’était pas à portée de l’entendre, il hurla de toutes ses forces :
« Mukoki ! Mukoki ! »
Rod, alors, se souvint des signaux convenus au début de leur expédition et par lesquels ils s’appelleraient mutuellement au secours. Deux coups de son fusil retentirent ; puis, après un instant d’intervalle, trois autres, aussi précipités qu’il le put.
Il vit l’Indien, qu’il suivait des yeux, s’arrêter et se retourner, en paraissant écouter.
Il répéta son signal. Mukoki avait compris et, se balançant sur ses raquettes, prenait sa course dans la direction indiquée, en s’élevant, avec toute la rapidité possible, sur la pente neigeuse.
Rod continuait à tirer de temps à autre. Un quart d’heure après, Mukoki, haletant, l’avait rejoint sur la crête.
« Les Woongas ! cria Rod. Ils ont attaqué le campement ! Voyez ! J’ai entendu aussi des coups de fusil, des coups de fusil ! »
Mukoki regarda le nuage de fumée. Pendant une seconde, le vieux trappeur fixa la cabane qui brûlait. Puis, sans rien dire, il se mit à dévaler des pentes neigeuses, avec une vitesse vertigineuse.
Rod, emboîtant sa piste, arrivait à grand’peine à le suivre, mais une surexcitation folle était pareillement en lui. Sa figure était écorchée et saignait, au fouettement des branches de sapins, à travers lesquels Mukoki coupait en ligne droite.
De quelques minutes seulement le vieil Indien l’avait précédé, lorsqu’il atteignit comme lui la petite colline qui dominait le lac et le campement.
Devant eux, la cabane écroulée dans les flammes n’était plus qu’une masse fumante. Et point de Wabi !
Mais, à peu de distance de cette ruine, une forme humaine était couchée dans la neige. Rod saisit le bras de Mukoki et, sans que sa bouche convulsée pût articuler une parole, il la lui montra.
Le vieil Indien avait vu, lui aussi. Avec un inexprimable regard, il détourna ses yeux vers le jeune blanc. Si c’était Wabi ! Oui, si c’était lui ! voilà ce que disait ce regard… Ce n’était plus un homme que Rod avait devant lui, mais une bête sauvage, affolée de haine.
Tous deux ne firent qu’un plongeon vers le lac et vers ce qui avait été la cabane. Sur la forme humaine écroulée dans la neige, Mukoki s’agenouilla. Il la retourna, puis se redressa.
Ce n’était pas Wabi.
C’était un cadavre horrible, celui d’un Indien gigantesque, dont la tête avait été écrabouillée de balles.
Rod frissonna, mais respira un peu. Et ses forces alors l’abandonnèrent. Épuisé par sa course et par l’émotion, il tomba dans la neige, près du cadavre.
Mukoki, cependant, s’était mis à remuer les cendres chaudes de la cabane, avec son pied et avec la crosse de son fusil, nerveusement.
Rod comprit que, ce qu’il cherchait là, c’étaient peut-être les débris de Wabi, calciné et enseveli, qui sait ? dans les flammes et sous les décombres. Chaque fois qu’il voyait le vieil Indien se pencher sur un bout d’objet et l’examiner, il se sentait pâlir d’effroi.
Mukoki remuait infatigablement les bûches encore brûlantes et les charbons ardents, et l’odeur de ses mocassins roussis venait jusqu’à Rod.
A un moment, il jeta près du boy quelques cailloux, qui étaient les pépites d’or. Que lui importait, à lui, ce brillant trésor ! il ne songeait qu’à son Wabi bien-aimé, que les Woongas avaient dû surprendre à l’improviste, comme des lâches qu’ils étaient, comme des coquins, sur lesquels il assouvirait bientôt sa vengeance. Wabi et Minnetaki, toute la vie, pour lui, était là.
A demi-calciné lui-même, la figure toute noire, il revint finalement vers Roderick.
« Lui pas là ! » dit-il, en parlant pour la première fois.
Sur le cadavre il s’inclina à nouveau et, avec un ricanement triomphant :
« Beaucoup mort, celui-là ! » cria-t-il.
Il se mit alors à examiner les empreintes laissées dans la neige. Il constata facilement que les Woongas avaient tourné la cabane, par le bois de cèdres, et s’étaient, de ce côté, rués à l’attaque. D’autres empreintes indiquaient la direction dans laquelle ils étaient repartis. Cinq hommes avaient donné l’assaut. Quatre seulement s’en étaient allés. Le compte était bon.
Mais cela ne disait toujours pas ce qu’était devenu Wabi. S’il avait été capturé par les Woongas et emmené avec eux, il y aurait eu cinq pistes. Rod le comprenait aussi bien que son compagnon.
Pensif, Mukoki renouvela ses recherches dans le bûcher qui commençait à s’éteindre. Mais elles demeurèrent pareillement infructueuses. Ni Wabi n’était mort dans les flammes, ni les Woongas ne l’y avaient jeté, après l’avoir tué. La seule conclusion qui en résultait était que le jeune homme avait lutté, tué un de ses assaillants au cours de la bataille, et que, blessé sans doute, il avait été emporté par les quatre autres. Il fallait, à tout prix, par une poursuite rapide, rejoindre les ravisseurs. Peut-être leur avance n’était-elle que de quelques milles. Si oui, en une heure, ils pouvaient être ralliés.
Mukoki était revenu vers Rod, qui avait machinalement ramassé et mis dans une de ses poches les pépites, et semblait toujours singulièrement abattu.
« Moi suivre et tuer ! dit-il. Suivre vite et tuer beaucoup d’eux ! Vous rester. »
Roderick s’était soudain redressé.
« Tu veux dire, Muki, que nous allons les suivre et les tuer ! Car tu penses bien que je serai de la partie. Montre-moi le chemin ! J’emboîterai le pas derrière toi. »
Tous deux armèrent leurs fusils et partirent.
La piste des Woongas suivait le fond boisé qui continuait vers le nord. Au bout d’une centaine de yards, Mukoki s’arrêta et montra à Rod une des pistes d’homme qui était plus marquée que les autres.
« Celui-là, dit-il, porter Wabi. Eux ne pas marcher très vite. Perdre beaucoup de temps ! »
Et ses yeux s’allumèrent d’une joie sauvage.
Rod constata en effet que les enjambées des Woongas étaient plus courtes que les leurs, ce qui signifiait que leur marche était moins rapide. Mais pourquoi musaient-ils ainsi ? Pensaient-ils qu’ils ne seraient pas poursuivis ? C’était invraisemblable. Était-ce bravade de leur part, car ils avaient le nombre ? Ou projetaient-ils quelque embuscade ? A toute éventualité, Rod et Mukoki tenaient droit devant eux les canons de leurs fusils, prêts à épauler.
Un bruit guttural, émis par Mukoki, alerta Roderick. Le pas d’un cinquième homme était marqué sur la piste. Il comprit que Wabi avait été remis sur ses pieds et marchait maintenant en compagnie de ses ravisseurs. Il avait toujours ses raquettes et ses pas étaient aussi réguliers que les autres. Il n’était donc pas sérieusement blessé.
Les deux compagnons traversèrent un boqueteau de cèdres, où de vieilles souches entremêlées formaient d’inextricables réseaux. C’était, pour tendre une embûche, un endroit idéal. Le vieil Indien n’hésita pas cependant à avancer. La piste, au demeurant, empruntée par les Woongas à celle d’un élan, était nette et facile.
Moins aguerri que son compagnon, Rod s’attendait, à tout moment, à entendre claquer un fusil et à voir, devant lui, Mukoki tomber, la face sur la neige. Lui-même, il s’imaginait sentir la piqûre brûlante d’une balle, qui apportait la mort avec elle. Comment Mukoki, songeait-il, ne ralentissait-il point sa marche, dans un pas aussi dangereux ? Aveuglé par le danger de Wabi, en oubliait-il le sien propre ?
Le vieil Indien, dont la froide résolution était inébranlable, avait au contraire, profitant de l’excellence de la piste, encore accéléré sa vitesse. D’un geste, il montra à Rod que les empreintes devenaient plus fraîches. A peine la neige avait-elle, autour d’elles, repris son équilibre.
« Près, très près ! » murmura-t-il.
La piste se relevait sur une petite colline. En approchant du faîte, Mukoki, et Rod après lui, se courbèrent sur leurs raquettes et se mirent presque à ramper, le fusil à l’épaule.
Arrivés au sommet, ils virent… et en dépit du silence que lui avait prescrit Mukoki, Rod ne put retenir une exclamation arrachée à ses lèvres par l’effroi… ils virent, sur la pente de la colline qui s’éployait devant eux, les bandits Woongas marchant à la file, avec Wabi, les mains liées derrière le dos, qui suivait le chef de la troupe. Ce n’était pas tout. A un mille au delà montait la fumée d’un feu de campement, autour duquel on distinguait une vingtaine de formes allant et venant. C’était là, sans nul doute, le gros de l’expédition, qui attendait le retour des ravisseurs.
La situation était terrible. Comment affronter, à deux, des ennemis dont la supériorité numérique était telle ? D’autre part, laisser Wabi prisonnier… Comment y songer une minute ? Le sort qui lui était réservé se devinait trop facilement.
Rod se perdait dans ces pensées. Mais déjà Mukoki avait arrêté son plan.
Décrivant, suivi de Rod, et à une allure vertigineuse, un mouvement tournant, le vieil Indien s’était résolu à attaquer de flanc, tout d’abord, les quatre Woongas qui emmenaient Wabi. Moins de dix minutes après, les deux compagnons, qui avaient réussi à se dissimuler dans des touffes de sapins, se trouvaient embusqués sur la piste suivie par l’ennemi, qu’ils avaient réussi à gagner en vitesse.
Un éclair de joie passa sur la face cuivrée de Mukoki.
« Les voici ! » murmura-t-il à Rod.
Les Woongas approchaient, inconscients du péril. Mukoki posa sa main crispée sur le bras de Rod.
« Vous, dit-il, point trembler. Point manquer. Vous tirer premier homme, chef, devant Wabi. Moi prendre les autres.
— C’est compris, Muki ! Celui que tu me désignes, je l’abattrai raide, d’un seul coup. »
Et, dans sa main, il pressa celle de Mukoki.
Les brigands du Wilderness apparurent. La figure de Wabi était couverte de sang.
Presque à bout portant, Rod appuya sur la détente de son fusil. A moins d’une seconde d’intervalle, l’arme de Mukoki crépitait à coups redoublés.
Lorsque la fumée de la poudre fut dissipée, il ne restait debout qu’un seul Woonga. Celui qu’avait visé Rod gisait dans la neige, mort. Deux autres avaient été atteints par le chapelet de balles de Mukoki. L’un d’eux gisait aussi sans un mouvement ; le second titubait, les mains sur sa poitrine, prêt à tomber.
Le Woonga demeuré indemne avait poussé une clameur formidable, à laquelle répondit au loin un long hurlement, qui venait du camp où ses compagnons l’attendaient. Puis, avant que Mukoki eût rechargé son fusil et que Rod eût épaulé à nouveau, il avait disparu.
De deux coups de son couteau, Mukoki trancha les liens qui retenaient captives les mains de Wabi.
« Vous blessé mauvais ? » demanda-t-il.
Wabi secoua la tête et fit jouer ses mains raidies.
« Non ! Non ! Ce n’est rien, répondit-il. Je savais bien que vous viendriez… chers amis ! »
Rod alla vers le chef de la troupe, lui prit son fusil et son revolver.
« Le coquin ! dit-il. C’est là mon propre fusil et c’est mon propre revolver, que j’avais perdus, il y a trois mois. A chacun son bien ! »
Quant à Mukoki, il avait repéré le ballot que portait un des Woongas.
« Ce sont nos fourrures, dit Wabi. Les bandits n’ont pas omis de faire main basse sur elles, avant de mettre le feu à la cabane. Ils avaient sans doute attendu si longtemps, pour nous attaquer, à seule fin que la provision fût complète ! Ce sont de fameux scélérats. »
Mukoki avait déjà chargé le ballot sur son dos.
« Et maintenant, mes petits, dit Wabi, il faut nous trotter ! Toute la bande sera bientôt à nos trousses. Dommage que la cabane soit détruite ! Nous aurions pu nous y défendre avec avantage.
— Il y a le ravin ! cria Rod. La lutte peut y être bonne pour nous. Le tout est de l’atteindre ! »
« Le ravin, oui ! » avait répondu Wabi.
Mukoki approuva, d’un signe de tête.
Et Wabi prit la direction du trio, Rod au milieu, le vieil Indien fermant la marche, avec son ballot.
Tout en filant sur ses raquettes, Wabi demanda à Rod combien il avait sur lui de cartouches.
« Quarante-neuf, répondit le boy.
— Tout va bien. Passez-m’en une douzaine. Avec les huit que j’ai ramassées sur notre homme, je suis muni pour l’instant. »
Ils atteignirent ainsi, sans avoir été rejoints, la dépression où, ce matin encore, s’élevait la vieille cabane.
Soudain, il sembla à Rod que son cœur lui tombait dans la poitrine, comme un bloc inerte. Son pouvoir d’endurance était à bout. Sa première course derrière Mukoki, lorsqu’avait apparu la fumée de la cabane qui brûlait, celle ensuite pour rejoindre Wabi, cette dernière enfin, avaient épuisé ses forces. Ses muscles étaient brisés et il sentait qu’il lui serait impossible de continuer du même train jusqu’au ravin. C’étaient trois milles encore à parcourir !
Il tenta cependant un dernier effort. Mais il perdait visiblement de la distance sur Wabi, qui le précédait, tandis que derrière lui les raquettes de Mukoki heurtaient presque les siennes. Il pouvait entendre à ses oreilles le souffle rauque et infatigable du vieil Indien.
Le pauvre boy était d’une pâleur mortelle, la sueur lui perlait aux tempes et la respiration lui manquait. Ses genoux fléchirent et il s’affaissa sur la neige. Presque au même moment, les Woongas apparaissaient.
Ils n’étaient plus qu’à une portée de fusil. Une balle siffla :
Bzzzzzz-inggggg !
A deux reprises, Rod entendit passer près de sa tête cette chanson de la mort. Il vit la neige jaillir en l’air, sous chacune des deux balles.
Mais la riposte n’avait pas tardé. Sous les balles de Wabi et de Mukoki, deux des poursuivants s’écroulaient.
Les Woongas, par bonheur, étaient à ce moment en terrain découvert, tandis qu’un boqueteau de cèdres, à proximité immédiate des trois compagnons, leur offrait un abri, au moins momentané.
D’une main vigoureuse, Wabi empoigna son camarade et l’entraîna, le traîna plutôt, sur la neige.
Une grêle de balles siffla à nouveau, avant que les trois compagnons eussent atteint les larges troncs protecteurs des cèdres et se fussent dissimulés derrière eux. Un cri de souffrance de Mukoki indiqua qu’il était touché.
Le vieux trappeur jeta à terre son ballot.
« Est-ce sérieux, Muki ? haleta Wabi. Où la balle a-t-elle porté ? »
Mukoki, un peu chancelant, se redressa.
« Balle dans épaule gauche. Pas grave. Ballot fourrures avoir amorti coup. Nous très bien ici. Leur donner le Diable. »
Les Woongas, en effet, s’étaient arrêtés. Ils n’étaient qu’une demi-douzaine. Le reste de la bande s’échelonnait sur la neige, à des distances diverses. Dans la hâte de leur poursuite, ils n’avaient point pris le temps de chausser tous leurs raquettes et ceux qui n’en étaient point munis traînaient à l’arrière.
Les fusils de Wabi et de Mukoki recommencèrent à crépiter. Deux autres Woongas tombèrent, tués ou grièvement blessés. Le reliquat esquissa prudemment un mouvement de retraite, en attendant du renfort. Rod eut la force d’épauler et un troisième ennemi pirouetta sur lui-même, une jambe cassée.
« Hourra ! cria Wabi. On va pouvoir souffler un peu. »
Mais la tache de sang s’élargissait à l’épaule de Mukoki, et Rod, qui s’était remis sur pied, déclara qu’il pouvait marcher, si l’on n’allait pas trop vite.
Le parti de Wabi fut bientôt pris.
« Tous deux, partez devant ! dit-il. Je les tiendrai en respect, quelque temps encore, et je reculerai ensuite, en tiraillant dans les arbres. Si Dieu le veut, je vous rejoindrai au ravin. Votre piste me conduira. Rod, redonnez-moi quelques balles. »
Les secondes étaient précieuses. Mukoki reprit sur son dos le précieux ballot, qu’il ne prétendait pas abandonner, et, tout en clopinant, il se mit en marche, accompagné de Rod, qui n’était guère plus solide sur ses pieds.
Wabi, qui avait fait héroïquement le sacrifice éventuel de sa vie, demeura seul à l’affût.
Mais un flottement inexplicable parut se produire chez les Woongas. La bande, qui s’était réunie hors de la portée des balles, semblait partagée entre deux résolutions opposées. Les uns paraissaient ne point vouloir, à tout prix, laisser échapper leur proie et gesticulaient comme des possédés. Les autres se retournaient dans la direction du campement et, avec des gestes non moins expressifs, manifestaient leur désir de rebrousser chemin. Finalement, ils s’assirent par terre, dans la neige, et un émissaire se détachant du groupe, parut s’en aller chercher des ordres.
Wabi, ne sachant que penser, laissa s’écouler une dizaine de minutes. Après quoi, songeant, tout heureux, que Rod et Mukoki avaient pu, durant ce temps, prendre une avance appréciable, il recula, d’arbre en arbre, puis s’élança à toute vitesse sur la trace de ses deux compagnons.
Ils n’étaient plus qu’à un quart de mille du ravin et de la fissure par où ils comptaient y pénétrer, lorsqu’il les rejoignit.
Mukoki, de plus en plus affaibli par le sang qu’il perdait, fléchissait sous le poids des pelleteries. C’était au tour de Rod à l’encourager de son mieux.
La vue de Wabi, qui arrivait indemne, leur fut un réconfort. Un dernier effort les amena au ravin.
Comme ils allaient s’engouffrer tous trois dans l’étroite fissure, qui leur serait un sûr abri, une volée de balles siffla à leurs oreilles. Les Woongas, qui avaient repris la poursuite, les avaient rejoints. Il était temps !
Mais déjà les trois amis s’étaient postés chacun, le fusil à l’épaule, derrière un pan de rocher, dans l’étroit couloir. Ivres de fureur, et oubliant toute prudence, les Woongas se précipitèrent, tête baissée, dans la souricière qui leur était tendue. « Pan ! pan ! pan ! — Pan ! pan ! pan ! — Pan ! pan ! pan ! » A chacun des coups d’une triple décharge, un d’eux tomba, foudroyé à bout portant. Le reste, singulièrement diminué, reflua en arrière.
« J’ai comme une idée, dit Wabi, qu’ils ne recommenceront pas de sitôt à tenter l’aventure. »
Des six hommes abattus, deux remuaient encore. Ils furent achevés à coups de revolver.
Le sang de Mukoki avait cessé de couler, mais la faiblesse du vieil Indien était si grande qu’il faillit s’évanouir.
« Il faudrait, dit Rod, lui faire prendre quelque chose de chaud. Cela le ravigoterait. »
Et, tandis que Wabi montait la garde, il ramassa des brindilles de bois mort, entraînées, au printemps dernier, par la fonte des neiges, dans le couloir rocheux. Il en forma un petit feu.
Puis il déballa le menu paquet de provisions qu’il avait, au début de cette tragique journée, emporté avec lui, comme de coutume.
« Ce sont là, dit-il, toutes nos ressources. Deux poignées de café, une pincée de thé, du sel et quelques biscuits. C’est peu pour trois personnes. Mais c’en est assez pour rendre ses forces à Mukoki. Quant aux allumettes, j’en ai toute une boîte ! »
Le feu joyeux commença à flamber. Dans la minuscule casserole qui était jointe au paquet, Rod ramassa un peu de neige et, lorsque l’eau qu’elle produisit fut bouillante, il y jeta son café, dont le fumet ne tarda pas à embaumer l’air.
Mukoki avança la tasse qui pendait à sa ceinture et absorba lentement la boisson bienfaisante. Deux autres fois, l’opération se répéta, et les deux boys imitèrent Mukoki. Chacun d’eux mangea ensuite un biscuit et le vieil Indien fut amicalement contraint d’accepter double part. La souffrance qui était empreinte sur ses traits commença à se détendre.
Les fourrures furent ensuite déballées et servirent à aménager pour la nuit, dans une anfractuosité du rocher, deux lits chauds et moelleux. L’un d’eux était réservé à Mukoki ; l’autre servirait à Rod et à Wabi qui, alternativement, se reposeraient et monteraient la garde.
« A propos, demanda Rod, où est Loup ? »
Wabi se mit à rire.
« Retourné vers les siens ! Il hurlera ce soir, dans le Wilderness, à l’unisson de ses frères de race. Vieux bon Loup ! »
Le rire fit place, chez Wabi, à un geste de regret, et une tristesse émue passa dans sa voix.
« Il s’est laissé surprendre comme moi-même, dit-il. Les Woongas sont arrivés sans bruit, à contre-vent, derrière la cabane. Son flair n’a pu l’avertir. Moi-même, je ne les ai vus qu’à l’instant où ils allaient s’élancer sur moi. Je me trouvais à côté de lui, en train de lier des fagots. Rapidement, j’ai coupé avec mon couteau la lanière qui l’attachait.
— A-t-il combattu ?
— Pendant une minute ou deux. Mais un des bandits ayant tiré sur lui un coup de fusil, qu’il esquiva d’ailleurs, il fila dans les bois. »
Il y eut un silence. Les Woongas, en haut, ne donnaient plus signe de vie.
« Ce que je ne m’explique pas, reprit Rod, c’est qu’ils n’aient tendu d’embûche qu’à vous seul. Pourquoi, Mukoki et moi, nous ont-ils laissés tranquilles ? Cachés derrière un buisson, ils pouvaient aussi bien nous guetter et tirer sur nous.
— Parce qu’ils n’avaient que faire de vous deux. C’est à moi seul qu’ils en voulaient. Une fois que j’eusse été en leur pouvoir, ils seraient revenus vers vous, en parlementaires, et vous auraient envoyés à la factorerie, pour traiter de ma rançon. Ils auraient saigné mon père jusqu’au dernier dollar. Puis… ils m’auraient tué. Oh ! ils ne me l’ont pas caché, tandis qu’ils m’emmenaient ! »
A ce moment, une petite pierre ronde déroula, en bondissant, dans le couloir rocheux.
« Ils sont toujours là-haut ! ricana Wabi. Ils nous attendent à notre sortie. Ils ont dû faire rouler cette pierre par mégarde… C’est un avertissement. »
Et, pour changer la conversation :
« Et nos belles pépites d’or ! s’exclama-t-il. Qui sait ce qu’elles sont devenues ?
— Je l’ignore comme vous », répondit Rod.
Puis, tâtant une de ses poches :
« Je les ai là-dedans, dit-il. Je l’avais oublié. Mukoki les a trouvées dans la cendre. »
L’obscurité était tombée peu à peu.
« Attendons demain, murmura Rod. Ce n’est pas tout d’être arrivés ici. Ce qu’il faudra demain, c’est en sortir… »
La nuit s’écoula sans incident. Tandis que Mukoki reposait, Rod et Wabi se relayaient de faction.
Vers minuit, le ciel parut s’empourprer.
Rod, qui veillait, tira le bras de son camarade.
« Regardez ! » dit-il.
Wabi se frotta les yeux.
« On dirait, Rod, cette fois encore, un sapin qui brûle. Que se passe-t-il donc chez nos ennemis ? »
Un long hurlement de loup retentit, peu après, solitaire et pleurard.
« Qui sait ? murmura Wabi. C’est peut-être… Loup ! Il haïssait ses congénères, en compagnie de qui il lui faudra vivre désormais. A la longue il s’y fera. Il nous regrette, pour le moment… »
Dès que parut l’aube, les trois compagnons absorbèrent chacun une dernière tasse de café et se partagèrent les trois biscuits qui restaient. Le repos de la nuit avait été favorable à Mukoki, et sa nature de fer reprenait le dessus. Un lapin blanc, qui s’était aventuré dans le couloir rocheux et trottinait paisiblement, fut au passage assommé d’un coup de crosse, par Wabi. Il fut dépouillé encore chaud et fournit à point un rôti réparateur.
Il s’agissait maintenant de sortir du ravin et de regagner Wabinosh-House au plus vite. La suprême bataille allait se livrer avec les Woongas, demeurés sans doute à l’affût.
Rod s’offrit à aller observer ce qui se passait en haut du couloir.
Avec une prudence infinie, le fusil à l’épaule, il monta. Il savait qu’une balle pouvait l’abattre, à l’instant même où il risquerait un pied dehors. Il le fallait pourtant.
Il s’avança d’un pas, puis de deux. Sur la blancheur neigeuse qui bordait la crête du ravin, il n’y avait personne. Les Woongas avaient disparu ! Un reste de feu s’éteignait et, sur une piste différente de celle de la veille, des pas, tournés à l’opposé du ravin, s’en étaient allés.
Roderick revint en hâte prévenir Wabi et Mukoki. Le vieil Indien opina que ce pouvait être une feinte et que les Woongas avaient dû s’embusquer plus loin. Wabi demeura silencieux. Il se souvint du flottement qui s’était, la veille, déjà produit dans la poursuite de leurs ennemis. Qui sait si quelque fait, inconnu d’eux trois, n’était pas intervenu ?
Il était, de toute façon, impossible de demeurer là. Pour plus de sûreté, il fut convenu qu’au lieu de sortir par la même issue, les trois chasseurs gagneraient l’endroit où Rod était, une première fois, descendu dans le ravin.
Le ciel s’était assombri et le vent avait tourné au sud. De gros flocons de neige commençaient à voltiger dans l’air.
« Bon, bon, cela ! dit Mukoki. La neige recouvrir nos pas ! »
Et il rechargea sur son dos le ballot de peaux, qui avaient été ficelées à nouveau.
Ce ne fut pas sans peine que Roderick retrouva la place où la muraille opposée pouvait être escaladée. Rod et Wabi se firent mutuellement, de rocher en rocher, la courte-échelle. Mais plus difficultueusement Mukoki parvint à se hisser, gêné par sa blessure et avec son lourd paquet. La neige tombait toujours et point de Woongas.
C’est le vieil Indien qui fut ensuite promu chef de file. Il s’agissait, en effet, de regagner la factorerie par une piste toute différente de celle suivie au début du voyage, et en décrivant un cercle vers le sud, afin de s’éloigner le plus possible de l’ennemi.
Seul, Mukoki était capable de se lancer ainsi dans l’inconnu. Il semblait posséder ce sixième sens mystérieux, ce sens de l’orientation, instinct presque surnaturel qui, à des centaines de milles de distance, ramène le pigeon voyageur, droit comme une flèche, à son colombier.
Là où tout autre aurait hésité, ou se serait mille fois perdu, l’Indien allait, sans se tromper. A plusieurs reprises, Rod et Wabi lui demandèrent dans quelle direction se trouvait Wabinosh-House et, chaque fois, son bras se tendit, comme si son regard, à travers forêts, monts et plaines, voyait effectivement la factorerie devant lui.
Au bout de quinze milles, on fit halte pour se reposer et un petit feu fut construit près d’une vieille souche. On déjeuna avec les restes du lapin. Puis on se remit en route.
Tout le jour, on marcha ainsi, en terrain difficile. Tantôt il fallait escalader de nombreuses crêtes, tantôt on suivait des bas-fonds, où il était nécessaire de se frayer un chemin à travers des taillis touffus. Lorsque le soleil descendit à l’horizon, on campa pour la nuit, près d’un bois de sapins. La pincée de thé de Rod fut utilisée pour trois tasses et constitua le souper. Aucun gibier n’avait été rencontré.
Le jeune citadin, qui éprouvait des tiraillements d’estomac, n’osait pas se plaindre.
Mukoki parut deviner sa pensée.
« Demain, dit-il, tirer pour le déjeuner perdrix de sapins. »
Rod demanda :
« Et comment le sais-tu, Muki ? »
L’Indien lui montra le petit bois :
« Beaux sapins épais. Perdrix hiverner dedans à l’abri. »
Wabi avait déballé les fourrures, qui furent partagées en trois tas. Seules, trois larges peaux de loup en furent distraites. Tendues sur des branches de sapin, elles formèrent trois petits toits, sous lesquels les dormeurs s’étendirent de leur mieux.
Roderick, rompu de fatigue, ne tarda pas à reposer profondément. Mais Wabi et Mukoki ne prirent que des bribes de sommeil, s’éveillant de temps à autre pour recharger le feu et s’assurer que rien d’anormal ne se produisait.
Rod dormait encore, entre ses chaudes fourrures, lorsqu’il fut réveillé par trois coups de feu. Un instant après, Mukoki apparaissait, tenant à la main trois perdrix.
Le boy battit des mains. Jamais déjeuner ne lui parut meilleur. Les oiseaux furent mangés jusqu’à la carcasse.
La neige avait, durant la nuit, cessé de tomber. Avec le jour, ses rafales recommencèrent. A demi-aveuglée, la petite caravane marcha jusqu’à midi. Elle dut, alors, faire halte. On était maintenant assez loin de la région où évoluaient les Woongas pour n’avoir plus rien à redouter d’eux et un confortable abri fut construit, tout à loisir, avec des branches et des ramures de sapin.
« Nous ne devons plus être, observa Wabi, beaucoup distants de la piste de Kénogami-House. Peut-être même l’aurons-nous dépassée.
— Non, pas dépassée, répondit Mukoki. Encore un peu au sud. »
Wabi expliqua à Rod :
« La piste en question est une piste pour traîneaux qui, du Lac Nipigon, conduit à la factorerie de Kénogami-House, dont l’agent est un de nos meilleurs amis. Bien souvent, nous nous rendons visite. »
Plusieurs lapins furent tués et alimentèrent le déjeuner. Le reste de l’après-midi se passa presque entièrement à dormir, car les trois compagnons étaient harassés. Aucun incident ne troubla non plus la nuit qui suivit.
Le lendemain, le temps s’était éclairci. Mais la blessure de Mukoki s’était rouverte. Il importait de tuer quelque animal, autre qu’un lapin, pour en avoir la graisse et panser la plaie. Le vieil Indien fut donc contraint, bien malgré lui, de rester au campement, tandis que les deux boys s’en iraient en chasse, chacun de son côté.
Roderick marcha, une heure durant, sans rencontrer bête qui vive, en dépit de nombreuses traces de rennes ou de caribous. Il se désolait, lorsqu’il croisa, à sa vive surprise, une piste bien battue qui, de biais, coupait la sienne. Deux traîneaux, attelés de chiens, avaient passé là, depuis la neige de la veille, et, de chaque côté des traîneaux, des raquettes d’hommes avaient laissé leur empreinte. Roderick reconnut que les hommes étaient au nombre de trois et les chiens une douzaine. Il ne douta point que ce fût la piste de Kénogami-House et, poussé par la curiosité, il se mit à la suivre.
Un demi-mille plus loin, il constata que la petite troupe s’était arrêtée, pour cuire son repas. Une grosse bûche achevait de se consumer parmi les cendres et, tout autour du foyer, étaient éparpillés des os et des restes de pain. Mais ce qui surtout attira l’attention de Rod, ce fut d’autres empreintes qui, à cet endroit, se mêlaient aux précédentes. De dimensions moindres, elles ne pouvaient provenir que de pieds de femme.
Une de ces empreintes surtout était si étonnamment petite que, soudain, le cœur du jeune homme se souleva d’émotion. Le mocassin, en outre, dont le dessin était nettement marqué dans la neige, était muni d’un léger talon.
La pensée de Rod s’envola aussitôt vers Minnetaki. C’était la seule femme, à la factorerie, qui possédât un pied aussi minuscule. Elle était la seule qui portât des talons ! La coïncidence, tout au moins, était bizarre. Il examina de plus près les empreintes. Elles étaient semblables en tout à celles qu’il avait découvertes sur le sol, le jour où la jeune fille avait été enlevée par les Woongas, où il l’avait arrachée à ses ravisseurs.
Était-ce bien elle, ou était-ce une autre, qui avait passé par là ? Si c’était une autre, elle devait lui ressembler. Cette inconnue était-elle aussi jolie qu’elle ?
Voilà ce que se disait Rod, en revenant vers le campement, l’imagination envolée dans le rêve.
Wabi l’avait précédé. Il avait rapporté un jeune daim et ce fut l’occasion d’un véritable festin. Mais si Roderick n’avait pas été aussi heureux dans sa chasse, la nouvelle qu’il annonçait de la proximité de la piste qui reliait Wabinosh-House à Kénogami-House était d’importance et valait bien un beau coup de fusil.
Après des semaines d’isolement dans les solitudes sauvages du Wilderness, c’était un joyeux événement de se savoir si près d’autres hommes, qui étaient des civilisés et non des bandits du Désert. Rod, par contre, n’insista pas outre mesure sur les jolis petits pieds, qui plus vite avaient fait circuler le sang de ses veines. C’était s’exposer, il le savait, vingt-quatre heures durant, aux quolibets de Wabi. Il se contenta de mentionner le fait, en ajoutant, d’un air indifférent, que les pieds en question étaient dignes de Minnetaki.
Cette journée encore s’écoula à manger, se reposer et dormir, et à panser la blessure de Mukoki. Mais, dès l’aurore du lendemain, les trois compagnons, cessant de marcher vers le sud pour se diriger désormais vers l’ouest, entamèrent les dernières étapes du retour. Chemin faisant, Wabi se frappa soudain le front.
« Nous avons oublié, dit-il, notre belle tête d’élan, enfouie par moi dans son trou de glace ! Oh ! c’est dommage… Si nous retournions la chercher ! Qu’en dis-tu, Muki ? Un pareil trophée nous ferait singulièrement honneur. »
Mukoki avait pris la proposition au sérieux. Il hocha la tête.
« Woongas, dit-il, toujours là-bas peut-être. Pourquoi tomber encore dans gueule du loup ? »
Wabi se mit à rire.
« Rassure-toi, Muki. Nous n’irons pas. C’étaient pourtant de bien belles cornes ! »
Deux jours après, vers midi, d’une haute crête de montagne, le Lac Nipigon apparut au loin, à une centaine de milles environ.
Colomb, lorsqu’il posa le pied, pour la première fois, sur le continent qu’il venait de découvrir, ne fut pas d’une once plus heureux que Roderick Drew, lorsqu’il aperçut le terme de son long voyage. Là-bas, c’était la factorerie, d’où il était parti, et Minnetaki retrouvée ! Oubliant les raquettes qu’il avait aux pieds, il esquissa en l’air, tant bien que mal, un saut périlleux.
Tout l’après-midi, il s’emplit l’esprit de visions dorées. Ce serait d’abord Minnetaki qu’il rencontrerait. Serait-elle contente de le revoir ? Oui, sans doute. Mais sa joie à elle égalerait-elle son bonheur à lui ? Puis, dans trois semaines, il serait rentré dans son home familial, à Détroit, et c’est Mistress Drew, sa mère bien-aimée, qui lui ouvrirait ses bras. Et il aurait emmené Wabi avec lui ! La fatigue ne semblait plus compter pour ses muscles et sa bonne humeur ne tarissait pas. Il riait, il sifflait, s’essayait même à chanter.
Deux autres jours de marche furent nécessaires pour atteindre le Lac Nipigon et en contourner ou traverser sur la glace une partie.
Le soir de ce deuxième jour, comme le soleil, en un dernier adieu, descendait à l’horizon, rouge et froid dans sa gloire, sur la blanche froidure du Wilderness, les trois chasseurs atteignirent la petite colline boisée à laquelle s’adossait Wabinosh-House.
Ils s’engagèrent sous les arbres et, au moment où l’astre, au terme de sa course, disparaissait dans les noires ramures, les notes imprévues d’un clairon parvinrent, claires et sonores, jusqu’à eux.
Wabi avait dressé l’oreille et écoutait. Son front joyeux s’était assombri.
« Que signifie ceci ? » dit-il.
Rod s’exclama :
« Un clairon ! »
Le clairon se tut et, quelques secondes après, retentissait le « boum » lourd d’un gros canon.
« Si je ne me trompe, dit Rod, c’est la vesprée militaire. Vous avez donc des soldats à la factorerie ?
— Je n’en ai jamais vus, par saint George, répondit Wabi. Qu’est-ce que tout cela signifie ? »
Les raquettes dévalèrent à toute vitesse et, un quart d’heure après, les trois compagnons étaient devant Wabinosh-House. Les alentours de la factorerie avaient complètement changé d’aspect. Sur le terrain libre s’étaient élevées une demi-douzaine de maisons près desquelles allaient et venaient des groupes de soldats, portant l’uniforme de S. M. le Roi d’Angleterre.
Tandis que Mukoki regagnait discrètement le logis des employés de la factorerie et que Wabi se précipitait vers le home du factor, Rod continuait jusqu’aux magasins qui étaient en bordure du lac, et où il se souvenait que Minnetaki aimait à s’isoler et à rêver.
Mais son espoir fut déçu. La jeune fille ne s’y trouvait pas. Il revint vers la maison du factor.
Wabi l’attendait en haut des marches, à côté de son père et de sa mère, la Minnetaki indienne, qui lui souhaitèrent la bienvenue.
« Rod, écoutez cela ! lui dit Wabi, lorsqu’ils furent restés seuls ensemble, en attendant le dîner. Durant notre absence, les Woongas ont redoublé d’audace, mis presque en état de siège la factorerie, et tout le monde a vécu ici des heures tragiques. Devant leurs assassinats et leurs vols, le gouvernement leur a officiellement déclaré la guerre et a expédié des soldats, avec ordre de les traquer et de les exterminer sans merci ! »
Les yeux de Wabi étincelaient. Après un instant, il reprit :
« Les battues et les reconnaissances ont commencé, il y a quelques jours. S’ils ont fléchi dans notre poursuite et s’ils ont finalement abandonné dans le ravin la proie tant convoitée que nous étions pour eux, c’est, je n’en doute pas, qu’ils ont été, à ce moment, alertés sur leur arrière. Mais tout ceci n’est encore qu’escarmourches. Demain, les soldats se mettront en marche pour le grand nettoyage ! Vous demeurez, Rod, n’est-il pas vrai ? Et vous vous enrôlez avec moi pour toute la durée de la campagne…
— Je ne le puis, Wabi ! Non, vous le savez bien, ma mère m’attend, et c’est vous qui m’accompagnez. Les soldats de Sa Majesté peuvent marcher sans vous. Venez à Détroit et persuadez à votre mère de nous laisser emmener Minnetaki ! »
Wabi prit affectueusement les mains de Rod et les serra. Mais il répondit d’une voix rauque :
« C’est impossible. Mon devoir est ici ! Minnetaki non plus ne saurait vous accompagner. Elle n’est plus en ces lieux… »
Roderick chancela et devint tout pâle.
« Elle est en sûreté, rassurez-vous ! reprit Wabi. Mais ses nerfs et sa santé avaient été tellement ébranlés par les terribles épreuves subies durant ces deux derniers mois, que mon père a décidé de l’éloigner momentanément, jusqu’au terme des opérations en cours. Il aurait voulu que ma mère fît de même, mais elle s’y est refusée.
— Et Minnetaki est loin d’ici ? balbutia Rod.
— Elle est partie pour Kénogami-House, il y a quatre jours, en compagnie d’une femme de confiance et de deux guides. Ce sont leurs empreintes que vous avez vues marquées sur la piste.
— Alors, les petits pieds étaient bien les siens ?
— Vous l’avez dit, cher ami ! Restez-vous, décidément ? Vous serez ainsi le premier à la saluer à son retour.
— Je ne le puis pas. Ma mère avant tout… »
Minnetaki ne s’était point éloignée cependant sans remettre à sa mère indienne une petite lettre, destinée à Roderick. Wabi vint la lui apporter dans sa chambre, pour le consoler.
La jeune fille y avait écrit qu’elle serait sans doute revenue avant le retour du jeune chasseur. Si le contraire avait lieu et si Rod était reparti chez lui, elle le priait de ne pas oublier le chemin de la factorerie et, une autre fois, d’amener Mistress Drew avec lui.
Au dîner, Minnetaki mère appuya plusieurs fois sur cette invitation, qu’elle déclara reprendre à son compte. Elle ajouta, pour la grande joie de Rod, qu’elle avait personnellement, à plusieurs reprises, correspondu avec Mistress Drew, qui était toujours en bonne santé, et que, déjà, elle la considérait comme une amie.
Dans la soirée, eut lieu le partage des fourrures, que le factor acquit au nom de la Compagnie. La part de Rod, en comprenant le tiers de la valeur des pépites d’or, s’élevait à près de sept cents dollars.
Le lendemain matin, il écrivit à Minnetaki une longue lettre, que le fidèle Mukoki se chargea d’aller porter à la jeune fille. Puis il monta dans le traîneau qui lui avait été préparé.
Les deux boys se serrèrent la main.
« Nous vous attendrons au printemps prochain, dit Wabi. C’est bien convenu, n’est-ce pas ? Dès que la glace se brisera.
— Oui, si je vis ! répondit Rod.
— Cette fois, ce sera pour la mine d’or.
— Pour la mine d’or !
— Et Minnetaki sera ici ! » ajouta Wabi, tandis que rougissait Roderick et que l’attelage s’ébranlait.
Bientôt le traîneau filait à toute vitesse sur l’étendue blanche. Rod, le regard fixé devant lui, songeait aux caresses maternelles qui l’attendaient. A un moment pourtant, il détourna la tête et sa pensée se reporta sur la piste de Kénogami-House, où de petits pieds aimés s’étaient empreints. Le printemps était loin encore… Et des yeux du pauvre boy deux grosses larmes roulèrent.
PAGES | ||
| CHAPITRE I. | — LE COMBAT DANS LES MÉLÈZES | |
| CHAPITRE II. | — COMMENT WABIGOON LE FILS PRIT GOUT A LA CIVILISATION | |
| CHAPITRE III. | — RODERICK TUE SON PREMIER OURS | |
| CHAPITRE IV. | — RODERICK SAUVE MINNETAKI | |
| CHAPITRE V. | — EN CONTACT AVEC LE DÉSERT | |
| CHAPITRE VI. | — MYSTÉRIEUX COUPS DE FEU DANS LE SILENCE | |
| CHAPITRE VII. | — LA DANSE DES CARIBOUS | |
| CHAPITRE VIII. | — MUKOKI DÉRANGE LES ANCIENS SQUELETTES | |
| CHAPITRE IX. | — CE QUE RENFERMAIT LE PETIT SAC EN PEAU DE DAIM | |
| CHAPITRE X. | — POURQUOI LOUP ET MUKOKI HAÏSSAIENT LES LOUPS | |
| CHAPITRE XI. | — COMMENT LOUP ATTIRA SES FRÈRES A LA MORT | |
| CHAPITRE XII. | — RODERICK EXPLORE LE MYSTÉRIEUX RAVIN | |
| CHAPITRE XIII. | — LE SONGE DE RODERICK | |
| CHAPITRE XIV. | — LE SECRET DE LA MAIN DU SQUELETTE | |
| CHAPITRE XV. | — SOUS L’AVALANCHE NEIGEUSE | |
| CHAPITRE XVI. | — LA CATASTROPHE | |
| CHAPITRE XVII. | — LA POURSUITE | |
| CHAPITRE XVIII. | — LE RETOUR A WABINOSH-HOUSE | |