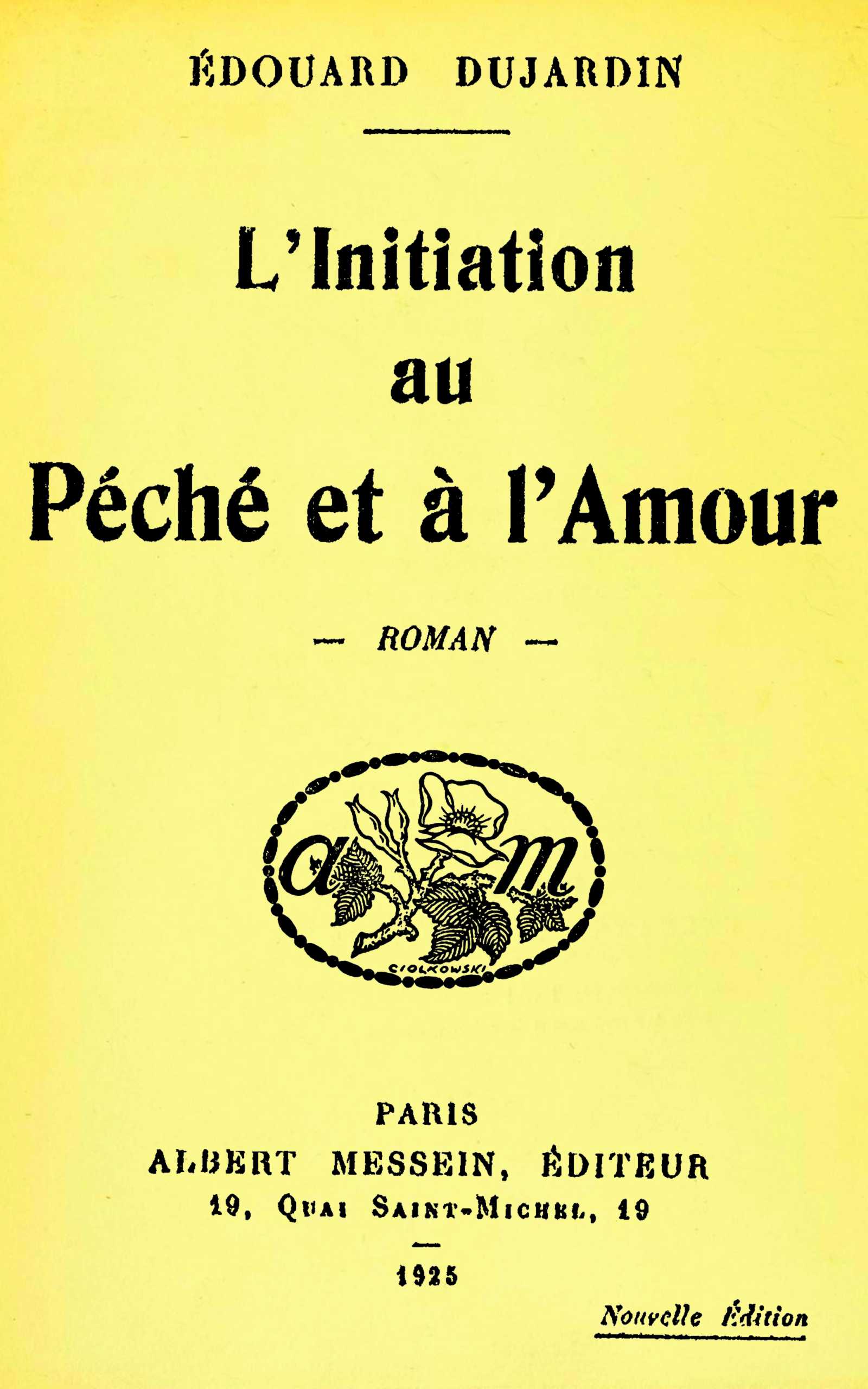
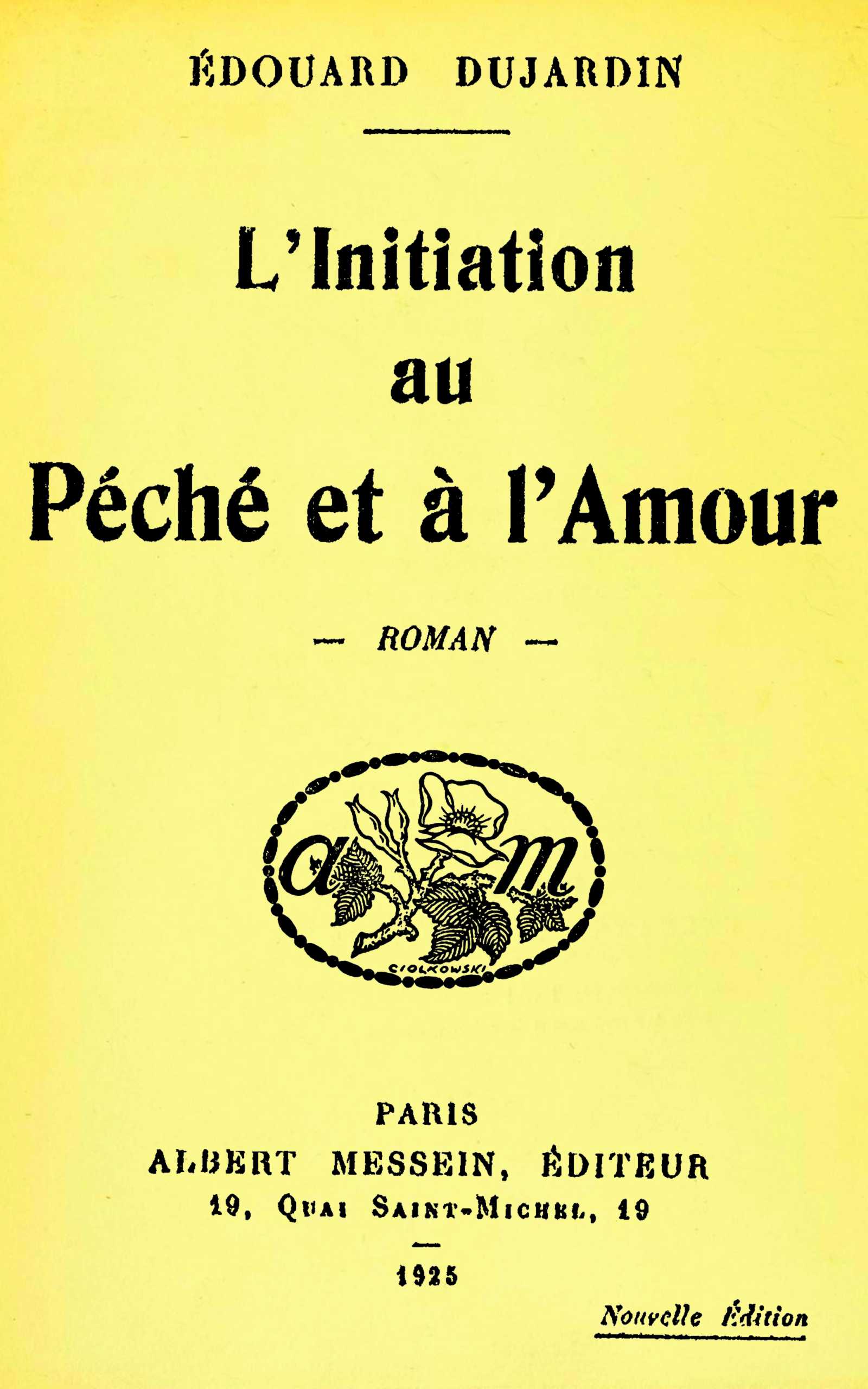
ÉDOUARD DUJARDIN
— ROMAN —
PARIS
ALBERT MESSEIN, ÉDITEUR
19, QUAI SAINT-MICHEL, 19
1925
DU MÊME AUTEUR :
Romans, contes et poèmes :
Histoire et critique :
Théâtre :
A paraître :
L’Initiation au péché et à l’amour a paru, en 1898, avec l’avant-propos suivant :
AVANT-PROPOS.
Ce roman, imaginé d’abord pour n’être qu’un récit, devait s’intituler l’Initiation au rêve et à l’amour. C’est peu à peu que l’auteur a vu se dégager, des faits qu’il voulait raconter, une idée que le nouveau titre fera comprendre, pour peu qu’on laisse au mot « amour » le sens chrétien qui fait opposition à celui de « péché ».
L’amour, est-il dit plus loin, c’est le dévouement à quelque rêve de bonté.
Le péché, c’est l’œuvre d’égoïsme, noble ou vil, généreux ou vulgaire, qui est le contraire du sacrifice.
En terminant cet avant-propos, l’auteur veut s’excuser de n’avoir pas fait, malgré ses efforts, un livre exempt de ce qu’on appelait autrefois « des peintures licencieuses ».
Si l’homme tient à la fois de l’ange et de la bête, est-il possible, comme beaucoup d’écrivains l’ont pensé, de considérer comme négligeable et de négliger en effet ce qui vient de la bête ? ou bien est-ce qu’il faut voiler, de façon à ce que les yeux les plus chastes soient satisfaits ?…
Pour qui s’attaque au problème de l’existence, le livre chaste paraît une impossibilité. La bête est la moitié de l’homme, a dit à peu près Pascal… S’il s’agit d’être sincère, la licence doit avoir sa place, inévitablement ou presque, dans le livre comme dans la vie.
Mai 1898.
En relisant ce roman, vingt-sept années écoulées, pour en donner une édition nouvelle, je me sens moins intéressé par l’« idée » dont il est question dans l’avant-propos de 1898, que par les « faits » qui sont racontés, et, pour tout dire, je regretterais d’en avoir subi la préoccupation, si je n’avais l’impression que cette préoccupation n’a aucunement empêché le roman de rester le « récit » qu’il devait être.
Plutôt que l’idée pseudo-chrétienne, je trouvé intéressant, à un quart de siècle d’intervalle, d’y reconnaître — particulièrement dans la première partie — l’idée freudienne du complexe d’Œdipe. On l’apercevrait déjà dans la Future Démence, l’un des contes de mon premier livre, les Hantises ; une trace en apparaît également dans la scène principale du second acte d’Antonia ; mais les soixante-quatre premières pages de l’Initiation au péché et à l’amour en sont le développement complet absolument caractérisé. Or, qu’on se rappelle les dates : les Hantises, 1886 ; Antonia, 1891 ; l’Initiation, 1898 ; et qu’on se rappelle, d’autre part, que les premiers travaux de Freud sont de 1893-1895, qu’aucun de ses ouvrages n’avait attiré l’attention jusqu’en 1900, et que rien n’en a guère été connu en France jusqu’en 1908 (article du journal la Neurologie)… Il est vrai que, si Édouard Dujardin a fait du freudisme avant Freud dès 1886 et 1891 et a publié un roman freudien en 1898, il serait injuste d’oublier qu’un certain Sophocle a écrit une tragédie non moins freudienne il y a une couple de millénaires.
On m’a souvent demandé pourquoi, après, les Lauriers sont coupés, je n’avais pas persévéré dans la voie que j’avais inaugurée. En relisant récemment l’Initiation au péché et à l’amour, j’ai été frappé de voir combien il s’en fallait de peu que certaines scènes de ce roman, et notamment la dernière (pages 218-243), ne soient du monologue intérieur… Et j’ai été bien tenté de faire la très légère retouche qui suffirait. Une volonté plus forte m’en a empêché. Le livre reste tel qu’il a paru en 1898.
Août 1925.
A FRANCIS VIÉLÉ-GRIFFIN
Ce fut le jour de Noël dans l’église du village, que la mère de Marcelin sentit pour la première fois l’enfant remuer dans son ventre.
Au premier appel des cloches de la messe, la triste châtelaine était sortie ; et, accompagnée d’une femme, elle était allée à pied, à travers la campagne blanche de givre, jusqu’à l’église. Sur la route gelée, entre les rangées des arbres dépouillés, les paysans saluaient la forme noire au visage voilé, aux pas de somnambule. Elle était entrée dans l’église, et, lentement, était venue s’agenouiller dans son banc. Ayant relevé son voile, la future mère, ainsi qu’un enfant, priait ; et sa blanche figure de jeune femme, plutôt de jeune fille, amaigrie et allongée, très blanche, grave, infiniment affligée, restait à demi inclinée vers le sol.
Les gens pénétraient dans l’église, et, derrière elle, les bancs s’emplissaient ; un enfant de chœur allumait les cierges ; l’air, par les vitraux gris, était sombre. Plus forte que la prière, sa tristesse remontait en elle.
Pourquoi la délaissait-il, l’époux qui l’avait choisie et qu’elle avait accepté ? Après si peu de jours, après de si brèves noces, pourquoi l’avait-il quittée ? Était-ce vers des plaisirs anciens qu’il était retourné, l’oubliant dans ce solitaire château de Saint-Paulin d’où toute joie s’était enfuie, apparaissant à de si rares intervalles, la laissant seule et telle qu’une veuve ?
Elle se rappelait le soir nuptial, le clair soir de septembre, et quand, doucement, il avait dégrafé sa belle robe de mariée, et comme elle était tombée pâmée entre ses bras. Puis, dès la semaine suivante, peu à peu, le visage de l’époux s’était fait glacial, indifférent, hostile ; puis, le premier départ, la première absence, et, maintenant, cette éternelle absence.
Ah ! pourquoi avait-elle quitté le couvent de son adolescence, les sœurs, les amies, la vie douce et insoucieuse ? Car elle se sentait mourir, abandonnée, telle qu’une coupable, sans amour, dans l’éclosion même de ses dix-sept ans. Mais, mourante presque, un trouble nouveau était en elle ; sa chair était bouleversée ; son âme tourbillonnait dans l’incertitude, et son pauvre cœur saignait de tant de larmes à cause d’un passé qu’elle ne s’expliquait pas et d’un avenir impossible à discerner.
Et parfois, dans le banc, la jeune femme avait de soudains arrêts de pensée ; elle sentait des malaises subits, des sueurs, des froids. Quand on lui avait dit, il y avait quelques jours, que peut-être elle était enceinte, elle était restée effarée, ne sachant pas, comprenant à peine, ne cherchant pas à savoir. Maintenant, elle demeurait immobile, le regard fixe.
Les cloches sonnaient.
— Seigneur… Seigneur… murmurait-elle.
L’église était à moitié pleine ; le prêtre apparut, suivi d’un enfant de chœur qui portait un bénitier ; et tous deux commencèrent le tour de l’église.
— Asperges me Domine hyssopo et mundabor, lavabis me, et super nivem dealbabor… Vous m’aspergerez, Seigneur ! et mieux que la neige je me blanchirai…
— Miserere met, Deus secundum magnam misericordiam tuam… Ayez pitié de moi, Seigneur, selon votre grande miséricorde.
Une goutte d’eau bénite tomba sur le front de la jeune femme agenouillée.
— Amen, disait l’enfant de chœur.
A ce moment, tandis que le prêtre remontait les trois marches du chœur et, pénétrant entre les stalles, s’avançait vers l’autel, dans l’église muette encore sous le bourdon des cloches, à ce moment où une goutte d’eau bénite tombait sur son front, la jeune femme sentit au fond d’elle-même une sensation extraordinaire. Elle releva brusquement le cou, et sa tête se rejeta en arrière ; sa blanche figure d’enfant meurtri tendue vers le Christ de l’abside, ses maigres mains gantées de noir ouvertes, elle resta une seconde les yeux béants ; puis, brusquement, elle reporta ses doigts sur son ventre, où quelque chose certainement avait remué… Là, dans ses entrailles, quelque chose avait remué, quelque chose avait remué pour la première fois.
Un éclair passa dans son esprit.
— L’enfant !
Et elle défaillit ; sa tête retombait plus blanche encore, les yeux éteints ; ses bras pendaient ; elle s’affaissait, elle s’évanouissait, et son corps coulait sur le banc.
Elle se retrouva dans la sacristie, entourée des gens d’église ; une femme l’avait dégrafée et lui humectait les tempes et la gorge d’eau.
— Quelle eau avez-vous puisée ?
— De l’eau qu’on trouve dans les églises… Dans le bénitier, près de la porte, nous avons puisé l’eau bénite.
Et l’office continuait ; Noël se célébrait ; les hymnes joyeusement chantaient.
— Puer natus est nobis : filius datus est nobis… Un enfant nous est né ; un fils nous est donné.
La faible femme entendait vaguement, dans le mode triomphal des hymnes, qu’il s’agissait de célébrer la souveraine fête… Il nous est né un enfant pour le salut et pour la gloire ; un fils nous est donné, le promis, l’espéré, le tout désiré, l’éternellement attendu.
— Alleluia ! réjouissez-vous ! chantait la foule, et adorez ! un jour très saint a lui pour nous.
La créature le sentait à présent dans son ventre, et elle pleurait, et, dans son âme, elle se réjouissait de s’offrir en sacrifice pour celui qui allait venir.
Marcelin Desruyssarts était né, et sa mère le même jour était morte. Le père revint à Saint-Paulin ; taciturne et le front plissé de remords, il déclara qu’il resterait auprès de son fils. Et, dans l’isolement du domaine familial, l’enfant grandit.
Il n’avait guère de petits camarades ; les petits paysans du bourg, les fils du percepteur, du médecin, étaient une compagnie que le père n’encourageait point ; et il ne fréquentait point chez les châtelains des environs.
Quelquefois l’enfant s’arrêtait à regarder, sur la route, les gamins qui jouaient aux barres, aux billes ; il s’approchait, un peu timidement ; alors les autres se sentaient moins à l’aise, ne lui proposaient pas d’entrer dans leurs parties, il s’asseyait sur un talus, à égrener des herbes ou à compter des cailloux.
Dans le parc, plus fréquemment dans le jardin du curé, il construisait des buttes en terre, entreprenait des travaux, s’occupait à suivre des insectes : la vieille gouvernante du prêtre était sa meilleure amie ; elle lui donnait des pommes, des confitures ; il assistait à la cuisine, était heureux si on lui confiait des cueillettes de fruits. Il lisait couramment, apprenait rapidement à écrire, connaissait bien l’histoire sainte.
Un jour l’évêque vint donner la confirmation dans l’église du bourg. C’était une fête très solennelle. Quand Monseigneur entra et traversa l’église, la gouvernante dit tout bas à Marcelin de faire le signe de la croix.
L’enfant, au milieu du silence des fidèles, récita à pleine voix :
— Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit…
Tout le monde se retourna ; Monseigneur s’arrêta, et, souriant doucement, il s’approcha de Marcelin. De ses doigts, il lui toucha une joue, et, regardant vers le ciel, il le bénit.
Des cousins, cet été-là, furent invités au château. Ils avaient un petit garçon, Paul, de l’âge de Marcelin, quelques mois de plus. Paul était turbulent, très joueur ; Marcelin le prit en grippe ; il lui abandonnait ses jouets, et, malgré les remontrances, s’enfuyait seul dans les bois.
De temps en temps, M. Desruyssarts allait à Paris, revenait après quelques jours ; une fois ou deux par an, il restait absent plusieurs semaines. Le père Homo, le régisseur, avait la surveillance de l’enfant qui l’aimait.
Marcelin alors se sentait plus libre ; il imposait ses quatre volontés au père Homo et à la gouvernante du curé ; il devenait plus expansif, parlait plus fort, faisait du bruit.
Le curé lui disait :
— Il faut donner de vos jouets, de vos gâteaux aux petits pauvres.
— Puisque c’est à moi, mes jouets, mes gâteaux…
— Le bon Dieu veut qu’on donne de ce qui est à soi.
Marcelin se taisait et regardait le curé dans les yeux, cherchant à comprendre.
Le vieux prêtre expliquait :
— Les bêtes ne donnent point, ne se privent point ; mais les hommes ne font pas comme les bêtes ; ils connaissent le bon Dieu, que les bêtes ne connaissent pas.
Le plus jeune des fils du médecin devint un peu plus tard son camarade. Marcelin aimait le blond garçonnet aux cheveux soyeux, aux manières douces ; il pensait souvent à lui et recherchait sa société ; mais il était intimidé lorsqu’il le rencontrait. Chaque fois il lui apportait quelque chose, des livres, des images, de beaux cailloux. Après un quart d’heure de compagnie, son embarras cessait ; alors les deux enfants causaient, longuement.
— Henri, pourquoi tu n’as pas un château ?
— Mon père n’a pas le moyen.
— Si tu veux, quand nous serons grands, tu demeureras avec moi.
— Je voudrais bien.
— Quand nous serons soldats, nous serons tous deux hussards ; nous serons capitaines.
— Moi, je serai lieutenant.
— Qu’est-ce que tu feras après ?
— Je serai médecin comme papa.
Au mois d’octobre, Henri annonça qu’il allait au collège ; il entrait en huitième. Il partit. Marcelin fut très triste : il songea longtemps aux beaux cheveux, aux mines si douces du petit ami ; il aurait voulu aller aussi au collège, entrer dans la même classe, et il se mit à travailler plus assidûment ses leçons.
Vint, à onze ans, l’époque de la première communion ; une grande piété s’était développée chez Marcelin ; il attendait avec une croissante impatience les trois jours de la retraite préliminaire.
Le lundi matin, il fut conduit à l’église ; une dizaine d’enfants étaient là ; d’autres arrivèrent encore. On entendit la messe ; puis, ce fut le curé qui instruisait, parlait de Dieu, du péché, de la rédemption ; et l’on récitait des cantiques, dans un élan de ferveur et une joie de chanter à pleine voix. On pensa à la confession, aux fautes commises ; et la journée se terminait avec la bénédiction du vieux curé et par des hymnes dans l’église. Marcelin rentra au château, plein d’onction.
C’était en mai, les premières tiédeurs embaumaient le ciel.
Le lendemain, pendant la messe, une grande ferveur prit subitement Marcelin. La journée était consacrée à préparer la confession générale ; il fallut récapituler les fautes commises depuis l’âge de raison. Quelques enfants faisaient des listes ; un espiègle vola de ces papiers ; quelques-uns lisaient dans des livres pieux la nomenclature de tous les péchés possibles et notaient d’un signe ceux où ils étaient tombés ; un petit nombre méditait, les plus dévots ; ils s’apercevaient l’âme très noire, avec une confusion d’avouer leurs iniquités, une peur de n’être point absous et de la confiance dans les miséricordes de Dieu et du curé. Tout le monde défila au confessionnal ; le prêtre, ce jour-là, ne donnait que l’attrition, réservant l’absolution à la veille de la communion. Marcelin redoutait de mourir dans la nuit, avant d’avoir reçu, sous sa forme définitive, le sacrement de la pénitence. De plus en plus, son âme s’exaltait ; en dormant, il eut des rêves où s’entrecroisaient les récits, les tableaux, les symboles sacerdotaux.
Le mercredi fut solennel ; eux-mêmes, les plus mutins se recueillaient. Il y eut, avec des hosties non consacrées, une répétition générale de la communion. On ne sortait plus de l’église, du jardin du presbytère, de la cour d’école ; l’église était en préparatifs de fête ; des ouvriers posaient des tentures, des fleurs ; le jardin, la cour verdoyaient sous le soleil. Les enfants passaient ici et là, à travers la jubilation et la pompe. Et le soir, après l’absolution donnée, ils rentraient le cœur et les sens remplis de l’attente du lendemain.
Le grand jour arriva. On mit au communiant son premier long pantalon ; un cierge à la main, il s’achemina gravement, à pied, du château vers l’église. Les enfants furent placés, en deux groupes séparés, les filles à gauche, les garçons à droite ; le curé circulait entre eux. Avant la messe on chanta des cantiques, pendant que la foule entrait ; puis, l’office commença.
Ce fut, dans l’âme de Marcelin, une brume. Comme ses camarades, il se levait, s’asseyait, s’agenouillait ; il entendait et voyait sans discerner ; et les cérémonies se déroulaient devant lui, lointaines cet imprécises. L’unique sentiment du sacrement prochain subsistait, et cela ondoyait dans sa tête ; un flux d’extase montait, en un parfait acquiescement de foi, d’espérance et d’adoration.
La voix bien connue du curé parlait :
— Le moment est venu…
Debout sur les marches du chœur, devant les enfants, le curé, en son étole blanche, parlait et l’émotion faisait trembler ses paroles. L’enfant entr’apercevait des idées formidables… Le péché originel effacé… la rédemption… la loi du monde remplacée par la loi divine… Et, peu à peu, il comprenait que Jésus-Christ c’était l’exemple et que son corps c’était le gage, et que son sang était le symbole… exemple, gage, symbole du renoncement, du sacrifice et de l’holocauste… et que Dieu s’était incarné pour enseigner jusqu’où il était bien d’aimer, — tandis que la voix du prêtre répétait :
— Corpus meum, quod pro vobis datur… mon corps, que je donne pour vous !
On s’était levé ; lentement, on se mettait en marche vers la nappe blanche, au pied de l’autel, en un long défilé. L’enfant, comme en une minute suprême, s’hallucinait de prendre sa part de sa rédemption ; il murmurait intérieurement, mais précipitamment, dans un affolement de reconnaissance éblouie :
— Seigneur, je ne suis pas digne… Seigneur, je ne suis pas digne…
Et, comme il revenait à sa place, il pleurait abondamment.
A midi, il déjeuna au presbytère, en face du curé, seul avec lui ; le vieux prêtre, ému et recueilli, le servait avec les égards de quelque ancien ermite pour un voyageur angélique descendu sous sa hutte ; et lui, souriant et silencieux, le cœur ravi, il considérait avec amour le bon soleil de mai dans les campagnes.
Les vêpres entendues, les cérémonies se terminèrent par la consécration à la Vierge. Dans la chapelle ornée de fleurs, les communiants, filles et garçons, étaient réunis et l’un d’eux récitait les vœux à la mère des hommes. Là était le bénitier dont l’eau, près de douze ans auparavant, l’avait aspergé dans le ventre de sa mère, et Marcelin, vaguement, était appuyé contre. Alors une dernière fois, le prêtre parla ; son regard tomba dans le regard de l’enfant, et celui-ci entendait confusément des paroles dont le sens s’élargissait au delà de leurs sonorités :
— Les jeunes hommes ont pour la première fois communié de l’exemple de Jésus. Allez ! Mais là, voici la vierge aux bras entr’ouverts, aux mains tendues ; les jeunes hommes iront à celle qui assiste, qui prie et qui intercède…
Les rangées des fillettes toutes vêtues de blanc dans leurs robes de mousseline et sous leurs voiles, candides, les fillettes levaient leurs yeux ingénus vers l’autel blanc fleuri de la Vierge Mère. Une émotion intense poigna le cœur de Marcelin ; il pâlit et il s’affaissait presque contre le bénitier miroitant.
Tout était fini ; les enfants se dispersaient, cherchaient leurs familles ; les familles accouraient. Marcelin vit chacun de ses camarades entouré des siens, tous, qui se laissaient bercer aux soins délicieux de leurs mères, toutes les mères qui éperdument embrassaient leurs filles, leurs fils. Il se retourna, et aperçut son père, qui, sans sourire, triste, presque sombre s’approchait.
L’été se passa sous le coup d’émotion de cette journée. La ferveur de piété s’était calmée ; un sentiment intérieur demeurait. Le goût de la solitude devint plus profond.
Maintenant, Marcelin s’arrêtait des heures à regarder couler l’eau, à considérer les arbres ; il délaissait sa vieille amie, la gouvernante du curé. A la moisson, il suivait de loin les ouvriers ; une fois il se mêla aux groupes et revint avec les lourdes voitures chargées ; il soupa chez le fermier, gaîment ; il rêva de recommencer et ne put le faire.
A la fin de l’hiver, le vieux prêtre tomba malade ; une semaine plus tard, il mourut. Marcelin eut un grand désespoir et toute l’année il lui resta de la tristesse.
Son père résolut de le garder, de continuer seul son éducation pendant un an ou deux.
Il grandissait. Un sérieux, une application précoce se manifestaient ; mais il se portait bien, était vigoureux. Il n’avait plus de camarade ; ses récréations étaient des promenades indéfinies dans le parc, seul souvent, quelquefois avec un dog, quelquefois avec le père Homo qui lui expliquait les essences des arbres, les mœurs des oiseaux.
Aux fêtes de Pâques, il vint à Paris pour la première fois. Il était allé plusieurs fois au chef-lieu de canton en compagnie du père Homo, deux fois à Évreux. Dès son arrivée à la gare Saint-Lazare, il resta muet de saisissement ; tout lui apparut énorme ; il traversa la place du Havre, ébloui, étourdi, enivré ; la hauteur des maisons l’écrasait ; la foule tourbillonnait autour de lui. C’était un pays de géants, un pays de féerie, immense, tout en clarté, tout en bruit, tout en mouvement, le monde d’une vie supérieure, surnaturelle.
Rentré à Saint-Paulin, l’impression ne s’effaçait pas de son souvenir ; il demanda à son père, comme récompense de son travail, de le conduire de nouveau à Paris. A chaque voyage, l’effarement le reprenait.
Comme il venait d’avoir treize ans, M. Desruyssarts, sur le conseil d’un docteur, le conduisit passer une partie de l’été aux bords de la mer ; il choisit un pays peu connu, peu fréquenté, de la plage normande, à quelques lieues de Saint-Paulin. Marcelin n’avait jamais vu la mer ; la nouveauté du spectacle fit jour à ses premiers romantismes.
M. Desruyssarts avait résolu de faire le voyage en voiture ; deux ou trois heures devaient suffire ; on partit un après-midi du commencement d’août. Une roue qui se démit retarda de plusieurs heures ; quand on fut prêt, le soir était venu ; le cocher pressait les chevaux ; peu à peu l’obscurité tombait. Déjà, sur la route, à travers les champs et les sapinières, un air frais et aromatisé étonnait de plus en plus les sens de l’adolescent ; les chevaux avaient pris le grand trot ; la nuit approchait ; le silence s’étendait autour du roulement de la voiture ; le père et le fils se taisaient, l’un taciturne toujours, l’autre impressionné par le mouvement, par l’attente. Quand on s’arrêta, la nuit était noire, sans lune et sans étoiles. On était à la porte d’un hôtel ; il y eut un grand va-et-vient ; des garçons circulaient avec des bougeoirs ; on descendait les bagages ; le père parlementait longuement ; les pas criaient sur le sable, sur les dalles, et des ombres apparaissaient au fond, derrière des vitrages mi-éclairés. Marcelin suivait, dans un ébahissement. La mer est à trois minutes, expliquait-on. On le fit monter dans une chambre ; il apprit que les fenêtres donnaient sur la plage.
Les domestiques partis, les premiers soins achevés, Marcelin ouvrit une fenêtre. L’espace béait, vide, noir. Le jeune homme s’approcha, s’accouda, chercha à voir ; mais rien ne pouvait se discerner. Une brise forte soufflait, qui fit aussitôt vaciller la flamme des bougies dans la chambre ; l’enfant eut un enivrement des aromes puissants qui le pénétraient, et pendant qu’il demeurait, il percevait peu à peu un bruissement bas, infiniment profond, toujours le même, une sorte de roulement continu, une symphonie lointaine, immense comme le ciel noir qui l’enveloppait.
Descendu, Marcelin sortait à la hâte, traversait les pelouses qui menaient à la mer. La brise saline soufflait plus âpre autour de sa tête, et le bruit des vagues grandissait dans l’ombre ; il s’approchait, lentement, avec des frissons, presque une peur, les sens exaltés et bouleversés, rempli de ce vent et de cette voix, et, tout d’un coup, il distingua dans l’ombre le blanc des lames qui déferlaient sur le sable. La mer apparut dans la nuit.
Il eut la notion vaguement de quelque chose dépassant le temps, éclatant l’espace ; halluciné, il s’arrêta ; tout son être était poigné d’angoisse et des larmes lui montaient aux yeux.
Suivirent trois années de collège à Paris, trois années régulières de travail, avec l’esprit qui s’ouvre aux choses. Il n’avait plus revu Saint-Paulin ; son père s’était mis à voyager, et il l’envoyait pendant les vacances en Angleterre, chez des amis, dans la monotonie correcte de la vie bourgeoise britannique. Il termina sa rhétorique et passa ses premiers examens.
Par cette belle fin d’après-midi de juillet, il sortait de la Sorbonne, heureux, l’esprit dispos à la joie. Ses camarades étaient là, bruyants, remuants, excités ; il les entendait parler et rire.
— Marcelin, tu viens avec nous ?
— Marcelin, nous allons nous amuser.
— Nunc bibendum et amandum.
— Moi, je suis reçu, toi aussi, toi aussi ; il faut arroser nos lauriers.
— Moi, j’ai droit à des consolations.
— Égalité, messieurs, devant le vin et près des femmes.
— D’abord à la brasserie !
— A la brasserie d’abord ! Louise et Jeanne y seront.
— Et puis, la grosse Blanche, et puis, la grosse Clarisse.
— Ma trop longue vertu, ouf ! me pèse.
— Que nul de nous, Messieurs, ne reste vierge !
— Je vous mènerai.
— Quand ?
— Tout de suite.
— Où ?
— Deux pas à faire.
— Hurrah !
— Eh bien, toi, Marcelin ?
— Marcelin, tu n’as pas les façons d’un soldat qui marche au feu.
— Tu ne réponds pas, Marcelin ?
— Messieurs, n’essayons pas de convertir Marcelin.
— Il est mélancolique.
— Il aime la solitude.
— Monsieur est chevalier de Malte.
— Monsieur est philosophe, de l’école d’Abélard.
— Il y a assez longtemps, mon petit Marcelin, que tu fais le grand seigneur.
— Nous allons t’apprendre à parler si on t’interroge.
— Nous t’offrirons, pour tes solitudes, des souvenirs dans le derrière.
— Fiérot !
— Beau ténébreux !
— Jésuite !
— Poète !
— Messieurs, messieurs, laissons-le.
— Soit !
— Mais sache, ami, qu’une chose vaut mieux qu’un vers de Lamartine, c’est un verre de vin.
— Les nuages manquent de femmes.
— La retraite, c’est immoral.
— Les dieux ont chanté le plaisir.
— Tu y viendras, mon cher ; tu te souviendras que nous nous amusons ; tu regretteras d’être demeuré ; les bois, la mer, le ciel bleu ne te diront plus rien ; tu désireras à ton tour. L’amour, les joies, les folies, les baisers, les vins qui saoulent, les fleurs, les fruits, les fêtes, les fandangos, les vertiges, les nuits blanches, les nuits rouges, les nuits pâles, les festins de champagne et de gorges moites, toutes les jouissances de vivre et de vivre encore et de vivre davantage et toujours, c’est pareillement, encore et toujours, le triomphe de la vie ; et c’est la vie, aussi, que l’orgie et que la nuit la plus nuptiale, que le dur travail et que l’or ruisselant, et toutes poussées de l’instinct, de la chair et de l’esprit ; le désir qui se veut satisfait, c’est la nature qui ordonne ; le péché qui allicie, c’est la loi mortelle qui commande. Crois-tu désobéir ? Eh ! mon maître, eh ! cher garçon, eh ! chaste dédaigneux, beau chevalier du Graal, compagnon de la lune, tu y viendras, chez Vénus et chez le Commandeur, tu y viendras… bonsoir !
Ses seize ans accomplis, dans sa plus belle adolescence, grand et mince, avec les yeux ouverts, un front de méditation, de mélancolie et d’innocence, il était revenu, par l’été épanoui, au domaine familial que depuis trois ans il n’avait pas revu.
Le premier soir, il parcourut le château. Les couloirs étaient larges, les salles profondes et hautes, avec des tentures de vieille tapisserie, d’épais rideaux, un air de choses passées. Marcelin errait silencieusement.
— Voici le grand salon ; voici la chambre où mourut l’aïeul ; voici la salle où l’on rangeait les armes ; voici la chambre de ta mère…
Grave, son père parlait :
— Marcelin, voici le portrait de ta mère.
A la lueur du soir tombant, dans une pièce grise et pâle, aux murs pâles, aux rideaux gris, il vit, au-dessus d’une ancienne table couverte de marbre, un pastel, une jeune femme, plutôt une jeune fille… Non loin, un lit, à jamais fermé, reposait… Le pastel, très doux, décoloré sans doute par le temps, regardait dans le vague.
Marcelin, en sortant, se retourna vers la jeune fille blanche, si tendre, clouée pour l’éternité sur le mur, dans sa plus pure jeunesse. Le père passait, les regards au dehors.
Marcelin avait sa chambre au-dessus du parc. Il dormit profondément, sans rêves. Le lendemain, il s’éveilla de bonne heure ; il ouvrit la fenêtre ; une pleine clarté de soleil et de rosée éclata ; la lumière entrait de toutes parts, du ciel bleuté, des gazons verts, des arbres ; un murmure bruissait. Dans son cœur un épanouissement se fit. Avec une joie intime et paisible, il allait et venait dans sa chambre, organisant lentement sa toilette, se retournait vers la fenêtre ouverte. Aussitôt habillé, un brusque désir le prit d’aller dehors ; il descendit, sortit et s’évada dans les verdures.
Le parc se déroulait largement ; des pelouses, des taillis, des chemins couverts, des chemins bordés de tilleuls ; puis, la forêt, et, au bas de la forêt, le ravin, sec maintenant, encore ravagé des torrents de l’hiver, avec des clairières caillouteuses, des arbres morts ; et, tout au long, le bois, ici des fourrés, là des futaies. Il marcha, ravi de respirer, de voir, de sentir, heureux d’agir, presque extasié.
L’après-midi, il traversa de nouveau les gazons, la forêt ; puis, il changea de route ; il arriva dans la campagne. Des champs couvraient la côte qui montait du côté du nord ; pâturages et cultures se mêlaient, allaient très loin, dans un silence chaud, vert et harmonieux. Il suivit les serpentements des sentiers ; ce n’était plus son ardeur juvénile du matin, mais un sentiment plus grave ; il s’avançait lentement et son esprit s’élargissait dans les horizons. La ligne noire de la forêt semblait sombre ; la longue crête de la côte formait une ligne lointaine et décisive.
Le soleil descendait ; le ciel avait les reflets religieux du couchant. Il s’assit sur le bord du sentier. Sa pensée roulait autour des choses qui l’entouraient, en de flottants désirs, des rêves ; il considérait les mille aspects de la campagne et des nuages ; le chant des plantes et des insectes le berçait. Alors un grand besoin de s’épancher le saisit, de n’être plus seul, de parler, de serrer des mains, de donner de lui-même à quelqu’un ; et il s’en revenait plus lentement.
Bientôt le château apparut, grisâtre, aux lignes uniformes, aux hautes fenêtres, sévère, presque sombre, sous le soir montant. Et, après le dîner, Marcelin rêvassait à la fenêtre, en regardant le disque blême de la lune.
Le lendemain, dès l’aurore, il repartait à travers bois et champs. Et parmi la même vague émotion de jouir de la nature, grandissait l’inquiétude de se trouver seul.
Oh ! quelqu’un à qui communiquer son cœur ! quelqu’un près de qui voir et sentir ! quelqu’un avec qui partager cette âme qui s’éveillait.
Au retour, le château lui semblait, dans son calme, comme s’il cachait quelque mystère. Il approchait. Il fixait des yeux l’une des hautes croisées fermées, à de larges rideaux tirés, derrière les vitres verdâtres ; l’idée lui revint de la jeune fille, de la jeune femme, du tendre pastel, et, le revoyant en son souvenir, il s’y complaisait.
Il parcourut encore, le lendemain, les chemins et les sentiers ; son père le laissait aller, et demeurait l’homme de peu de paroles. L’après-midi, pendant que le soleil brûlait les terres, assis, au fond du ravin, sur des rochers mousseux taillés par les courants de l’hiver, sous le dôme des yeuses qui longeaient le lit pierreux et dont les têtes se joignaient à de grandes hauteurs, il lui montait des bouffées d’enthousiasme.
— Arbres, ruisseaux, plantes, herbes obscures, fleurs sauvages, et vous, oiseaux, insectes, animalcules, votre vie m’enchante, et je vis avec vous.
Le concert des choses répondait dans un tourbillonnement.
— Et je ne puis vivre votre vie où j’aspire. Vous avez votre vie : la moitié de moi-même me manque. Vous me dites que vous êtes heureux ; je n’ai à vous conter que des rêves inexaucés.
La brise d’été agitait les feuilles de toutes parts.
— Vous avez votre destin, fleurs fertilisées, créatures chantantes. Mais pour qui parlerai-je ? pour qui mon cœur bat-il ? et pour qui existé-je, tandis que je rêve, au fond de ce vallon, inutile, et que je n’ai qu’à rêver, de vous, de moi, de tout ce que j’ignore, tandis que je meurs de rêver et ne puis dormir.
Les mouches, les moucherons bourdonnaient profondément ; un oiseau se posa, et, d’une voix éperdue, vocalisait ses coui-coui, coui-coui, à travers les feuillages drus.
— Coui-coui ! coui-coui ! chanta Marcelin, en cherchant des yeux l’oiseau.
L’oiseau, comme s’il se moquait, reprit plus fort.
— Coui-coui ! répliqua le garçon.
Les coui-coui alternaient, perçant l’air ; l’oiseau ne s’arrêtait plus ; Marcelin reprenait de plus belle.
— L’oiselet, il est chez lui, se dit-il ; moi, je suis parasite en son pays.
D’un bond il se releva. L’oiseau s’envola : et, s’enfuyant, il continuait à répandre les trilles, les gammes. Marcelin descendit à pas lents le cours du ravin.
— Être cela ! être une chose parmi les choses ! être le frère de cet oiseau, l’oiseau de cette oiselle, le papillon de ces papillonnes !
Un flux de tristesse le reprenait.
— Est-ce après l’amour que j’aspire ? J’ai lu dans mes poètes chéris que l’amour était un désir d’un objet entre tous les objets, que c’était s’absorber dans un autre être, se donner et se recevoir, et s’unir avec une âme image et complément de son âme. Il me semble que ce n’est pas après cela que j’aspire. Il me semble que je regrette un cœur où me confier, des bras à qui m’offrir, un esprit qui me prenne, et ne plus être pour moi seul et être ami et dire et entendre des paroles.
Une bataille d’insectes traversa l’air en sonore mêlée.
— Oh ! disait le jeune homme, qu’elle était belle et bonne et douce et secourable, la figure de la jeune femme du pastel !
Le soleil baissait derrière les arbres ; Marcelin reprit le chemin du château ; les allées s’empourpraient ; l’atmosphère se taisait.
Il retourna dans la chambre où le pastel était suspendu…
… Ce n’était pas une jeune femme, c’était encore une jeune fille ; comme ses yeux étaient candides ! Mais ce n’était plus une enfant ; ses regards étaient si mélancoliques ! Le cou nu apparaissait, une faible gorge de vierge ; puis, les mousselines s’entrecroisaient, s’entremêlaient, et la taille s’amincissait, et aux hanches le pieux pastel s’était arrêté… Marcelin voyait la jeune fille rayonner en un jour de pâleur attristée, comme la Vierge Matinale, comme la Vierge Vespérale…
— Oh ! se disait le jeune homme… oh ! elle m’eût aimé, et combien je l’eusse aimée, la pauvre jeune fille, la pauvre jeune femme qui est devenue ma mère, et que voici !
Et quand le soir fut venu, dans la grande salle du château :
— Marcelin, demandait le père, pourquoi retourner dans cette chambre, en troubler le repos ?
— Fais-je mal, mon père ?
— Mon fils, quelle peine t’assombrit ? quel souci ?
— Le sais-je, mon père ?
La nuit vient ; dans la longue salle à manger la table est encore dressée ; les argenteries et les verreries n’ont pas été enlevées et des fruits restent, mats, dans les plateaux ; la grande lampe à l’abat-jour bleu brun brûle. Pendant que le père lit, le jeune homme regarde d’une fenêtre les formes fantastiques, les formes invitantes des choses dans la nuit tombante. Le proche bosquet semble infiniment distant, infiniment énorme, et, dans ses flancs épais, oh ! comme il cèle des mystères merveilleux, farouches et ensorceleurs ! La pelouse, au-devant, est vide et plate, et, à la fixer, des figures y surgissent. Cependant, on sent dans les rideaux, au-dessus de soi, des présences qui pèsent, qui font qu’on se retourne. La nuit s’étend sur la campagne et dans le cœur.
Et Marcelin soupçonne qu’il lui est impossible d’avoir de la confiance pour l’homme qui est son père, et que peut-être — il ne sait à cause de quel passé mystérieux — il n’a même pas pour lui le simple amour filial qu’il lui doit.
Avant de monter dans sa chambre, il sortit, et, par la silencieuse nuit d’été, il erra dans le parc.
La lune s’était levée ; les arbres avaient d’immenses silhouettes ; l’horizon s’agrandissait démesurément. Le jeune homme se promena au hasard ; il était en communion avec la nature. Aucun bruit ne s’entendait ; il suivait le bord de la futaie, respirant largement.
Tout à coup, brusquement, il se dit qu’il était seul, seul toujours, seul à jamais ; et il se trouva malheureux et pitoyable. Une grande tristesse le poigna. Il s’écria tout haut.
— Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Mais où trouverai-je celle, semblable à moi-même, qui serait le but de ma vie ?
A travers la merveilleuse harmonie qui l’entourait, il revint, lentement, dans une songerie mélancolique. Au moment de rentrer, pourtant, s’étant arrêté sur les marches du perron, la beauté de la nuit lumineuse reprit sa jeune âme ; de nouveau, il admirait et se laissait caresser par la clarté lunaire, et il s’attardait sur la balustrade de pierre, tandis que, derrière lui, toutes les fenêtres s’étaient éteintes.
Marcelin s’est couché ; et, avant de s’endormir, il rêve, en une sorte de demi-sommeil.
Il contemple la demoiselle du pastel.
Elle lui apparaît, infiniment douce et bienveillante ; il lui semble qu’elle lui sourit, de très loin ; et il se dit :
— Voilà celle qui a vécu pour moi.
Il pense que, si elle était là, elle l’entendrait, le consolerait, le secourrait.
— Avec moi elle viendrait dans ces bois, le long de ces ravins, dans ces plaines ; nous écouterions ensemble les oiseaux ; elle m’instruirait à les comprendre ; ils ne se moqueraient plus ; nous serions deux à regarder les nuages, à nous asseoir sur les talus solitaires.
Et il comprend :
— Et elle serait le but de ma vie, comme j’ai été le but de sa vie.
Tout à coup il se redresse dans une exaltation de tout son être :
— C’est elle que j’aurais dû avoir ; c’est cette beauté pâle, ce sourire, ces cheveux de cendre, et cette poitrine que j’aurais dû aimer, et ces regards profonds, mais si purs, mais si simples, si doux !
Il aurait voulu humblement baiser sa ceinture.
— O ma mère, ma sœur, ma bien-aimée ! criait-il du fond de son âme, vous à qui j’aspire, que j’attends, à qui je suis dû !…
Comme sa tête retombait et que le sommeil commençait à fermer ses yeux, il lui semblait voir frissonner les blonds cheveux cendrés, et se tourner les yeux si longs, si clairs, si humides ; il lui sembla qu’imperceptiblement les roses de ses lèvres s’entr’ouvraient pour lui…
Pendant qu’il dormait, en son rêve elle parlait, dans une magnificence d’harmonies et d’orchestrations souterraines.
— Dors ! L’amour est sacré. Les printemps, les étés sont fleuris. Dors ! L’automne a des fruits ; les hivers ont des souvenirs.
» J’étais une vierge. Vois mes seins, vois mon cou ; je suis éclose du matin ; je suis pâle ; je viens de la fontaine où penchent les marguerites. Pour toi je me suis faite femme ; mes guirlandes pour toi se sont fanées, mes voiles sont flétris, mes fleurs cueillies, je me suis renoncée… Enfant, apprends de moi ce que c’est que d’aimer.
» Dors ! Je vais baiser tes cils. Je vais me poser dans ton cœur. Je bénis ton adolescence. Dors ! je suis le sacrifice, le don de soi-même et l’holocauste ; enfant, je suis l’Amour. »
Et, devant lui, la dame du pastel passait et repassait.
L’aurore, le lendemain, fut sombre ; des nuages noirs chargeaient le ciel. Marcelin se rappela son rêve, et une tristesse l’obsédait.
Il revit en son esprit le pastel, et il s’inquiétait d’un aspect douloureux, non encore remarqué, de la jeune figure ; l’idée lui vint que celle-là avait dû souffrir et qu’elle avait été malheureuse ; ses yeux lui semblaient tristes, son front voilé, son sourire éteint.
Il avait tardé à descendre ; la mélancolie des campagnes l’oppressait ; un découragement l’accablait ; l’inutilité de vivre éclatait dans la confusion de ses pensées ; une rêvasserie faisait défiler pêle-mêle en son esprit les visions des choses antérieures. Il se rappela une promenade, lors du printemps dernier, à Paris, autour du Luxembourg. Des fillettes, des jeunes femmes allaient et venaient ; il les avait considérées curieusement, sans émotion ; pas un visage où il vît une attirance ; les sourires et les tristesses féminines n’avaient rien éveillé en lui. Pourtant, à chaque page, ses poètes ne lui parlaient-ils pas de femmes aimées, toujours aimées ? Il s’était souvenu de maintes strophes des Contemplations, des Chansons des rues et des bois, et il avait éprouvé la peine d’une sorte de déception. Alors il s’était demandé pourquoi son cœur, le cœur de cet esprit si hanté de lyrismes, était muet, tandis qu’allaient autour de lui les fillettes, les jeunes femmes. Oh ! ce dont il rêvait, c’était quelque blonde figure de jeune femme, de demoiselle lointaine… Marcelin fermait les yeux à suivre la figure lointaine, pâle, blanche, de son rêve, comme en quelque pastel.
Par un effort, il se remit au souvenir de cette promenade près du Luxembourg. Des filles avaient ensuite passé, en des toilettes violentes, des parfums outrés, et dont les regards fouillaient, hardis, dans les sensibilités des hommes ; une d’elles était jolie, point effarouchante, jeune ; aucun désir d’être auprès d’elle ne l’avait sollicité. Où donc était le charme de la femme ? Les images de toutes les femmes rencontrées surgissaient devant lui ; nulle n’avait laissé quelque impression, et il s’était désespéré de ne pas connaître ce délice que devaient être l’amour, le désir, le frisson mental et charnel tant chantés par l’humanité.
Il s’était couché par terre, le ventre dans l’herbe drue ; et les insectes ronflaient à ses oreilles. Pourquoi vivre ? à quoi bon les choses ? une danse macabre de l’existence roulait dans son cerveau.
Les heures passèrent. Puis, à coups lents et réguliers, il entendit les cloches de l’église, au loin comme un glas. Était-ce une mort ? était-ce la mort ? Il s’imagina le prêtre, devant l’autel, célébrant le mystère, avec des échos d’orgues… Et le besoin le prenait de s’apitoyer sur quelqu’un, sur quelqu’un qui aurait souffert, sur quelque image très pâle et douloureuse dans un cadre de mélancolie.
Il revint à la maison, la tête vide. Le repas, comme tous les jours, fut silencieux. Le soir, un orage éclata ; la pluie tomba pendant toute la nuit. Marcelin dormit d’un sommeil inquiet et se leva tard. Après de longues incertitudes, il pensa à visiter la bibliothèque. Il trouva d’anciens livres, fureta longtemps ; aucun ne l’intéressait ; il parcourait des pages au hasard, passait à quelque autre volume. Quand l’obscurité se fit, il remonta dans sa chambre, répétant en son esprit, ressassant des mots, aucune idée.
Il avait des bourdonnements dans la tête, une grande lassitude.
La hantise grandissait dans sa pensée :
— Elle a souffert ; elle a été malheureuse.
Des détails anciens qu’il se rappelait tout à coup, des mots autrefois entendus çà et là, des impressions fugitives d’enfant lui revenaient ; et un grand apitoiement montait en lui pour la si pure jeune femme de son rêve.
Le régisseur, le père Homo, était le fidèle serviteur traditionnel, discret et dévoué.
Marcelin le rencontra du côté du verger. Le bonhomme lui montra les fruits qui mûrissaient, lui expliqua les espérances de l’automne. Marcelin l’écoutait, l’air attentif ; brusquement, il l’interrompit, et, sans le regarder, presque tout bas, il lui demanda, avec un grand effort sur lui-même :
— Vous avez connu ma mère ?
Le bonhomme resta rêveur, puis, tristement :
— La pauvre jeune dame !
Comme il se taisait, Marcelin leva les yeux.
— La pauvre jeune dame ! la pauvre jeune dame ! répéta le vieillard.
Marcelin n’eut pas la force d’insister ; le cœur poigné, il continua son chemin.
Il retourna dans la bibliothèque et reprit ses vagues lectures ; il était morose, les sourcils contractés, avec des yeux défiants, presque blême, l’air tour à tour fiévreux et harassé.
Le soir, à dîner, son père lui reprocha son assiduité d’études. Il ne répondit rien ; il levait sur son père des regards obliques ; des pensées malveillantes lui venaient. Il se demanda pourquoi celui-là se mêlait de sa vie, après l’avoir si longtemps négligée. Intérieurement, il lui reprochait sa taciturnité, ses absences, ses oublis de son fils ; et il considérait cet homme aux cheveux grisonnants, toujours silencieux, assis en face de lui, et se demandait s’il n’était pas la cause d’où il ne savait quel malheur mystérieux était issu. Sa pensée coulait, sous le calme du dîner finissant, vers de lointaines inquiétudes.
— Ne serait-ce pas, ne serait-ce pas lui ?…
Il n’osait achever…
— Si elle a tant pleuré, tant souffert…
Il le regardait à la dérobée…
— Lui, cet homme qui est mon père…
Et il reprenait :
— Si elle a souffert jusqu’à en mourir…
Son cœur sursauta dans sa poitrine ; il ferma les yeux ; il serrait dans ses mains convulsivement le couteau à fruits, la fourchette en vermeil, et, livide, se raidissait contre le dossier de la chaise.
Le père maintenant lisait un journal. Marcelin retomba, comme épuisé, un coude sur la table, la tête entre une de ses mains ; dans ses yeux flottait, ainsi qu’un nuage, l’image de la bien-aimée martyre.
Parfois il retournait dans le parc et dans les campagnes. Certains jours, il passait l’après-midi assis sur des troncs d’arbres ou sur l’herbe, à rêver ; certains jours, il marchait sans relâche et rentrait las.
Il entendit une fois le père Homo qui disait :
— Bien sûr, monsieur Marcelin est amoureux…
— Par exemple ?… se dit-il.
Mais il resta songeur tout le reste de la journée.
Un soir, dans sa chambre, ayant achevé une lecture, comme, en redressant le front, il regardait autour de lui ainsi qu’au sortir d’un rêve, il demeura quelque temps sans pensée. La pendule, à la lueur de la lampe, marquait dix heures ; une grande solitude régnait ; les murs, les meubles, les rideaux, le plafond, les deux portes semblaient dissimuler un repos menteur, une complicité maligne. Marcelin se leva. Il marchait sur les tapis sourds, un brouhaha de choses ténébreuses dans la tête.
Qu’il était pauvre et triste et délaissé et déplorable ! Quel isolement en son passé, quel isolement aujourd’hui, quel isolement pour l’avenir ! Celle, la seule, qui l’eût aimé, qu’il eût aimée, elle n’était pas là ; on la lui avait prise, on l’avait tourmentée, on avait semé d’angoisses sa candeur de jeune fille, on avait éteint le pur flambeau de sa frêle jeunesse. Que tout était noir ! et combien de mystère !
Il marchait, le sang aux tempes.
Pourquoi n’avait-il pas, aussi bien que les autres, les gaîtés de ses seize ans ; et pourquoi, elle, en avait-elle été sevrée ? pourquoi les épanchements du cœur lui étaient-ils déniés ; et pourquoi, elle, en avait-elle été déshéritée ? pourquoi songeait-il obscurément ; et pourquoi avait-elle été clouée pour l’éternité dans l’immobilité du pastel funèbre ? Un lourd destin pesait, à cause de quelque fatalité inexpiable ; car la raison n’apparaissait point d’être exceptionnel au milieu de la vie commune.
Il s’appuyait à la fenêtre, entrevoyant les ténèbres de la nuit. L’étoile ne brillait point ; ses yeux ne trouvaient point l’astre nocturne et clair ; il n’avait pas de phare dans le ciel pour la traversée de la vie ; l’initiatrice, la consolatrice, l’éducatrice, l’inspiratrice, celle dont les bras montrent le port, elle n’était pas là, l’uniquement rêvée.
Marcelin retomba sur un fauteuil, auprès de la table.
Par la fenêtre restée ouverte, la brise du soir entrait ; attirés par la lumière, quelques insectes, des papillons s’approchèrent.
Marcelin releva la tête ; il se rappela ses belles promenades dans le parc, dans les campagnes, quelques semaines auparavant. Il eut un désir de sortir, d’aller comme alors errer sous les arbres, autour des pelouses, Mais un découragement pesait sur lui.
— A quoi bon ! se dit-il.
Une inexorable tristesse persistait, et, volontiers, le jeune homme aurait pleuré sur lui-même. Et des possibilités extraordinaires entr’apparaissaient. De suprêmes abattements succédaient aux chimériques vouloirs, qui renaissaient, qui s’effaçaient et qui finalement s’embrouillaient dans l’exaltation de la nuit.
A la pendule, la demie sonna d’un coup rapide et clair. Marcelin eut une commotion ; il se releva, et, soudainement, il s’écria, des sanglots dans la gorge :
— Comme je l’aime ! comme je l’aime !
Oui, il était amoureux ; il aimait la jeune fille, la jeune femme dont il rêvait et qu’il rêvait, celle dont l’angélique beauté était l’idéal vers qui tendait sa jeune âme.
Il se l’imaginait telle toujours que la lui montrait le précieux pastel, telle qu’elle avait été à dix-sept ans, dix-sept ans auparavant, telle qu’elle était pour à jamais figurée là, si belle, si belle, mais si pure, si mélancolique ! Et il savait qu’elle avait été malheureuse ; il tremblait de se dire que c’était pour lui qu’elle avait souffert ; et il souffrait autant qu’elle avait souffert, dans l’aspiration de se dévouer à son tour pour elle.
Comprenait-il l’étrange amour qui lui était venu ?… Des fièvres qui bouillonnaient au fond de son cœur il ne pouvait, il ne voulait rien connaître. Dans la candeur et l’enthousiasme de ses seize ans, il ne voyait que l’absolue beauté de douceur, de refuge et de charité vers qui s’envolaient ses ardeurs nouvelles, et son secret, il le cachait à tous, il se le cachait presque à lui-même, avec la jalousie de sa plus intime pudeur. Mais c’était bien d’amour qu’il aimait, comme il se sentait aimé ; et pour elle il aurait voulu s’offrir, comme il savait que pour lui elle s’était donnée, immolée, sacrifiée.
Subitement il était devenu très pâle, sous la possession du désir forcené d’aller, de voir, de parler, d’interroger, de prier. Il s’approcha de la cheminée, enleva l’abat-jour de la lampe, baissa légèrement la mèche, et d’une main qui tremblait, il prit la lampe. Et, sans bruit, il descendait l’escalier, ouvrait, refermait les portes, traversait les salles… entrait.
Elle était là. Au-dessus du lit toujours clos, avec sa pâleur et son regard profond, la dame du pastel brillait d’une lueur de lune au ciel. Et tout sombrait, dans une terreur de religion, alentour d’elle et devant lui.
Lentement il posa la lourde lampe ; il prit une chaise, l’approcha de la table au-dessus de laquelle était fixé le pastel ; il s’assit. Ses deux coudes étaient appuyés au marbre de la table, son menton posé sur ses deux mains, et, la tête levée, il regardait.
La beauté de la vierge souriait presque ; immobile, il la considérait infiniment ; et il songeait douloureusement, mais avec une intime douceur.
Et il reprenait :
— O belle aux voiles candides et au cœur profond ! unique auxiliatrice ! n’est-ce pas pour moi, depuis de si longues années, que vous vous êtes renoncée !
La contemplant dans la lumière de la lampe, il adorait, comme au temps de ses exaltations religieuses, celle qui maintenant lui enseignait l’Amour…
Tout à coup, un bruit se fit dans la salle voisine ; la porte s’ouvrit.
Marcelin se leva et saisit la lampe.
Dans la porte un homme apparut, le père.
Marcelin resta muet de saisissement, immobile, les yeux fixes. Une minute s’écoula.
— Que fais-tu ? dit la voix.
Marcelin ne bougeait pas. De son immobilité de statue à l’immobilité de la dame dans le pastel, il n’y avait point de différence, si ce n’est que la lampe tremblait maintenant dans sa main levée.
— Que fais-tu ? répéta la voix.
Une angoisse poignait l’adolescent, de l’invasion subite, du secret découvert. Il tourna la tête vers la dame, puis ferma lentement les yeux. Le sourire de la bien-aimée semblait s’être figé dans une terreur hagarde…
Et il pensa que l’amante et l’amant étaient surpris, que le mystère était pénétré, la retraite envahie… Adieu ! il n’était pas permis que tous deux ils s’aimassent dans le silence ! Ils venaient de se retrouver en une nuit réparatrice, et voilà que leur nuit était close ; ils retourneraient à leurs isolements ; elle, elle séjournerait dans le délaissement de ce cadre sépultural ; lui, il irait ailleurs…
Menaçante, la voix s’écria une troisième fois :
— Enfin, que fais-tu ?
Marcelin vit que son père tournait les yeux vers le portrait…
Une rougeur, une chaleur soudaine monta au visage du jeune homme…
Brusquement, son âme s’était soulevée ; le sacrilège éclatait à ses yeux, la souillure, la meurtrissure, la profanation. Une muette fureur l’étreignit à la gorge. Ses yeux étaient grands ouverts et s’injectaient de sang ; il regarda fixement l’homme qui, debout, sur le seuil, blêmissait ; sa main droite trembla. Avec un cri, il agita le bras et brandit la lourde lampe, pour la jeter, meurtrière, au visage maudit. Mais, comme ses doigts se crispaient, un flot de larmes éclata dans ses yeux ; il chancela, et la lampe, avec un fracas, tomba à ses pieds, tandis qu’il s’affaissait contre le lit.
Un an avait passé. Marcelin, ayant achevé ses classes, avait résolu de faire ses études de droit. Il arriva à Paris par un après-midi d’octobre ; un soleil clair brillait ; et, tout à coup, le crépuscule était tombé, les rues s’étaient illuminées, les fenêtres, les boutiques, les becs de gaz, les lanternes des voitures, parmi le brouhaha du soir.
Son cousin, M. Desruyssarts, lui avait recommandé une pension de famille de la rue de Grenelle, une antique et respectable maison ; l’hôtesse, la vieille madame de M., avait la réputation de soigner ses dix ou douze pensionnaires comme des enfants adoptifs. Elle accueillit Marcelin avec une bonhomie correcte qui le séduisit.
Après dîner, il monta à sa chambre ; au milieu de ce Paris qui lui représentait la vie moderne, il était libre, maître de lui-même ; les bruits du dehors entraient par la fenêtre ouverte, et mille rêves, mille désirs anciens lui revenaient au cœur ; il se demanda si l’heure des accomplissements allait enfin sonner.
Il avait tenu autrefois, au collège, un petit livre de ses pensées intimes. Une nuit, quelques semaines après son arrivée à Paris, il écrivit :
« Dans ma première adolescence je me souviens de rêves bleus et dont les parfums sont devenus une fluide vapeur dans mon âme. Puis, comme après des catastrophes, ce fut une sorte d’effacement de tout, un oubli, une disparition, quelque chose comme l’obscur recommencement qui suit les bouleversements de la terre. Depuis que je suis installé ici, dans le confort et la régularité de ma vie paisible, je sens peu à peu se rouvrir la fleur de mon adolescence.
» Et, depuis lors, j’attends.
» Je veux, j’espère aimer ; autour de moi passent des vols de Juliettes et de Marguerites ; je leur tends les bras ; que de fois me suis-je enivré d’illusoires extases ! Puis, subitement, je me retrouve dans mon isolement, et, comme Hamlet, je plonge mes yeux dans le vide de l’air.
» Je ne supporte pas la pensée de l’amour vénal ; je m’efforce à chasser l’idée même de la profanation, et je m’écrie : Venez et me consolez, idéales amantes ! Car je me sais le cœur vivant, très jeune, très fertile. Et parfois je me prends à rêver de la belle jeune fille pensive, aux yeux chers, que je rencontrerai quelque jour providentiel. »
« Je suis, écrivit-il une autre fois, le jeune amant, qui, la nuit, au bas du mur et du verger, cherche, — l’amant vierge dont le cœur palpite, et qui attend celle qui doit venir, et l’entrevoit, blanche, derrière les feuilles. »
« Désirs ! s’écriait-il encore, désirs, non des sens, désirs de l’âme ! »
Souvent, dans les rues, son cœur tout à coup se mettait à battre violemment ; il marchait à grands pas, dans un flux d’ardeurs exubérantes. Son âme débordait de son corps, remplissait l’espace, s’étendait parmi la création. Il sentait alors en lui une force surhumaine, et quelles confiances !
L’exaltation durait des soirées entières.
Il n’allait plus au théâtre sans en revenir troublé. Il rentrait dans son solitaire logement de garçon avec un malaise d’inquiétude et de tristesse qui persévérait plusieurs jours. Des clameurs lui restaient dans l’esprit ; il ne pouvait oublier ; il souhaitait quelqu’un qui prît part à ses obsessions ; le vide l’étouffait.
Jadis les poètes lyriques le laissaient en un enchantement ; les désirs qu’ils éveillaient étaient des voix joyeuses ; leurs mélancolies autant que leurs enthousiasmes étaient très douces.
Aujourd’hui le moindre cri de passion proféré par une bouche humaine au milieu d’un drame quelconque le bouleversait.
Ses fenêtres ouvraient sur l’endroit le plus fréquenté de la rue de Grenelle. Il s’attardait à regarder les passants, sans intérêt, sans sympathie, ne cherchait pas à deviner leurs préoccupations. Des femmes défilaient, des jeunes et des vieilles, des ouvrières, des bourgeoises ; étaient-elles jolies ? étaient-elles capables d’amour, dignes d’amour ? à quoi bon ! Et tout à coup il se disait que peut-être il y avait là, pourtant, une âme dont la pensée eût correspondu à la sienne ; mais, dans le flot confus des choses, comment trouver, comment seulement chercher ?
« A celle qui viendra quelles richesses sont réservées ! écrivit-il un soir. Une tendresse infinie prête à se répandre, une infinie sympathie, un besoin d’écouter et de comprendre, de répondre aux plus intimes aspirations d’un cœur, d’être un dévouement et une seconde conscience, et une virginale profusion de baisers… Le fruit n’est-il pas mûr pour que quelqu’une le cueille ? »
Quelques jours avant Noël, il quitta son deuil. Il y avait un an que son père était mort, seul, dans ce château de Saint-Paulin où il l’avait laissé… Il se rappela l’enterrement, le long de la route grise et neigeuse, les cierges dans l’église jetant à travers un jour sombre leurs ombres fumeuses sur le mur, la cérémonie sans fin, les condoléances…
Et il se demandait s’il allait, avec ses vêtements noirs, se débarrasser de la hantise du passé, — s’il allait devenir un autre homme.
Rien toujours. D’insignifiantes relations, des études oiseuses, nulles joies, maints rêves, la seule récréation de quelques livres. Il songeait parfois à fréquenter avec des gens de son âge, essayer des plaisirs, des femmes. Mais puis-je, se disait-il, suicider les choses nobles que je crois exister en mon âme ? J’ai le temps encore ; rien n’est perdu ; l’époque n’est pas venue de l’abdication.
Un jour, il fit une lettre pour une jeune actrice admirée au théâtre ; mais, au dernier moment, il n’osa l’envoyer.
Pendant une semaine, il se persuada qu’il était amoureux.
La trop grande inutilité de son amour finit pourtant par le décourager. Et la crise passée le laissa plus calme.
Un autre jour, il écrivait dans son petit livre :
« De grandes confiances parfois renaissent…
» Je suis le voyageur qui entre dans la route ; la cité est lointaine ; mais dans les brumes je l’aperçois ; et puis, c’est le matin, et jusqu’au soir combien d’heures ! Je vois sans effroi la route longue, les pierres et les marais du chemin, les lassitudes du midi brûlant, les suites moroses des murs qui voilent de leurs circuits le but ; je ne crains point les brigands des bois, les sirènes des sources, les tonnerres qui peut-être gronderont dans les nuages. Dans le soir de la ville rêve quelque vierge prédestinée. »
Il ne comprenait pas qu’on n’aimât pas qui vous aime. Dans ses souvenirs classiques il restait choqué de Bajazet n’aimant pas Roxane, de Pyrrhus méprisant Hermione ; il souffrait de la Esméralda repoussant Claude Frollo ; toute sa sympathie allait à l’archidiacre contre l’aveugle jeune fille. Il ne doutait point qu’il eût aimé qui l’eût aimé ; l’amour non partagé lui semblait un monstre.
Deux samedis de suite, aux répétitions générales des Concerts Colonne, qu’il suivait assez régulièrement, il se trouva auprès de la fille de l’un de ses anciens professeurs du Collège. Elle était arrivée des premières, il salua son père, la salua. Et dans la salle mi-éclairée, sous les galeries vides et noires, parmi la foule élégante qui remplissait l’orchestre et les balcons, il considérait à la dérobée ce blond visage de jeune Parisienne, ces grands yeux brillants. Elle l’avait une fois regardé et avait souri. Il se promit de lui adresser la parole le samedi suivant.
Sous sa fenêtre passaient des groupes d’ouvrières, alertes, jolies, nu-tête et les cheveux voltigeants, la taille mince. Il les suivait du regard qui marchaient avec des balancements d’épaules et des rires et de juvéniles fronts au ciel.
Le troisième samedi, il ne vit pas à la répétition la demoiselle de ses pensées. Pourquoi n’était-elle pas venue ?…
— Quelle folie, se dit-il ! Qu’ai-je à espérer, à seulement désirer ? Je ne puis me marier avec elle. A quoi bon y penser ?
Aux jours gras, il alla au bal de l’Opéra. Son camarade d’école, Charles Berty, l’avait emmené. Ils se promenèrent, deux heures durant, parmi l’ennui des habits noirs, la trivialité des créatures débraillées. Les efforts de Charles à la gaîté, au flirt, le navraient et les navraient tous deux. A trois heures ils rencontrèrent les deux frères Crémone qui suivaient deux dominos assez propres. Marcelin assista à une demi-heure de cette campagne, puis accepta de souper avec ses trois amis et les deux dominos.
Au Café Riche, les dominos se démasquèrent ; c’étaient deux jolies filles, la blonde et la brune traditionnelles, d’un demi-monde de marque convenable. Il était assis entre l’aîné des frères Crémone et la brune, Angélique, se nomma-t-elle.
Marcelin se grisa pour la première fois de sa vie, d’une sorte de fort étourdissement qui l’intéressa beaucoup. Au quatrième verre de Mumm, il se sentit entraîné. La conversation restait générale ; il avait été un peu silencieux, et la brune Angélique le méprisait un peu ; maintenant, des gaîtés, des expansivités lui venaient ; ce fut lui qui commença la série des excentricités. Il se mit ensuite à dire des galanteries à sa voisine ; en même temps il trouvait des plaisanteries à lancer ; il était heureux.
Le Mumm coulait à flots ; Marcelin se laissait aller ; cela l’amusait ; il remarqua que ses compagnons s’échauffaient. Il avait la tête brûlante, les mains moites, le sang aux yeux. Il se surprit à fredonner un air de valse… Heu ! heu ! se dit-il. Et il rit tout haut. Personne n’y fit attention.
Le verre d’Angélique était vide ; Marcelin eut un attendrissement et un remords ; il saisit la bouteille et le remplit.
— A votre santé !
— A votre santé !
Il se pencha et s’accouda en face d’elle ; elle s’était renversée dans son fauteuil ; il s’approcha. Alors il prit la parole et parla, parla ; dans une demi-conscience, lui-même il admirait sa facilité. Il buvait à petites gorgées ; il passait de temps en temps la main sur les épaules nues de sa voisine, et il continuait.
Au milieu d’une phrase, tout d’un coup, elle l’interrompit ; à son tour, elle prit la parole. Elle lui raconta des épisodes, évidemment mensongers, de sa vie ; elle le regardait en parlant ; il avait le sentiment d’être un vague public ; il souriait béatement.
Il était arrivé à cette première ivresse qui est une sorte de séparation de l’âme et du corps. Il agissait par mouvements automatiques ; il eût été incapable de se lever ; mais sa présence d’esprit, il la gardait ; seulement, son corps n’aurait plus obéi aux ordres de sa raison. Davantage, il n’aurait pu parler, malgré qu’il eût fort bien su que dire ; sa langue était comme inerte ; cela ressemblait, moins l’horreur, à l’état de cauchemar, quand l’on veut sans pouvoir. Il lui venait à l’esprit une foule de réflexions profondes ou spirituelles, dont émailler les narrations d’Angélique et qu’il ne savait que se formuler intérieurement. Tout à coup, il eut une honte : il ne fallait pas laisser voir qu’il était ivre : et, en fait, l’était-il ? il se rendait compte de tout, il avait son bon sens entier. Il se redressa, se raidit ; mais sa tête penchait de côté et d’autre, comme s’il avait été pris de sommeil.
Le cadet des frères Crémone s’était assis sur le divan avec son amie blonde, et la pinçait obstinément. Son frère et Charles discutaient sur quelque chose… Marcelin notait tout cela pour se prouver sa lucidité. L’idée lui vint de remplir à nouveau les deux verres ; Angélique but sans cesser de parler ; il but avec un sourire. Il mit son fauteuil tout près du sien ; d’un geste elle gara sa robe ; il admira sa présence d’esprit.
Brusquement elle se tut. Marcelin sentit ses yeux papilloter. Je suis gris, se dit-il ; mais cela ne m’empêchera pas de faire mon devoir. Son devoir lui apparut de pincer Angélique ; il l’exécuta avec facilité. Il lui prit la taille et lui baisa la gorge. Elle le laissa faire. Elle semblait rêvasser. Il chiffonnait dans son corsage, avec persévérance et lenteur. Bientôt, il se trouva presque sur elle. Ils se disaient des mots langoureux :
— Ma petite chatte ! Mon gros chien ! Mon beau mimi ! Le toutou à sa petite femme…
Il prit ses mains, résolu à oublier toutes les convenances. Charles à ce moment s’écria :
— Sacrédié ! regarde Marcelin et Angélique se bécoter… C’est joli…
Angélique ânonnait, les yeux sur les yeux de Marcelin :
— Laisse-les dire, mon bébé ; laisse-les dire, mon rat ; laisse-les dire, mon petit poulet…
En même temps, Charles l’interpellait, en se tournant à moitié :
— Crois-tu, Marcelinet, que cet animal de Crémone ne veut pas, depuis une heure, convenir que le niveau intellectuel est plus élevé en Pologne qu’en Danemark ?
L’outrecuidance de Crémone révolta Marcelinet. Mais une invincible envie de dormir l’étreignit. Il entendit encore que sa voisine le traitait de crétin ; une discussion avait lieu entre elle et Crémone l’aîné. Il renonça à barder sa lucidité, et cette abdication fut son dernier acte mental.
Le lendemain, en se réveillant, il ne se rappela pas comment il était rentré chez lui.
Le samedi suivant, il aperçut de nouveau, à la répétition, la fille de son ancien professeur. Il y avait une place libre derrière elle ; mais il fallait déranger vingt personnes ; il se risqua. En le voyant traverser les rangs, elle rougit et se détourna ; de toute la répétition, elle fit semblant de ne pas le remarquer. Son père ne lui rendit pas son salut.
… Tout était fini.
La nuit du bal de l’opéra lui avait laissé des souvenirs qui hantaient son imagination ; les premiers beaux jours de mars achevèrent de lui bouleverser les sens.
Il avait jusque-là vécu vierge, malgré les entraînements des camarades, peu tenté, isolé au milieu des autres, point précoce, pris par des regrets, des tristesses. Un soir, brusquement, il se dit qu’il fallait en finir. Dix heures venaient de sonner ; il était chez lui, devant des livres de droit ; il se leva pour prendre son chapeau, son pardessus, sortir…
— Où, se demanda-t-il.
Il ne savait pas.
Une angoisse l’étreignit. Il se découragea, remit au lendemain.
Huit jours passèrent, huit mortels jours, pendant lesquels il mâchonna sa résolution. Des difficultés existaient ; il ne savait où aller ; il ne voulait pas demander ; il craignait son inexpérience. Et ces difficultés, il les aggravait, en son esprit, par l’appréhension de l’événement. Et il remettait au lendemain, sans cesse ; une fois, il fit un copieux dîner dans l’espoir de se donner du cœur ; une autre fois il alla au théâtre. Son hôtesse, la bonne madame de M., s’inquiétait de ses sorties de tous les soirs.
Le huitième jour, après dîner, il fut aux Folies-Bergère. Il était angoissé. Dix femmes l’assaillirent ; il ne les voyait pas. D’autres se promenaient ; il se promena et se remit un peu. Il n’osait regarder les femmes et il essayait de les voir ; il les considérait à la dérobée, en passant, et fuyait vite ; il les frôlait ; toutes le terrorisaient. Comment suivre l’une d’elles ? mais comment, surtout, comment l’aborder ? On peut se laisser aborder ; mais comment répondre ? Des gymnastes se balançaient sur des trapèzes ; les femmes s’étaient arrêtées à les contempler ; il se dit qu’il n’y avait rien à faire, et sortit.
Dehors, ce fut une désolation, un découragement ; et, aussitôt, une résolution de tout brusquer. Il s’adresserait à un endroit sûr ; c’était le plus simple ; mais il n’en connaissait pas… bah ! il en trouverait ; c’était facile à reconnaître ; il savait à quelle enseigne ; persiennes closes, lanterne, gros chiffre… Il n’avait qu’à suivre les rues peu fréquentées ; il arriverait tôt ou tard ; dix heures sonnaient ; il avait le temps.
Il descendit le faubourg Poissonnière ; ce n’était pas ce genre de rue ; il bifurqua rue d’Enghien, examinant les façades. Parfois, des filles l’accostaient ; il s’énervait, filait sans répondre, il se laissait toucher au bras ; il avait une mauvaise volupté à se sentir abordé, à entendre, en fuyant, les propositions obscènes. Il déambula assez longtemps ; à la fin, il ne regardait plus le nom des rues ; et il ne trouvait rien ; il se lassait, mais il s’excitait ; il s’entêtait pourtant, marchait vite, explorant une rue d’un coup d’œil. Tout d’un coup, rue Saint-Denis, près du boulevard, il aperçut une lanterne éclairant un numéro ; c’était ça. Il n’y avait personne alentour ; il entra.
Un long couloir s’ouvrait, puis un escalier. A ce moment, il entendit un piano, des rires ; une voix de femme chantait ; il s’arrêta à la deuxième marche. On lui avait pourtant dit qu’à Paris les choses allaient sans musique, sans liqueurs et sans bruit. Quelle figure ferait-il en tombant dans cette noce ?… Une seconde après, il était dans la rue ; personne ne l’avait vu ; il reprit sa route.
Presque aussitôt, il aperçut dans une rue perpendiculaire, à quelques pas, une femme habillée de noir, nu-tête, debout sur le seuil d’une porte. Il passa en jetant un coup d’œil furtif…
— Monsieur veut-il entrer ?…
Il continua son chemin sans s’arrêter ; mais tout de suite il se demanda pourquoi il n’irait pas là aussi bien qu’ailleurs ; une chaleur lui était montée au visage, subitement, sous un coup de désir ; il ralentit le pas ; oui ; il fallait aller là… Il ne pouvait pourtant faire demi-tour ; il aurait l’air d’un sot, d’un enfant… Il se décida à tourner le pâté de maisons et à revenir par le même côté ; la dame ne ferait pas attention ; elle ne le reconnaîtrait pas ; et puis, il voulait d’abord savoir dans quelle rue il était. Il lut : rue d’Aboukir. D’un brusque effort, il arriva ; la dame était encore là ; elle s’effaça pour le laisser passer ; rapidement, il franchit le seuil.
Du coup, tout son courage tomba ; il eut la force juste de se laisser conduire ; il marchait dans une sorte de brume, distinguant à peine les choses, souhaitant vaguement et n’osant reculer. Il avait des bourdonnements dans la tête, des vapeurs dans les yeux ; pour un rien, il aurait trébuché. Maintenant il traversait des couloirs, montait des escaliers, et il se trouvait dans une chambre tendue de jaune dont la pauvreté le poigna, en face de la créature qui lui réclamait de l’argent. Et, ayant donné sans discuter ce qu’on lui demandait, comme il était là, immobile, n’osant pas regarder, les yeux baissés, ne sachant que faire de ses bras, balbutiant l’aveu de ses ignorances :
— Allons ! fit l’initiatrice.
Le terrible duo commença ; et de tout ce qu’il ressentit dans le trouble affreux où il vaguait, il ne put jamais plus tard se rappeler qu’une suite de sensations analogues à celles du cauchemar, lorsque les choses se succèdent sans causes discernables. Ce fut d’abord une appréhension abominable, comme au moment qui précède une opération chirurgicale encore mystérieuse ; puis, peu à peu, il devinait des hideurs non encore aperçues, et c’était une répugnance de toutes ses fibres, un malaise grandissant… Brusquement, un déchirement… Il pensa crier : mais la douleur cessa subitement, et il y eut une attente d’une seconde ; il entendait dans ses oreilles un grand brouhaha ; il avait fermé les yeux ; une sueur lui coulait le long du dos. Alors voilà que, confusément, progressivement, il avait la sensation de quelque chose qui montait et descendait, comme un flot de mer, comme une respiration, comme les rouages huileux de quelque machine énorme, par mouvements larges et réguliers, et qui l’engouffrait, l’emportait, l’hallucinait dans une chaleur tiède, une ardeur de plus en plus poignante, et il râlait, ses bras se crispaient, il défaillait…
Il était rentré chez lui, navré, la tête vide, à peu près aussi ignorant que quelques heures auparavant, quand il errait dans les rues borgnes, enfiévré du besoin de connaître. De ce tourbillon où les choses s’étaient embrouillées, un émoi lui restait seulement ; comme une idole mal entrevue dans l’épouvante des yeux, le sexe demeurait pour lui un angoissant mystère.
Le lendemain, il médita longuement son aventure ; il conclut qu’il était mal tombé, et que dans de meilleures circonstances, avec une personne plus agréable, il eût été plus heureux.
Il se décida à interroger des camarades d’école ; ceux-ci lui donnèrent une adresse, le conseillèrent, avec toute sorte d’encouragements…
— Tu demanderas Georgette… Tu demanderas Mignon…
Il alla demander Georgette, et, quelques jours après, Mignon. L’installation lui sembla confortable, les divans moelleux ; il nota la bonne condition du linge. Les deux dames étaient élégantes ; elles furent gracieuses. Elles dévoilèrent de bon gré, avec des indulgences et des flatteries, les secrets de leurs personnes ; leurs personnes étaient jolies et se faisaient désirables ; elles donnaient du plaisir. Marcelin connut pourtant ce sentiment qu’auparavant il ne pouvait seulement concevoir en son esprit ; l’horreur après le désir satisfait. Il restait stupéfait, autrefois, quand il lisait, quand il entendait dire que le désir ne laissait pas derrière lui le rayonnement de sa jubilation… Eh bien, il l’avait éprouvé, le désir : et puis, il n’avait plus eu dans ses bras que le cadavre de la créature, veuve de tout charme.
Après ces premières équipées, longtemps il resta sage. C’était peut-être la régularité de la vie à la pension et du travail, la monotonie des jours sans incidents. Peut-être aussi que la curiosité plutôt que l’instinct avait été surexcitée en lui. Et il se disait que sans doute aussi les besoins plus purs, les rêveries d’amour partagé, et cette poésie qui toujours l’exaspérait mais le consolait, ne comportaient pas la satisfaction qu’eussent offerte Georgette et Mignon.
Les premiers jours d’août, Marcelin se rendit aux Andelys.
Son cousin Georges Desruyssarts, le fils aîné de son tuteur Desruyssarts de Rouen, se mariait ; il épousait la fille d’un tanneur du pays ; toute la famille était convoquée pour la cérémonie ; Marcelin était garçon d’honneur.
Il arriva la veille du grand jour et s’en fut dîner chez le beau-père. Quelles excellentes gens ! Le dîner avait malheureusement un peu traîné. Marcelin sentit qu’on l’avait jugé timide ; il se proposait de donner le lendemain une autre impression. A neuf heures, des parents de la mariée étaient arrivés de la gare ; des Parisiens ; la femme d’un chef de bureau de l’Intérieur avec sa fille. La fille du chef de bureau, mademoiselle Amélie, était la demoiselle d’honneur de Marcelin. Son cousin lui expliqua que, suivant l’usage du pays, le garçon d’honneur avait, durant toute la noce la charge de sa demoiselle d’honneur et ne devait pas l’abandonner… Il trouvait la chose un peu embarrassante… Mademoiselle Amélie était plus âgée que lui, vingt-deux ou vingt-trois ans ; elle était jolie et semblait aimable. La noce allait d’ailleurs être très gaie ; cela se passait sans étiquette, familialement, et durait deux grands jours. Depuis l’avant-veille on travaillait dans la cour de l’usine à disposer une tente pour servir de salle de festin.
En regagnant son auberge, Marcelin fit une petite promenade auprès de la rivière. C’était délicieux. Tout le long, il y avait une allée plantée de grands arbres qui s’appelait « les Promenades ». La pleine lune à travers les feuilles mettait des reflets dans l’eau qui miroitait. A gauche, on voyait les maisons du Grand Andely, entourées de jardinets, toutes blanches sous la clarté nocturne ; sur le coteau, à droite, les ruines du Château-Gaillard. Le jeune homme s’assit sur un banc et se rappela le Vallon de Lamartine, avec la musique de Gounod.
Le lendemain, à dix heures du matin, on se retrouva à l’usine. Tous les ouvriers étaient là ; quand la mariée fit son entrée au bras de son père, on poussa des vivats, et les chapeaux s’agitèrent en l’air ; tout le monde jubilait. Mademoiselle Amélie prit le bras de son garçon d’honneur ; ils marchaient derrière le marié. Elle avait une délicieuse toilette crème, beaucoup de chic : ses cheveux blond foncé frisaient sur son front ; elle était un peu pâlotte, mais les pupilles de ses yeux étaient des diamants, des diamants noirs, vifs comme du soleil. Ils montèrent dans la voiture de la mariée, avec leur gros bouquet blanc. Le temps était très beau. On traversa une haie de gamins et de gens qui saluaient. A la mairie, à l’église, tout se passa bien. Les demoiselles d’honneur quêtèrent, assistées de leurs garçons d’honneur. L’autre garçon d’honneur était Paul Desruyssarts, le frère du marié, un brave garçon, un peu province, avec, pour demoiselle d’honneur, une cousine de la mariée, fillette insignifiante. On avait fait valoir à Marcelin qu’on lui avait réservé, des deux demoiselles d’honneur, la plus agréable, une Parisienne.
A une heure, on rentra à l’usine et l’on se mit à table. Il y avait quatre-vingts couverts. La tente était ornée de guirlandes, avec les initiales des mariés ; le service était superbe à voir ; on avait établi un plancher recouvert d’une toile pour danser le soir ; à côté, un petit salon était disposé, et un fumoir. Le soleil rayonnait à travers la tente, par les portes, dans les rideaux, et répandait la gaîté ; aussi, quand tout le monde fut assis, il y eut un murmure de satisfaction. Tout près, dans l’usine même, le beau-père donnait à dîner à ses ouvriers ; par moments, on entendait leurs rires et leurs cris joyeux.
Marcelin avait naturellement Amélie à sa droite ; à sa gauche, une vieille parente un peu idiote ; il lui suffirait de veiller à sa subsistance et de lui dire un mot toutes les dix minutes ; il put se consacrer à Amélie.
Amélie était gaie ; elle avait de l’entrain, beaucoup d’aisance et une bonne grâce inaltérable ; elle fut parfaite avec les gens du pays et les ouvriers. Pendant le repas, tous deux se mirent à causer longuement ; elle savait soutenir, animer la conversation. Elle commença par demander à son voisin à quoi il se destinait ; il lui raconta qu’il étudiait le droit, qu’il n’avait pas encore déterminé l’usage qu’il ferait de ses diplômes, qu’il vivait dans une pension de la rue de Grenelle ; la vérité. Et puis, comme elle s’enquérait s’il allait beaucoup dans le monde, s’il avait des relations, il lui dit tout de suite que non et lui parla de la monotonie, de la tristesse de son existence, et combien il aurait de joies à de bonnes relations amicales non point seulement avec des camarades d’école, mais avec des familles ; il avait envie d’ajouter avec des familles où sont des jeunes filles élégantes et charmantes comme elle était. Elle écoutait, elle répondait, elle souriait, l’arrêtait dans ses développements, l’y ramenait. Il parlait sans trop de gêne ; elle était si avenante !
Ils se confièrent les choses qu’ils aimaient, celles qui leur étaient antipathiques ; ils se trouva qu’ils avaient beaucoup de goûts semblables ; elle adorait, comme lui, la musique ; mais ni elle, ni lui, n’étaient de fameux pianistes ; ils méprisaient tous deux l’Opéra ; lui, pourtant, y allait de temps en temps, à cause du public, des toilettes, de la belle tenue de la salle. Ils s’apprirent avec étonnement que, l’un et l’autre, ils suivaient les concerts Colonne ; comment ne s’étaient-ils jamais vus ? c’était bien simple pourtant, puisque l’on ne se connaissait pas ! Elle ignorait les répétitions publiques des concerts Colonne, le samedi matin ; il en fit un éloge enthousiaste ; le public y était élégant ; et puis, c’était si commode ! on pouvait, le dimanche, aller ailleurs, aux concerts Lamoureux, aux matinées ; seulement, il fallait se lever de bonne heure, être au Châtelet à neuf heures. Cela ne la dérangeait pas ; elle était debout tous les jours à huit heures.
— Et vous ?
— Moi ? pas toujours.
Il n’y avait que les lendemains de soirée, qu’elle était paresseuse ; c’était bien naturel ! Elle parlait de sa vie ; ses parents n’avaient qu’une cuisinière ; elle devait s’occuper elle-même de la maison ; sa mère l’avait élevée ainsi ; sa mère était excellente, si bonne, si intelligente ! Elle allait beaucoup dans le monde ; malheureusement, son père, bien qu’il ne fût pas vieux, se fatiguait. Elle avait deux frères, tous deux dans l’armée ; quelle chose bizarre ! tous deux avaient absolument voulu être soldats ; ils avaient été à Saint-Cyr ; l’aîné, trente ans, était marié depuis un an, était lieutenant de chasseurs à Perpignan ; elle l’aimait beaucoup ; elle aimait beaucoup aussi le second ; il était sous-lieutenant dans l’infanterie.
— Et vous, vous n’avez pas encore été soldat, je pense ?
— Oh ! pas encore.
— Vous êtes très jeune…
— J’ai dix-huit ans.
— Dix-huit ans et vous n’avez plus vos parents !
Il vit dans ses jolis yeux un attendrissement.
— Je suis seul, répondit-il.
Elle savait déjà cela, et qu’il n’avait pas de frères ni de sœurs.
— C’est bien triste, murmura-t-elle.
Elle regardait devant elle, vers la porte lumineuse de soleil.
Il crut devoir ajouter.
— Mes cousins sont très gentils avec moi ; vous savez que M. Desruyssarts est mon tuteur.
Elle tourna les yeux vers lui, avec un sourire ami.
— Il faudra, reprit-il après un silence, que tout cela, parents, sœurs et frères, une femme me le donne.
Elle rougit imperceptiblement, sans répondre, et, lentement, le regarda en face.
— Qu’est-ce que vous racontez là ? demanda en riant le marié à travers la table. Vous faites un peu bande à part, il me semble.
On regardait. Amélie avait du coup repris son air de pimpante gaîté.
— Monsieur Marcelin, répondit-elle, me parle de ses idées de mariage ; en qualité d’aînée, je lui donne des conseils… Car je suis votre aînée.
— Mais non.
— Mais si.
— Pariez-vous ?
— Je parie.
La jolie folle entamait des histoires, des discussions.
— Vous verrez que nous serons encore à table à cinq heures, affirmait-elle.
Il était presque six heures quand on se leva.
— A quelle heure le dîner ? demanda-t-elle pour rire.
On sortit prendre l’air, faire un tour ; on allait en groupes ; par convenance, Amélie et Marcelin se quittèrent. Deux ou trois personnes le leur reprochèrent. On suivit la petite rivière jusqu’à la Seine ; on n’avait pas le temps de monter au Château-Gaillard ; le soleil déclinait ; l’horizon flambait au couchant. Marcelin marchait en compagnie de Paul et de quelques jeunes gens, à vingt pas derrière Amélie ; il admirait sa jolie prestance ; quelquefois elle se tournait avec un gentil sourire ; Paul faisait des plaisanteries. A un détour du chemin, ils la perdirent ; ils continuèrent lentement, dans la tiédeur de la tombée du soir. C’était charmant. Vers huit heures, on rentra à l’usine. Des petites tables étaient servies dehors, dans la cour, pour la collation. Quelques dames, Amélie et sa mère, étaient à leur toilette. Il fallut collationner ; la nuit descendait ; on allumait. Sous la tente, les tables avaient été repoussées toutes d’un côté et formaient un long buffet ; la salle était disposée pour le bal : du dehors on la voyait s’illuminer.
Tout à coup les violons retentirent. La porte de la maison, au-dessus du perron, s’ouvrit, et les dames apparurent. Amélie était en rose, une jupe bouffante avec des dentelles, un corsage demi-décolleté et des fleurs dans les cheveux. Rapidement, elle descendit ; ses petits souliers de satin rose sautaient sur les marches. Elle vint prendre le bras de son garçon d’honneur.
— Vous êtes ravissante, exquise.
Ils entrèrent. Les violons faisaient rage.
— Vous m’avez dit que vous aimiez la danse, mademoiselle ?
— Je l’adore. Vous aussi ?
— Moi ? j’en raffole.
L’orchestre jouait une sorte d’ouverture ; le monde arrivait rapidement ; ils s’assirent ; on causait, on se pressait, les braves gens se récriaient. Tout à coup, chacun se retourna ; les mariés entraient ; l’orchestre se tut et, une minute après, entama un grand quadrille ; les mariés ouvraient le bal. Amélie dansait parfaitement ; les deux jeunes gens bostonnèrent toutes les danses, polkas, mazurkas, scottischs. On les regardait beaucoup. Ils étaient les seuls à valser des deux sens ; cela excita l’admiration. Georges vint les prévenir que les usages du pays voulaient qu’ils dansassent toujours, ou du moins presque toujours ensemble. Ils eurent un mouvement d’embarras ; mais, au fond, il lui sembla qu’elle s’en applaudissait aussi bien que lui. Ils dansèrent comme des fous ; au bout d’une heure, ils faisaient de la virtuosité ; ils commençaient dès le prélude, entremêlaient des temps de slow-valse qu’ils déchaînaient subitement en pas de boston qui traversaient la salle en trois mesures ; ils passaient à gauche, à droite ; ils vaguaient d’inspiration. Il la tenait de près ; cela était nécessaire d’ailleurs ; et il s’enchantait, et tous deux s’enchantaient dans cet emportement cadencé. On eût dit qu’il la portait entre ses bras, si légère qu’elle frôlait à peine le plancher. Et, peu à peu, elle se donnait davantage, avec un plaisir qui semblait grandissant, liée plus étroitement, plus intimement en quelque sorte, à son cavalier.
— Vous êtes un danseur admirable ; c’est délicieux de valser avec vous, lui dit-elle à l’oreille.
Et une fois encore, il rencontra ses grands yeux devenus profonds qui le regardaient.
Un moment où ils se reposaient, le cousin Paul Desruyssarts s’approcha avec mademoiselle Blanche, sa demoiselle d’honneur.
— Venez faire une promenade dehors.
— Comment ?
— Cela se fait très bien. Regardez un tel et un tel.
— Au fait, si c’est permis…
— Il fait si beau !
— Soit ! mais pas longtemps.
Ces demoiselles prirent leurs pèlerines, ces messieurs leurs pardessus, et, tous quatre, ils sortirent. Ils marchaient par paires, lentement, causant peu ; Paul faisait les frais de la conversation, jetait des plaisanteries un peu faciles ; ces demoiselles riaient. Mademoiselle Blanche se montra moins insignifiante que pendant l’après-midi ; elle eut des reparties drôles. Amélie s’appuyait nettement sur le bras de son cavalier ; il affectait de tenir la tête de son côté ; tous deux regardaient le ciel clair, la lune qui montait. On passa devant une statue… Nicolas Poussin, né aux Andelys. On approchait de la rivière ; Amélie manifesta des inquiétudes sur l’escapade ; on la rassura.
— D’ailleurs, dit mademoiselle Blanche, on ne s’occupe guère de nous, là-bas.
Cette fois, c’était un édifice carré, au milieu d’une place. Paul paria pour une école, Amélie pour une prison. Mademoiselle Blanche connaissait les Andelys.
— C’est le théâtre, dit-elle.
Cette nouvelle amusa.
— Mais voyez ; la porte n’est pas fermée.
— Si nous entrions ?
— J’ai des allumettes.
— Entrons, entrons.
Paul alluma des allumettes ; on traversa des couloirs. Blanche marchait bravement, le nez en avant. Amélie faisait un peu la peureuse ; elle serrait le bras de Marcelin, et, par amusement, se pelotonnait contre son épaule. Ils se trouvèrent dans une grande salle avec des bancs de bois rembourrés ; il y avait une galerie ; au fond, le rideau levé laissait voir le trou noir, béant de la scène. On ne put s’empêcher de trouver cela sinistre.
— Nous ne jouons rien ? questionna Paul.
— Allons-nous-en, prièrent les deux jeunes filles.
Il n’était pas très aisé de retrouver la sortie. Il y eut une discussion. Finalement, Paul et sa compagne prirent d’un côté, Marcelin et Amélie d’un autre.
— Si vous vous étiez trompé ? demanda Amélie au jeune homme en le fixant de ses deux yeux brillants.
Il y avait dans ce regard quelque chose d’ironique et de provoquant qui le frappa.
— Bah ! se dit-il.
Les allumettes lui brûlaient le bout des gants. Ils avaient suivi un couloir ; ils débouchèrent par une petite porte sur la scène. Ils s’étaient perdus ; c’est les autres qui avaient raison. Marcelin fut désolé. Amélie, elle, eut un sourire ; elle rajustait sur sa tête sa mantille de dentelle blanche.
— Vous voyez, vous voyez, disait-elle avec de petits mouvements de tête et en le regardant.
Il était fort embarrassé. Elle le taquinait…
— Ça n’a pas dix-huit ans, et ça veut conduire des jeunes filles, de vieilles jeunes filles…
— Eh bien, retournons.
On rebroussa chemin, et on se retrouva dans la salle. Marcelin n’avait plus que trois allumettes. Il appela Paul deux fois, fortement ; rien ne répondit.
— C’est une promenade aux catacombes, dit-il pour plaisanter.
A ce moment, ils reconnurent le couloir par où les autres étaient partis. Amélie avait de petits mouvements d’impatience.
— Vous allez prendre mal, fit-il.
— Mais non.
La dernière allumette s’éteignit. Il appela encore ; rien. On distinguait à peine le chemin. Tous deux se tenaient par la main ; ils allaient devant, en suivant le mur. Par instants, la petite main de la jeune fille serrait la sienne ; il se sentait des battements de cœur ; sans savoir, sans chercher pourquoi, il lui passait comme des étourdissements…
— Les portes des loges ne sont pas fermées dit très bas Amélie.
— Si nous entrions ?
Il disait n’importe quoi, pour parler ; il entendit un petit Oh ! mal indigné et gentil qui lui répondait. Comme dans une peur qu’elle aurait éprouvée, elle lui pressait les doigts. Il ne savait plus où il en était. D’un mouvement, il saisit la main d’Amélie entre ses deux mains.
— Monsieur Marcelin ! fit-elle encore plus bas, d’une sorte de reproche.
Elle l’avait laissé faire. Il n’avait qu’à garder cette main qui s’abandonnait, il se le dit à lui-même. Elle le regarda de nouveau. Une angoisse de timidité le poignait à la gorge. Il se sentit stupide, et s’arrêta ; cela dura une seconde. A ce moment, tout à coup, il distingua devant lui, au bout du couloir, la clarté du dehors, la porte de la rue ; il eut un cri de soulagement, du fond du cœur…
— Voilà !
Ils étaient dehors, sur les marches. Le cœur lui battait violemment.
— Paul et mademoiselle Blanche sont partis, fit-il.
Amélie prit son bras en silence, et ils se dirigèrent vers la maison. Il considérait les rues, le ciel, les arbres dans les jardins ; et, maintenant, la certitude lui venait de n’avoir pas trop agi comme il aurait pu agir ; et, aussitôt, ce fut un regret, un désespoir, une désolation… Quelle occasion il avait perdue ! Il voulut se consoler… Si, pourtant, il avait fait un pas de clerc ?… pourtant, elle avait eu des façons si engageantes… mais oser cela !… enfin, si c’était une occasion qu’il avait perdue, elle se retrouverait…
— Nous rentrons, n’est-ce pas ? demanda Amélie.
— Vous le désirez ?
— Beaucoup ! je suis fatiguée.
Un besoin le prenait à présent de lui dire des choses douces ; elle était si jolie, si tendre, si fine ! la nuit était si propice !
— Quelle belle nuit ! commença-t-il.
Elle ne répondit pas. Son bras s’appuyait à peine, elle avait l’air sérieux. Il se tut.
— Bah ! se dit-il, l’occasion se retrouvera.
Ils arrivèrent. Ils rentrèrent. Elle alla s’asseoir auprès de sa mère.
— D’où viens-tu, ma fille ?
Elle expliqua sans aucun embarras. Marcelin restait debout, à examiner l’orchestre. Son tuteur passait ; la mère d’Amélie l’appela :
— Croiriez-vous, monsieur Desruyssarts ? ma fille vient de se promener dans la campagne avec votre pupille !
Le jeune homme entendit son tuteur qui répondait en riant :
— Marcelin ? oh ! madame, vous pourriez lui confier mademoiselle votre fille. Vous n’avez rien à craindre.
Il se sentit rougir et s’éloigna. Il chercha Paul ; celui-ci n’était pas rentré. Il n’osait pas retourner auprès d’Amélie ; il l’aperçut au buffet, avec sa mère. Il tira sa montre ; minuit allait sonner. Il allait à travers le bal ; le fumoir était désert ; il s’installa dans un fauteuil et se mit à fumer des cigarettes. Il reconnut qu’il était tout ennuyé, triste, presque morose. Pourquoi ? Elle devait se moquer de lui. Pourquoi ? Il n’avait rien à se reprocher. L’idée lui vint qu’il aurait dû avoir des assiduités auprès de cette petite Blanche qui était gentille. Mais Paul et elle, que faisaient-ils dehors ? N’allaient-ils pas rentrer ? Il était navré ; s’il avait osé, il serait parti. Son tuteur l’aperçut.
— Eh bien, mon petit Marcelin, que diable fais-tu ? Veux-tu bien aller inviter ta demoiselle d’honneur ?
— Vous avez raison, mon cousin.
D’un effort il se leva. Elle l’accueillit aussi gracieusement que jamais. Il se dit qu’il était fou de se faire des idées. Et ils se remirent à danser. Elle était toujours aussi charmante ; il reprit contenance. Ils dansaient pourtant plus sagement. Ils parlaient de choses et d’autres. Il invita quelques autres jeunes filles ; une fois il aperçut Amélie qui dansait avec Paul. Il était donc revenu ? Amélie était rouge. Que lui disait-il ? Marcelin se sentit furieux. Il chercha Blanche ; elle prenait des glaces ; elle refusa de danser ; elle était fatiguée ; il regardait sa petite figure pâlotte aux yeux cernés. Il savait qu’elle dansait mal ; mais son refus l’exaspéra.
A ce moment, l’autre lui fit signe ; elle partait.
— Encore cette valse ?
— Maman m’attend. A demain.
Paul vint lui souhaiter le bonsoir. Et Marcelin suivait des yeux la jupe rose qui s’éloignait, ondulait. Il alla se coucher, et à peine au lit, s’endormit.
Le lendemain, Paul vint le réveiller ; il était onze heures. Il avait juste le temps de s’habiller pour le déjeuner. Paul resta là, à raconter des histoires, en fumant des cigarettes.
Le grand air, le beau soleil, l’eau fraîche remettaient Marcelin en bonne humeur. Il confia à son cousin qu’il trouvait mademoiselle Amélie parfaite.
— J’espère la revoir à Paris, ajouta-t-il.
Il était heureux et un peu fier en cette circonstance, d’habiter Paris.
— Je te félicite, lui répondit Paul, toujours un peu moqueur. Je suis de ton avis qu’elle est parfaite.
— Tu sais, ajouta-t-il, qu’elles viennent tantôt à Rouen avec nous.
— Quelle bonne nouvelle !
Marcelin devait passer l’été avec son tuteur et sa famille, quelques jours à Rouen, le reste à Dieppe.
— Nous voulions qu’elles viennent à Dieppe ; mais il faut qu’elles rentrent à Paris demain ; elles reprendront l’express du soir. Elles ne connaissent pas Rouen.
— Nous le leur montrerons.
Le déjeuner fut gai, sans cérémonies. On garda à peu près les mêmes places que la veille. Amélie avait toujours son exquis sourire. Le voyage à Rouen fut le grand sujet de conversation ; elle et Marcelin n’avaient plus tant de choses à se dire ; mais elle s’entendait à ne pas laisser languir la conversation, et il y mettait, de son côté, de l’amour-propre.
Puis, on ferma les malles, et l’on monta en wagon. Il fut obligé d’entrer dans le compartiment des fumeurs. Le temps lui sembla long. Malgré la présence du père, et avec sa complicité, on fit des plaisanteries un peu gauloises sur les nouveaux mariés ; Marcelin croyait encore que les propos légers n’allaient qu’entre jeunes gens ; il fut scandalisé. Il s’occupait, entre temps, à se demander s’il avait de l’amour pour Amélie ; il se répondit qu’hélas ! il en avait.
Il espérait passer une agréable soirée ; il s’était décidé à commencer les aveux et à pousser les choses. Mais le dîner fut morne ; tout le monde était las ; on se sépara vite ; il n’eut le temps de rien dire ; il essaya, aux bonsoirs, de rendre sa poignée de main éloquente ; ce fut tout.
Il y avait rendez-vous, le lendemain matin, à neuf heures. La journée commença mal ; personne ne vint réveiller Marcelin ; dix heures sonnaient quand il ouvrit les yeux ; il n’avait qu’à attendre le déjeuner.
Il se préparait à subir d’amicaux reproches ; il en eut un mot à peine ; il se trouva légèrement vexé. Paul avait été exact ; on le complimentait de ses qualités de cicerone ; on avait fixé le programme de l’après-midi ; tout cela ennuyait Marcelin ; il ne put être gai. Quant à ses déclarations, elles se figeaient.
Mais, quand on sortit, il reçut un coup terrible ; Amélie prit le bras de Paul. Lui, marchait, à côté de sa mère et de madame Desruyssarts, abasourdi, la mort dans l’âme, ne pensant même pas à s’expliquer ce trait. Amélie heureusement l’appela.
— Vous fréquentez avec les grandes personnes ? Pourquoi ne venez-vous pas avec nous ?
Il s’approcha sans répondre.
Paul, avec une grande volubilité, expliquait Rouen ; elle souriait, du même admirable sourire ! On remontait la rue Grand-Pont. Comme on s’était arrêté devant une boutique, Marcelin prit sur lui de parler.
— On ne me donne plus le bras aujourd’hui ? dit-il à voix basse.
Elle le regarda d’un air étonné, comme si elle ne comprenait pas.
— Aujourd’hui ? mais on n’est plus de noce aujourd’hui. Je ne puis refuser le bras à votre cousin. Tout à l’heure vous m’offrirez le vôtre.
Il dut convenir que c’était très bien. Paul commençait à narrer une ridicule histoire de Saint-Roch, à propos d’une statue près d’où l’on passait ; il faisait des calembours ; elle riait.
— Est-il drôle ! répétait-elle.
Marcelin se dit qu’il ne fallait pas chercher à lutter.
— Vous avez l’air tout chose, monsieur Marcelin, continua-t-elle. Vous êtes encore fatigué de lundi ?
On visita la cathédrale. Il fut question de monter dans la flèche ; les mamans se récrièrent ; Marcelin ne prit pas part à la discussion ; le projet fut délaissé. On se dirigea vers Saint-Maclou ; de là on traversa le quartier de Martinville, l’eau de Robec, les ruelles où les maisons se touchent par le faîte, et l’on admirait ce vieux Rouen si pur ; la verve du cousin s’était apaisée ; on marchait isolément ; on regardait. Saint-Ouen enchanta. On s’assit dans le square ; la musique militaire jouait des morceaux ; il y avait beaucoup de monde ; madame Desruyssarts et Paul saluaient à chaque instant ; deux ou trois sociétés s’arrêtèrent à échanger des civilités ; chaque fois, on présenta les Parisiens.
La promenade reprit.
— Eh bien, monsieur Marcelin, dit Amélie, m’offrez-vous votre bras ?
Marcelin pensa que le moment était venu, il s’efforça de laisser Paul en arrière ; c’était difficile ; en même temps, il préparait ce qu’il voulait dire ; il fallait oser, tout avouer, son amour, ses tristesses d’aujourd’hui… Après une grande demi-heure, il réussit à laisser Paul avec les mamans devant une boutique de chemins de croix. Tous deux firent vingt pas en silence.
— Mademoiselle, commença-t-il enfin, ainsi vous retournez ce soir à Paris.
— Certainement.
Après un instant :
— Quel dommage que vous ne puissiez venir à Dieppe ! J’aurais été si heureux !… Nous aurions fait des promenades, des…
— Malheureusement, je ne suis pas la maîtresse.
— Vous savez nager ?
Il s’égarait.
— Un peu, et vous ?
— Bien.
Il fallait recommencer. Il se tut pour reprendre. Ce n’était pas cela. Il valait mieux y aller franchement, d’un seul coup ; il prit son parti.
A ce moment, elle se retourna et appela Paul. Il accourut. Les calembours et les histoires recommencèrent jusqu’à la maison.
Elle donnait le bras à Marcelin, mais c’était avec Paul qu’elle était : c’est lui qu’elle écoutait, à lui qu’elle parlait.
Tout était fini.
Au dîner, Marcelin s’arrangea pour ne pas être à côté d’elle ; sans embarras, Paul prit sa place. Et tous deux ils causaient à mi-voix, comme Marcelin avec elle l’avant-veille. Paul s’était rapproché d’une façon presque inconvenante ; les parents ne disaient rien ; c’était insensé…
Enfin, l’heure du départ arriva.
— Elles ne m’ont même pas invité à aller les voir, se dit Marcelin. Tant mieux ! je n’y aurais pas été.
A l’automne suivant, Marcelin Desruyssarts décida de quitter la pension de madame de M. et de s’installer ; il était temps pour lui de vivre sa vie, d’essayer comme il voulait vivre.
Il prit un petit appartement place Delaborde, au second, sur le square ; il s’agissait de le meubler ; c’était un mois de courses dans les magasins, dont il attendait beaucoup de distraction.
Son tuteur l’avait fait émanciper ; il lui avait fourni des comptes et donné le détail de sa situation. Sa propriété de Saint-Paulin lui valait, tous frais d’entretien déduits, des rentes suffisantes ; c’étaient d’excellentes terres, toutes bien louées ; il n’avait d’ailleurs qu’à se fier au père Homo, le régisseur. Il possédait, en outre, quelques valeurs mobilières déposées chez le notaire, avec quelque argent que son père avait laissé et des économies sur ses revenus des deux dernières années.
Au mois de juillet, il avait passé avec bonheur ses premiers examens de droit ; suivant toutes probabilités, il serait avocat dans deux ans ; il verrait alors que faire. Il ne voulait pas se donner les soucis d’affaires compliquées, de fortune à gagner. Il n’avait point de folles ambitions. Quand il serait marié, il pourrait vivre à Saint-Paulin, veiller à ses terres, peut-être s’occuper un peu de politique ; son tuteur le lui avait conseillé. D’ici là, il pouvait encore voyager. Enfin il ne savait pas.
« Quelle charmante occupation, écrivait-il plus tard, qu’une première installation ! Je me souviens, la première fois que je suis entré place Delaborde, je considérais les murs nus et sales de ces chambres vides, à l’enfilade, où mes pas faisaient écho, et dont j’avais à créer mon home. Quel champ à l’imagination. La destination de chacune des pièces s’indiquait, la chambre avec le cabinet de toilette, la salle à manger près de la cuisine, le salon ouvert sur un très petit cabinet de travail en retrait ; mais comment décorer tout cela ? Chaque heure m’amenait de nouvelles conceptions. Je fis venir quelques camarades ; ils ne me proposèrent que des excentricités ; l’excellente madame de M. m’a été précieuse. En somme, une élégante simplicité, ce qui se fait, tel a été mon programme. Mais que d’argent dépensé, que je n’avais pu prévoir ! »
La période des maçons et des menuisiers, et celle des peintres, fut le moins bon moment — non sans le charme, pourtant, de voir poindre sous les boiseries brutes, puis dans le cru des peintures, la forme que devaient avoir les choses. Et dès lors c’étaient les visites chez les tapissiers, les interminables conférences, les hésitations entre les vingt étoffes quasi semblables ou tout à fait différentes, les choix enfin arrêtés sur le prétexte d’innotables minuties, les idées subites qui dérangent tout et font recommencer. Et les meubles ! les grands magasins en ont de parfaits ; mais la jalousie des tapissiers suscite des difficultés, des méfiances.
— Peut-être vendons-nous plus cher, mais au moins ce n’est pas de la camelote.
Le premier février au soir, l’entrepreneur, M. Perrot, livrait, un peu solennellement, l’appartement à M. Rouff, le tapissier. Et les tentures d’apparaître, les grandes étoffes, les larges bandes ; cela prenait déjà tournure. Quand les rideaux eurent fait leur entrée, cela devint définitif.
Et, tout ce mois, c’était, quatre fois par jour, le voyage de la rue de Grenelle au square Delaborde à travers tout Paris.
Les meubles arrivèrent enfin, les gros meubles, car il fallait se réserver d’acheter peu à peu, suivant le besoin et l’occasion, tout le bibelotage.
Le tapissier tenta de placer deux grands tableaux d’on ne savait qui, une superbe affaire. Marcelin déclara ne rien connaître à la peinture et vouloir attendre. Madame de M. le guida au Bon Marché pour l’acquisition d’un trousseau. Elle-même présida à l’entassement des draps dans les armoires, des serviettes, des lingeries pesantes ; puis, ce fut le tour des vêtements ; une femme de chambre de la pension aidait. Jean, le valet de chambre entré au service dès le premier du mois, considérait, dans sa gravité silencieuse, ce zèle et cet affairement, avec, apparemment, l’inquiétude de savoir s’ils dureraient.
Maintenant tout était en place. Marcelin arriva un matin avec une voiture qui apportait ses valises ; l’après-midi, il acheva l’ordonnance de la bibliothèque, et, toute la journée, se promena avec ravissement, seul, d’une pièce à l’autre. Il se coucha de bonne heure… Dormir pour la première fois dans son lit, entre ses draps, dans sa chambre… quelle douceur !
Quelques semaines plus tard, il écrivait :
« Lorsque, ces dernières années, je souffrais de la solitude et de confus besoins, était-ce seulement après le calme établissement d’un home que je soupirais ? Depuis que je suis entré, si tranquille, dans la vie régulière et le confort de mon logis, il me semble que les grandes soifs sont apaisées et que je suis heureux.
» La monotonie, qui m’oppressait à la pension, ici m’enchante ; mes jours coulent semblables les uns aux autres, j’ai toujours la même joie à me trouver chez moi ; j’existe suivant mes désirs, et je m’endors dans une bonne conscience de bien-être.
» Seule, quelquefois, la pensée me trouble, aux soirs longs, que ce bonheur vaudrait mieux à deux… Et ce regret serait-il le recommencement des troubles de mon âme ? »
Au commencement d’avril, Charles Berty l’entraîna en Belgique ; ils passèrent quatre jours à Bruxelles ; Charles y avait des affaires ; Marcelin visita la ville ; le musée lui entr’ouvrit l’esprit au charme de la peinture. Un après-midi, il fit la connaissance d’une jeune femme qui occupa quelques mois de ses exaltations…
Ce fut le troisième jour, au salon de l’hôtel où Charles et lui étaient descendus. Charles était sorti. Elle était en noir, avait un beau maintien, paraissait élégante. Il la considérait de derrière son journal ; deux ou trois fois, leurs regards se croisèrent ; il y avait un peu d’affectation dans la manière dont elle remuait des papiers ; évidemment, on ne pouvait la juger du monde le plus correct. Cela dura quelque dix minutes ; il n’osait lui adresser la parole, n’imaginait rien à lui dire. Ce fut elle qui trouva.
— Je vous demande pardon, monsieur, auriez-vous l’obligeance de me donner cet horaire ?
Un indicateur était là ; Marcelin le donna. Elle ouvrit, chercha ; elle tournait les pages les unes sur les autres. Il se demandait s’il ne devait pas intervenir. Ce fut elle encore qui prit la parole.
— Oh ! monsieur… je suis vraiment confuse… je n’ai jamais pu me reconnaître dans un horaire. Je vais demain à Anvers, et je ne sais où trouver les heures…
— Si vous me permettez, madame.
La chose était faite ; ce n’était pas une plus grande difficulté d’enlever un cœur de dix-neuf ans…
Une demi-heure après, ils sortaient ensemble de l’hôtel. De conserve, ils suivirent le boulevard d’Anspach ; ils parlaient de choses indifférentes. Chemin faisant, elle avoua qu’elle n’avait aucune occupation de l’après-midi ; elle accepta une promenade au Bois de la Cambre ; on monta en voiture.
Elle conta qu’elle était artiste : l’avant-dernier hiver, elle avait chanté à la Scala, à Paris ; cet hiver-ci, elle avait été engagée à Bruxelles, elle interprétait les demi-caractères à l’Alcazar ; son engagement venait de finir ; on lui faisait des offres à Anvers ; elle irait voir, le lendemain ; elle aurait préféré retourner à Paris ; elle se résignerait ; on fait ce qu’on peut, on ne fait pas ce qu’on veut.
Pendant ces propos, et tandis que la voiture atteignait les premières verdures, Marcelin commençait à se monter la tête. Elle n’avait point l’air provincial ; sa tenue restait marquée de quelque chic ; elle parlait gentiment ; une jolie crânerie brillait dans ses yeux ; la peau était très blanche, soyeuse, les cheveux plutôt bruns ; sa toilette, encore que simple, indiquait un bon faiseur ; il remarqua qu’elle était exquisément parfumée. Il tenait sa main finement gantée de noir, et l’écoutait un peu vaguement, en la considérant ; elle se laissait considérer et continuait ses petits discours. Entre temps, elle demandait à son nouvel ami ce qu’il faisait, par de petites questions, comme par hasard, ne poussant pas, s’arrêtant à l’essentiel, reprenant aussitôt son histoire. En revenant du Bois, ils étaient de vieilles connaissances.
Elle n’accepta pas à dîner ; mais il fut convenu qu’ils iraient ensemble, et avec l’ami de Marcelin, au théâtre du Parc ; Marcelin offrit des fleurs ; ils se quittèrent à l’hôtel.
Charles rentrait ; il se moqua de Marcelin et lui déclara qu’il était tombé entre les mains d’une simple cocotte.
— N’importe ! fit celui-ci, non convaincu.
La soirée au théâtre du Parc fut convenable, sans ennui. Mademoiselle Hélène Delile — c’était son nom — avait revêtu une toilette de soie grise et noire, un peu moins pure que celle de l’après-midi ; elle était pourtant jolie ; Charles convint qu’elle l’était. Les diamants ne paraissaient pas trop authentiques ; on n’approfondit pas la question. Marcelin se crut obligé à un petit souper à trois, mais qui ne traîna point.
Et l’on rentra à l’hôtel commun. Charles monta dans sa chambre. Marcelin reconduisit Hélène dans la chambre de celle-ci. Il s’était mis dans un fauteuil ; elle retira son manteau, ses gants, son chapeau, et l’on causa…
— Voyons, ma chère amie, voulez-vous venir avec moi demain à Paris ?
— Je ne demanderais pas mieux, mais il faut que j’aille à Anvers.
— Oui, pour votre engagement. Mais si vous aviez une situation à Paris !
— Je n’en ai pas.
— Je vous l’offre ; je me chargerai de vous.
— C’est fort aimable…
— Eh bien.
— Eh bien… Eh bien… Vous êtes très jeune ; quel âge avez-vous ?
Il l’assura en riant qu’il était, sinon majeur, du moins émancipé, et libre de lui-même.
— Et vous voudriez bien, reprit-elle, avoir une maîtresse.
La réponse le décontenança ; il insista, ne voyant pas autre chose à faire. Alors commencèrent d’interminables et assez obscures explications. On confessa qu’on avait un amant ; on voulut bien faire entendre qu’il n’était pas aimé. Il était en voyage ; il revenait le lendemain soir ; des ménagements étaient nécessaires ; on pouvait le quitter toutefois ; mais… mais… Ces mais durèrent encore un petit quart d’heure, après quoi il fut convenu que Marcelin partirait seul et qu’on le rejoindrait à Paris.
Elle allait et venait dans la chambre. Il l’arrêta et la prit par la taille ; il l’embrassa.
A ce moment, ils entendirent des pas dans le couloir ; on frappa à la porte ; ils restèrent stupéfaits.
— Qui est là ? demanda Hélène.
— Le portier.
— Que voulez-vous ?
— Je voudrais parler à madame.
Le ton de la voix était légèrement impératif. Ils se regardèrent.
— Je vais me cacher.
— Oui, mettez-vous là.
Il entra dans un cabinet. Elle ouvrit.
— Je demande pardon à madame, dit le portier ; je croyais que le monsieur du cinq était chez elle.
— Mais non…
— Je demande pardon à madame ; je suis sûr qu’il est là ; c’est une chose qui n’est pas permise dans la maison.
Marcelin apparut, indigné. On causait ; cela se voyait bien ; que signifiait cette pruderie ? L’homme insistait ; c’était la règle de la maison ; si l’on voulait causer, le salon de conversation était encore ouvert.
— Eh bien, bonsoir, à demain, dit Hélène au jeune homme.
Maintenant, le portier ébauchait des excuses. Furieux, Marcelin regagna son numéro cinq. Il se mit au lit. Une demi-heure plus tard, il revint gratter à la porte d’Hélène ; pas de réponse ; elle dormait sans doute.
Le lendemain, avant le départ, il fit une petite visite. Les promesses furent confirmées ; aucun chiffre toutefois ne fut prononcé ; grande fut l’effusion ; mais il n’obtint aucune faveur définitive.
— De la patience ! lui disait-on. A samedi, trois heures et demie, à la gare du Nord.
Le voyage, les remontrances de Charles achevèrent de lui monter la tête.
Rentré chez lui, à Paris, le soir même, il écrivait une longue lettre… Il l’aimait, il ne pensait qu’à elle, il avait tant de peur qu’elle ne pût venir le jour fixé, il allait lui chercher un appartement, il comptait sur sa promesse, sur sa parole qu’elle avait donnée, il lui appartenait tout entier, il n’imaginait plus qu’il pût vivre sans elle, et cetera, et cetera…
Le surlendemain matin, il reçut la lettre suivante, sauf les virgules et l’orthographe :
« Hôtel***, Bruxelles.
» Mon cher Marcelin.
» Comme je te l’ai dit, mon amant est arrivé, mais par le train de six heures ; j’ai reçu une dépêche et j’y suis allée. A la gare, ce matin, je lui ai déjà touché quelques mots de mon intention, sans encore lui dire la chose véritable. Il m’a dit que si jamais je le quittais, il aurait beaucoup de chagrin. Voici alors ce que j’ai décidé. Samedi à midi, il part pour Anvers et ne revient que dimanche soir. Alors, moi, je partirai pour Paris dimanche matin sans rien lui dire. Il faudrait que tu m’envoies deux cents francs, car le voyage coûte déjà cinquante francs avec les bagages et j’aurai de l’argent à payer. Tu vois que je suis de parole, car je pourrais parfaitement entrer au théâtre des Bouffes-Parisiens. C’est un artiste qui a joué avec moi à Troyes et qui m’aimerait beaucoup. Mais j’ai refusé net. Je trouve déjà le temps long ; je voudrais déjà être auprès de toi pour t’embrasser.
» Ta petite femme qui t’aime,
» Hélène.
» P.-S. — Réponds-moi à l’hôtel où je suis ; c’est marqué sur le papier, chambre numéro quatre. J’attends une lettre par retour du courrier. »
Il envoya les deux cents francs.
Le dimanche, il alla à la gare du Nord, à trois heures et demie ; elle n’était pas là. Il rentra chez lui, au cas d’un télégramme ; rien. Lui-même envoya d’inutiles dépêches. Au train suivant, à six heures et demie, personne encore.
Le soir, chez Charles, dans une détente nerveuse, il éclata en sanglots.
A la fin de la semaine, il trouva, un jour, comme il rentrait chez lui, madame de M. qui l’attendait ; elle surveillait son ménage. La lettre d’Hélène traînait sur une table. Un peu avant de le quitter, Madame de M., en causant, lui dit :
— Prenez garde, mon petit Marcelin, à ne pas trop mal placer vos affections.
Il rougit beaucoup.
Il avait eu un mot qui fit rire indéfiniment son ami Charles.
— Elle ne viendra pas, lui disait celui-ci la veille du fameux dimanche.
— Elle ne peut pas ne pas venir, répondit-il. Ce serait trop mal…
Une quinzaine plus tard, il écrivait dans son petit livre de pensées le menu poème en prose suivant :
« Saviez-vous, Hélène, quelle que vous fussiez, que j’étais prêt à vous aimer, que tout était mûr dans mon cœur pour vous y recevoir, et que je vous aurais aimée ?
» Vous m’avez joué, très ordinairement. Vous n’avez pas entrevu la vie qui vous était offerte ; ou bien, avez-vous préféré la joyeuse bohème accoutumée ? Pauvre, qui n’aurez pas essayé !
» Mon âme, toute de tendresse, mon âme de printemps et aux neuves sèves, si vous l’aviez eue, cette âme que nulle femme n’eut encore et qui vous était promise, ô folle compagne d’un soir !
» Vous ai-je, vous aurai-je aimée ? Votre pensée a habité mon esprit ; votre espérance me donna maint enthousiasme ; votre trahison, quelle douleur ! mais déjà le temps passe et vous emporte. Et vous vous effacerez.
» Et il me restera ceci, que la première m’aura trompé, et que j’aurai connu les angoisses avant les joies. Et puis, je sais que vous n’étiez qu’une vaine et falote image, et qu’il est bon que je vous néglige.
» Une autre apparaîtra, une autre, une autre… O continuité des désirs et des efforts ! terreur des réserves que tient la vie ! comment y songer sans pâlir ? est-ce vers le péché, est-ce vers l’amour ?
… avec, pour la partie en vers, la collaboration de Victor Hugo.
Vers cette époque, Marcelin Desruyssarts entra en relations avec les Delannoy, des cousins du côté de sa mère, avec qui son père s’était brouillé. Ils s’étaient mis autrefois dans l’industrie et y avaient gagné de l’argent ; depuis quelques années, ils avaient quitté les affaires et habitaient une maison de campagne à Ville-d’Avray. Ils avaient trois filles, les deux aînées mariées en province, la cadette Paule, pas encore mariée quoique ayant vingt-six ans sonnés. Marcelin la jugea difficile à caser ; elle avait ces façons à la fois trop libres et pincées des jeunes filles qui prennent de l’âge. Toute la famille, d’ailleurs, avait acquis dans le commerce une facilité de plaisanteries un peu ordinaires et une morgue qui éclatait à l’improviste en les circonstances où on l’attendait le moins. En outre, la cousine Paule avait introduit dans la maison un usage d’engouements ; telles personnes devenaient des amis dont on ne pouvait plus se passer, qu’on voyait tous les jours, pour qui l’on n’avait plus de secrets ; puis, subitement, on se brouillait, et c’était le tour à d’autres. Marcelin assista, en arrivant, à l’épilogue d’une amitié avec la famille d’un officier d’artillerie ; il n’y avait point de sottises qu’on ne leur fît, jusqu’au jour où, abasourdis, ils renoncèrent à venir. En même temps commençaient des relations avec les Rigout, des bijoutiers du Palais-Royal, qui avaient loué tout proche une villa.
La première fois que Marcelin rencontra les Rigout chez ses cousins, madame Delannoy le prévint :
— Je vais te faire faire connaissance, mon petit Marcelin (elle s’était mise à le tutoyer tout aussitôt), avec un jeune homme qui te sera un excellent camarade ; nous l’appelons par son petit nom, Gustave ; il a à peu près ton âge ; il est très gentil, tu verras. Il a une sœur, que nous aimons beaucoup, un peu plus jeune… Mais les voilà.
Marcelin assista à des embrassades, des cris de joie, des effusions.
On le présenta.
Gustave lui tendit les mains :
— Trop heureux, monsieur…
La sœur, en lui tendant la main, imita son frère :
— Trop heureuse, monsieur…
Ce fut une explosion de rires.
— Oh ! la folle ! est-elle amusante ! est-elle moqueuse !
Marcelin se sentit consterné, et se força à sourire.
On entra au salon. M. Delannoy, avec sa barbiche blanche et son faux air d’ancien officier de cavalerie, participait à la joie générale. Quand sa fille voulut s’asseoir, Gustave retira le fauteuil.
Elle poussa un cri, moitié de surprise, moitié de rire.
— Ah ! le cochon !
— Oh ! oh ! oh ! Quel langage ! mademoiselle ! ma fille ! Paule !…
— Je vous demande pardon, mais c’est la faute à ce grand dindon de Gustave.
— Oh !
Madame Rigout, une brune de quarante ans aux airs passionnés et qui se rajeunissait, prit la parole ; elle tapait sur les genoux de madame Delannoy et s’exprimait avec volubilité.
— Vous savez, ma chère, nous avons été hier aux Variétés. C’est étonnant, c’est à se rouler, à se tordre. Granier est ravissante.
— Et Baron ! ma chère Paule, exclama la fille ; moi, j’en suis amoureuse.
— Ah ! j’aime mieux Cooper, riposta Paule.
— Mais Granier, ma chère, Granier ! continuait madame Rigout.
— Il est vrai qu’elle est mince de pschutt, affirma Gustave.
M. Delannoy riait, semblait très heureux. Cela dura un quart d’heure. Gustave imita Lassouche ; Paule faillit avoir, à force de rire, une crise de nerfs. A un moment, Julie (mademoiselle Rigout) se leva :
— Voyez comme il fait beau. Allons au jardin.
— Nous jouerons au tonneau.
— Ça y est.
— Et je ferai la cote.
— Hioup ! allons-y.
Gustave offrit comiquement son bras à Paule. Marcelin fit un effort et s’avança en riant vers Julie :
— Alors, mademoiselle, vous acceptez le mien ?
— Volontiers, monsieur. Et j’espère bien que vous allez me faire la cour.
— Oh ! les enfants ! les enfants ! soupira par plaisanterie M. Rigout, un gros petit homme barbu, l’air réjoui.
Marcelin la lui aurait bien faite, la cour ; mais, en face d’une telle écervelée, comment prendre un personnage ? Elle n’était pourtant pas désagréable ; boulotte, point mal tournée, la figure colorée, très brune, des yeux de page de cour, les cheveux relevés au dernier chic, une jolie poitrine… Marcelin parla théâtre ; mais il se sentait fade.
On arriva dans une grande allée droite. Il y avait un jeu de tonneau…
— Mais nous allons avoir des mains horribles, fit Marcelin pour dire quelque chose.
— Oh ! là, là !… pauvre petit !… s’écrièrent les deux jeunes filles.
On joua. L’enjeu était de deux sous. Tout à coup on proposa de le mettre d’un louis ; ce fut accepté. A la grande indignation de sa femme et de sa fille, M. Rigout gagna ; il en fit force plaisanteries ; M. Delannoy perdait ; il se fâcha presque et réclama le retour à deux sous ; on reprit à deux sous. Les parties roulaient au milieu des farces et des cris. Gustave et sa sœur se battirent ; elle lui arracha les cheveux ! Paule eut sa robe déchirée.
— Pour une grande fille de ton âge, gronda la mère…
— Après ?… riposta la fille.
Les deux papas s’étaient assis dans un coin et causaient en fumant ; c’était une ressource ; Marcelin allait les rejoindre entre deux parties ; ou bien il ramassait les pièces et marquait les coups ; cela l’occupait. Il frémit quand il entendit sa cousine inviter ses amis à dîner ; ils acceptèrent de suite ; ils demeuraient à deux pas ; ils prendraient juste le temps d’aller s’habiller pour revenir à sept heures ; et l’on resta au jardin.
Gustave s’était étendu dans un hamac et fumait des cigarettes. A droite, sa sœur s’était assise ; à gauche, Paule ; et toutes deux imploraient des cigarettes qu’on leur accordait sous des conditions bizarres ; elles fumaient. De temps en temps, Gustave donnait un mouvement au hamac et venait heurter les deux jeunes filles qui s’esclaffaient.
Quand ils furent partis s’habiller, Marcelin resta seul avec sa cousine Paule. Elle portait allègrement ses vingt-six ans ; seule avec lui, elle était volontiers cordiale et camarade ; quand les Rigout étaient là, elle ne connaissait plus personne. Elle lui demanda son avis sur eux ; il dut professer une énorme sympathie.
— N’est-ce pas ? faisait-elle.
Une demi-heure après, ils étaient de retour. Les deux dames Rigout avaient de petits costumes de casino, le même toutes deux, crème, en cachemire, à petits plis, avec un ruban de ceinture, toutes deux des fleurs dans les cheveux. Le dîner commença convenablement ; il finit dans la démence ; les jeunes filles imitaient des cris d’animaux ; Gustave disait qu’il voulait griser madame Delannoy qui pleurait de rire.
— Eh bien, Marcelin, tu n’es pas gai, tu n’as pas d’entrain, disait la bonne dame.
Il n’était pas gai et n’avait aucun entrain. Maintenant, il était en dehors de la société. Par moments, il enviait la folie des autres, leur aisance, leur confiance en eux, leur sans-gêne parfait, et il souhaitait de les imiter, qu’ils l’y aidassent, qu’il se sentît encouragé, entraîné…
La jeune cousine l’avait abandonné, et les trois jeunes gens, sentant qu’il n’était pas de leurs façons, avaient cessé de lui adresser la parole. Son embarras augmentait sans cesse ; il était assis entre sa vieille cousine et mademoiselle Rigout ; la vieille cousine s’occupait de son service, de ses invités, de lui un peu ; mademoiselle Julie avait oublié son existence. Ses plaisanteries, celles de Paule, les farces de chacun passaient à présent au-dessus de sa tête ; il n’avait plus même besoin de se forcer à sourire.
On s’en fut au salon. Paule se mit au piano et joua des valses. Gustave faisait quelques tours avec sa sœur ou sa mère. Tout à coup Paule attaqua le quadrille de l’Œil crevé.
— Un quadrille ! hurla Gustave.
On se compta. Il y avait la mère, la sœur, lui et Marcelin. Il avait pris sa mère par le bras ; Marcelin vit que Julie était vexée de l’avoir pour cavalier. Il fut sur le point de s’excuser et de sortir.
— Allons, Marcelin ! fit gentiment madame Delannoy.
Ce fut un épouvantable chahut. Mais, dès la première figure, Julie commençait à plaisanter son cavalier ; elle affectait des airs graves en revenant auprès de lui. A la seconde figure, la mère en fit autant. Elle s’emportait, elle levait la jambe, elle répondait au cancan endiablé que menait le fils. A la troisième figure, Julie faisait à Marcelin des pieds-de-nez par derrière. La cousine Paule pianotait toujours, à moitié retournée sur le tabouret, et regardant la danse ; elle voyait qu’on se moquait du cousin ; elle riait de tout son cœur. Au galop, on voulut le faire tomber ; il affecta la tenue la plus correcte. Et ce fut fini.
Madame Delannoy eut pitié de lui ; elle l’appela, le fit asseoir près d’elle, le garda ; puis, elle le remit aux mains de son mari qui l’invita à jouer avec lui et M. Rigout ; il leur gagna vingt francs à l’écarté ; ce succès le réconforta un peu. La vieille cousine lui en fit honneur. Les autres étaient occupés de leur côté.
Il prétexta la crainte de manquer le dernier train et prit congé. En mettant son pardessus, il entendit les valses et les polkas qui continuaient de plus belle ; il avait presque envie de pleurer.
Marcelin passa l’été à la campagne, dans la famille de son ami Charles Berty. Il goûta deux mois de cette vie animale où le manger est chaque jour la raison d’être, où l’on dort dix heures, où l’on engraisse. Il ressentit une joie, presque une délivrance, de rentrer dans son cher logis, à Paris.
Il commença à suivre les cours de l’École des Sciences politiques. La clientèle en était décidément de bonne tenue ; mais il n’y voyait guère de relations possibles. Et puis, cet esprit de républicanisme gouvernemental, d’opportunisme, était bien gênant ; mais peut-être que pour arriver à quelque chose, il fallait se faire républicain… Marcelin se disait qu’il avait le temps.
Il avait quelques relations dans le monde bourgeois. Une fois ou deux la semaine, il dînait en ville ; il faisait des visites à cinq heures ; il brilla dans des sauteries ; il allait quelquefois au théâtre. Tout cela n’était que distraction ; ce n’était ni un plaisir ni une occupation, mais une certaine façon de passer, de tuer le temps. N’importe ; il le fallait !… Que ferait-il seul chez lui, puisqu’il n’arrivait pas à trouver de maîtresse ?
— Il est probable, se disait-il, que je cherche mal ; je ne sais même guère où chercher ; peut-être encore est-ce qu’en réalité je ne cherche pas… Je ne fréquente pas dans le monde des théâtres ; non plus dans le demi-monde… je suis trop jeune, trop timide, je ne suis pas assez riche. J’ai horreur des filles. Que reste-t-il ? Me bercerais-je de l’espoir que quelque jeune femme comme il faut oubliera ses devoirs en ma faveur ? Non. Alors il ne reste que le hasard. La vérité est que je compte sur le hasard. Aussi, ça ne va pas vite.
Quand il traversait les rues, quand il allait par exemple à l’École ou dîner, ou faire visite, il coudoyait des femmes et des femmes, toujours d’autres, et il s’affolait que nulle d’elles ne fût celle qu’il attendait. Et il continuait son chemin, éternellement seul.
Il commit des horreurs. Ayant lu quelques romans où il était question de belles mondaines qui promenaient dans les églises leurs sens inassouvis, il s’avisa d’entrer à la tombée du soir dans les églises élégantes. Il faisait le tour des nefs, inspectant d’un œil discret les coins des chapelles, les prie-dieu.
Néant ou indignité.
Il observa également les salles des théâtres où il allait. Mais il en arriva vite à ce dilemme :
— Ou bien la personne remarquée m’écoutera : c’est donc une fille…
— Ou bien elle ne m’écoutera pas…
Il y avait une troisième chance : les longues assiduités, la persévérance, le peu à peu des déclarations de plus en plus pressantes… Mais il fallait commencer, et on n’aborde pas une inconnue pour lui offrir de longs soins…
Mais les amies de nos amis ? Plus honnêtement, les amies des amies de nos amis ?…
Faudrait voir.
Charles Berty n’avait pas de maîtresse ; suivant son expression, il vivait au jour le jour. Marcelin rencontra une fois chez lui l’aîné des frères Crémone. On causa femmes ; Marcelin dit combien il lui semblait difficile de se faire une maîtresse.
— Point, répondit Crémone. Il y a un certain monde fait exprès pour nous fournir de bonnes amies. Ce n’est ni le théâtre, vous avez raison ; ni la cocotterie, grande ou moyenne ; ni les lieux de plaisir, le skating ou le café-concert. Je ne parle pas de la bourgeoisie ou du monde, qui ne donnent que par exception. On trouve bien encore une certaine espèce de femmes de lettres, de femmes artistes ; c’est horrible ; elles sont sales et ennuyeuses. Gardez-vous également des femmes pour peintres ou pour musiciens ; elles vous lâcheront à brûle-pourpoint, pour retourner à leur bohème. Il y a aussi des filles genre Jardin de Paris qui, tirées de là, deviennent gentilles ; cela est si dangereux ! Non, messieurs, ce qu’il nous faut, c’est le trottin. Ne vous récriez pas et écoutez-moi. Je dis le trottin, la petite ouvrière, la modiste, qui va au magasin ou à l’atelier le matin, qui continuera à y aller, qui a déjà un tout petit peu jeté son bonnet par-dessus les moulins ; diable ! il ne faut pas dévirginiser les filles ! Choisissez-la à votre goût ; toutes les têtes y sont. Veillez à ce qu’elle ait les qualités d’esprit et de cœur auxquelles vous tenez ; tous les caractères sont représentés. C’est l’avantage de la corporation ; elle fournit sur commande. Eh bien, je pose en principe qu’un simple trottin, une couturière quelconque, une apprentie modiste, mettez-lui des toilettes bien coupées, les portera comme la plus suave demi-mondaine.
— Et après ?
— Voilà justement le seul « après » qui ne soit point embarrassant. Prenez une cocotte, tirez-la de son vilain métier, gardez-la ; comment oserez-vous, après, l’y rejeter ? Essayez de débaucher une jeune fille ; il faut l’épouser. Mais votre trottin est de taille à se tirer d’affaire, et tout le monde sait que rien ne l’empêchera de se marier à trente ans, de devenir une excellente femme et d’avoir beaucoup d’enfants.
— Oui, disait Charles, les mains dans ses poches, en se renversant dans son fauteuil. Mais à quoi bon ? Raisonnons un peu. Pourquoi vous faut-il une maîtresse ? A cause du sexe, ou à cause d’autre chose ? Si vous n’avez affaire que du sexe, avouez sans plus qu’une maîtresse est un meuble bien inutile. Si vous avez besoin d’une amie, d’une compagne, d’une camarade, ne voyez-vous pas qu’il y a superfétation ? Je prétends que les amis suffisent à l’amitié ; les camarades hommes sont les vrais camarades ; vous me suffisez, messieurs ; et, si j’avais envie de ce genre d’épanchement scabreux qu’est l’amitié féminine, eh bien, je me lierais avec de charmantes femmes, de charmantes jeunes filles, celles chez qui nous allons dîner, mais avec qui, sacredié, je n’essaierais pas de coucher. Quant au ménage, triple fou qui demande ça à une maîtresse ; mariez-vous alors.
Marcelin prit la parole :
— A vous entendre, il semblerait qu’on trouve des femmes comme des bonbons, les fondants chez Boissier, les chocolats chez Marquis, les marrons glacés chez un autre.
— Ça n’est pas plus difficile, dit Crémone ; il suffit de savoir au juste ce que l’on veut ; pour chaque espèce il y a le bon endroit. Quel est votre genre ? grande ou petite ? la taille symbolise tant de choses !
— Vous voulez le savoir ?… Plutôt petite.
— Pas beauté classique ?
— Pas du tout.
— Brune, blonde ?
— L’une ou l’autre.
— Bravo ! cela est indifférent. Continuons : simple ? sans morgue ? plus gentille que jolie ? article de Paris ?…
— Exactement.
— Je vous comprends, mon cher. C’est l’espèce « petite femme » qu’il vous faut. Il y en a dix mille à Paris pour qui vous seriez un idéal.
Tout le monde riait.
— Tenez ! faites la Chaussée d’Antin de midi à une heure, de sept heures à huit ; descendez les rues qui vont du centre à Montmartre et aux Batignolles ; si vous le pouvez, levez-vous à sept heures du matin. Une fois en campagne, ne vous pressez pas ; raisonnez votre choix. Le choix fait, suivez ! ayez de la patience, de la persévérance : on vous fera poser de trois à huit jours. Au premier dîner qu’on acceptera, allez-y des huîtres et du champagne ; parlez de votre bel appartement, on voudra le visiter ; et puis, soyez gentil, tendre empressé ; d’ailleurs, je suppose que vous serez amoureux ; surtout, soyez gentleman. Payez le théâtre ; et, le lendemain, offrez une toilette. Mon cher, vous serez aimé.
Le cousin Georges Desruyssarts et sa femme vinrent à Paris ; ils invitèrent à dîner au cabaret ; il y avait là l’ancienne demoiselle d’honneur, mademoiselle Amélie, son père et sa mère, et quelques amis de Georges. Amélie ! il sembla à Marcelin qu’il l’avait aimée ! Il n’était pas assis à côté d’elle ; ils causèrent un peu après dîner ; elle était gentille toujours ; son père était un vieux abruti ; il pria Marcelin de les venir voir… C’est égal, pas encore mariée !…
Marcelin menait une vie ridicule. Il essayait des conseils de l’aîné des frères Crémone. Il était entré en campagne ; il suivait les petites couturières, les modistes, à travers la Chaussée d’Antin et les rues qui montent aux Batignolles et à Montmartre.
Le soir et le matin, elles passaient seules ou à deux ; à midi, quand elles allaient déjeuner, elles étaient par bandes de quatre à six ; alors, elles étaient inabordables. C’est le soir qu’il fallait opérer.
La première difficulté était de bien voir ; d’un coup d’œil, il fallait apprécier les charmes physiques et les qualités morales. Souvent, après un quart d’heure de suivage, un bec de gaz illuminait des antipathies décisives.
Ensuite, il fallait savoir suivre, pas trop près, pas trop loin, quelquefois de l’autre côté de la rue. Et puis, parler… Oh ! de cela comment venir jamais à bout ? quoi dire, bon Dieu, qui ne fût stupide ?
Conclusion : rien, rien, rien.
… Heureusement qu’il y avait cette vieille et bonne hospitalité des Mignon et des Georgette !
Cela faisait dix jours. Marcelin en avait assez, des trottins qui ne lui répondaient pas, ou l’envoyaient promener.
Il alla voir Crémone ; il lui confia ses tentatives, ses échecs.
— Vous n’êtes pas assez hardi.
— Vous croyez ?
— Voulez-vous que je vous accompagne aujourd’hui ?
— Certes.
Charles était là. Ils sortirent tous les trois à six heures. Ce fut une soirée aristophanesque.
Crémone interpellait, au hasard, vieilles ou jeunes, laides ou jolies, les ouvrières qui passaient ; il leur disait des madrigaux ineptes ; elles souriaient ; lui, faisait signe à Marcelin :
— Faut-il pousser celle-là ?
Marcelin était confus de honte. Il arrêta les choses.
— C’est pourtant la méthode, dit Crémone. Il faut leur parler à toutes. Vous voyez ainsi celles qui vous plaisent, et avec celles-là vous continuez ; vous laissez filer les autres.
Marcelin invita ses amis à dîner. Ils entrèrent au café de la Paix. Marcelin déclara solennellement qu’il renonçait aux couturières ; le bourgogne donna de l’indulgence à Crémone. Le dîner coûta cinq louis, et on alla voir la revue des Nouveautés.
Pendant un entr’acte, ils remarquèrent au foyer une petite femme mince, en velours bleu sombre, avec un grand chapeau à plumes ; elle allait et venait, d’un air délibéré, point effrontée. Marcelin en fit l’éloge à ses compagnons, qui approuvèrent.
Ils l’aperçurent ensuite au balcon ; elle vit qu’ils la regardaient. Marcelin y mit de la persistance.
— Eh bien ? lui demanda Charles.
Il eut quelque émoi à se décider.
— Il y aura encore un entr’acte. Allons au café.
L’acte suivant, la belle ne tourna pas les yeux du côté des jeunes gens.
— Tu vois, dit Charles, tu l’as découragée.
L’émoi reprit Marcelin au baisser du rideau : le besoin d’en imposer à ses amis luttait avec une croissante appréhension. On était au foyer ; Crémone aborda la dame ; on s’assit devant des tables ; elle crut que c’était Crémone qui lui faisait la cour ; Marcelin dut s’avancer, il lui sembla qu’elle avait un regret, mais il repoussa cette idée. Il parla ; ses amis soutenaient la conversation ; il proposa un rendez-vous ; on se retrouverait après la fin, à la sortie des balcons.
Ils regagnèrent leurs places et prirent immédiatement leurs pardessus.
Marcelin était content de son succès.
— Elle n’est vraiment pas mal, faisaient les autres.
— Faut-il vous la céder ? reprit-il, un peu donjuanesque.
On s’arrêta une demi-heure dans un café ; puis, Blanche Leclerc et Marcelin montèrent en fiacre. Elle était enveloppée dans une fourrure ; la correction qu’il affectait de garder lui facilitait sa tenue ; ils arrivèrent place Delaborde et montèrent ; il renvoya rapidement son valet de chambre : ils étaient seuls.
C’était la première femme qui venait chez lui. Il lui prit sa pelisse ; elle se promenait dans la chambre ; elle passa dans le cabinet de travail, pénétra jusqu’au salon ; elle furetait.
— C’est gentil chez vous… Il y a encore des pièces ?… Oh ! c’est très bien… Combien avez-vous de loyer ?
Et puis :
— Moi, je demeure rue Saint-Georges ; j’étais auparavant tout près d’ici, rue de Vienne ; mais la propriétaire… et cetera, et cetera.
Marcelin était tombé sur une petite personne assez agréable ; elle montrait de la bonne grâce ; elle avait des façons amicales de parler. Un feu de bois pétillait dans la cheminée de la chambre ; elle se chauffait le bout des pieds en se dévêtant, avec des mines joliment effarouchées, des rires.
— Oui, mon loup ; oui, mon gros bébé…
D’un fauteuil, il assista à l’apparition du corset, des jupons, des dentelles, du frais pantalon bouffant au-dessus des bas ; il découvrait ces pimpants mystères des dessous féminins, les fins linges où transparaît la peau, les élégances des rubans coquettement posés, les sveltes et parfumés contours qu’indiquent les robes, tout ce dont il avait tant rêvé ! En de folles envies de baiser ces jarretières, les nœuds de ces épaules, il demeurait dans une rêverie immobile. Elle riait encore, jasait ; il n’y avait plus que le pantalon qui pinçait le cercle de sa taille sur les plis de la chemise entr’ouverte ; les bras levés, elle ajustait ses cheveux.
— Eh bien, mon chat ? interrogeait-elle avec une moue plaisante.
Il s’attendrissait : elle était jolie, elle était bonne fille, elle était charmante ; pourquoi ne l’aimerait-il pas ? Et l’idée lui venait de lui dire la vérité, que c’était elle qui avait l’étrenne de sa chambre de jeune homme ; que, si elle voulait l’aimer un peu, il serait bien heureux de l’aimer ; qu’il avait beaucoup désiré, beaucoup cherché quelque maîtresse, et qu’elle était délicieuse ; et, ces choses, il prenait la résolution de les lui dire. Elle avait retiré ses souliers, ses bas ; d’un coup, le pantalon tomba et vola sur le divan, et, comme il se levait pour la prendre dans ses bras, elle était déjà, en courant à petits pas de toute sa vitesse, gentiment, dans le lit.
— Oh ! que c’est froid !
Il courut à son tour baiser ses yeux ; trois minutes plus tard, il était près d’elle. Il se sentait d’extraordinaires ardeurs, à n’être assouvies de rien, à durer éternellement ; il l’embrassait éperdument, lui disait de folles paroles ; elle répondait doucement ; il avait à peine sa raison ; chaque point du corps féminin lui donnait des transports ; ses mains et ses lèvres couraient dans une fièvre sur la jolie chair ; ils s’enlacèrent et il fut au ciel.
Il ne se sentit point désenchanté, mais calmé seulement ; elle souriait. Il était dans un alanguissement bien heureux ; il n’avait plus aucune parole ; il demeurait comme dans un flot tranquille où il aurait nagé sans mouvements. Elle causa un peu ; il la laissait dire, et il se reprenait à l’embrasser.
— Quel âge as-tu ? demanda-t-elle… Dix-neuf ans ?… Ça se voit.
Elle raconta encore quelques histoires, des épisodes de sa vie ; et ils s’endormirent.
Le matin, Jean leur apporta le chocolat et des brioches. Blanche l’admira beaucoup. A dix heures, elle partit. Marcelin fut princier.
— Tu viendras me voir… ou bien écris-moi… D’ailleurs, je suis presque tous les soirs aux Nouveautés.
Ce fut alors une fureur ; pendant six mois il roula aux hasards de toutes les rencontres.
Le surlendemain du jour où il avait connu Blanche Leclerc, il était allé chez elle ; pendant trois semaines, elle venait presque régulièrement tous les deux ou trois jours. Puis, un beau soir, ce fut une autre ; deux jours après, une autre. Alors, Charles et lui, sans phrases, obstinés, ils coururent les lieux de plaisir ; les bals, où des filles à vingt francs firent leur bonheur ; les brasseries de femmes, où, silencieux, ils demeuraient jusqu’à deux heures du matin, devant quarante francs de consommations, dans l’espoir — toujours chimérique — d’être finalement agréés par Georgina ou Amandine ; les cafés-concerts et les théâtres de genre, où ils s’étaient enhardis à faire gravement passer des cartes aux petites chanteuses ; même le Jardin de Paris, les Folies-Bergère et les cafés de nuit.
Et, tous deux, ils ambulaient, corrects et quasi solennels, uniquement occupés de leur vice, aveugles et sourds à quoi que ce fût hormis la chair, les yeux allumés de luxure, sans un rire, ainsi que des monomanes.
Un soir, ils avaient emmené souper deux danseuses-étoiles du Jardin de Paris ; ils ne surent pas les amuser ; au dessert, elles les plantèrent là ; ils étaient chez Baratte ; furieux, tout étant fermé, ne pouvant pas se décider à rentrer chez eux, ils descendirent au salon du rez-de-chaussée, et ramassèrent deux vieilles dames maquillées. Ce fut le plus noir souvenir de ces six mois.
La chimère d’une maîtresse reprenait Marcelin à certains soirs. Une fois, dans un affreux endroit où l’on dansait, il s’était entiché de la frimousse d’une sorte de petite blanchisseuse. Il se montait la tête ; il parlait de la garder avec lui ; Charles était désolé. Marcelin répondait qu’elle était tout autre chose qu’une vulgaire catin. Ils sortirent.
— Alors vous voulez m’emmener chez vous ? demanda la jeune fille.
— Oui.
— Mais, vous savez, je ne reste qu’un petit moment.
Madame de M. rencontra une fois dans l’escalier une fille de Bullier ; une autre fois comme elle sonnait, une demoiselle était en train de hurler en tapant sur le piano ; elle ne revint plus.
Une nuit, une femme de la rue Bréda lui demanda cinq louis ; il trouva la prétention exorbitante ; c’était chez elle ; elle insista.
— Tu peux me les donner : donne-les-moi.
Comme il refusait, elle se fâcha et appela son propriétaire ; un type à accroche-cœur entra, d’une politesse humble et tenace ; il raisonnait monsieur, calmait madame ; et en parlant, s’appuyait avec affectation sur une canne plombée ; Marcelin dut s’exécuter.
Ils ne sortaient guère de la plus banale prostitution, des créatures grossières, du vice abject, des marchandages infâmes. Ils eurent la curiosité des boulevards extérieurs ; une fois ils explorèrent Grenelle, où ils crurent devoir porter des chapeaux mous et de vieux vestons.
Puis, quand, sur les deux heures du matin ils se séparaient, chacun une donzelle au bras, également sérieux et pressés de rentrer, ils échangeaient des bonsoirs corrects et partaient sans se retourner. Mais les soirs où ils rentraient seuls, c’était à trois et quatre heures du matin qu’ils traînaient, en de perpétuelles reconduites, leurs mélancolies, dans les rues, au milieu des chiffonniers solitaires et des balayeuses, et leur désespoir de n’avoir rien fait.
Et, comme l’argent filait, le notaire un jour se permit une observation ; il paraît qu’on touchait aux économies, aux réserves, les rentes ne suffisaient pas.
La lassitude vint pourtant ; les exploits déclinèrent : il y eut encore d’étranges parties dans les campagnes de la banlieue, avec de noirs ennuis, parmi des femmes stupides ; mais cela baissait. Et il salua le départ de Paris comme presque une libération. A Dieppe, avec ses cousins Desruyssarts, dans une vie régulière, il trouva un repos ; et il affirma qu’il avait plus de plaisir à faire danser, les soirs de casino, les jeunes filles en mousseline et en tulles blancs.
Il revint à Paris pour assister au mariage de sa cousine Paule ; elle épousait un commerçant qui fut immédiatement sympathique à Marcelin.
Il revit les Delannoy et fréquenta chez le jeune ménage. Comme il s’enquérait des Rigout, Paule raconta qu’ils venaient de faire faillite ; on ne se voyait plus.
Paule était devenue une femme charmante ; le mariage l’avait transformée… Marcelin se plaisait avec eux ; la famille l’attirait ; il ne pensait plus à courir. Il est vrai que Charles n’était pas encore rentré : il lui aurait manqué pour sortir le soir.
— Tout le monde se marie alors, s’écria Marcelin.
Il venait de recevoir un faire-part :
« Monsieur et madame*** ont l’honneur de vous faire part du mariage de leur fille Amélie… et vous prient d’assister… »
— Pauvre Amélie ! se dit-il. Pauvre moi !… Après tout, c’était fatal.
Il revit quelques anciennes connaissances, de celles dont il se rappelait les noms et dont il avait gardé les adresses ; il ne désirait rien de nouveau. Il en était venu à une grande indifférence des choses de l’amour, quand, un jour, tout à coup, il crut trouver la femme qu’il avait autrefois tant cherchée. Après tant de déceptions, le hasard, le hasard en qui seul il avait raison d’espérer, lui avait-il apporté l’amour ? Elle était tombée dans ses bras, pâmée, comme une vierge, et il avait connu ce que c’était qu’une femme heureuse.
Rencontre banale, dans un wagon de chemin de fer, entre Passy et la gare Saint-Lazare. Il était cinq heures. Une jeune fille brune, aux longs yeux, était assise en face de lui, simplement vêtue, les regards dehors sur les talus qui passaient. Elle l’avait tout de suite impressionné. Il avait osé lui parler ; ils étaient seuls ; comme ils arrivaient à la gare, il obtint deux mots quelconques.
Elle ne voulait pas qu’il la suivît. Il l’avait suivie tout de même ; rue Tronchet, elle était entrée dans une maison de modes. Il s’était obstiné et avait attendu. Il attendit une heure et demie. Quand elle sortit, il l’aborda, elle montait vers les Batignolles ; elle le laissait parler ; il trouvait des choses à lui dire ; sans y penser, il pratiquait la méthode de son ami Crémone ; et il s’aperçut que cela est tout instinctif, mais qu’il faut y aller de tout son cœur.
Elle refusa de dîner avec lui ; elle dînait avec sa mère, ses sœurs ; elle travaillait ; elle n’avait pas le temps de s’amuser ; elle était déjà en retard. Ils arrivaient à la place Clichy.
— Eh bien, après votre dîner, venez avec moi au théâtre.
— Je ne peux pas.
— Je vous en prie… Je vais revenir vous chercher dans une heure ; j’attendrai devant votre porte.
Ce fut convenu. Elle demeurait en haut de l’avenue de Saint-Ouen. Il dîna rapidement. A huit heures il était là ; cinq minutes après elle apparut. Elle avait la même toilette noire en cachemire, avec un plus joli chapeau.
— Que cela est bien de votre part !…
— Oh ! je fais une folie !…
Elle aimait le drame ; ils montèrent en voiture et arrivèrent à la Porte-Saint-Martin ; il prit une baignoire.
Ils se tenaient les mains ; maintenant elle le regardait, et il se voyait dans le noir d’ébène et profond de ses grands longs yeux aux cils mouillés ; son teint était blanc et très mat ; elle avait les cheveux coiffés à la vierge, en deux bandeaux qui encadraient de leur noir ce blanc mat et ces yeux.
A la sortie, quand ils furent remontés en voiture, elle fut saisie de peurs ; elle se tirait très doucement, mais opiniâtrement.
— Non, monsieur, je vous en supplie, reconduisez-moi.
Elle faiblissait ; elle se taisait ; il la prit entre ses bras, et ils se baisèrent follement sur la bouche.
Elle fut divine ; les pointes de ses seins étaient des coraux incrustés dans l’ivoire de sa frêle poitrine, ses lèvres étaient d’un feu très languide, et son ventre avait des moiteurs et des douceurs et des chaleurs à perdre l’âme.
Et il écrivit dans un moment de lyrisme :
« Nous nous aimons.
» Voilà trois soirées, trois nuits et trois matins que notre astre rayonne… Oh ! merci que je t’ai connue, étoile des cieux, étoile du berger, clarté des cœurs !
» Et cela durera infiniment. »
… Il ne pouvait le croire… Ce fut un matin, en se levant, qu’il s’en aperçut… Louise n’était justement pas venue la veille au soir… Il se dit qu’il rêvait… Mais non ; cela était certain : il était malade !
Après déjeuner, il courut chez son médecin.
— Eh bien ! mon cher ami, ça y est ; vous êtes pincé… Oh ! rassurez-vous ; cette maladie-là, ce n’est pas grave ; mais il faut vous soigner.
Il vivait maintenant dans une stupeur. Et quoi !… Louise !… La seule qu’il avait aimée, la seule sans doute qui l’avait aimé ; elle, si désintéressée, si tendre ; elle, la plus chaste, la plus délicate ; celle qui s’était révélée l’amante si longtemps attendue ; la jeune femme, la jeune fille merveilleuse, la fleur d’élite !
Elle vint le soir ; il lui dit tout. Elle ne comprenait pas. Elle ignorait ce qu’étaient ces maladies. Ce n’était pas lui, pourtant ; il en était sûr…
Alors elle se mit à pleurer.
Que faire ?
— Soit, lui dit-il, ce n’est pas votre faute ; mais il n’y a plus moyen de se voir.
Elle se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots.
Le médecin, à qui le lendemain il confia ses incertitudes, se moqua de lui.
— Cela ne vient guère tout seul, mon cher. Mais consolez-vous ; soignez-vous bien ; n’épargnez pas la tisane ; et ça ne sera rien. Ensuite, choisissez mieux.
Cela durait, durait toujours.
Au commencement, il croyait pouvoir continuer ses courses, ses visites ; la fatigue aggrava horriblement le mal ; il ne voulait pas avouer aux amis ; il dut en arriver là. Pendant trois semaines, il souffrit cruellement ; Jean fut sur les dents ; c’étaient des grands bains, des tisanes, un régime spécial. Enfin, il y eut un peu de mieux ; les souffrances diminuèrent, puis cessèrent ; le médecin pourtant le supplia de ne pas sortir trop tôt.
Le jour du mariage d’Amélie était venu. Il voulut aller à l’église. Il se traînait. Le mal l’empêchait de penser à cette pauvre mariée, celle qu’il aurait pu avoir, lui ! Ah ! il s’agissait bien de cela aujourd’hui !
Elle, elle était jolie en mariée.
Il se dit qu’il aurait dû n’y pas aller… Et cette abominable maladie qui lui coupait, lui brisait la vie !…
Louise lui écrivit une fois pour lui demander de ses nouvelles. C’était trop fort. Il ne répondit pas.
— J’étais guéri, mon cher ; au moins, je me croyais guéri. J’ai accepté de faire le réveillon chez la maîtresse de Crémone l’aîné. Comme un niais, j’ai mangé des truffes, j’ai bu du champagne. Me voici rechuté. Il faut que je passe un mois dans le calme le plus austère, à ne pas sortir, à ne voir personne ; je ferai de la métaphysique. Que diable, je veux en finir.
Le lamentable premier janvier ! Il y avait de la neige sur les toits ; le square, sous les fenêtres, dormait dans le blanc… C’était le jour délicieux des petites visites, des cadeaux qui éclairent les visages, des vieilles poignées de mains, des gros baisers et des marrons glacés… Les marrons glacés, ça lui était défendu, comme les gros baisers.
Charles trouva pourtant qu’il exagérait.
Au mois de mars, il put aller au dernier bal de l’Opéra. Il adorait ces foules. Cette fois, il s’y ennuya horriblement.
Le lendemain, il reçut de ses amis d’Angleterre une invitation de passer quelques mois, pendant la saison, chez eux, à Brighton. Vie paisible et confortable ; sports nombreux, pas de femmes, des amis charmants… une vraie cure. Pourquoi n’irait-il pas ?
Il vivait en ascète.
Les velléités érotiques qui lui venaient au cerveau, il les refrénait.
Le médecin lui permit de petites sorties, régulières, espacées, pas longues, régulières surtout. On revit les vieilles connaissances, Mignon, Georgette.
Le service militaire approchait ; Marcelin n’y songeait guère ; il fut terrifié.
Il y eut le tirage au sort, puis la revision. Marcelin invoqua ses études de droit, et obtint un sursis.
N’importe ; il faudrait tout de même en passer par là.
Et, vers la fin d’avril, à la gare du Nord, il serrait les mains de son fidèle Charles. C’était fini ; il partait en Angleterre, y passerait quelques mois, de là reviendrait pour l’été à Dieppe, chez ses cousins Desruyssarts…
— En avons-nous fait, tout de même, des folies !
— Bonne chance là-bas !
— Je ne crois pas… Suis édifié… Au revoir.
Un grand désir était venu à Marcelin Desruyssarts de revoir le vieux château familial, où depuis cinq années il n’était plus retourné. Son cousin Desruyssarts l’y avait encouragé.
— Il est incompréhensible, lui disait celui-ci, que depuis cinq ans tu n’aies pas voulu mettre les pieds dans ta propriété.
— Vous avez raison, mon cousin, c’est inexplicable.
Et Marcelin avait écrit au père Homo d’ouvrir le château, de mettre en état quelques chambres. On était aux premiers jours de septembre. Il quitta Dieppe seul, ses cousins devaient venir le rejoindre quelques jours plus tard. Il était parti très curieux de retrouver ses impressions d’autrefois ; la lenteur des trains, l’incommodité du voyage, la chaleur étouffante de l’après-midi le harassèrent ; il reconnut sans émotion la forêt, le parc, la maison, tels à peu près que son souvenir les avait gardés, et, aussitôt, il s’occupa de s’organiser. Il voulut se rendre compte, se fit mettre au courant, monta à cheval, visita ses fermes, s’intéressa à son nouveau rôle de gentilhomme campagnard.
Le curé du village était un jeune abbé un peu insignifiant ; Marcelin lui fit visite et l’invita à déjeuner ; le curé lui parla de ses paroissiens, du pays, de la pauvreté de la fabrique. Marcelin l’écoutait ; il promit un don pour l’église.
Il reconduisit l’abbé jusqu’à la grille, puis rentra, monta en voiture avec le père Homo, alla voir des fermiers.
Le soir il se couchait de bonne heure ; sans effort, il se levait aux premiers rayons du soleil.
Un matin, Jean annonça une visite :
— M. Henri Courtois…
Un grand garçon se présenta, de l’âge de Marcelin, l’air doux, un peu embarrassé.
— Vous ne me reconnaissez pas, monsieur Desruyssarts ? Le petit Henri, le fils du médecin, votre ancien camarade…
Marcelin se rappela.
— Excusez-moi… Je me rappelle très bien… Nous étions si bons amis…
Ils s’assirent et se mirent à causer ; une sympathie était née tout de suite entre les deux jeunes gens.
— Comme est gentil d’être venu me voir !… Et qu’est-ce que vous faites !
— Je serai médecin, comme mon père ; j’espère être docteur dans un an.
— Vous aimez votre futur métier ?
— J’aurais peut-être préféré la théorie à la pratique ; mais il faut vivre.
— Vous souvenez-vous ? nous voulions être soldats ; mais nous choisissions d’être capitaines.
— C’est vrai.
— Vous resterez quelque temps à Saint-Paulin ?
— Jusqu’à la fin des vacances.
— Tant mieux ! On se verra souvent, voulez-vous ?
Charles Berty devait venir passer huit jours ; il annonça sa visite pour la fin du mois. Le cousin Desruyssarts, au contraire, arriva au bout de quelques jours ; il n’était pas fâché, disait-il, de renouer connaissance avec ce vieux pays de Saint-Paulin. Sa femme et son fils cadet, Paul, l’accompagnaient ; son premier fils, Georges, vint le rejoindre le surlendemain avec sa femme. Madame Desruyssarts mère prit momentanément la direction de la maison ; elle avait amené deux domestiques et apporté mille sorte de provisions ; ce fut un branle-bas général dans le château. Henri Courtois avait été présenté ; Marcelin le contraignit à venir tous les jours. Le père Homo rayonnait. Le mois de septembre était magnifique ; il fut question de chasser, mais on n’était pas préparé, on se rabattit sur les promenades, les excursions.
Paul était un joueur de tennis admirable ; il avait apporté un tennis ; on eut beaucoup de peine à l’installer ; on joua deux ou trois fois, tant bien que mal. A la fin de la semaine, quand les cousins parlèrent de partir, Marcelin se surprit à étouffer un soupir de soulagement.
— Tu sais, dit Paul à son cousin un jour qu’ils se promenaient tous deux avec Henri… Madame Aron-Véber m’a beaucoup parlé de toi depuis ton départ.
Henri releva la tête. Paul se tourna vers lui, et, désignant Marcelin d’un coup d’œil :
— C’est son flirt de Dieppe.
— La femme du coulissier ?
— Vous la connaissez ?
— Oh ! moi, je ne connais personne. J’ai été deux fois chez elle à Paris. Mon professeur, le docteur Dubois, m’a présenté.
— C’est aussi son flirt, au docteur.
— Je n’en sais rien.
— Avouez-le ; ça va navrer Marcelin ; n’est-ce pas, Marcelin ?
— Elle est jolie, ajouta Henri.
Marcelin prit un air dégagé :
— J’te crois !
Puis, il conclut :
— Mais ce que ça m’est égal !
— Allons donc ! riposta son cousin. Tu en es amoureux comme une bête. Mais n’aie pas d’inquiétude ; si tu insistes, tu l’auras un jour, entre cinq et sept, comme les camarades.
Le dimanche, madame Desruyssarts voulut persuader à tout le monde qu’il était décent d’aller à la messe. M. Desruyssarts et son fils Georges résistèrent ; Henri dut accompagner à l’office les deux dames et les deux jeunes gens.
Marcelin revit l’église, où depuis cinq ans il n’était plus entré, où, dans sa première jeunesse, si ardemment il avait rêvé.
La nef était pleine de monde ; le soleil brillait à travers les vitraux ; quand ils entrèrent, l’harmonium ronflait au-dessus du porche. Marcelin eut une émotion, et sa pensée courut à travers un vague de choses anciennes ; il trempa ses doigts dans l’eau du bénitier, à l’entrée de la chapelle de la Vierge, près de la porte.
Henri accepta de sa main l’eau bénite, et ils pénétrèrent dans la nef.
Ils regardaient, en marchant, au fond, le chœur qu’une grille de bois isolait de l’assistance ; et ils entrèrent dans le banc de la famille.
M. Desruyssarts prit un matin son ancien pupille à part et le sermonna sur la question d’argent.
Non seulement la respectable liasse de billets de mille qu’il avait trouvée il y a cinq ans dans le tiroir de son père avait disparu, mais il avait commencé à écorner son capital. Les rentes qu’il avait héritées ne pouvaient-elles suffire à sa vie de garçon ?
— Mais mon installation…
— Ton installation place Delaborde t’a coûté beaucoup trop cher ; mais s’il n’y avait eu que cela…
Marcelin baissa le nez.
— Tu as beau être majeur et indépendant ; si cela continue, et dans ton intérêt, sache que je puis très bien te faire pourvoir… tu sais de quoi.
— J’y ferai attention.
— Rends-toi un compte exact de tes ressources, mon garçon, et vis en conséquence. Et surtout point d’exagérations ; autrefois, c’était la solitude quand même ; après, ç’a été une fête de tous les jours. Sois modéré en tout, voilà le conseil dont tu as besoin.
La veille du départ, Paul disait à son cousin, après dîner, en fumant des cigarettes :
— Ça manque de femmes ici.
La maman entendit ; elle se retourna.
— Veux-tu laisser ton cousin tranquille ! Il s’est déjà suffisamment amusé à Paris.
— Il est vrai, reprit Paul un peu gouailleur, qu’il s’en est payé…
— Et je pense qu’il en a maintenant assez, reprit Henri.
Marcelin songea aux années qu’il venait de passer dans le tourbillon de Paris. Et, comme chacun se taisait, sa rêverie alla au parc, à la forêt, et à cette chambre du château qu’il avait laissée fermée et où il n’avait introduit personne.
Le silence durait.
Et ce fut madame Desruyssarts qui conclut à mi-voix :
— Il faut que jeunesse s’instruise.
Ses cousins partis, Marcelin resta seul. Henri continua à venir tous les jours. Ils faisaient de longues promenades en causant. Henri montrait un esprit préoccupé d’idées générales ; les choses de tous les jours ne semblaient pas l’intéresser ; de son métier, il ne parlait guère ; sa conversation tournait vite à la philosophie. Marcelin l’appelait le métaphysicien, et, lui-même, il se sentait s’intéresser aux hautes questions dont son ami aimait à l’entretenir. Souvent, le soir, après avoir dîné ensemble, ils sortaient, et, en bavardant, ils parcouraient le parc, lentement, et puis se reconduisaient sans fin, Henri demeurant dans le bourg, à un kilomètre du château.
C’était ainsi, l’autre année, que Marcelin allait, avec Charles, à travers les rues de Paris, la nuit, en d’interminables reconduites. Mais, à présent, il ne s’agissait plus du plaisir et de demoiselles ; et, ce dont il s’entretenait, c’était du problème de l’existence, et d’idées, et de rêves…
Ils s’étaient peu à peu raconté leurs existences ; peu à peu, ils se confiaient l’état de leurs âmes.
— C’est étrange, disait Marcelin, comme depuis que je suis revenu à Saint-Paulin, l’idée religieuse me hante.
— C’est nouveau chez toi, ce me semble ? demanda Henri.
— Pas tout à fait…
— A Paris, ces dernières années, tu n’as guère songé à la religion.
— Non ; mais, pourtant, la religion ne serait pas aujourd’hui chez moi une nouvelle venue.
— La religion, dit Henri, comme les philosophies, c’est une solution qui nous est proposée du problème de la vie.
— Toi, un savant, tu ne crois pas à la religion ?…
— Qu’y a-t-il de commun entre la science et la religion ? La science a son domaine qui est l’univers, elle établit les lois naturelles ; la religion, qu’elle s’appelle en effet religion ou se nomme philosophie, scrute au delà de l’univers la raison des choses et définit la loi morale. La nature peu à peu se manifeste ; rien n’empêche d’espérer qu’un jour tous les phénomènes physiques, physiologiques, psychologiques, soient élucidés ; cela est possible ; le monde, les choses, le rapport des choses, l’esprit humain, la vie, tout ce qui tombe sous les sens, ce qui s’analyse, ce que les savants découvrent, ce que les paysans observent, ce que l’expérience ou le calcul étudie, c’est le connaissable… Mais il y a ce qu’on ne peut pas connaître, ce que jamais on ne connaîtra, ce qui est au-dessus, en dehors de la raison humaine, l’inconnaissable.
— C’est alors que le nommé Dieu entre en scène.
— Justement. Là commencent les philosophies, les religions, toutes les métaphysiques, chacune présentant son hypothèse. Entends-tu bien qu’une religion, une philosophie, ce n’est pas autre chose qu’une supposition de l’inconcevable ? Prouver est impossible ; conjecturer seul est permis. Prouver, quelle ridicule pétition de principes ! Dès que l’on dépasse l’expérience, une preuve même irréfutablement établie dans l’esprit ne prouve rien dans la réalité ; si j’arrivais à me prouver Dieu, cela voudrait dire simplement que l’idée de Dieu est nécessaire à mon esprit, mais comment cela établirait-il qu’il existe en effet ?
— Tu me sers du Kant, je crois…
— Aussi, je n’insiste pas ; il y a évidence ; et je reviens…
— A la théorie des premiers principes…
— La distinction du connaissable et de l’inconnaissable, cela est immortel. La théorie de l’évolutionisme durera plus ou moins ; je ne sais pas ; mais la distinction du connaissable et de l’inconnaissable est une de ces simplifications grandioses qui, comme l’idée de Kant, sont au-dessus des systèmes.
— Mais, si elles opèrent dans l’inconnaissable, les philosophies et la religion ne sont-elles pas condamnées d’avance ? Quand les phénomènes du monde sont expliqués, quand la science a parlé, quand le connaissable a été élucidé, à quoi peuvent prétendre les chercheurs de l’au-delà ?
— Certes, ils ont bien l’air de délicieux inutiles ; au moment où tout ce qui pouvait être dit a été dit, ils arrivent, philosophes et théologiens, ainsi que des dilettantes ; des artistes, n’est-ce pas ? l’art pour l’art, tout simplement ; ils vont chercher ce qui ne peut être trouvé, s’exhausser vers ce qui ne peut s’atteindre, raisonner dans l’inconcevable ; que sais-je… Seulement, ces hypothèses, ces chimères, ces divagations, c’est la plus hautaine occupation de la pensée, et c’est la plus poignante et la plus inévitable.
Un jour qu’une pluie légère tombait, ils étaient restés tous deux au château, et ils devisaient en fumant des cigarettes.
— Il y a, disait Henri, des explications du monde qui sont absurdes ; car s’il est impossible qu’une explication soit prouvée vraie, il faut qu’elle soit démontrée logique. La religion a commencé par être une hypothèse un peu simplette, mais soutenable, et qui se résume dans l’antagonisme du bon Dieu et du Diable. Tu te rappelles le Dieu bonhomme, barbe blanche, globe à la main, assis dans le ciel ; c’est la Providence, une puissance supérieure, oh ! une puissance considérable, mais quelque chose de très relatif ; à côté est son ennemi le Diable, une autre puissance qui, en fait, ne le cède guère à la première ; et, entre les deux seigneurs, la guerre.
— Pour des âmes naïves, l’hypothèse est suffisante.
— Fatalement, elle est devenue le manichéisme, disons le dualisme, la seule forme raisonnable du christianisme classique. Il y a deux forces dans le monde, deux lois morales ; l’une s’appelle l’égoïsme, c’est elle que la science a définie le « Struggle for life » ; l’autre se nomme l’altruisme, et c’est l’instinct mystérieux du renoncement à soi-même et de la charité. La vie est le conflit de ces deux nécessités contradictoires.
— L’égoïsme et l’amour…
— La science s’arrête à la constatation du double fait ; la philosophie et la religion en proposent des explications. L’orthodoxie contemporaine, qui n’oppose à un Dieu éternel et souverain qu’un Satan de second ordre, verse dans l’absurde ; l’hypothèse du dualisme, au contraire, en supposant Dieu et Satan, le Très Haut et le Très Bas, deux puissances égales l’une à l’autre, éternelles toutes deux, toutes deux souveraines, rayonne de la splendeur de la plus absolue logique.
— Je me suis en effet souvent demandé, reprit Marcelin, comment un Dieu qui serait plus puissant que le Diable permettrait au Diable d’exister, d’agir… Pouvoir le bien et admettre le mal, quelle perversité ! quel néronisme ! Et, cependant, ceux qui croient en lui le nomment le bon Dieu.
— Suppose un père disant à son enfant : Tu as faim, voici des fruits ; et si tu touches à ces fruits, ô mon fils, je t’arracherai les yeux et les lèvres, je te brûlerai la langue et te briserai les dents… Ce père effroyable, c’est le bon Dieu qui punit de l’enfer, oui, de l’éternel enfer, les actes où sa volonté suprême nous expose et en vérité nous autorise à tomber.
— Mais il a des pardons…
— Pardonner à qui se repent, la belle affaire !
— Il a de plus hautes miséricordes…
— Que valent toutes ses miséricordes, si, une seule fois, il lui est arrivé de ne pas pardonner !
— On parle de pitiés infinies…
— Un seul, un seul pécheur damné contre un milliard de pécheurs pardonnés, c’est toujours l’irrémédiable abdication de Dieu.
— Tu n’admets pas le mal ?
— Non, s’il existe un Dieu assez puissant pour l’abolir.
— Les théologiens répondent que l’harmonie finale s’établit…
— Eh ! mon cher, la fin ne justifie pas les moyens.
Marcelin se mit à rire.
— Il me semble, dit-il, que tu lui fais son procès, au Dieu du catéchisme ?
— Il n’est qu’abominable ; mais songe au Dieu d’absurdité qu’ont créé les théologiens qui ont voulu fusionner avec la philosophie spiritualiste.
— Oui, le Dieu mi-partie religieux et mi-partie philosophique…
— Le Jéhovah coléreux et rancunier, le bonhomme de bon Dieu, le Créateur des imageries saintes est devenu l’absolu ; la Providence s’est faite infini métaphysique… Quelle contradiction ! C’est le Dieu de la Sorbonne et des séminaires. Écoute, il est l’impossible ; sa propriété est de ne pas être ; par définition, il est celui qui n’est pas ; ego sum qui non sum ; il se nomme l’Inexistant.
— Mon ami Charles Berty dit quelquefois dans la conversation : « Que Dieu vous bénisse, s’il existe… » ou : « A la grâce de Dieu, s’il existe… » Ce doute est inutile ; je lui conseillerai de dire : « A la grâce de l’Inexistant !… » et, quand quelqu’un éternuera : « Que celui qui n’est pas vous bénisse ! »
— Ne plaisantons pas, haïssons le mensonge orthodoxe ; oui, haïssons le monstre. Pourquoi accommoder la Genèse aux travaux des savants ? à quoi bon expliquer scientifiquement Josué ? pourquoi donner une apparence humainement possible à la résurrection des corps ? La bêtise des pauvres d’esprit est touchante, leur ignorance est vénérable ; mais la mauvaise foi des pharisiens est hideuse. Garde de la tendresse pour le vieux bon Dieu qui juge, s’irrite, s’apaise et donne la pluie ou le beau temps ; sois indulgent au Tout-Puissant en dépit de ses erreurs et tiens-lui compte de ses bons mouvements ; et pour le brave curé naïf qui ne fait pas de spiritualisme, aie des respects et des pitiés et de l’amour. Mais, je te le dis, hais, sache haïr fortement le christianisme conciliateur qui s’habille à la moderne et s’embarque sur le dernier bateau des philosophies à la mode.
— Lourd fardeau, la haine, reprit avec un demi-sourire Marcelin.
— Tu as raison. Il y a mieux : l’indifférence.
— Le dualisme, disait encore Henri, est une chose logique ; et sache que c’est l’âme même de toute religion. Dieu et Satan, Bel et Sin, Vischnou et Siva, Ormuzd et Ahriman, partout tu reconnaîtras l’antithèse de deux esprits contraires d’où se crée l’univers. Dans son effroyable grossièreté, le manichéisme explique le bien et le mal ; la prière et l’envoûtement ; la misère, la souffrance, toutes les ruines, et l’espérance ; le paradis et l’enfer ; il explique que l’on puisse être un Jésus-Christ, un saint François de Sales, un héros et un martyr, et que l’on puisse aussi bien être un bandit, un criminel, une bête féroce ; il explique qu’un saint pèche sept fois par jour et que Jean Valjean devienne un bienfaiteur ; que nous soyons si lâches et quelquefois si forts, si épris d’idéal, si tourmentés de vices, et si misérables, avec des moments plutôt délicieux.
— Le manichéisme est une religion possible ; ce n’est pourtant pas celle-là qui m’a jadis ému.
— Prends garde d’affirmer à la légère ! peut-être ne l’avais-tu pas reconnu… Le manichéisme n’est qu’une formule grossière de l’idée religieuse. Sous sa forme la plus purifiée, le christianisme est encore l’expression du même dualisme.
— L’âme du christianisme, ce n’est pas l’antagonisme de Dieu et de Satan.
— Si ! puisque Satan et Dieu sont l’hypothèse logique par qui il explique le monde. D’une part, la nature, l’instinct, le désir, la volonté de vivre, d’être soi-même, de développer son individualité, et, nécessairement, la lutte contre ce qui entoure, la guerre, l’acte méchant de l’animal qui égorge pour se nourrir et pour vivre et pour se conformer à la loi universelle. D’autre part, la charité, le renoncement au désir et à l’instinct, le sacrifice de soi, l’effort à faire du bien, à créer du beau, la montée vers un idéal, et l’animal qui refuse d’égorger et consent à mourir et dit non à la loi naturelle, afin qu’un peu de mieux vienne parmi les choses. Combat irréfrangible ; duel irrémédiable ; antagonisme sans fin. Oui, Satan et Dieu, s’ils symbolisent l’égoïsme et l’amour.
La pluie avait cessé ; le soleil brillait ; ils prirent leurs chapeaux, des cannes, et sortirent. Ils marchèrent quelque temps en silence. Marcelin sentait monter en lui une foule d’idées très anciennes, très profondes, très oubliées ; il regardait vaguement le ciel qui rayonnait d’un bleu intense et lumineux.
— As-tu jamais lu, demanda Henri, mais lu sérieusement et profondément Pascal ?
Marcelin tourna la tête, s’arrêta ; puis lentement :
— Oh ! comme ce nom que tu viens de prononcer éveille en moi de choses !… Oui, Je l’ai lu, jadis, bien lu… Prenons cette allée ; marchons un peu, veux-tu ?…
Marcelin faisait maintenant des confidences qu’il n’avait faites à personne encore. Le temps avait la douceur des belles après-midi de soleil après la pluie passée ; l’air était frais et point froid, le soleil clair sur la rosée des gouttes de pluie qui s’évaporaient, le sable déjà sec mais sans poussière sous les pieds ; une puissante haleine de verdure s’exhalait de partout. Il dit :
— Le vieux curé qui nous a fait faire notre première communion m’a raconté que la première fois que ma mère m’a senti remuer dans ses entrailles, ce fut un jour de Noël, dans l’église. Elle s’évanouit, et les gens de l’église l’ayant emportée, c’est avec de l’eau d’un bénitier, avec de l’eau bénite, qu’ils humectaient ses tempes. Oh ! comme elle avait souffert, pour que je vinsse au monde, ma pauvre, pauvre mère ! Le jour de la communion, ne me retrouvai-je pas, presque affaissé, contre le bénitier qui miroitait, et ne me retrouvai-je pas plus tard, avant d’entrer dans la vie, au pied du vieux portrait où la bien-aimée me souriait divinement ?
Maintenant, il parlait à voix basse, la tête mi-penchée.
— Tu ne sais pas, mon ami, la sainte piété de mon enfance… Un jour, dans l’église, te rappelles-tu que l’évêque s’est approché de moi et de ses doigts a touché mon front et mes lèvres qui le saluaient ?… Et cette première communion, quel don de moi-même à la religion !… J’ai pleuré, mon cher, à chaudes larmes, en revenant à notre banc, et j’étais halluciné ; dans les simples paroles bien ordinaires qu’a dû prononcer notre bon curé, je me souviens que j’ai entendu des choses affolantes ; et je me suis donné, oui, donné ce jour-là !
Son émotion était telle que par moments sa voix se convulsait.
— La grande ferveur apaisée, continua-t-il de plus en plus bas, il m’en resta un sentiment calme et profond, et j’ai chéri la solitude. Mon ami, j’ai passé mes années de collège sous l’impression ineffacée de ces exaltations primitives ; j’en ai gardé la marque dans le fond de mon cœur, au milieu de la vie abominable du lycée ; tu ne sais pas comme j’étais un collégien pieux, moi. A quinze ans, seul de la classe, je communiais à Noël et à Pâques, et, le soir, à l’étude, je les lisais, ces Pensées de Pascal qui me poignaient l’âme. Un jour je me suis demandé, tu ne sais pas cela, si je ne devais pas me faire prêtre. Comment se peut-il que l’enfant religieux que je fus, soit devenu l’homme qui vient de vivre à Paris ces années d’imbécillité ? Quelle noble et lyrique enfance, mon ami ! Et puis, et puis, à seize ans… oh !…
Ils passaient près d’un banc ; ils s’assirent ; Henri écoutait, gravement attendri, le jeune homme qui dévoilait son cœur et qui parlait, les yeux sur la terre, la gorge oppressée :
— Et puis, à seize ans, oh ! j’ai aimé de toute mon âme, la sainte, la martyre qui est encore là, regarde…
Et il montrait, vaguement, d’un geste, une fenêtre éternellement fermée du château qu’un rideau fané voilait.
— Oh ! qu’elle était belle, et pâle, et douce, et mélancolique, ma mère, ma tendre mère !
Henri lui prit la main ; Marcelin avait relevé la tête ; un flot de larmes s’échappa de ses yeux ; il se précipita sur le bras de son ami, mêlant ses larmes de sanglots.
— Mon cher ami, mon bon ami disait Henri, calme-toi…
— Pardon, faisait Marcelin en s’épongeant les yeux ; ce n’est rien ; mais elle est trop horrible, cette vie d’incertitude !
Tout le passé était revenu dans l’âme du jeune homme, les souvenirs d’enfance, l’adolescence si religieuse, les seize ans si romantiques et purement passionnés, les fleurs d’ébène, les pleurs d’ivoire…
Et il raconta à son ami, des secrets que nul n’avait jamais connus.
— Sais-tu, dit-il un jour, qu’en ces temps-là j’ai failli entrer au séminaire ? Toi qui me parles des Pensées de Pascal, sache que je fus un effroyable janséniste… Oh ! janséniste ne veut pas dire rigoriste imbécile, puritain hypocrite ou stupide… C’est le dogme qui m’avait pris.
— Tu ne m’étonnes pas, répondit Henri.
— A seize ans passés, presque dix-sept ans, je sortais de cette crise de passion chimérique et si pure ; ma vie avait toujours été religieuse, sans aucune grave interruption de l’idée chrétienne ; un soir de février, au lycée où mes études se terminaient banalement, quelques mois après la mort de mon père, un soir, j’ai été pris par l’enthousiasme de l’apostolat. Je me souviens très bien, je ne sais par quel hasard le livre de Pascal avait toujours été mon livre de chevet ; jusque-là je le lisais sans y comprendre grand chose, peut-être séduit seulement par de la littérature ; mais, ce soir-là, je compris subitement ce que c’était que la Grâce… Dieu choisit ses élus pour le sacrifice ; il leur fait connaître sa volonté qu’ils renoncent à l’égoïsme ; la Grâce est un mouvement qui, hors de toute humaine raison, mystérieusement, irrésistiblement, porte l’âme à se dévouer. Et je compris dès lors le renoncement chrétien : plus d’accommodements, tout abandonner ; plus d’atermoiements, agir ; la vocation est terrible et souveraine ; un seul souvenir impur, a dit Saint-Cyran, peut à jamais troubler un cœur ; ce qui veut dire qu’un acte d’égoïsme souille une carrière de charité. Une seule pensée mauvaise anéantit les effets de la Grâce ; c’est-à-dire qu’une pensée d’égoïsme fait sombrer la charité dans l’âme.
» Et j’eus un divin enthousiasme.
» Faire le bien, faire du bien sur la terre ! Il y a des hommes qui sont utiles aux hommes ; il y a des serviteurs humbles qui se dévouent au progrès du bonheur des hommes ; il y a les artistes qui créent de la beauté et par qui l’âme des hommes s’élève ; mais, au-dessus, dans une pure splendeur blanche, il y a le prêtre qui console et raffermit et guide ; il y a le moine qui prie, c’est-à-dire qui par une suggestion mystique crée de l’amour parmi le monde… Le missionnaire n’est pas celui qui, cachant sous sa robe des desseins politiques, va ouvrir des colonies aux comptoirs des civilisations ; l’authentique missionnaire est celui qui prêche dans le désert des capitales européennes et qui parmi les appétits et les désirs offre et répand le sacrifice de soi.
— O mon ami, soupirait Henri Courtois, tu as donc vécu ces exaltations !
— Écoute, continua Marcelin, la suite de mon histoire. Je résolus de me faire prêtre. J’avais horreur des prêtres que je voyais autour de moi ; qu’étaient-ils, sinon des professionnels du culte ? Mon confesseur du lycée était un de ces abbés instruits, très fins et fort respectables, que les évêques choisissent pour la fréquentation des jeunes gens de l’Université. Je lui confiai mon âme et la soif de sacrifice qui me brûlait ; et je me rappelle très bien ses conseils qui m’incitaient à la modération, au calme, à un délicieux juste-milieu… Quel dégoût !… Pas d’exagération ! pas d’excès ! pas de zèle ! répétait-il.
— Je connais cette sorte de prêtres ; ce sont toujours les hommes des Provinciales.
— Les sœurs qui dirigeaient l’infirmerie du lycée étaient les dernières d’un ordre venu de Hollande, de la tradition de l’évêque Jansenius. La supérieure avait quatre-vingts ans, âme simple et si bonne ! J’allai la trouver et lui demandai le nom de son directeur ; c’était l’aumônier d’un des hôpitaux de Paris ; je lui écrivis ; je lui demandai, à lui qui gardait le dépôt des traditions des pieux solitaires du Port-Royal, de m’aider, d’accepter de diriger mon âme. J’attendis dans la fièvre de mon émotion la réponse du dernier prêtre janséniste…
— Et le prêtre janséniste n’était pas un prêtre janséniste, n’est-ce pas ?
— Je n’eus pas même de réponse. Je retournai trouver la vieille religieuse et lui racontai ma déception. Elle me regardait avec des regards ébahis, la bonne vieille ; puis, tout à coup, je vis des larmes qui coulaient de ses yeux ; et dans une sorte de rire amer et résigné qui se mêlait à ses pleurs : « Mais mon pauvre petit gas, me disait-elle, il n’y en a plus de ces prêtres-là ; plus un seul ; il n’y en a plus ; personne ; c’est fini… Si tu m’avais dit !… Mais nous nous confessons à n’importe quel curé… Vois… j’ai quatre-vingts ans, et voilà cinquante ans que je n’ai plus entendu l’ancienne parole du bon Dieu ! »
— Pauvre vieille !
— Je suis resté accablé. J’ai eu deux mois de taciturne découragement ; et, peu à peu, j’ai pensé à autre chose ; le foyer était mort, et, peu à peu, les cendres se refroidissaient ; peu à peu, la religion semblait s’effacer de mon âme. Cela mit toute la fin de l’hiver à mourir, comme une de ces puissantes roues actionnées par la vapeur, quand la vapeur a été tout d’un coup arrêtée ; la roue continue à tourner, mais insensiblement elle se ralentit ; quelque temps encore elle tourne, mais insensiblement la vitesse s’atténue, et bientôt elle s’arrête ; c’est la fin.
» Au printemps, je me remis à lire les poètes ; tu sais comme Lamartine m’avait enchanté ; puis, ce fut Hugo ; leurs lyrismes remplirent le vide de mon cœur, et, à l’automne, quand je vins m’établir à Paris, j’avais comme oublié la crise religieuse.
— C’est-à-dire, reprit Henri, que la religion ne fut plus à tes yeux la forme de l’amour.
Henri disait encore :
— Le christianisme populaire explique la vie par l’antagonisme de Dieu et de Satan ; devant le problème de l’existence, le christianisme des Pères de l’Église émet le dogme du péché originel et de la rédemption, qui n’est qu’une formule purifiée de la même idée. Le péché originel, œuvre de Satan, et sa contre-partie, la rédemption, œuvre de Dieu, voilà donc l’hypothèse, le mystère, le postulat qui nous est proposé. L’homme naît sous la loi de Satan, c’est-à-dire sous la loi de nature, c’est-à-dire sous la loi du péché, c’est-à-dire avec l’instinct de vivre ; mais Dieu, mais le Christ a révélé la loi de rédemption, c’est-à-dire la loi de renoncement, la loi d’amour. Et le phénomène par lequel l’homme passe de la loi de nature à la loi d’amour…
— C’est la Grâce ?…
— Oui, la Grâce, mouvement divin, disent les Pères, qui conduit de l’état du péché originel à l’état de rédemption, — mouvement divin, entendons-nous, qui arrache à l’égoïsme et transporte aux ferveurs du sacrifice et du renoncement. Comprends-tu dès lors comment Pascal était sceptique par la raison et croyant par le cœur ?
» Le connaissable est le connaissable ; l’inconnaissable est l’inconnaissable ; les lois scientifiques du monde, physique, physiologie, mécanique, sont les lois scientifiques du monde. Mais, pour voir dans l’au-delà et pour expliquer la loi morale, une hypothèse a été émise : Satan et Dieu, le péché originel et la rédemption, la loi du désir et la loi du sacrifice, la loi d’égoïsme et la loi d’amour… J’hésite, je compare, je médite, je rêve — et tout à coup voici que tout s’illumine ; l’hypothèse éclate vérité, la supposition est une certitude, je crois au mystère : c’est la Grâce !
» Je comprends que l’homme est né dans le péché et le malheur, et que le sacrifice le rédime du péché et du malheur. A l’origine régnait l’instinct ; mais par le renoncement voici la rédemption. Une fatalité égoïste pèse ; mais, grâce à l’holocauste, le ciel d’amour s’entr’ouvre. Adorable mystère ! merveilleuse explication ! délicieuse hypothèse, par qui tout devient lumière ! Le monde est expliqué, tout est manifeste, tout rayonne ! Homme, tu es né sous la nécessité de la lutte pour la vie ; mais voici que le Divin s’incarne dans le renoncement et l’holocauste, et les portes du mieux sont ouvertes ; et toi, si misérable de par ton origine, tu deviens, de par le Sacrifice et la Rédemption, le plus noble et le plus pur. Si Satan est la loi terrestre, le Dieu en qui je crois est l’Idéal.
» Les invraisemblances paraissaient à Pascal une preuve de la divinité du christianisme… La religion semble absurde, disait-il ? Oui. Si elle était claire, cela serait contradictoire avec le péché originel qui nous a rendus aveugles. La religion, absurde à la raison, éclate vraie au cœur ? Oui elle doit éclater, vraie, puisqu’il y a eu la rédemption pour dessiller nos yeux… Prodige de logique ! L’état religieux n’est plus une abdication de ce scepticisme nécessaire à la raison et de l’esprit scientifique : l’esprit scientifique, le scepticisme, n’est plus une abdication de l’état de religion. Va ! le connaissable et l’inconnaissable font bon ménage ; le connaissable implique l’inconnaissable ; l’inconnaissable comporte tout le connaissable. Oui, je sais que la loi de nature est la lutte pour la vie et est le péché : et je crois que la loi morale est le sacrifice et est l’amour… Pascal, mon cher, a fort bien causé de tout cela…
— Mais, songea tout haut Marcelin, comment peut se produire le phénomène de la Grâce ? ce mouvement, que tu qualifies de divin, qu’est-ce qui peut l’amener ? quand peut-il naître ? comment ? pourquoi ?
Henri resta quelques minutes silencieux, puis il dit :
— En un terrain très préparé, en une âme prête à l’exaltation, nourrie de doctrine, surexcitée par le rêve, — en un cœur brûlant de flamme, — que tout à coup surgisse l’idée d’un sacrifice, d’une immolation, d’un renoncement, — ainsi qu’après la chute il y a la rédemption, ainsi qu’après le péché originel il y a l’incarnation et l’holocauste, — que le renoncement, que l’immolation, que le sacrifice surgisse aux yeux de l’âme, — ce mouvement, ami, voilà la Grâce.
Et il reprit :
— Parmi l’acte formidable du renoncement, quelqu’un t’assistera pourtant ; parmi les affres de l’immolation, il sera prié pour toi ; parmi l’effort surnaturel du sacrifice, quelqu’un intercédera et t’aidera… Tu te rappelles ce symbole ?… celle qui est tout dévouement, étant mère, et qui est toute pureté, étant vierge, — Marie.
— Où est le temps, soupirait encore le jeune homme, où dans les tourments des luttes intérieures je savais dire : Sancta Maria, ora pro nobis !
— Le monde, ajouta Henri, était sous l’empire du désir ; la satisfaction du désir était la loi des êtres, et chacun se ruait à chercher le bonheur dans la joie de vivre. Mais un homme est venu, qui s’est nommé Jésus, et qui a dit d’immoler le désir, de sacrifier la chair et la raison, de renoncer à la joie de vivre ; et, ayant dit, il a scellé sa parole par son exemple ; et, lui-même, il s’est offert pour être l’exemple du sacrifice, de l’immolation et du renoncement. Au monde qui disait : je veux vivre ! il a dit : prenez ma chair, prenez mon sang, et il s’est dévoué pour enseigner la rédemption.
» … Oh ! quelle race fatidique et prédestinée a pu se faire l’instrument d’une telle œuvre !… Il fallait accomplir l’acte plus effroyable que tous les crimes qu’ait jamais inspirés la cupidité, la vengeance, le sadisme ou la peur… Oh ! quelle race a été assez bénie de toute éternité pour pouvoir, afin que l’exemple divin fût donné, crucifier l’Idéal ?…
» Et maintenant il y a deux doctrines entre lesquelles il faut choisir, entre lesquelles chacun choisit, entre lesquelles il est impossible de ne pas choisir : être conformément à la nature ; être contrairement à la nature. Le péché originel et la rédemption, mon ami, c’est exactement le Struggleforlifisme de la loi de nature et la charité de la loi morale ; sachons choisir !
— C’est égal, quels théologiens nous faisons ! disaient-ils tous deux ; et comme, il y a quelques siècles, ce christianisme nous eût bel et bien conduits au bûcher !
Marcelin et Henri s’entretinrent longtemps ; il y eut encore des discussions métaphysiques et beaucoup de théologie ; il y eut aussi des épanchements, des confidences, de longues méditations, et de longues heures à parler, à rêver de l’inconnu.
L’automne arrivait cependant ; les jours se faisaient courts ; le parc peu à peu se dénudait ; les pluies commencèrent.
Un matin, Marcelin reçut une dépêche de Charles Berty, qui lui annonçait son arrivée. Il fit atteler et se rendit à la gare. Charles débarqua par une pluie torrentielle.
— Voilà ma chance ! s’écria-t-il.
— Comment va ? demanda Marcelin.
— Fourbu, cassé, vidé ; suis allé à la mer pour me remettre ; rencontré des cocottes ; pas des petites femmes comme dans le temps ; les grandes dames de la noce.
— Tu n’es pas dégoûté de cette vie-là ?
— Oh ! ce n’est pas les femmes qui m’ont éreinté ; mais, vois-tu, les soupers, les nuits au tripot, la fête.
Le landau les emmenait grand train, sous la pluie, vers Saint-Paulin.
— Alors, reprit Charles, c’est fini, toi ? converti ? garé des voitures ? rentré au bercail ?
Marcelin rougit un peu.
— Si c’était possible ! dit-il.
Le mauvais temps continua.
— Pas drôle, la campagne, fit Charles. Si nous fichions le camp ? Écoute ; j’ai fait la connaissance d’une petite bande de cocottes, tout ce qu’il y a de bonnes et gentilles filles ; et de jolis morceaux, mon cher. Ça fait la fête à domicile ; pas dans les restaurants ; c’est chic et amusant. Rentrons à Paris ; je te présenterai. On en prend une à cinquante louis par mois, et on a toutes les camarades. Pas jalouses, elles, et pas jaloux non plus, les pauvres nous.
— Mon cher, j’ai une passion.
— Quoi ça ?
— Une femme du monde.
— Justement ! ça n’empêche rien… Avec une femme du monde, on a toujours ses nuits disponibles.
Ils passaient le temps au château ; Charles refusait de sortir. Il avait exigé des raffinements dans la cuisine et les vieux vins oubliés dans les caves. Le billard fonctionnait ; et puis, on restait des heures à fumer, dans les fauteuils, d’admirables cigares que Charles avait apportés.
La sympathie manquait entre lui et Henri Courtois ; celui-ci espaça ses visites. Marcelin se laissa aller à la bonne chair et aux bons cigares. Un soir, il confessa à Charles :
— Tu sais, depuis l’été, pas de femmes.
— Et la femme du monde ?
— Rien encore.
Charles resta un instant sans rien dire ; puis, il demanda :
— C’est vieux, cette histoire ?
— Un flirt de cet été à Dieppe.
— Se nomme ?
— Madame Aron-Véber… Gabrielle pour les messieurs.
— Faut pas laisser les choses en train.
— Oh ! ça viendra.
— Nous approchons de l’été de la Saint-Martin. C’est le moment de se réveiller. En route !
— Tu as raison ; on pourrait rentrer à Paris.
Le soir, à dîner, Charles réclama le champagne. Il descendit lui-même aux caves et dénicha un vieux Moet.
— Celui-là est plus vieux que nous, mon cher… Honneur à lui !
Au dessert, on décida de faire les malles le lendemain.
— Heureusement, s’écria Henri, qu’il n’y a au château que la mère Homo pour représenter le beau sexe !
Marcelin ne voulait point partir, toutefois, sans faire une dernière visite dans le pays. La pluie avait cessé ; il monta à cheval dès le matin et ne rentra qu’à midi. Charles venait de se lever.
Après déjeuner, Marcelin sortit de nouveau. Un grand sérieux, une tristesse vague l’avaient pris. Comme il passait près de l’église du village, il s’arrêta, attacha son cheval à un arbre, sur la place, et pénétra dans l’église. Et il restait là, ne songeant à rien, les yeux fixes, dans la solitude et le silence.
Le soir, le dîner fut morne. Charles avait envie de dormir. Marcelin était songeur.
Quand il fut rentré dans sa chambre, soudain le souvenir lui revint d’une heure semblable, il y avait cinq ans, par un soir d’été, quand, prenant sa lampe, il avait voulu voir…
Il ouvrit la fenêtre ; une claire nuit d’automne brillait ; il s’accouda au balcon.
Et il se rappelait comme il était allé, en ce temps-là, silencieux, vers la chambre close, vers le portrait, vers le rêve, vers l’amour…
— Oh ! pensa-t-il, avoir été cette âme-là !…
Et il n’osa achever sa pensée :
— Redevenir cette âme-là !…
Car il sentait qu’il ne pouvait plus lui revenir même la pensée de reprendre sa lampe et de retourner, là-bas, vers la chambre où dormait maintenant ce passé.
On partit le lendemain.
Aussitôt arrivé à Paris, Marcelin alla déposer une carte rue de Châteaudun, chez madame Aron-Véber. Le lendemain, il reçut un petit mot aimable ; il accourut, et le flirt commencé sur la plage de Dieppe reprit de plus belle.
Le gros Aron-Véber, le classique coulissier ventru, abonné à l’Opéra, disait en riant :
— Jeune homme, vous compromettez ma femme.
— Laissez donc cet enfant en paix, répliquait celle-ci.
Dans l’intimité, elle le présentait :
— Mon page !
En madame Aron-Véber, Marcelin voyait le divin assemblage de toutes les séductions ; la beauté parfaite, cela lui semblait évident, mais une beauté un peu étrange de brune très mince, au visage émacié, avec des yeux immenses ; peu loquace ; l’air rêveur qu’il exigeait de la femme ; l’air mélancolique d’un lys penché, lui disait-il ; la peau d’une brune, mais des chevaux roux, sans teinture jurait-elle ; mais avec ces cheveux roux, de larges sourcils noirs, noirs d’encre, d’énormes sourcils au-dessus de ces grands yeux qui n’en finissaient plus. L’origine sémitique apparaissait ; mais Marcelin affirmait qu’elle était l’Orientale et non la Juive, l’Orientale des Arabies fabuleuses et modernes, une Asiatique éclose à Paris, frêle comme une Parisienne, troublante comme une apparition biblique, une Sulamite aux yeux de Primitif italien et qui s’habillait avec des robes conseillées quelquefois par Jacques Blanche.
Il avait fait relier, pour le lui offrir, un curieux exemplaire du Cantique des Cantiques imprimé à Londres sous la direction de William Morris avec des ornementations de style préraphaélite ; la reliure était en soie claire où se dessinaient de grandes fleurs pâles d’après un croquis d’Armand Point.
A Dieppe, elle était très courtisée ; elle laissait faire, distraitement, comme sans intérêt. Marcelin tout de suite l’avait remarquée ; elle parut goûter sa jeunesse, ses bonnes manières et sa discrétion ; elle l’accueillit aimablement ; ils avaient ensemble de longues conversations camarades. Ce fut au concert du Casino, un soir que l’on jouait une sélection du Samson et Dalila de Saint-Saëns, que le flirt se décida. Marcelin était monté aux galeries supérieures généralement désertes. Il y trouva madame Aron-Véber avec sa mère, seules toutes deux, dans un coin ; comme lui, elle était venue là pour mieux écouter cette musique qui la ravissait. Marcelin demanda la permission de s’asseoir à côté d’elle ; il y avait une demi-obscurité ; la maman se prenait à somnoler discrètement, comme elle savait le faire. L’orchestre attaqua le prélude. Madame Aron-Véber regardait vaguement devant elle, dans l’ombre, et restait immobile ainsi que sous un charme. Peu à peu, Marcelin releva les yeux de son côté, et, sans trop s’en rendre compte, il les tenait fixés sur elle.
Qu’elle était belle et divinement rêveuse ! et à travers cette musique délicieusement nuancée d’Orient, il s’imprégnait et s’attendrissait et s’enthousiasmait de l’âme de l’exquise Orientale qui était assise auprès de lui.
Elle lui avoua plus tard qu’elle aimait les gens qui savaient écouter pieusement les belles choses. Ce soir-là, le morceau terminé, sans se parler, d’un accord tacite, ils se levèrent et descendirent ; elle sortit et se dirigea vers la plage ; sa mère suivait ; il marchait à côté d’elle, en silence toujours, et lentement ils parcouraient la terrasse, au bord de la mer.
— Que c’est beau ! murmura-t-elle.
— Oui, c’est bien beau, fit-il à demi-voix.
Elle s’était assise sur une chaise, il s’assit auprès d’elle, il lui prit la main qu’il serra, dans une communion d’admiration et de lyrisme.
Quand ils s’étaient retrouvés, à Paris, deux mois plus tard, Marcelin s’était tout de suite aperçu que ses affaires étaient dans la meilleure voie.
Aussi, ce fut, non plus un flirt discret, mais une cour assidue. Madame Aron-Véber devenait tendre ; ses yeux donnaient de positives espérances. Marcelin faisait d’énormes progrès : chaque jour il s’enhardissait, et chaque jour la victoire paraissait plus probable.
Quelques semaines passèrent.
Un soir enfin, après dîner, dans un coin du salon de la rue de Châteaudun, il obtint la promesse définitive. Les invités étaient allés fumer dans le cabinet du mari ; une amie déchiffrait au piano la valse des Résédas Bleus ; l’atmosphère était aussi languide qu’il était nécessaire… Marcelin, cependant, suppliait à voix basse…
— Vous ne m’aimez pas, Gabrielle, vous ne m’aimez pas, répétait-il.
— Vous savez bien, grand enfant, que je vous aime.
— Alors, quand, quand donc, quand serez-vous à moi ?
Et, comme il restait la tête tout près de ses cheveux, elle avait fini par répondre :
— Eh bien, venez demain, à cinq heures, je serai seule et je serai à vous.
Tout cela avait été très régulier et s’était passé selon les règles établies par les romanciers de l’adultère mondain.
Marcelin rentra chez lui, à minuit, le ravissement au cœur. Il allait et venait dans sa chambre, traversait le salon, s’asseyait, se relevait, l’esprit uniquement occupé de la promesse qui venait de lui être faite, avec le besoin persistant de s’affirmer son bonheur. Il songeait aux longues inutilités de ses désirs, autrefois, et les comparait à son triomphe d’aujourd’hui. En furetant machinalement dans de vieux papiers, il retrouva l’ancien carnet où jadis il notait ses impressions ; il en relut des pages. Les dernières étaient datées d’il y avait presque trois ans ; c’étaient des plaintes au sujet de la trahison d’une certaine Hélène rencontrée à Bruxelles, et des tristesses, des regrets, des espérances…
« … Mon âme, toute de tendresse, mon âme de printemps et aux neuves sèves… »
Et mille choses pareilles.
Il laissa une page blanche, et au verso il écrivit d’un trait :
« O passé ! mélancolique et doux passé d’aspirations et d’attentes ! voici donc que le présent est né et que la femme est venue !
» Pauvre rêveur, tu n’es plus ! tu n’es plus, ô enfant sans sourires, amoureux sans amoureuses, avide de baisers ! voici qu’un homme est à ta place. Car, à cette heure, je n’en puis douter, le bonheur à deux va commencer.
» O joie d’entrer dans la vie ! joie, ô joie de vivre ! »
Il posa la plume, et pensa. Puis, il feuilleta en arrière, et son regard tomba sur des pages beaucoup plus anciennes, des souvenirs de la seizième année, où il était question d’une immortelle fiancée, d’une épouse venue des profondeurs de l’Orient, d’une mystique bien-aimée noire mais belle, apparue un soir nuptial en la Jérusalem du rêve, et pour qui il eût voulu se sacrifier, se renoncer à lui-même et s’immoler.
Et, un peu mélancolique, un peu avec un sourire, il se disait en se couchant que cette adorable madame Aron-Véber ne pouvait guère être celle-là.
Marcelin avait vingt-et-un ans.
Sans qu’il fût laid et bien qu’il fût assez svelte, il n’avait rien de ce qui caractérise un beau garçon ; il était grand, mais trop mince, et ne donnait pas l’impression de la force physique ; les épaules étaient même un peu rondes, et la poitrine étroite ; il n’avait pas la démarche assurée, mais plutôt une certaine élégance un peu frêle ; les mains étaient presque féminines ; la figure et le cou, longs, plutôt maigres. La courte moustache châtain, avec les joues et le menton toujours rasés n’arrivait pas à donner à sa physionomie l’énergie nécessaire à la beauté de l’homme ; la bouche et le nez étaient ordinaires, mais c’étaient les yeux surtout qui manquaient d’éclat : d’un gris bleuté très clair, ils étaient doux, et lors même qu’ils se fixaient sur quelqu’un, ils n’imposaient jamais ce sentiment d’autorité que l’homme accompli doit toujours inspirer. Il n’avait jamais porté les cheveux courts ; et les boucles un peu romantiques qui entouraient son front accompagnaient bien l’expression rêveuse du regard. La voix douce et sans éclats, les gestes retenus, concordaient à lui donner l’air très jeune. En l’appelant son page, madame Aron-Véber avait heureusement défini sa manière. Amoureux, il avait les regards longs et alanguis, craintifs aussi, la voix caressante, respectueuse, l’empressement timide qu’on se plaît à imaginer chez le damoiseau aux pieds de la dame du castel. Et cinq années de Paris avaient à peine fait du damoiseau un jeune homme.
Après la romantique éclosion et la religieuse exaltation de la seizième année, tel il avait été, à dix-sept ans, platonique amoureux de la fille de son ancien professeur, l’esprit plein de rêves roses et bleus, perdant un beau jour ses ignorances virginales dans la plus banale circonstance, puis naïf soupirant épris de la demi-vierge des Andelys, et s’excitant jusqu’à souffrir deux mois de la vulgaire mésaventure de Bruxelles ; à dix-neuf ans, ayant inutilement cherché après l’amour, il avait cherché après le plaisir dans les rues de ce Paris où le baiser s’offre de toutes parts, et, vulgairement, pendant deux ans, il venait de courir les filles de joie, les maîtresses faciles. Et maintenant que fatalement lui arrivaient les maîtresses désirables et les flirts jolis et les fleurs aimables du péché, voilà que le mysticisme de son adolescence recommençait à bouillonner au fond de son âme ; parmi le flux des désirs et des jouissances de la vingt-et-unième année, les aspirations anciennes remontaient, peu à peu ou soudainement…
Dès le réveil, le lendemain, il se sentit nerveux. La matinée était claire et sèche. Il sortit, s’en fut à une conférence, et revint à pied par la place de la Concorde et la Madeleine. L’esprit lourd, il pensait confusément à mille choses vagues autant qu’à la promesse qui lui avait été faite pour l’après-midi. Après déjeuner, ayant fumé hâtivement une cigarette et parcouru les journaux, ne sachant que faire, il passa dans son petit salon ; il s’aperçut qu’il avait près de quatre heures à attendre, et se dit qu’il n’avait pas autre chose à faire que cela, attendre.
Il s’était jeté dans un fauteuil, et considérait le feu, en face de lui, dans la cheminée. L’idée roulait dans son cerveau :
— Enfin, elle va être à moi, tout à l’heure…
Le piano était ouvert ; il se leva, alla s’y asseoir, et, machinalement, plaqua quelques accords.
— Gabrielle, ma merveilleuse Gabrielle ! se disait-il…
Il la voyait telle qu’il aimait à se la représenter, telle, dans sa beauté étrange d’Orientale rêveuse, que la bien-aimée du Cantique des Cantiques ; et, au piano, il improvisait des chants et des accords sur les paroles latines qu’il se rappelait.
— Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem, sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis… Je suis noire, mais belle, ô filles de Jérusalem, ainsi que les tentes de Cedar, ainsi que les pavillons de Salomon…
Ainsi parlait la voix de l’amante, et la voix de l’amant répondait :
— Pulchra es, amica mea, suavis et decora, sicut Jerusalem… Tu es belle, mon amie, suave et noble, ainsi que Jérusalem…
Et la voix reprenait :
— Revertere, Sulamitis, revertere, revertere… Reviens, ô Sulamite, reviens, reviens…
Il chantait, en s’accompagnant de longs accords, et redisait les paroles du livre saint :
— Revertere, revertere… Reviens, ô bien-aimée, reviens…
Il se laissait aller à l’improvisation, mêlant, sous le coup d’émotion qui le prenait, les réminiscences de musiques connues.
Tout à coup, il entendit la pendule sonner deux heures. Il s’arrêta, referma le piano, marcha quelques pas dans la chambre et revint s’asseoir dans un fauteuil.
Il se disait qu’il était beau ce rêve de sa seizième année, lorsqu’un moment il avait cru que la vocation l’appelait vers l’apostolat. L’idée, en ce temps-là, ne s’était-elle pas précisée à ce point qu’il avait pu l’envisager avec toutes ses conséquences pratiques ? Il avait pu songer à entrer dans un séminaire, à prendre la robe du prêtre, peut-être celle du moine… Quelle époque de pur enthousiasme ! Quelle floraison de foi !
Tous les souvenirs anciens lui apparaissaient, comme au dernier automne, lorsqu’il s’était confié à son ami Henri Courtois. Et ils s’auréolaient dans son esprit :
— Que cela a été beau ! que cela a été beau ! répétait-il.
Il ajouta :
— Si cela revenait !
Avec un geste vague, il continua :
— Mais je n’ai plus la foi.
Il se leva en répétant ces mots :
— Mais je n’ai plus la foi.
Et aussitôt il s’amusa, car il souriait presque au discours intérieur qu’il se tenait, il s’amusa à insister sur la question.
— Mais la foi que je n’ai plus, c’est la foi de l’orthodoxie courante ; évidemment, je n’ai pas la foi comme messieurs les vicaires d’à côté l’entendent ; mais est-ce cette foi-là qui, moi, m’intéresse, qui m’a jamais intéressé ?
— C’est curieux, c’est curieux, répétait-il.
Et il reprit tout haut, comme s’il s’adressait à quelqu’un :
— Nous avons, Henri et moi, très bien compris qu’on peut être et rester par la raison un sceptique tout en étant par le sentiment un religieux. C’est l’affaire de la Grâce ; elle souffle ou elle ne souffle pas. Quand elle ne souffle pas, la raison tient la corde ; quand elle souffle, le sentiment reprend le commandement. C’est évident, c’est convenu. Le connaissable et l’inconnaissable. La science et la religion. Nous sommes d’accord.
Il revenait sur les errements jansénistes de son adolescence, et il se complaisait dans la dialectique bien connue. Mais, tout de même, il trouvait une profondeur croissante dans cette idée qu’il se ressassait :
— Oui, sceptique ; je sais que rien de l’au-delà ne peut être atteint ; oui, athée ; je ne crois à rien ; oui, matérialiste, positiviste, idéaliste, si vous le préférez ; incompétent, et tout ce que vous voudrez… Mais ça ne m’empêche pas d’être chrétien, puisque la science s’arrête à l’inconnaissable, puisque la religion se proclame insaisissable à la raison. La raison ? elle reste en son domaine de l’univers ; mais c’est la Grâce, l’aveugle et irrésistible Grâce, qui pourrait me jeter à genoux.
Et il chercha à retrouver le signe de croix de son jansénisme…
— Dieu, je ne sais si le ciel n’est pas vide de toi et si la matière éternelle ne remplit pas l’infini, seule et sans ton aide… Tu as voulu, depuis la Chute, que la nature te voilât à nos esprits.
» Jésus, je me méfie de ton origine divine, et peut-être n’es-tu même qu’une belle légende… Tu as voulu, depuis la Chute Primitive, que ta réalité fût obscurcie à nos raisons.
» Esprit, je soupçonne que tes prophéties et tes miracles sont radotages de vieilles femmes, et j’ai peur que les paroles de ton Église ne soient les rhétoriques d’une école bien stylée… Tu as voulu, de par la Chute, être absurde pour nos sagesses.
» Mais, de par la Rédemption et de par la Grâce, vous voulez, O Père, ô Fils, ô Esprit, que le cœur adore ce que la raison méconnaît… et que — dans l’éternité — il en soit ainsi ! »
Marcelin Desruyssarts sourit encore une fois. Il était, décidément, en veine de dandysme religieux.
— Il serait intéressant de pousser la chose à bout, se dit-il.
Et il continua :
— Que faudrait-il faire pour redevenir chrétien ?
Il réfléchit un moment.
— Sacrifier…
Et, sans achever, il redit trois fois le mot :
— Sacrifier… sacrifier… sacrifier…
Dans un éclair, la vision passa, devant son esprit, du Crucifié offrant sa chair et son âme pour l’exemple du sacrifice.
Son sourire de tout à l’heure avait disparu ; ses yeux étaient devenus graves, ses regards lents. Le logicien qui erre dans les dialectiques, même sur les matières qui le touchent le plus puissamment, peut avoir le sourire des analyses un peu subtiles ; mais, revenant aux bases du sentiment humain, l’émotion remontait, grandissait.
Tout à l’heure il songeait aux magnifiques aspirations de son adolescence, et il arrivait maintenant à la vision d’un avenir possible et lumineux.
— Le sacrifice ! comme cela est poignant, le sacrifice !
A seize ans, la vie s’ouvrait pure, claire et toute droite ; il n’aurait eu qu’à marcher vêtu de blanc dans la voie de l’apostolat. Mais, aujourd’hui, la route était obstruée ; avant le départ, il y avait la hache et l’incendie à porter de tous côtés ; et quelle rupture avec le monde ! quel arrachement du désir ! oh ! le fer et le feu dans les plaies, et puis, quelle pénitence pour tant de souillure ! quelles expiations ! Et il s’exaltait à l’idée d’un tel effort.
— Briser la vie charnelle… entrer dans la vie ascétique…
Peu à peu, il se plaisait au détail de ce qu’il aurait à faire.
— Dès tout de suite, il faudrait commencer le sacrifice… oui… tout de suite.
L’idée lui venait, en toute évidence, qu’il fallait qu’à l’instant même il renonçât à madame Aron-Véber. Il s’écria :
— Ce serait rudement chic, un effort comme celui-là !
Aussitôt, il s’apparut à ses propres yeux comme un héros et un martyr ; il se vit foulant aux pieds son bonheur, accomplissant sur lui-même la conquête la plus difficile, réalisant la suprême énergie et se haussant aux plus nobles victoires. Tout ce qu’il avait de romantismes s’émut et s’enthousiasma. Et, tout haut, il prononça :
— Je le ferai.
La pénitence et les plus dures expiations, qu’était-ce, cela ? Le sacrifice de son désir, le renoncement à soi-même seul comptait dans la religion. Éblouissant comme la neige au soleil, le dilemme apparaissait : d’un côté, vivre conformément à la nature ; de l’autre côté, résister à l’instinct, s’opposer à la nature. La religion, n’était-ce pas l’immolation de la chair et de l’esprit ? et ne trouvait-il pas la joie suprême dans ce renoncement ?
Il resta quelques instants stupéfait de la conclusion où il arrivait.
— Est-ce sérieux ? se demandait-il.
Mais l’exaltation de l’effort, la fierté du sacrifice chantaient de plus en plus fort en son esprit, et, rapidement, il s’en grisait.
— C’est la Grâce, s’écria-t-il, et, tombant à genoux contre un fauteuil, il se prit le visage entre les mains, et des larmes lui humectaient les paupières.
Quand il se releva, il se jugea plus maître de lui-même ; il se promenait dans la chambre, se parlant intérieurement :
— Ce n’est pas en vain que tant de signes se sont manifestés pour me consacrer à la vie religieuse et que j’eus une enfance si pieuse ; les enthousiasmes romantiques de mon adolescence, qu’étaient-ils, sinon des déviations du sentiment religieux ? Pouvais-je échapper à la vocation ?
» Quelle vie horrible j’ai menée ces dernières années ! quel écœurement m’en reste ! quelle lassitude ! Recommencer, continuer, se ruer après une impossible satisfaction, désirer sans fin, sans trêve, sans repos ?
» O Seigneur ! Seigneur ! soutenez-moi. Si vous voulez que j’immole mon désir, inspirez-moi une force secourable. »
Se reprenant de nouveau, il dit :
— Voici ce que je dois faire : renoncer aujourd’hui à cette femme. Que ce soit le gage de mon changement de vie.
Il était redevenu plus calme. Il se déclara à lui-même qu’il n’irait pas rue de Châteaudun. La résolution prise, un nouvel apaisement se fit, et, allant et venant toujours dans la chambre, il méditait sur son cas.
— La vie que j’ai menée ces dernières années est indigne d’un homme. Que d’autres y trouvent leur joie ! je ne suis pas né, ô mon Dieu, pour faire le but de ma vie d’être l’amant de madame Aron-Véber.
Il se rappela le pastel où sa mère était représentée et qu’il avait aimé…
— Celle qui s’était donnée pour mettre l’enfant au monde !
— Quel exemple encore ! songea-t-il, et comme elle m’a enseigné ce que c’est que l’amour !
Tout à coup, sa pensée revenant à la tentation, une série de scrupules le prirent :
— Mais il faut écrire…
— Pourquoi des ménagements ?…
— Je ne suis pourtant pas obligé de me conduire comme un rustre…
— Je ne suis pas non plus obligé de m’excuser pour faire ce qu’il est de mon devoir de faire…
Il demeura incertain. La question se tournait et se retournait dans son esprit, et, peu à peu, il perdait toute faculté de raisonnement, comme si ses sens s’obscurcissaient… L’idée générale sombrait ; le détail, le petit fait, la vétille envahissait…
— Faut-il lui écrire ?… ne pas lui écrire ?…
Machinalement il se rassit devant le piano, où il plaqua quelques accords. Il était affalé. Une paresse l’avait pris, comme une fatigue, après l’effort de tout à l’heure.
La pendule sonna quatre heures… il était temps de se préparer…
Il eut un ressaut d’énergie ; il chassait l’idée ; mais il hésitait.
— Soit ! se dit-il, je vais sortir ; j’ai besoin de marcher, de prendre l’air ; cela me fera du bien.
Il passa dans son cabinet de toilette, mit une jaquette, un pardessus, chercha un chapeau ; il regarda dehors ; le temps restait beau ; il prit une canne ; d’un coup d’œil il vérifia sa toilette, ouvrit la porte, et sortit.
— J’ai besoin de prendre l’air, j’ai besoin de prendre l’air, se disait-il.
Il descendit le boulevard Malesherbes ; il tournait le dos à la rue de Châteaudun. Il allait en rêvassant, et, à certains instants, par sursauts, il se ressaisissait :
— Il faut être fort. C’est le gage que je dois me donner à moi-même.
Près de la Madeleine, il se laissa distraire par un encombrement de voitures, un cheval d’omnibus tombé, un rassemblement, les jurons du cocher, l’empressement bruyant du conducteur. Et il prit les boulevards, remontant du côté de l’Opéra.
Il pensa à aller voir Henri Courtois, rue Gay-Lussac.
— Cinq heures moins un quart ; il n’est pas chez lui.
Un instant, il s’arrêta :
— Et quand je me serai donné ce gage, qu’est-ce que je ferai ?
Il se rappela le dilemme fatal ; deux genres de vie : l’une, la vie selon l’instinct, la vie de l’égoïsme, la vie selon Satan ; l’autre, la vie du sacrifice et de la charité, la vie chrétienne ; l’égoïsme, noble ou vil, généreux ou vulgaire, pour le plus grand développement de soi-même ; et l’amour, mais l’amour suivant la définition de Jésus, et qui est le dévouement à quelque rêve de bonté.
— Le péché ou l’amour, songeait-il…
Puis, peu à peu, les termes de la question s’ennuageaient ; il se répétait des mots dont le sens de plus en plus s’enveloppait dans un brouillard ; et, maintenant, il allait, presque sans pensée, dans un grouillement d’idées confuses.
Il remontait la Chaussée d’Antin.
— Je ne vais pourtant pas rue de Châteaudun ! s’écria-t-il en s’arrêtant tout d’un coup. O mère, ô Vierge divine, s’il est vrai que je doive revenir au mieux, aidez-moi, soutenez-moi, sauvez-moi !
Le cœur lui battait à grands coups dans la poitrine. L’émotion d’il y avait une heure lui était revenue soudainement ; une bouffée de sang lui montait au visage. Devant lui, il regardait les deux clochers de l’église de la Trinité, l’image de madame Aron-Véber voletait dans son esprit, avec ses yeux profonds, ses sourcils noirs, ses cheveux roux, son sourire ; la croix qui surmontait le portail de la Trinité lui sembla vaciller dans l’espace ; les bruits de la rue bourdonnaient à ses oreilles.
— Zut ! s’écria-t-il… c’est trop bête !
Et cinq minutes plus tard, il sonnait à l’appartement de la rue de Châteaudun.
Il était venu d’un trait ; comme il attendait, un peu essoufflé, le cerveau vide, la porte s’ouvrit ; une femme de chambre parut.
— Madame Aron-Véber est chez elle ?
La femme de chambre prit un air mystérieux.
— Madame vient de sortir. Je crois que madame vient d’envoyer un télégramme à monsieur.
Marcelin était atterré. Il redescendit l’escalier, sans pensée, bouleversé.
En dix minutes il fut chez lui. Il y avait en effet un télégramme.
« Impossible de vous recevoir aujourd’hui… Vous expliquerai… Venez demain. »
Marcelin avait reçu un coup de massue.
— C’est bien fait, se dit-il. Voilà le châtiment de ma lâcheté. Je suis puni.
Un moment, il essaya de se consoler.
— J’aime mieux cela. C’était trop précipité. A présent, j’aurai le temps de réfléchir, de peser ma décision, de savoir ce que je veux, et de vouloir…
Mais un énorme découragement était en lui.
— Renoncer ?… je suis trop faible.
Il suivait les rues au hasard. Il se força à prendre le chemin de Notre-Dame, à y entrer, à essayer de prier. Mais un « A quoi bon ? » incessant l’obsédait.
— A quoi bon ? je suis trop faible.
Et, comme il sortait :
— Fichu le camp, la Grâce ! se dit-il.
L’idée lui vint d’aller passer une demi-heure dans l’hospitalière maison où jadis Georgette et Mignon avaient fait ses délices.
Quelques jours plus tard, il parlait vaguement à Henri du service militaire qui menaçait ; puis, tout à coup, s’interrompant, il lui contait sa dernière aventure.
— Et comment la comédie s’est-elle terminée ? lui demanda celui-ci.
— Eh bien, le lendemain je suis retourné chez madame Aron-Véber ; elle était là ; et… tout a été consommé…
— Piètre dénouement !
— Que veux-tu ?… Pas la taille d’un ascète, encore que bien dégoûté d’être un jouisseur… Comme les autres, tout simplement, un pauvre bougre qui vit la vie.
Saint-Amand (Cher). — Imprimerie R. Bussière.