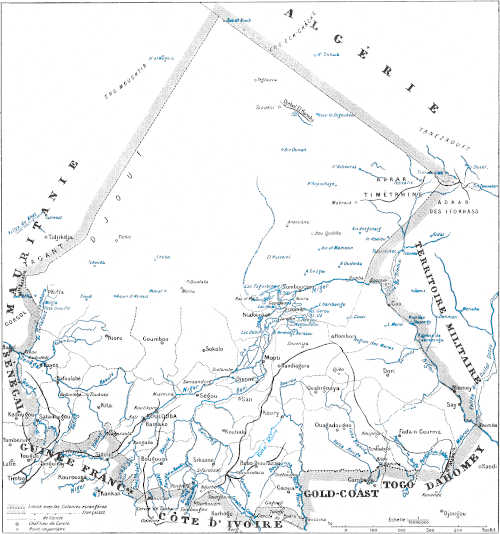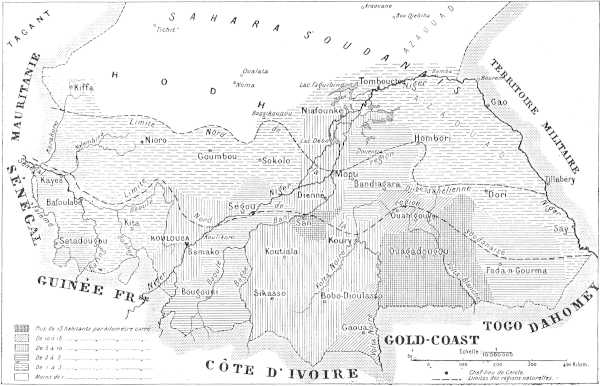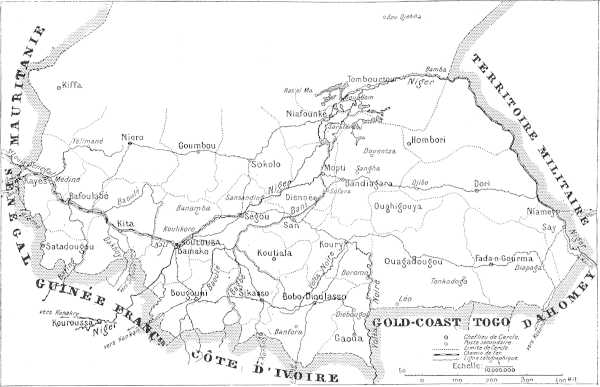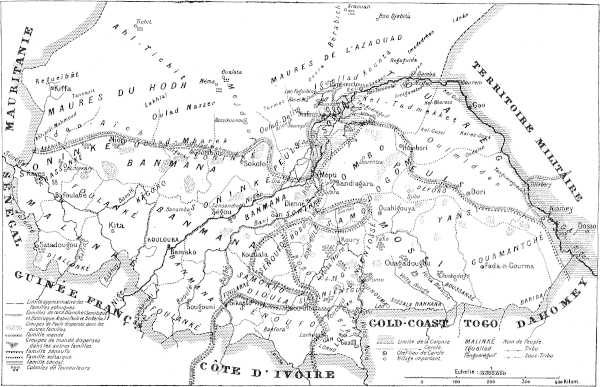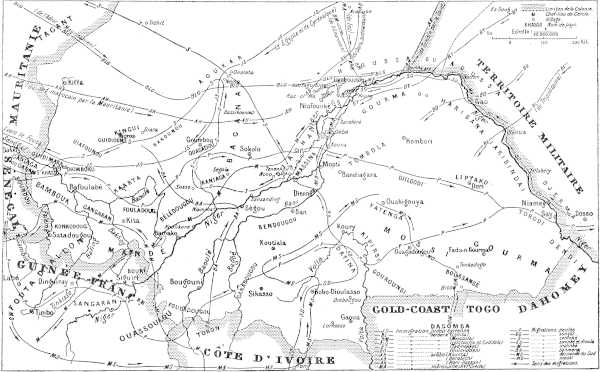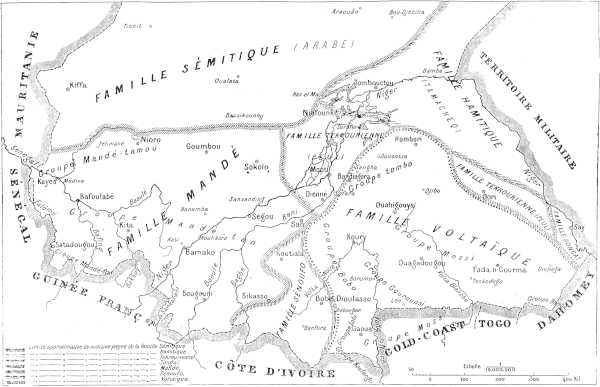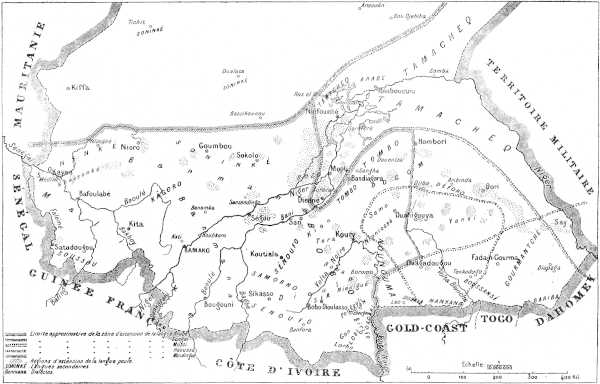On peut cliquer sur les cartes pour les agrandir.
Tome
II — Tome
III
Matières — Cartes
— Illustrations
— Index
Haut-Sénégal-Niger
(Soudan Français)
![[Décoration]](images/decor1.jpg)
PREMIÈRE SÉRIE
Tome I
SOUS PRESSE :
DEUXIÈME
SÉRIE
Géographie
économique
(Voies de communication. — Faune sauvage. — Productions forestières. — Productions agricoles. — Elevage des bovidés et des ovidés. — Elevage des équidés. — Industries indigènes. — La question des mines d’or. — Commerce intérieur. — Commerce extérieur. — La politique économique à suivre).
Par Jacques MENIAUD
Ouvrage illustré de nombreuses photographies et de cartes documentaires
![[Décoration]](images/decor2.jpg)
EN PRÉPARATION :
TROISIÈME
SÉRIE
Le Territoire militaire du
Niger
Par Jules BRÉVIÉ
Haut-Sénégal-Niger
(Soudan Français)
Séries d’études publiées sous la
direction
de M. le Gouverneur CLOZEL
![[Décoration]](images/decor3.jpg)
PREMIÈRE SÉRIE
Le Pays, les Peuples, les
Langues,
l’Histoire, les Civilisations
PAR
Maurice DELAFOSSE
Administrateur de
1re classe des Colonies
Chargé de cours à l’École Coloniale et à l’École des Langues
Orientales
Préface de M. le Gouverneur CLOZEL
![[Décoration]](images/decor4.jpg)
80 illustrations photographiques, 22
cartes dont une carte d’ensemble au 1 : 5.000.000.
Bibliographie et Index
![[Décoration]](images/decor4.jpg)
Tome I
Le Pays, les Peuples, les
Langues
![[Décoration]](images/logo.jpg)
PARIS
ÉMILE LAROSE,
LIBRAIRE-ÉDITEUR
11, Rue Victor-Cousin, 11
1912
AVIS AU LECTEUR
Durant l’impression du présent ouvrage, quelques modifications ont été apportées dans l’extension territoriale et l’organisation administrative de la colonie du Haut-Sénégal-Niger : un arrêté du Gouverneur général de l’A. O. F., en date du 21 juin 1911, a distrait le cercle de Gao du Territoire militaire et l’a rattaché à la colonie proprement dite du Haut-Sénégal-Niger ; un décret du 7 septembre 1911 a placé le Territoire militaire du Niger, ainsi amputé du cercle de Gao, sous le commandement direct du Gouverneur général de l’A. O. F. ; enfin, pour des raisons d’hygiène, le chef-lieu du cercle de Koury a été transféré à Dédougou, à quelque distance au sud de Koury et sur la rive droite de la Volta Noire.
Il doit être bien entendu que les limites territoriales et les statistiques relatives à la population données dans le cours de ce volume s’appliquent au territoire de la colonie tel qu’il était constitué avant l’arrêté du 21 juin 1911.
ERRATA DU PREMIER VOLUME
- Page 135, ligne 2, au lieu de : Baoulo, lire : Gaoulo.
- Page 189, note 111, ligne 2, au lieu de : Makhfar, lire : Maghfar.
- Page 395, ligne 30, au lieu de : pas d’adjectifs, lire : peu d’adjectifs.
- Page 414, ligne 4, au lieu de : mba, lire : ba.
| Delafosse | Planche I |

Cliché Manuel
Fig. 1. — M. Clozel, Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger.
[1]PRÉFACE
Lorsque j’ai pris possession du Gouvernement du Haut-Sénégal-Niger au mois de mai 1908, parmi les documents que j’ai eu à consulter pour étudier la Colonie nouvelle dont j’étais chargé, figuraient des monographies de cercles établies par ordre de mon prédécesseur en 1903. Ces travaux, généralement intéressants, ne correspondaient cependant plus à la réalité ; les documents de ce genre vieillissent vite dans une colonie aussi jeune et aussi vivante que le Soudan. De là le projet de reprendre l’idée de mon prédécesseur et d’obtenir une situation du Haut-Sénégal-Niger en 1909 ; je la complétais par une enquête analogue à celle que j’avais entreprise à la Côte d’Ivoire en 1901 sur le droit coutumier des Indigènes. On trouvera plus loin les deux questionnaires qui ont servi de base et de cadre à cette consultation.
Il convient tout d’abord de rendre justice à l’empressement et à la conscience, qu’à la presque unanimité, les commandants de Cercle, civils ou militaires, mirent à répondre au double questionnaire qui leur avait été adressé. Je suis heureux de pouvoir les en remercier une fois encore.
En possession de cette masse vraiment considérable de documents de valeur un peu inégale, mais presque toujours intéressants, il m’apparut qu’il y avait mieux à faire que les garder dans nos archives pour les consulter en cas de besoin.
Mais il ne fallait pas songer à une publication intégrale de tous ces rapports ; par leur nature même, leur juxtaposition eût abouti à une quantité de redites de double emploi, dans lesquelles le lecteur perdu et lassé aurait eu grand peine à trouver les renseignements essentiels et d’où il n’aurait pu dégager ni[2] vues d’ensemble ni appréciations nettes. Un travail de refonte et de coordination s’imposait donc.
Après avoir adopté le cadre qui me paraissait le plus convenable pour y faire entrer le tableau complet de notre Soudan, il restait à trouver des hommes joignant, au talent d’exposition nécessaire à cette tâche, une connaissance assez approfondie du pays et de ses habitants pour corriger les erreurs de détail, situer exactement les faits historiques, économiques, géographiques qui constituent la vie de peuples nombreux, en dégager les données générales et les caractéristiques essentielles.
M. Delafosse, ses nombreux travaux antérieurs l’attestent, est de tous les Français, celui qui connaît le mieux les langues, les traditions, les coutumes et les mœurs des Indigènes de l’Afrique Occidentale. Si sa forte culture générale et ses études antérieures l’avaient mieux que beaucoup d’autres préparé à apprendre, ce n’est pas seulement dans les livres, mais par seize ans de vie africaine, en contact permanent avec les hommes et la nature, qu’il a acquis son érudition.
L’Adjoint à l’Intendance Méniaud accomplit son troisième séjour au Soudan ; il en a dirigé les finances et en a soigneusement étudié les besoins et les ressources. Préparé par la haute culture que donne l’Ecole Polytechnique et par les études spéciales que nécessitait son admission dans l’Intendance, il a de plus, au cours de nombreuses missions, parcouru la Colonie entière du Sénégal au lac Tchad. Partout il a examiné sur place les produits du sol, les ressources de toutes natures, les moyens de transport, la vie économique du pays dans ses détails et dans son ensemble.
M. Brévié est au Soudan depuis sa sortie de l’Ecole Coloniale ; après s’être initié à la vie et à l’administration du pays en servant dans les cercles les plus divers, il est depuis bientôt cinq ans placé à la tête du bureau politique du Gouvernement. Il y a fait preuve d’un talent d’exposition et de qualités que jusqu’à ce jour ses chefs hiérarchiques ont pu seuls apprécier et il y a surtout acquis les connaissances les plus complètes sur la vie politique et administrative de la Colonie.
C’est à ces trois collaborateurs que reviendra tout le mérite[3] de l’œuvre ; je ne réclame, en cas de succès, que celui de les avoir choisis.
*
* *
La tâche était en effet assez vaste et assez complexe pour dépasser la compétence d’un seul. A la différence de la plupart des Colonies africaines, dont le passé, aussi vierge que leurs forêts, se réduit à l’historique de l’effort des Explorateurs Européens pour les pénétrer, le Soudan a une histoire. Histoire peu connue, imparfaitement documentée, mais réelle, et susceptible de prendre forme et de récompenser le labeur de celui qui en débrouillera les obscurités et les incertitudes.
Aux temps de la Grèce, de Carthage, des anciennes dynasties Egyptiennes, le Soudan est en relations commerciales avec la Méditerranée, berceau des civilisations antiques. Ces caravanes d’autrefois avaient à traverser un Sahara très probablement moins stérile et moins inhospitalier que celui d’à présent.
Le Soudan a été effleuré par la conquête arabe ; de ses confins mystérieux sont sortis les Almoravides qui ont conquis le Maghreb et l’Espagne ; il a vu se fonder et disparaître de grands empires noirs ; des armées marocaines ont envahi et dominé pendant plus d’un siècle certaines de ses provinces. Enfin le récit de la conquête française commencée en 1880, terminée d’hier, reste encore à faire. Il a manqué à cette épopée, mal connue et mal jugée parce que trop près de nous, son Bernal Diaz et son Heredia.
On y admirerait tout d’abord la continuité des desseins et de l’effort, depuis les plans lointains tracés avec une si remarquable prévision par les Bouët-Willaumez et les Faidherbe, jusqu’à la série ininterrompue des expéditions militaires commencées par les Brière de l’Isle et les Borgnis-Desbordes, continuées par Frey, Galliéni, Humbert, Archinard, Combe, Audéoud, de Trentinian, Gouraud... j’en passe et des meilleurs.
On y verrait les entreprises de la témérité la plus folle, conduites avec la plus froide intrépidité, justifier par leur succès les théories philosophiques les plus osées sur la force de la volonté. Le Général Combe dans les campagnes contre Samory,[4] le Général Archinard à Nioro, Ouossébougou et Dienné, le Général Audéoud à Sikasso ont renouvelé les exploits des Cortez et des Pizarre, ceux plus récents d’autres Français, Francis Garnier et ses quelques compagnons lors de la première conquête du Tonkin.
A côté des chefs et des combats les plus connus, que d’héroïsmes obscurs, que de fatigues et de souffrances : le climat, les fièvres, les privations, l’ennui des lointains exils, l’inaction déprimante pendant les saisons mauvaises ! La douleur paraît inséparable de tout enfantement humain ; ainsi se justifie une fois encore le vers du poète :
... Tantæ mollis erat romanam condere gentem.
De tous ces périls, les plus allègrement affrontés ont toujours été ceux des combats. Il semble que la guerre possède une vertu propre et singulière, au moins au point de vue esthétique et moral, puisque des hommes que j’ai connus d’ailleurs assez ordinaires, vulgaires parfois, nos simples soldats noirs eux-mêmes, lorsqu’ils succombent les armes à la main, savent mourir en beauté, avec une noblesse stoïque, une pureté d’attitude toutes classiques.
*
* *
Parmi ces soldats, beaucoup furent des organisateurs et des administrateurs excellents. La Colonie se meut encore dans les cadres administratifs tracés par les Généraux Archinard et de Trentinian. Il serait injuste cependant d’oublier le Gouverneur Grodet, dont les circulaires et instructions, en matière financière surtout, n’ont rien perdu de leur valeur. Les polémiques, aujourd’hui oubliées, auxquelles avait donné lieu son passage au Gouvernement du Soudan ont fait trop négliger cette partie solide et inattaquable de son œuvre.
De 1900 à 1908, mon prédécesseur immédiat, le Gouverneur Général Ponty, a travaillé avec l’esprit le plus averti, le sens pratique le plus juste, au développement de la jeune Colonie. De l’ensemble de son œuvre deux faits se détachent avec un relief tout particulier et perpétueront longtemps encore le souvenir[5] de son Gouvernement : la libération des captifs et la création du centre administratif de Koulouba.
Si tout le monde était d’accord pour la répression énergique de la traite, la suppression immédiate de la captivité faisait hésiter les meilleurs esprits. Toutes les sociétés indigènes dans toutes les Colonies du groupe admettaient l’esclavage ; son existence se trouvait ainsi intimement liée à la vie économique et sociale du pays tout entier. La suppression brusque d’un rouage aussi essentiel de l’existence de nos sujets païens ou musulmans pouvait à bon droit passer pour un saut dans l’inconnu comportant les plus fâcheuses conséquences pour la tranquillité et pour la prospérité de nos Colonies. On pouvait se trouver d’autant plus encouragé à procéder progressivement que la question d’humanité ne se posait généralement pas comme on le croyait en France. C’était en effet une grossière erreur que d’envisager la captivité africaine à travers les souvenirs du roman de Mrs Beecher Stowe. Les malheurs du vertueux oncle Tom n’avaient rien de commun avec la vie des captifs africains en Afrique. Celle-ci n’était vraiment pas très dure et leur condition n’était en général pas beaucoup plus pénible que celle des hommes libres. La traite rigoureusement supprimée, il paraissait plus sage de laisser agir le temps en procédant à des libérations partielles toutes les fois qu’un incident quelconque les aurait motivées.
Le Gouverneur Ponty eut le mérite de n’admettre aucun de ces atermoiements. Dès que le Gouverneur Général Roume eut décidé la suppression complète et absolue de l’esclavage, il y procéda résolument. Et non seulement les troubles soulevés par cette libération de plus de 300.000 captifs en moins de deux ans ont été tout à fait insignifiants, mais encore la prospérité du pays s’en est trouvée accrue. Les anciens maîtres, dépossédés de leurs esclaves, se sont mis eux-mêmes au travail, et les captifs libérés en ont fait autant de leur côté, et, sûrs de conserver désormais tout le fruit de leur labeur, ils ont déployé une activité beaucoup plus grande que par le passé. Ce succès d’une mesure si discutée et si discutable fait le plus grand honneur à M. le Gouverneur Général Ponty.
[6]L’idée d’installer le chef-lieu de la Colonie à Koulouba appartient à M. le Général de Trentinian. Cet homme d’un esprit si vif et si clairvoyant a eu assez souvent, pendant son passage au Gouvernement du Soudan, le tort d’avoir raison quelques années trop tôt. Beaucoup de ses projets repris par ses successeurs ont abouti ou sont en train d’aboutir actuellement ; d’autres attendent encore une réalisation qu’ils trouveront, sans doute, dans un avenir plus ou moins rapproché.
Il était évident pour le Général de Trentinian et pour quiconque voulait bien se donner la peine d’étudier une carte du Soudan Français que Kayes, base d’opérations obligée lors de la conquête, ville du transit et port de la Colonie sur le Sénégal, était beaucoup trop excentrique pour en rester la capitale politique. La température y est en outre particulièrement chaude et pénible pendant presque toute l’année. Le haut Sénégal, dont Kayes et Médine sont les villes principales, est de plus un assez pauvre pays : des chaînes de collines rocheuses et stériles, des plateaux de latérite ne laissent de terres vraiment fertiles que dans les vallées assez étroites arrosées par les divers cours d’eau qui forment le bassin supérieur du Sénégal. La population n’y est ni très dense ni très riche. Enfin le décret du 17 octobre 1899 qui rattachait à la Colonie du Sénégal le cercle de Bakel, à la Guinée les cercles du Haut-Niger les plus rapprochés de Kayes, accentuait encore la position excentrique de cette ville et reportait plus évidemment sur le Niger moyen l’axe de la Colonie.
Le climat de la vallée du Niger beaucoup moins pénible pour les Européens que celui du Haut-Sénégal, le fleuve lui-même, voie d’accès naturelle vers Tombouctou et Niamey à laquelle venaient aboutir toutes les routes terrestres de l’immense plateau encerclé par la boucle du Niger, tout militait en faveur d’un transfert du chef-lieu. Le Général de Trentinian ébaucha le mouvement en installant sur les collines de Kati à 12 kilomètres de Bamako la portion principale des troupes. Déjà il indiquait comme emplacement de la capitale future le plateau de Koulouba (point « F »), qui domine de 161 mètres la plaine où sont construits le village et le poste de Bamako. Sur un plateau[7] voisin d’une altitude un peu supérieure (point « G »), devait s’élever l’hôpital central de la Colonie. Avant de quitter le Soudan, le Général faisait bâtir à Koulouba une petite maison, modeste jalon de la cité future.
En 1903, le Gouverneur Général Roume, se rendant à Tombouctou, visitait le point F et le point G ; séduit par la vue admirable que l’on avait du haut de ces plateaux rocheux, véritables falaises qui dominent le fleuve et la vallée du Niger, appréciant les avantages multiples qu’ils présentaient au point de vue de l’aération et de la salubrité, il sanctionnait de sa haute autorité les projets du Général de Trentinian. Libre d’agir, le Gouverneur Ponty, secondé par le Commandant Digue et le capitaine Lepoivre du corps du Génie, se mit immédiatement à l’œuvre. En moins de cinq ans il faisait édifier à Koulouba la plus belle et la plus réussie des capitales coloniales que l’on puisse trouver en Afrique Occidentale, aussi bien dans les Colonies étrangères, anglaises ou allemandes, que dans les Colonies françaises.
Arrivé à Kayes le 10 mai 1908 lorsque les travaux étaient à peu près terminés, j’y transportais dix jours après le siège du Gouvernement.
L’hôpital du point G est en construction depuis l’an dernier et pourra sans doute fonctionner dès les premiers jours de 1912.
Des machines élévatoires et des conduites d’eau pourvoient sur ces deux points à toutes les nécessités de l’hygiène et du confort modernes ; Bamako-Koulouba et l’hôpital seront l’année prochaine éclairés à la lumière électrique. A Koulouba s’élèvent le Gouvernement, l’hôtel du Secrétaire Général, trois grands bâtiments affectés au Trésor, aux Archives et aux divers bureaux. Toutes ces constructions, d’un style hispano-mauresque un peu lourd mais admirablement approprié au climat, constituent un ensemble qui ne manque ni d’harmonie ni d’une certaine majesté. Vingt-cinq maisons, plus petites mais toutes bien aérées et pourvues de larges vérandahs, abritent l’imprimerie du Gouvernement et les fonctionnaires employés à l’administration centrale de la Colonie. C’est à Koulouba également que sont installés le chef du service des Travaux Publics avec ses[8] bureaux, le directeur de l’Agriculture et le chef du Service Zootechnique.
A Bamako sont venus s’établir, dans les bâtiments construits depuis 1909, la direction du chemin de fer de Kayes au Niger, une justice de paix à compétence étendue, le service des Domaines, la direction des Postes et Télégraphes. Les deux villes, distantes de 1.500 mètres à vol d’oiseau, de 5 kilomètres par la route carrossable qui relie Bamako dans la plaine à Koulouba sur la montagne, sont destinées à se réunir dans un avenir assez rapproché, probablement lorsque le railway Thiès-Kayes achevé aura donné au Haut-Sénégal-Niger le débouché sûr et permanent sur la mer qui a manqué jusqu’à ce jour à son développement économique.
L’organisation centrale qui fonctionne à Koulouba depuis deux ans est, ainsi que je l’ai dit, encore celle créée par les Généraux Archinard et de Trentinian. L’arrêté local du 19 juin 1908 dont on trouvera plus loin le texte a uniquement pour but de préciser et de mettre au point les attributions de chacun.
Le Gouverneur, assisté de son Cabinet et de son bureau militaire, a sous sa direction immédiate les quatre bureaux du Gouvernement : Affaires Politiques, Affaires Economiques, Finances et Matériel. Le Secrétaire Général a dans ses attributions particulières le service de ces deux derniers bureaux ; c’est lui qui présente leur travail à la signature du Gouverneur, tandis que les chefs des premier et deuxième bureaux rapportent directement les affaires qui leur sont confiées. C’est là le travail quotidien. De plus les chefs des services techniques : Chemin de fer de Kayes au Niger et Navigation, Travaux Publics, Postes et Télégraphes, Agriculture etc., ont, chaque semaine, leur jour de conférence avec le chef de la Colonie.
9.000 kilomètres de lignes télégraphiques mettent le chef-lieu en communication avec les vingt-neuf cercles de la Colonie. Ce sont : Kayes, Bafoulabé, Kita, Bamako, Nioro, Goumbou, Sokolo, la résidence de Kiffa, Satadougou, Bougouni, Sikasso, Bobo-Dioulasso, Gaoua, Ségou, Koutiala, San, Dienné, Mopti, l’Issa-Ber ou Niafounké, Bandiagara, Ouahigouya, Koury, Ouagadougou ou le Mossi, Dori, Fada-N’Gourma ; auxquels, depuis[9] le 1er janvier 1911, sont venus s’ajouter l’ancienne région de Tombouctou et les pays de la rive droite du Niger détachés du Territoire Militaire pour être placés sous les ordres directs du Gouverneur, avec toutefois une organisation spéciale (arrêtés du 22 juin 1910) que comportent encore les circonstances et formant les cercles de Tombouctou-sédentaires et de Tombouctou-nomades, du Gourma et de Say.
Le Territoire Militaire, avec son budget spécial et son autonomie relative, s’étend désormais du Niger au lac Tchad et comprend une marche semi-saharienne longue d’environ 1.500 kilomètres et servant de trait d’union entre l’Afrique Equatoriale et l’Afrique Occidentale françaises. A cette même date du 1er janvier 1911 le chef-lieu en a été transporté de Niamey à Zinder, à peu près à son centre géographique, d’où le Colonel Commandant le territoire peut exercer une action plus efficace sur les sept cercles qui relèvent de son autorité : Gao, Niamey, Madaoua, Zinder, N’Guigmi, Agadez, Bilma. Une ligne télégraphique de 800 kilomètres relie déjà Niamey à Zinder et se raccorde par Tombouctou-Gao et par Dori au réseau général de la Colonie. En 1911 elle sera continuée jusqu’à N’Guigmi, et, après entente avec le Gouverneur Général de l’Afrique Equatoriale Française, prolongée jusqu’à Mao, le poste le plus voisin de la Colonie congolaise.
De par sa situation semi-désertique, ses obligations militaires de protection contre les nomades sahariens, les prix de transport considérables qui grèvent son administration, le Territoire Militaire du Niger ne peut vivre et s’organiser avec les 1.200.000 francs environ que lui rapportent ses taxes locales. Une subvention variable (elle est de 300.000 francs en 1911), allouée par le budget du Haut-Sénégal-Niger, vient chaque année suppléer à l’insuffisance de ses ressources. Le Gouverneur de la Colonie dirige et contrôle l’administration du Territoire Militaire et y exerce son autorité par l’intermédiaire du Colonel Commandant.
Telle est dans son ensemble l’organisation qui permet, avec à peine 500 officiers ou fonctionnaires français et une force armée d’environ 4.500 noirs tout compris, troupes régulières,[10] milices et gardes-cercles, de faire régner l’ordre et la sécurité parmi 5.000.000 d’indigènes épars sur un territoire qui, de la Falémé au Tchad, mesure plus de 2.800 kilomètres et qui, du Nord au Sud, en y comprenant la zone saharienne dont la police nous incombe, en a rarement moins de 1.300. Nous y percevons, en additionnant les trois budgets qui fonctionnent dans la Colonie, budget local, budget annexe du Territoire Militaire, budget annexe du chemin de fer, près de 12 millions de revenus, sans parler des recettes douanières qui appartiennent au budget général.
Nous assurons, en dehors du maintien de l’ordre, condition nécessaire de tout progrès, l’exécution des travaux utiles au développement économique du pays, l’assistance médicale aux indigènes, la diffusion de l’instruction parmi les populations primitives dont la tutelle nous est confiée.
On admettra, si l’on envisage l’étendue et la multiplicité de la tâche, que nous n’abusons pas du fonctionnarisme ; encore serait-il possible d’alléger sensiblement les effectifs employés au chef-lieu, si les bureaux de Dakar et de Paris, conformant un peu plus leurs actes aux beaux discours que l’on prononce périodiquement en France sur la décentralisation, voulaient bien faire leur tutelle moins étroite et exiger par suite un peu moins de papiers qui ne sont pas tous d’une utilité évidente. Mon expérience de Gouverneur Colonial n’est pas très vieille, mais elle me permet de constater que le nombre de rapports, de pièces comptables et de documents de toutes natures à fournir au Gouvernement Général ou au Ministère a triplé depuis moins de dix ans. Si le développement rapide de nos jeunes colonies d’Afrique peut dans une certaine mesure justifier partie de cet accroissement, il ne saurait être invoqué pour la totalité. Il est à craindre même que cet excès de sollicitude ne paralyse à la longue les progrès de nos possessions africaines ; il a déjà pour résultat de retarder de une ou plusieurs années la solution de nombre d’affaires, l’exécution de nombreux travaux, sans que les avantages de ce contrôle inquiet apparaissent bien clairement dans la plupart des cas. Mais ce[11] n’est point ici la place d’étudier les réformes à apporter à notre administration coloniale.
*
* *
La deuxième série de cette publication, consacrée à la situation économique de la Colonie, démontrera, je l’espère, que l’héroïsme de nos soldats, le labeur de nos fonctionnaires, l’effort de nos commerçants, n’ont pas été prodigués à une œuvre vaine.
Le Soudan Français n’est certes point un Eldorado, s’il est encore des Eldorado de par le monde. Là comme ailleurs, si nous voulons récolter, il faut cultiver notre jardin. Mais si, en bien des points de cette vaste Colonie, la terre d’Afrique se montre hostile et ingrate, elle est déjà assez féconde pour nous permettre d’augurer un florissant avenir.
Le nombre et la diversité des produits exploitables, conséquence de l’étendue du pays et de la variété de ses aspects, assurent à cette prospérité des bases solides. Je dis « exploitables » et non « exploités » ; jusqu’à ce jour, un seul, le caoutchouc, l’a été sérieusement ; deux ou trois autres (arachides, laines, coton, richesses minières, bétail) commencent à peine à l’être. Enfin nous avons le Niger.
La vallée du Niger Moyen est, de tous les pays d’Afrique que je connais, celui dont l’avenir agricole me paraît le plus vaste et le plus certain. Lorsqu’il y a une quinzaine d’années, au lendemain de la conquête de Tombouctou, de jeunes officiers enthousiastes ont comparé le Niger au Nil, beaucoup, dont j’étais, ont souri de ce qui leur paraissait une exagération excusable mais tout de même un peu forte. Depuis j’ai vu et je crois, ou du moins je comprends.
La vallée du Niger Moyen, de Sansanding à Tombouctou, avec ses vastes inondations périodiques, ses bras multiples, ses lacs formant réservoirs, est sans doute aussi fertile et certainement beaucoup plus étendue que le Delta du Nil. Seulement c’est un Nil tout neuf, auquel il manque 3.000 ou 4.000 ans de civilisation antique sans parler des travaux modernes. Qu’elle puisse devenir un des greniers du monde, c’est probable. Mais[12] ce grenier est à 1.800 kilomètres du port le plus proche et il n’en peut pas sortir grand chose parce que les moyens de transport sont coûteux et encore bien imparfaits.
Cependant la civilisation moderne dispose de moyens mécaniques qui manquaient au monde antique. Le chemin de fer de la Guinée est aujourd’hui achevé, le Thiès-Kayes le sera dans peu d’années. Ce jour-là, malgré l’élévation forcée des tarifs de nos railways africains, bien des choses deviendront possibles qui ne le sont pas aujourd’hui. Il ne faudra sans doute pas 3.000 ans à nos ingénieurs pour étudier les crues du Niger, les canaliser, les diriger et leur faire donner leur maximum de rendement utile. Mais les hommes ne manqueront-ils pas à cette tâche ? Et par là j’entends les indigènes formant le gros de la troupe industrielle et agricole dont nous fournirons les cadres, troupe indispensable à la mise en valeur de toutes ces richesses latentes. Au Soudan, sur les rives du fleuve surtout, la population est sans doute moins clairsemée que dans la plupart des autres régions de l’Afrique intertropicale ; mais combien insuffisante encore. Ce n’est pas impunément que ces pays ont traversé des siècles de guerres intestines et de barbarie. Et par là nous sommes ramenés à la question indigène qui domine toutes les autres. Je l’écrivais déjà en 1902 : « On ne saurait trop redire que, dans l’Afrique Occidentale Française, l’indigène est la base de toute prospérité, le pivot de tout progrès. »
Au Soudan règne la paix française ; les guerres intestines, les pillages, les massacres ont définitivement cessé, mais l’œuvre d’assistance est à peine ébauchée ; nous faisons déjà plus de 100.000 vaccinations par an, mais c’est 500.000 que nous devons faire pour lutter contre la variole. Et nous avons d’autres fléaux à combattre pour conserver à nos races indigènes toute leur vitalité et toute leur puissance d’accroissement. C’est là le devoir prescrit à l’heure présente plus encore par notre intérêt que par l’humanité. Les possibilités de richesses existent : plus nous aurons d’hommes pour les mettre en valeur, plus nous serons riches, et mieux nous aurons travaillé à la grandeur et à la force de la France.
Koulouba, le 1er janvier 1911.
Clozel.
[13]DOCUMENTS ANNEXES
I. — Arrêté du Lieutenant-Gouverneur fixant la répartition et les attributions des différents bureaux et services du Gouvernement du Haut-Sénégal-Niger.
Le Gouverneur des Colonies, lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, officier de la légion d’honneur,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement Général de l’Afrique occidentale française,
Arrête :
L’organisation des Services de Direction au Gouvernement du Haut-Sénégal-Niger comprend sous l’autorité directe du Gouverneur :
Le Cabinet du Gouverneur,
Le Bureau Militaire,
Le Bureau des Affaires Politiques (1er bureau),
Le Bureau des Affaires économiques (2e bureau),
Le Secrétariat Général du Gouvernement.
Il existe en outre un Secrétariat particulier auprès du Gouverneur.
Attributions des différents bureaux.
Cabinet
Ouverture, enregistrement et répartition des dépêches et télégrammes entre les différents bureaux du Gouvernement.
Enregistrement au départ des dépêches à destination du Gouverneur Général et du contrôle financier.
Chiffre : établissement des chiffres, instructions relatives à leur emploi.
Chiffrage et déchiffrage des télégrammes officiels.
Personnel, tenue des dossiers du personnel, nominations, mutations.
Mise en route du personnel civil.
[14]Bibliothèque, souscriptions.
Archives. Classement et conservation des originaux des actes du Gouverneur Général et du Gouverneur de la Colonie.
Classement et conservation de la correspondance avec le Gouverneur Général et le Directeur du Contrôle financier.
Délivrance des états de service des anciens fonctionnaires et agents.
Légalisation des actes établis dans la Colonie.
Conseil d’administration et Conseil du Contentieux.
Journal officiel de la Colonie.
Bureau militaire.
Administration du personnel hors cadres, désignations, mutations, mise en route, relève.
Transmissions des rapports d’opérations militaires.
Justice militaire, conseils de guerre.
Officiers de réserve et réservistes européens.
Réservistes indigènes.
Administration des brigades de garde indigène et de la milice. Recrutement, habillement, armement, administration.
Inspection des gardes.
Recrutement et inspections des goums.
Anciens tirailleurs et méharistes (masses, décorations, pensions).
Service géographique, centralisation des rapports géographiques, cartes, levers et itinéraires de la Colonie.
Etablissement des cartes d’ensemble de la Colonie.
Observations astronomiques.
Observations pluviométriques, étiage du Sénégal et du Niger.
Bureau des affaires politiques.
Affaires Politiques.
Justice.
Instruction publique.
Postes et Télégraphes, circulaires et notifications relatives aux modifications des services maritimes postaux, approvisionnements en figurines, cartes, lettres et enveloppes. Communications avec le Bureau de Berne.
Missions, centralisation des documents politiques, ethnographiques, etc. autres que les renseignements géographiques ou d’ordre économique et financier.
Assistance médicale indigène et services d’hygiène.
Successions vacantes, administration de la curatelle aux successions et biens vacants. Recherches dans l’intérêt des familles.
Villages de refuge, secours aux indigents.
Conventions écrites passées entre indigènes.
Statistiques diverses autres que les statistiques douanières et celles ressortissant aux affaires commerciales.
[15]Bureau des affaires économiques.
Affaires d’ordre économique et commercial.
Affaires domaniales, application du régime foncier, concessions urbaines et rurales.
Mines, questions d’ordre administratif et contentieux.
Législation commerciale.
Colonisation, main-d’œuvre, crédit.
Centralisation de tous les renseignements agricoles et de la correspondance concernant le service de l’agriculture.
Autrucheries, bergeries.
Stations agronomiques et jardins d’essais, établissements hippiques, missions agricoles et économiques diverses.
Relations avec l’Office Colonial. Participation aux expositions.
Etudes avec le Secrétaire Général des questions relatives :
1o Aux patentes, taxe de colportage, oussourou, droits de marché et taxes imposées au commerce, droits de bac, taxe des Decauville, etc.
2o Aux tarifs du chemin de fer et de la navigation ;
3o Aux poids et mesures, monnaies ;
4o Aux relations avec les Chambres de commerce ;
5o Aux questions douanières.
Secrétariat Général.
Le Secrétariat Général comprend, sous l’autorité directe du Secrétaire Général, deux bureaux :
Bureau des finances ;
Bureau du matériel.
Attributions.
Bureau des finances.
Administration du budget local et du budget annexe du Territoire Militaire du Niger.
Centralisation de tous les renseignements et de la correspondance concernant la préparation, l’exécution et le contrôle des deux budgets.
Contrôle de l’administration du chemin de fer de Kayes au Niger ; centralisation de tous les renseignements et de la correspondance concernant ce service.
Administration des fonds d’emprunt et du budget général.
Centralisation de tous les renseignements et de la correspondance concernant les travaux effectués sur les deux budgets.
Contrôle financier des services d’exploitation ;
Postes et Télégraphes ;
Service de navigation du Niger ;
[16]Service de navigation sur le Sénégal ;
Decauville de Kayes et Bamako ;
Imprimerie.
Centralisation des renseignements et de la correspondance concernant ces services.
Contrôle des régies financières, Douanes, Enregistrement ; questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service du Trésor.
Comptabilité des dépenses engagées, relations avec le Directeur du contrôle financier.
Bureau du matériel.
Réalisation des approvisionnements nécessaires aux différents services et postes de la Colonie.
Préparation des marchés et commandes, recettes des fournitures.
Comptabilité-matières, questions générales de comptabilité-matières ; préparation des instructions qui s’y rapportent, pour les différents postes et services.
Vérification et centralisation de la comptabilité des mouvements des approvisionnements en magasin et de la comptabilité du matériel en service.
Examen des procès-verbaux de recensement, de prise de service, de condamnation, de perte et tous autres documents produits à la charge ou à la décharge des gestionnaires et des dépositaires comptables.
Etablissement des comptes généraux du matériel.
Mouvements du matériel, expédition et réexpédition entre les différents postes et services, établissement des réquisitions, comptabilité du matériel en cours de transport.
Liquidation des dépenses de fournitures, de transports (chemin de fer, navigation Niger et Sénégal), des cessions diverses et des baux.
Toutes les commandes, projets de marchés doivent être revêtues du visa du bureau des Finances (comptabilité des dépenses engagées).
Le Secrétaire Général, en outre de la Direction des bureaux des Finances et du Matériel, est chargé de la présentation au Conseil d’Administration des affaires de la Colonie. Le chef du bureau des affaires économiques doit étudier avec lui les questions de fiscalité et de tarification intéressant le commerce de la Colonie.
La correspondance afférente à ces questions préparée par le 2e Bureau doit également porter le timbre du Secrétariat Général.
Il peut être, par délégation du Gouverneur, chargé de l’ordonnancement et de la signature des pièces comptables.
Inspections et services divers.
A. — L’Inspecteur des écoles est le conseil technique du Gouverneur. Il peut être consulté sur toutes les questions d’organisation du service de l’Enseignement, il donne son avis sur les demandes et les rapports des[17] Commandants de Cercle qui lui sont transmis, et propose au Gouverneur toutes mesures qu’il juge utiles pour le progrès de l’Enseignement dans la Colonie. Il procède, sur l’ordre et d’après les instructions du Gouverneur, à des inspections dans le but d’assurer le contrôle permanent du Gouvernement sur le fonctionnement du service de l’Enseignement dans la Colonie.
B. — Le Chef du service de santé est le conseil technique du Gouverneur en ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement de l’assistance médicale, du service des épidémies, de la vaccine, du laboratoire bactériologique.
C. — Le Chef du service de l’Agriculture est le conseil technique du Gouverneur ; il peut être consulté sur toutes les questions d’organisation du service de l’Agriculture. Il donne son avis sur les demandes et les rapports des commandants de cercle qui lui sont transmis et propose au Gouverneur toutes mesures qu’il juge utiles pour le développement de l’agriculture dans la Colonie. Il procède, sur l’ordre et d’après les instructions du Gouverneur, à des inspections des stations agronomiques, jardins d’essais, bergeries, autrucheries, dans le but d’assurer le contrôle permanent du Gouvernement sur le fonctionnement du service de l’Agriculture dans la Colonie.
D. — Un vétérinaire hors cadres est chargé, dans les mêmes conditions du Service Zootechnique de la Colonie.
E. — Le Chef du service des Travaux Publics est chargé :
1o De l’étude et de la direction des travaux publics entrepris sur les fonds du budget local. Il peut être appelé à étudier et diriger l’exécution des travaux publics entrepris dans la Colonie sur des ressources étrangères au budget local (budget général ou fonds d’emprunt).
2o Du service des Mines (questions d’ordre technique). Il est en même temps le conseil technique du Gouverneur pour les différents services d’exploitation de la Colonie (Chemin de fer, Navigation) et en ce qui concerne particulièrement les approvisionnements et travaux.
La correspondance et les rapports concernant les Inspections et Services divers sont centralisés par les Bureaux du Gouvernement :
Inspection des Ecoles et Service de Santé : au 1er Bureau.
Service de l’Agriculture et Service Zootechnique : au 2e Bureau.
Service des Travaux Publics : au Secrétariat Général.
Bamako, le 19 juin 1908.
Signé : Clozel.
[18]II. — Circulaire relative à l’étude des coutumes indigènes
Le Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, à MM. les Administrateurs et Commandants de Cercles du Haut-Sénégal-Niger et à M. le Commandant du Territoire militaire du Niger.
Messieurs,
Le décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du Service de la Justice dans les Colonies du Gouvernement général de l’Afrique occidentale française, a eu pour but essentiel d’unifier l’Administration de la Justice soumise autrefois à des régimes variant avec les divisions administratives de notre grande possession ouest-africaine et de garantir aux indigènes, sous notre contrôle et notre direction, en tout ce qui n’est pas contraire à nos principes essentiels d’humanité et de civilisation, le maintien de leurs coutumes, fondement d’un droit privé approprié à leur mentalité et à leur état social.
Dans ses instructions du 25 avril 1905, relatives à l’application de l’article 75 de ce décret, qui synthétise en quelques lignes l’objectif dominant du législateur, M. le Gouverneur général Roume s’exprime ainsi qu’il suit :
« J’appelle tout particulièrement votre attention sur les dispositions de l’article 75 aux termes desquelles la Justice indigène appliquera en toute matière les coutumes locales en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire aux principes de la civilisation française.
« Les tribunaux indigènes auront à juger soit suivant les règles plus ou moins modifiées par l’usage de la loi coranique, rite malékite, acceptée en fait dans une grande partie de nos territoires, soit d’après les traditions locales dans les régions qui n’ont point encore subi l’influence musulmane.
« Nous ne pouvons, en effet, imposer à nos sujets les dispositions de notre droit français manifestement incompatibles avec leur état social. Mais nous ne saurions davantage tolérer le maintien, à l’abri de notre autorité, de certaines coutumes contraires à nos principes d’humanité et au droit naturel.
« Dans les matières civiles, les coutumes ne sont pas les mêmes dans toute l’étendue de nos territoires. Variables suivant les régions, il arrive même qu’au sein de groupements indigènes, unis cependant par une communauté d’origine ou de langage, les coutumes changent de village à village. Il y aura donc lieu de veiller à ce que, à l’abri de cette trop grande diversité, quelquefois difficile à contrôler, les tribunaux indigènes ne se livrent point à l’arbitraire.
« Notre ferme intention de respecter les coutumes ne saurait nous créer l’obligation de les soustraire à l’action du progrès, d’empêcher leur régularisation ou leur amélioration. Avec le concours des tribunaux indigènes eux-mêmes, il sera possible d’amener peu à peu une classification[19] rationnelle, une généralisation des usages compatible avec la condition sociale des habitants et de rendre ces usages de plus en plus conformes, non point à nos doctrines juridiques métropolitaines qui peuvent être opposées, mais aux principes fondamentaux du droit naturel, source première de toutes les législations.
« Vous devrez donc, dans l’exercice de vos attributions judiciaires, étudier avec la plus grande attention les cas d’application des coutumes indigènes.
« Dans ce but, vous comparerez entre eux les usages divers qui, pour varier au premier coup d’œil dans leurs détails, n’en doivent pas moins présenter à l’examen réfléchi des points communs permettant de déterminer un caractère général.
« Vous vous attacherez, par conséquent, à les grouper méthodiquement, à les formuler avec précision, à leur donner la clarté qui leur manque trop souvent. Ces travaux serviront plus tard à la rédaction d’un coutumier général qui deviendra la règle des tribunaux indigènes pour les matières civiles.
« Un questionnaire détaillé vous sera ultérieurement adressé pour faciliter le classement méthodique et rationnel de vos observations. »
Vous avez eu tout le temps nécessaire, durant les cinq années qui se sont écoulées depuis l’envoi de ces instructions, de vous familiariser avec les dispositions les plus communes des divers droits coutumiers dont l’application était soumise à votre contrôle, d’en noter les particularités propres à chaque groupement ethnique et de faire toutes remarques utiles de nature à vous faciliter le travail de classification et de coordination qui vous était demandé.
Le moment me paraît venu de profiter des connaissances que vous avez pu ainsi acquérir et de l’expérience des questions indigènes que la majorité d’entre vous possède, pour réaliser l’œuvre de codification projetée par M. le Gouverneur général Roume et dont l’intérêt capital, tant au point de vue de la tâche des magistrats trop souvent inexpérimentés ou dépendants de certaines influences locales, que des garanties qui en résulteront pour les justiciables, ne saurait vous échapper.
En vue de mener à bien une œuvre aussi complexe que délicate, j’ai décidé d’en confier la réalisation à une commission qui sera chargée de centraliser vos travaux, de les coordonner et par comparaison, rapprochement ou adaptation, d’élaborer pour chaque groupe indigène de la Colonie le coutumier qui devra lui être applicable.
Cette commission, dont je désignerai ultérieurement les membres, se réunira aussitôt après la réception des rapports que vous aurez à établir en vous conformant aux indications tracées par le questionnaire que je joins à cette circulaire.
Ce questionnaire qui comprend deux parties : I. Droit civil. — II. Droit criminel, vous indique les sujets essentiels que vous devrez vous attacher à exposer et au besoin à élucider.
Mais votre contribution à l’œuvre dont je poursuis l’accomplissement n’est pas nécessairement limitée au développement des questions soumises à votre examen attentif. Si, au point de vue spécial qui va occuper votre[20] activité, vous avez, en dehors des points précisés par le canevas ci-joint, des communications intéressantes à me faire sur les institutions et usages particuliers des indigènes habitant vos cercles respectifs, je les accueillerai volontiers.
Je n’ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que je compte entièrement sur le zèle et le dévouement qui vous sont habituels pour mener à bien l’œuvre entreprise, dont la réussite ne peut dépendre que du soin et de l’exactitude que vous aurez apportés dans vos travaux.
J’ajoute, pour terminer, que je désire que vos rapports me parviennent avant le 1er juin prochain et que je ne manquerai pas, lors de l’établissement périodique des propositions pour l’avancement et autres récompenses, de me souvenir de ceux d’entre vous qui se seront le plus particulièrement distingués dans l’œuvre de progrès et d’amélioration sociale à laquelle je vous convie.
Bamako, le 12 janvier 1909.
CLOZEL.
QUESTIONNAIRE
PREMIÈRE PARTIE
DROIT CIVIL
SECTION I. — DE LA FAMILLE
Organisation de la famille. — Cette organisation est-elle basée sur les principes admis par les peuples civilisés ? Définition de la parenté : s’établit-elle par tige paternelle, par tige maternelle ou par les deux ? De l’alliance. Des degrés de parenté et d’alliance au point de vue de leurs effets, notamment en ce qui concerne : 1o les droits de tutelle et en particulier les apports d’oncle à neveu ; 2o les empêchements au mariage.
Note sur l’organisation de la tribu et sur ses rapports avec l’institution analogue qu’on remarque, à l’origine des civilisations (genos, gens, clan, horde, etc.). Eléments constitutifs de la tribu. Droits et devoirs de ses membres. Organisation politique et administrative des groupes indigènes avant notre occupation. Etat actuel. Evolution en cours. Modifications à apporter.
SECTION II. — DU MARIAGE
Monogamie ou polygamie ? — La polygamie a-t-elle le caractère légal qu’elle présente chez certains primitifs ? Conséquences de la polygamie[21] relativement à la condition de la femme. Des fiançailles ou promesses de mariage : sont-elles réglementées et sanctionnées ? Conditions requises chez l’homme et la femme pour pouvoir contracter. La polyandrie existe-t-elle ?
Mariage. — La distinction, établie par l’ensemble des législations positives, entre les empêchements absolus et les empêchements relatifs, se remarque-t-elle dans la coutume indigène ? Quid des empêchements résultant des différences de tribu entre conjoints ? A quelle catégorie de nullités se rattachent l’impuberté et le défaut de consentement de l’un des époux ? Enumérer les divers cas d’empêchements absolus ou relatifs.
Mode d’obtention de la femme. — Le mariage a-t-il lieu par achat ou par enlèvement ? Dans quelles conditions ? Est-ce l’homme ou la femme qui apporte la dot ? Quel en est le montant ? Formalités de la célébration du mariage. Les présents donnent-ils lieu à une réglementation spéciale ? Qui prononce les unions ? Des droits et obligations nés du mariage : dettes alimentaires, devoirs de fidélité, secours et assistance. L’adultère de l’homme ou de la femme entraîne-t-il, en règle générale, la rupture de l’union ou se résout-il par une peine pécuniaire ? La pénalité infligée à l’adultère est-elle uniforme ou varie-t-elle suivant la condition des époux et du complice ? Dans le cas de peine pécuniaire, qui verse l’amende, qui l’inflige et quel en est le montant ? Des devoirs particuliers à chaque époux.
De la dissolution du mariage. — Divorce, ses causes et ses effets. Juridiction qui le prononce. Quid du divorce par consentement mutuel ? Restitution de la dot et des présents. A qui sont confiés les enfants ?
SECTION III. — DE LA FILIATION
Des diverses sortes de filiation. — La coutume indigène consacre-t-elle la distinction de notre droit civil entre la filiation légitime, naturelle simple, adultérine et incestueuse ? Des effets du lien de parenté, en ce qui regarde les droits et devoirs : 1o du père, 2o de la mère, 3o des enfants. Des droits de garde, de surveillance ou de correction. Le père ou la mère peut-il donner ses enfants en gage, en faire des captifs temporaires ? Dans quelles conditions et jusqu’à quel âge ? Déchéance de la puissance paternelle : ses causes et ses effets.
Existe-t-il une parenté artificielle ? — De l’adoption : ses conditions, ses formes et ses conséquences.
SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L’ÉMANCIPATION ET DE L’INTERDICTION
La législation française distingue quatre sortes de tutelle : 1o la tutelle des survivants des père et mère ; 2o la tutelle testamentaire, conférée par le dernier mourant des père et mère ; 3o la tutelle des ascendants attribuée à celui le plus proche ; 4o la tutelle dative déférée par le conseil de famille. Ces divers modes se retrouvent-ils dans la coutume indigène ? Des attributions[22] du tuteur quant à la personne et quant aux biens de l’enfant. De la responsabilité civile du tuteur.
De l’émancipation et de l’interdiction étudiées dans leurs causes et leurs résultats.
SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ
Théorie générale de la propriété chez les indigènes. — De l’origine du droit de propriété. La propriété est-elle collective ou privée, ou, à la fois, collective et privée selon la nature des biens ? Est-elle domaine éminent du chef, du souverain ? Y a-t-il une distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers ? Le droit de propriété comporte-t-il les facultés d’user de la chose, d’en disposer, comme il les confère dans l’ancienne Rome et dans les législations actuelles ?
Des servitudes personnelles ou droits d’usufruit, d’usage et d’habitation. — Comment et sur quels biens l’usufruit peut-il être établi ? Des droits et obligations de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Comment l’usufruit prend fin ? De l’usage et de l’habitation : droits et devoirs de l’usager.
Des servitudes réelles ou services fonciers. — Comment elles s’établissent, droits qu’elles donnent, causes d’extinction.
Note sur le domaine public. — Quelles sont les conceptions des indigènes à cet égard ? Existe-t-il, chez eux, des biens appartenant en commun au village, à la tribu ou à des groupements plus importants ? Ces biens peuvent-ils être aliénés ? Par qui et dans quelle forme ? Des diverses dépendances du domaine public.
SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS
De l’ouverture des successions et de la saisine ou investiture des biens héréditaires au profit de l’héritier. — Des qualités requises pour succéder. Des divers ordres de succession. Qui hérite ? Sont-ce les enfants du défunt, ses ascendants ou ses frères et sœurs utérins ? Les femmes héritent-elles et, si oui, dans quelles conditions ? Quid des neveux du défunt ? Quid du conjoint ? Des droits de la collectivité, village ou tribu, sur les biens du défunt. Formes de l’acceptation et de la répudiation des successions. Conséquences de l’acceptation, notamment au point de vue des dettes. Conséquences de la renonciation. Du partage des successions. Des rapports : l’héritier peut-il cumuler sa part héréditaire avec le montant des donations reçues du de cujus ?
Note détaillée sur les us et coutumes qui touchent aux cérémonies accompagnant les décès (tams-tams, libations, inhumations, sacrifices, etc.) et sur l’époque où se produit la liquidation des successions. Du deuil.
Des donations entre-vifs et des testaments. — Capacité de disposer ou de recevoir par donation ou par testament. La matière de la quotité disponible est-elle réglementée ? Formes et effets de la donation entre-vifs. Est-elle révocable ? Des règles de forme des testaments. Legs[23] universel, legs à titre universel et legs particuliers. Des exécuteurs testamentaires. De la révocation et de la caducité des testaments.
SECTION VII. — DES CONTRATS
Quels sont ceux usités dans le pays ? — Comment naissent les contrats ? Sont-ils l’objet de formes solennelles spéciales ? Causes essentielles à leur validité. De l’effet des obligations. Comment elles s’éteignent. Modes de preuves.
De la vente, de l’échange et du louage. — Nature et forme de la vente. Qui peut acheter ou vendre ? Quelles choses peuvent être vendues ? Des obligations du vendeur : délivrance et garantie. Des obligations de l’acheteur.
La forme habituelle des transactions n’est-elle pas l’échange ? L’usage de la monnaie, intermédiaire des échanges, est-il connu ? Quelle est la monnaie usitée ?
La coutume indigène admet-elle le louage des personnes comme celui des choses ? L’esclavage volontaire et l’esclavage pour dettes existent-ils encore ? Moyens d’assurer progressivement l’abandon de cette coutume ? Domestiques et diverses catégories de salariés.
Des baux et, en particulier, du bail à cheptel.
Du contrat de prêt : du commodat ou prêt à usage, du prêt de consommation ou simple prêt. Obligations respectives : 1o du commodant et du commodataire ; 2o du prêteur et de l’emprunteur. Les indigènes pratiquent ils le prêt à intérêt ? Si oui, quel en est le taux habituel ? Du contrat de mandat : sa nature et sa forme. Obligations du mandant. Obligations du mandataire. Comment finit le mandat.
Du dépôt et des objets livrés en garanties de dettes. Règles générales et particulières régissant la matière.
Sanction des obligations. La contrainte par corps est-elle en usage ? Quelles en sont la durée minima et la durée maxima ?
SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION
Connaît-on la prescription ? Quelle en est la durée ?
DEUXIÈME PARTIE
DROIT CRIMINEL
SECTION I. — DE L’INFRACTION
Les indigènes font-ils un classement des infractions ? — Admettent-ils des catégories analogues à celles des crimes, délits et contraventions ? Règles présidant aux distinctions qu’ils établissent.
[24]Eléments constitutifs de l’infraction. — La tentative est-elle punie comme le délit consommé ? De la responsabilité civile et criminelle : 1o des parents du délinquant ; 2o de son village ou de sa tribu. Le principe de l’irresponsabilité pénale est il en vigueur devant les juridictions répressives ? Quels sont les cas d’irresponsabilité et quels en sont les effets au point de vue de l’application de la coutume ? Quid des faits justificatifs, tels que la légitime défense ?
Des principaux actes tombant sous l’application de la loi pénale.
SECTION II. — DES PEINES
Notions générales sur les peines. — Est-ce sur l’idée du châtiment ou sur celle du dédommagement qu’elles sont fondées ? Du rachat de l’infraction commise ou système germanique des compositions pécuniaires. Principales peines appliquées : corporelles, privatives de la liberté, pécuniaires. Peines principales et peines accessoires. De l’application des peines : la coutume traite-t-elle de la matière des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes ? Le principe de la substitution des peines, de l’emprisonnement à la peine de mort ou de l’amende à l’emprisonnement, par exemple, est-il admis ? De la complicité : ses éléments constitutifs et les peines qu’elle provoque. De la pluralité d’infractions : en ce cas, est-ce le cumul ou le non cumul des peines qui est la règle ? L’état de récidive donne-t-il sujet à l’application de peines ou de mesures spéciales ?
SECTION III. — RÉFORMES
Y a-t-il lieu de modifier certaines pénalités ? Faut-il introduire dans la coutume certaines infractions prévues par notre Code pénal ?
III. — Circulaire relative à la mise à jour des monographies des cercles.
Le Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, à Messieurs les Administrateurs et Commandants de Cercles du Haut-Sénégal-Niger et à Monsieur le Commandant du Territoire militaire du Niger.
Messieurs,
Les monographies des cercles du Haut-Sénégal-Niger qui ont été établies au commencement de l’année 1904, sur l’ordre et d’après un plan tracé par M. le Gouverneur général p. i. Merlin, constituent encore à l’heure actuelle, et malgré les imperfections ou les lacunes de certaines d’entre elles, le recueil méthodique le plus complet que nous possédions[25] des notions acquises à l’époque sur l’histoire, la géographie, l’ethnographie et la valeur économique de notre Colonie.
Mais, depuis cinq ans, les études et travaux entrepris par quelques-uns d’entre vous, les investigations auxquelles se sont livrés certains officiers ou fonctionnaires chargés de mission, les recensements de plus en plus minutieux qui ont pu être effectués dans les cercles, ont singulièrement élargi le domaine de nos connaissances sur l’évolution historique des populations placées sous notre tutelle et notamment sur l’origine, la formation politique, la distribution géographique et l’importance des groupements ethniques qui constituent l’ensemble de ces populations.
D’autre part, l’achèvement en 1905 du Chemin de fer de Kayes au Niger a eu pour effet d’accroître considérablement la richesse économique et les forces productives d’une grande partie des territoires de la Colonie qui jusque-là étaient restés improductifs.
Il convient donc, afin de ne pas perdre le fruit du précieux labeur fourni en 1904 et de conserver une documentation complète et précise, au courant de tous les progrès accomplis dans l’œuvre de civilisation que nous poursuivons dans ces pays, de reprendre les travaux de vos prédécesseurs et de les compléter pour chacun de vos cercles respectifs par l’addition des renseignements de toute nature recueillis et l’enregistrement des faits nouveaux qui se sont produits pendant les cinq dernières années.
La présente circulaire a pour but de vous inviter à cette tâche dont l’intérêt et l’utilité pratique ne peuvent vous échapper.
Afin de faciliter votre travail et de donner aux rapports que vous aurez à établir et à m’adresser avant le 1er août prochain, le caractère d’uniformité qui leur est indispensable pour en rendre la lecture et la coordination plus aisées, j’ai fait dresser le canevas ci-joint qui reproduit dans ses dispositions essentielles le programme adopté primitivement pour l’établissement des premières monographies, tout en laissant de côté un certain nombre de questions ayant perdu leur raison d’être ou ne présentant plus qu’un intérêt relatif au point de vue particulier qui nous occupe.
Je crois n’avoir aucune recommandation spéciale à vous faire touchant les matières qui doivent solliciter plus particulièrement votre attention et comporter des développements plus ou moins longs suivant l’importance qu’elles ont dans votre cercle. Il vous appartient de traiter chacune d’elles suivant l’intérêt qu’elle présente au point de vue local.
Je sais que je puis compter sur tout votre dévouement et je ne doute pas que vous n’ayez à cœur d’apporter tous vos soins à l’établissement et à la rédaction du travail que je vous confie.
Je ne manquerai pas, d’ailleurs, de tenir compte à ceux d’entre vous qui se seront particulièrement fait remarquer par la façon dont ils se seront acquittés de leur tâche.
Bamako, le 15 janvier 1909.
Clozel.
[26]QUESTIONS A TRAITER
PREMIÈRE SECTION
Formation historique et ethnique des provinces qui constituent le cercle. — Nomenclature des groupes ; leur origine ; leurs rapports ou leurs affinités avec les autres groupes de la Colonie.
DEUXIÈME SECTION
Organisation politique, administrative et judiciaire indigène qui a précédé l’exercice de notre autorité.
TROISIÈME SECTION
Renseignements géographiques. — Notes succintes sur les nouvelles constatations ou remarques qui auraient pu être faites depuis 1904 concernant le climat, la nature du sol, la végétation (notamment les essences utiles) et la faune terrestre, aérienne ou aquatique.
QUATRIÈME SECTION
Renseignements économiques :
a) Principales cultures d’exportation (arachides, coton, indigo, riz, caoutchouc, sisal et autres textiles, etc.).
b) Principales cultures indigènes ; leur avenir économique.
c) Pâturages. Leur nature, leur superficie.
d) Elevage du bétail d’alimentation. Nature des troupeaux, leur nombre, valeur des laines et peaux. Leur production, leur avenir économique.
e) Elevage des bêtes de somme, chevaux, ânes, chameaux, bœufs porteurs ; principaux centres d’élevage.
f) Carrières, mines, salines en exploitation.
g) Industries indigènes. Progrès accomplis depuis 1904.
h) Exploitations agricoles. Leur nombre, leur importance. Jardins d’essais et pépinières, etc.
CINQUIÈME SECTION
Main-d’œuvre. — Son importance et sa nature. Taux des salaires.
SIXIÈME SECTION
Commerce. — Indications générales sur la nature et l’importance du[27] commerce. Chiffres globaux du mouvement commercial pendant les cinq dernières années. Principaux marchés. Principales maisons de commerce. Nature de leurs transactions. Colporteurs. Nature de leur trafic. Moyens de transport. Caravaniers maures ou autres.
SEPTIÈME SECTION
Religion. — Progrès de l’islamisme et des sectes religieuses. Marabouts principaux. Etablissements religieux : leur nombre, leur importance.
HUITIÈME SECTION
Langues. — Dialectes parlés. Nombre d’individus parlant chaque dialecte.
NEUVIÈME SECTION
Instruction publique. — Ecoles publiques laïques ; écoles confessionnelles ; écoles coraniques. Leur nombre, leur importance, leur fonctionnement ; population scolaire.
DOCUMENTS A JOINDRE
1o Carte au 1/200.000e indiquant les divisions du cercle par provinces ou cantons et par races (indiquer chaque race au moyen d’une combinaison de hachures séparées par de larges intervalles de manière à conserver à la carte toute sa clarté). Chef-lieu du cercle. Résidences. Principaux centres et marchés indigènes. Lignes et bureaux télégraphiques. Principales routes avec un tableau annexe pour leurs étapes ;
2o Un état numérique des villages groupés par province ou par canton avec les noms des chefs de province ou de canton ; chiffre global de la population de chaque village ;
3o Un état numérique de la population par province ou canton classée par race et religion ;
4o Un état numérique des troupeaux par catégorie de bétail ;
5o Un état numérique des animaux de transport ou de trait.
[29]HAUT-SÉNÉGAL-NIGER
(Soudan Français)
PREMIÈRE SÉRIE
TOME 1
Les Pays — Les Peuples — Les
Langues
PAR
Maurice
DELAFOSSE
Administrateur de 1re classe des
Colonies
[31]AVANT-PROPOS
Le travail dont m’avait chargé M. le Gouverneur Clozel et qui a fourni la matière du présent volume et du suivant n’a trait qu’à la partie de la colonie du Haut-Sénégal-Niger administrée directement par le Gouverneur, c’est-à-dire que je ne me suis pas occupé de la zone comprise entre le Bas-Niger et le lac Tchad, laquelle zone constitue actuellement le Territoire Militaire du Niger et forme l’objet de la troisième série de cette publication, rédigée par M. Brévié.
J’ai divisé l’ouvrage en cinq parties.
La première — le pays — est une étude succincte de la géographie du Haut-Sénégal-Niger ; je n’ai pas cru devoir me livrer à des considérations de longue étendue sur un sujet qui sort de ma compétence particulière et qui, d’ailleurs, va être traité de façon remarquable par M. l’administrateur-adjoint Henry Hubert dans un livre reproduisant les résultats de sa grande mission géologique.
La deuxième partie — les peuples — renferme la nomenclature, la classification et la répartition des divers groupements ethniques qui composent la population indigène de la colonie, avec un coup d’œil sur les origines et la formation probables de chacun d’eux et une description de ses caractères ethnographiques les plus saillants.
La troisième partie — les langues — est une tentative de classification des nombreux idiomes parlés au Soudan Français, doublée d’un aperçu rapide de la physionomie propre à chaque famille de langues et d’une indication des principales publications relatives à ces langues.
[32]La quatrième partie — l’histoire — est un essai de reconstitution de la vie des Etats indigènes qui se sont succédé ou ont coexisté depuis les temps les plus reculés jusqu’à la période contemporaine, essai basé à la fois sur les quelques documents écrits que nous ont légués les auteurs arabes et les voyageurs européens et sur les traditions orales recueillies de nos jours dans les différents cercles. J’y ai ajouté une sorte de tableau des explorations qui nous ont fait connaître les pays du Haut-Sénégal-Niger, une esquisse de l’occupation française depuis ses débuts jusqu’à l’époque actuelle et enfin un résumé synthétique groupant les principaux faits par ordre chronologique.
La cinquième partie — les civilisations — se compose d’une étude des coutumes constituant en quelque sorte le code civil indigène ; de l’organisation sociale et politique qui a précédé notre occupation du pays et a survécu, dans ses bases fondamentales, à cette occupation ; de l’organisation judiciaire indigène, telle qu’elle existait avant le décret de 1903 et telle qu’elle fonctionne depuis l’application de ce décret ; enfin des religions diverses que professent actuellement nos sujets indigènes et parmi lesquelles l’islamisme, bien que la mieux connue, est loin d’être la plus répandue.
Pour traiter ces différentes matières, j’ai tout naturellement utilisé les monographies des cercles et les coutumiers établis en 1909 conformément aux instructions de M. le Gouverneur Clozel, en groupant les indications qu’ils renferment et les coordonnant de façon méthodique et, au besoin, en les rectifiant.
Mais je n’ai pas cru pouvoir borner ma documentation à ces travaux : quelque excellents que soient certains d’entre eux, quelque richesse d’information que la plupart renferment, ils ne m’ont pas semblé constituer à eux seuls une base suffisamment solide, principalement en ce qui concerne l’histoire des temps passés. Aussi ai-je eu recours à un certain nombre d’ouvrages, dont le dépouillement m’a permis plus d’une fois de compléter ou de préciser des points seulement effleurés dans les notices des commandants de cercle. Là aussi, j’ai cru ne pas devoir me borner à une simple compilation : je me suis permis de faire œuvre de critique, de rejeter certaines affirmations hasardées[33] un peu à la légère, d’en interpréter d’autres à la lumière d’une méthode nouvelle, de comparer les documents écrits avec les traditions orales et de tirer de cette comparaison tout le bénéfice qu’on peut en attendre.
| Delafosse | Planche II |

Fig. 2. — M. le Général Archinard.

Fig. 3. — M. le Général de Trentinian.

Fig. 4. — M. le Gouverneur Général Ponty.
Les relations historiques et géographiques des Arabes, notamment celles des auteurs réputés à bon droit les plus consciencieux, tels que Ibn Haoukal, Bekri, Ibn Saïd, Ibn Batouta, Ibn Khaldoun, Yakout, sans oublier Sa’di et son Tarikh-es-Soudân, m’ont été du plus grand secours. A vrai dire, leurs ouvrages avaient été mis déjà plus d’une fois à contribution en ce qui concerne l’histoire du Soudan, et il semblerait de prime abord que, après les commentaires qu’en ont donnés Ralfs, Barth, Basset, Binger et tant d’autres, il n’y eût plus beaucoup d’inédit à glaner dans cette source d’informations. Cependant j’ai cru m’apercevoir que, malgré la valeur incontestable des traductions que nous possédons de la plupart de ces auteurs, il y avait un intérêt majeur à ne pas s’en tenir uniquement à ces traductions et à recourir au texte arabe lui-même, en particulier lorsqu’il s’agit de lire ou d’identifier des noms de personnes ou de lieux étrangers à la langue et au pays arabes : les meilleurs traducteurs, peu familiarisés avec les langues et la géographie du Soudan et mal aidés par le système de transcription, souvent défectueux, des auteurs arabes, ont défiguré beaucoup de noms propres qu’il n’est en général possible de lire correctement qu’en ayant recours au texte original. De plus, quelques-uns de ces ouvrages relatifs à l’Afrique du Nord et, incidemment, au Soudan, n’ont encore été traduits dans aucune langue européenne, notamment le précieux dictionnaire géographique de Yakout, et, pour ceux-là, force m’a bien été de m’en tenir au texte arabe et de traduire moi-même les passages à utiliser.
Enfin, il m’a paru nécessaire de tenir compte dans une certaine mesure, surtout en ce qui concerne l’ethnographie, la sociologie et la linguistique, de mes travaux personnels antérieurs et des notes et de l’expérience que j’ai été à même d’accumuler durant mes seize années de séjour en Afrique Occidentale, dont neuf ans passés dans la région soudanaise. J’ai cru devoir aussi faire état de renseignements qui m’ont été fournis[34] gracieusement par des savants, des missionnaires, des officiers et des fonctionnaires tels que MM. Chudeau, Brun, Gaden, Figaret, Marc, Vidal, Henry Hubert, etc., auxquels leur compétence spéciale ou leurs études personnelles ont permis de me documenter de façon très précieuse sur quelques points de détail.
Malgré tout, mon rôle dans la rédaction du présent volume a été surtout un rôle de compilateur, d’ordonnateur et de critique, et je tiens à laisser à tous les auteurs anciens et modernes, défunts et vivants, que j’ai mis à contribution, le mérite de leurs travaux.
La bibliographie qu’on trouvera à la suite de la cinquième partie mentionne d’ailleurs, — non pas la liste de tous les livres, mémoires et brochures relatifs au Soudan Français, car cette simple liste ferait presque un volume à elle seule, — mais le titre, le nom de l’auteur et les date et lieu de publication de chacun des ouvrages et documents que j’ai utilisés ou simplement consultés, ainsi que toutes les monographies et tous les coutumiers que M. le Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger a mis à ma disposition.
L’ouvrage se termine par un index alphabétique des noms propres cités dans le texte et des sujets traités, avec renvoi aux pages à consulter.
Pour faciliter la lecture de certains chapitres, je les ai accompagnés de cartes hors texte et de croquis établis chacun spécialement en vue des matières traitées dans le chapitre. Ces cartes et croquis ont été exécutés, sur mes indications, par M. Meunier, cartographe du Ministère des Colonies, lequel est également l’auteur de la carte d’ensemble placée à la fin du volume ; parmi les documents récents qui ont servi à l’établissement de cette carte d’ensemble, je dois signaler les cartes fournies en 1909 par les commandants de cercle en même temps que les monographies de leurs circonscriptions respectives.
Paris, le 1er janvier 1911,
M. Delafosse,
Administrateur des Colonies.
[35]PREMIÈRE
PARTIE
Le Pays
[37]CHAPITRE PREMIER[1]
Limites
Etendue et population. — La colonie du Haut-Sénégal-Niger, Territoire Militaire compris, a comme limites politiques et administratives : au Nord, les territoires sahariens relevant du Gouvernement Général de l’Algérie ; à l’Est, le Territoire du Tchad, faisant partie du Gouvernement Général de l’Afrique Equatoriale Française ; au Sud, et de l’Est à l’Ouest, la colonie anglaise de la Northern Nigeria, la colonie française du Dahomey, la colonie allemande du Togo, la colonie anglaise de la Gold Coast, les colonies françaises de la Côte d’Ivoire et de la Guinée ; à l’Ouest les colonie et territoire français du Sénégal et de la Mauritanie.
L’ensemble représente une superficie approximative de 3 millions de kilomètres carrés, peuplée de 5.600.000 habitants environ.
Mais une portion notable de cette superficie, environ 1.200.000 kilomètres carrés, se compose des terrains en partie arides et désertiques qui forment le Territoire Militaire du Niger, peuplé de 800.000 habitants.
[38]Le territoire civil de la colonie, ou Haut-Sénégal-Niger proprement dit, a donc une superficie de 1.800.000 kilomètres carrés environ, soit plus du triple de la superficie de la France, et compte à peu près 4.800.000 habitants, c’est-à-dire une moyenne de 2 habitants et demi (exactement 2,66) par kilomètre carré.
Ainsi réduite à la partie qui, seule, fait l’objet du présent volume, la colonie du Haut-Sénégal-Niger correspond à peu près à l’ensemble des territoires que, par suite d’une longue habitude, on appelle encore communément le Soudan Français.
Ses limites géographiques restent imprécises du côté du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est, en raison de la nature désertique de ces régions et de la vie plus ou moins nomade que mènent leurs habitants ; on peut toutefois assigner à ses marches sahariennes, comme confins extrêmes, les points de Tichit au Nord-Ouest, de Taodéni au Nord et de Tessalit (en face et à hauteur de Timiaouine) au Nord-Est : par le premier de ces points, le Haut-Sénégal-Niger touche à la zone d’influence de la Mauritanie, par le second à la zone de pénétration algérienne et par le troisième à la zone d’action saharienne du Territoire Militaire du Niger. Mais en réalité la zone d’administration directe de la colonie ne dépasse guère à l’Ouest le 17° parallèle de latitude nord, soit approximativement la ligne Kiffa-Oualata, tandis qu’à l’Est elle s’étend un peu au Nord du 19° parallèle, soit à la ligne Araouâne-Bou-Djebiha. Au Nord de cette ligne brisée Kiffa-Oualata-Araouâne-Bou-Djebiha, nous exerçons surtout un rôle de police et de surveillance et nous ne possédons pas de postes fixes ni d’établissements permanents.
Limite avec la Mauritanie. — La limite entre le Haut-Sénégal-Niger et la Mauritanie, prise à hauteur de Tichit, est formée d’abord par l’extrême pointe que pousse, entre Tichit et Tidjikja, la région sablonneuse du Djouf, puis par une ligne suivant à peu près le bord oriental des hauteurs qui encerclent le plateau du Tagant, pour contourner ensuite vers l’Ouest la partie méridionale de ces hauteurs jusqu’aux monts Assaba, point de départ de la vallée du Gorgol-Noir.
[39]De ce point, la limite, tournant assez brusquement vers le Sud-Est, va rejoindre vers Fété-Dioullé, au Sud-Ouest de Kiffa, la vallée connue sous les noms de Tartafout, Bakhambora et Karakoro, et la suit depuis Fété-Dioullé jusqu’à son confluent avec le Sénégal, près et en amont du village de Kabou, entre Ambidédi et Bakel.
La limite avec la Mauritanie est ensuite constituée par le Sénégal lui-même, depuis l’embouchure du Karakoro jusqu’à celle de la Falémé ; à partir de ce dernier point, le Sénégal abandonne complètement le Haut-Sénégal-Niger pour donner sa rive droite à la Mauritanie et sa rive gauche à la colonie du Sénégal.
Limite avec le Sénégal. — La limite entre le Sénégal et le Haut-Sénégal-Niger est constituée par la Falémé[2], depuis son embouchure dans le Sénégal, jusqu’au point, situé un peu en amont de Satadougou, où cette rivière est formée par la réunion de la Balinko et de la Koundako. A partir de ce point, c’est la Guinée qui succède au Sénégal comme colonie limitrophe du Haut-Sénégal-Niger.
Limite avec la Guinée. — La limite entre la Guinée et le Haut-Sénégal-Niger est constituée : d’abord par la Balinko ou haute Falémé occidentale, puis par son affluent la Kassaya jusqu’aux collines d’où sort cette dernière ; ensuite, se dirigeant d’une façon générale vers l’Est, par les collines en question, puis par la Dialako, qui en sort également, jusqu’à son confluent avec la Koundako ou haute Falémé orientale. La limite descend alors le cours de la Koundako jusqu’au point où cette rivière reçoit la Kolounko, puis elle remonte le cours de la Kolounko depuis son embouchure jusqu’au mont Sagou, où la Kolounko prend sa source ; la frontière franchit alors le mont Sagou, descend le ruisseau Koroko depuis le versant oriental de la montagne[40] jusqu’au Bafing ou haut Sénégal occidental, descend le Bafing sur 26 kilomètres environ jusqu’au point où il reçoit la Fariko, puis quitte ce fleuve pour se diriger approximativement vers l’Est en décrivant une courbe infléchie vers le Sud qui sépare le cercle de Kita (H.-S.-N.) des cercles de Dinguiray et de Siguiri (Guinée) et qui aboutit au Bakhoy ou haut Sénégal oriental à peu près à hauteur et à l’Ouest de Niagassola. La limite descend le Bakhoy vers le Nord sur 30 à 40 kilomètres, puis le quitte pour se diriger vers l’Est et ensuite vers le Sud, de façon à décrire une sorte d’arc de cercle autour de Niagassola, pour se continuer dans une direction à peu près Sud-Sud-Est jusqu’à ce qu’elle atteigne le Niger à une cinquantaine de kilomètres en aval de Siguiri. La frontière traverse alors le Niger et se dirige vers le Sud-Est jusqu’à la rencontre de la Sankarani et remonte ensuite cet affluent du Niger, en se dirigeant vers le Sud-Sud-Ouest, sur 60 kilomètres environ ; puis elle quitte cette rivière pour se continuer par une ligne en zigzags d’une direction générale Sud-Est (Est-Nord-Est, puis Sud-Sud-Ouest, puis Sud-Est), jusqu’à ce qu’elle atteigne, sur le cours supérieur de la rivière Ouassouloubalé et à 15 kilomètres environ au Nord-Ouest de Maninian, le point de jonction des trois cercles de Bougouni (H.-S.-N.), Kankan (Guinée) et Touba (Côte d’Ivoire).
Limite avec la Côte d’Ivoire. — La limite du Haut-Sénégal-Niger, partant du point précédemment défini, se dirige d’abord vers le Nord-Est jusqu’à la rencontre du Baoulé ou haut Bani occidental, le traverse, continue dans la direction de l’Est jusqu’au Dékou ou Dégou, franchit ce cours d’eau, se dirige vers le Sud-Est jusqu’à la rencontre du Banigbê (appelé aussi Banifing), traverse cette rivière, gagne vers l’Est le Bafing, descend vers le Nord le cours du Bafing pendant 15 kilomètres environ, puis le quitte pour se diriger sensiblement vers l’Est, en passant au Nord de Tengréla, jusqu’au Bagoé ou mieux Bagbê ou haut Bani oriental. Ensuite elle remonte le Bagbê vers le Sud pendant une quarantaine de kilomètres, le quitte pour se diriger sensiblement vers l’Est-Nord-Est, en passant au Nord de Tiorhotiéri[41] et de Toungboro, jusqu’à la rencontre d’une rivière appelée Bani dont elle descend le cours jusqu’à son confluent avec la Léraba ou haute Comoé occidentale, puis descend la Léraba elle-même pendant une centaine de kilomètres jusqu’au parallèle 9° 25′ environ de latitude Nord, point le plus méridional de la colonie. Elle se dirige ensuite vers le Nord-Est, puis vers l’Est, jusqu’en un point situé entre Gagouli ou Galgouli au Nord et Yologo au Sud, point d’où, par une direction générale Sud-Est, elle gagne la Volta Noire entre Kpéré au Nord et Tantama au Sud, par 9° 30′ environ de latitude Nord.
Limite avec la Gold Coast. — A partir de ce point, la frontière devient commune au Haut-Sénégal-Niger et à la colonie anglaise de la Gold Coast. Elle remonte d’abord le thalweg de la Volta Noire vers le Nord jusqu’au 11° de latitude Nord, puis se dirige vers l’Est en suivant à peu près ce parallèle jusqu’à la rencontre de la Volta Rouge ; ensuite elle descend le thalweg de la Volta Rouge vers le Sud-Sud-Est pendant une dizaine de kilomètres pour se diriger après vers le Nord-Est jusqu’à la rencontre de la Volta Blanche ; puis elle descend ce dernier fleuve pendant quelques kilomètres pour remonter ensuite son affluent, la rivière de Tenkodogo, jusqu’à hauteur de Badima, au Sud-Sud-Est de Bitou, se diriger de là vers l’Est-Sud-Est sur une quinzaine de kilomètres et rencontrer alors le point où la frontière de la Gold Coast fait place à celle de la colonie allemande du Togo.
Limite avec le Togo. — La limite entre le Haut-Sénégal-Niger et le Togo suit une direction approximativement Est-Sud-Est, sur une longueur de 125 kilomètres environ, et atteint le 11° de latitude Nord à 16 kilomètres au Nord-Est du point où le Pendjari, en se réunissant avec le Pépiénou ou Yanga, forme l’Oti. De là, elle se dirige vers le Sud-Sud-Ouest jusqu’à la rencontre du ruisseau Nambi-Kouna, par 10° 48′ environ de latitude Nord.
Limite avec le Dahomey. — C’est le Dahomey qui, à partir[42] de ce point, devient limitrophe du Haut-Sénégal-Niger. La frontière se dirige d’abord vers le Sud-Est jusqu’au sommet sud des monts Pangou, puis de là vers l’Est-Nord-Est jusqu’au point où le ruisseau Bourpoudabonga sort du massif de l’Atakora, par 10° 40′ environ de latitude Nord. Ensuite elle longe ce très long massif presque rectiligne, dans une direction générale Nord-Est, jusqu’à la rencontre de l’affluent du Niger appelé Mékrou, qu’elle atteint par 11° 30′ environ de latitude Nord et à proximité du méridien de Paris ; puis elle descend le Mékrou, dans une direction générale Nord-Est, jusqu’à son embouchure dans le Niger.
Limite avec le Territoire Militaire du Niger. — A partir de l’embouchure du Mékrou, qui se trouve à hauteur du village de Boumba, le Niger constitue la limite entre le Territoire Militaire et la colonie proprement dite du Haut-Sénégal-Niger, depuis le 1er janvier 1911. Cette limite remonte le thalweg du fleuve jusqu’en un point situé à peu près sur le 17° de latitude Nord et approximativement à moitié chemin entre Bourem et Bamba. En ce point, la limite quitte le Niger pour suivre une direction sensiblement Nord-Nord-Est jusqu’au 18° de latitude Nord, puis Nord-Est depuis ce parallèle jusqu’en un lieu sis entre Tessalit à l’Ouest et Timiaouine à l’Est par 20° 40′ environ de latitude Nord, de façon à laisser au Territoire Militaire la vallée du Tilemsi et l’Adrar des Iforhass et à la colonie civile le territoire des Kounta de Mabrouk.
Limite avec l’Algérie. — A partir de la région de Tessalit-Timiaouine, c’est l’Algérie qui devient limitrophe du Haut-Sénégal-Niger. La limite, tout à fait approximative, passe entre le Tanezrouft au Nord et l’Adrar Timetrhine au Sud, puis entre l’Erg-ech-Châche au Nord et, au Sud, les hauteurs (Djebel-el-Haricha) qui dominent Taodéni, laissant au Haut-Sénégal-Niger ce dernier point (22° 40′ 19″ latitude Nord et 6° 12′ 49″ longitude Ouest), ainsi que l’emplacement probable des anciennes mines de sel de Teghazza, situé à 120 kilomètres environ au Nord-Nord-Ouest de Taodéni. La limite se dirige ensuite vers le Nord-Ouest,[43] dans la direction du Cap Noun, rencontrant en un point imprécis du Djouf, connu sous le nom d’Erg Moughtir, la limite de la zone d’extension de la Mauritanie.
Cercles frontières. — Pour compléter cette description des limites du Haut-Sénégal-Niger, il me reste à donner la liste des cercles qui sont en bordure de cette vaste frontière. Ces cercles ou circonscriptions sont, en partant de Tichit et en suivant la même direction que ci-dessus : la résidence de Kiffa, limitrophe de la Mauritanie (cercles du Tagant et du Gorgol) ; le cercle de Kayes, limitrophe de la Mauritanie (cercle du Gorgol) et du Sénégal (cercles de Bakel et de Kédougou ou de la Haute-Gambie) ; le cercle de Bafoulabé, limitrophe du Sénégal (cercle de Kédougou) ; le cercle de Satadougou, limitrophe du Sénégal (cercle de Kédougou) et de la Guinée (cercles de Yambéring, Tougué et Dinguiray) ; les cercles de Kita et de Bamako, limitrophes de la Guinée (cercles de Dinguiray et de Siguiri) ; le cercle de Bougouni, limitrophe de la Guinée (cercles de Siguiri et de Kankan) et de la Côte d’Ivoire (cercles de Touba et de Korhogo) ; le cercle de Bobo-Dioulasso, limitrophe de la Côte d’Ivoire (cercles de Korhogo et de Kong) ; le cercle de Gaoua, limitrophe de la Côte d’Ivoire (cercle de Bondoukou) et de la Gold Coast ; le cercle de Ouagadougou, limitrophe de la Gold Coast et du Togo ; le cercle de Fada-n-Gourma, limitrophe du Togo et du Dahomey (cercles de Djougou-Kouandé et de Kandi) ; le cercle de Say, limitrophe du Dahomey (cercle de Kandi) et du Territoire Militaire (cercle de Niamey) ; les cercles de Dori, de Hombori ou du Gourma et de Tombouctou-nomades, limitrophes du Territoire Militaire (cercles de Niamey et de Gao) ; enfin les cercles de Tombouctou-nomades, de Niafounké ou de l’Issa-Ber, de Sokolo, de Goumbou et de Nioro ont vers le Nord une zone d’influence, d’action ou d’extension qui va rejoindre la limite de l’Algérie.
Sur les 29 cercles ou circonscriptions de la colonie, 10 seulement ne se trouvent pas en bordure des frontières : Tombouctou-sédentaires[3],[44] Mopti, Bandiagara, Dienné, Ouahigouya, Koury, San, Ségou, Koutiala et Sikasso[4].
[2]Sur une faible portion de son cours inférieur, à hauteur de Sénoudébou et de Tamboura, la Falémé a ses deux rives dans la colonie du Sénégal.
[3]Les deux cercles de Tombouctou-nomades et de Tombouctou-sédentaires n’ont pas de limites respectives définies, mais, par suite de la façon dont se trouve répartie la population, Tombouctou-sédentaires se trouve de fait à peu près englobé dans Tombouctou-nomades.
[4]Le cercle de Sikasso touche en réalité à la frontière de la Côte d’Ivoire, mais par un point géométrique seulement, point situé sur le Bagbê ou Bagoé et où se rencontrent les cercles de Bougouni, Sikasso et Bobo-Dioulasso (Haul-Sénégal-Niger) et celui de Korhogo (Côte d’Ivoire).
[45]CHAPITRE II[5]
Hydrographie.
Hydrographie rétrospective. — Avant de passer à l’étude du régime hydrographique du Haut-Sénégal-Niger, il peut être intéressant de voir ce que l’antiquité et le moyen-âge connaissaient ou croyaient connaître des fleuves soudanais et comment, de ces notions fausses ou imparfaites, on est arrivé — assez récemment — à une appréciation satisfaisante de la réalité. Ce coup d’œil rétrospectif aurait pu trouver sa place au chapitre de l’exploration du Soudan Français, mais, en raison de l’importance capitale, pour la connaissance géographique d’un pays, des données que l’on possède sur le régime des eaux de ce pays, j’ai trouvé préférable de placer ici cet aperçu.
Il est vraisemblable que l’embouchure du Sénégal fut découverte dès le VIe siècle avant J.-C., vers 570, par le navigateur carthaginois Hannon, lorsque, ayant franchi le détroit de Gibraltar, il fit voile vers le Sud et s’avança jusqu’aux environs du Sierra-Leone actuel. Malheureusement l’original de son récit de voyage, qui aurait été rédigé par lui en langue punique et conservé à Carthage, ne nous est jamais parvenu ; nous ne le connaissons que par une traduction grecque qu’en auraient faite à Carthage des savants dont le nom ne nous a pas été révélé. C’est ainsi que les renseignements fournis par le plus ancien voyage accompli sur les côtes occidentales d’Afrique n’ont commencé à être utilisés que deux siècles environ après[46] ce voyage lui-même[6] et que leur authenticité demeure forcément douteuse. Cependant, quelle que soit la limite extrême que l’on assigne à l’exploration maritime de Hannon, il est fort probable, si les documents utilisés par Ptolémée et les autres géographes grecs n’étaient pas apocryphes, que l’amiral carthaginois fit relâche à l’embouchure du Sénégal et que c’est ce fleuve auquel il donna le nom de Chretes ou Khritis.
Un peu plus tard, vers 550 avant J.-C., des Phéniciens, sur l’ordre du roi d’Egypte Néchao ou Néko II, s’embarquèrent sur la Mer Rouge, firent route vers le Sud, et, trois ans après leur départ, revinrent en Egypte par le détroit de Gibraltar et la Méditerranée : si ce premier périple de l’Afrique, que nous a fait connaître Hérodote, a été réellement exécuté, il est possible que les Phéniciens qui l’ont accompli aient, eux aussi, reconnu l’embouchure du Sénégal ; mais leur voyage en tout cas n’a pas laissé de traces dans les connaissances géographiques de leurs contemporains.
L’historien grec Hérodote, qui vécut de 484 à 410 environ avant J.-C. et qui voyagea en Egypte, en Cyrénaïque et en Libye, nous parle aussi d’un autre voyage dont il aurait été le contemporain, puisqu’il aurait été exécuté sous Xerxès, lequel régna de 485 à 465 avant J.-C. Un parent de ce roi, nommé Sataspe, condamné à mort pour avoir violé une jeune fille, aurait obtenu sa grâce par l’intermédiaire de sa mère, sœur de Darius, à condition de faire le tour de l’Afrique. Il partit d’Egypte sur un vaisseau, franchit les colonnes d’Hercule (détroit de Gibraltar), puis fit route vers le Sud pendant plusieurs mois, vit un pays dont les habitants se vêtaient de feuilles de palmier et auxquels il enleva du bétail pour se ravitailler, puis, effrayé de la longueur du chemin qui lui restait à faire, il revint en Egypte par le même chemin qu’il avait suivi à l’aller. Xerxès, estimant qu’il n’avait pas rempli les conditions imposées, le fit crucifier[7]. La circonstance des feuilles de palmier est de nature à nous faire croire que ce Sataspe atteignit au[47] moins le cap Vert, mais c’est là tout ce qu’il est permis de conjecturer de ce voyage.
Hérodote d’ailleurs ne nous parle pas du Sénégal ; mais on a prétendu qu’il avait, le premier, révélé l’existence du Niger. A vrai dire, rien n’est plus douteux. Sans doute il est permis de supposer à la rigueur que c’est du Niger qu’il entend parler lorsqu’il décrit le Cinyps, « pays qui porte le même nom que le fleuve dont il est arrosé » et qui « peut entrer en parallèle avec les meilleures terres à blé : aussi — continue Hérodote — ne ressemble-t-il en rien au reste de la Libye. C’est une terre noire et arrosée de plusieurs sources : elle n’a rien à craindre de la sécheresse et, les pluies excessives ne faisant que l’abreuver, elle n’en souffre aucun dommage. Il pleut en effet dans cette partie de la Libye »[8]. Cette description pourrait assurément s’appliquer à la vallée du Niger, mais comme Hérodote ne nous donne aucune indication sur la situation du Cinyps, sinon qu’il faisait partie de la « Libye », et comme il donne ce nom de Libye à toute la région située à l’Ouest de la Cyrénaïque, depuis la Méditerranée jusqu’aux limites du monde alors connu, il est bien difficile d’affirmer que son Cinyps doive être identifié avec notre Niger.
Ailleurs[9] le même auteur raconte la fameuse équipée des Nasamons dans des termes qui ont fait supposer parfois que le Niger avait été le terme de ce singulier voyage. Voici cette histoire, telle qu’Hérodote l’apprit de quelques Cyrénéens qui, eux-mêmes, l’avaient entendu raconter par le roi Etéarque, lorsqu’ils étaient allés dans son pays pour consulter l’oracle d’Ammon. Cinq jeunes Nasamons[10] de bonne famille avaient fait le pari de traverser les déserts de Libye ; partis avec des provisions d’eau et de vivres, ils franchirent d’abord les pays habités de la Libye septentrionale, puis une région remplie de bêtes féroces, et ensuite, se dirigeant vers l’Ouest, des contrées désertes, sans eau et très sablonneuses. Après avoir marché[48] longtemps, ils arrivèrent à une plaine où se trouvaient des arbres et apaisèrent leur faim et leur soif en dévorant les fruits de ces arbres. Des hommes noirs, d’une taille au-dessous de la moyenne, se montrèrent alors, se saisirent des Nasamons et les emmenèrent, à travers un pays marécageux, jusqu’à une ville dont tous les habitants étaient comme eux de couleur noire et de faible stature et que bordait une grande rivière coulant de l’Ouest à l’Est, infestée de crocodiles ; les Noirs ne comprenaient pas la langue des Nasamons et réciproquement. Sans doute ne se montrèrent-ils pas trop cruels pour les voyageurs méditerranéens, car ceux-ci purent revenir dans leur pays et raconter leurs aventures.
A mon avis (et à supposer que les cinq jeunes Nasamons n’aient pas abusé de la crédulité de leurs compatriotes), la rivière dont il est parlé ne saurait être identifiée avec le Niger. S’il s’agissait de ce fleuve, les voyageurs l’auraient atteint au sommet de sa boucle, puisqu’ils trouvèrent la « grande rivière » immédiatement en sortant du désert, et il est peu vraisemblable qu’un peuple de nains ait jamais existé dans la région de Tombouctou à Gao. Il me paraîtrait plus logique d’adopter la conclusion d’Hérodote lui-même, d’après laquelle le fleuve visité par les Nasamons ne serait autre que le haut Nil ou tout au moins l’une de ses branches : le Bahr-el-Ghazal par exemple, au voisinage duquel la présence de marécages et de Noirs de petite taille serait très explicable. Il resterait, il est vrai, à démontrer comment les jeunes voyageurs auraient pu atteindre le Bahr-el-Ghazal en marchant « vers l’Ouest » ; mais il convient de se rappeler qu’Hérodote nous dit que les Nasamons étaient en relations fréquentes avec Aoudjila, d’où l’on peut déduire que les cinq jeunes gens, s’aventurant vers des pays inconnus, commencèrent par se rendre à cette oasis et continuèrent leur voyage dans la même direction, c’est-à-dire vers le Sud. Il ne faut pas oublier en effet que le récit n’est arrivé aux oreilles d’Hérodote que par une suite d’intermédiaires : les points relatifs aux nains et à la rivière, qui sont les points saillants de l’histoire, ont pu se transmettre sans altération, tandis qu’il est fort possible que la direction générale du voyage ait[49] été modifiée par la tradition. D’autre part il est juste d’observer qu’Hérodote, supposant que le Nil traversait toute la Libye avant d’arroser l’Egypte, identifiait implicitement son cours supérieur avec notre Niger moyen.
| Delafosse | Planche III |
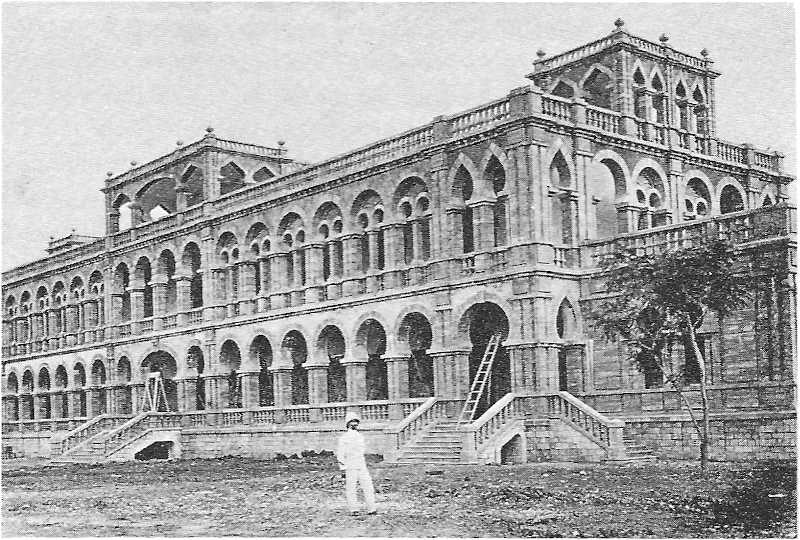
Fig. 5. — Koulouba, le palais du Gouverneur (pendant la construction).
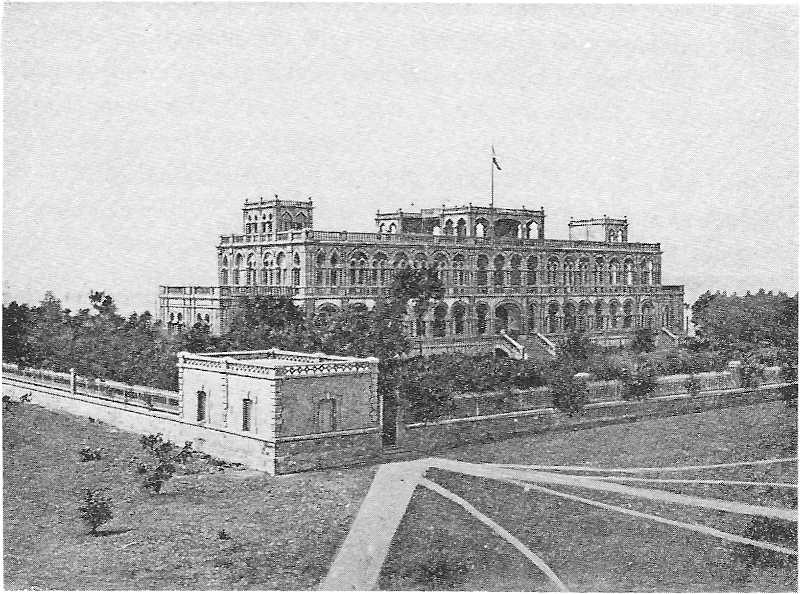
Fig. 6. — Vue générale actuelle du palais du Gouverneur, à Koulouba.
Et c’est là surtout ce qui est intéressant au point de vue de l’idée que pouvaient se faire les anciens du régime hydrographique du Soudan : pour Hérodote, le Sud de la Libye était traversé par un grand fleuve allant de l’Ouest à l’Est qui, arrivé en Nubie, devenait le Nil. Et c’est cette idée, plus ou moins modifiée, qui sera admise par tous les géographes, jusqu’à une époque relativement récente.
Cependant le philosophe grec Aristote, qui vivait un siècle après Hérodote (384 à 322 avant J.-C.), adopte une autre théorie qui, elle aussi, aura plus tard de nombreux partisans, entre autres Léon l’Africain : pour lui, d’une source commune située quelque part au centre du Soudan, partaient deux grands fleuves ; l’un, se dirigeant vers l’Est, puis vers le Nord, pour se jeter dans la Méditerranée, était le Nil ; l’autre, coulant de l’Est à l’Ouest, allait se jeter dans l’Océan Atlantique, correspondant ainsi au Sénégal. Ce second fleuve est appelé Krémétès par Aristote, et dans ce nom on pourrait à la rigueur retrouver le Chrétès de Hannon. Du Niger ou d’un fleuve correspondant au Niger, il n’est pas question dans Aristote, qui le confondait par conséquent, soit avec le Nil, soit plutôt, renversant son cours, avec le Krémétès ou Sénégal.
L’historien grec Polybe exécuta vers 130 av. J.-C., sur l’ordre de Scipion Emilien, une reconnaissance nautique le long de la côte occidentale du Maghreb. Au-delà du fleuve Darat (Oued Draa), il rencontra le cap Barce (sans doute le cap Juby), puis plus au Sud le fleuve Palsus (peut-être la Saguiet-el-Hamra) et, plus au sud encore, le fleuve Bambotus, qui abondait en crocodiles et en hippopotames et qu’on a cru pouvoir, à cause de cela, identifier avec le Sénégal.
Vers 110 avant J.-C., un Grec, connu sous le nom d’Eudoxe de Cyzique, équipa trois vaisseaux et partit de la Méditerranée par Gadès et le détroit de Gibraltar, avec l’intention de renouveler, en sens inverse, le périple accompli sous Néko II. Mais, à quelque[50] distance des colonnes d’Hercule, il perdit l’un de ses bâtiments et, devant les murmures de son équipage, dut revenir sur ses pas. Plus tard il organisa une seconde expédition qui fut sans doute aussi malheureuse mais dont, en tout cas, on a toujours ignoré le résultat. Nous devons la mention de ces tentatives à Strabon, à Pomponius Mela et à Pline l’Ancien.
En somme, après Aristote, il nous faut arriver au naturaliste latin Pline l’Ancien (23 à 79 après J.-C.) pour trouver des informations nouvelles sur les fleuves du Soudan. Ces informations sont d’ailleurs peu explicites et assez confuses, mais elles sont cependant intéressantes parce que c’est à elles que le Niger doit son nom actuel. En effet, Pline situe dans le sud de la Libye un fleuve qu’il appelle Nigris et qui, très probablement, correspondait dans son esprit avec notre Niger. Ailleurs, en racontant l’expédition de Suétonius Paullinus dans le sud marocain, laquelle eut lieu en 41 après J.-C., Pline nous dit qu’à quelques milles au Sud des monts Dyrin, c’est-à-dire de l’Atlas, dans un désert de sable noir, le général romain découvrit une rivière appelée Ger (prononcez « Guer ») : cette rivière était très vraisemblablement le Guir de nos cartes, lequel sort de la région de Bou-Denib et se dirige vers le Touat sous les noms successifs de Saoura et Oued Messaoud ; mais Pline crut pouvoir identifier le Ger découvert par Suétonius Paullinus avec un fleuve qu’il connaissait d’après ce qu’en avait dit peu avant lui le roi de Numidie Juba II, lequel vécut de 25 avant J.-C. à 22 après J.-C. Les informateurs de Juba appelaient ce fleuve Niger (prononcez « Niguer ») ; ils le faisaient sortir d’un lac appelé Nilis, situé non loin de l’Atlantique, d’où il coulait vers l’Est, pour se perdre ensuite sous terre et reparaître, très au delà, sortant d’une source appelée Nigris ; ensuite, prenant le nom d’Astapus, constituait l’une des branches du Nil.
Assurément, la rivière rencontrée par Suétonius Paullinus n’était pas notre Niger, ni, très probablement, le Niger de Juba. Mais la théorie de Pline devient facile à comprendre si l’on se reporte à celle développée plus tard par Ptolémée et si l’on conjecture que Pline identifiait le Ger de Suétonius Paullinus avec un cours d’eau relativement voisin du Guir et de cours[51] analogue, au moins à ses débuts, c’est-à-dire avec l’une des branches de l’Oued Ziz : actuellement, après avoir arrosé le Tafilelt, cette rivière semble aller se perdre au Sud de cette province, dans les sables de l’Erg Iguidi, à hauteur du Gourara ; mais elle a pu, autrefois, se continuer jusqu’à la dépression du Faguibine par une série d’oueds temporaires dont on retrouve aujourd’hui les traces, avec, il est vrai, de nombreuses solutions de continuité dues sans doute à l’envahissement sablonneux de l’Iguidi, du Moughtir et du Djouf. Il ne paraît pas absurde en tout cas de supposer qu’à une époque lointaine le Niger possédait une branche saharienne, d’une direction générale Nord-Sud, qui naissait dans l’Atlas au Nord du Tafilelt, non loin des sources du Guir, passait à l’Ouest de Taodéni et d’Araouâne et venait, aux environs de l’emplacement actuel de Tombouctou, mais plutôt à l’Ouest de cet emplacement, se joindre à la branche soudanaise venant des montagnes de Guinée[11]. Il est fort possible que ce soit le cours supérieur de cet hypothétique Niger saharien, quelque chose comme l’Oued Ziz actuel, que Pline ait confondu avec le Ger de Suétonius Paullinus et qu’il ait cherché à identifier d’autre part avec le Niger du roi berbère Juba.
En ce qui concerne ce roi, il est permis de supposer que, par ses compatriotes sahariens, il avait une certaine connaissance du Niger proprement dit ou tout au moins de son existence ; les renseignements qu’il a donnés et qu’a utilisés Pline s’accordent avec les croyances anciennes sur le régime fluvial du Soudan : son lac Nilis pouvait correspondre à la région lacustre allant du Débo au Faguibine, à partir de laquelle en effet le Niger coule vers l’Est ; le cours inférieur du fleuve étant sans doute totalement inconnu des Numides, Juba supposait que, à peu[52] près vers le Gao actuel, les eaux du Niger se perdaient sous terre, hypothèse que justifiait la connaissance qu’il avait probablement de plusieurs oueds sahariens à cours souterrain, tels que l’Oued Rirh ; peut-être aussi avait-il une vague notion de l’existence du Tilemsi et le prenait-il pour un épanchement des eaux du Niger dans les terres. Son Nigris, point de réapparition superficielle du fleuve, pouvait correspondre au Tchad, d’où, suivant la croyance générale, il faisait sortir l’une des branches supérieures du Nil sous le nom d’Astapus.
Ce qui en tout cas mérite d’être retenu des indications fournies par Pline et ce qui en effet a été retenu, c’est le nom de Niger donné à un fleuve important et quelque peu mystérieux qui arrosait les terres inconnues situées au delà de la Libye désertique. Ce nom est parvenu jusqu’à nous et nous l’appliquons à un fleuve qui peut ne pas appartenir au bassin entrevu par Suétonius Paullinus ni à celui soupçonné par Juba, mais qui en tout cas est bien, par l’une au moins de ses parties, le fleuve qu’avait deviné Pline.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans toute cette affaire, c’est que cette appellation de « Niger » pouvait s’appliquer parfaitement à la rivière rencontrée près de l’Atlas par le général romain et qu’elle s’applique mieux encore au fleuve aujourd’hui bien connu qui passe près de Tombouctou et arrose Gao. En langue berbère en effet, la syllabe gher ou ghir est un radical exprimant l’idée d’« eau mouvante » et désignant soit la mer soit un fleuve, comme en arabe le mot bahr : c’est ainsi que, actuellement encore, le nom de Ghir (Guir) est donné à la rivière d’Igli et que les Oulmidden appellent le fleuve de Gao egheriou-n-igheriouan ou gher-n-igheren, c’est-à-dire « le fleuve des fleuves », expression qui peut très bien, de la part d’un voyageur ignorant le berbère, être traduite par « le fleuve Niger ». Et, quel que soit le degré d’exactitude des informations recueillies par Pline, c’est bien là l’étymologie du nom du Niger, qui n’a aucun rapport avec la couleur de peau de ses riverains, de même que les dérivés Nigrites, Nigritæ et Nigritia, qu’en ont tirés les Grecs et les Latins, voulaient dire simplement « les gens du Niger, la région du Niger » : ce n’est qu’à[53] une époque récente (XVIe siècle) que l’ignorance de certains cartographes a fait de « Nigritie » le synonyme de « Soudan », c’est-à-dire de « pays des Nègres », et que des ethnologues aussi mal informés ont inventé une « race nigritique » opposable à la race blanche ; en réalité les Nigrites des anciens étaient des « Nigériens », comprenant des Berbères blancs aussi bien que des Nègres, et « Nigritie » est l’équivalent absolu du nom de Nigeria donné par les Anglais à leur colonie riveraine du Niger[12].
Le mathématicien et géographe grec Ptolémée, qui vivait un siècle après Pline l’Ancien et qui composa sa géographie vers 150 après J.-C., d’après des documents antérieurs et en particulier d’après ceux de Pline et de Martin de Tyr, nous a donné une description relativement étendue du cours du Niger. Il cite un certain nombre de villes voisines ou riveraines de ce fleuve et donne même la position astronomique de l’une d’elles, qu’il appelle Thamondakana. Malheureusement les latitudes et les longitudes de Ptolémée, obtenues à l’aide de l’évaluation des distances par journées de marche, sont rarement exactes, surtout lorsqu’il s’agit de pays éloignés de sa base d’opérations et sur lesquels il ne possédait que peu de renseignements, et c’était le cas des pays nigériens.
Ptolémée distingue nettement le Nigher ou Nighir du Gher ou Ghir, mais il semble bien que son Niger, au moins dans sa partie supérieure, était celui de Pline interprétant à sa manière Suétonius Paullinus, c’est-à-dire l’Oued Ziz : il fait en effet sortir l’une de ses branches septentrionales du mont Sagapola, d’où il fait naître également le Subus, c’est-à-dire le Sebou qui passe à Fez, et l’autre du mont Usargala, près duquel il place aussi la source du Ghir, lequel était sans doute le vrai Ger de Suétonius Paullinus et très probablement notre Oued Guir actuel[13].[54] Ces deux branches septentrionales correspondraient bien avec les deux principales branches de l’Oued Ziz.
D’autre part, il faisait sortir la branche maîtresse de son Niger du mont Mandros, qu’il donne également comme source au Salathos qui représente probablement le Tensift ou fleuve de Marrakech et au Massa (Masatat de Pline) qui sans doute est le Sous actuel. Cela laisserait supposer que le Niger de Ptolémée était formé par la réunion de l’Oued Ziz avec le Dadès, ou branche supérieure du Dara ou Oued Draa, ce qui est évidemment impossible. Mais il ne convient pas d’accorder une trop grande confiance aux renseignements de Ptolémée, même pour ce qui regarde la région voisine de la Méditerranée : ne fait-il pas en effet sortir du même mont Usargala le Nighir (admettons que ce Nighir soit l’Oued Ziz), le Ghir et le Bagradas, alors que ce dernier fleuve est sans doute le Bedjerda ou Medjerda, qui se jette dans le golfe de Tunis et qui prend sa source dans l’Aurès à près de mille kilomètres de l’Atlas Marocain ? Ne nous dit-il pas d’autre part que le Dara ou Oued Draa de nos cartes, qu’il appelle Daras ou Darados, sort d’un mont Kaphas voisin de ses monts Sagapola et Usargala et situé comme eux dans l’Atlas Marocain, ce qui est exact, et ailleurs que le même fleuve est une émanation de son Nighir ?
Quoi qu’il en soit, ce Nighir ou Niger, une fois formé par la réunion des trois branches sorties de l’Atlas Marocain, se dirigeait vers le Sud, dans la direction d’un mont Thala (?) et allait aboutir à un lac Nigritique qui pourrait très bien correspondre à la région lacustre actuelle de Tombouctou (le Nilis de Pline) ; de là, il coulait vers l’Est pour aller former le lac Libyque (sans doute le Nigris de Pline, c’est-à-dire probablement le lac Tchad). Nous retrouvons encore ici la théorie faisant couler le Niger vers le Tchad, et ensuite vers le Nil.
Quant aux villes de la vallée nigérienne citées par Ptolémée, il semble bien, comme l’a soutenu Vivien de Saint-Martin[14], qu’elles appartenaient pour la plupart, non pas au Soudan, mais au Sahara ou en tout cas au pays berbère. Berlioux[15] a[55] voulu retrouver dans les noms donnés par Ptolémée des noms actuels de villes ou de pays soudanais, mais ses identifications me semblent bien hasardées, par exemple celle de Velegia avec « Oulmidden » et celle de Panagra avec « Demâgherim » ! Tout au plus peut-on rapprocher le Tagama de Ptolémée, qui d’après lui était une ville située sur la rive nord du Niger, du nom des « Tagama » ou « Teggama », tribu berbère citée par les auteurs arabes et que nous retrouvons aujourd’hui, sous le double nom de « Tagama » et de « Kel-Haoussa », sur la rive gauche du Niger dans la région de Tombouctou.
Quant à son Thamondakana, la longitude et la latitude qu’il en donne (17° de latitude nord et 23° de longitude est en partant des Canaries) correspondraient à peu près à celles de l’ancienne ville saharienne de Tadmekket ou Es-Souk, située au Nord de Gao ; mais nous avons vu avec quelle méfiance il convenait d’accepter les positions de Ptolémée. Qu’était sa Nighira Metropolis, située comme Velegia et Tagama sur la rive nord du Nighir ? Il serait bien difficile de le déterminer, à moins qu’on veuille l’identifier avec l’antique Ghâna, dont nous parlerons plus loin et qui se trouvait dans les environs du Néma actuel, non loin de Oualata, et au Nord-Ouest de la région lacustre du Débo et du Faguibine ou lac Nigritique de Ptolémée.
En ce qui concerne sa ville de Panagra, qu’il place aussi sur la rive nord du Nighir (alors qu’il place Thamondakana sur la rive sud), peut-être serait-il permis de la rapprocher du pays de Ouangara dont nous ont parlé les auteurs arabes et qui représentait pour les plus anciens d’entre eux, très vraisemblablement, les régions comprises entre la Falémé et le Niger et dont les districts aurifères du Bambouk et du Bouré ont fait la célébrité. Nous retrouvons encore ce nom, sous les formes Gbangara, Gouangara, Gangara et Gangaran, appliqué de nos jours à l’une des provinces de ce pays. Vers la fin du Moyen-Age, le nom fut donné indistinctement à tous les sujets de l’empire de Mali, lequel avait pris possession de ces mines d’or d’ailleurs voisines de son territoire primitif (le Manding actuel) ; plus tard encore, on s’en servit plus spécialement pour désigner ceux des sujets de l’empire qui habitaient son extrême nord,[56] c’est-à-dire les Soninké, qui avaient plus de contact que les autres avec les voyageurs venus du Maghreb. Il n’est pas téméraire de supposer que Ptolémée avait eu connaissance des mines d’or du Ouangara, puisque, vers 80 après J.-C., Julius Maternus s’était avancé du Fezzan jusque dans l’Aïr, pour obéir à l’ordre que lui avait donné l’empereur Domitien de rechercher les mines d’or déjà fameuses du pays des Noirs. Il n’est pas invraisemblable non plus de penser que Ptolémée situait ces mines plus au nord qu’elles ne sont en réalité, les plaçant sur la rive septentrionale du Sénégal au lieu de les mettre sur la rive méridionale, et qu’il faisait du fleuve qui arrose le Ouangara (le Sénégal) une simple dérivation du Niger : la même théorie a été adoptée plus tard par les géographes arabes et européens. Mais ce n’est là qu’une hypothèse.
L’ébauche rudimentaire de géographie soudanaise qu’avaient esquissée les savants grecs et latins demeura durant huit siècles en l’état où l’avait laissée Ptolémée, et il nous faut arriver aux Arabes pour la voir se développer et se préciser, dans des limites d’ailleurs restreintes. Au Xe siècle après J.-C., Ibn-Haoukal accomplit un voyage à la frontière septentrionale du pays des Noirs et vit une partie du cours moyen du Niger, qu’il baptisa du nom de Nil, supposant qu’il coulait vers l’Est jusqu’en Nubie et qu’il se confondait là avec le fleuve d’Egypte, ainsi que l’avaient supposé Pline et Ptolémée. Bekri, qui vivait au XIe siècle et qui, grâce sans doute à l’excellence des documents qu’il put utiliser, est certainement de tous les géographes arabes le meilleur et le plus exact en ce qui concerne le nord du Soudan, nous donne, le premier, des informations sur le cours du Sénégal et complète celles d’Ibn-Haoukal relatives au Niger ; malheureusement il confond ces deux fleuves sous le nom unique de Nil, bien qu’il les distingue cependant implicitement en faisant couler dans l’Atlantique le Nil de Tekrour et en faisant couler vers l’Est le Nil de Ras-el-Ma. Edrissi, qui vivait au siècle suivant, n’a guère fait que reproduire les indications de Bekri, avec beaucoup moins d’exactitude et de précision ; dans son ouvrage aussi il n’est question que du Nil, tantôt coulant de l’Est à l’Ouest dans la région de Tekrour et se jetant[57] dans l’Atlantique (Sénégal), tantôt coulant de l’Ouest à l’Est dans la région de Gao (Niger), pour aller se confondre en Nubie avec le Nil d’Egypte.
Le fameux géographe Yakout (XIIIe siècle) s’en tient également à l’appellation de Nil pour le Sénégal, le Niger et le vrai Nil ; mais il semble cependant avoir eu le pressentiment que le Nil de Gao (Niger) n’était pas le même fleuve que le Nil d’Egypte, qu’il fait sortir des « monts de la Lune ». Ibn-Saïd, qui mourut en 1286, fait délibérément un même bassin fluvial du Niger, du lac Tchad et du Nil, et englobe le tout sous le sempiternel nom de Nil ; Aboulféda fait de même au début du XIVe siècle : ces deux géographes semblent avoir ignoré le Sénégal. Il en est de même du célèbre voyageur Ibn-Batouta qui, vers 1352, visita une partie du haut Niger un peu en amont de Ségou et décrivit le cours de ce fleuve en aval jusqu’au Noupé : pour lui aussi, ce fleuve était le Nil et, du Noupé, il le fait aller à Dongola.
A l’époque où Ibn-Batouta accomplissait son voyage, des navigateurs normands, espagnols et italiens avaient commencé déjà à longer la côte occidentale d’Afrique et avaient redécouvert, environ deux mille ans après l’amiral carthaginois Hannon, l’embouchure du Sénégal : ce sont eux qui donnèrent à ce fleuve le nom qu’il porte encore. On dit communément que cette appellation lui vient de ce que les Berbères Zenaga ou Sanaga habitaient sa rive nord, mais il se pourrait fort bien que cette étymologie soit inexacte et que le Sénégal ait reçu son nom du pays que traverse son cours inférieur : ce pays est appelé Senegana ou Sangana par Bekri, qui semble appliquer ce terme à une région ou à une tribu occupant à peu près le territoire que se partagent aujourd’hui les Maures Trarza et les Ouolofs, c’est-à-dire à cheval sur le bas Sénégal. Ce nom de Senegana n’a assurément rien à faire avec celui des Zenaga : d’abord parce que l’orthographe adoptée par Bekri pour les deux mots est complètement différente ; ensuite parce que les Maures ont conservé de nos jours encore ce terme, sous la forme Isongân, pour désigner la rive ouolove du bas Sénégal, et qu’ils prononcent et écrivent de façon très distincte ce dernier mot d’une[58] part et le nom des Zenaga de l’autre ; enfin parce qu’il est plus que probable que, au temps de Bekri, les Zenaga venaient seulement de se porter jusqu’au Sénégal, que les Noirs étaient encore beaucoup plus nombreux que les Berbères sur la rive nord et que les Senegana ou gens du Senegana étaient — Bekri le dit explicitement — des Nègres et non pas des Berbères.
Lors des voyages de navigation accomplis à hauteur du Cap Vert dans la première moitié du XIVe siècle, il est probable que les Zenaga étaient répandus déjà dans le pays actuel des Trarza, mais il devait y avoir encore beaucoup de Noirs au nord du Sénégal, et il n’est même pas invraisemblable de supposer que ces Noirs possédaient le territoire et peut-être exerçaient l’hégémonie politique. En tout cas le Senegana ou Isongân devait comprendre alors les deux rives du bas fleuve et c’est probablement le nom de ce pays qui fut donné par les premiers navigateurs européens au fleuve qui le traversait.
Sur l’une des premières cartes que nous possédions de cette région, le portulan des Médicis de 1351, le fleuve Sénégal figure sous le nom de Senegany[16]. Les cartes postérieures adoptèrent en général l’orthographe Senega, Sanaga ou Çanaga ; ce n’est qu’au XVIIIe siècle, semble-t-il, que l’on commença à employer l’orthographe « Sénégal »[17]. Mais il est à remarquer que, jusqu’au XVIe siècle, presque toutes les cartes portent deux orthographes différentes pour le nom des Zenaga et celui du fleuve Sénégal : c’est ainsi que Denis Fernandez (1446) appelle les premiers Assenages et le second Sanaga, que Cadamosto (1455) appelle les premiers Azanaghes et le second Senega et parle d’un royaume de Senega qui était le Djolof, que la carte de Thevet (1575) porte un royaume des Zanhaga à hauteur du cap Blanc et plus au sud un royaume de Sénéga bordé au nord par un fleuve Sénéga arrosant une ville de même[59] nom, que la carte de Livio Sanuto (1588) indique les Zanhagæ populi et le Çanaga fluvius. Marmol (fin du XVIe siècle) nous dit bien que l’on a appelé momentanément le fleuve arrosant le royaume de Gualata (Oualata) « rivière des Sénègues » (c’est-à-dire des Zenaga), mais il entendait sans doute par là le Niger et non le Sénégal ; en tout cas il nous apprend que le bas-fleuve — ici, c’est bien du Sénégal qu’il s’agit — était appelé Senedec par les Sénègues (Zenaga) et Senega par les Portugais parce qu’un navigateur de cette nation — il s’agit de Lancelot du Lac, qui visita le Sénégal en 1447 — avait donné au fleuve le nom d’un royaume avec le prince duquel il avait trafiqué tout d’abord[18] : les habitants de ce royaume, des Ouolofs sans doute, appelaient eux-mêmes ce fleuve Ovidech. Marmol ajoute que la langue des Ouolofs était le zungay et Moore, dans ses Travels in Africa (1737), appelle les Ouolofs Zanguay. Il semble permis de conclure de tout cela que le nom du Sénégal vient, plutôt que de celui des Zenaga, du mot Senegana ou Senegan, qui désignait autrefois les Ouolofs et leur pays et qui désigne encore de nos jours, au moins parmi les Maures, la partie de la vallée du Sénégal habitée par les Ouolofs.
Cadamosto, qui visita en 1455 et 1457 la côte du Sénégal, fait de ce fleuve, du Niger et du Nil un même cours d’eau sortant de l’intérieur du continent et envoyant une branche vers l’Egypte et une autre (le Niger) vers l’Atlantique, où elle se déversait par deux canaux, le Sénégal et la Gambie. Le voyageur arabe Hassan-ibn-Mohammed, plus connu sous le nom de Léon l’Africain, qui écrivit son récit vers 1520, partage à peu près la même opinion : il place la source du Niger dans un grand lac situé dans le désert de Séou (probablement le Tchad,[60] qui avoisine le pays des Arabes Shoa) et le fait couler vers l’Ouest jusqu’à ce qu’il atteigne l’Océan, le confondant ainsi avec le Sénégal ; il ajoute que ce fleuve dérive d’un bras du Nil qui, après avoir passé sous terre, est venu former le lac d’où sortirait le Niger. Ramusio (1550) établit, d’après les indications fournies par Léon, une carte sur laquelle le Niger, à hauteur de Tombouctou, commence à former un delta dont les bras principaux sont le Sénégal, la Gambie et le Rio-Grande. Joao de Barros (1552-53) continue la même tradition, réduisant seulement le delta au Senega et à la Gamber. Forlani de Vérone (1562) et Ortelius (1570) adoptent à peu près le même système : la mappemonde d’Ortelius fait déverser le Niger dans l’Océan par le Sénégal et le Rio-Grande. Thevet (1575) reproduit sur sa Table d’Afrique les indications de Ramusio et donne trois bouches au Niger : le Sénégal, la Gambie et le Rio-Grande ; la principale nouveauté de sa carte consiste dans la traduction naïve qu’il a faite du mot « Niger » : il inscrit délibérément Noir Fl. Quant à Marmol, qui s’inspire surtout de Barros dans sa Descripcion general de Africa parue de 1573 à 1599, il en tient pour le delta formé du Sénégal et de la Gambie ; il nous apprend d’autre part que son « Niger-Sénégal » porte, de Tombouctou à l’Océan, les noms successifs de Oued-Nichar (rivière Niger) chez les Arabes, Yça ou Iza chez les gens de « Tombut », Zimbala ou Zimbale chez les gens habitant à l’Est du « Tocror », Colle chez les « Saragoles », Maye chez les « Turcorons » ou « Tucorons » ou « Tucorols », Dengueh chez les « lalofes » ou « Gelofes » et Senedec chez les « Sénègues », l’appellation Senega étant donnée par les Portugais à l’extrémité de son cours inférieur ; il ajoute que le confluent du « fleuve blanc » (Bakhoy) et du « fleuve rouge » (Baoulé) est appelé Busitemba par les « Saragoles »[19].
[61]Livio Sanuto (1588) s’écarte de ses prédécesseurs en énumérant trois fleuves à peu près parallèles coulant de l’Est à l’Ouest et se jetant dans l’Atlantique, avec sources, cours et embouchures distincts ; ces fleuves sont, du Nord au Sud : le Çanaga, qui d’ailleurs représente à la fois le moyen Niger et le Sénégal, la Gambia et enfin le Niger, qui en réalité correspond au Rio-Grande.
A la fin du XVIIe siècle, le géographe hollandais Dapper confondait encore en un seul fleuve le Niger et le Sénégal et lui attribuait un cours Est-Ouest avec delta multiple. Il identifie à la légère le Sanaga avec le Daras de Ptolémée — lequel était le Dara ou Oued-Draa, comme je l’ai dit plus haut — et reproduit les indications de Marmol sur l’origine du nom donné au Sénégal par les Portugais, ainsi que sur les différentes appellations de ce fleuve et du Niger le long de leur parcours, ajoutant seulement que le mot Zimbala est usité chez les Baganes, c’est-à-dire sans doute les Mandé du Bagana ou Baghena.
Quatre ans après que l’ouvrage de Dapper avait été traduit en français, en 1690, le sieur La Courbe, inspecteur général de la Compagnie du Sénégal, poussait une reconnaissance jusqu’aux chûtes du Félou (près et en amont de Médine) et affirmait, le premier, que le Sénégal et le Niger ne pouvaient être un seul et même fleuve.
Cependant les géographes furent quelque temps encore avant d’admettre la vérité : Guillaume Delisle partagea d’abord l’erreur ancienne et, dans ses cartes publiées de 1700 à 1707, confondit, lui aussi, le Sénégal avec le Niger ; mais en 1722, il attribua un bassin distinct à chacun des quatre fleuves auxquels il donna les noms de Sénégal, Gambie, Rio-Grande et Niger. Enfin d’Anville, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, revint à la théorie des grands géographes arabes et fit couler le Niger vers l’Est, réalisant d’ailleurs sur les arabes un réel progrès, puisqu’il distinguait nettement son bassin de celui du Sénégal ;[62] mais il ignorait encore le cours inférieur du Niger et le faisait se terminer dans l’intérieur du Soudan.
Ce n’est qu’en 1830 que le problème de l’embouchure du Niger fut définitivement résolu. Mungo-Park, lorsqu’il partit en 1795 pour son premier voyage, était persuadé que le Niger allait se jeter dans le Congo ; il ne put alors le descendre que jusqu’à quelque distance en aval de Sansanding et fit en 1805 une nouvelle tentative qui se termina, l’année suivante, par sa mort et celle de ses derniers compagnons dans les rapides de Boussa, en sorte que le bas Niger avait encore gardé son secret. D’autre part Mungo-Park, en accréditant, sur la foi de renseignements erronés, la légende des montagnes de Kong, contribua à perpétuer l’ignorance dans laquelle on était de l’hydrographie de la Boucle du Niger et en particulier du cours supérieur de la Volta, ignorance qui ne prit fin qu’en 1889 avec l’exploration de M. Binger. Cependant en 1817 James Riby, devançant les découvertes ultérieures, affirmait que le Niger, après avoir décrit l’arc de cercle que l’on connaissait déjà, venait se jeter dans le golfe de Guinée. L’année suivante Mollien, sans reconnaître précisément l’emplacement exact des sources du Sénégal et de la Gambie, donnait de bonnes indications sur la région d’où sortent les hauts affluents de ces deux fleuves et détruisait définitivement la légende des communications de ces fleuves entre eux ou de l’un d’eux avec le Niger. Quatre ans plus tard (1822), Gordon Laing indiquait la place approximative des sources du Niger. Peu après (1824), Denham, Clapperton et Oudney démontraient que le Niger et le Tchad constituaient deux bassins entièrement différents. Enfin, en 1830, Richard Lander, ancien domestique de Clapperton, qui avait déjà atteint Boussa en 1826 avec son maître, peu avant la mort de ce dernier à Sokoto, gagnait le fleuve à ce même point de Boussa qui avait été le terminus malheureux du voyage de Mungo-Park, et le descendait en pirogue jusqu’au golfe de Bénin : le cours entier du grand fleuve soudanais, au moins dans ses grandes lignes, était définitivement connu, dix-huit siècles après que Pline en avait parlé pour la première fois. Il ne demeurait à déterminer que l’emplacement exact de ses sources, dont l’une des principales[63] — celle du Tembiko — fut découverte le 30 octobre 1879 par Zweifel et Moustier, agents de l’armateur C.-A. Verminck de Marseille.
Restait la Volta, à laquelle, en raison de la croyance à la fameuse chaîne des montagnes de Kong, on n’accordait qu’une étendue fort restreinte. C’est seulement en 1889 que, revenant en France après sa superbe exploration, M. Binger révélait l’inexistence de cette chaîne et donnait, sur le cours supérieur et l’importance de la Volta, des indications très précises que les voyageurs qui le suivirent n’eurent qu’à compléter[20].
Bassin de la Comoé. — Les cours d’eau qui arrosent le Haut-Sénégal-Niger appartiennent tous aux bassins de quatre fleuves, d’importance très diverse, qui sont, par ordre de longueur, le Niger, la Volta, le Sénégal et la Comoé[21].
La Comoé n’a, en ce qui concerne sa branche principale, qu’une longueur totale de 750 kilomètres environ ; ce fleuve[64] n’intéresse que médiocrement le Haut-Sénégal-Niger, car il ne l’arrose que par la partie supérieure de ses branches extrêmes, la Léraba (fleuve de Léra) ou haute Comoé occidentale et la Komonoba (fleuve des Komono) ou haute Comoé orientale, et quelques-uns de leurs affluents ; ces branches ou affluents, souvent à sec ou presque durant une partie de l’année, ne sont jamais navigables, même pour des pirogues, et, loin de concourir à la fertilité du pays qu’ils arrosent, ils le rendent au contraire en partie inhabitable en raison des vastes marécages, inutilisables et malsains, dont ils se trouvent bordés à la saison des hautes eaux. On sait d’ailleurs que le cours inférieur de la Comoé est lui-même impropre à la navigation, étant coupé fréquemment, jusqu’à 60 kilomètres environ en amont de son embouchure, par des rapides que les plus petits vapeurs et souvent même les pirogues ne peuvent franchir, et se trouvant privé d’accès du côté de la mer par suite de la barre de Grand-Bassam.
Notons, à titre documentaire, que la Léraba et la Komonoba ou Baoulé prennent toutes les deux leur source, à peu de distance l’une de l’autre, dans le pays des Tagba ou Tagoua (cercle de Bobo-Dioulasso), entre Sifarasso et Ouorodara, à peu près à hauteur de Bobo-Dioulasso et à l’Ouest de cette ville.
Bassin du Sénégal. — Tout autre est le Sénégal : non seulement ce fleuve, depuis la plus reculée de ses sources — celle du Bafing — jusqu’à son embouchure, mesure environ 1.500 kilomètres de long, c’est-à-dire le double de la Comoé, mais sa largeur, son débit d’eau, sa profondeur relative même aux plus basses eaux dans la partie inférieure de son cours, ses rives nettement délimitées qui se prêtent peu aux débordements, la possibilité pour les navires — quoique non continue et souvent malaisée — de franchir la barre de Saint-Louis et de passer directement de l’Océan sur le fleuve, enfin et surtout les 700 kilomètres de Saint-Louis à Kayes navigables en toute saison pour des chalands, cinq mois de l’année pour des vapeurs calant 1 m. 30 et deux à trois mois pour des navires de fort tonnage à 4 mètres de tirant d’eau, font du Sénégal une précieuse voie de transport pour la colonie du Haut-Sénégal-Niger.[65] Bien que les irrégularités de la navigation ne donnent pas entière satisfaction et que l’on se trouve forcé de doubler, en quelque sorte, le Sénégal, par la voie ferrée en construction de Kayes à Thiès-Dakar, il n’en est pas moins vrai que le Sénégal a été jusqu’ici la seule voie d’accès vers le Soudan Français et qu’il demeurera toujours, même après l’achèvement du Thiès-Kayes, une excellente et économique voie de transport durant une partie de l’année.
Le Sénégal proprement dit est formé à Bafoulabé (rencontre des deux fleuves) par la réunion du Bafing (fleuve noir) et du Bakhoy ou Badié ou encore Bagoué (fleuve blanc) ; ce dernier lui-même doit son importance à son affluent le Baoulé (fleuve rouge), qu’il reçoit entre Toukoto et Badoumbé. Le Bafing prend sa source en Guinée, non loin de Timbo et du col de Koumi, dans le même massif d’où sort le Tinkisso, l’une des branches du haut Niger. Le Bakhoy naît également dans la Guinée, à quelque distance au Nord-Ouest de Siguiri. Quant au Baoulé, son bassin est tout entier compris dans le Haut-Sénégal-Niger : il est formé à l’origine par plusieurs ruisseaux qui prennent leur source dans les collines longeant le Niger entre Kangaba et Bamako et dont l’un sort de Kati, à douze kilomètres seulement du Niger, ce qui indique combien est étroite la zone séparant le haut bassin du Sénégal de la haute vallée du Niger.
Le Sénégal ne devient navigable qu’en aval de Kayes, après avoir reçu sur sa rive droite un affluent assez important, le Kolembiné (rivière noire), qui provient de la région des mares avoisinant Nioro. Un peu au-delà d’Ambidédi, un autre affluent vient aussi se jeter sur sa rive droite : c’est le marigot de Karakoro, qui sert de limite entre le Haut-Sénégal-Niger et la Mauritanie. Enfin, un peu avant d’arriver à Bakel et au moment où il quitte le Haut-Sénégal-Niger, le Sénégal reçoit, sur sa rive gauche cette fois, un très important affluent, la Falémé, qui prend sa source sur la frontière de la Guinée, non loin de la source de la Gambie, et sert de limite au Haut-Sénégal-Niger depuis son cours supérieur jusqu’à son embouchure, à l’exception d’une faible portion de son cours inférieur, à hauteur de[66] Tamboura et de Sénoudébou, où ses deux rives appartiennent à la colonie du Sénégal.
Bassin de la Volta. — La Volta est un peu plus longue que le Sénégal, puisqu’on compte plus de 1.600 kilomètres depuis la source extrême de la Volta Noire jusqu’à l’embouchure du fleuve dans le golfe de Guinée. Mais elle présente, en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger, un intérêt bien moindre que le Sénégal : d’abord son embouchure est située dans une colonie anglaise (Gold-Coast) et son cours inférieur est tout entier en pays étranger, tantôt coulant à travers la colonie anglaise, tantôt servant de limite entre celle-ci et la colonie allemande du Togo ; ensuite son embouchure est à peu près dans la même situation que celle de la Comoé, c’est-à-dire obstruée par une barre infranchissable aux navires ; enfin le bief inférieur, où des embarcations d’un certain tonnage peuvent circuler, ne commence qu’après que le fleuve a pénétré en Gold-Coast, près du confluent de la Volta Noire et de la Volta Blanche. A la vérité, on peut utiliser une partie de la Volta Noire coulant en territoire français, depuis Koury jusqu’au confluent du Bougouriba et même à la rigueur jusqu’à la rencontre du 10° de latitude nord (environ 350 kilomètres), pour la navigation à l’aide de chalands plats de 2 à 5 tonnes ; mais ces transports, sans issue vers le Sud ni le Nord, ne peuvent présenter qu’un intérêt purement local et ils ne seraient appelés à quelque développement qu’au cas où la Volta Noire serait réunie, soit au Bani par une voie ferrée de Koury à San, soit au prolongement futur des chemins de fer de la Côte d’Ivoire, de la Guinée ou du Haut-Sénégal-Niger. De plus, s’il est en général aisé de descendre la Volta Noire en chaland, il est parfois très dur d’en remonter le courant. Enfin le manque de profondeur en amont de Koury, la fréquence des rapides en aval du 10° de latitude nord et la violence de ces rapides à partir du point où la Volta pénètre dans la Côte d’Ivoire restreignent par trop l’étendue de ce bief relativement navigable.
Les branches et gros affluents de la haute Volta, comme ceux de la haute Comoé, ont des bords excessivement marécageux et[67] inhabitables en général sur une largeur de 2 à 5 kilomètres sur chaque rive, tant à cause de la présence des mouches tsétsé qu’en raison de la nature argileuse du sol, qui se transforme en boue épaisse lors des inondations et se durcit quand les eaux se retirent. Ces inondations sont dues généralement, non pas au débordement des rivières — la Volta Noire en particulier a des berges très élevées —, mais au manque d’écoulement des eaux de pluie, qui s’accumulent le long du fleuve dans une sorte de cuvette plus basse que la berge et ne communiquant que de loin en loin avec la branche principale par des affluents qui d’ailleurs présentent la même disposition.
La Volta Noire ou occidentale est la plus longue et la plus importante des deux branches principales dont la réunion, près et à l’Ouest de Salaga, forme la Volta proprement dite. Elle prend sa source à Sifarasso, au Sud et près de la route de Sikasso à Bobo-Dioulasso, tout près des sources de la Comoé. Par suite d’un phénomène assez particulier, la Volta a un cours à peu près parallèle à celui du Niger, formant une boucle assurément beaucoup plus modeste que celle de ce dernier fleuve mais de courbe et de direction analogues : après avoir coulé vers le Nord-Est jusqu’à Koury — comme le Niger jusqu’à Tombouctou — elle s’infléchit ensuite vers l’Est, puis vers le Sud-Est, à peu près comme le Niger se comporte entre Tombouctou et le 11° de latitude Nord ; au delà du même parallèle, de même que le Niger se dirige nettement au Sud jusqu’à Djebba, pour couler ensuite vers l’Est-Sud-Est jusqu’au confluent de la Bénoué et reprendre enfin la direction du Sud jusqu’à son embouchure, de même la Volta fait du Sud pendant toute la partie de son cours qui sert de limite aux possessions françaises et anglaises, puis de l’Est-Sud-Est jusqu’au confluent de l’Oti et ensuite du Sud jusqu’à la mer.
Les principaux affluents de la Volta Noire, dans la partie de son cours appartenant au Haut-Sénégal-Niger, sont : sur sa rive droite, le Poni ou Bammasso qui arrose Gaoua et le Bougouriba qui arrose Diébougou ; sur sa rive gauche, le Sourou, qui naît non loin de Ouahigouya, décrit une boucle de sens opposé à celle de la Volta Noire et vient finir à Koury ; lorsque la crue se fait[68] sentir dans la haute Volta Noire, les eaux de ce fleuve s’engouffrent dans le Sourou, qui semble alors remonter vers sa source ; lorsque le niveau baisse dans le Volta, les eaux du Sourou reprennent leur cours normal et viennent à leur tour alimenter le fleuve principal.
La Volta Blanche ou orientale naît, dans les cercles de Ouahigouya et de Dori, par deux branches prenant leur source au Sud-Ouest et à l’Est de Djibo ; elle a un cours sensiblement Nord-Sud. Elle reçoit dans la Gold-Coast, sur sa rive droite, un affluent de médiocre importance qu’on appelle la Volta Rouge et dont le cours commence près et à l’Ouest de Ouagadougou.
La troisième branche de la Volta, l’Oti, est formée de la réunion du Pépiénou, qui prend sa source entre Koupéla et Fada-n-Gourma, et du Pendjari, qui naît au Dahomey et traverse, en faisant d’immenses détours, le cercle de Fada-n-Gourma.
Bassin du Niger. — Avec le Niger, nous arrivons à un bassin hydrographique d’une bien autre importance. Depuis le Tembi-Kounda (frontière de la Guinée et du Sierra-Leone) jusqu’à Akassa (point central du delta du Niger), l’immense nappe d’eau n’a pas moins de 3.800 kilomètres de long, soit presque exactement l’ensemble des longueurs totalisées de la Volta, du Sénégal et de la Comoé réunis.
Après s’être grossi du Milo à l’Est et du Tinkisso à l’Ouest, le Niger pénètre dans le Haut-Sénégal-Niger en aval de Siguiri, reçoit encore, sur sa rive droite, en face de Kangaba, le Sankarani, puis coule jusqu’à Koulikoro dans une vallée rocheuse souvent très resserrée, barrée de forts rapides entre Bamako et Koulikoro : parmi ces rapides, il convient de citer ceux de Sotuba, près de Bamako, où le bras le plus important du fleuve n’a pas toujours trente mètres de large.
En aval de Koulikoro, la vallée s’élargit ; les collines qui la forment s’abaissent et s’espacent peu à peu, les rochers font place aux bancs de sable, les berges s’aplatissent et le lit du fleuve se transforme petit à petit en une nappe dont la crue ou la décrue réglera seule l’étendue. A partir de Ségou, le Niger n’est plus un fleuve proprement dit, mais une vallée de faible[69] déclivité au milieu de laquelle coule une grande masse d’eau. A hauteur de Dienné et en aval, des communications s’établissent entre le Niger et le Bâni.
Ce Bâni (petit fleuve, en langue mandé) ou Mayèl-Balévèl (rivière noire, en langue peule) est en somme le seul affluent important du Niger, mais il constitue à lui seul un véritable fleuve dont la branche principale a plus de 900 kilomètres de long. Cette branche principale, appelée Bâgbê ou Bagoé (fleuve blanc) dans son cours supérieur, prend sa source à la Côte d’Ivoire, au Sud de la route d’Odienné à Tombougou, pénètre dans le Haut-Sénégal-Niger entre Tengréla et Ngorho, se grossit successivement du Bâfing (fleuve noir), du Bânigbê (petit fleuve blanc) et du Baoulé (fleuve rouge), qui tous les trois proviennent aussi de la Côte d’Ivoire, puis du Bânifing (petit fleuve noir), devient le Bâni, passe à San et à Dienné, et se confond avec le Niger à Mopti.
Comme je le disais plus haut, des communications se sont déjà établies entre le Niger et le Bâni, ou plutôt, comme ce n’est plus assez de deux vallées pour charrier l’énorme quantité d’eau qui arrive des deux côtés de Dienné, le Niger se transforme en un lacet de canaux auquel vont bientôt s’entremêler des lacs et qui va constituer un système excessivement curieux et intéressant depuis Dienné jusqu’à Tombouctou. Reconnaître, en cette région, où se trouve le lit propre du Niger est chose à peu près impossible.
A Diafarabé, à l’Ouest-Nord-Ouest de Dienné, le fleuve forme un V dont l’un des bras se dirige vers Mopti (qui s’appelle en songaï Issa-ka, c’est-à-dire « arrivée du fleuve ») et l’autre, dit Dia ou Diaga, vers le lac Débo. En aval de Mopti, nouvelle communication par un canal transversal entre les deux canaux principaux, qui se réunissent dans le lac Débo après avoir donné naissance à un troisième canal, le Kolikoli, lequel se dirige vers Saraféré par le lac Korienza. A la sortie du Débo, l’un des deux canaux principaux, l’Issa-Ber (grand fleuve, en songaï), se dirige vers Niafounké, tandis que l’autre, le Bara-Issa (fleuve du Bara), va rejoindre à Saraféré le canal de Korienza. Les deux branches maîtresses se réunissent ensuite près d’El-Oualedji,[70] à l’endroit appelé Issa-feï (partage du fleuve), pour former peu après, en se séparant encore une fois, l’île de Koura, un peu en aval de Tombouctou.
Entre Niafounké et El-Oualedji, la branche occidentale dessert plusieurs lacs, dont les principaux sont le lac Horo et le lac Fati et ceux de moindre importance les lacs Tenda, Kabara, Soumpi, Takadyi et Gaouati ; entre El-Oualedji et Koura, elle dessert encore les grands lacs de Goundam et de Ras-el-Ma ou Hari-bongo ou encore Issa-bongo (mots qui veulent dire, le premier en arabe et les deux autres en songaï, « tête de l’eau » ou « tête du fleuve ») : lacs Télé, Faguibine ou Fangabina, Daouna-keïna et Daouna-ber, tandis que la branche orientale dessert les lacs Haribongo, Garou, Dô, Nangaï, Hagoundou, Koratou, etc.
Toute cette partie de la vallée du moyen Niger, comprise, d’une façon générale, entre Sansanding et Tombouctou, est une véritable région lacustre, dont l’aspect se modifie étrangement selon les saisons et où, indépendamment des bras et lacs principaux qui viennent d’être énumérés, existent de nombreux canaux de dérivation et lacs ou mares temporaires : cette région constitue la zone d’inondation du Niger, zone qui, aux périodes de grande crue, couvre en largeur une étendue de 150 à 200 kilomètres d’où n’émergent plus que les mamelons où sont construits les villages.
Il est facile de conclure de ce qui précède quelle est l’importance du Niger au double point de vue de l’agriculture et des facilités de transport. Les terres de la vallée nigérienne, dont la nature argileuse est tempérée par une quantité suffisante de sable, ne deviennent pas dures et cassantes, comme celles du bassin de la Volta, lorsque les eaux d’inondation se retirent : elles deviennent au contraire un sol merveilleusement fécond et propice à la culture, comme à la croissance d’herbes de pâturage, et il n’est pas téméraire de penser que, maintenant que la sécurité assurée aux indigènes leur permet de s’attacher davantage à leur sol, la région du moyen Niger deviendra rapidement la plus riche de tout le Soudan.
D’autre part les produits qui y seront récoltés trouveront[71] dans le Niger lui-même une voie de transport économique et relativement constante : des vapeurs à faible tirant d’eau peuvent en effet circuler durant six mois de l’année entre Koulikoro et Gao, et le reste du temps des chalands peuvent être utilisés dans des conditions satisfaisantes. Ces chalands peuvent même, en janvier et février, continuer au-delà de Gao jusqu’à Niamey. La faible portion du fleuve où les rapides s’opposent à la navigation, entre Koulikoro et Bamako, a été doublée d’une voie ferrée : en sorte que, grâce à l’utilisation successive des chemins de fer et des fleuves, on a actuellement une voie de transport à peu près satisfaisante depuis le port de Dakar jusqu’à Gao, voie qui sera améliorée encore par l’achèvement de la ligne directe de Dakar à Koulikoro par Thiès, Diourbel et Kayes.
Le bief supérieur du Niger est lui aussi navigable une bonne partie de l’année, quoique dans des conditions moins bonnes, entre Bamako et Kouroussa, où aboutit depuis quelques mois la voie ferrée partant du port de Conakry. On peut également remonter en chaland plusieurs des affluents du haut Niger et se rendre ainsi de Bamako et Siguiri à Kankan par le Milo et de Bamako à 75 kilomètres d’Odienné par le Sankarani et son affluent le Gouanhala, au moins à l’époque des hautes eaux. Le Bâni permet d’assurer les transports entre Mopti et la région de Sikasso par Dienné et San.
Tout cela constitue un réseau navigable assurément imparfait, en raison de la différence des niveaux selon les saisons, mais qui a déjà été perfectionné et pourra l’être encore par l’exécution de quelques travaux et qui, tel qu’il existe, est fort appréciable en un pays où les cours d’eau se prêtent si rarement à la navigation et où les voies et moyens de transport sont en général embryonnaires et coûteux.
En aval de Tombouctou, quoique parsemé d’îles et d’îlots, le Niger forme un fleuve beaucoup plus régulier qu’en amont. Après avoir traversé la région sablonneuse qui s’étend de Tombouctou à Bourem, son lit redevient rocheux aux approches de Gao et il est coupé çà et là de rapides dont les principaux sont ceux d’Ayorou et de Labezenga, mais dont aucun ne constitue[72] d’obstacle vraiment sérieux à la navigation, au moins à la période des hautes eaux. C’est seulement après sa sortie du territoire français que le Niger présente des seuils infranchissables (région de Boussa), qui séparent nettement le long bief moyen du bief maritime.
La rive droite du Niger, ou plus exactement toute la région située sur la rive droite, entre le lac Débo et Say, porte en songaï le nom de Gourma ou celui de Hari-banda (que nous avons orthographié Aribinda) ; les pays de la rive gauche sont compris sous la dénomination de Haoussa ou Aoussa, aussi bien à hauteur du Débo qu’à hauteur de Bamba, de Gao et de Say[22]. Ces appellations sont souvent employées comme termes d’orientation, mais il est facile de voir qu’elles revêtent alors des acceptions multiples et fort diverses, selon le lieu où l’on se trouve : ainsi, du Débo à Tombouctou, Gourma désigne l’Est et Haoussa l’Ouest ; de Tombouctou à Bourem, Gourma désigne le Sud et Haoussa le Nord ; enfin, en aval de Bourem, Gourma voudra dire l’Ouest et Haoussa l’Est. Il est également facile de comprendre combien est peu exacte l’application que nous avons faite de certains de ces termes à telle ou telle région localisée de la Boucle du Niger, en appelant par exemple Gourma le cercle de Hombori et celui de Fada-n-Gourma et Aribinda le pays situé au Sud de Tombouctou et celui situé à l’Ouest de Dori : en réalité tout l’intérieur de la Boucle du Niger mérite ces deux noms de Gourma ou Aribinda.
Il n’est peut-être pas inutile de parler ici des ports de Tombouctou. Le principal, en ce sens qu’il est le plus constant, est Korioumé, situé sur le Niger même. Mais à Korioumé, un canal se détache du Niger et vient atteindre Daï, à 10 kilomètres de Tombouctou, pour rejoindre le fleuve principal en aval. De plus, un canal qu’on dit artificiel, dont on attribue la création ou tout au moins l’aménagement à un roi de Gao et qui fut élargi au début du XIXe siècle par le roi du Massina Sékou Amadou, amène l’eau de Daï à Kabara, à 7 kilomètres de Tombouctou.[73] Enfin, lors des grandes crues, le courant se fraie un passage, dans l’Est de Kabara, jusqu’à 300 mètres de la ville même de Tombouctou[23].
Tombouctou possède donc en réalité quatre ports : Korioumé, utilisable toute l’année et en tout temps ; Daï, qui ne l’est guère que de septembre à avril ; Kabara, qui le devient de novembre à avril ; et enfin l’un des faubourgs de Tombouctou, mais l’accès de ce dernier port n’est possible que dans les années de grande crue (tous les trois ans environ) et seulement au mois de janvier.
Le plus ou moins d’abondance des pluies dans la région soudanaise a en effet une influence considérable, non seulement sur le plus ou moins d’extension de la zone inondée, mais aussi sur la limite atteinte par les eaux dans les lacs, dépressions et canaux issus du Niger. Tous ces lacs et canaux en effet ne sont que des déversoirs : ils n’alimentent pas le Niger, mais sont alimentés par lui. Lorsque la crue a été exceptionnellement forte dans le haut fleuve, le Faguibine est rempli jusqu’à Ras-el-Ma, les Daouna se transforment en lacs et l’eau reflue vers le Nord dans les canaux de dérivation sahéliens et sahariens, qui sont eux aussi des déversoirs plutôt que des affluents, comme le marigot de Niamina, les parties basses des vallées du Tilemsi, de l’Azaouag, etc., et les maigres rivières, telles que le Gorouol et la Sirba, qui traversent la région de mares temporaires séparant, du côté de Dori, le bassin de la Volta du bas Niger. Lorsqu’au contraire la crue a été faible, l’eau ne se répand que peu en dehors du fleuve lui-même et de ses bras principaux, les lacs ne sont plus que des étangs et beaucoup de mares ou de vallées demeurent sèches pendant une ou plusieurs années.
Dans une communication récente[24], le lieutenant Salvy[74] constate que, au cours des quinze dernières années, il y a eu diminution progressive du lac Faguibine et assèchement des Daouna : l’eau, qui arrivait à Ras-el-Ma lors des crues de 1894, n’arrivait plus l’an dernier qu’à une quarantaine de kilomètres à l’Est de ce point. Il suppose que, indépendamment de causes climatériques passagères, ce dessèchement serait dû à une cause générale et constante qui affecterait tout le Nord du Soudan. Je ne crois pas devoir partager son opinion : au XIe siècle, selon le témoignage de Bekri, le point de Ras-el-Ma (tête de l’eau) méritait déjà son nom par sa position à la limite extrême des crues ; il serait singulier que, si une cause constante de dessèchement existait réellement, la limite des crues fût demeurée identique pendant neuf siècles au moins pour reculer brusquement ensuite. Il est beaucoup plus probable que cette limite varie et a toujours varié selon les années ou plutôt selon des périodes de plusieurs années chacune, proportionnellement avec les quantités d’eau tombées, et que, si le maximum a toujours été à Ras-el-Ma — au moins depuis les débuts de la période historique —, le minimum a varié et variera encore d’époque en époque ; il est vraisemblable qu’avant 1894 la limite extrême des crues avait déjà reculé bien des fois jusqu’au minimum constaté en 1910 et peut-être plus loin encore et que, après une suite d’années pluvieuses, Ras-el-Ma redeviendra de nouveau la « tête de l’eau ».
[5]Voir la carte 1 à la fin du chapitre III et la carte d’ensemble à la fin de l’ouvrage.
[6]Il semble que c’est Aristote qui, le premier, ait cité le voyage de Hannon, dont nous ont parlé ensuite Eratosthène, Strabon, Pline et Ptolémée.
[7]Hérodote, livre IV, XLIII.
[8]Hérodote, livre IV, CXCVIII.
[9]Livre II, XXXII à XXXIV.
[10]Les Nasamons étaient des Berbères habitant la province de la Cyrénaïque appelée aujourd’hui Barka, à l’Est de la Tripolitaine.
[11]Une autre branche saharienne du Niger, représentée aujourd’hui par l’Azaouag, qui sort des montagnes du Sahara Central pour aboutir sur le bas Niger en aval de Niamey, a été reconnue par les derniers explorateurs du Sahara, et notamment par le capitaine Cortier. On y a trouvé des crocodiles, ce qui tendrait à prouver que cet oued a eu autrefois une importance plus considérable et des relations aquatiques avec le Niger plus réelles que de nos jours.
[12]Pline dit expressément que les Ethiopiens Nigrites sont appelés ainsi du nom du fleuve qui arrose leur pays.
[13]Ptolémée supposait d’ailleurs que le Ghir, coulant vers l’Est, passait au travers des « gorges garamantiques » (montagnes du Fezzan) et, après avoir disparu sous terre, réapparaissait dans le marais ou lac Nuba, sans doute pour y former une branche supérieure du Nil.
[14]Le Nord de l’Afrique dans l’antiquité grecque et romaine, 1863.
[15]Doctrina Ptolemæi ab injuria recentiorum vindicata, 1874.
[16]Cultru, Histoire du Sénégal, page 25.
[17]A titre d’information, il convient de noter que le mot asenghêl, en berbère, signifie « inondation ». Dans un manuscrit arabe encore inédit, rapporté de Tombouctou par M. Bonnel de Mézières et datant, semble-t-il, du XVIIe siècle, le pays situé entre le Fouta et l’Atlantique est désigné sous le nom de Sénékal ou Sénégal.
[18]Le moine franciscain Gaby, qui écrivit en 1689 une relation de son voyage au Sénégal (Relation de la Nigritie), nie l’existence, au moins à cette époque, d’un royaume du nom de Senega, royaume dont l’existence avait été affirmée quelques années auparavant par Moreri dans son dictionnaire (édition de Lyon, 1683). Il n’y a pas à tenir compte de la documentation du Père Gaby, qui faisait sortir d’une même source, située à quelque distance à l’est du Khasso, le Sénégal, le Niger et le Joto (?), moins d’un an avant la reconnaissance de La Courbe au Khasso et aux chûtes du Félou.
[19]Dans ces noms on retrouve, à peine déformés, ceux par lesquels les peuples riverains du Niger et du Sénégal traduisent le mot « fleuve » et désignent la rivière principale, quelle qu’elle soit, traversant leur pays : en songaï issa, en soninké ou sarakollé kollé ou kholé, en peul ou toucouleur mâyo, en ouolof dêkh ou dêh et au cas déterminé dêkh-gui ou dêh gui (comparez l’Ovidech de Lancelot du Lac et le Senedec des « Sénègues » de Marmol). Zimbala n’est autre que le mot mandé dyimbala, qui signifie « lieu de la grande eau » et qui est donné de nos jours à une partie de la zone d’inondation du Niger. Quant à Busitemba, on peut rapprocher ce terme de Badoumbé, qui veut dire « fleuve rouge » en soninké.
[20]La Volta doit son nom, soit aux sinuosités de son cours inférieur, qui l’auraient fait appeler ainsi par les Portugais, soit au nom que donnent les indigènes à son embouchure et qui, d’après ce qu’on m’a affirmé, serait Folita. Comme tous les grands fleuves africains, elle ne porte pas, dans les langues locales, de nom spécial, et chaque tribu riveraine la désigne par un mot qui, dans son idiome, ne signifie pas autre chose que « le fleuve » (Mâné chez les Dagari, Mîro chez les Lobi, Môrhe chez les Nounouma, etc.). Il en est de même du Sénégal et du Niger, comme l’avaient déjà observé Marmol et Dapper. Cependant les peuples de langue mandé désignent souvent le Niger — en outre du mot bâ qui veut dire simplement « fleuve » — par l’appellation plus particulière de Bâba (le fleuve grand) ou celle de Diêlibâ, orthographiée souvent à tort « Dioliba », qui veut dire « le fleuve des Diêli », c’est-à-dire des « griots » ou chanteurs et musiciens professionnels ; de même les Haoussa l’appellent tantôt Baba-n-goulbi (le grand fleuve), tantôt Kouara, mot dont j’ignore l’étymologie.
[21]Contrairement aux indications données par certaines cartes, le bassin du Bandama est entièrement en dehors du Haut-Sénégal-Niger : les cours d’eau naissant près de Ngorho (cercle de Bobo-Dioulasso) et donnés parfois comme des affluents supérieurs du Bandama sont en réalité, les uns des affluents du Bagbê (bassin du Niger), les autres des affluents de la Léraba (bassin de la Comoé). Les reconnaissances exécutées dans le cercle de Korhogo de 1904 à 1907, notamment celles de M. Terrasson de Fougères, ont démontré que le Bandama prenait sa source au Sud de la route de Korhogo à Tombougou, traversait cette route et contournait Korhogo au Nord pour se diriger ensuite vers le Sud.
[22]Peut-être y a-t-il quelque rapport entre ce terme et le nom des Haoussa, dont le pays est en effet à l’Est de la rive gauche du Niger au moins pour la partie du fleuve en aval de Gao.
[23]On prétend qu’autrefois c’était à l’Ouest de Kabara que l’eau se frayait un passage et que, comme elle venait inonder de temps à autre un quartier de Tombouctou — le Tarikh-es-Soudân relate plusieurs de ces inondations — les habitants comblèrent ce passage à l’endroit où se trouve aujourd’hui la dune Amadia, forçant ainsi les eaux à refluer vers l’Est.
[24]Dans la Géographie, décembre 1910.
[75]CHAPITRE III[25]
Orographie
A qui rechercherait les altitudes élevées, le système orographique du Haut-Sénégal-Niger se présenterait comme plutôt maigre : il ne semble pas en effet que l’on rencontre dans la colonie des sommets dépassant mille mètres, et encore le nombre de ceux qui atteignent cette altitude est-il fort restreint. On les trouve dans la région de Hombori (boucle du Niger) et peut-être dans le cercle de Satadougou, près des sources de la Falémé, au point d’aboutissement vers le Nord du massif dit du Fouta-Diallon.
Ce dernier massif s’étend en réalité depuis les sources du Bandama et du Bâgbê (Côte d’Ivoire) jusqu’à celles de la Gambie (Guinée), suivant une direction générale Sud-Est Nord-Ouest ; il donne naissance d’une part à tous les petits fleuves côtiers qui se jettent à la mer entre Grand-Lahou et Bathurst (Bandama, Sassandra, Cavally, Nuon ou Cestos, Saint-Jean, Saint-Paul, Makona, Sherbro, Roquelle, Grande et Petite Scarcies, Konkouré, Rio-Grande, Gambie) et, d’autre part, aux branches principales du Niger et du Sénégal (Bâgbê, Baoulé, Sankarani, Milo, Tembiko, Tinkisso pour le Bâni et le Niger, Bafing et Falémé pour le Sénégal). Les plus hauts sommets de ce massif sont situés dans la région où se touchent la Guinée, le Libéria et la Côte d’Ivoire (Nimba ou Nuonfa 1.644 m., Momy 1.400 m., Dou 1.339 m., Soulou 1.121 m., Gouékouma 1.026 m., d’après les observations barométriques de M. Aug. Chevalier en 1909). Le massif semble s’abaisser en se dirigeant vers le Nord-Ouest et ce sont ses derniers contreforts dans cette[76] direction qui, seuls, touchent à la colonie du Haut-Sénégal-Niger dans les cercles de Satadougou, de Kita et de Bamako.
Là ils se soudent, pour ainsi dire, à un autre système, beaucoup moins important comme altitude et comme étendue, qui sépare la haute vallée du Niger du bassin du Sénégal. Ce système est constitué par une sorte de crête irrégulière tombant par pentes abruptes et étagées du côté du Niger, à très peu de distance du fleuve, parfois même bordant le fleuve lui-même, comme à Koulikoro, d’une haute falaise rocheuse, et se prolongeant, sur le versant d’où sortent le Bakhoy, le Baoulé et leurs affluents, en une série de collines tantôt isolées et tantôt groupées ou ramifiées qui s’étendent vers l’Ouest de façon à déterminer les vallées très resserrées de ces branches du Sénégal et ensuite du Sénégal lui-même jusqu’à Kayes.
Ce système prend fin vers le Nord à partir de l’endroit où le Niger s’élargit et s’étale avant de pénétrer dans la région lacustre, c’est-à-dire à hauteur de Ségou environ. On ne rencontre plus ensuite qu’une succession de mamelons très peu élevés et de plateaux bas, d’où émergent parfois quelques collines isolées qui, en raison même de leur isolement, ont au premier abord des aspects de montagne que leur altitude est loin de justifier.
Sur la rive droite du Niger, entre ce fleuve et le Bâni, apparaît un troisième système qui se soude vers le Sud, du côté d’Odienné (Côte d’Ivoire), avec les dernières ramifications orientales du massif dit du Fouta-Diallon et qui suit la direction du Niger, venant clore son étroite vallée du côté de l’Est à peu près comme le système précédemment décrit la clot du côté de l’Ouest, quoique avec un relief moins considérable. Comme il arrive aussi pour la chaîne de la rive gauche, celle de la rive droite est moins abrupte sur le versant qui ne regarde pas le fleuve et se prolonge de ce côté par des ramifications qui déterminent les vallées des hautes branches du Bâni (Baoulé et Bâgbê), pour mourir peu à peu en arrivant près de la région des canaux et des inondations.
Le quatrième système, plus original peut-être, commence au delà du Bâni et enserre tout le bassin supérieur de la Volta,[77] qu’il sépare du bassin du Niger : c’est ce système que l’on a appelé tantôt le plateau central nigérien et tantôt le plateau de la Volta. Nous avons vu que le cours de la branche principale de la Volta est sensiblement parallèle au cours du Niger et forme une boucle inscrite à l’intérieur de la boucle de ce dernier fleuve : il résulte de ce phénomène que le système orographique qui nous occupe en ce moment se présente, d’une façon générale, sous la forme d’un arc de cercle parallèle lui aussi à la vallée du Niger, avec cette restriction qu’il épouse plus volontiers les contours du bassin de la Volta que ceux du Niger. Ce système a encore ceci d’analogue avec les précédents que son versant le plus abrupt et le plus accentué est en général celui qui regarde le Niger.
Il commence à la Côte d’Ivoire par les massifs de collines séparant la haute Comoé du Bandama vers l’Ouest (monts du Niarhafolo) et de la Volta vers l’Est (monts de Kinnta) : ces deux branches initiales se soudent au Sud-Ouest de Bobo-Dioulasso, entre Sikasso et Gaoua, pour former le massif d’où sortent la Comoé, le Bougouriba, la Volta Noire et quelques affluents du Bâni ; ce massif s’allonge ensuite pour suivre la rive gauche de la haute Volta Noire, puis se redresse entre Koury et Bandiagara pour former des sortes de falaises qui, par Douentza et Hombori, ferment, depuis le Bâni jusqu’à ce dernier point, la vallée du Niger[26], présentant vers Hombori leurs altitudes culminantes et se dirigeant ensuite, par des courbes irrégulières, vers le Sud-Sud-Est jusqu’à la route de Djibo à Dori. Cette sorte de demi-cercle de falaises, qui d’ailleurs offre un certain nombre de solutions de continuité, pousse vers le Sud des ramifications à pentes plus douces qui s’insinuent entre les différentes branches supérieures de la Volta et finissent par ne plus constituer que des mamelons bas ou des pitons isolés. Entre Dori et le Dahomey, la falaise regardant le Niger s’atténue d’abord et se ramifie, pour contourner les quelques affluents du bas Niger qui traversent le cercle de Fada-n-Gourma, puis se reforme pour[78] constituer le long massif de l’Atakora, qui court presque en ligne droite le long de la limite Sud-Est de ce cercle, isolant le bassin du Pendjari (ou haut Oti) du bassin du Niger et allant se souder vers le Sud au massif d’où sortira l’Ouémé.
Ces quatre grands systèmes montagneux n’ont pas tous la même structure géologique et chacun d’eux se présente sous des aspects qui varient plus ou moins d’une région à une autre : en général le granit domine dans le Sud, avec des traces variables de quartz, tandis que le grès devient plus abondant dans le centre et que le calcaire ne se montre que dans le nord, à partir de la latitude de Koury. La latérite ferrugineuse domine à peu près partout sur les plateaux et les mamelons ou crêtes de faible hauteur. Aussi bien la géologie du Haut-Sénégal-Niger n’a été étudiée d’une façon scientifique et rationnelle que tout récemment, au Nord par M. Chudeau, au Sud par M. Henry Hubert, aux travaux desquels je crois préférable de renvoyer directement le lecteur.
[26]Cette ligne de falaises porte en songaï le même nom (Hari-bongo « tête de l’eau ») que la pointe occidentale du lac Faguibine.
[79]CHAPITRE IV[27]
Régions naturelles
Au point de vue de l’aspect du pays, de la constitution du sol, de la flore et de la faune, le Haut-Sénégal-Niger peut être divisé en trois grandes régions naturelles. Ces régions ou zones ne sont d’ailleurs pas nettement délimitées : elles se pénètrent l’une l’autre en bien des points et les indications qui vont suivre ne doivent être acceptées qu’à un point de vue tout à fait général et approximatif.
Région soudanaise. — La partie Sud du Haut-Sénégal-Niger appartient à la zone africaine que l’on appelle communément la « région soudanaise », quelque impropre que soit cette dénomination au point de vue étymologique, le mot « Soudan » provenant de l’expression arabe Blâd-es-Soudân, qui signifie « pays des Nègres » et devant par suite s’appliquer logiquement à toute la partie du continent africain située au Sud du Sahara.
Cette zone commence là où finissent les dernières ramifications de la grande forêt dense du golfe de Guinée et s’étend au Nord, très approximativement du reste, jusqu’un peu au delà du parallèle de Bamako. Il convient d’y ranger, dans le bassin du Sénégal, les pays situés sur la rive gauche de ce fleuve lui-même ou arrosés par ses branches principales, le Bafing, le Bakhoy et le Baoulé, et, dans les bassins du Niger et de la Volta, les pays situés au Sud d’une ligne passant à peu près par Koulikoro, Ségou, San, Koury, Ouahigouya et Fada-n-Gourma.
Cette région est, d’une façon générale, celle où le terrain est[80] le plus mouvementé ; elle est arrosée, en dehors des fleuves proprement dits qui la traversent et de leurs affluents principaux, par de nombreux ruisseaux dont les uns ont une source permanente et dont les autres ne sont alimentés que par les pluies et peuvent se tarir complètement lors de la saison sèche. Bien que la forêt dense, telle qu’elle se présente à la basse Côte d’Ivoire par exemple, soit absente de cette région, il n’en faudrait pas conclure qu’il ne s’y rencontre pas de forêts : il s’en rencontre au contraire beaucoup et parfois d’assez étendues, tout au moins là où la densité de la population n’a pas contraint les habitants à les détruire pour se livrer sur leur emplacement à des cultures vivrières. Ces forêts se présentent sous deux aspects principaux : le long des rives de certains cours d’eau même temporaires, on a une bande souvent très étroite mais généralement très dense de végétation qui, tant par sa tenue que par les espèces la composant (palmiers à huile, raphias, lianes diverses, etc.), rappelle beaucoup la forêt dense de la Côte d’Ivoire ; en dehors de cette circonstance spéciale, il existe un peu partout des bois plus ou moins étendus, possédant de très beaux arbres et des bosquets touffus, mais offrant cette caractéristique qu’il pousse de l’herbe sous les arbres et entre les bosquets, chose absolument inconnue dans la forêt dense du golfe de Guinée lorsqu’elle n’a pas été modifiée par l’œuvre de l’homme. Les plateaux latéritiques, bien que souvent la couche de terre qui les recouvre n’ait qu’une épaisseur de quelques millimètres, ne sont pas les endroits les plus pauvres en végétation arborescente : tout au contraire on y rencontre de vraies forêts, dont les arbres vont puiser l’humidité qui leur est nécessaire en insinuant leurs racines dans les fissures des roches. Ces forêts à sol pierreux sont les plus riches en lianes à caoutchouc.
Les terrains trop argileux ou trop sablonneux, et aussi beaucoup de terrains dont le sol n’est pas mauvais pour la culture, constituent des savanes où les hautes herbes forment la presque totalité de la végétation, mais d’où émergent de place en place des arbustes et même des arbres de très belle venue, tels que des caïlcédras, des karités, des nérés, des fromagers,[81] des baobabs, etc. Il convient de dire que beaucoup de ces savanes étaient autrefois des forêts et que, si la nature de la végétation s’y est transformée, cela est dû non pas tant aux incendies de brousse qu’on accuse trop à la légère d’un déboisement auquel ils sont à peu près étrangers, qu’à un défrichement fait autrefois dans un but agricole : les arbres ayant été abattus et leurs souches enlevées, lorsque le terrain est rendu à lui-même, c’est de l’herbe qui les remplace.
Tels sont les aspects sous lesquels se présente le plus communément la flore naturelle de la région dite soudanaise : bien entendu, je ne parle que des parties où la nature est abandonnée à elle-même et non de celles que le travail de l’homme a métamorphosées.
La faune de cette région est assez riche, quoique le nombre des individus — non des espèces — y soit beaucoup plus restreint qu’on n’est souvent porté à le croire. On y rencontre comme mammifères l’éléphant (très rare sauf dans les districts les plus méridionaux), le buffle, de nombreuses espèces d’antilopes, la panthère et d’autres félins de plus petite taille, l’hyène, le phacochère et le potamochère, le fourmilier et le pangolin, le lièvre et de nombreux rongeurs, le cynocéphale, le singe vert et d’autres espèces de guenons, etc. Le lion est très rare. Je ne parle pas ici de la faune aquatique qui, elle, est à peu près la même sur toute l’étendue du Niger et comprend, comme mammifères, l’hippopotame et le lamentin.
Région sahélienne. — Au nord de la région communément appelée « soudanaise » est la région dite « sahélienne ». Le mot sahel, qui en arabe signifie « littoral »[28], est appliqué par les Maures du Haut-Sénégal-Niger à la zone qui borde au Sud le Sahara et qui forme comme le « rivage » du désert. Il est appliqué également au rivage de l’Atlantique par les Maures de[82] l’Adrar Mauritanien, en sorte que ce même terme désigne l’Ouest dans l’Adrar, le Nord-Ouest ou le Nord-Est au Fouta, le Nord à Kayes et le Sud à Tichit. Dans la pratique, les Européens appellent communément Sahel la région comprenant l’ensemble des cercles de Nioro, Goumbou et Sokolo ; mais, entendue comme désignation géographique et climatologique, cette expression a un sens beaucoup plus large. En réalité le Sahel commence à quelque distance de la rive nord du Sénégal et du coude du Baoulé et, dans les bassins du Niger et de la Volta, aux environs de la ligne citée plus haut.
Mais l’aspect du Sahel se modifie peu à peu à mesure que l’on avance vers le Nord : d’abord peu différent du Soudan propre, il accentue son caractère spécial à hauteur de Sokolo et de Bandiagara pour s’identifier de plus en plus avec le désert jusqu’à ce que l’on arrive au Sahara soudanais. La limite entre le Sahel et le Sahara soudanais peut être représentée par une ligne passant à une cinquantaine de kilomètres au Nord de Nioro et Goumbou, s’avançant jusque près de Bassikounou, atteignant le Niger à Mopti, gagnant de là Hombori en passant au Nord de Bandiagara et de Douentza, descendant ensuite vers le Sud jusqu’aux environs de Djibo, pour prendre alors une direction Est et rejoindre le Niger vers Niamey par Dori.
Il ne serait pas exact de dire que le Sahel soit aride : la végétation y est même parfois plus dense qu’au Soudan, mais en général les arbres de belle venue y sont plus rares et surtout les arbustes épineux s’y montrent en quantité beaucoup plus considérable, dépassant les autres espèces en nombre à mesure qu’on s’avance vers le Nord, jusqu’à devenir à peu près les seuls représentants de la végétation arborescente lorsqu’on arrive au Sahara Soudanais. Il existe aussi des savanes, mais les herbes y sont plus maigres et de moins haute taille que dans les savanes du Soudan et paraissent d’ailleurs constituer de bien meilleurs pâturages.
En dehors du cours inférieur de la Kolembiné dans le bassin du Sénégal et, dans le bassin du Niger, du fleuve lui-même et de ses canaux, il n’existe à peu près aucun cours d’eau au Sahel ressemblant à une rivière ou à un ruisseau : tout au plus rencontre-t-on[83] des lits de dérivation où les eaux se déversent au moment des pluies et qui constituent une sorte d’intermédiaire entre les oueds sahariens et les cours d’eau temporaires de la région soudanaise. Mais en général l’eau n’apparaît que sous forme de mares ou étangs plus ou moins étendus qui se remplissent à la saison des pluies et dont plusieurs du reste ne se tarissent jamais complètement. La plupart des villages ne sont alimentés en eau que par ces mares ou par des puits.
Quant aux roches qui constituent le terrain, elles se différencient de celles de la région soudanaise particulièrement en ceci que le calcaire se rencontre au Sahel, alors qu’il fait défaut plus au Sud. Par contre, la latérite soudanaise abonde encore au Sahel, tandis qu’elle fait défaut au Sahara. A ce point de vue comme à beaucoup d’autres, le Sahel représente la zone de transition entre la région soudanaise et le Sahara soudanais.
En ce qui concerne la faune, on rencontre au Sahel à peu près les mêmes espèces qu’au Soudan, avec l’éléphant en moins, la girafe et l’autruche en plus ; le lion y est aussi plus commun. Mais surtout, probablement en raison des plus grands espaces inhabités et aussi du nombre restreint des points d’eau, dont chacun devient en quelque sorte un rendez-vous forcé pour les bêtes sauvages, on voit beaucoup plus de gibier au Sahel qu’au Soudan et les chasses y sont bien plus fructueuses.
Pour ce qui est des habitants humains, tandis qu’au Soudan les autochtones sont, à l’exception des tribus commerçantes et des castes d’artisans et de pêcheurs, presque exclusivement agriculteurs et appartiennent uniquement à la race noire, on rencontre au Sahel une très notable proportion de pasteurs semi-nomades de race blanche plus ou moins métissée (Maures et Peuls).
Sahara soudanais. — La troisième région naturelle du Haut-Sénégal-Niger peut être dénommée « Sahara soudanais » ; elle est appelée par les indigènes Hodh ou Haoudh dans sa partie occidentale, entre le Tagant et la région lacustre de Tombouctou, et Azaouad dans sa partie orientale, c’est-à-dire à l’intérieur de la Boucle du Niger entre Tombouctou et Tillabéry et au Nord[84] de la Boucle jusqu’à Tessalit et Timiaouine environ[29]. Le Sahara soudanais est limité au Nord-Est par le Tanezrouft et au Nord-Ouest par le Djouf, qui appartiennent l’un et l’autre au Sahara proprement dit.
La différence d’aspect et de climat entre ces deux parties du désert a été très nettement indiquée par MM. Gautier et Chudeau : alors qu’à partir de la région de Timiaouine et d’In-Ouzel, en allant vers le Nord, la végétation fait défaut en dehors des vallées des oueds et des dépressions qu’a favorisées une pluie occasionnelle d’ailleurs fort rare, le Sahara soudanais, où il pleut à peu près partout régulièrement tous les ans, renferme, sauf dans les régions particulièrement pierreuses, une végétation assurément fort maigre mais cependant visible. Il convient tout d’abord de mettre à part la zone d’inondation du Niger, entre Mopti et Tombouctou, qui participe plutôt du Sahel que du Sahara. En dehors de cette zone spécialement favorisée, on rencontre des arbres — des gommiers et autres mimosées principalement — dans le Hodh et l’Azaouad, à peu près jusqu’à hauteur de Bou-Djebiha, et ensuite des steppes et de maigres pâturages jusqu’à Timiaouine. A vrai dire, les arbres s’espacent et diminuent de hauteur à mesure qu’on va vers le Nord et de même les pâturages s’atrophient à mesure que l’on s’approche du Sahara proprement dit : mais il n’en demeure pas moins vrai que l’aspect du Sahara soudanais, dans son ensemble, est bien moins désolé que celui du Sahara algérien au sud des Oasis.
Cette troisième région ne renferme des sédentaires proprement dits que dans la zone d’inondation de Mopti à Tombouctou, sur les rives mêmes du Niger en aval de Tombouctou, dans les rares villages permanents du Hodh (Kiffa, Tichit, Oualata, Néma, Bassikounou, etc.) et dans ceux plus rares encore et souvent insignifiants de l’Azaouad Nord (Mabrouk, Bou-Djebiha, Araouâne, etc.), ainsi que dans le centre salin de Taodéni. Cette population sédentaire se compose de Noirs agriculteurs et pêcheurs dans la vallée du Niger, de Noirs agriculteurs ou sauniers[85] dans les villages du Hodh et à Taodéni, et de quelques Arabes, Berbères ou métis d’Arabes et de Berbères, commerçants ou religieux, dans les mêmes villages et dans ceux, beaucoup moins populeux, de l’Azaouad Nord. Le reste du Sahara soudanais, c’est-à-dire la presque totalité de cette région, est habité ou parcouru par des nomades ou des semi-nomades, pasteurs de moutons et de chameaux, commerçants, caravaniers, guides et religieux. Les uns, dans le Hodh et l’Azaouad Nord, sont surtout des Maures d’origine arabe plus ou moins métissée, accompagnés de vassaux d’origine berbère et de Harrâtîn ou serfs d’origine nègre : tous, en dehors bien entendu des quelques habitants sédentaires des ksour ou villages, vivent sous la tente et peuvent être considérés comme de véritables nomades, transportant leurs campements, selon les années et les saisons, à des distances souvent considérables. Les autres, sur les deux rives du Niger et dans l’intérieur de la Boucle, sont principalement des Touareg, avec quelques Peuls qui ne dépassent guère les abords immédiats de la limite Nord du Sahel, accompagnés les uns et les autres de serfs d’origine nègre (Bella chez les Touareg, Rimaïbé chez les Peuls) : ceux-là vivent dans des huttes plutôt que sous des tentes, Touareg aussi bien que Peuls, et possèdent de véritables villages, temporaires il est vrai, mais ne se déplaçant en général que dans une aire de rayon restreint.
Le Sahara soudanais renferme un nombre appréciable de puits, créés et entretenus par les indigènes ; en dehors de ces puits, du Niger et des lacs et mares alimentés par le fleuve, il n’existe pas de points d’eau permanents. Quelques vallées médiocres recueillent temporairement l’eau des pluies dans la partie située à l’Ouest d’Araouâne, où devait se trouver probablement autrefois une sorte de branche saharienne du Niger. Dans la partie montagneuse située entre Bou-Djebiha et Timiaouine (Adrar Timetrhine), et qui n’est que le prolongement occidental de l’Adrar des Iforhass[30], des vallées plus[86] larges et plus profondes existent, qui se dirigent vers le Tilemsi.
Si la région saharienne du Haut-Sénégal-Niger est pauvre en eau, elle est par contre assez riche en sel : c’est elle surtout qui a alimenté le pays des Noirs de ce précieux aliment jusqu’au jour où le perfectionnement de nos moyens de transport nous a permis d’amener sur les marchés du Soudan du sel des îles du Cap Vert ou d’Europe en état de concurrencer le sel saharien. Ce dernier provenait autrefois surtout des salines d’Aoulîl, situées dans le Trarza actuel, près du rivage de l’Atlantique, au Nord de Biakh, et des mines de Teghazza, ces dernières situées à 120 kilomètres environ au Nord-Nord-Ouest de Taodéni ; le sel d’Aoulîl était apporté, moitié par bateaux remontant le cours du Sénégal, moitié par des caravanes qui gagnaient le Sahel en traversant le Tagant. De nos jours, le sel vient surtout au Soudan des carrières de Taodéni, qui ont remplacé celles de Teghazza, par la voie d’Araouâne, et des salines d’Idjil, situées au Nord de l’Adrar Mauritanien, par la voie de Tichit ; on importe aussi, mais en quantités bien moins considérables, du sel récolté dans un certain nombre de mares du Hodh, dont l’une des plus importantes se trouve près de Tichit même.
On a souvent prétendu que le Sahara soudanais était autrefois mieux arrosé et par suite plus fertile qu’il ne l’est à l’heure actuelle : cette hypothèse n’est pas invraisemblable, surtout si l’on admet que le Niger de Pline et de Ptolémée tirait réellement de l’Atlas marocain une partie appréciable de ses eaux, ce qui d’ailleurs est loin d’être démontré. Mais il est fort probable que depuis fort longtemps, depuis sans doute le commencement de notre ère et peut-être beaucoup plus tôt, l’aspect général du Sahara ne s’est pas modifié d’une façon sensible. Au temps d’Hérodote, c’est-à-dire plus de quatre siècles avant J.-C., cette partie de l’Afrique brillait déjà par l’absence d’eau et de végétation, puisque cet auteur nous dit qu’au Sud des côtes maritimes de Libye « on rencontre la Libye peuplée de bêtes féroces, au delà de laquelle est une élévation sablonneuse qui s’étend depuis Thèbes en Egypte jusqu’aux colonnes d’Hercule. On trouve dans ce pays sablonneux, environ de dix journées en[87] dix journées, de gros quartiers de sel sur des collines[31] ; du haut de chacune de ces collines, on voit jaillir, au milieu du sel, une eau fraîche et douce. Autour de cette eau, on trouve des habitants, qui sont les derniers du côté des déserts »[32]. Il convient de noter d’ailleurs qu’il ne s’agit dans ce passage que du Nord du Sahara, puisque Hérodote y place Aoudjila, Djerma (pays des Garamantes, Fezzan) et Ghadamès (pays des Atarantes). Quant au Sahara proprement dit, voici ce qu’en dit notre auteur : « Au dessus de cette élévation sablonneuse, vers le midi et l’intérieur de la Libye, on ne trouve qu’un affreux désert, où il n’y a ni eau, ni bois, ni bêtes sauvages ; on n’y trouve aucune humidité »[33].
La description d’Hérodote pourrait s’appliquer parfaitement à la partie du Sahara comprise entre les dernières oasis du Touat et Timiaouine, telle qu’elle se présente aujourd’hui à nos regards : si cette portion du désert n’a pas varié depuis plus de 2.300 ans, il n’y a guère de chance pour que la portion méridionale, celle que nous appelons le Sahara soudanais, ait varié de façon appréciable durant le même laps de temps. Quelques vallées ont pu être comblées par le sable, mais le régime des pluies doit être tel aujourd’hui qu’il a toujours été, et il me semblerait bien téméraire d’avancer que le Sahara soudanais possédait autrefois des rivières proprement dites et des forêts que les feux de brousse auraient fait disparaître.
Dans le Sahel même, la situation se présentait au temps de Yakout, c’est-à-dire il y a 700 ans, exactement telle qu’elle se présente aujourd’hui : cet auteur nous parle en effet de déserts sans eau qui s’étendaient entre la latitude de Oualata environ et les régions avoisinant le Sénégal où l’on allait acheter la poudre d’or récoltée dans le Bambouk, désert où la sécheresse était[88] telle que l’eau s’évaporait dans les outres et qu’on ne pouvait vaincre la soif qu’en gavant de liquide, au départ, des chameaux haut-le-pied que l’on abattait ensuite pour boire l’eau infecte conservée dans leur estomac[34]. Je ferai même observer que les géographes arabes du Moyen-Age — notamment Bekri (XIe siècle) — nous signalent la présence du chameau notablement plus au Sud qu’on ne le rencontre de nos jours.
Que certaines régions du Sahara méridional, notamment dans le Tagant et le Hodh, aient été autrefois abondamment peuplées de Noirs sédentaires et agriculteurs qui avaient su, à force de travail, mettre ces régions en valeur, tandis que leurs successeurs, Berbères et Arabes, pasteurs ou pillards, les ont laissées retomber en friche, cela paraît incontestable ; que quelques provinces, à la suite d’une série d’années particulièrement sèches, aient été abandonnées par leurs habitants, cela est établi par de nombreuses traditions indigènes. Mais que la physionomie générale du pays ait sensiblement changé, quant à la rareté de l’eau et au peu d’exubérance de la végétation spontanée, depuis le temps de Yakout et même depuis celui d’Hérodote, cela me semble bien difficile à admettre.
Il est bien certain que des régions autrefois couvertes de forêts sont aujourd’hui dénudées : ce changement s’est produit en France, depuis le temps des Gaulois, et il continue à s’accentuer de plus en plus ; les mêmes raisons qui l’ont causé en France l’ont causé au Soudan. Ces raisons se ramènent à deux qui sont d’ailleurs connexes : l’accroissement de la population et le passage progressif de la vie sauvage des chasseurs à la vie plus civilisée des agriculteurs ; chaque fois qu’une fraction de population a dû, pour assurer sa subsistance, mettre en valeur des terrains fertiles mais encore vierges, elle a détruit la forêt. Les fameux incendies de brousse, qui ont été l’objet de tant d’anathèmes[89] malgré leur utilité certaine, n’ont constitué à toutes les époques que l’une des manifestations du défrichement et l’une des plus inoffensives vis-à-vis de la végétation arborescente : la hache et la houe, en procédant au dessouchement des racines et à la mise à nu des roches et argiles improductives, ont eu un résultat autrement appréciable, et cependant nous ne saurions raisonnablement faire un crime aux Soudanais d’avoir transformé en champs producteurs les forêts stériles où leurs ancêtres menaient la vie sauvage et précaire des primitifs les plus lointains. Nous serions d’ailleurs mal venus à reprocher aux indigènes d’avoir déboisé pour vivre une partie du Soudan, nous qui, dans des proportions bien plus considérables mais heureusement dans des zones restreintes, avons déboisé en quelques années les rives du Sénégal et du Niger pour chauffer nos bateaux à vapeur, ainsi que le voisinage des voies ferrées et des villes créées par nous, pour construire nos établissements, fabriquer nos meubles et entretenir nos feux de cuisine.
[28]Il existe en arabe deux mots différents, ayant chacun une orthographe spéciale, mais que l’on transcrit vulgairement en français par la même forme sahel : l’un signifie « littoral » et l’autre « plaine » ; si nous nous reportons à la manière dont les Maures orthographient le mot dont il est question ici, nous voyons qu’il s’agit bien de sâhel signifiant « littoral ».
[29]Pour la région au Nord d’Araouâne, voir la carte no 1.
[30]Le mot adrar, pluriel idraren, signifie « montagne » en berbère ; ne pas le confondre avec le mot adrharh ou adghagh, qui signifie « pierre », ni avec le mot adar, qui veut dire « cuvette ».
[31]Ailleurs Hérodote parle de maisons construites en blocs de sel ; M. Gautier, en signalant que, dans les oasis du Touat, les murettes des jardins sont souvent faites de blocs de sel, fait remarquer que ce mode de construction serait incompatible avec un régime pluvieux (La conquête du Sahara, page 227).
[32]Livre IV, CLXXXI.
[33]Livre IV, CLXXXV.
[34]Voir l’article et-tibr (la poudre d’or) dans le Dictionnaire Géographique de Yakout. Cette singulière méthode appliquée au transport de l’eau est encore en usage de nos jours : « Il arrive qu’un chamelier mourant de soif, abatte une bête pour lui prendre sa provision d’eau. Il y faut, avec quelque cruauté, un réel courage ; le liquide est verdâtre et nauséabond : mais le fait, souvent cité, n’est pas légendaire ». (Gautier, Conquête du Sahara, page 90).
[90]CHAPITRE V[35]
Climatologie
Régions climatériques. — Les régions climatériques du Haut-Sénégal-Niger correspondent assez exactement aux régions naturelles dont je viens de donner une description rapide et approximative. Sans parler du Sahara pour le moment, il est incontestable que le climat de la région sahélienne diffère assez notablement de celui de la région soudanaise. D’une façon plus générale, on pourrait dire que le climat du Haut-Sénégal-Niger diffère à mesure qu’on s’éloigne davantage de l’équateur.
Dans le Sud de la colonie, les pluies sont plus nombreuses et plus abondantes et la saison des pluies dure plus longtemps ; comme conséquence de ce régime et du nombre plus grand des cours d’eau, l’air est en général plus chargé d’humidité, même lorsqu’il n’a pas plu depuis longtemps. D’autre part la température est plus constante d’un bout de l’année à l’autre et les écarts du thermomètre dans une même journée sont moins considérables. Les sautes barométriques sont par contre plus fréquentes et la moyenne des pressions est un peu plus faible ; les orages sont plus nombreux et plus violents, de même que les tornades accompagnées de pluie, tandis que les tornades sèches, ou ouragans de poussière, sont plus rares et plus bénignes.
Dans la région sahélienne, la saison des pluies est plus courte, les heures de pluie sont moins nombreuses et la quantité d’eau tombée dans un temps donné est moindre en moyenne : l’air[91] est donc plus sec, les glandes sudoripares fonctionnent plus facilement et la chaleur se supporte plus aisément. Il y a plus d’écarts de température, surtout durant la saison sèche, pendant laquelle le thermomètre atteint des maxima et des minima inconnus ou tout au moins exceptionnels dans le Sud ; d’autre part la moyenne thermométrique est plus élevée durant la saison des pluies.
Au Sahara, même là où existent des pluies annuelles, la période de pluie est d’une durée très faible — quelques jours seulement —, et, quelle que soit la quantité d’eau tombée, on peut dire que la sécheresse de l’air est extrême durant toute l’année. Les températures estivales sont fort élevées, mais par contre il existe un hiver appréciable et la pression barométrique est généralement constante.
Saisons. — La division de l’année en périodes climatériques est partout la même au Soudan et au Sahel, en ce sens que les mêmes périodes se succèdent dans le même ordre au Nord comme au Sud ; mais les dates auxquelles commence et finit généralement chaque période ne sont pas exactement les mêmes.
Ces périodes ou saisons sont au nombre de quatre : la saison froide ou saison sèche proprement dite, la saison chaude, la saison des pluies ou « hivernage » et la saison intermédiaire entre les pluies et le froid.
La saison froide dure à peu près trois mois : dans la région soudanaise, elle commence vers le 1er décembre pour se terminer à la fin de février. Le nom de « saison froide » appliqué à cette période n’est juste qu’en partie : c’est en effet l’époque de l’année où le thermomètre descend le plus bas (8°, 5° et même 2° centigrades au-dessus de zéro, selon les années et les régions), mais, sans atteindre les maxima de la saison suivante, il monte durant la saison dite « froide », même dans l’extrême Sud de la colonie, jusqu’à 30° et 35°. C’est pendant cette période que souffle l’harmattan, vent du Nord-Est venant du Sahara, qui est par excellence un vent desséchant, faisant jaunir et tomber les feuilles, écaillant la peau et gerçant les lèvres. En raison[92] du rayonnement considérable causé par ce vent durant la nuit, la température est réellement froide le matin au lever du soleil ; mais elle s’élève rapidement et il n’est pas rare de constater un écart d’une trentaine de degrés centigrades entre 5 heures du matin et 2 heures de l’après-midi. Il serait par suite plus exact d’appeler cette période la « saison des nuits froides ».
La saison chaude qui la suit mérite complètement son nom : c’est, en effet, l’époque de l’année où le thermomètre descend le moins bas et où il monte le plus haut, en sorte que la moyenne de la température est plus élevée durant cette saison que pendant tout le reste de l’année. Il est rare que l’on constate moins de 18° lors de cette période à Bamako et on y lit souvent à la même époque des températures de 40° à 45°. Les maxima observés à Kayes et à Ségou sont plus considérables encore. En général cette saison est plus supportable dans l’extrême Sud du Soudan que dans la région sahélienne, mais elle est désagréable partout. Elle commence à peu près avec le mois de mars pour finir vers le 15 juin. Au début, elle se rattache encore à la saison sèche, mais le vent est presque nul et il ne se produit pour ainsi dire pas de rayonnement nocturne ; la température ne commence à s’abaisser un peu que vers minuit pour remonter dès 8 heures du matin et devenir accablante dans l’après-midi. Parfois, alors que l’atmosphère est la plus étouffante, le vent se met à souffler brusquement, venant de l’Est avec une extrême rapidité et une grande violence et des tourbillons de poussière rouge se précipitent en cyclone : ce sont les tornades sèches. Vers la fin de la saison chaude, ces tornades sèches sont en général suivies d’un violent orage et d’une pluie diluvienne mais de peu de durée, après laquelle il semble faire plus chaud encore qu’auparavant.
La saison des pluies ou « hivernage » commence en général dans la région soudanaise vers la mi-juin pour durer jusqu’à la fin d’octobre, avec une petite accalmie dans la seconde quinzaine d’août ; mais au Sahel elle se précise un peu plus tard et prend fin un peu plus tôt. Elle débute par des tornades pluvieuses amenées par le vent d’Est comme durant la saison précédente,[93] mais qui ne sont pas toujours précédées de tornades sèches et qui se terminent par une pluie ordinaire, à la suite d’une saute de vent. A partir de juillet, on a des pluies de durée plus longue, par vent du Sud-Ouest, très souvent accompagnées de violents orages, surtout du 15 juillet au 15 août. Les pluies de septembre et octobre sont en général plus espacées, mais souvent plus fortes. C’est la saison durant laquelle les écarts de température sont le moins prononcés ; la moyenne thermométrique se tient en général aux environs de 22° ou 23°, avec 15° comme minimum et 30° comme maximum ; il arrive assez souvent que la température moyenne est un peu moins élevée au Soudan qu’en France durant les mois de juillet et août. Malgré cela, cette période est en général moins appréciée des Européens que la saison des nuits froides, en raison de l’état d’humidité de l’atmosphère, mais elle est certainement moins désagréable que la saison chaude de mars-avril-mai. Les indigènes au contraire redoutent la saison froide, pendant laquelle, faute de savoir se prémunir contre la fraîcheur des nuits, ils contractent fréquemment des affections de la gorge ou des poumons ; il convient aussi de noter que c’est durant la saison sèche que les maladies contagieuses, la variole principalement, exercent surtout leurs ravages, par suite de la plus grande facilité de propagation des germes morbides causée par la siccité de l’atmosphère.
Malgré la virulence des pluies qui tombent de fin juin à fin octobre, le Haut-Sénégal-Niger, même dans sa partie Sud, est loin d’être un pays à chaleur humide comme beaucoup de pays tropicaux : les pluies, en effet, durent rarement plus de quelques heures et il ne pleut pas tous les jours, même au cœur de l’hivernage. La chute d’eau annuelle oscille autour de 1 m. 50 à Bamako, 0 m. 75 à Nioro et 0 m. 50 à Niafounké.
La quatrième saison, très courte, dure environ un mois : novembre ; c’est une sorte de répit entre les dernières pluies et l’époque où souffle l’harmattan. Elle présente à peu près les mêmes inconvénients que la saison chaude : à vrai dire, la température est moins élevée, mais le vent est généralement faible[94] ou absent, l’air encore humide ne se dessèche que lentement et la pluie ne vient plus rafraîchir l’atmosphère.
Au point de vue des aspects divers que revêt la nature selon les saisons, on peut observer entre le Soudan et notre pays une correspondance relative. Bien qu’on donne vulgairement le nom d’« hivernage » à la saison des pluies, cette dernière période n’a rien qui rappelle notre hiver ; au contraire la saison froide, dont la durée correspond à peu près à notre hiver, présente avec ce dernier de nombreuses analogies : arrêt de la végétation, chûte des feuilles, durcissement de la croûte terrestre, etc. Dès les premières tornades de la saison chaude se manifestent, vers la même époque que chez nous, les phénomènes qui caractérisent le printemps : les arbres se revêtent de feuilles nouvelles, l’herbe repousse et possède une belle couleur verte, les premières fleurs apparaissent. La saison des pluies est, comme notre été, la période de la maturité des grains et des fruits et celle des moissons, au moins pour une partie des céréales, tandis que la saison intermédiaire de novembre, marquant l’épuisement de la nature, correspond en partie avec notre automne.
Conditions générales du climat. — On a cru pendant longtemps que le climat soudanien devait être plus agréable et plus sain aux altitudes élevées que dans les régions basses ; il est possible en effet qu’il en soit ainsi en théorie, mais dans la pratique, si les sommets — d’ailleurs modestes — du Soudan sont dans de meilleures conditions d’aération, il s’ensuit d’abord qu’ils sont plus exposés aux tornades, et il arrive ensuite que ces sommets, toujours dénudés et composés de rochers, constituent pour la plupart de véritables réservoirs de chaleur, en sorte que les nuits y sont fréquemment moins fraîches que dans les plaines environnantes[36]. De plus, lorsque ces sommets sont[95] formés d’assises de latérite, comme c’est le cas général, l’eau de pluie séjourne dans les anfractuosités, qui deviennent ainsi d’excellents milieux de culture pour les larves de moustiques.
Somme toute, le climat du Haut-Sénégal-Niger dans son ensemble est certainement parmi les plus sains de l’Afrique Occidentale et les plus faciles à supporter pour des Européens. Assurément le paludisme y règne, comme dans tous les pays tropicaux, mais il y exerce beaucoup moins de ravages que dans les colonies côtières du golfe de Guinée ; la fièvre bilieuse hémoglobinurique, si fréquente dans ces dernières colonies, est rare au Soudan et à peu près inconnue dans la région sahélienne.
Quant au Sahara soudanais, malgré les inconvénients multiples que présente la vie en ce pays déshérité, il est, de l’aveu de tous ceux qui l’ont parcouru ou y ont résidé, la plus saine de toutes les régions du Haut-Sénégal-Niger pour les Européens.
[36]Le capitaine Cortier fit au cours de son dernier voyage l’ascension du mont Tozat, situé au Sahara dans le Tassili des Azguer ; cette montagne mesure 2.020 mètres d’altitude d’après les calculs du même officier. Ce dernier, ayant passé une nuit au sommet de la montagne, constata que le froid y était notablement moins vif que dans la vallée.
[96]CHAPITRE VI[37]
Répartition de la population
Nous avons vu plus haut que la densité moyenne de la population était d’environ 2,66 habitants par kilomètre carré pour l’ensemble de la colonie civile du Haut-Sénégal-Niger. Mais cette densité varie énormément suivant les régions.
Cela tient à des causes diverses, dont la nature du sol et sa fertilité relative ne sont que l’un des facteurs. Les bouleversements amenés par les guerres qui se sont succédé pendant un si long temps avant notre occupation du pays, les migrations qui en ont été le résultat et les razzias qui en furent la rançon, ont influé énormément sur la répartition actuelle de la population indigène. Maintenant que la sécurité est rétablie partout, il est fort probable que des régions, fertiles mais dépeuplées ou abandonnées, se repeupleront au détriment d’autres moins avantageuses et qui n’ont été occupées par leurs habitants actuels ou leurs ancêtres que parce qu’ils ne pouvaient aller ailleurs : nous en avons un exemple dans le cercle de Bougouni qui, presque complètement désert au moment où nous y avons donné la chasse aux bandes dévastatrices de Samori, occupe actuellement le 13e rang, parmi les 29 circonscriptions administratives de la colonie, au point de vue de la densité de la population. Il est fort possible d’autre part que telle contrée, quoique déshéritée par la nature, devienne un jour populeuse parce qu’on y aura créé une industrie nouvelle ou qu’une voie ferrée, en la traversant, en aura modifié profondément les conditions économiques.
| Delafosse | Planche IV |

Fig. 7. — L’Hôtel du Secrétaire Général, à Koulouba.

Fig. 8. — Bamako et la vallée du Niger, vue prise de Koulouba.
[97]Nous ne pouvons faire à ce sujet aucune prévision présentant quelques chances de certitude et nous devons nous contenter de constater quelle est actuellement la répartition de la population.
La région où la densité du peuplement est la plus considérable est — avec les environs de la ville de San — le Mossi, ou plus exactement le cercle de Ouagadougou, qui renferme à lui seul le quart de la population totale de la colonie, bien qu’on n’y compte aucune ville digne de ce nom et que les agglomérations importantes n’y soient composées en général que d’un nombre plus ou moins grand de hameaux dispersés au milieu des cultures. La densité de cette population presque exclusivement agricole et paysanne peut être évaluée à 16 habitants par kilomètre carré pour l’ensemble du cercle et s’élève à 35 dans le Mossi propre.
Le reste du pays compris dans l’Ouest et le Sud de la Boucle du Niger vient immédiatement après, avec le bassin de la Volta au premier rang ; ici, on rencontre un certain nombre de villes, habitées surtout par des commerçants et des artisans, au milieu d’une population autochtone essentiellement agricole et paysanne et dispersée comme celle du Mossi, avec parfois des solutions de continuité assez considérables. La densité moyenne y varie de 13 à 7 habitants par kilomètre carré.
Les vallées du haut Niger et du Bâni ne viennent qu’en troisième lieu, avec une population de cultivateurs moins dispersée que celle du bassin de la Volta, une population citadine composée de pêcheurs, de commerçants et d’artisans et une population errante de pasteurs nomades ou plutôt semi-nomades. Densité moyenne : 8 à 4 habitants par kilomètre carré, avec une moyenne exceptionnelle de 17 habitants au kilomètre carré pour la circonscription de San.
Le bassin du Sénégal vient en quatrième ligne, avec de petits villages de cultivateurs et de chasseurs séparés par de grandes étendues inhabitées et une population citadine de formation récente à peu près localisée d’ailleurs à la ville de Kayes. Densité moyenne : 4 à 1,5 habitants par kilomètre carré.
En cinquième lieu viennent se ranger les cercles du Sahel, à[98] l’exception de ceux qui se trouvent dans la zone des inondations du Niger et que j’ai compris dans la troisième catégorie et en y ajoutant la partie du Sahara soudanais située à l’intérieur de la Boucle du Niger ou limitrophe de la rive nord de ce fleuve. Cette région ainsi définie renferme des îlots de population agricole relativement dense, disséminés au milieu de vastes étendues souvent inhabitées ou bien habitées par des semi-nomades ou même seulement parcourues temporairement par des nomades. Densité moyenne : 3,5 à 1 habitants par kilomètre carré.
Au Nord de cette cinquième région, la population sédentaire fait presque complètement défaut et la densité du peuplement devient infime : 0,16 habitant par kilomètre carré.
Les villes les plus peuplées de la colonie sont : Bobo-Dioulasso 7.788 habitants, Bamako 6.539 habitants, Ségou 6.255 habitants, Kayes 5.932 habitants, Tombouctou 5.797 habitants, et Dienné 4.527 habitants, banlieues non comprises.
La population européenne, concentrée principalement à Kayes, Bamako-Koulouba, Kati, Koulikoro, Mopti, Sikasso et Tombouctou, se compose d’un millier de personnes environ.
Quant à la population indigène, qui est de 4.800.000 habitants, elle se répartit ainsi entre les 29 circonscriptions administratives de la colonie, la zone saharienne qui constitue l’aire d’extension et de surveillance des cercles du Nord ayant été comptée à part et formant une trentième circonscription de peuplement[38] :
| [99]1o | Cercle de | Ouagadougou | 1.457.326 | habitants. |
| 2o | — | Bobo-Dioulasso | 282.935 | — |
| 3o | — | Koury | 280.558 | — |
| 4o | — | Ouahigouya | 249.452 | — |
| 5o | — | Bamako | 191.936 | — |
| 6o | — | Fada-n-Gourma | 189.846 | — |
| 7o | — | Sikasso | 185.502 | — |
| 8o | — | Gaoua | 175.350 | — |
| 9o | — | Koutiala | 162.357 | — |
| 10o | — | Bougouni | 157.435 | — |
| 11o | — | Ségou | 155.406 | — |
| 12o | — | Bandiagara | 150.000 | — |
| 13o | — | Niafounké | 115.941 | — |
| 14o | — | Nioro | 113.236 | — |
| 15o | Circonscription de San | 110.670 | — | |
| 16o | Cercle de Dori | 110.000 | — | |
| 17o et 18o Cercles réunis de Tombouctou-sédentaires et Tombouctou-nomades | 93.894 | — | ||
| 19o | Cercle de | Dienné | 82.857 | — |
| 20o | — | Kayes | 69.633 | — |
| 21o | — | Goumbou | 66.515 | — |
| 22o | — | Mopti | 60.000 | — |
| 23o | — | Bafoulabé | 59.570 | — |
| 24o | — | Kita | 58.493 | — |
| 25o | — | Satadougou | 38.835 | — |
| 26o | — | Sokolo | 36.306 | — |
| 27o | — | Hombori | 25.000 | — |
| 28o | — | Say | 25.000 | — |
| 29o | Résidence de Kiffa | 20.000 | — | |
| 30o | Zone saharienne | 84.000 | — | |
Si maintenant nous rangeons les mêmes circonscriptions d’après la densité moyenne respective de leur population, nous obtenons l’ordre suivant :
| 1o | Circonscription de San | 17 | habitants par kilom. carré. | |
| 2o | Cercle de | Ouagadougou | 16 | — — |
| [100]3o | — | Gaoua | 14 | — — |
| 4o | — | Ouahigouya | 13 | — — |
| 5o | — | Sikasso | 10 | — — |
| 6o | — | Koury | 8 | — — |
| 7o | — | Niafounké | 8 | — — |
| 8o | — | Dienné | 7 1/2 | — — |
| 9o | — | Koutiala | 7 1/2 | — — |
| 10o | — | Mopti | 7 | — — |
| 11o | — | Bobo-Dioulasso | 7 | — — |
| 12o | — | Bamako | 5 1/2 | — — |
| 13o | — | Bougouni | 4 1/2 | — — |
| 14o | — | Fada-n-Gourma | 4 1/2 | — — |
| 15o | — | Ségou | 4 | — — |
| 16o | — | Satadougou | 4 | — — |
| 17o | — | Bandiagara | 3 1/2 | — — |
| 18o | — | Kayes | 3 1/2 | — — |
| 19o | — | Bafoulabé | 2 1/2 | — — |
| 20o | — | Goumbou | 2 1/2 | — — |
| 21o | — | Nioro | 2 1/2 | — — |
| 22o | — | Kita | 1 1/2 | — — |
| 23o | — | Dori | 1 1/2 | — — |
| 24o et 25o Cercles réunis de Tombouctou-sédentaires et Tombouctou-nomades | 1 1/2 | — — | ||
| 26o | Cercle de | Say | 1 1/2 | — — |
| 27o | — | Sokolo | 1 | — — |
| 28o | — | Hombori | 1 | — — |
| 29o | Résidence de Kiffa | 1 | — — | |
| 30o | Zone saharienne | 0,16 | — — | |
[38]Les chiffres mis à ma disposition sont ceux du recensement de 1909. Comme ils étaient naturellement antérieurs aux arrêtés du 22 juin 1910 qui ont créé les nouveaux cercles de Mopti, de Hombori (Gourma) et de Say et agrandi le cercle de Dori, au moyen de régions enlevées au cercle de Bandiagara et aux anciens cercles militaires de Gao, de Tillabéry et du Djerma, je ne possède que des renseignements approximatifs en ce qui concerne les cercles actuels de Mopti, de Hombori, de Bandiagara et de Say. Il en est de même, pour d’autres raisons, en ce qui regarde la résidence de Kiffa et la zone d’influence saharienne. — Le total de la population indigène de la colonie varie de 4.809.053 à 4.799.703 habitants selon les divers documents officiels mis à ma disposition : l’écart entre ces deux extrêmes est négligeable et doit tenir à une erreur de calcul.
[103]CHAPITRE VII
Géographie administrative
J’ai déjà eu plusieurs fois l’occasion de citer les noms et la situation des 29 circonscriptions administratives actuelles de la colonie civile du Haut-Sénégal-Niger. Je les donne ci-après de nouveau, avec l’indication des postes ou résidences secondaires dépendant de chacune de celles qui en possèdent.
Je note pour mémoire que, pour plus de commodité, on a donné à chaque cercle le nom de son chef-lieu ; cependant le cercle de Niafounké est appelé souvent cercle de l’Issa-Ber, celui de Gaoua cercle du Lobi, celui de Ouagadougou cercle du Mossi, celui de Ouahigouya cercle du Yatenga, celui de Hombori cercle du Gourma, nom qui est donné parfois également au cercle de Fada-n-Gourma.
La liste qui suit est conçue dans l’ordre géographique, en commençant par le Nord-Ouest (frontière de Mauritanie) pour aller de l’Ouest à l’Est, revenir ensuite de l’Est à l’Ouest, retourner de l’Ouest à l’Est et revenir une dernière fois de l’Est à l’Ouest.
La mention PT indique un bureau de poste et une station télégraphique, la mention F une station de chemin de fer, la mention J une Justice de paix à compétence étendue.
| 1o | Résidence de Kiffa : sans poste secondaire. | |
| 2o | Cercle de | Nioro (PT) : poste à Yélimané. |
| 3o | — | Goumbou (PT) : sans poste secondaire. |
| 4o | — | Sokolo (PT) : sans poste secondaire. |
| 5o | — | Niafounké (PT) : poste à Saraféré. |
| [104]6o | — | Tombouctou-sédentaires (PT-J) : postes à Goundam (PT) et Bamba (PT). |
| 7o | — | Tombouctou-nomades : postes à Ras-el-Ma et Bou-Djebiha. |
| 8o | — | Hombori : sans poste secondaire. |
| 9o | — | Dori (PT) : poste à Djibo (PT). |
| 10o | — | Bandiagara (PT) : postes à Douentza et Sangha. |
| 11o | — | Mopti (PT-J) : poste à Sofara (PT). |
| 12o | — | Dienné (PT) : sans poste secondaire. |
| 13o | — | Ségou (PT) : poste à Sansanding. |
| 14o | — | Bamako (PT-F-J) : postes à Kati (PT-F), Koulikoro (PT-F) et Banamba. (Le cercle de Bamako renferme en outre Koulouba (PT), le chef-lieu de la colonie, sur la hauteur qui domine au Nord-Ouest la ville de Bamako). |
| 15o | — | Kita (PT-F) : sans poste secondaire. |
| 16o | — | Bafoulabé (PT-F) : sans poste secondaire. |
| 17o | — | Kayes (PT-F-J) : poste à Médine (PT-F). |
| 18o | — | Satadougou : sans poste secondaire. |
| 19o | — | Bougouni (PT) : sans poste secondaire. |
| 20o | — | Sikasso (PT) : sans poste secondaire. |
| 21o | — | Koutiala : sans poste secondaire. |
| 22o | Circonscription de San (PT) : sans poste secondaire. | |
| 23o | Cercle de | Koury (PT) : poste à Boromo. |
| 24o | — | Ouahigouya : sans poste secondaire. |
| 25o | — | Ouagadougou (PT) : postes à Léo et Tenkodogo. |
| 26o | — | Fada-n-Gourma (PT) : poste à Diapaga (PT). |
| 27o | — | Say (PT) : sans poste secondaire. |
| 28o | — | Gaoua (PT) : poste à Diébougou (PT). |
| 29o | — | Bobo-Dioulasso (PT) : poste à Banfora. |
[107]DEUXIÈME
PARTIE
Les peuples
[109]CHAPITRE PREMIER[39]
Classification et répartition géographique actuelle des divers groupements ethniques
Difficultés d’une bonne classification. — Une classification précise et exacte des divers groupements ethniques existant à l’heure actuelle dans le Haut-Sénégal-Niger est chose fort difficile. Bien des bases peuvent servir de point de départ à une classification des peuples, mais aucune méthode n’est exempte d’inconvénients sérieux.
La méthode anthropologique, reposant sur l’étude comparative des caractères physiques des individus et sur les mensurations des vivants ou des squelettes, est malaisément applicable dans les pays qui nous occupent ; en admettant qu’on puisse un jour réunir un nombre suffisant d’observations et de mensurations pour avoir des moyennes satisfaisantes — et ce jour n’est pas venu encore —, la classification ainsi obtenue serait purement artificielle, chacun des groupements étant composé d’éléments fort divers quant à leur origine, en raison des migrations, des conquêtes, des unions entre individus de peuples divers, du grand nombre d’esclaves importés de pays lointains, etc. Si les résultats de la méthode anthropologique présentent quelque intérêt en ce qui concerne les populations des campagnes, chez lesquelles les mélanges sont moins considérables, ils semblent à peu près nuls au point de vue pratique en ce qui regarde la population des villes.
La méthode généalogique, s’appuyant sur les origines et l’ascendance des familles actuelles, est d’une réalisation à peu près[110] impossible : les mélanges de sang dûs aux causes mentionnées plus haut rendraient vains les résultats des recherches les plus scrupuleuses et, d’autre part, il y aurait lieu de tenir compte de deux coefficients d’erreur bien difficiles à déterminer exactement, à savoir l’ignorance de la plupart des indigènes en ce qui concerne les générations qui ont précédé l’époque actuelle et la tendance de tous les musulmans à s’attribuer une origine chérifienne ou tout au moins arabe, tendance qui a été signalée de tout temps chez les Berbères et que l’on retrouve même chez les peuples les plus franchement nègres, tels que les Mandingues. Ajoutons à cela qu’un individu interrogé sur les origines de son peuple ou de sa tribu répond presque toujours en donnant ce qu’il croit ou veut faire croire être sa propre généalogie à lui, l’ascendance de sa petite famille, et non pas celle du groupe ethnique auquel appartient cette famille.
La méthode ethnographique, basée sur les analogies et les différences des civilisations matérielles et sociales, est assurément bien meilleure et bien plus féconde que les deux précédentes, mais elle ne suffit pas à elle seule à donner des résultats entièrement satisfaisants : l’analogie de deux civilisations peut en effet provenir d’une communauté d’origine entre les deux peuples considérés, mais elle peut provenir aussi, soit de ce que ces deux peuples ont été influencés par un milieu identique, soit de ce que l’un d’eux, soumis au joug de l’autre ou au contraire l’ayant conquis et s’étant laissé ensuite assimiler par lui, a adopté les mœurs de cet autre peuple et les a substituées aux siennes propres. On a signalé bien souvent déjà les erreurs où l’on est destiné à tomber lorsqu’on prend comme base de classification soit les tatouages par scarifications soit les diamou ou noms de clan : telle tribu vivant au contact d’une autre adopte le tatouage ethnique de cette autre ; les esclaves prennent le diamou de leur maître et les indigènes auxquels nous nous adressons dans une langue qui n’est pas la leur traduisent leurs diamou dans cette langue étrangère ; par exemple, nombre de Dioula portent les scarifications de leurs voisins sénoufo, et un Sénoufo Soroo, interrogé par l’intermédiaire d’un interprète mandé, dira que son nom de clan est Kouloubali, etc.
[111]La méthode linguistique enfin, qui ne tient compte que du degré ou de l’absence de parenté des langues parlées par les divers groupements, a un avantage incontestable : celui d’être basée sur des données actuellement exactes, faciles à contrôler et ne laissant, une fois établies, place à aucune discussion. Bien que l’inventaire linguistique du Haut-Sénégal-Niger soit loin d’être achevé et qu’on ne l’ait pas fait en général d’une façon vraiment scientifique ni suffisamment précise, la classification des peuples de cette colonie d’après leurs idiomes est certainement celle qui offre le plus de garanties et qui est la plus pratiquement utilisable. Toutefois elle ne peut donner, au point de vue ethnique, toute la satisfaction désirable : bien des peuples en effet, pour des raisons diverses (conquête, contact géographique, etc.), ont adopté la langue d’autres peuples dont l’origine est fort différente de la leur, sans d’ailleurs adopter leurs mœurs ni leur caractère, tandis que, par contre et pour des raisons inverses, deux fractions d’un même peuple peuvent parler deux idiomes complètement distincts. Les exemples de ce double phénomène sont nombreux en Afrique Occidentale : je me contenterai pour l’instant de citer, d’une part celui des Peuls parlant la même langue que les Toucouleurs, et, d’autre part, celui des Soninké ou Marka de la Boucle du Niger parlant en général, non pas la langue de leurs congénères du Sénégal, mais celle des Dioula, et celui des Soninké de Dienné parlant la langue des Songaï.
Méthode de classification adoptée. — Je n’ai aucunement la prétention d’opposer un système nouveau aux méthodes scientifiques de classification dont je viens d’exposer les difficultés et les inconvénients ; j’ai tâché simplement de faire appel au concours simultané de ces diverses méthodes et de classer les groupements ethniques du Haut-Sénégal-Niger, tels qu’ils se présentent actuellement à notre observation, en tenant compte à la fois des données anthropologiques manifestement certaines, des traditions les plus probables relatives à l’origine des différents groupements, des analogies constatées dans les civilisations matérielles, l’état social et le caractère intellectuel et[112] moral, et enfin, dans une mesure raisonnée, des affinités linguistiques.
Cette méthode n’a peut-être pas une base scientifique bien profonde, mais peut-être a-t-elle le mérite d’amener à un résultat s’approchant le plus possible de la réalité pratique, étant donné l’état de nos connaissances actuelles. J’ai d’ailleurs parfaitement conscience des lacunes et des défauts de cette classification, que je ne considère que comme provisoire et qui devra être sérieusement remaniée, surtout en ce qui concerne les populations de la Boucle, lorsque nous serons en possession d’une documentation plus précise et plus abondante.
Je dois définir tout d’abord la valeur et la portée des termes que j’emploie pour désigner chacune des catégories et des unités envisagées.
Je réserve le nom de race aux grandes divisions de l’espèce humaine, telles qu’on les entend communément, c’est-à-dire qu’en l’espèce il ne s’agira que de deux races : la race blanche et la race noire. Ce terme, appliqué à des catégories plus restreintes, me paraît inadéquat à la signification qu’on voudrait lui donner et il me semble tout à fait impropre de parler de « race peule », de « race mandé », de « race mossi », etc.
J’appellerai famille un ensemble de peuples procédant, d’une façon générale, de la même origine, présentant les mêmes grands caractères anthropologiques et ethnographiques et parlant tous, sauf exceptions, des langues qui se rattachent à la même famille linguistique.
Une famille ainsi comprise peut se subdiviser en plusieurs fractions auxquelles je donne le nom de groupes et dont chacune est caractérisée par une modalité spéciale de l’ensemble des caractères communs à tous les groupes de la famille.
La division venant immédiatement après le groupe est le peuple : j’appellerai « peuple » un groupement ethnique caractérisé par des origines et une histoire communes et parlant — le plus généralement — un idiome commun qui se différencie suffisamment des idiomes voisins pour mériter le nom de « langue ». Il peut arriver qu’un peuple constitue à lui seul un groupe ou tout au moins qu’un groupe donné ne soit représenté[113] dans la région qui nous occupe que par un peuple unique. De même une famille peut ne renfermer qu’un seul groupe.
| Delafosse | Planche V |

Cliché Froment
Fig. 9. — Sur les bords du Sénégal.
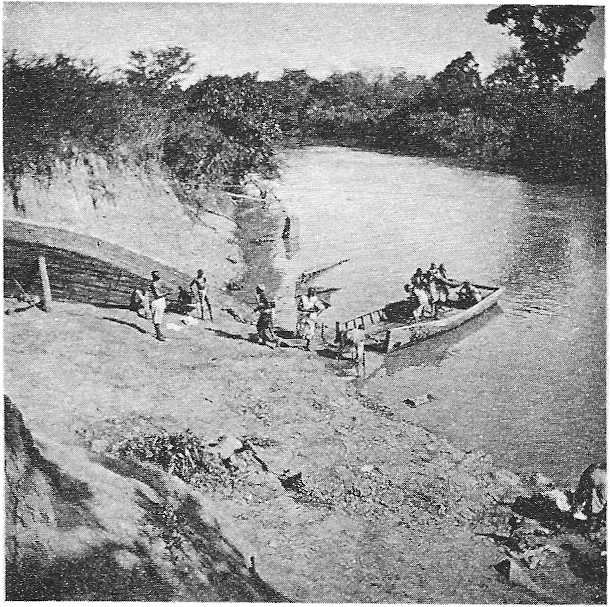
Cliché Froment
Fig. 10. — La Volta Noire, à Koury.
Chaque peuple à son tour se subdivise le plus souvent en tribus, dont chacune présente des caractères secondaires spéciaux et parle en général un « dialecte » spécial de la langue commune à tout le peuple, ou bien s’est simplement différenciée par suite de l’écart de sa position géographique.
Enfin une tribu peut comprendre plusieurs sous-tribus, sans parler des subdivisions sociales telles que les castes, les classes, les clans, dont il ne convient pas de tenir compte dans une classification purement ethnique mais qu’il y a lieu cependant de mentionner lorsqu’elles nous sont connues.
Le système adopté ici ayant été ainsi exposé, je puis maintenant passer à la nomenclature des divers groupements ethniques, nomenclature qui — on s’en apercevra — ne correspond pas absolument au tableau de classement des langues qui sera donné plus loin dans la troisième partie de cet ouvrage.
Nomenclature des familles, groupes et peuples du Haut-Sénégal-Niger. — Les peuples habitant actuellement les territoires d’administration civile du Haut-Sénégal-Niger sont au nombre de quarante, sans tenir compte des quelques colonies d’étrangers établies parmi eux (Ouolofs et Haoussa principalement). Ils appartiennent à deux races (race blanche et race noire) et se répartissent en sept familles, dont deux de race blanche plus ou moins mélangée (la famille sémitique et la famille hamitique ou chamitique) et cinq de race noire (les familles tekrourienne ou toucouleure, songaï, mandé, sénoufo et voltaïque).
Quatre peuples seulement, sur les quarante précités, sont à ranger dans les deux familles de race blanche, sous cette réserve d’ailleurs que chacun d’eux renferme en son sein des éléments plus ou moins nombreux appartenant à la race noire. Ces peuples sont :
1o Les Maures de l’Azaouad, de famille sémitique (groupe arabe) à peu près pure[40], comprenant deux tribus, les Bérabich et les Kounta ;
[114]2o Les Maures du Hodh, appartenant aux deux familles sémitique (groupe arabe) et hamitique (groupe berbère) tantôt mélangées et tantôt simplement juxtaposées, et comprenant, en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger, sept tribus principales ; les Regueïbât, les Idao-Aïch (vulgairement Douaïch), les Ahl-Tichit, les Oulad-Mbarek (ou Gassouch), les Oulad Nasser (ou Mozara ou Asrach), les Mejdouf et les Oulad-Delim, plus des Chorfa ;
3o Les Touareg, de famille hamitique (groupe berbère), se partageant en trois grandes tribus (en ce qui concerne les territoires civils du Haut-Sénégal-Niger), celle des Iguellad, celle des Kel-Tadmekket et celle des Oulmidden ou Ioulmidden (sing. Aoulmid) : la première de ces tribus se rattache à la même origine que les Zenaga du Hodh et de la Mauritanie (Goddala et Lemtouna) ; la seconde et la troisième se rattachent à une origine commune (Lemta) ;
4o Les Foulbé ou Peuls proprement dits, appartenant probablement au groupe judéo-syrien de la famille sémitique, avec un mélange très prononcé d’éléments hamitiques (berbères) et d’éléments nègres divers, et comprenant, en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger, quatre fractions principales qui sont des subdivisions géographiques plutôt que des tribus proprement dites : les Peuls du Sahel, les Peuls du Massina (Massinankobé ou Massinanké), les Peuls du Gourma et les Peuls de la Volta.
Les trente-six autres peuples se répartissent comme il suit entre les cinq familles de race noire :
I. — Famille tekrourienne : un seul peuple, celui des Toucouleurs ou Foutanké.
II. — Famille songaï : un seul peuple, celui des Songaï, comprenant deux fractions géographiques plutôt que deux tribus, les Songaï du Nord-Ouest et les Songaï du Sud-Est ou Djerma, qui comprennent les Dendi ; parmi les Songaï se trouve la caste des Sorko ou Kourteï.
III. — Famille mandé (trois groupes).
1o Groupe du Nord : trois peuples, les Bozo, les Soninké (ou[115] Sarakolé ou Marka, comprenant la caste ou le clan des Diawara) et les Dioula[41] ;
2o Groupe du Centre : cinq peuples, les Kâgoro, les Banmana (ou Bambara, comprenant la caste des Somono), les Khassonkè, les Malinké (ou Mandingues) et les Foulanké ;
3o Groupe du Sud : quatre peuples (en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger), les Diallonké, les Samo, les Samorho et les Sia (ou Bobo-Dioula), plus quatre petites tribus de classification douteuse (les Blé, les Natioro, les Ouara et les Sembla)[42].
IV. — Famille sènoufo : un seul peuple, celui des Sénoufo, comprenant dans le Haut-Sénégal-Niger dix tribus, les Bamâna (ou Minianka), les Siénérhè, les Tagba (ou Tagoua), les Mbouin (ou Gouin), les Karaboro[43], les Komono, les Nanergué, les Folo (ou Foro ou Pomporon), les Tourka et les Sémou.
V. — Famille voltaïque (sept groupes).
1o Groupe tombo : trois peuples, les Tombo (ou Habé), les Dogom et les Déforo ;
2o Groupe mossi : six peuples (en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger), les Mossi, les Yansi, les Nankana, les Gourmantché (ou Bimba), les Dagari et les Birifo (ou Bérifon) ;
3o Groupe gourounsi : quatre peuples (en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger), les Nioniossé (ou Lilsé), les Nounouma[44], les Sissala et les Boussansé ;
4o Groupe bobo : un seul peuple, celui des Bobo, comprenant[116] quatre tribus, les Kian (ou Bobo-Gbê), les Tara (ou Bobo-Oulé), les Boua (ou Bobo-Fing) et les Niénigué ;
5o Groupe lobi : quatre peuples, les Lobi, les Pougouli (ou Bougouri), les Dian (ou Dian-né) et les Gan (ou Gan-né) ;
6o Groupe koulango : un seul peuple, celui des Koulango (ou Pakhalla), représenté au Haut-Sénégal-Niger par la tribu des Lorho ;
7o Groupe Bariba : deux peuples (en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger), les Bariba et les Soumba (tribu des Takamba).
A cette nomenclature, il convient d’ajouter une tribu du cercle de Gaoua et quatre tribus du cercle de Bobo-Dioulasso que l’état actuel de nos connaissances ne permet pas de rattacher de façon définitive à l’une des familles énumérées ci-dessus, mais qui appartiennent très probablement soit à la famille voltaïque soit à la famille sénoufo. Ces cinq tribus sont celles des Padorho, des Dorhossié, des Tiéfo, des Toussia et des Vigué.
Enfin, comme je le disais plus haut, on rencontre dans quelques gros centres des colonies d’étrangers venus surtout du Sénégal (Ouolofs) ou de la Nigeria (Haoussa) et qui ne rentrent dans aucune des sept familles précitées, à moins que l’on veuille rattacher les Ouolofs à la famille tekrourienne, ce qui ne pourrait se faire qu’avec quelque témérité.
Différentes appellations données aux peuples du Haut-Sénégal-Niger. — Les familles et groupes ethniques de l’Afrique Occidentale ne se connaissent pas de noms génériques et souvent les divers peuples qui composent chaque famille ne se doutent même pas des liens de parenté qui les unissent. La plupart des peuples se désignent eux-mêmes chacun par un nom spécial ; il arrive cependant que certains peuples (les Sénoufo par exemple) ne font pas usage d’un terme correspondant à l’ensemble du peuple et que, seules, les tribus se désignent chacune par un terme distinct. D’autre part il n’est pas rare qu’un peuple étranger use d’un terme spécial pour désigner toute une famille ou tout un groupe qui, en ce qui le concerne, ne possède pas dans sa langue le mot correspondant. Enfin les divers groupements ethniques nous sont connus sous des appellations très différentes[117] selon que nous avons été mis en relation avec eux par tel ou tel autre groupement. Aussi il m’a paru nécessaire d’indiquer et au besoin d’expliquer les appellations diverses qui sont données à chacun des groupements.
Les termes de sémitique et hamitique, empruntés à la terminologie biblique des enfants de Noé, sont suffisamment connus, ainsi que les expressions de « groupe arabe » et de « groupe berbère » — ou libyco-berbère —, pour que je n’aie pas à m’étendre à leur sujet.
Le nom de Maures, que nous donnons aux populations arabes et arabo-berbères de l’Azaouad et du Hodh, a été emprunté par nous aux Latins, qui le tenaient eux-mêmes des Grecs, lesquels l’avaient formé du mot punique Mahourim (ou Maouharîn) qui signifie « les Occidentaux » et est l’équivalent exact de l’arabe Maghrebiyyîn, en sorte que « Mauritanie » est tout simplement synonyme de « Maghreb ». Les Maures se désignent entre eux par les noms de leurs différentes tribus ; cependant les Maures du Hodh qui revendiquent une origine arabe se donnent à eux-mêmes l’appellation générique de Beni-Hassân ou simplement Hassân (au singulier Hassâni), tandis qu’ils désignent ceux d’entre eux dont l’origine berbère est incontestable par le terme de Zenaga (sing. Zenagui, en berbère Iznaguen sing. Aznag, en peul Sénagabé sing. Tiénagadio) ; il convient d’ajouter que le mot Zenaga, dans la bouche d’un Hassâni, renferme une signification quelque peu méprisante et est presque devenu synonyme de « tributaires », bien qu’étant le nom de l’une des plus glorieuses fractions de l’ancienne nation berbère, de celle qui donna naissance à plusieurs empires fameux et notamment à celui des Almoravides. Les Berabich (sing. Berbouchi) et les Kounta ou Kenata (sing. Kounti) ne se connaissent pas d’autre appellation générique que celle de chacune de ces deux tribus. Les Maures, dans leur ensemble, sont appelés par les Peuls et les Toucouleurs Safalbé (sing. Tiapado ou Tiapato), par les Songaï Sourkou ou Sourgou et par les Mandé Soura-ka, Soula-ka, Soulaa-ka, Soularha-ka ou Soularha. Les Maures ont auprès d’eux des serfs nègres qu’ils appellent Harrâtîn[118] (sing. Hartâni) et que les Ouolofs désignent par l’expression de Pourogne.
Les Touareg doivent ce nom, par lequel nous les désignons d’ordinaire, à l’appellation que leur donnent les Arabes : Taouâreg (sing. Targui) ; les Arabes, grands amateurs d’étymologies compliquées et tirées toujours de leur propre langue, ont attribué à ce mot la signification de « renégats » (du verbe arabe taraka « abandonner »), sous prétexte que les Touareg auraient renié douze fois la religion musulmane avant de l’embrasser définitivement ; certains auteurs européens ont voulu traduire Touareg par « voleurs de grand chemin » ou plus simplement « chemineaux » (du mot arabe tharîq « chemin »), étymologie qui d’ailleurs ne concorderait pas avec l’orthographe usitée par les Arabes pour écrire le nom des Touareg : mais il est beaucoup plus vraisemblable de supposer que Targui (dont on a fait le pluriel Taouâreg) est tout uniment la forme du singulier de l’ethnique Targa, nom donné autrefois à l’une des tribus du Sahara, peut-être celle des Hoggar ou celle des Oulmidden, et ensuite, par extension, à tous les représentants du même peuple[45]. Les Touareg ne se désignent eux-mêmes que par les noms de leurs diverses tribus ou sous-tribus, mais, dans chaque tribu, ils se distinguent en deux classes, celles des Imocharhen (sing. Amocharh) ou « nobles » et celle des Imraden (sing. Amrad) ou « vassaux ». Les Songaï nomment les Touareg Sourkou ou Sourgou, comme les Maures, désignant plus spécialement les Imocharhen par le terme de Bourdâm ou Berdâm[46] et les Imraden par celui de Daga. — Les Touareg ont auprès d’eux des serfs nègres désignés généralement sous le nom de Bella et qui correspondent aux Harrâtîn des Maures.
Les Peuls se dénomment eux-mêmes Foulbé (sing. Poullo), mot qui, dans leur langue, signifierait « les dispersés, les éparpillés », d’après M. le commandant Gaden. C’est le radical de ce mot, prononcé Peul par les Ouolofs, que nous avons adopté le plus généralement en France pour désigner ce peuple. Il est[119] appelé Foullânia ou Foullâniyîn (sing. Foullâni) par les Maures, Ifoulân ou Ifellân (sing. Afouli) par les Touareg, Foulani ou Foulaoua (sing. Bafilatché) par les Haoussa, Fellata ou Filata par les Kanouri du Mounio et du Bornou, et enfin par les Mandé Foula ou Fila ou encore Foulanka, bien que ce dernier terme s’applique plus spécialement aux Mandé d’origine peule parlant le malinké et que nous appelons communément Foulanké. Les Mossi désignent les Peuls par le nom de Silmissé (sing. Silmiga). Parmi les Peuls existent des castes spéciales, notamment celles des Diawambé (sing. Diawando) et des Laobé (sing. Labbo), auxquelles les Peuls propres n’étendent pas l’appellation générique de « Foulbé ». De plus, ils ont auprès d’eux, comme les Maures et les Touareg, des serfs nègres qu’ils appellent Rimaïbë (sing. Dimadio) : ce mot signifie à peu près « ceux qui vont devenir libres », par allusion à la coutume d’après laquelle les descendants d’esclaves, qui à l’origine ont constitué les Rimaïbé, devenaient libres au bout de quelques générations ; ces Rimaïbé sont appelés Komongallou par les Soninké.
Les Toucouleurs se désignent entre eux par le terme de Halpoularen (sing. Halpoular), « ceux qui parlent le poular »[47], ou par celui de Foutankobé ou Foutanké (sing. Foutanko ou Foutankédio), c’est-à-dire « ceux du Fouta », ou encore par les noms de leurs différentes tribus ou fractions. Les Maures les appellent Tekarir (sing. Tekrouri) et les Zenaga parlant berbère Itkariren (sing. Etkarir), tous mots dérivant du nom de l’ancienne ville ou de l’ancien pays de Tekrour, pays qui correspondait à peu près au Fouta sénégalais actuel et où se constitua le peuple toucouleur. Cette dernière appellation, que les Français ont adoptée, vient tout simplement de la façon dont les Ouolofs prononcent le nom du Tekrour et de ses habitants : Tokoror, Tokorogne ou Tokolor. Les Mandé donnent aux Toucouleurs l’appellation de Foutanka (gens du Fouta).
Les Songaï se dénomment eux-mêmes Songaï, Sonrhaï ou[120] Songoï. Ils se divisent en plusieurs classes dont la plus noble, celle des Arma (appelés aussi Darbout et Haïdara), prétend descendre des soldats marocains (Berbères, Arabes et surtout renégats andalous) qui, de 1590 à 1650 environ, participèrent à la conquête de la ville de Tombouctou et de l’empire de Gao ; ces Arma font venir leur nom du mot arabe râmi « lanceur de projectiles » et expliquent cette étymologie en disant que leurs ancêtres marocains auraient été les premiers à se servir de fusils dans la région du Niger[48]. Les Arma donnent à la classe inférieure, ouvrière et surtout agricole, qui constitue du reste l’immense majorité du peuple songaï, le nom de Gabibi qui signifie « corps noir », c’est-à-dire « nègres », voulant marquer par là que les gens de cette classe ne peuvent prétendre à une ascendance blanche. Une partie de la population songaï, composée principalement de pêcheurs et de bateliers, est désignée sous les termes spéciaux de Sorko et de Kourteï. Les Touareg appellent les Songaï Ihattân (sing. Ahatti) et les Peuls Diermabé (sing. Diermadio) ; c’est ce dernier mot que nous appliquons principalement, sous la forme Djerma, aux Songaï de la région de Dosso et Niamey, sur la rive gauche du Niger, région qu’on appelle également Saberma ou Zaberma, tandis qu’on appelle Dendi la région correspondante sur la rive droite du fleuve et les Songaï qui l’habitent.
Le nom de Mandé que nous donnons, faute d’appellation[121] indigène, à l’ensemble de la famille ethnique comprenant, entre autres peuples, les Soninké, les Malinké et les Diallonké, n’est pas autre chose que le nom de la mère-patrie de l’un de ces peuples, celui des Malinké ou Mandingues, et de ce peuple lui-même. A proprement parler, ce nom de Mandé ne convient pas plus aux Soninké, aux Diallonké et même aux Dioula et Banmana, que le nom d’Anglais ne convient aux Ecossais et aux Irlandais ; mais, puisqu’il faut bien donner un nom à chaque famille ethnique, il n’y a en somme aucun inconvénient à se conformer à un usage aujourd’hui admis.
Le pays d’origine des Malinké a en effet porté de tout temps le nom qu’il porte encore actuellement : Mandé ou Mandeng, Mandi ou Manding, selon que les prononciations dialectales ferment moins ou plus la voyelle finale et selon qu’elles en éludent ou en exagèrent la nasalisation. Ce nom est prononcé souvent Mané ou Mani par les gens du Ouassoulou, Malé ou Mali par les Soninké, Mallé ou Malli, Mellé ou Melli par les Peuls : cette dernière prononciation a été adoptée par plusieurs auteurs arabes et par des auteurs européens qui les ont mis à contribution, tandis que d’autres adoptaient l’orthographe Mali ou l’orthographe Mandé ou Manding ; mais toutes ces formes ne sont que des variantes d’un même mot, variantes parfaitement conformes aux lois de la phonétique soudanaise. On a voulu trouver à ce mot une étymologie totémique et on a traduit Mali par « hippopotame » et Mandé par « petit lamentin » : ces deux étymologies sont rejetées par les indigènes du pays, c’est-à-dire les Malinké, qui déclarent que Mandé ou Mali est simplement le nom de leur patrie et qu’ils n’en connaissent pas la signification[49] et qui, au surplus, n’ont aucun totem de peuple, pas plus le lamentin que l’hippopotame : un de leurs clans seulement[122] a pour tana ou « tabou » l’hippopotame et il n’en porte pas le nom (clan des Keïta).
Soninké est l’appellation par laquelle le peuple des Soninké se désigne lui-même. On a prétendu que ce mot voulait dire « les gens ou les partisans du Sonni » et avait été appliqué à ceux qui, lors de la conquête de l’empire de Gao par Ali Kolon, fondateur de la dynastie des Sonni (en 1331), auraient embrassé le parti de ce dernier ; cette étymologie me paraît inacceptable pour plusieurs raisons : d’abord les Soninké existaient comme peuple et avaient même joué un rôle très considérable dans l’histoire du Soudan bien avant le début de la dynastie des Sonni ; de plus, ils semblent n’avoir eu que peu de relations avec l’empire de Gao, au moins avant les dernières années de la dynastie des Sonni, et il serait étrange que le peuple entier dût son nom au fait — d’ailleurs hypothétique — que quelques-uns de ses membres auraient pris parti pour le fondateur de cette dynastie. Il est probable d’ailleurs que ce mot — dont j’avoue ignorer complètement l’étymologie — n’est pas formé d’un élément sonni ou soni suivi du suffixe ké qui, en peul du reste plutôt qu’en mandé[50], est le suffixe de nationalité : au contraire de ce qui existe dans les mots Malinké, Foulanké, etc., la syllabe ké fait sans doute, dans Soninké, partie du radical du mot ; j’en trouve une preuve dans le fait que le k a été conservé par les Maures Bérabich dans la forme qu’ils ont donnée à ce nom : Assouanik. On a voulu aussi[51] identifier le nom des Soninké avec celui des Zenaga, écrit Sanhadja par les auteurs arabes ; cette identification me semble bien malaisée à établir : d’abord il serait assez étonnant que, si les deux noms étaient identiques, les Maures eussent conservé la forme Zenaga pour désigner les Berbères vivant à côté d’eux et adopté une autre forme — Assouanik — pour désigner les Soninké ; ensuite il y a, entre les deux noms, des différences phonétiques réelles, particulièrement en ce qui concerne leur première voyelle,[123] laquelle a toujours été écrite a et prononcée a ou e par les Arabes dans le nom des Zenaga (Sanhadja, Sanaga, Zenaga) tandis qu’elle est nettement prononcée o ou ou dans le nom des Soninké ; enfin il est bien difficile de supposer que les Soninké, nègres parfois métissés, mais incontestablement nègres, soient issus d’une fraction des Berbères Zenaga. Ce qui avait conduit M. Ch. Monteil à cette identification est un passage du Tarikh-es-Soudân où Sa’di donne le nom de « Sanhadja » aux « Nono porteurs de tresses », lesquels étaient presque indubitablement une fraction du peuple soninké : à mon avis, il y a eu là, de la part de Sa’di, soit une erreur d’information lui ayant fait prendre ces Nono pour des Berbères, soit plutôt une erreur orthographique inconsciente lui ayant fait transcrire par la forme « Sanhadja », bien connue de lui, une forme « Soninké » qu’il pouvait avoir mal entendue, qui, en tout cas, ne lui était pas familière et qui a, du reste, une certaine analogie avec la forme « Sanhadja » prononcée « Senaga ».
Quoi qu’il en soit de l’origine du mot Soninké, c’est, de l’aveu des Soninké eux-mêmes, leur véritable nom. Comme je le disais plus haut, les Bérabich ont transformé ce mot en Assouanik (sing. Souananki)[52]. Les Maures donnent aussi aux Soninké le nom d’Azer ou Adjer. Les Ouolofs les appellent Sarakhoullé ou Séréwoullé, mot qui a été adopté sous la forme Sarakolé par les premiers voyageurs européens pour désigner le peuple qui nous occupe actuellement. Les Peuls les appellent Sébé (sing. Tiédo),[124] ou parfois Nononkobé (sing. Nononko), Sillabé (sing. Silladio), Sossobé ou Sossébé (sing. Tiotiodo ou Tiotiédo) ou encore Ouangarbé (sing. Gangardo) ; le premier de ces termes s’applique à l’ensemble du peuple soninké ; celui de Nononkobé ne s’applique en réalité qu’à la tribu qui fonda la ville de Dienné[53], celui de Sillabé à la tribu ou plutôt au clan des Silla, celui de Sossobé ou Sossébé aux Soninké du Sénégal et de la Gambie et particulièrement à ceux demeurés païens et mélangés de Malinké[54] ; enfin le terme de Ouangarbé est usité principalement dans la Boucle du Niger pour désigner à la fois les Soninké et les Dioula, c’est-à-dire les Mandé musulmans d’une façon générale. Les Songaï usent aussi, pour désigner non seulement les Soninké, mais également les Dioula, de l’expression Ouankoreï ou Ouankoré qui, comme Ouangarbé, provient de Ouangara, nom donné par les Soudanais du Nord et par les géographes et voyageurs anciens aux régions aurifères du bassin du Sénégal et à l’ensemble de la famille mandé[55]. Les Haoussa se servent, avec la même acception, du mot Ouangaraoua. Les Foulanké appellent les Soninké Diaganka (les gens du Diagha ou Diaka, terme analogue au « diamou » soninké Diaghaté, Diakaté ou Niakaté). Enfin les Malinké, les Banmana et les Dioula les appellent Marka, Maraka, Malarhaka ou simplement Malarha et les Mossi Marassé (sing. Maraga).
Le mot Dioula — forme universellement adoptée aujourd’hui par les Français — est prononcé plutôt par les Dioula eux-mêmes Giula (par g dur et u français) ou Diula, tandis que les Banmana le prononcent Diôra et les Malinké Dioula ou Dioulanka, dont les Peuls ont fait Dioulankobé ou Dioulanké (sing. Dioulanko ou Dioulankédio). On a dit souvent que ce mot n’était pas un nom de peuple ni de tribu et qu’il signifiait « commerçant »[125] et surtout « commerçant ambulant, colporteur » : c’est assurément inexact ; « commerçant » se dit en mandé diagolila ou diaolila ou de plusieurs autres manières qui toutes sont des dérivés du verbe diago ou diao « commercer », mais le mot dioula ne possède le sens de « commerçant » ou « colporteur » dans aucun dialecte mandé. Seulement, comme les Dioula exercent surtout, et plus que les autres peuples, le métier de colporteur, leur nom est devenu synonyme de « commerçant ambulant » dans la majeure partie de l’Afrique Occidentale, absolument de la même façon que le nom des Auvergnats a été longtemps chez nous synonyme de « porteur d’eau » et celui des Savoyards synonyme de « ramoneur », et sans plus d’exactitude. D’ailleurs les Dioula eux-mêmes sont très affirmatifs sur ce point et revendiquent ce mot de Diula ou Dioula comme l’appellation propre de leur peuple ou tribu, ajoutant qu’il signifie « du fond, de la souche », c’est-à-dire « ceux qui sont de noble origine, qui n’ont pas été altérés par des immixtions de sang étranger ». Les Dioula et les Soninké se confondant souvent ensemble dans la Boucle du Niger par la religion (les uns et les autres sont en majorité musulmans), par le métier (commerçants, tisserands, teinturiers) et par l’emploi de la même langue (le dialecte dioula), on les confond souvent aussi sous les mêmes appellations de Ouangarbé chez les Peuls, Ouangaraoua chez les Haoussa, Ouankoreï chez les Songaï, Yarhsé (sing. Yarhga) chez les Mossi de Ouagadougou, Kambossé (sing. Kamboga) chez les Mossi du Yatenga, Sahersé (sing. Saherga) chez les Nankana, Yourou chez les Samo, Sorho chez les Koulango, Tiorho chez les Sénoufo, Nzoko chez les Agni, etc. Les Dioula eux-mêmes donnent souvent le nom de Dafing[56] à ceux d’entre eux et aux Soninké qui habitent dans la région de Koury ou Dafina (chez les Dafing).
Les Banmana sont communément appelés Bambara, non seulement par les Européens, mais encore par la plupart des peuples du Soudan qui les environnent et c’est sous cette dernière forme que leur nom se trouve orthographié dans le[126] Tarikh-es-Soudân ; il est fort possible que Bambara ne soit pas autre chose qu’une altération de la prononciation indigène Banmana, il est possible aussi que le mot ait une autre origine ; quoi qu’il en soit, il est absolument certain que, pour les musulmans du Soudan en général et de la Boucle du Niger en particulier, le mot Bambara désigne, non pas un peuple déterminé ni une tribu spéciale, mais l’ensemble de tous les Soudanais vivant au milieu ou à côté de musulmans et étant demeurés fidèles à la religion indigène : c’est ainsi que les Dioula de Sikasso et de la région de Kong appellent « Bambara » les Sénoufo, que les Dioula et Soninké d’Odienné appellent « Bambara » les Malinké non-musulmans qui les entourent, que les Dioula des pays de la Volta appellent « Bambara » les Gbanian et les Dagari, etc. ; c’est ainsi encore qu’à Sikasso l’expression bambara-kan signifie, non pas la langue mandé ni le dialecte mandé des Banmana, mais bien la langue sénoufo. Par suite, l’emploi du mot Bambara, fait sans discernement, a amené des résultats fâcheux ; il a conduit par exemple à faire croire que les Bambara-Minianka du cercle de Koutiala formaient un même peuple avec les Bambara de Ségou et de Bamako, alors que les premiers sont des Sénoufo et les seconds des Mandé. Aussi je préfère m’abstenir complètement de cette expression à valeur amphibologique et je désignerai toujours le peuple de Ségou, du Bélédougou, etc. comme il se désigne lui-même, c’est-à-dire par le mot Banmana[57].
Les Khassonkè, comme ils se dénomment eux-mêmes, ou Kassonké, comme prononcent les Peuls, tirent leur nom de celui de leur pays d’origine, le Khasso ou Khasson (région de Kayes). Ils partagent souvent avec les Soninké mêlés de Malinké du Sénégal et de la Gambie l’appellation de Sossé.
[127]Les Malinké se dénomment eux-mêmes Mandenka, Mandenga, Mandinga ou Maninga selon les prononciations régionales ; les Dioula disent plutôt Manenga ou Mandenga et les Banmana Maninka ; les Peuls les appellent Mandinké, Malinké, Mellinké, ou Mellenké (sing. Mandinkédio, Malinkédio, etc.) ou encore Mandinkobé, Malinkobé, etc. (sing. Mandinko, Malinko, etc.), et les Touareg Imalan (sing. Amali) : toutes ces expressions ont la même valeur, celle de « gens du Mandé, Manding, Mali, Melli, etc. », c’est-à-dire du pays qui est porté sur nos cartes sous le nom de « Manding », au Sud de Kita et au Sud-Ouest de Bamako, et qui fut en effet le pays d’origine de ceux que nous appelons nous-mêmes Mandingues ou Malinké. Les géographes arabes leur ont souvent donné le nom de Ouangara qui, aujourd’hui, est surtout appliqué aux Soninké et aux Dioula, ainsi que je l’ai mentionné tout à l’heure.
Le mot Foulanké (en peul) ou Foulanka (en mandé), parfois employé pour désigner les Peuls ou les Toucouleurs, s’applique en réalité à des populations qu’on peut considérer actuellement comme incorporées à la famille mandé et qui ne parlent que le mandé (dialecte malinké), bien qu’elles soient certainement d’origine peule, en partie tout au moins ; on les rencontre dans plusieurs provinces, toutes appelées en mandé Fouladougou ou Fouladou (pays du Foula ou des Foulanka).
Les Diallonké ou Diallonka sont, comme leur nom l’indique, les autochtones du Diallon ou Fouta-Diallon et des régions avoisinantes ; ils revendiquent eux-mêmes le nom de Soussou, que nous donnons de préférence à ceux d’entre eux qui se sont avancés vers l’Atlantique.
Les Sia sont appelés communément Bobo-Dioula, bien que l’expression soit doublement impropre puisqu’ils ne sont ni Bobo ni Dioula ; elle vient de ce que certaines de leurs coutumes se rapprochent de celles des Bobo, tandis que leur façon de s’habiller les fait ressembler aux Dioula, dont ils ont en partie d’ailleurs adopté le dialecte, tout en conservant leur langue propre.
Je ne vois pas d’observations à faire sur le nom des autres peuples ou tribus de la famille mandé (Bozo, Kâgoro, Samo,[128] Samorho, etc.), sinon qu’il y a de fortes présomptions pour que Samo et Samorho ne soient qu’un seul et même vocable, la première forme représentant la prononciation banmana et la seconde la prononciation dioula.
Les Sénoufo ne se désignent la plupart du temps que par les noms de leurs diverses tribus (Bamâna que les Mandé appellent Minianka et qu’il convient de ne pas confondre avec les Banmana, Siénérhè, Tagba, etc.). Cependant ils possèdent un terme pour désigner leur peuple tout entier, bien qu’ils en fassent très rarement usage et qu’il ne soit pas connu de toutes les tribus : ce terme est Siéné ou Siéna[58] (au pluriel Siénamana). Par contre les Malinké et les Banmana, qui connaissent ce mot, s’en servent pour les désigner, sous les formes Siénéfo, Sénéfo, Sénofo, Sénoufo, « (ceux qui) parlent siéné », et c’est la dernière de ces formes que les Européens emploient le plus souvent. Les Dioula appellent couramment les Sénoufo Bambara (voir plus haut) et parfois Nafana (du nom d’une de leurs tribus de la Côte d’Ivoire) ou encore Pomporon (terme qui semble être un surnom donné surtout à la tribu des Folo et à quelques fractions des Siénérhè). Les Samorho les appellent Sopi ; les Koulango les appellent Gan[59], et les Agni Kanga, mot qui dans leur langue est devenu presque synonyme d’« esclave » ; les Abron et Assanti ou Achanti les nomment Pantara ou Ouandara.
J’ai donné le nom de voltaïque à la très importante famille ethnique dont les membres forment presque la moitié de la population totale du Haut-Sénégal-Niger ; ce nom m’a paru justifié par le fait que le domaine de cette famille est sensiblement localisé au bassin de la Volta. Pour faciliter la nomenclature, j’ai attribué à chacun de ses sept groupes le nom du peuple principal ou du peuple le plus connu de ce groupe, sans prétendre faire par là de ce peuple celui dont les autres seraient issus.
[129]Les trois peuples du groupe tombo (Tombo proprement dits, Dogom et Déforo) sont communément désignés par les Français du Soudan sous le terme générique de Habé ou Habbé ou encore par celui de Kado ou Kaddo : ces deux termes ne sont pas autre chose que le pluriel et le singulier d’un mot peul qui s’applique à toutes les populations qui ne sont ni arabes, ni berbères ni peules, c’est-à-dire à tous les Nègres ; c’est ainsi que les Peuls de la Nigeria appellent les Haoussa Habé comme les Peuls du Massina appellent Habé les montagnards de la falaise de Bandiagara. Ce terme (Habé ou Kado) est donc encore plus vague et plus impropre que le terme Bambara et doit être rejeté. Il semble bien — sans que je puisse l’affirmer cependant — que les montagnards dont je viens de parler se désignent eux-mêmes par le mot Tombo, tandis que les deux autres peuples du même groupe se dénomment l’un Dogom ou Dom et l’autre Déforo. Les Peuls appellent Houmbébé ou Hombobé (sing. Koumbédio ou Kombodo)[60] les Tombo et une partie au moins des Dogom, et Déforobé les Déforo. Les Mossi appelleraient Kibsé (sing. Kibga) les Tombo proprement dits et donneraient le nom de Suida à l’ensemble du groupe tombo, mais je n’ose me prononcer à cet égard.
Les Mossi s’appellent eux mêmes Mô-sé ou plus rarement Mô-si (sing. Mô-rha ou Mô-ga) et appellent leur pays Mô-rho et leur langue Mô-rhé. Tous les noms de peuples ou de tribus terminés par le suffixe sé ou si au pluriel et rha ou ga au singulier sont empruntés à la langue des Mossi ou à une langue du même groupe. — Les Yansi (sing. Yanga), ainsi appelés par les Mossi, se dénommeraient eux-mêmes Kôssé, mais je n’affirme rien à cet égard[61]. — Les Gourmantché (sing. Gourmanga), c’est-à-dire « ceux du Gourma, de la rive droite du Niger », s’appelleraient eux-mêmes Bimba.
Par le terme un peu méprisant de Gourounsi ou Gouressi (sing. Gourounga ou Gouréga), qui voudrait dire « incirconcis »,[130] les Mossi — et les Européens d’après eux — désignent un ensemble de peuples qui ne se connaissent pas eux-mêmes d’appellation générique et qui constituent une notable partie d’un groupe que j’appelle, pour cette raison, « groupe gourounsi ». Deux de ces peuples nous sont connus par leur véritable nom — au moins je le pense — : les Nounouma ou Nourouma et les Sissala, ces derniers comprenant les Kiâlo de Léo. Les Boussansé (sing. Boussanga) ont reçu ce nom des Mossi. Quant aux Nioniossé (sing. Nioniorha), ils sont appelés ainsi par les Mossi du Yatenga ; les Mossi de Ouagadougou les appelleraient Kassomsé (sing. Kassomga) ; dans d’autres régions de langue mossi ou de langue parente du mossi, on les appelle des noms divers de Foulsé, Youlsé, Lilsé, Nimsé, Kipirsi, etc., sans que je puisse dire si ces différents noms s’appliquent à l’ensemble du peuple ou seulement à certaines de ses tribus ; enfin les Peuls les appellent Kouroumankobé (ceux du Kourouma)[62] : j’ignore quel est leur nom véritable.
Le nom de Bobo (« bègue » en mandé) est un terme de mépris appliqué par les Dioula et les Banmana à quatre tribus qui forment un seul peuple mais ne se connaissent pas, je crois, d’appellation générique en dehors de leurs noms de tribus : Kian ou Tian, Tara, Boua et Niénigué. Les Dioula distinguent les trois premières tribus par des épithètes différentes, appelant les Kian Bobo-Gbê (Bobo blancs), les Tara Bobo-Oulé (Bobo rouges) et les Boua Bobo-Fing (Bobo noirs), sans que ces épithètes soient motivées par la couleur de peau de ceux qui les ont reçues, pas plus que par la couleur de leurs vêtements, lesquels brillent du reste en général par leur absence. Les Mossi distinguent aussi ces trois mêmes tribus par les noms de Tiansé (Kian), Talessé ou Talassé (Tara) et Boulsé (Boua).
Koulango est le nom indigène du peuple formant le sixième groupe de la famille voltaïque, mais nos cartes portent souvent ce peuple sous le nom de Pakhalla, qui est une orthographe[131] défectueuse de l’appellation que lui donnent les Dioula : Kparhala ou Kpagala[63].
Les Soumba sont appelés également Taberma ; les musulmans qui les avoisinent les nomment Kafiri (païens).
Je n’ai pas, pour l’instant, d’observations à faire sur les appellations des autres peuples de la famille voltaïque représentés au Haut-Sénégal-Niger (Nankana, Dagari, Birifo ou Bérifon ; Lobi, Pougouli ou Bougouri, Dian ou Dian-né, Gan ou Gan-né ; Bariba), non plus que sur celles des tribus dont le rattachement ne peut être encore prononcé (Padorho, Dorhossié, Tiéfo, Toussia, Vigué).
1o Maures de l’Azaouad. — J’ai dit plus haut que les Maures de l’Azaouad se divisaient en deux tribus : Bérabich et Kounta.
A la première de ces tribus se rattachent les Oulad-Slimân, les Oulad-Abderrahmân et les Oulad-Ameur et, au moins au point de vue ethnique, les sous-tribus des Tormoz (ou Tourmous), des Ousra, des Borrada, des Oulad-Noumou, des Oulad-el-hadj-el-Hassân, des Idao-Yata (ou Doyata), etc.
Parmi les Kounta, on range les Regaguida du Nord de Bamba, les Ahl-cheikh-sidi-el-Mokhtar ou Bekkaï de la région de Tombouctou et les Oulad-el-Ouafi de la région de Mabrouk, ainsi que des Chorfa (sing. Cherif), descendants ou prétendus tels de la famille du Prophète, plus des vassaux d’origine berbère (les Zakhoura).
[132]De plus, il convient de ne pas oublier que, quelque illogique que cela puisse paraître lorsqu’il s’agit d’une classification ethnique, il nous est impossible de séparer des Maures les Harrâtîn d’origines nègres diverses qui leur sont pour ainsi dire incorporés ; en sorte que, indépendamment d’individus chez lesquels le sang sémitique a été profondément altéré par un long atavisme d’alliances avec des Berbères et des Nègres, il existe chez les Maures de l’Azaouad de véritables Nègres de pure race noire.
2o Maures du Hodh. — Les Maures du Hodh comprennent, je l’ai dit déjà, deux éléments ethniques bien différents, qui sont juxtaposés le plus souvent mais parfois aussi mélangés : un élément arabe représenté par les Beni-Hassân et un élément berbère, très vraisemblablement plus considérable que le premier, représenté par les Zenaga et par des familles qui se disent hassânides mais qui sont cependant d’origine berbère ; il convient de noter que les familles maraboutiques, qui se désignent elles-mêmes sous le nom générique de Zaouiya (les gens vivant en zaouïa ou couvents), sont pour la plupart d’origine berbère ou tout au moins issues d’un mélange de Zenaga et de Beni-Hassân, mélange auquel n’ont pas échappé d’ailleurs beaucoup de Beni-Hassân parmi ceux qui se prétendent de pure origine sémitique.
Chacune des sept grandes tribus énumérées plus haut comprend plusieurs sous-tribus dont les unes sont considérées comme nobles et se composent principalement de Beni-Hassân, dont les autres sont regardées comme vassales et se composent surtout de Zenaga et dont d’autres enfin renferment les familles maraboutiques. On a ainsi des divisions politiques et sociales qui ne sont pas toujours des groupements ethniques. Les sous-tribus les plus importantes du Hodh sont :
Chez les Idao-Aïch ou Douaïch, celles des Ahl-Amar (Arabes et Berbères, séparés en Abakak et en Chrattit), des Tadjakant (Arabes et Berbères), des Ligouatit et des Louata (Berbères), des Laghlal (Arabes), des Ahl-Mokhtar et des Ahl-Soueïd (Arabes et Berbères), des Idao-Ali (marabouts) et des Ahl-sidi-Mahmoud ou Oulad-sidi-Mahmoud (marabouts, se rattachant aux Idao-el-hadj ou Darmankor de l’Adrar Mauritanien) ;
[133]Chez les Oulad-Mbarek ou Gassouch, celles des Ahl-ould-Amar ou Loudamar des anciens voyageurs (Arabes), des Askeur (Arabes), des Oulad-Mahmoud ou Ladoum (Berbères et Arabes) et des Tanoazit (Berbères) ;
Chez les Mejdouf, celles des Ahl-Sidi, des Choamât et des Hammounât (Arabes), des Tâleb-Mokhtar ou Oulad-cheikh-el-Adrami (marabouts) et des Nimadi[64] ;
Chez les Oulad-Delim, celles des Oulad-Daoud et des Deïlouba (Arabes) et des Allouch ou Oulad-Allouch (Arabes mélangés de Berbères et de Peuls).
Je ne possède pas de renseignements précis sur les sous-tribus des Regueïbât, des Ahl-Tichit et des Oulad-Nasser.
Aux éléments arabes et berbères, il faut signaler un élément nègre, introduit chez les Maures du Hodh comme chez ceux de l’Azaouad par des unions avec des Noirs et par la présence de nombreux Harrâtîn[65].
De plus, certains Maures du Hodh sont issus d’un mélange très ancien de Berbères avec des Peuls ou Proto-Peuls : on les appelle Massîn ou Ahl-Massina ou encore Guirganké et on les divise au Sahel en « Guirganké blancs » et en « Guirganké noirs », sans que cette distinction soit plus justifiable que celle des Bobo en blancs, rouges et noirs.
3o Touareg. — Les Touareg des familles nobles (Imocharhen) sont, semble-t-il, de sang berbère à peu près pur, tandis que beaucoup de ceux des familles vassales (Imraden) sont plus ou moins métissés par suite d’unions avec des Nègres ou des Peuls. Chez les Touareg comme chez les Maures du Hodh, il existe des familles maraboutiques qui se sont alliées souvent avec des[134] Arabes. Enfin, comme chez les Maures aussi, il faut noter la présence de nombreux serfs nègres (les Bella), qui sont si bien incorporés aujourd’hui avec leurs maîtres qu’il est difficile de les en séparer, même dans une classification ethnique.
Chaque tribu touareg comprend plusieurs sous-tribus, les unes nobles, les autres vassales, les autres maraboutiques. Les principales de ces sous-tribus, dans les territoires civils du Haut-Sénégal-Niger, sont :
Chez les Iguellad, celles des Tagama ou Kel-Haoussa (nobles), des Kel-Antassar[66], Kel-Nkounder et Kel-Ncheria (marabouts), des Kel-Tounboukouri, Inataben, Kel-Taberint, Kel-Dokoré, Kel-Rezzaf, Kel-Tinakaouat, Kel-Ouorodjel, Kel-Teguiaït et Kel-Tountoun (vassaux) ;
Chez les Kel-Tadmekket, celles des Tenguéréguif, des Igouadaren, des Kel-Temoulaï et des Irréganaten (nobles), des Chorfiga ou Icherifen, des Zimmaten, des Ahl-sidi-Ali et des Kel-es-souk (marabouts), des Imededrhen et des Idnân (vassaux) ;
Chez les Oulmidden, celles des Kel-Gheress, des Oudalen et des Tenguéréguédech (nobles), des Kel-Oulli et Kel-Gossi (vassaux).
Il convient d’ajouter à cette liste les sous-tribus vassales suivantes, dont le rattachement à telle ou telle tribu ne m’est pas connu : Kel-Guerisouân, Kel-Tigouelt, Imakelkellen, Ibourliten, Imetchas, Kel-Rila, Déguésellen, Chemenama, Damossân et Missiguender.
4o Peuls ou Foulbé. — Nous verrons plus loin combien d’éléments divers entrent dans la composition du peuple peul actuel, éléments parmi lesquels la race noire tient une place indéniable. En outre, nous sommes obligés de considérer comme faisant partie de ce peuple les castes spéciales des Laobé (sing. Labbo, artisans en bois et bûcherons), des Abarbé (sing. Gabardo, bijoutiers et cordonniers), des Ouaïloubé (sing. Baïlo, forgerons et potiers), des Mabbé (sing. Mabo, griots et tisserands),[135] des Ouambabé (sing. Bambado, musiciens et griots), des Ouaouloubé (sing. Gaoulo, mendiants), des Soubalbé (sing. Tiouballo, pêcheurs et bateliers), des Diawambé (sing. Diawando, courtiers et tisserands) ; il nous faut aussi ranger parmi les Peuls certaines fractions fort mélangées, telles que celle des Silmimossi, issus d’alliances entre Peuls et Mossi, et même des groupements d’origine nègre pure mais incorporés aux Peuls : les Rimaïbé, qui correspondent aux Harrâtîn des Maures et aux Bella des Touareg.
Les Peuls, en dehors de leur répartition en tribus ou fractions géographiques, se divisent encore en un certain nombre de clans, dont chacun peut être représenté dans plusieurs tribus à la fois, et dont les plus répandus au Haut-Sénégal-Niger sont ceux des Ourourbé (sing. Bourourdo ou Bolardo ou Boli), des Tôrobé (sing. Tôrodo)[67], des Dialloubé (sing. Diallo), des Yalabé ou Alaïbé (sing. Galadio), des Irlabé (sing. Guerladio), des Oualarbé (sing. Balardo), des Salsalbé (sing. Tialtiallo), des Fitobe (sing. Pitodo), des Daébé (sing. Daédio), des Férèbé ou Férobé (sing. Pérèdio), des Sitigabé (sing. Tyitigadio), etc. D’autres noms de clan, empruntés aux Toucouleurs ou aux Mandé, revêtent la même forme aux deux nombres ; tels sont Bâ ou Diakité (même clan que les Ourourbé), Soumontara (même clan que les Dialloubé), Bari ou Sangaré (même clan que les Daébé), Sô ou Sidibé (même clan que les Férobé), etc. Enfin il convient de noter que beaucoup d’individus portent, comme nom de clan, le nom même du peuple peul (Poullo) ou celui de la caste à laquelle ils appartiennent (Labbo, Diawando, etc.).
5o Toucouleurs. — Les Toucouleurs ou Foutanké, peu nombreux[136] du reste dans le Haut-Sénégal-Niger, se répartissent en quatre fractions selon qu’ils sont originaires du Dimar (ouest du Toro), du Toro (province de Podor, les Toronké ou Toronâbé), du Fouta proprement dit (province de Saldé, les Foutanké propres, comprenant les Foutanké du Lao, les Foutanké Irlâbé, les Bosséâbé, les Ebiâbé et les Koliâbé) ou du Damga (province de Matam, comprenant les Dénianké, les Toucouleurs du Ganar et les Aéranké).
En outre, comme les Peuls, ils se divisent en un certain nombre de clans dont les principaux sont ceux des Ba ou Boli, des Ka, des Si ou Bari, des Sô[68], des Li, des Fal, des Tal, des Sal, des Diao, des Kane, des Diko, etc.[69].
6o Songaï. — Le peuple songaï, tel qu’il se présente aujourd’hui, comprend les Arma, les Gabibi et les Sorko ou Kourteï, classes ou castes dont nous avons vu plus haut la composition. J’ai dit également qu’il convenait d’y rattacher les fractions du Sud-Est connues sous les noms de Dendi, Djerma et Zaberma. A Tombouctou, on range habituellement parmi les Songaï la classe des alfa ou docteurs musulmans (alfa serait l’abréviation de l’arabe al-faqih « le jurisconsulte ») : en réalité ces alfa sont d’origines multiples et se composent de gens appartenant à des peuples très divers.
Les Songaï se divisent en clans, comme les Peuls, les Toucouleurs et tous les peuples du Soudan (Maures et Touareg exceptés), mais je ne possède que fort peu d’informations sur leurs noms de clan ; je sais seulement qu’on rencontre chez eux les clans des Meïga et des Haïdara, ce dernier comprenant les Arma qui revendiquent une origine chérifienne, et que la caste des Sorko se répartit entre deux grands clans, celui des Faran ou Faram et celui des Fono.
[137]7o Bozo. — On a parfois identifié les Bozo avec les Sorko d’une part et les Somono de l’autre : c’est une erreur au point de vue ethnique. Il existe bien à la vérité un trait commun entre ces trois groupements : tous les trois se livrent à la pêche et à la navigation. Mais les Sorko et les Somono ne se livrent qu’à ce double métier, ou plutôt ce métier est, en quelque sorte, le privilège de leur caste : ils forment, les premiers chez les Songaï, les seconds chez les Banmana, une caste analogue à celle des Soubalbé chez les Peuls, caste de pêcheurs et de bateliers. Les Bozo, au contraire, ne constituent pas une caste, au moins à l’heure actuelle, et ne sont pas exclusivement pêcheurs et bateliers ; certains habitent des villages assez éloignés du fleuve et s’y livrent à l’agriculture. Les Sorko sont des Songaï, les Somono sont des Banmana ; les Bozo forment un peuple à part. Je n’ai pas de renseignements sur les noms de clan portés par les Bozo, sauf sur ceux des clans Diennépo, Sétao et Karapata, cités par M. Ch. Monteil.
8o Soninké. — Je range dans le peuple soninké, au moins au point de vue ethnique, la tribu des Nono et ceux de ses représentants actuels qu’on appelle communément les Diennenké parce qu’ils constituent la presque totalité de la population de Dienné. J’y range aussi les Diawara (Sagoné ou Sahonéra et Dabo), groupement hybride participant à la fois de la tribu, de la caste et du clan, et qui paraît correspondre chez les Soninké au groupement des Diawambé chez les Peuls.
Les clans proprement dits sont nombreux chez les Soninké. Les plus répandus dans le Haut-Sénégal-Niger sont ceux des Diakaté, Diakhaté, Diaghaté ou Niakaté, des Sissé, des Silla, des Diâbi ou Diâbira, des Sakho, des Tounkara[70], des Daramé, des Kamara, des Sissokho, Soussokho ou Sossé, des Niarè, des Touré (dont font partie les Daraoué), des Doukouré, des Diarisso ou Diaressi, des Koromakha ou Koromaga, des Soumaré, des Souaré, des Sibi, des Bakili ou Simbara ou Sempré, des Gourseï, des Kounaté ou Kounaré, des Taraoré, des Diabouraga, des Gaoudéra, des Kanndé ou Kannté, des Koumma ou Koumba, des[138] Kaba, des Fofana, des Ouagui, des Dikéné, des Bérété, des Diagouraga, des Soma, des Koné, des Séméga, des Maréga, des Mokhossiré, des Tiléra, des Gakou, des Sarambounou, des Yatéra ou Yaté, des Timéra ou Timété, des Fadé, des Nambounou, des Goundiémou, des Galadyi, des Baradyi, des Soudouré, des Kalé, des Mana, des Koussata, des Samoura, des Mangara, etc. Les Soninké qui se prétendent d’origine chérifienne se donnent le nom de Sirifé ou, dans la région de Dienné-Tombouctou, celui de Haïdara.
Au point de vue ethnique, je considère comme Soninké tous les Marka de la Boucle du Niger et des pays banmana et malinké, bien que la plupart ne fassent plus usage de leur langue et aient adopté le parler des Dioula, celui des Banmana ou celui des Malinké selon les régions, comme les Soninké de Dienné ont adopté la langue songaï. On donne souvent comme Marka, c’est-à-dire Soninké, les Dafing ou musulmans du Dafina : en réalité les Dafing se composent, au point de vue de leur origine, en partie de Soninké et en partie de Dioula.
9o Dioula. — Les Dioula ne se répartissent pas en tribus ; peut-être même serait-il plus exact de les considérer comme une tribu que comme un peuple, au moins au point de vue linguistique. Mais ils se divisent en clans, dont les principaux sont ceux des Ouatara, des Konaté ou Kounaté, des Sissé, des Konndé ou Koné, des Kouloubali ou Kouroubari, des Sarhandorho ou Sarhanorho, des Kamara ou Kamaya, des Sinngaré ou Sinnari, des Diâbi, des Fofana, des Touré, des Dao, des Dagnorho, des Dosso, des Barho, des Timété, des Kangoté, des Garamvoté, des Tondossama ou Samatondo, des Siya, des Nanaya, des Dérébo, des Daramé, des Karidioula, des Sissouma, des Bérété, des Sorhoba, des Dembélé, des Koïta, des Somarha, des Koro, des Taraoré, des Bamba, des Kérou, des Sarha, des Sânou, etc. On rencontre aussi des Sirifé, qui se prétendent d’origine chérifienne.
J’ai cru devoir rattacher aux Dioula la petite tribu des Boron ou Bolon, qui a des représentants dans les cercles de Bobo-Dioulasso (8.000) et de Koury (450).
[139]10o Kâgoro. — Le peuple — ou la tribu si l’on préfère — des Kâgoro a comme clans principaux ceux des Kâgorota, des Fofana, des Kané, des Tounkara, des Magaza ou Makassa, des Konaté, des Touré.
11o Banmana. — Les Banmana, comme les Dioula, les Kâgoro, les Khassonké, les Malinké et les Foulanké, pourraient être considérés, surtout au point de vue linguistique, comme ne formant qu’une tribu, plutôt qu’un peuple. Ils se divisent en plusieurs fractions politiques et géographiques (Kaartanka, Bélédougouka, Ségouka, Baninkoka, etc.). Leurs clans principaux sont ceux des Kouloubali (dont font partie les Massassi)[71], des Taraoré ou Travélé (dont font partie les Dembélé ou Dambélé), des Doumouya ou Doumbouya (dont font partie les Kourouma), des Diara (dont font partie les Konnté ou Koné et les Sinngaré), des Fofana, des Konaté ou Kounari, des Koussata, des Tangara, des Kanté ou Kané, des Niarè, des Touré, des Dansira[72], des Mariko, des Sanorho, des Sissé, des Samakè, des Kamara, des Bouaré, etc.
Ainsi que je l’ai dit plus haut, je rattache aux Banmana la caste des Somono (pêcheurs et bateliers). D’autres castes existent encore chez les Banmana : celles des Noumou (forgerons et potiers), des Lorho (bijoutiers en cuivre), des Koulè (artisans en bois), des Diêli (griots), des Founè ou Founérhè (griots religieux et magiciens), des Donso ou Lonzo (chasseurs) ; ces différentes castes ne sont pas spéciales au peuple banmana : on les retrouve sous les mêmes noms chez les autres peuples mandé et, sous d’autres noms, chez la plupart des peuples du Soudan. Dans chaque peuple donné, les membres de ces castes ne sont pas désignés par les indigènes sous le nom du peuple, mais sous le nom de leurs castes respectives ; cependant, au point de vue ethnique, il convient de les incorporer dans l’ensemble du peuple.
[140]12o Khassonkè. — Les Khassonkè, fort peu nombreux, renferment les clans des Sissokho ou Soussokho ou Sossé, des Séga, des Sambala, des Diala, des Fali, des Diakité ou Diakhaté, des Sangaré, des Sidibé, des Diallo, etc.
13o Malinké ou Mandingues. — Le peuple — ou la tribu — mandingue se divise en plusieurs sous-tribus qui sont surtout des fractions géographiques et qui, en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger, sont celles du Manding proprement dit, du Bambougou ou Bambouk, du Gangaran, du Ouassoulou, etc.
Les clans principaux sont ceux des Keïta (dont font partie les Mansaré[73], les Kanessi et les Batassi), des Diara (dont font partie les Konnté ou Koné), des Kouloubali (dont font partie les Bamba), des Taraoré (dont font partie les Dembélé), des Doumouya (dont font partie les Kourouma), des Diarassouba, des Kamissorho, des Sissé, des Sarhanorho, des Kamara ou Kamaaté, des Diabaaté ou Diawaté, des Konaté ou Koyaté, des Kannté, des Tounkara, des Fané ou Fani, des Samakè, des Fofana, des Diomansi ou Diomandé, des Sissoko (comprenant les Maga et les Koromaga), des Barhayorho, des Mariko, des Doukouré, des Béré ou Béréya ou Bérété, des Mété ou Mérité, des Souko, des Demba, des Sakiliba[74], etc. Il faut y ajouter quelques Sirifé de prétendue origine chérifienne.
14o Foulanké. — Les Foulanké sont, comme je l’ai dit plus haut, des descendants de Peuls très fortement métissés de sang mandingue et qui, par leurs mœurs et leur langage, ne se distinguent guère aujourd’hui des Malinké proprement dits. On les reconnaît surtout grâce à leurs noms de clan, qui sont presque exclusivement Diakité, Sankaré ou Sangaré, Sidibé et Diallo.
15o Diallonké. — Les clans principaux des Diallonké du Haut-Sénégal-Niger sont ceux des Monékata, des Kessékho, des Dagnokho, des Dao, des Kontaga, des Touré, des Diatara, des Dansoko, des Bamba ou Bambaya, des Siré ou Siréya, des Kelléma, etc.
[141]16o, 17o et 18o Samo, Samorho et Sia. — Je ne possède pas de renseignements suffisamment certains sur les clans de ces trois peuples, pas plus que sur ceux des tribus de classification douteuse qui les avoisinent (Blé, Natioro, Ouara et Sembla). La plupart des individus appartenant à ces peuples ou tribus, lorsqu’on les interroge sur leur clan, répondent par un diamou (nom de clan) dioula (ou mossi s’il s’agit des Samo), mais il est fort probable que ce diamou dioula ou mossi n’est qu’une sorte de traduction de leur diamou national.
19o Sénoufo. — J’ai donné plus haut la liste de dix tribus sénoufo dont la présence a été constatée dans le Haut-Sénégal-Niger. Je dois ajouter qu’à la tribu des Siénérhè se rattache la sous-tribu des Niéné, qui a des représentants dans le cercle de Bougouni. Je ne connais que cinq clans sénoufo, ceux des Soroo, des Yéo, des Siluè, des Tuô et des Sékongo, mais il en existe probablement d’autres : c’est ainsi qu’on signale, chez les Sénoufo du cercle de Koutiala, les clans des Malé, des Péné et des Ounogo. Comme les Samorho et les Sia, les Sénoufo s’attribuent fréquemment des noms de clan dioula, banmana ou malinké (Kouloubali, Ouatara, Koné, Diarassouba, Touré, Dagnorho, Kamara, Sânou, Dembélé, Fofana, etc.).
Les mêmes castes existent chez les Sénoufo que chez les Mandé et les Peuls ; je ne connais pas les noms que revêtent ces castes chez les Sénoufo, sauf celui de la caste des Sono ou Sonon, qui correspond à peu près à celle des Founè chez les Mandé (griots religieux et magiciens).
20o à 40o Famille voltaïque. — Nous ne possédons encore que des renseignements fort incomplets sur la composition des 21 peuples de famille voltaïque que l’on rencontre dans le Haut-Sénégal-Niger, en ce qui concerne leurs tribus, sous-tribus, castes et clans.
Je puis dire seulement que les Dagari se divisent en deux grandes tribus : celle des Dagari proprement dits, appelés par les Dioula Dagari-Fing (Dagari noirs), et celle des Oulé ou Oulé-Oulé, appelés par les Dioula Dagari-Oulé (Dagari rouges). La première comprend de nombreuses sous-tribus, dont les[142] principales portent, en territoire français, les noms de Dakpélé ou Dafiélé, Gban-né, Zéghè, Gbolé, etc.
Je sais aussi que tous les peuples de la famille voltaïque se répartissent en clans, mais nous ne connaissons la plupart du temps que l’équivalent mandé de leurs diamou ou sondré nationaux. Toutefois, le capitaine Dominé nous a révélé les principaux noms de clan des Lobi : ce sont Da, Héna, Noufi, Kambou ou Kambiri, Dioloumpo, Pala, Somé. J’ajouterai que, chez les Mossi, l’un des clans les plus répandus est, d’après le Père Brun, celui des Pima[75].
Répartition numérique des peuples du Haut-Sénégal-Niger par races, familles et religions. — La race blanche, en y comprenant — quelque illogique que ce soit — non seulement les Maures, les Touareg et les Peuls les plus métissés de sang nègre, mais encore les Nègres purs qui vivent avec eux (Harrâtîn, Bella et Rimaïbé), renferme, dans les territoires civils actuels du Haut-Sénégal-Niger, 566.175 représentants, tous musulmans à l’exception de 35.646 Peuls animistes[76]. La répartition de ces 566.175 indigènes entre les deux familles sémitique et hamitique serait fort malaisée.
Le reste des 4.800.000 habitants de la colonie[77], soit 4.233.528 — l’immense majorité en un mot —, appartient à la race noire et renferme 608.642 musulmans seulement, au grand maximum, contre 3.624.886 animistes. La répartition des indigènes de race noire entre les cinq familles est la suivante :
| [143]famille | voltaïque | 2.292.088 | indigènes, | dont | 26.209 | musulmans ; |
| — | mandé | 1.435.001 | — , | dont | 440.851 | — ; |
| — | sénoufo | 343.470 | — , | dont | 0 | — ; |
| — | songaï | 101.582 | — , | dont | 101.582 | — ; (totalité) |
| — | tekrourienne | 38.256 | — , | dont | 36.706 | — ; |
| tribus non classées | 19.035 | — , | dont | 0 | — ; | |
| étrangers divers | 4.096 | — , | dont | 3.294 | — ; | |
| Total: | 4.233.528 | — , | dont | 608.642 | — . | |
La famille voltaïque renferme à elle seule, comme on le voit, plus de la moitié de la population de race noire et près de la moitié de la population totale de la colonie, et la famille mandé renferme à peu près le tiers de la population de race noire et le quart de la population totale.
Les musulmans ne forment que le septième de la population de race noire et un peu moins du quart de la population totale.
Répartition numérique par subdivisions ethniques et par zones géographiques et administratives.
1o Maures de l’Azaouad (y compris les Harrâtîn).
| Zone saharienne | 26.000 | |
| Cercles de Tombouctou | 5.715 | |
| Cercle de Niafounké | 300 | |
| Total | 32.015 | (tous musulmans). |
Les Bérabich habitent principalement la région d’Araouân et sont maîtres de la route conduisant de Tombouctou à Taodéni. Leurs sous-tribus se rencontrent : les Tormoz, entre Bassikounou et Ras-el-Ma ; les Ousra et les Borrada, entre Ras-el-Ma et Araouân ; les Oulad-Noumou, Oulad-el-hadj-el-Hassân et Idao-Yata (ces derniers sédentaires), dans la vallée du Niger en aval de Niafounké.
Les Kounta du Haut-Sénégal-Niger habitent près et au Nord-Est de Tombouctou, à Araouân, dans la région de Mabrouk et au Sud du Niger, répandus parmi les Touareg. Les Chorfa de Tombouctou se rattachent aux Kounta. Il convient de noter qu’on rencontre aussi dans le Hodh quelques familles de[144] Kounta (Oulad-sidi-Boubakar, Oulad-Bousseïf et Oulad-sidi-Haïballah) que j’ai comptées avec les Maures du Hodh.
2o Maures du Hodh (y compris les Zenaga, les Guirganké et les Harrâtîn).
| Zone saharienne | 40.000 | ||
| Résidence de Kiffa | 20.000 | ||
| Cercle de | Goumbou | 4.557 | |
| — | Kayes | 4.260 | |
| — | Sokolo | 1.830 | |
| — | Nioro | 1.776 | |
| Total | 72.423 | (tous musulmans). | |
Les Regueïbât habitent principalement dans la résidence de Kiffa ; les Idao-Aïch dans cette même résidence, dans le cercle de Nioro (Bakounou-sud) et dans le cercle de Kayes (Ahl-sidi-Mahmoud), ainsi qu’entre Kiffa et Tichit et au Nord-Est du cercle de Nioro (Laghlal) ; les Ahl-Tichit se rencontrent dans la région de Tichit et dans les cercles de Nioro (Kingui) et de Goumbou (Mourdia) ; les Oulad-Mbarek se trouvent surtout dans la province de Nioro (Kingui), dans le cercle de Goumbou et au Nord de ce cercle, ainsi que dans le cercle de Kayes et dans l’Est de Kiffa (Askeur et Tanoazit) et au Nord de Goumbou et de Sokolo (Oulad-Mahmoud) ; les Mejdouf, avec les Tâleb-Mokhtar, habitent entre Goumbou et Oualata et entre Sokolo et Ras-el-Ma ; les Oulad-Delim (Oulad-Daoud, Deïlouba et Allouch) se rencontrent dans la région comprise entre Bassikounou, Soumpi et Ras-el-Ma, les Oulad-Daoud proprement dits étant surtout sédentaires ; les Oulad-Nasser habitent au Sud-Ouest de Oualata, au Nord des Oulad-Mbarek ; les Chorfa, très mélangés de Soninké, habitent principalement les villes de Tichit, Oualata et Néma, où ils se livrent au commerce et au travail des cuirs, tout en s’occupant de religion ; enfin les Guirganké, Maures demi-sédentaires métissés de Peuls, se trouvent surtout dans le cercle de Goumbou (Bakounou-Nord, Kolon, Ouagadou, Ouaharo), et (sous le nom de Massîn ou Ahl-Massina) dans les villes de Tichit, Néma, Oualata, etc.
[145]3o Touareg (y compris les Bella).
| Zone saharienne | 8.000 | ||
| Cercles de Tombouctou | 28.019 | ||
| Cercle de | Dori | 12.000 | |
| — | Hombori | 8.000 | |
| — | Niafounké | 1.000 | |
| Total | 57.019 | (tous musulmans). | |
Les habitats respectifs des Iguellad et des Kel-Tadmekket sont aujourd’hui assez mêlés, quoique, d’une façon générale, les premiers se rencontrent surtout dans la région de Tombouctou et les seconds dans l’Est de la Boucle du Niger.
Les Iguellad sont principalement nombreux du côté de Ras-el-Ma, de Goundam et de Tombouctou ; les Tagama se rencontrent près du lac Fati et dans l’Est de Tombouctou, les Kel-Nkounder et Kel-Ncheria dans la province de Goundam, les Kel-Antassar près des lacs de la rive gauche et au Nord-Est de Tombouctou.
Les Kel-Tadmekket sont dispersés de Tombouctou à Gao, à l’intérieur de la Boucle du Niger, mais possèdent aussi des fractions sur la rive gauche du fleuve : les Tenguéréguif se rencontrent dans la région des lacs, les Igouadaren du côté de Bamba (rive Nord et rive Sud), les Kel-Temoulaï sur la rive droite du Niger à l’Est de Tombouctou, les Irréganaten au Sud-Ouest de Bamba, les Chorfiga près du lac Fati, dans le Kili et le Kissou et dans le cercle de Hombori, les Kel-es-souk dans l’Est du cercle de Hombori, les Imededrhen dans l’Azaouad-Nord, les Idnân à l’Est de Mabrouk.
Les Oulmidden, qui forment la plus nombreuse des grandes tribus touareg, habitent surtout dans le Territoire Militaire, à l’Est et au Nord-Est de Gao ; cependant on en rencontre aussi sur la rive droite du Niger à hauteur de Gao ainsi qu’en plusieurs points du fleuve (Kel-Oulli), autour des mares de Gossi et dans le cercle de Hombori (Kel-Gossi), au Sud de Bamba et de Bourem (Kel-Gheress), à cheval sur les cercles de Hombori et de Dori (Oudalen) et dans le cercle de Dori (Tenguéréguédech).
Quant aux sous-tribus de rattachement incertain, on les trouve dans le district de Bamba (Kel-Guerisouân, Kel-Tigouelt,[146] Imakelkellen, Ibourliten, Imetchas, Kel-Rila), dans le cercle de Hombori (Déguésellen et Chemenama) et dans le cercle de Dori (Damossân et Missiguender).
4o Peuls (y compris les Silmimossi et les Rimaïbé).
| Cercle de | Niafounké | 74.832 | (dont 14.832 animistes). |
| — | Ouagadougou | 48.753 | (tous musulmans). |
| — | Dori | 42.791 | — |
| — | Dienné | 38.944 | — |
| — | Mopti | 35.278 | — |
| — | Ouahigouya | 27.435 | (dont 10.549 animistes). |
| — | Koury | 27.179 | (tous musulmans). |
| — | Ségou | 20.968 | (dont 1.230 animistes). |
| — | Nioro | 19.753 | (tous musulmans). |
| — | Bandiagara | 15.231 | (dont 3.068 animistes). |
| — | Goumbou | 12.697 | (tous musulmans)[78]. |
| — | Fada-n-Gourma | 9.752 | — |
| Circonscription de San | 9.243 | (dont 3.800 animistes). | |
| Cercle de | Sokolo | 6.230 | (tous musulmans). |
| — | Say | 5.000 | — |
| — | Hombori | 3.937 | — |
| — | Bobo-Dioulasso | 2.130 | (dont 1.930 animistes). |
| — | Koutiala | 1.750 | (tous musulmans). |
| — | Satadougou | 1.078 | — |
| — | Bafoulabé | 1.000 | — |
| — | Bamako | 737 | (dont 237 animistes). |
| Total | 404.718 | (dont 35.646 animistes et 369.072 musulmans). | |
On voit par ce tableau que les Peuls se rencontrent dans 21 des 29 circonscriptions administratives de la colonie : seuls, les districts purement sahariens (Kiffa et les deux cercles de Tombouctou), le cercle de Kayes et quatre cercles du Sud (Kita, Bougouni, Sikasso, Gaoua) en sont totalement dépourvus. Mais on remarquera aussi que les Peuls sont surtout nombreux le[147] long de la lisière sud du Sahara, particulièrement dans la partie qui avoisine la zone des inondations (Massina) et au Sud de l’Azaouad ; ils diminuent à mesure que l’on s’avance vers le Sud de la colonie.
5o Toucouleurs.
| Cercle de | Nioro | 18.706 | (tous musulmans) |
| — | Ségou | 7.000 | — |
| — | Kayes | 5.050 | (dont 1.550 animistes). |
| — | Satadougou | 3.000 | (tous musulmans). |
| — | Bandiagara | 1.500 | — |
| — | Bafoulabé | 1.000 | — |
| — | Say | 1.000 | — |
| — | Kita | 500 | — |
| — | Mopti | 500 | — |
| Total | 38.256 | (dont 1.550 animistes et 36.706 musulmans). |
Les Toucouleurs ne sont en somme représentés dans le Haut-Sénégal-Niger que par quelques colonies peu nombreuses, dont les plus importantes — celles des cercles de Nioro et de Ségou — proviennent des immigrations qui se produisirent à l’occasion des conquêtes d’El-hadj-Omar. Le gros de la population toucouleure habite la colonie du Sénégal.
6o Songaï.
| Cercles de Tombouctou | 60.058 | ||
| Cercle de | Hombori | 12.063 | |
| — | Niafounké | 10.809 | |
| — | Say | 10.000 | |
| — | Dori | 3.029 | |
| — | Mopti | 2.317 | |
| — | Ouahigouya | 2.206 | |
| — | Bandiagara | 1.000 | |
| — | Dienné | 100 | |
| Total | 101.582 | (tous musulmans). | |
Les Songaï ne forment pas un peuple bien nombreux et les[148] territoires civils du Haut-Sénégal-Niger n’en renferment qu’une partie, le reste habitant la rive gauche du Niger de Bourem à Niamey ainsi que la région de Dosso. Ceux de la colonie civile sont répandus surtout le long des deux rives du Niger depuis Mopti jusqu’à Bamba et ensuite le long de la rive droite ; on en rencontre très peu lorsqu’on s’éloigne du fleuve ou de ses lacs et canaux. Ils disparaissent vers Mopti, lorsqu’on remonte le Niger : Dienné, qui passe bien à tort pour être une ville songaï, ne renferme que trois familles ayant des ascendants songaï, et l’immense majorité de ses habitants est d’origine soninké ; il est vrai que ces Soninké parlent aujourd’hui le songaï, mais c’est là un phénomène dû à des raisons politiques et économiques dont nous parlerons plus loin, et qui n’a rien à voir avec l’origine des Diennenké. Lors donc que l’on s’est appuyé sur les caractères physiques des gens de Dienné pour démontrer la soi-disant origine égyptienne ou libyque des Songaï[79], on a commis la même erreur de principe qu’en s’appuyant, pour prouver la même origine, sur le type architectural des maisons de Dienné, lequel type ne représente en rien l’architecture songaï et est d’ailleurs d’importation marocaine et non pas égyptienne.
7o Famille mandé (1.435.001 représentants).
| Groupe du Nord |
Groupe du Centre |
Groupe du Sud |
Totaux par cercles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle de | Bamako | 10.070 | 180.272 | » | 190.342 | ||||
| — | Bougouni | 4.645 | 148.701 | » | 153.346 | ||||
| — | Ségou | 17.680 | 109.758 | » | 127.438 | ||||
| — | Koury | 73.527 | » | 43.470 | 116.997 | ||||
| — | Sikasso | 27.302 | 59.878 | 20.705 | 107.885 | ||||
| — | Ouagadougou | 84.869 | » | » | 84.869 | ||||
| — | Nioro | 58.893 | 13.054 | » | 71.947 | ||||
| — | Bobo-Dioulasso | 40.815 | » | 27.780 | 68.595 | ||||
| — | Kayes | 24.100 | 34.897 | » | 58.997 | ||||
| — | Kita | » | 54.926 | 3.067 | 57.993 | ||||
| — | Goumbou | 25.819 | 24.442 | » | 49.261 | ||||
| — | Bafoulabé | » | 47.870 | » | 47.870 | ||||
| — | Dienné | 24.947 | 17.247 | » | 43.194 | ||||
| [149]— | Ouahigouya | 19.764 | » | 21.939 | 41.703 | ||||
| — | Koutiala | 11.380 | 30.055 | » | 41.435 | ||||
| Circonscription de San | 20.860 | 20.103 | » | 40.963 | |||||
| Cercle de | Satadougou | » | 28.000 | 6.757 | 34.757 | ||||
| — | Niafounké | 13.000 | 16.000 | » | 29.000 | ||||
| — | Sokolo | 8.250 | 19.996 | » | 28.246 | ||||
| — | Mopti | 7.930 | 7.277 | » | 15.207 | ||||
| — | Bandiagara | 2.405 | 928 | 9.823 | 13.156 | ||||
| Zone saharienne | 10.000 | » | » | 10.000 | |||||
| Cercle de Gaoua | 1.800 | » | » | 1.800 | |||||
| Totaux | 488.056 | [80] | 813.404 | [81] | 133.541 | [82] | 1.435.001 | [83] | |
A. — Groupe du Nord (488.056 représentants).
| Bozo | Soninké | Dioula | Totaux par cercles |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercles de | |||||||
| Ouagadougou | » | 425 | 84.444 | 84.869 | |||
| Koury | » | 30.000 | (dont 5.000 an.) | 43.527 | (dont 18.037 an.)[84] | 73.527 | |
| Nioro | » | 58.893 | [85] | » | 58.893 | ||
| Bobo-Dioulasso | » | 1.600 | 39.215 | (dont 34.965 an.)[86] | 40.815 | ||
| Sikasso | » | » | 27.302 | (dont 24.556 an.) | 27.302 | ||
| Dienné | 12.079 | 13.868 | [87] | » | 25.947 | ||
| Goumbou | » | 24.819 | » | 24.819 | |||
| Kayes | » | 24.100 | (dont 6.100 an.) | » | 24.100 | ||
| Circonscription de San | 312 | 16.112 | 4.436 | 20.860 | |||
| Cercles de | |||||||
| Ouahigouya | » | » | 19.764 | 19.764 | |||
| Ségou | » | 17.680 | » | 17.680 | |||
| Niafounké | » | 13.000 | » | 13.000 | |||
| Koutiala | » | 7.098 | 4.282 | (dont 1.838 an.) | 11.380 | ||
| Bamako | » | 10.070 | (dont 2.380 an.) | » | 10.070 | ||
| Zone saharienne | » | 10.000 | » | 10.000 | |||
| Cercles de | |||||||
| Sokolo | » | 8.250 | » | 8.250 | |||
| Mopti | 1.826 | 6.104 | » | 7.930 | |||
| Bougouni | » | 2.145 | (dont 1.110 an.) | 2.500 | (dont 88 an.) | 4.645 | |
| Bandiagara | 1.177 | 1.228 | (dont 324 an.) | » | 2.405 | ||
| Gaoua | » | » | 1.800 | 1.800 | |||
| Totaux | 15.394 | 245.392 | 227.270 | 488.056 | |||
| (tous musulmans) | (dont 13.814 an.) | (dont 79.484 an.) | |||||
[150]On voit par le tableau qui précède que les Bozo (15.394, tous musulmans) sont localisés dans les cercles de Dienné, Mopti et Bandiagara, avec quelques représentants à San ; que les Soninké (245.392, dont 231.578 musulmans et 13.814 animistes) sont représentés surtout dans le Sahel (cercles de Kayes, Nioro, Goumbou, Sokolo, Niafounké, Mopti, Dienné) et dans la partie de la région soudanaise qui touche au Sahel (Nord du cercle de Bamako, Nord du cercle de Ségou, circonscription de San, Nord du cercle de Koury), avec quelques colonies dans les villes sahariennes (Tichit, Taodéni, Oualata, Néma, etc.), le reste du Haut-Sénégal-Niger n’en renfermant qu’un nombre infime ; qu’enfin les Dioula (227.270 dont 147.786 musulmans et 79.484 animistes) se trouvent tous dans le Sud et le Sud-Ouest de la Boucle du Niger (cercles de Ouagadougou, de Ouahigouya, de Koury, de Bobo-Dioulasso, de Sikasso, principalement). Comme nous le verrons plus loin, presque tous les Soninké habitant la Boucle du Niger ont abandonné leur langue pour adopter le parler des Dioula.
B. — Groupe du Centre (813.404 représentants).
| Kâgoro | Banmana | Khassonkè | Malinké | Foulanké | Totaux par cercles |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle de | Bamako | 1.850 | 146.966 | » | 31.456 | » | 180.272 | |||||
| — | Bougouni | » | 104.216 | » | 3.297 | 41.188 | 148.701 | |||||
| — | Ségou | » | 109.758 | » | » | » | 109.758 | |||||
| — | Sikasso | » | 30.000 | » | » | 29.878 | 59.878 | |||||
| — | Kita | 6.368 | 2.339 | » | 26.219 | 20.000 | 54.926 | |||||
| — | Bafoulabé | » | 2.100 | » | 30.770 | 15.000 | 47.870 | |||||
| — | Kayes | » | » | 7.906 | 26.991 | » | 34.897 | |||||
| — | Koutiala | » | 30.055 | » | » | » | 30.055 | |||||
| — | Satadougou | » | » | » | 28.000 | » | 28.000 | |||||
| — | Goumbou | 2.332 | 22.110 | » | » | » | 24.442 | |||||
| Circonscription de San | » | 20.103 | » | » | » | 20.103 | ||||||
| Cercle de | Sokolo | » | 19.996 | » | » | » | 19.996 | |||||
| — | Dienné | » | 17.247 | » | » | » | 17.247 | |||||
| — | Niafounké | » | 16.000 | » | » | » | 16.000 | |||||
| — | Nioro | 414 | 9.355 | 3.285 | » | » | 13.054 | |||||
| — | Mopti | » | 7.277 | » | » | » | 7.277 | |||||
| — | Bandiagara | » | 928 | » | » | » | 928 | |||||
| Totaux | 10.964 | 538.450 | 11.191 | 146.733 | 106.066 | 813.404 | ||||||
Sur les 813.404 représentants du groupe des Mandé du Centre dans le Haut-Sénégal-Niger, on compte 767.511 animistes et seulement 45.893 musulmans, qui se répartissent en 29.639[151] Banmana (dont les Somono forment le plus grand nombre), 4.285 Khassonkè, 3.380 Malinké et 8.589 Foulanké. Les Kâgoro sont tous animistes.
Les Kâgoro ne forment que de petits groupes disséminés pour la plupart dans le Sud du Sahel occidental. Les Banmana, qui constituent l’un des peuples les plus nombreux du Haut-Sénégal-Niger et forment à eux seuls les deux tiers environ des Mandé du Centre et près de la moitié de tous les Mandé des trois groupes réunis, se présentent sous l’aspect d’une masse compacte à cheval sur le Niger (cercles de Bamako, Ségou et Bougouni) avec des colonies fort importantes dans le Sahel d’une part et à l’Est du Bani d’autre part. Les Khassonkè, fort peu nombreux, peuplent le Khasso et ses dépendances (cercle de Kayes) et une portion du Sanga (cercle de Nioro). Les Malinké sont, de tous les Mandé du Haut-Sénégal-Niger, ceux dont l’habitat est le plus compact et présente le moins de solutions de continuité ; d’une façon générale, cet habitat s’étend au Sud du Sénégal de la Falémé au Bakhoy (Bambouk et Gangaran), puis au Sud du chemin de fer du Bakhoy au Niger (Manding), enfin, à l’Est du Niger, au Sud du pays banmana (Ouassoulou oriental)[88]. Les Foulanké, au contraire, se trouvent éparpillés dans le Ganadougou (cercle de Sikasso), dans le Birgo (cercle de Kita) et dans les divers Fouladougou (cercles de Bougouni, Kita et Bafoulabé).
C. — Groupe du Sud (133.541 représentants).
| Diallonké | Samo | Samorho | Sia | Tribus diverses |
Totaux par cercles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercles de : | |||||||||||
| Koury | » | 43.470 | » | » | » | 43.470 | |||||
| Bobo-Dioulasso | » | » | 3.000 | 6.000 | 18.780 | 27.780 | |||||
| Ouahigouya | » | 21.939 | » | » | » | 21.939 | |||||
| Sikasso | » | » | 20.705 | » | » | 20.705 | |||||
| Bandiagara | » | 9.823 | » | » | » | 9.823 | |||||
| Satadougou | 6.757 | » | » | » | » | 6.757 | |||||
| Kita | 3.067 | » | » | » | » | 3.067 | |||||
| Totaux | 9.824 | 75.232 | 23.705 | 6.000 | 18.780 | 133.541 |
[152]Sur les 133.541 Mandé du Sud, on ne compte que 200 musulmans, lesquels sont des Sia de Bobo-Dioulasso. — Les 18.780 indigènes de tribus diverses se répartissent en 8.000 Sembla, 7.000 Ouara, 2.745 Natioro et 1.035 Blé, tous habitant dans le cercle de Bobo-Dioulasso. — Les Diallonké du Haut-Sénégal-Niger habitent l’extrême Sud des cercles de Satadougou et de Kita. — Les Samo sont surtout répandus dans le triangle Koury-Ouahigouya-Bandiagara. — Les Samorho habitent le Nord du cercle de Sikasso et entre cette ville et Bobo-Dioulasso.
8o Sénoufo.
| Cercle de | Bobo-Dioulasso | 132.885 | |
| — | Koutiala | 108.427 | |
| — | Sikasso | 77.184 | |
| Circonscription de San | 20.885 | ||
| Cercle de Bougouni | 4.089 | ||
| Total | 343.470 | (tous animistes). | |
Ce total se décompose comme suit entre les dix tribus sénoufo représentées dans le Haut-Sénégal-Niger :
Bamâna ou Minianka 129.312 (dont 108.427 dans le cercle de Koutiala et 20.885 dans la circonscription de San) ;
Siénérhè 81.273 (dont 77.184 dans le cercle de Sikasso et 4.089 dans le Niénédougou, cercle de Bougouni) ;
Les représentants des huit autres tribus se trouvent tous dans le cercle de Bobo-Dioulasso : Mbouin 31.875, Folo 23.790, Tourka 21.205, Karaboro 18.535, Tagba 17.170, Nanergué 11.260, Komono 5.605 et Sémou 3.445.
On remarquera que la famille sénoufo est groupée dans un territoire assez nettement délimité par le Bani puis le Bagbê à l’Ouest et le bassin supérieur de la Volta Noire à l’Est. Ce territoire se prolonge à la Côte d’Ivoire dans les bassins supérieurs du Bandama et de la Comoé.
[153]9o Famille voltaïque (2.292.088 représentants).
| Gr. Tombo |
Gr. Mossi |
Gr. Gourounsi |
Gr. Bobo |
Gr. Lobi |
Gr. Koulango |
Gr. Bariba |
Totaux par cercles |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercles de : | |||||||||||||||
| Ouagadougou | » | 1.116.504 | 205.499 | 1.612 | » | » | » | 1.323.615 | |||||||
| Fada-n-Gourma | » | 175.057 | » | » | » | » | 5.037 | 180.094 | |||||||
| Ouahigouya | 2.684 | 141.999 | 33.425 | » | » | » | » | 178.108 | |||||||
| Gaoua | » | 93.600 | » | 1.600 | 74.650 | 4.000 | » | 173.850 | |||||||
| Koury | 500 | 2.600 | 25.465 | 107.817 | » | » | » | 136.382 | |||||||
| Bandiagara | 117.744 | » | » | 1.369 | » | » | » | 119.113 | |||||||
| Bobo-Dioulasso. | » | » | » | 61.105 | » | » | » | 61.105 | |||||||
| Dori | 12.000 | 40.180 | » | » | » | » | » | 52.180 | |||||||
| Circonscription de San | 1.587 | » | » | 37.992 | » | » | » | 39.579 | |||||||
| Cercles de : | |||||||||||||||
| Koutiala | » | » | » | 10.745 | » | » | » | 10.745 | |||||||
| Say | » | 9.000 | » | » | » | » | » | 9.000 | |||||||
| Mopti | 2.020 | » | » | 4.678 | » | » | » | 6.698 | |||||||
| Hombori | 1.000 | » | » | » | » | » | » | 1.000 | |||||||
| Dienné | » | » | » | 619 | » | » | » | 619 | |||||||
| Totaux | 137.535 | 1.578.940 | 264.389 | 227.537 | 74.650 | 4.000 | 5.037 | 2.292.088 |
Le groupe mossi compte 25.209 musulmans (24.209 Mossi et 1.000 Dagari) et le groupe lobi en compte 1.000 (des Dian) ; les autres groupes sont entièrement animistes : soit 26.209 musulmans seulement pour toute la famille voltaïque, contre 2.265.879 animistes.
Le tableau qui précède montre que la famille voltaïque est nettement groupée sur le bassin de la Volta et les hauteurs qui le circonscrivent ; son territoire n’est occupé que par elle seule, à l’exception d’un certain nombre de Peuls disséminés çà et là et de colonies principalement urbaines peuplées de Mandé du Nord (Soninké et Dioula). Ce territoire s’étend au Sud sur une notable partie de la Côte d’Ivoire, de la Gold Coast, du Togo et du Dahomey.
A. — Groupe tombo (137.535 représentants).
| Tombo | Dogom | Déforo | Totaux par cercles |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle de | Bandiagara | 115.208 | 2.536 | » | 117.744 | |||
| — | Dori | » | » | 12.000 | 12.000 | |||
| — | Ouahigouya | » | 2.684 | » | 2.684 | |||
| — | Mopti | 2.020 | » | » | 2.020 | |||
| [154]Circonscription de San | 1.587 | » | » | 1.587 | ||||
| Cercle de | Hombori | 500 | 500 | » | 1.000 | |||
| — | Koury | 500 | » | » | 500 | |||
| Totaux | 119.815 | 5.720 | 12.000 | 137.535 | ||||
| (tous animistes.) | ||||||||
Les Tombo habitent de préférence les sommets ou les flancs des falaises dites de Bandiagara, de Douentza, de Hombori, etc. Les Dogom se rencontrent à peu près dans les mêmes régions, mais ils vivent plutôt dans la plaine ou sur la lisière des montagnes. Quant aux Déforo, ils sont répandus surtout dans la région d’Aribinda (entre Djibo et Dori).
B. — Groupe mossi (1.578.940 représentants).
| Mossi | Yansi | Nankana | Gourmantché | Dagari | Birifo | Totaux par cercle |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercles de : | ||||||||||||||
| Ouagadougou | 1.076.434 | [89] | 13.214 | 19.836 | » | 7.020 | [90] | » | 1.116.504 | |||||
| Fada-n-Gourma | 21.014 | 25.493 | » | 128.550 | » | » | 175.057 | |||||||
| Ouahigouya | 141.999 | [91] | » | » | » | » | » | 141.999 | ||||||
| Gaoua | » | » | » | » | 53.239 | [92] | 40.361 | 93.600 | ||||||
| Dori | 20.180 | 10.000 | » | 10.000 | » | » | 40.180 | |||||||
| Say | » | » | » | 9.000 | » | » | 9.000 | |||||||
| Koury | 2.600 | [93] | » | » | » | » | » | 2.600 | ||||||
| Totaux | 1.262.227 | [94] | 48.707 | 19.836 | 147.550 | 60.259 | [95] | 40.361 | 1.578.940 | [96] |
Les Mossi habitent principalement les provinces du Yatenga (cercle de Ouahigouya), celles de Yâko, Boussouma, Béloussa, Koupéla, Ouagadougou, etc. (cercle de Ouagadougou), et poussent des pointes à l’Ouest vers Koury, au Nord-Est vers Djibo et Dori et à l’Est vers le Nord du cercle de Fada-n-Gourma. Les Yansi se rencontrent surtout au Nord-Est du territoire des[155] Mossi. Les Nankana vivent près de la Volta Rouge, à cheval sur la frontière franco-anglaise. Les Gourmantché remplissent la plus grande partie du cercle de Fada-n-Gourma, ainsi que l’extrême Sud du cercle de Dori et la pointe du cercle de Say s’avançant entre les deux cercles précités. Les Dagari et les Birifo sont, à l’exception d’une fraction dagari située au Nord de la frontière anglaise entre la Volta Noire et Léo, localisés dans le cercle de Gaoua, surtout le long de la Volta, bien que les Birifo s’avancent un peu plus loin du fleuve vers l’Ouest que les Dagari.
C. — Groupe gourounsi (264.389 représentants).
| Nioniossé | Nounouma | Sissala | Boussansé | Totaux par cercles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercles de : | ||||||||||
| Ouagadougou | 34.626 | 58.277 | 7.283 | 105.313 | 205.499 | |||||
| Ouahigouya | 33.425 | » | » | » | 33.425 | |||||
| Koury | 10.335 | 15.130 | » | » | 25.465 | |||||
| Totaux | 78.386 | 73.407 | 7.283 | 105.313 | 264.389 | [97] |
Les Nioniossé se rencontrent, à côté ou au milieu des Mossi, dans les régions du Yatenga, de Yâko et de Ouagadougou, et en groupes plus compacts dans le Kipirsi (triangle Koury-Boromo-Yâko). Les Nounouma habitent à l’Ouest de la Volta Noire à hauteur de Boromo (au Nord des Oulé) et à l’Est du même fleuve au Sud des Nionossé et au Nord des Dagari propres. Les Sissala vivent à l’Est des Nounouma et à l’Ouest des Nankana, le point de jonction des Nounouma et des Sissala coïncidant avec la ville de Léo. Les Boussansé se trouvent entre la Volta Blanche et le cercle de Fada-n-Gourma, à partir de Tenkodogo en allant vers le Sud.
D. — Groupe ou peuple bobo (227.537 représentants).
| Kian | Tara | Boua | Niénigué | Totaux par cercles |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle de Koury | » | 96.227 | 11.590 | » | 107.817 | ||||||
| Cercle de Bobo-Dioulasso | » | » | 39.500 | 21.605 | 61.105 | ||||||
| Circonscription de San | 30.000 | 6.530 | 1.462 | » | 37.992 | ||||||
| Cercle de | Koutiala | » | » | 10.745 | » | 10.745 | |||||
| — | Mopti | 4.678 | » | » | » | 4.678 | |||||
| — | Ouagadougou | » | » | » | 1.612 | 1.612 | |||||
| — | Gaoua | » | » | » | 1.600 | 1.600 | |||||
| — | Bandiagara | 1.369 | » | » | » | 1.369 | |||||
| — | Dienné | 619 | » | » | » | 619 | |||||
| Totaux | 36.666 | 102.757 | 63.297 | 24.817 | 227.537 | [98] | |||||
[156]Les Kian sont les plus occidentaux des Bobo et se trouvent répandus non loin de la rive droite du Bani, entre Mopti et San, mais sont surtout nombreux aux environs de cette dernière ville. Les Tara leur font suite vers l’Est, entre San et Koury. Les Boua habitent au Sud des Kian et des Tara. Les Niénigué se rencontrent à l’Est des Boua, entre ceux-ci d’une part et les Dagari-Oulé et Nounouma d’autre part.
E. — Groube lobi (74.650 représentants).
Ce groupe est localisé dans le cercle de Gaoua, au moins en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger, car il a quelques représentants à la Côte d’Ivoire (district de Bouna). Il comprend, dans le Haut-Sénégal-Niger : 62.050 Lobi proprement dits, habitant surtout la région de Gaoua et l’Ouest de ce poste ; 5.950 Dian, formant la majeure partie de la population de Diébougou et de ses environs ; 5.550 Pougouli, répandus principalement le long du Pougouliba ou Bougouriba — qui leur doit son nom — en amont de Diébougou ; enfin 1.100 Gan, vivant à Lorhosso dans le Sud-Ouest du cercle.
Tous sont animistes, à l’exception de 1.000 Dian musulmans de la ville de Diébougou.
F. — Groupe koulango (4.000 représentants).
Ce groupe, assez nombreux à la Côte d’Ivoire, ne renferme au Haut-Sénégal-Niger que 4.000 individus de la tribu des Lorho, tous animistes, habitant à côté des Gan dans la région de Lorhosso, à laquelle ils ont autrefois donné leur nom (cercle de Gaoua)[99].
G. — Groupe bariba (5.037 représentants).
Ce groupe, fort important au Dahomey, n’est représenté dans le Haut-Sénégal-Niger que par 4.497 Bariba proprement dits et 540 Soumba de la tribu des Takamba, tous animistes, et habitant le Sud du cercle de Fada-n-Gourma, dans l’Atakora.
10o Tribus de classification douteuse (19.035 représentants).
[157]Ces tribus, qui, sans doute, se rattachent soit à la famille sénoufo soit à la famille voltaïque, forment un total de 19.035 indigènes, tous animistes, dont 500 appartiennent au cercle de Gaoua (Padorho) et 18.535 au cercle de Bobo-Dioulasso (à savoir 10.045 Toussia, 3.700 Dorhossié, 2.790 Vigué et 2.000 Tiéfo).
11o Etrangers divers (4.096 représentants).
Les principales colonies étrangères sont composées de Ouolofs (3.205, tous musulmans sauf quelques chrétiens, dont 1.116 dans le cercle de Kayes, 1.054 dans le cercle de Nioro, 500 dans le cercle de Bamako, 433 dans le cercle de Sikasso et 102 à Tombouctou). On compte aussi 802 étrangers non-musulmans d’origines diverses (445 à Kayes et 357 à Bamako) et 89 Haoussa musulmans dans le cercle de Ouagadougou ; en réalité le nombre des Haoussa établis dans les territoires civils du Haut-Sénégal-Niger et particulièrement dans le Mossi et l’Est de la Boucle du Niger est certainement plus considérable, mais la plupart ont été englobés, lors des recensements, avec les Soninké ou les Dioula, à cause de la similitude de leurs occupations et de leur religion.
Composition de la population de chacune des circonscriptions administratives.
1o Zone saharienne.
| Maures de l’Azaouad | 26.000 | familles sémitique et hamitique : 74.000 | |
| — du Hodh | 40.000 | ||
| Touareg | 8.000 | ||
| Soninké | 10.000 | (famille mandé) | |
| Total | 84.000 | (environ), tous musulmans. |
Les Maures de l’Azaouad de la zone saharienne sont les Bérabich et les Kounta des régions de Taodéni, Araouân et Mabrouk ; les Maures du Hodh de la même zone sont ceux qui sont répandus au Nord de la région d’administration directe de la résidence de Kiffa et des cercles de Nioro, Goumbou et Sokolo (Regueïbât, Idao-Aïch, Ahl-Tichit, Oulad-Mbarek, Oulad-Nasser, Mejdouf, Oulad-Delim) ; les Touareg appartiennent aux quelques fractions (Imededrhen et Idnân principalement) répandues dans les environs de l’Adrar Timetrhine ; les Soninké sont les Azer de Tichit, Oualata, Néma, Araouân, Taodéni, etc.
[158]2o Résidence de Kiffa.
Maures du Hodh : 20.000 (familles sémitique et hamitique, tous musulmans).
3o Cercle de Nioro.
| Maures du Hodh | 1.776 | familles sémitique et hamitique : 21.529 (tous musulmans). | |
| Peuls | 19.753 | ||
| Toucouleurs | 18.706 | (famille tekrourienne, tous musulmans). | |
| Soninké | 58.893 | famille mandé : 71.947 (dont 4.031 animistes). | |
| Kâgoro | 414 | ||
| Banmana | 9.355 | ||
| Khassonkè | 3.285 | ||
| Etrangers | 1.054 | (Ouolofs, tous musulmans). | |
| Total | 113.236 | (dont 4.031 animistes : 414 Kâgoro et 3.617 Banmana). |
Les Maures se rencontrent dans le Kingui et le Bakounou-Sud. — Les Peuls sont surtout nombreux dans le Kingui, le Sanga ou Lankamané, le Digna ou Ouossébougou. — Les Toucouleurs habitent dans le Kéniarémé et le Kingui. — Les Soninké sont répandus dans le Diafounou, le Kéniarémé, le Guidioumé, une partie du Kingui, du Sanga, du Diangounté, du Dianghirté ou Komintara, du Bakounou-Sud et du Digna. — Les Kâgoro se trouvent dans le Kingui, le Sanga, le Diangounté, le Digna. — Les Banmana habitent dans le Kingui, le Diangounté, le Dianghirté et le Digna. — Les Khassonkè sont à peu près localisés au Sanga.
4o Cercle de Goumbou.
| Maures du Hodh | 4.557 | familles sémitique et hamitique : 17.254 (tous musulmans)[100]. | |
| Peuls | 12.697 | ||
| Soninké | 24.819 | famille mandé : 49.261 (dont 24.442 animistes). | |
| Kâgoro | 2.332 | ||
| Banmana | 22.110 | ||
| Total | 66.515 | (dont 2.332 Kâgoro et 22.110 Banmana animistes). |
[159]Les Maures sont répandus dans le Bakounou-Nord, le Kolon, le Ouagadou, le Kaniaga (Ouaharo) et le Niamala (Mourdia) ; les Peuls dans le Kolon et le Kaniaga (Damfa) ; les Soninké dans le Bakounou-Nord, le Kolon, le Ouagadou, le Niamala et le Kaniaga (Damfa) ; les Kâgoro dans le Bakounou et le Kaniaga ; les Banmana dans le Kolon, le Niamala et le Kaniaga.
5o Cercle de Sokolo.
| Maures du Hodh | 1.830 | familles sémitique et hamitique : 8.060 (tous musulmans). | |
| Peuls | 6.230 | ||
| Soninké | 8.250 | famille mandé : 28.246 (dont 19.996 animistes) | |
| Banmana | 19.996 | ||
| Total | 36.306 | (dont 19.996 Banmana animistes). |
Les Maures se rencontrent dans les cantons d’Akor, Sokolo, Nampala, Néré ; les Peuls dans ceux d’Akor, Sokolo, Nampala et Dia ; les Soninké dans ceux d’Akor, Sokolo et Dia ; les Banmana dans ceux de Ségala, Sokolo et Monempé.
6o Cercle de Niafounké.
| Maures de l’Azaouad | 300 | familles sémitique et hamitique : 76.132 (dont 14.832 Peuls animistes). | |
| Touareg | 1.000 | ||
| Peuls | 74.832 | ||
| Songaï | 10.809 | (famille songaï, tous musulm.) | |
| Soninké | 13.000 | famille mandé : 29.000 (dont 8.000 Banmana animistes). | |
| Banmana | 16.000 | ||
| Total | 115.941 | (dont 22.832 animistes). |
Les Maures se rencontrent entre Soumpi et le lac Horo ; les Touareg entre le lac Horo et le lac Nangaï ; les Peuls dans le Farimaké, la région de Soumpi, le Guimbala ou Djimbala et le Fitouka ; les Songaï dans le Dirma (Tendirma à Saraféré), le Fitouka, le Bara et le Guimbala, les Sorko étant disséminés partout où il y a de l’eau à partir du lac Débo en allant vers le Nord. Les Soninké sont répandus sur les deux rives de l’Issa-Ber, ainsi que les Banmana, qu’on rencontre aussi dans le Farimaké.
[160]7o et 8o Cercles de Tombouctou.
| Maures de l’Azaouad | 5.715 | familles sémitique et hamitique : 33.734 | |
| Touareg | 28.019 | ||
| Songaï | 60.058 | (famille songaï). | |
| Etrangers | 102 | ||
| Total | 93.894 | (tous musulmans). |
Sur ce total, on compte 19.612 indigènes pour l’ancien secteur de Goundam et 22.051 pour l’ancien cercle de Bamba.
Les Touareg sont : dans le district de Goundam, des Imededrhen, des Kel-Nkounder, des Kel-Ncheria, des Tagama, des Chorfiga ; dans le district de Ras-el-Ma, des Kel-Antassar et des Zimmaten ; dans le district de Tombouctou, des Tenguéréguif, des Kel-Temoulaï, des Igouadaren, des Irréganaten, des Kel-Nkounder, des Kel-Ncheria, des Imededrhen, des Ahl-sidi-Ali ; dans le district de Bamba, des Kel-Antassar, des Kel-Oulli, des Idnân, des Kel-Guerisouân, des Kel-Tigouelt, des Imakelkellen, des Iguellad, des Igouadaren, des Imededrhen, des Kel-es-souk, des Kel-Gossi, des Chorfiga, des Ibourliten, des Imetchas, des Kel-Rila, des Kel-Gheress.
Les Songaï sont concentrés près du fleuve et des lacs.
9o Cercle de Hombori.
| Touareg | 8.000 | familles hamitique et sémitique : 11.937 (tous musulmans). | |
| Peuls | 3.937 | ||
| Songaï | 12.063 | (famille songaï, tous musulmans). | |
| Tombo | 500 | famille voltaïque (groupe tombo) : 1.000 (tous animistes). | |
| Dogom | 500 | ||
| Total | 25.000 | (dont 1.000 Tombo et Dogom animistes). |
Les Touareg du Cercle sont surtout des Kel-es-Souk, des Kel-Gossi, des Déguisellen, des Kel-Gheress, des Chorfiga, des Chemenama, des Imededrhen, des Irréganaten et des Oudalen. Les Peuls sont surtout nombreux dans l’Ouest du Cercle, au pied des falaises de Hombori. Les Songaï sont surtout riverains du Niger. Les Tombo habitent la falaise et les Dogom le pied de la falaise de Hombori.
| Delafosse | Planche VI |

Cliché Froment
Fig. 11. — Le Niger près de Ségou.

Cliché Froment
Fig. 12. — Sur le Niger, à hauteur de Tillabéry.
[161]10o Cercle de Dori.
| Touareg | 12.000 | familles hamitique et sémitique : 54.791 (tous musulmans). | |
| Peuls | 42.791 | ||
| Songaï | 3.029 | (famille songaï, tous musulmans). | |
| Déforo | 12.000 | famille voltaïque : 52.180 (tous animistes) (dont 12.000 (Déforo) du groupe tombo et 40.180 (Mossi, Yansi et Gourmantché) du groupe mossi). | |
| Mossi | 20.180 | ||
| Yansi | 10.000 | ||
| Gourmantché | 10.000 | ||
| Total | 110.000 | (dont 57.820 musulmans). |
Les Touareg du Cercle sont surtout des Oudalen, des Damossân, des Missiguender et des Tenguéréguédech. Les Peuls sont répandus surtout dans les régions de Djibo et de Dori, les Songaï près du Niger, les Déforo dans la province d’Aribinda (entre Djibo et Dori), les Mossi dans le Sud-Ouest du cercle, les Yansi et les Gourmantché dans le Sud.
11o Cercle de Bandiagara.
| Peuls | 15.231 | (dont 3.068 animistes). | |
| Toucouleurs | 1.500 | (tous musulmans). | |
| Songaï | 1.000 | — | |
| Bozo | 1.177 | famille mandé : 13.156 (dont 11.075 animistes : 324 Soninké, 928 Banmana et 9.823 Samo). | |
| Soninké | 1.228 | ||
| Banmana | 928 | ||
| Samo | 9.823 | ||
| Tombo | 115.208 | famille voltaïque : 119.113 (tous animistes) (dont 117.744 (Tombo et Dogom) du groupe tombo et 1.369 (Kian) du groupe bobo). | |
| Dogom | 2.536 | ||
| Kian | 1.369 | ||
| Total | 150.000 | (dont 17.744 musulmans). |
Les Peuls sont dispersés un peu partout, surtout dans l’Est du cercle ; les Toucouleurs se trouvent à Bandiagara et aux environs ; les Songaï dans la région des lacs ; les Bozo dans l’Ouest du cercle ; les Soninké et les Banmana dans le Sud ; les Samo près du haut Sourou (région de Louta) ; les Tombo dans toute la région montagneuse (Sangha, Bankassi, Bandiagara,[162] Douentza, etc.) ; les Dogom dans la plaine à l’Est des falaises ; les Kian ou Bobo-Gbê dans le Sud du Cercle.
12o Cercle de Mopti.
| Peuls | 35.278 | (tous musulmans). | |
| Toucouleurs | 500 | — | |
| Songaï | 2.317 | — | |
| Bozo | 1.826 | famille mandé : 15.207 (dont 4.529 Banmana animistes) | |
| Soninké | 6.104 | ||
| Banmana | 7.277 | ||
| Tombo | 2.020 | famille voltaïque : 6.698 (tous animistes). | |
| Kian (Bobo-Gbê) | 4.678 | ||
| Total | 60.000 | (dont 48.773 musulmans). |
Les Peuls se rencontrent un peu partout, surtout dans le Kounari et le Pignari ; les Songaï (Sorko surtout) le long du Bani en aval de Mopti ; les Bozo à Mopti et en amont ; les Soninké à Mopti et dans le district de Sofara ; les Banmana surtout dans le sud du cercle ; les Tombo dans l’Est et les Kian dans le Sud-Est.
13o Cercle de Dienné.
| Peuls | 38.944 | (tous musulmans). | |
| Songaï | 100 | — | |
| Bozo | 12.079 | famille mandé : 43.194 (dont 12.220 Banmana animistes). | |
| Soninké | 13.868 | ||
| Banmana | 17.247 | ||
| Kian | 619 | (famille voltaïque, groupe bobo, tous animistes). | |
| Total | 82.857 | (dont 70.018 musulmans). |
Les Peuls habitent la partie du cercle qui forme le Massina proprement dit (contrée à l’Ouest du marigot de Diaka et pays compris entre ce marigot et le Niger), ainsi que le Diennéri et le Sébéra. Les Songaï ne comprennent guère que quelques familles sorko de la pointe Sud du lac Débo. Les Bozo sont répandus le long du Niger, du Bani et du marigot de Diaka. Les Soninké peuplent le Sébéra, le Diennéri (pays de Dienné) et le Pondori. Les Banmana sont surtout nombreux entre le Niger et le[163] Bani (Kaladougou, Say, Saro, Séladougou). On trouve des Bobo-Gbê dans le Sud-Est du Séladougou.
14o Cercle de Ségou.
| Peuls | 20.968 | (dont 1.230 animistes). | |
| Toucouleurs | 7.000 | (tous musulmans). | |
| Soninké | 17.680 | famille mandé : 127.438 (dont 104.500 Banmana animistes). | |
| Banmana | 109.758 | ||
| Total | 155.406 | (dont 49.636 musulmans). |
Les Peuls sont répandus surtout au Nord et au Nord-Ouest de Sansanding et entre le Niger et le Bani ; les Toucouleurs se rencontrent principalement à Ségou et aux environs ; les Soninké à Sansanding, à Ségou et le long du Niger. Les Banmana peuplent l’immense majorité des cantons du cercle.
15o Cercle de Bamako.
| Peuls | 737 | (dont 237 animistes). | |
| Soninké | 10.070 | famille mandé : 190.342 (dont 180.757 animistes, comprenant 2.380 Soninké, 1.850 Kâgoro, 145.621 Banmana et 30.906 Malinké). | |
| Kâgoro | 1.850 | ||
| Banmana | 146.966 | ||
| Malinké | 31.456 | ||
| Etrangers | 857 | (dont 357 animistes). | |
| Total | 191.936 | (dont 10.585 musulmans). |
Les Peuls sont bergers au service des Banmana ; les Soninké habitent surtout les cinq villes de Banamba, Touba, Kiba, Kérouané et Niamina ; les Kâgoro se rencontrent dans le Nord-Ouest du cercle ; les Banmana peuplent le Fadougou, le Bélédougou, le Messékélé, le Méguétana, le Djitoumou, etc. ; les Malinké les cantons du Manding sur la rive gauche du Niger et le canton de Samaya sur la rive droite.
16o Cercle de Kita.
| Toucouleurs | 500 | (tous musulmans). | |
| Kâgoro | 6.368 | famille mandé : 57.993 (tous animistes sauf 130 malinké musulmans). | |
| Banmana | 2.339 | ||
| Malinké | 26.219 | ||
| Foulanké | 20.000 | ||
| Diallonké | 3.067 | ||
| Total | 58.493 | (dont 630 musulmans). |
[164]Les Toucouleurs sont fixés à Kita et aux environs ; les Kâgoro et les Banmana se rencontrent au Kaarta ; les Malinké habitent la région de Kita et les pays entre le Bakhoy et le Bafing (Gangaran, Baniakadougou, Gadougou) ; les Foulanké peuplent les deux Fouladougou de la boucle du Baoulé (Saboula et Arbala) et le Birgo (Mourgoula) ; les Diallonké se trouvent dans le Sud du cercle (Kolou, Boké, Kankoumakania).
17o Cercle de Bafoulabé.
| Peuls | 1.000 | (tous musulmans). | |
| Toucouleurs | 1.000 | — | |
| Soninké | 9.700 | famille mandé : 57.570 (tous animistes sauf les 9.700 Soninké). | |
| Banmana | 2.100 | ||
| Malinké | 30.770 | ||
| Foulanké | 15.000 | ||
| Total | 59.570 | (dont 11.700 musulmans). |
Les Peuls et Soninké sont surtout répandus dans l’extrême Nord du cercle ; les Toucouleurs et les Banmana ne forment que de petites colonies dispersées ; les Malinké habitent surtout le Bambougou ou Bambouk (Ouest du Bafing, y compris Koundian), le Gangaran (entre le Sénégal et le Bafing) et le Kontella (rive Nord du Sénégal) ; les Foulanké peuplent le Fouladougou, au Nord du Kontella.
18o Cercle de Kayes.
| Maures du Hodh | 4.260 | (tous musulmans). | |
| Toucouleurs | 5.050 | (dont 1.550 animistes). | |
| Soninké | 24.100 | famille mandé : 58.997 (dont 39.997 animistes, comprenant 6.100 Soninké, 6.906 Khassonkè et 26.491 Malinké). | |
| Khassonkè | 7.906 | ||
| Malinké | 26.991 | ||
| Etrangers | 1.561 | (dont 1.116 Ouolofs musulmans et 445 non-musulmans). | |
| Total | 69.868 | (dont 27.876 musulmans). |
Les Maures se trouvent dans le Guidimakha, le Séro et le Nord du Cercle (Ahl-sidi-Mahmoud et Askeur). Les Toucouleurs se[165] rencontrent dans le Diomboko, le Khasso et le Séro ; les Soninké habitent le Kaméra ou province orientale du Gadiaga ou Galam (rive Sud du Sénégal), le Guidimakha (au Nord du Sénégal) et une partie du Bambouk ; les Khassonkè peuplent le Logo, le Natiaga et une partie du Khasso et du Diomboko ; les Malinké se trouvent dans le Bambouk (Tambaoura, Niagala et Kamana) ; les étrangers sont établis à Kayes et à Médine.
19o Cercle de Satadougou.
| Peuls | 1.078 | (tous musulmans). | |
| Toucouleurs | 3.000 | — | |
| Malinké | 28.000 | famille mandé : 34.757 (tous animistes, sauf 2.000 Malinké musulmans). | |
| Diallonké | 6.757 | ||
| Total | 38.835 | (dont 6.078 musulmans). |
Les Peuls sont répandus un peu partout. Les Toucouleurs sont surtout nombreux dans la province de Satadougou. Les Malinké habitent la majeure partie de cette province, le Konkodougou, le Sintédougou et une partie du Mérétembaya. Les Diallonké peuplent le reste de ce dernier canton et le Fontofa.
20o Cercle de Bougouni.
| Soninké | 2.145 | famille mandé : 153.346 (dont 13.710 musulmans seulement, à savoir 1.035 Soninké, 2.412 Dioula, 1.474 Banmana, 200 Malinké et 8.589 Foulanké). | |
| Dioula | 2.500 | ||
| Banmana | 104.216 | ||
| Malinké | 3.297 | ||
| Foulanké | 41.188 | ||
| Sénoufo | 4.089 | (tous animistes). | |
| Total | 157.435 | (dont 13.710 musulmans). |
Les Soninké et les Dioula forment des colonies éparses. Les Banmana occupent la majeure partie du cercle. Les Malinké habitent les cantons du Baya et du Siankadougou ; les Foulanké ceux du Gouanan, du Gouandiaka, etc. (Fouladougou). Enfin les Sénoufo (sous-tribu des Niéné) se rencontrent dans le Niénédougou.
[166]21o Cercle de Sikasso.
| Dioula | 27.302 | famille mandé : 107.885 (tous animistes sauf 2.746 Dioula musulmans). | |
| Banmana | 30.000 | ||
| Foulanké | 29.878 | ||
| Samorho | 20.705 | ||
| Sénoufo | 77.184 | (tribu des Siénérhè, tous animistes). | |
| Etrangers | 433 | (Ouolofs, tous musulmans). | |
| Total | 185.502 | (dont 3.179 musulmans). |
Les Dioula occupent l’Est du Cercle (Sonondougou, Bougoula et Kaboïla) et forment une bonne partie de la population de la ville de Sikasso. Les Banmana se rencontrent surtout dans le Nord (Dolindougou, Diédougou, Ntolondougou, Ganadougou-Nord). Les Foulanké du cercle, appelés souvent Gana, habitent les deux Ganadougou (Nord et Sud). Les Samorho se trouvent dans les cantons de Bougoula, Kaboïla et Fourou. Les Sénoufo peuplent le Centre et le Sud du cercle (Kapolondougou, Fama, Sonondougou, Natiè, Bougoula, Kaboïla, Fourou, Nienguélédougou, Molasso, Kouoro et Sikasso).
22o Cercle de Koutiala.
| Peuls | 1.750 | (tous musulmans). | |
| Soninké | 7.098 | famille mandé : 41.435 (dont 9.631 musulmans, à savoir les 7.098 Soninké, 2.444 Dioula et 89 Banmana). | |
| Dioula | 4.282 | ||
| Banmana | 30.055 | ||
| Sénoufo | 108.427 | (tribu des Bamâna ou Minianka, tous animistes). | |
| Boua | 10.745 | (famille voltaïque, groupe bobo ; tous animistes). | |
| Total | 162.357 | (dont 11.381 musulmans). |
Les Peuls sont disséminés dans le Nord du Cercle. Les Soninké habitent surtout dans le Nord-Est, les Dioula dans le Sud. Les Banmana se rencontrent principalement sur la rive droite du Bani, dans le Nord-Ouest du cercle (Dionkadougou, Fadougou, Sadougou). Les Sénoufo occupent le centre et le Sud. On trouve les Boua ou Bobo-Fing dans l’Est.
[167]23o Circonscription de San.
| Peuls | 9.243 | (dont 3.800 animistes). | |
| Bozo | 312 | famille mandé : 40.963 (dont 20.103 Banmana animistes). | |
| Soninké | 16.112 | ||
| Dioula | 4.436 | ||
| Banmana | 20.103 | ||
| Sénoufo | 20.885 | (tribu des Bamâna ou Minianka, tous animistes). | |
| Tombo | 1.587 | famille voltaïque : 39.579, tous animistes (dont 1.587 du groupe tombo et 37.992 du groupe bobo). | |
| Kian (Bobo-Gbê) | 30.000 | ||
| Tara (Bobo-Oulé) | 6.530 | ||
| Boua (Bobo-Fing) | 1.462 | ||
| Total | 110.670 | (dont 26.303 musulmans). |
Les Peuls sont éparpillés un peu partout ; les Bozo se trouvent près du Bani ; les Soninké et les Dioula sont surtout nombreux à San et dans la province de San ; les Banmana occupent principalement le Bendougou ; les Sénoufo se rencontrent dans le Sud de la circonscription, les Tombo dans le Nord-Est, les Bobo dans la direction de San à Koury et dans le Sud-Est de la circonscription.
24o Cercle de Koury.
| Peuls | 27.179 | (tous musulmans). | |
| Soninké | 30.000 | famille mandé : 116.997 (dont 66.507 animistes, savoir 5.000 Soninké, 18.037 Dioula et les 43.470 Samo). | |
| Dioula | 43.527 | ||
| Samo | 43.470 | ||
| Tombo | 500 | famille voltaïque : 136.382, tous animistes sauf les 2.600 mossi (dont 500 du groupe tombo, 2.600 du groupe mossi, 25.465 du groupe gourounsi (Nioniossé et Nounouma) et 107.817 du groupe bobo (Tara et Boua). | |
| Mossi | 2.600 | ||
| Nioniossé | 10.335 | ||
| Nounouma | 15.130 | ||
| Tara (Bobo-Oulé) | 96.277 | ||
| Boua (Bobo-Fing) | 11.590 | ||
| Total | 280.558 | (dont 80.269 musulmans). |
[168]Les Peuls sont dispersés dans toute l’étendue du cercle (Barani, Dokuy, Koury, Tissé, Boromo, Tchériba, Safané). Les Soninké habitent surtout le Kombori et le Dafina (cantons de Koury, Safané, Tounou, Ouahabou), ainsi que les Dioula ; les Samo se rencontrent entre Koury et Ouahigouya. Les Tombo sont localisés dans le Kombori, les Mossi du côté de Yaba. Les Nioniossé sont surtout nombreux dans le canton d’Ouri ; les Nounouma dans les cantons de Boromo, Tissé et Tchériba ; les Bobo-Oulé dans l’Ouest du cercle (Barani, Dokuy, etc.) et les Bobo-Fing dans les cantons de Ouarkoy, Ouakara et Ouahabou. Les Dafing sont répartis entre Soninké et Dioula ; parmi ces derniers sont compris les Boron.
25o Cercle de Ouahigouya.
| Peuls | 27.435 | (dont 10.549 animistes). | |
| Songaï | 2.206 | (tous musulmans). | |
| Dioula | 19.764 | famille mandé : 41.703 (dont 21.939 Samo animistes). | |
| Samo | 21.939 | ||
| Dogom | 2.684 | famille voltaïque : 178.108 (tous animistes sauf 552 mossi musulmans) ; détail : 2.684 du groupe tombo (Dogom), 141.999 du groupe mossi et 33.425 du groupe gourounsi (Nioniossé). | |
| Mossi | 141.999 | ||
| Nioniossé | 33.425 | ||
| Total | 249.452 | (dont 39.408 musulmans). |
Les Peuls sont répandus surtout dans le Nord du cercle (région de Bané) et dans le Nord-Est, les Silmimossi se trouvant mêlés aux Mossi. Les Songaï sont fixés en quelques points du Yatenga et les Dioula surtout en pays samo, c’est-à-dire dans le Sud-Ouest du Yatenga. Les Dogom se rencontrent dans le Nord du cercle, les Mossi dans tout le Yatenga, les Nioniossé dans la majeure partie du Yatenga au milieu des Mossi.
[169]26o Cercle de Ouagadougou.
| Peuls | 48.753 | (tous musulmans). | |||
| Soninké | 425 | famille mandé : 84.869 (tous musulmans). | |||
| Dioula | 84.444 | ||||
| Mossi | 1.076.434 | groupe mossi : 1.116.504 (tous animistes, sauf 21.057 Mossi et 1.000 Dagari) | famille voltaïque : 1.323.615 | ||
| Yansi | 13.214 | ||||
| Nankana | 19.836 | ||||
| Dagari | 7.020 | ||||
| Nioniossé | 34.626 | groupe gourounsi : 205.499 (tous animistes) | |||
| Nounouma | 58.277 | ||||
| Sissala | 7.283 | ||||
| Boussansé | 105.313 | ||||
| Niénigué | 1.612 | (gr. bobo, tous animistes) | |||
| Etrangers | 89 | (Haoussa, tous musulmans). | |||
| Total | 1.457.326 | (dont 155.768 musulmans). | |||
Les Peuls et les Dioula sont répandus à peu près sur toute l’étendue du cercle. Les Mossi peuplent le Nord, le Centre et l’Est (Yâko, Baloum, Lallé, Ouagadougou, Mani, Boussouma, Béloussa, Koupéla, etc.) ; les Yansi sont répandus surtout dans le Nord-Est (Ponsa, Béloussa), les Nankana près de la Volta Rouge le long de la frontière anglaise, les Dagari près de la jonction de la Volta Noire avec cette frontière, les Nioniossé dans le Kipirsi, les Nounouma entre la Volta Noire et Léo, les Sissala entre Léo et les Nankana, les Boussansé au Sud de Tenkodogo (Bitou), les Niénigué près de la Volta Noire.
27o Cercle de Fada-n-Gourma.
| Peuls | 9.752 | (tous musulmans). | |||
| Mossi | 21.014 | groupe mossi : 175.057 | famille voltaïque : 180.094 (tous animistes) | ||
| Yansi | 25.493 | ||||
| Gourmantché | 128.550 | ||||
| Bariba | 4.497 | groupe bariba : 5.037 | |||
| Soumba | 540 | ||||
| Total | 189.846 | (dont 9.752 musulmans). | |||
[170]Les Peuls sont surtout nombreux dans le Nord du Cercle, les Mossi dans l’Ouest, les Yansi dans le Nord-Ouest ; les Gourmantché en habitent la majeure partie ; les Bariba et les Soumba (tribu des Takamba) se rencontrent dans la région montagneuse du Sud (Atakora).
28o Cercle de Say.
| Peuls | 5.000 | (tous musulmans). |
| Toucouleurs | 1.000 | — |
| Songaï | 10.000 | — |
| Gourmantché | 9.000 | (famille voltaïque, groupe mossi ; tous animistes). |
| Total | 25.000 | (dont 16.000 musulmans). |
Les Peuls sont surtout répandus dans le Torodi, les Toucouleurs à Say, les Songaï tout le long du Niger, les Gourmantché dans le Torodi et la province de Botou.
29o Cercle de Gaoua.
| Dioula | 1.800 | (famille mandé, tous musulmans). | |||
| Dagari | 53.239 | groupe mossi : 93.600 | famille voltaïque : 173.850 (tous animistes sauf 1.000 Dian musulmans). | ||
| Birifo | 40.361 | ||||
| Niénigué | 1.600 | (gr. bobo : 1.600) | |||
| Lobi | 62.050 | groupe lobi : 74.650 | |||
| Dian | 5.950 | ||||
| Pougouli | 5.550 | ||||
| Gan | 1.100 | ||||
| Lorho | 4.000 | (gr. koulango : 4.000) | |||
| Padorho | 500 | (tribu non classée, tous animistes). | |||
| Total | 176.150 | (dont 2.800 musulmans). | |||
Les Dioula habitent à Diébougou et à Lorhosso. Les Dagari propres (32.654) sont répandus le long de la Volta Noire depuis Dioumbalé jusqu’au 11° de latitude Nord ; les Oulé (20.585)[171] leur font suite dans la direction du Nord ; les Birifo se rencontrent au Sud et à l’Ouest des Dagari ; les Niénigué ne font qu’effleurer le Nord du cercle ; les Lobi se sont infiltrés au milieu des Birifo et habitent surtout l’Ouest de Gaoua ; les Dian peuplent Diébougou et ses environs, et les Pougouli les bords du Bougouriba en amont de Diébougou ; les Gan sont à Lorhosso, les Lorho dans la province de Lorhosso et les Padorho dans l’Ouest du Cercle.
30o Cercle de Bobo-Dioulasso.
| Peuls | 2.130 | (dont 1.930 animistes). | |
| Soninké | 1.600 | famille mandé : 68.595 (dont 6.050 musulmans, savoir : les 1.600 Soninké, 4.250 Dioula et 200 Sia). | |
| Dioula | 39.215 | ||
| Samorho | 3.000 | ||
| Sia (Bobo-Dioula) | 6.000 | ||
| Tribus diverses | 18.780 | ||
| Sénoufo | 132.885 | (tous animistes). | |
| Boua (Bobo-Fing) | 39.500 | famille voltaïque, groupe bobo : 61.105 (tous animistes). | |
| Niénigué | 21.605 | ||
| Tribus non classées | 18.535 | (tous animistes). | |
| Total | 282.250 | (dont 6.250 musulmans). |
Les Boron sont comptés avec les Dioula. — Les tribus diverses de famille mandé (groupe du Sud), de rattachement d’ailleurs incertain, sont celles des Blé 1.035, des Natioro 2.745, des Ouara 7.000 et des Sembla 8.000. — Les Sénoufo se partagent en 31.875 Mbouin, 23.790 Folo, 21.205 Tourka, 18.535 Karaboro, 17.170 Tagba, 11.260 Nanergué, 5.605 Komono et 3.445 Sémou. — Les tribus non classées sont celles des Toussia (10.045), des Dorhossié (3.700), des Vigué (2.790) et des Tiéfo (2.000).
Les Peuls sont disséminés dans le Nord-Est du cercle. Les Soninké se rencontrent surtout dans le pays des Niénigué ; les Dioula sont installés à Bobo-Dioulasso et aux environs ; les Boron chez les Nanergué ; les Samorho entre Bobo-Dioulasso et[172] Sikasso ; les Sia à Bobo-Dioulasso ; les Sénoufo dans le Nord du cercle (Tagba), dans le Centre et dans le Sud ; les Bobo dans le Nord et la plupart des tribus non classées dans la circonscription de Banfora.
[40]Cependant quelques Berbères Zenaga vivent, en qualité de vassaux, auprès des Kounta : on les appelle Zakhoura.
[41]En réalité les Dioula devraient, au double point de vue géographique et linguistique, être rattachés plutôt au groupe du centre. C’est à cause de leurs origines (voir au Chap. II) et de leur caractère que je les range dans le groupe du Nord.
[42]Le rattachement de ces divers peuples ou tribus — les Diallonké exceptés — au groupe mandé du Sud et, plus généralement parlant, à la famille mandé n’est pas encore bien démontré et je ne l’indique qu’à titre provisoire. Il est possible d’autre part que les Samo et les Samorho ne forment qu’un même peuple.
[43]Il n’est pas absolument certain que les Karaboro soient des Sénoufo ; il se pourrait qu’on dût les rattacher à la famille voltaïque.
[44]Peut-être pourrait-on faire un seul peuple des Nioniossé et des Nounouma, peuple qui comprendrait plusieurs tribus (Nioniossé ou Kassomsé, Lilsé ou Youlsé, Nounouma proprement dits, etc).
[45]Voir notamment Léon l’Africain.
[46]On retrouve le mot Berdâm chez les géographes arabes sous la forme Berdâma.
[47]Le poular est la langue des Toucouleurs, adoptée par les Peuls comme je tâcherai de l’expliquer plus loin.
[48]Cette étymologie peut à bon droit paraître douteuse, aussi bien d’ailleurs que l’origine exclusivement marocaine des Arma. Le mot arabe râmi ne désigne pas nécessairement un « fusilier », il désigne même plutôt un « archer » : or les archers formaient précisément le gros, non pas de l’armée marocaine, mais de l’armée indigène qui chercha à repousser les Marocains. Quant aux Arma eux mêmes, ils méritent, actuellement au moins, le nom de « nègres » aussi bien que les Gabibi et ne se distinguent de ces derniers ni par la couleur ni surtout par la langue. Il est probable qu’ils descendent surtout des nobles songaï qui, bien avant la conquête marocaine, détenaient le pouvoir et constituaient l’aristocratie indigène ; plus tard lorsque, la domination marocaine s’affaiblissant, ils reprirent leur rang de maîtres, ils voulurent sans doute, pour justifier leur substitution aux caïds marocains, se constituer une généalogie qui les fît descendre des conquérants ; il est fort vraisemblable d’ailleurs que leur prétention était en partie justifiée, car c’est assurément dans les familles nobles que les Marocains prirent femme le plus volontiers.
[49]Si d’ailleurs la forme mali peut signifier « hippopotame » dans certains dialectes, ce sens ne peut en aucune façon s’appliquer à la forme mandé ; par contre, si l’on peut traduire mandé, mané, mani, etc., par « petit lamentin », il serait bien difficile de donner la même traduction aux formes mali, mallé, etc. ; on pourrait encore proposer l’étymologie de « fils de maître », mais elle serait également fort douteuse.
[50]La prononciation mandé du suffixe de nationalité est ka, parfois kè, mais non ké.
[51]Ch. Monteil, dans sa remarquable Monographie de Djenné.
[52]D’après M. Binger, qui donne à Soninké la signification de « partisans du Sonni », Assouanik ne viendrait pas du mot Soninké mais de Assouanka (gens de l’Assoua, en mandé) et Assoua serait le nom d’un pays situé au Sud-Ouest de Tombouctou : je n’ai pu retrouver de pays de ce nom, à moins qu’il ne s’agisse de l’Aoussa ou du Haoussa, c’est-à-dire de tous les pays de la rive gauche du Niger, selon le terme employé pour les désigner dans la région de Tombouctou-Gao ; mais alors la forme Assouanik serait incorrecte, et de plus il serait étrange que des Maures eussent emprunté un mot à désinence mandé — mot d’ailleurs inusité et dont le radical serait étranger au mandé — pour désigner un peuple qui n’a jamais habité du reste qu’une très faible portion du Haoussa, à savoir, au Sud et surtout au Sud-Ouest du Débo la province de Dia ou Diaka ou Diagha, pays d’origine des Soninké, province qui se trouve précisément en dehors de la zone à laquelle les Songaï donnent le nom de Haoussa.
[53]Les Songaï appellent Dakouraré les Soninké Nono ou Nononkobé, lesquels aujourd’hui parlent songaï et non plus soninké.
[54]On se sert également chez les Maures du mot Sossé pour désigner les Mandé en général et surtout les Soninké. (Voir notamment un mandement de Saad Bouh à Ma el-Aïnîn, dans le no de novembre 1909 des Renseignements coloniaux du Comité de l’Afrique Française).
[56]C’est-à-dire « bouche noire » ou plutôt « bouche bleue », à cause de l’habitude qu’ont les indigènes de cette fraction de se bleuir les lèvres.
[57]Certains font dériver Bambara du mot mandé bamba ou bamma « crocodile » et donnent à ce terme la signification de « (ceux) du crocodile », par allusion au fait que le crocodile est un emblème religieux fort répandu chez tous les peuples que les musulmans englobent sous le sobriquet de « Bambara ». Quant au mot Banmana, il signifierait, d’après les Banmana eux-mêmes, « refus au maître » (ban-ma-na), par allusion à la légende d’après laquelle les Banmana auraient quitté leur pays d’origine (Ouassoulou) pour échapper au joug de conquérants Malinké.
[58]Ce mot se retrouve dans le nom de tribu des Siénérhè.
[59]Ne pas confondre avec les Gan de famille voltaïque ni avec les Ngan du groupe mandé-sud qui habitent dans le Diammala et le Mango (Côte d’Ivoire).
[60]De là les mots Kombori (Nord-Ouest du cercle de Koury) et Hombori, qui en peul signifient l’un et autre « pays des Tombo ».
[61]Il se pourrait que ce terme de Kôssé dût s’appliquer plutôt à une fraction des Nioniossé ou à une fraction des Bobo.
[62]Je ne suis pas certain que le nom de Kouroumankobé, qui a peut-être la même origine que Gourmantché (ceux du Gourma, c’est-à-dire de l’intérieur de la Boucle du Niger), s’applique exclusivement aux Nioniossé.
[63]Ne pas confondre les Kparhala ou Koulango avec les Kpalarha, Pallaka ou Pala du cercle de Korhogo (Côte d’Ivoire), qui sont des Sénoufo. Il convient également de ne pas confondre les Gan ou Gan-né de Lorhosso (groupe lobi de la famille voltaïque) avec les Ngan ou Ngan-né du Diammala et du Mango (Côte d’Ivoire), qui sont des Mandé du Sud ; ni les Sia ou Bobo-Dioula de Bobo-Dioulasso (groupe mandé du Sud) avec les Sia du cercle de Mankono (Côte d’Ivoire), qui sont un mélange de Mandé du Centre et de Mandé du Sud ; ni les Dioula de la Boucle du Niger (groupe mandé du Nord) avec les Dan ou Mêbé, dits « Dioula anthropophages », du cercle du Haut-Cavally (Côte d’Ivoire), qui sont des Mandé du Sud, ou avec les Diola de la Casamance, qui appartiennent à une famille ethnique spéciale (famille côtière), n’ayant aucun représentant dans la colonie du Haut-Sénégal-Niger.
[64]Les Nimadi seraient, dit-on, d’origine juive et ne professeraient pas l’islamisme ; on en rencontre dans la région de Oualata.
[65]D’après M. Gautier (La conquête du Sahara), le mot Harrâtîn signifierait « laboureurs » (du verbe haratsa, bien que l’orthographe usuelle comporte un tha et non un tsa) et ne désignerait pas nécessairement des Nègres ni même des gens de condition servile. Mais dans la pratique ce mot s’applique aux Nègres qui descendent d’anciens esclaves et qui sont devenus les serfs des Maures ; il ne s’applique pas aux Nègres des villes sahariennes dont les ancêtres occupaient le pays avant la domination berbère, c’est-à-dire aux Azer ou Soninké de Tichit, Oualata, etc.
[66]On a voulu rattacher le nom des Kel-Antassar à celui des Ansâr ou premiers partisans de Mahomet, mais l’orthographe donnée par les meilleurs auteurs arabes au nom des Kel-Antassar (par un sin et non par un sad) doit faire rejeter cette étymologie.
[67]Le mot Tôrobé ne signifie pas, comme on le croit généralement, « les gens originaires du Toro », expression qui se dit en peul Toronké ou Toronkobé ou encore Toronâbé (sing. Toronkédio, Toronko ou Toronâdio) ; d’après M. le commandant Gaden, Tôrobé ou mieux Tôrodbê ou Tôrobbé (sing. Tôrodo) veut dire « ceux qui supplient ensemble » : c’est le nom d’un clan qui pourrait aussi bien être considéré comme une caste. Ce clan a d’ailleurs de nombreux représentants au Toro, mais pas plus là qu’ailleurs, et il ne paraît pas qu’il y ait plus de rapports entre le Toro et le clan des Tôrobé qu’entre le Diallon ou Fouta-Diallon et le clan des Dialloubé.
[68]Barth dit que le nom de l’ensemble des gens de langue peule lui a paru être So : peut-être a-t-il fait confusion avec le clan toucouleur des Sô, fort répandu chez les familles princières de l’empire de Sokoto au moment de son voyage.
[69]Beaucoup de Toucouleurs portent aussi des noms de clan à singulier et à pluriel, identiques à ceux des Peuls ; le clan des Tôrobé en particulier compte de nombreux représentants chez les Toucouleurs. Enfin on rencontre chez ces derniers les mêmes castes que chez les Peuls, avec les mêmes noms.
[70]Les Tounkara se donnent comme étant de souche royale et font venir leur nom de tounka « roi ».
[71]Les Massassi (de massa « roi » et si « descendance ») sont les Kouloubali de la branche aînée.
[72]D’après le Père Brun, le nom de Dansira serait donné aux femmes du clan des Dembélé ; sans vouloir contredire ce missionnaire très bien informé, je dois dire que j’ai connu des hommes portant ce nom et le donnant comme celui d’un clan spécial.
[73]Mansaré veut dire, comme Massassi, « de souche royale ».
[74]D’après le Père Brun, Souko serait le nom donné aux femmes du clan des Keïta, Demba celui donné aux femmes du clan des Sissoko et Sakiliba celui donné aux femmes du clan des Doumouya.
[75]Pour compléter cette nomenclature, d’ailleurs très imparfaite, des noms de clan du Haut-Sénégal-Niger, je donne ci-après les diamou ou santa les plus fréquemment portés par les Ouolofs installés dans cette colonie : Ndiaye, Diop, Diouf, Tiam, Diang, Sar, Tièp, Niang, Ngom, Diao, Boye, etc.
[76]J’appelle animisme l’ensemble des croyances communes à toutes les populations non-musulmanes de l’Afrique Occidentale, croyances qui comportent un mélange de monothéisme, de dynamisme et d’animisme proprement dit, mais qui se manifestent par un culte presque exclusivement animiste. J’expliquerai plus loin (Ve partie) pourquoi j’ai adopté ce terme et pourquoi j’ai rejeté les expressions tout à fait impropres — quoique usuellement employées — de « paganisme » et de « fétichisme ».
[77]4.809.053 ou 4.799.703, selon les divers tableaux de recensement qui m’ont été fournis.
[78]D’après certaines informations, un nombre assez considérable de Peuls non-musulmans existerait dans le cercle de Goumbou.
[79]Dans Tombouctou la mystérieuse, par Félix Dubois.
[80]Dont 93.298 animistes.
[81]Dont 767.511 animistes.
[82]Tous animistes.
[83]Dont 994.140 animistes.
[84]Y compris 450 Boron ou Bolon.
[85]Dont 19.170 Diawara.
[86]Y compris 8.000 Boron ou Bolon.
[87]Dont 3.000 Diennenké ou habitants de la ville de Dienné.
[88]Il est à remarquer que le Haut-Sénégal-Niger ne renferme qu’une assez faible fraction du peuple malinké, lequel est répandu dans une notable partie de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Sénégal, ainsi que dans le Libéria, le Sierra-Leone, la Guinée portugaise et la Gambie. Dans leur ensemble, les Malinké sont certainement plus nombreux que les Banmana et forment l’élément le plus fort de toute la famille mandé : il est donc assez juste qu’ils aient donné à cette famille leur nom ou tout au moins celui de leur pays d’origine.
[89]Dont 21.057 musulmans.
[90]Dont 1.000 musulmans.
[91]Dont 552 musulmans.
[92]Dont 20.585 Oulé.
[93]Passant tous pour musulmans.
[94]Dont 24.209 musulmans au total contre 1.238.018 animistes.
[95]Dont 1.000 musulmans seulement.
[96]Dont 25.209 musulmans au total contre 1.628.963 animistes.
[97]Tous animistes.
[98]Tous animistes.
[99]Beaucoup de ces Lorho sont bijoutiers en cuivre : il est probable qu’ils constituent chez les Koulango une caste analogue à celle qu’on appelle Lorho chez les Mandé et que ce sont ces derniers qui leur ont, en raison de ce fait, donné le nom sous lequel nous les connaissons.
[100]D’après le commandant de Lartigue, un grand nombre des Peuls Ourourbé dits Sambourou ne professeraient pas l’islamisme.
[175]CHAPITRE II[101]
Origines et formation des groupements ethniques actuels
Généralités. — Si la nomenclature et la classification des groupements ethniques actuels présente de nombreuses difficultés, il est plus malaisé encore de fixer leurs origines et d’expliquer leur formation. Il ne suffit plus en effet de se documenter sur des faits qui tombent sous le sens de l’observateur ; il devient nécessaire de démêler les écheveaux toujours embrouillés d’un passé nuageux que les quelques historiens du Soudan ont souvent embrumé plus qu’ils ne l’ont éclairci.
Nos sources d’information sont maigres et leur valeur est fréquemment médiocre.
J’ai dit plus haut combien étaient précaires les données que nous peuvent fournir, dans l’état actuel de nos connaissances, l’anthropologie, l’ethnographie et la linguistique. L’histoire n’est pas plus féconde en ce qui concerne l’objet de ce chapitre. Les auteurs arabes du Moyen-Age ne nous ont guère renseignés que sur l’origine des peuples avec lesquels ils se trouvaient en contact immédiat, c’est-à-dire — en ce qui a trait à notre sujet — sur l’origine des Berbères, et leurs contradictions comme leurs fantaisies imaginatives laissent perplexe le lecteur qui les consulte. Il est rare qu’ils nous aient transmis des faits précis concernant les origines des peuples plus éloignés et, lorsqu’ils l’ont fait, ils ne tenaient leurs renseignements en général que de deuxième ou troisième main ; le problème d’ailleurs est[176] encore compliqué par la difficulté que nous éprouvons à identifier les noms des peuples soudanais cités par les Arabes.
Les dires des indigènes, recueillis sur place par les voyageurs anciens et modernes, sont rarement nets et explicites. La plupart du temps, ainsi que je le faisais observer plus haut, le Noir que l’on interroge sur les origines de son peuple répond en donnant simplement l’origine de sa famille ou de son village, ou celle de la famille régnante[102], et encore ne la donne-t-il avec quelque précision qu’en ce qui concerne les deux ou trois générations qui l’ont précédé lui-même. Pour les temps plus reculés et pour l’origine des groupements de quelque importance, il n’existe en réalité qu’une source d’information : je veux parler des légendes historiques et épiques qui constituent l’une des formes les plus curieuses de la littérature populaire au Soudan, légendes que l’on se transmet oralement de père en fils et qui sont ainsi parvenues jusqu’à nous.
Malheureusement, comme toutes les légendes, ces traditions purement orales sont sujettes à des remaniements et à des interpolations que les conteurs successifs ne se font pas faute d’introduire dans le récit qui leur a été légué. Il faut de plus tenir compte du côté merveilleux de nombre de ces histoires, non pas pour le rejeter comme un hors d’œuvre inutile, mais pour en extraire le symbole qu’il renferme le plus souvent et le traduire de façon rationnelle. Il convient d’autre part de se montrer très circonspect chaque fois que la légende tend à donner au peuple qu’elle concerne une origine particulièrement noble et à attribuer sa naissance à une migration venue d’Asie ou d’Egypte : il n’est pas, je crois, une seule tribu soudanaise quelque peu frottée d’islamisme, même parmi les plus manifestement nègres, qui ne prétende descendre d’Abraham ou de Himyar et qui ne s’attribue comme berceau le Hidjaz ou le Yémen, à moins que ce ne soit l’Egypte, la Tunisie ou le Maroc ; le Yémen est l’objet d’une préférence marquée, préférence qui[177] se traduit par le nombre considérable de localités appelées Yamina ou Niamina, prononciation soudanaise du nom du Yémen.
| Delafosse | Planche VII |

Cliché Paulin
Fig. 13. — Chameaux au pâturage, auprès de Tombouctou.

Cliché Paulin
Fig. 14. — Maures nomades et leurs chameaux, aux environs de Tombouctou.
Là encore cependant, sans prendre les légendes au pied de la lettre, on peut y découvrir un symbole qu’il suffit d’interpréter avec bon sens. Tout le monde sait qu’au Soudan — comme en beaucoup d’autres contrées du reste — on use fréquemment de noms de pays pour exprimer les points cardinaux ; c’est ainsi que, du côté de Bamako, le Sud est appelé Ouorodougou, du nom donné par les Mandé à la région d’où viennent les colas, région qui se trouve effectivement dans le midi par rapport à Bamako ; Sourakadougou (pays des Maures) y est employé de même pour désigner le Nord, Bâkô (l’au-delà du fleuve) pour désigner l’Est ; j’ai dit plus haut que Sahel, Haoussa, Gourma, mots qui représentent en réalité des pays — le Sahel étant la lisière Sud du Sahara, le Haoussa la rive gauche du Moyen-Niger et le Gourma sa rive droite —, servent couramment à exprimer des directions d’orientation. Tout me porte à croire qu’il en est de même du Yémen pour les musulmans du Soudan et qu’en traduisant ce mot par « Est » dans les légendes qui l’indiquent comme pays d’origine d’une tribu ou d’un fondateur d’empire, on a de grandes chances de ne pas commettre d’erreur[103].
De tout ce qui précède il résulte que, si nous ne manquons pas totalement de documents en ce qui concerne les origines des peuples soudanais, si nous possédons en plus quelques données d’histoire qui jettent une certaine lueur sur les phases principales de leur formation, nous ne pouvons pas en déduire des affirmations positives : tout au plus avons-nous le droit d’en bâtir des hypothèses vraisemblables, en n’opérant d’ailleurs qu’avec la plus grande circonspection et en nous gardant de[178] l’esprit de système et de généralisation. C’est ce que j’ai tenté de faire dans les pages suivantes, non pas avec la prétention d’exposer des vérités, mais seulement avec l’espoir de signaler des probabilités qui pourront peut-être servir de base aux recherches futures.
Parmi ces probabilités, il en est une qu’il convient de noter dès maintenant, avant de passer à l’étude de chacun des peuples dont nous avons à parler. Des sept familles ethniques représentées actuellement dans le Haut-Sénégal-Niger, quatre semblent être venues du dehors, par des immigrations successives dont certaines remontent d’ailleurs à une haute antiquité : ce sont les familles sémitique, hamitique, tekrourienne et songaï.
La chose est indubitable en ce qui concerne la famille sémitique. Pour ce qui regarde les familles hamitique et songaï, il est possible que, dès les temps les plus reculés, des tribus appartenant à chacune de ces deux familles aient été domiciliées sur une petite portion des territoires qui forment aujourd’hui la colonie civile du Haut-Sénégal-Niger, mais elles ne pouvaient l’être en tout cas que sur les extrêmes confins de ces territoires, tandis que maintenant ces deux familles sont implantées au cœur même de la colonie : on peut par suite les considérer comme immigrées. Quant à la famille tekrourienne, il est possible au contraire que son domaine primitif se soit étendu plus à l’Est — de même qu’il est à peu près certain qu’il s’étendait bien au Nord de son domaine actuel, — et que, en conséquence, une fraction tout au moins de cette famille ait été autochtone d’une partie du Haut-Sénégal-Niger actuel ; mais, comme nous ne possédons à ce sujet aucun indice certain et que, aussi loin que s’étend notre documentation, le domaine de la famille tekrourienne nous apparaît localisé au delà des frontières de la colonie, nous devons considérer aussi comme des immigrés les représentants de cette famille que nous rencontrons aujourd’hui dans les bassins du Haut-Sénégal et du Niger.
Les trois autres familles ethniques — mandé, sénoufo et voltaïque — sont au contraire autochtones, mais à des titres divers. Il paraît bien certain que le groupe septentrional de la famille mandé a eu son berceau dans le Massina occidental ou Diagha[179] (ou Diaga),en plein Centre de la colonie ; le principal des peuples du groupe central, le peuple mandingue, semble bien être également originaire du Haut-Sénégal-Niger, son pays d’origine correspondant au Mandé ou Manding actuel ; quant à l’autre des deux grands peuples du même groupe, le peuple banmana, il est peut-être originaire d’une province de la Côte d’Ivoire (le Toron), mais, cette province étant située sur la lisière même du Haut-Sénégal-Niger, on peut aussi regarder ce peuple comme autochtone ; le groupe méridional, lui, a eu vraisemblablement son berceau au Fouta-Diallon, dont l’une des provinces extrêmes seulement appartient au Haut-Sénégal-Niger (Sud du cercle de Satadougou et Sud-Ouest du cercle de Kita). Quoi qu’il en soit, la famille mandé, dans son ensemble, peut être dite autochtone dans la colonie ; mais il s’en faut de beaucoup qu’elle le soit dans une grande partie des contrées du Haut-Sénégal-Niger où elle est représentée actuellement : il serait inexact de parler d’immigration mandé, mais il nous faudra parler assez longuement des « migrations » mandé, qui furent considérables et fort importantes au point de vue historique. De ces trois petits pays — Diaga, Mandé, Toron — les Mandé se sont répandus à travers le Nord-Ouest, l’Ouest, le Centre et le Sud-Ouest de la colonie, entamant même l’Est et le Sud-Est, sans parler de leurs poussées dans les colonies du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire.
La famille sénoufo semble avoir occupé de tout temps les territoires qu’elle occupe encore actuellement : j’ignore si son berceau primitif doit être placé à la Côte d’Ivoire ou au Haut-Sénégal-Niger, mais en tout cas son domaine ne paraît pas avoir jamais subi de modifications bien sensibles et, si elle a effectué des migrations, nous n’en pouvons découvrir aucune trace sérieuse.
La famille voltaïque enfin est vraisemblablement autochtone aussi dans son territoire actuel : tout au plus peut-on supposer que ce territoire s’étendait autrefois davantage vers le Nord et le Nord-Ouest, qu’il a subi des reculs dans ces deux directions sous la poussée des Berbères, des Songaï et des Mandé et que, par contre, il a gagné un peu de terrain vers le Sud-Ouest aux[180] dépens des Sénoufo. D’autre part, plusieurs des peuples qui composent cette famille n’ont pas occupé de tout temps les régions où on les trouve aujourd’hui ; l’origine des Mossi en particulier remonte à une migration importante du Sud vers le Nord et le Nord-Ouest : mais cette migration et d’autres moins considérables n’ont pas dépassé les limites du territoire de la famille, en sorte que, comme les Sénoufo, les Voltaïques sont strictement autochtones.
Bien entendu, lorsque je parle de familles autochtones, je ne remonte pas au delà de la période historique. Comment le Soudan était-il peuplé avant cette période ? je laisse à de plus savants le soin de le déterminer. Qu’une certaine école prétende trouver dans l’Inde ou dans l’Océanie le berceau de la race nègre, c’est son droit. Je préfère, quant à moi, prendre comme point de départ une époque à laquelle les Nègres se trouvaient déjà indubitablement là où ils se trouvent actuellement, au moins d’une façon générale, et je crois que, si je pouvais retracer seulement jusqu’au début de notre ère les origines probables des peuples du Haut-Sénégal-Niger, j’en aurais fait assez pour ma part.
1o Bérabich. — Les Bérabich ont dû faire leur première apparition du côté de Taodéni et d’Araouân vers la fin du VIIIe siècle de notre ère. Ils venaient du Dara ou Draa, province méridionale du Maroc située entre le Tafilelt et le Noul ou Noun et qui a donné son nom à l’oued Dara ou Draa qui l’arrose. Ces Bérabich étaient, croit-on, des Arabes originaires du Yémen, venus d’Arabie dans le Maghreb sous le règne du troisième tobba ou roi himyarite du Yémen, Ifrîkos ou Africus, vers l’époque de la naissance de J.-C., c’est-à-dire bien avant Mahomet[104]. Au moment de leur départ pour le Sahara Soudanais, ils occupaient le Dara depuis plusieurs siècles et y voisinaient avec des[181] Berbères de tribus diverses (Messoufa et Lemta entre autres). Il est probable qu’ils s’étaient plus ou moins « berbérisés » au contact de ces derniers ; on peut néanmoins leur reconnaître une origine arabe.
Ce furent sans doute les premières expéditions musulmanes dans le Sud marocain ou les bouleversements amenés par la fondation de la dynastie des Idrissides (788) qui incitèrent les Bérabich à aller chercher plus au Sud des territoires où ils pussent conserver leur indépendance. Ils quittèrent le Dara en deux groupes conduits l’un par Inis-ben-Yaïs et l’autre par Yaïch ; plus tard ils furent rejoints par deux autres familles arabes du Dara, les Oulad-Abderrahmân et les Oulad-Ameur. Ils n’étaient pas encore musulmans à cette époque, selon toute vraisemblance, et ne furent convertis que vers le début du XVIIe siècle par des marabouts Kounta, après la prise de Tombouctou par les Marocains.
L’attrait des profits qu’ils pouvaient retirer de l’exploitation des mines de sel de Teghazza ne fut pas étranger probablement à leur exode et de fait ils se rendirent maîtres de ces mines, possédées auparavant par des Berbères Messoufa et, tout en en abandonnant l’exploitation proprement dite aux Soninké qui y étaient établis déjà et dont ils firent leurs vassaux, ils s’instituèrent guides et convoyeurs des caravanes du Soudan qui venaient chercher le sel à Teghazza ainsi que des caravanes marocaines qui, passant par ce même point, allaient dans la région de Oualata-Tombouctou chercher des esclaves et de la poudre d’or. C’est ainsi que leurs terrains de parcours s’étendirent peu à peu jusqu’au Niger et à Ras-el-ma ; Araouân, qui n’aurait pris toute son importance que vers 1690, devint à partir du XVIIIe siècle leur centre géographique et leur principal point d’attache. Lorsque Taodéni remplaça Teghazza en 1596, les Bérabich conservèrent leur monopole et ils l’ont gardé jusqu’à nos jours.
Lors de leur arrivée dans le Sahara Soudanais, ils y avaient trouvé — comme je viens de le mentionner — des Berbères Messoufa et des Nègres Soninké ; il semble bien certain que des unions se formèrent entre ces deux éléments et les Bérabich[182] et que les produits de ces unions durent altérer singulièrement le type arabe déjà mitigé des envahisseurs. Nombreux sont actuellement les Bérabich métissés de sang noir et, si les métissages de sang berbère sont plus difficiles à constater, ils n’en sont pas moins infiniment probables. Toutefois, par la langue, les mœurs et les traditions, les Bérabich sont demeurés surtout arabes.
Les sous-tribus connues sous les noms d’Ousra et de Tormoz se sont séparées politiquement du reste de la tribu vers 1875 et se sont écartées de la ligne Taodéni-Tombouctou pour émigrer vers le Sud-Ouest, dans la direction de Ras-el-ma et de Bassikounou, faisant cause commune avec les Maures Oulad-Delim contre le gros des Bérabich. Toutefois, au point de vue de l’origine, les Ousra et les Tormoz ne sont, semble-t-il, qu’une simple fraction des Bérabich.
2o Kounta. — Les Kounta eux aussi sont d’origine sémitique. Ils font remonter la généalogie de leur tribu — ou tout au moins des familles nobles de leur tribu — au conquérant Okba-ben-Nafi qui, nommé en 670 gouverneur de l’Ifrikia (Tripolitaine et Tunisie) par le premier khalife omeyyade Moaouiya (661-680), guerroya en Tunisie contre les Romains et les Berbères, construisit Kaïrouân, pénétra au Maroc et jusqu’au Dara et fut tué près de Biskra en 681 par des partisans du chef berbère Kosseïla. Les compagnons et les descendants de Okba, musulmans naturellement, s’essaimèrent de la Tunisie au Touat, et ce serait l’un d’eux[105] qui, vers le XVe siècle, serait venu du Touat s’établir avec sa famille dans la région de Mabrouk[106], au Nord-Est d’Araouân, au moment où le chef touareg Akil régnait sur Tombouctou. Il y aurait été rejoint par des parents et des amis de même descendance arabe que lui-même et aussi, très probablement, par des membres de la colonie juive jusque là toute puissante au Touat, mais qui[183] venait d’être persécutée et pourchassée en 1492 par le réformateur musulman El-Merhili.
C’est du mélange de ces Arabes descendants de Okba et de ces Juifs du Touat, islamisés par la suite, que serait sortie la tribu des Kounta. A ces deux éléments sémitiques primitifs, il convient cependant d’en ajouter deux autres : l’un, hamitique, provenant de quelques tribus berbères de l’Azaouad qui acceptèrent la domination des Kounta et s’incorporèrent à eux — les Zakhoura en particulier — et aussi d’unions fréquentes avec les tribus maraboutiques touareg[107] ; l’autre, nègre, provenant d’unions avec des Songaï ou des Soninké et avec des esclaves ou des serfs également d’origine noire.
Ces mélanges devinrent surtout fréquents lorsque, ayant quitté en partie leur foyer primitif de Mabrouk pour se répandre dans la région de Tombouctou sur les deux rives du Niger et pour se rendre, à travers le Hodh, dans le Tagant et l’Adrar mauritanien, les Kounta multiplièrent les occasions de contact avec des Berbères et des Nègres. Néanmoins, comme chez les Bérabich, c’est le type et le sang arabes — ou tout au moins sémitiques — qui semblent, encore aujourd’hui, dominer chez les Kounta.
1o Elément berbère. — Il paraît difficile de savoir si le Hodh était peuplé par des Nègres avant que les Berbères y eussent fait leur première apparition. Il est certain que les Soninké y possédaient des colonies bien avant le mouvement almoravide, c’est-à-dire bien avant le XIe siècle de notre ère, mais il n’est pas moins certain qu’avant cette date les Berbères de l’Adrar et du Tagant et particulièrement ceux de l’empire lemtouna d’Aoudaghost — dont nous parlerons dans la partie historique de cet ouvrage — s’étaient déjà répandus jusque dans la région où se trouve aujourd’hui Oualata et y avaient exercé au moins à[184] un moment donné une sorte d’hégémonie politique. Il est probable même qu’à une époque plus reculée, lorsque se produisit — sans doute durant les deux premiers siècles de l’ère chrétienne — l’immigration judéo-syrienne dont il sera question à propos des origines du peuple peul, des Berbères se trouvaient déjà dans la région, en même temps que des Soninké. J’inclinerais toutefois à penser que ces derniers furent les premiers colonisateurs du Hodh et qu’ils avaient fondé déjà Néma et Ghana — ou d’autres villes que celles-ci remplacèrent par la suite — avant l’apparition des premiers Berbères : si l’exactitude de cette hypothèse vient à être démontrée, il faudrait placer la première immigration berbère dans le Haut-Sénégal-Niger — en l’espèce dans le Hodh — quelques siècles avant J.-C., mais postérieurement au grand mouvement de migration soninké que je tenterai de retracer plus loin.
Quoi qu’il en soit, ces Berbères — cela paraît bien établi — appartenaient à la grande fraction des Zenaga, notamment aux tribus Goddala, Lemtouna et Messoufa, et venaient de l’Adrar mauritanien par le Tagant (Goddala et Lemtouna), ainsi que du Sud marocain par Taodéni (Lemtouna et Messoufa). Depuis fort longtemps sans doute les Lemtouna occupaient l’Adrar, ayant les Goddala entre eux et l’Océan et les Messoufa au Nord et au Nord-Est. Ils s’étaient installés là en venant du Maroc. Rechercher plus loin leur point de départ primitif serait fort malaisé : cela reviendrait à trancher la question de l’origine des Berbères, qui a été résolue, il est vrai, mais de diverses manières souvent contradictoires.
Ce groupe de la famille hamitique est-il autochtone dans l’Afrique du Nord ou y est il venu de la péninsule arabique ? je ne vois pas la nécessité de répondre ici à cette question, qui dépasse les limites de ma faible compétence et nous entraînerait trop loin de notre sujet. Qu’il me suffise de rappeler que la présence des Libyens, manifestement identiques aux Berbères, dans la Cyrénaïque, la Tunisie actuelle et le Maghreb a été signalée dès le Ve siècle avant J.-C. par Hérodote, qui semblait les considérer comme les plus anciens et les seuls habitants de la presque totalité de ces contrées. Les Berbères ne sont autres[185] en effet que les Libyens, les Gétules et les Numides de l’antiquité classique, auxquels les Latins donnèrent, parce qu’ils se montraient rebelles à la civilisation romaine, le surnom de Barbari (du grec Barbaroï « étrangers, barbares »), que les Arabes ont transformé en Berber tout en le faisant dériver d’un mot arabe signifiant « murmurer, parler d’une façon incompréhensible », selon leur habitude de trouver à tous les noms de lieux et de peuples une étymologie dans la langue de Mahomet[108].
[186]Nous savons que les Berbères étaient partagés autrefois en plusieurs grandes fractions dont les deux plus importantes étaient appelées Zenata et Zenaga. Les Zenata sont en général demeurés dans l’Afrique du Nord, tandis que les Zenaga, tout en laissant au Maghreb de très nombreux représentants, essaimèrent, dès une époque fort lointaine, quelques-unes de leurs sous-tribus dans le Sahara et la Mauritanie actuelle : les Messoufa, les Djedala ou Goddala, les Lemtouna, les Maddassa et les Ouareth furent les principales de ces sous-tribus zenaga du désert ; les Hoouara, les Lemta et les Guezoula, apparentés de près aux Zenaga, sinon Zenaga eux-mêmes, participèrent au même mouvement. Tous se distinguèrent de bonne heure de leurs frères demeurés dans le bassin méditerranéen en adoptant le voile qui leur valut plus tard le surnom arabe de Molettsemîn (les voilés) et qui, aujourd’hui, n’est plus porté que par ceux d’entre eux qui ont échappé à la conquête arabe et sont devenus les Touareg.
Les Lemta et les Hoouara se portèrent principalement dans le Sahara central, où on les retrouve sous les noms à peine transformés d’Oulmidden (Lemta) et de Hoggar ou Ihaggaren[187] (Hoouara). Les Messoufa restèrent longtemps cantonnés au Sud du Maroc dans la région de Tindouf, puis s’avancèrent du côté de Taodéni et de l’Azaouad. Les Maddassa se dirigèrent également vers le cours septentrional du Niger. Quant aux Lemtouna et aux Goddala, accompagnés de quelques familles des Guezoula et des Ouareth, ils allèrent s’installer dans l’Adrar mauritanien et dans le Tirs ou Tiris, puis dans le Tagant, vivant généralement côte à côte, quoique les Goddala se soient plus tard portés davantage vers le Sud-Ouest et le cours du bas Sénégal.
Il est probable, comme je le disais plus haut, que, depuis les derniers siècles qui ont précédé notre ère jusqu’au VIIe siècle environ après Jésus-Christ, des Lemtouna de l’Adrar, traversant le Tagant, firent des randonnées dans le Hodh, allant sans doute demander ou prendre aux cultivateurs soninké et ensuite aux pasteurs judéo-syriens les vivres qui leur manquaient. A partir du VIIIe siècle, ils commencèrent à se répandre en nombre plus considérable dans les pays dépendant aujourd’hui du Haut-Sénégal-Niger et y eurent même peut-être, aux IXe et Xe siècles, leur capitale Aoudaghost, qui devait se trouver non loin de Kiffa et qui tout au moins était située dans la partie du Tagant oriental avoisinant Kiffa, probablement un peu au Nord de cette dernière localité[109]. Tantôt suzerains des Noirs du pays, tantôt leur payant tribut, les Berbères durent, dès cette époque, se métisser assez fortement de sang nègre, surtout les sédentaires.
Selon toute vraisemblance, ils étaient chrétiens[110] au moment où prit naissance parmi eux la secte des Almoravides (1052), ou tout au moins ils l’étaient en majorité, puisque le but principal de la fondation de cette secte fut la conversion[188] des Lemtouna et Goddala infidèles ou mauvais musulmans. Beaucoup d’entre eux n’acceptèrent la religion de Mahomet que contraints et forcés, et après avoir été vaincus par les sectateurs d’Abdallah-ben-Yassîn ; beaucoup aussi, trouvant exagérés le puritanisme et l’autoritarisme du réformateur, émigrèrent vers l’Est et vinrent s’établir dans l’Azaouad auprès des Messoufa et des Maddassa.
D’une façon générale, les Lemtouna demeurèrent dans le Hodh et ce sont eux qui, plus ou moins métissés de sang noir, ont donné naissance à l’élément berbère qui, aujourd’hui encore, entre en majorité dans la composition des familles zénaga et même de beaucoup de familles prétendues arabes des diverses tribus des Maures du Hodh. Parmi les Goddala, les uns se fixèrent également dans le Hodh, mais les autres, plus nombreux, poussèrent jusque sur le Niger et au delà ; rejoints dans la région lacustre de Tombouctou par quelques familles lemtouna, ils donnèrent naissance à la tribu touareg des Iguellad ou tout au moins contribuèrent puissamment à sa formation, comme nous le verrons plus loin en parlant des Touareg. Il me faut ajouter que, parmi les Maures du Hodh oriental (Mejdouf et Allouch), on retrouve des traces de l’immigration Messoufa dont j’ai dit un mot déjà et dont je reparlerai à propos de la formation des Touareg.
2o Elément arabe. — L’élément arabe, en ce qui concerne les Maures du Hodh, a été fourni à peu près exclusivement par les Beni-Hassân : son introduction est relativement récente.
Les Beni Hassân, qui se disent descendants de la famille de Koreïch, à laquelle appartenait Mahomet, proviennent de la plus importante des immigrations arabes qui se soient accomplies dans l’Afrique du Nord, celle que l’on appelle l’invasion hilalienne. Les Arabes Hilaliens, descendants d’Adnân et rangés par Ibn-Khaldoun dans les Arabes « barbarisants », c’est-à-dire mélangés, passèrent en Afrique vers le début du XIe siècle ; c’étaient surtout des nomades. En réalité les Beni-Hassân (alias Idao-Hassân ou Doui-Hassân) n’étaient pas des Hilaliens ; ils appartenaient à un groupe issu de Makil, lequel prétendait descendre de Djâfer, fils d’Abou-Taleb, fils de Hachem, bisaïeul[189] de Mahomet, mais, d’après Ibn Khaldoun, descendait plutôt des Arabes du Yémen issus de Kodâa, petit-fils de Himyar.
Quoi qu’il en soit, les Beni-Hassân suivirent les Hilaliens dans leur migration et, après avoir traversé toute l’Afrique du Nord, s’établirent avec eux dans le Sous, le Noul ou Noun et le Dara ou Draa, entre l’Atlantique et le Tafilelt, vers la fin du XIIIe siècle, envoyant paître leurs troupeaux jusqu’aux régions sahariennes habitées par les Messoufa, les Lemtouna et les Goddala.
Ils comprenaient plusieurs fractions : celle des Beni-Hassân proprement dits ou descendants de Hassân fils de Mokhtar fils de Mohammed fils de Makil ; celle des Chebanât ou descendants de Chebana, frère de Hassân (comprenant les Beni-Tâbet ou Idao-Aïch, descendants de Aïch-ben-Talha, et les Ahl-Ali ou Idao-Ali) ; enfin celle très importante des Oulad-Delim qui, en réalité, formait une sous-tribu distincte des Beni-Hassân proprement dits.
Dès le XIVe siècle, selon le témoignage d’Ibn-Khaldoun, le territoire des Beni-Hassân s’étendait depuis le Sous jusqu’à la frontière du pays des Noirs, c’est-à-dire jusqu’à l’Adrar mauritanien tout au moins. Vers la fin du XVIe siècle, un grand nombre de Beni-Hassân, après avoir conquis définitivement l’Adrar, se répandirent de là sur les bords du Sénégal, puis dans le Tagant et enfin dans le Hodh[111], subjuguant les Berbères, les convertissant définitivement à l’islamisme et en faisant leurs vassaux. Les Beni-Hassân proprement dits et les Chebanât constituèrent l’élément arabe et en même temps guerrier chez les Regueïbât, les Idao-Aïch, les Ahl-Tichit, les Oulad-Mbarek, les Oulad-Nasser et les Mejdouf ; les Oulad-Delim, poussant davantage vers l’Est, contribuèrent à former les sous-tribus des Oulad-Daoud, des Oulad-Allouch, etc.
Les Maures actuels du Hodh sont donc, en somme, des Berbères arabisés plutôt que des Arabes. Il est bien certain en tout cas que l’élément arabe fut, dans leur formation, très inférieur[190] en nombre à l’élément berbère. Tout d’abord il importe de considérer que, lors de leur départ du Maroc pour la Mauritanie, les Beni-Hassân n’étaient plus des Arabes bien purs : Ibn-Khaldoun nous apprend en effet que, lors de leur premier établissement entre la Moulouya et le Tafilelt, les Beni-Makil (Beni-Hassân et Beni-Soleïm) s’étaient unis aux Berbères Zenata, installés avant eux dans cette région, et que, lorsqu’ils se portèrent vers le Sud après la conquête de Maghreb central par les Zenata, les Beni-Hassân soumirent les Berbères Guezoula de Taroudant et les Berbères Masmouda, Zenaga et Lemta du Sous, du Dara et du Tafilelt, et se les incorporèrent au moins en partie. Ensuite, il convient de remarquer que certaines sous-tribus actuelles du Hodh ne renferment que des gens d’origine berbère et ont gardé le qualificatif ethnique de Zenaga. D’autres, qui se prétendent d’origine arabe, sont beaucoup plus berbères qu’arabes : c’est en particulier le cas chez nombre d’Idao-Aïch. Enfin les familles maraboutiques se trouvent être presque toujours — quelles que soient les généalogies qu’elles se sont fabriquées après coup — ou uniquement berbères ou du moins surtout berbères quant à leur origine.
Si l’on ajoute à cela les infiltrations de sang noir qui se sont produites constamment chez les Berbères d’abord et chez les Beni-Hassân ensuite et les mélanges parfois considérables dûs à des unions avec des Peuls (chez les Guirganké[112] notamment et chez les Allouch), on comprendra combien il serait inexact de dire que les Maures du Hodh sont d’origine arabe.
D’autre part, s’ils ne sont d’origine arabe qu’à un degré infime, ils méritent cependant, dans leur ensemble, le qualificatif d’Arabes au même titre que les soi-disant Arabes de l’Algérie et du Maroc. Si en effet l’on en excepte les rares familles qui ont conservé[191] l’usage de la langue berbère[113], les Maures du Hodh ont presque tout pris aux Arabes : la langue, la religion et même le costume ; c’est en effet depuis l’immigration des Beni-Hassân que les Berbères de la Mauritanie et du Hodh ont cessé de porter le voile, tandis que leurs congénères non arabisés de l’Azaouad et du Sahara central l’ont conservé. Tout au plus, dans certaines des coutumes des Maures du Hodh, peut-on retrouver des survivances berbères encore très nettes, ainsi que dans la désignation des noms de lieux et dans les termes géographiques en usage[114].
Les Touareg des territoires civils du Haut-Sénégal-Niger se répartissent aujourd’hui, comme nous l’avons vu, en trois grandes tribus ou fractions. Dans l’ensemble, ils ont été formés par cinq grands courants d’immigration berbère, auxquels il faut ajouter quelques mélanges d’origine arabe, peul et songaï. Les cinq grandes immigrations berbères qui ont contribué à leur formation sont, par ordre probable de dates, celles des Lemta et Hoouara de Tripolitaine, des Messoufa, des Saghmâra ou Kel-Tadmekket, des Goddala et Lemtouna et des Oulmidden. D’une façon générale, de la première et de la dernière sont issues les sous-tribus oulmidden actuelles, de la troisième la tribu des Kel-Tadmekket et de la deuxième et de la quatrième la tribu des Iguellad et les sous-tribus qui s’y rattachent.
[192]1o Immigration lemta et hoouara. — Ainsi que je le disais plus haut, lors de l’époque reculée où les Berbères commencèrent à s’enfoncer dans le Sahara, les Lemta allèrent s’établir à l’Ouest de l’Aïr, où nous les retrouvons encore de nos jours sous le nom d’Oulmidden qui semble bien provenir du même radical que le mot Lemta employé par les auteurs arabes. Ces Lemta provenaient au moins en partie de la Tripolitaine actuelle, où ils avaient laissé nombre de leurs compatriotes ainsi qu’au Touat et dans le Sud marocain. Une fraction des Lemta demeurés dans le Nord, de religion chrétienne très probablement, fuyant la première conquête arabe de l’Ifrîkia, quitta vers 670 la Tripolitaine avec un grand nombre de Hoouara (autre tribu berbère à demi christianisée et établie alors dans les mêmes parages). Les Hoouara s’installèrent principalement dans la région montagneuse du Sahara central et devinrent les Hoggar. Quant aux Lemta, accompagnés sans doute de quelques familles hoouara, ils allèrent rejoindre les membres de leur tribu déjà installés plus au Sud.
Ceux-ci, qui très probablement étaient demeurés fidèles à l’ancienne religion libyenne, regardèrent d’un assez mauvais œil ces nouveaux arrivants chrétiens, craignant surtout d’ailleurs de se voir disputer par eux la maigre chère qu’ils arrivaient péniblement à se procurer. Les derniers immigrés, ainsi mal reçus par leurs compatriotes, continuèrent leur mouvement plus avant et arrivèrent enfin, dans un état assez misérable, sur les rives du Niger, dans le lieu où s’élevait alors le village songaï de Gounguia ou Koukia, peuplé surtout de Sorko pêcheurs. Ce village — je le crois du moins — devait être situé dans l’île aujourd’hui connue sous le nom de Bentia, entre Gao et Tillabéry[115].
Mieux accueillis par les Sorko qu’ils ne l’avaient été par leurs propres compatriotes, les Lemta de Tripolitaine parvinrent[193] même à s’imposer aux indigènes riverains du Niger et — non sans luttes, comme nous le verrons plus loin — à fonder, vers la fin du VIIe siècle, un empire qui devait plus tard devenir puissant et dont ils demeurèrent les maîtres jusque vers la fin du XVe siècle[116]. Tout naturellement, ils ne demeurèrent pas fixés à Koukia et, tout en y maintenant au moins provisoirement la capitale de leur empire, ils se répandirent dans l’Est de la Boucle du Niger, où ils demeurèrent lorsque la suprématie leur fut enlevée par les Noirs (Songaï dirigés par des Soninké) en 1493 et que, de suzerains de ces derniers, ils devinrent leurs vassaux. Encore chrétiens au moment de leur arrivée à Koukia, ils commencèrent à embrasser l’islamisme vers l’an 1009 de notre ère, sous le règne de leur quinzième empereur, Dia Kossoï.
2o Immigration messoufa. — Vers le début du VIIIe siècle, à la suite sans doute des premières conquêtes arabes dans le Maghreb, des Messoufa établis au Sud du Maroc dans la région de Tindouf se portèrent vers le midi et s’emparèrent des mines de sel de Teghazza. Dépossédés vers le IXe siècle par les Bérabich, comme nous l’avons vu précédemment, ils devinrent les vassaux de ces derniers ; les uns demeurèrent à Teghazza, d’autres accompagnèrent les Bérabich dans leurs randonnées à travers le désert ou se firent comme eux convoyeurs de caravanes. Il est possible que les Messoufa n’aient pas attendu la venue des Bérabich pour pousser jusque dans la région de Tombouctou ; en tout cas, les Berbères Maddassa, signalés au XIe siècle par Bekri comme habitant la rive Nord du lac Faguibine et du Niger, et qui étaient déjà musulmans à cette époque, étaient très vraisemblablement une fraction des Messoufa.
3o Immigration saghmâra ou des Kel-Tadmekket. — Dans la vallée du Tilemsi, à 300 kilomètres environ au Nord-Nord-Est de Gao, les Berbères émigrés les premiers dans le Sahara avaient fondé, sans doute avant la naissance de J.-C., une ville[194] qu’ils appelaient Tadmekket[117] et que, bien plus tard, les Arabes dénommèrent Es-souk (le marché) parce qu’elle était le seul centre commercial de tout le Sahara central et le rendez-vous des caravanes allant de la Tripolitaine et du Touat vers les pays nigériens. Ce point semble avoir été florissant, si toutefois une telle épithète a jamais pu s’appliquer à une ville saharienne ; mais tout est relatif et ce qui serait une vulgaire bourgade en un pays fertile et peuplé revêt facilement au désert les allures d’une brillante métropole. Il est possible d’ailleurs que les premiers colons berbères du Tilemsi aient su mettre à profit les terres de cette vallée et que Tadmekket ait été autrefois une oasis prospère.
Quoi qu’il en soit, elle eut un grand renom et, dès les premiers siècles de l’hégire, elle attira des musulmans de l’Ifrîkia[118], berbères sans doute comme ses fondateurs, qui vinrent y prêcher l’islam et constituèrent la fraction maraboutique connue aujourd’hui sous le nom d’Iforhass, tandis que l’ensemble des populations berbères gravitant autour de Tadmekket portait le nom de Saghmâra.
Les Oulmidden nomades, qui plantaient leurs tentes entre Tadmekket et l’Aïr et qui devaient avoir la même origine première que les Saghmâra — les uns et les autres étaient vraisemblablement des Lemta, au moins en majorité —, attaquèrent à maintes reprises les populations de Tadmekket, pour des raisons qui ne nous apparaissent pas très clairement, mais dont la principale fut sans doute la cupidité. Dès le Xe siècle au moins, ils avaient contraint une partie des familles maraboutiques à se retrancher dans la région de collines pierreuses que nous appelons l’Adrar des Iforhass et une partie des[195] Saghmâra à descendre la vallée du Tilemsi, avec l’espoir de retrouver sur les bords du Niger d’autres terres favorables. Les Saghmâra, se heurtant du côté de Bourem aux Oulmidden de la région de Gao, obliquèrent vers l’Ouest, atteignirent le fleuve près de Bamba et se répandirent sur ses deux rives, occupant surtout la rive droite depuis la hauteur de Bamba jusqu’aux lacs situés au Sud de Tombouctou. Les Touareg Iguellad, quand ils vinrent se fixer dans cette région, leur donnèrent le nom de Kel-Tadmekket (gens de Tadmekket) en raison de leur origine ; on les appela aussi Kel-es-souk, ce qui revient au même, mais on réserva de préférence cette dernière appellation à la fraction maraboutique qui avait suivi l’exode des Saghmâra au lieu de s’établir avec les autres familles religieuses dans l’Adrar des Iforhass.
Bekri signale au XIe siècle la présence de Kel-Tadmekket (sous le nom de Saghmâra) sur la rive droite du Niger, en face de Gao : leur exode fut donc bien antérieur à la destruction de la ville de Tadmekket par les Oulmidden, destruction qui aurait eu lieu vers 1640. Mais il semble établi d’autre part que la ruine finale de Tadmekket eut comme conséquence une nouvelle immigration saghmâra sur les rives du Niger, vers le milieu du XVIIe siècle.
4o Immigration goddala et lemtouna. — J’ai dit tout à l’heure, en retraçant les origines des Maures du Hodh, comment, vers le XIe siècle, un certain nombre de Lemtouna et surtout de Goddala, venant de l’Adrar Mauritanien, s’étaient avancés jusque vers Tombouctou. Ils échappèrent là à la conquête arabe des Beni-Hassân qui, vers la fin du XVIe siècle, subjugua leurs compatriotes demeurés dans le Hodh. Ils furent bien rejoints à la fin du XIe siècle par l’immigration arabe des Bérabich et au XVe par celle des Kounta et il y eut alors entre eux et les Arabes des mélanges dont le résultat est sensible encore, dans la tribu maraboutique des Kel-Antassar[119] principalement. Mais[196] il n’y eut pas là, comme dans le Hodh, conquête de la part des Arabes ; les Goddala et les Lemtouna des lacs et de l’Azaouad, devenus les Iguellad, ne furent pas arabisés et conservèrent leur langue et leur voile, adoptant seulement la religion musulmane que leur prêchèrent les Kel-Tadmekket et plus tard les Kounta.
5o Immigration oulmidden. — C’est aux Lemta établis au Sahara avant l’arrivée de ceux qui, après les avoir rejoints, poussèrent jusqu’à Koukia que je donne de préférence ici, pour les distinguer de ces derniers, le nom d’Oulmidden.
On peut supposer que, lorsqu’ils eurent constaté le degré de prospérité des Lemta de Gounguia ou Koukia, les Oulmidden demeurés au Sahara cherchèrent à renouer avec eux des relations. Les rôles étaient changés : d’hôtes encombrants et de bouches inutiles, les anciens immigrés de Tripolitaine étaient devenus des puissants dont la force était à craindre et l’alliance à rechercher. Aussi les Oulmidden ne se firent-ils pas faute sans doute d’aller les saluer et même de reconnaître leur suzeraineté, moyennant quoi ils obtinrent le droit de prélever leur part des moissons que faisaient pousser les Songaï le long du Niger. Mais il ne semble pas qu’ils aient franchi le fleuve ni pénétré dans les territoires relevant actuellement de la colonie civile du Haut-Sénégal-Niger durant l’époque de l’hégémonie berbère en pays songaï.
C’est seulement à la fin du XVe siècle, lorsque l’empire lemta de Gounguia puis de Gao fut remplacé par l’empire soninké-songaï de Gao et que cette dernière ville fut devenue à la fois un grand marché et un centre musulman important, que les Oulmidden, attirés davantage encore vers le Niger, commencèrent à franchir le fleuve et à se fixer en partie à l’intérieur de la Boucle, dans la direction de Gao à Hombori, auprès des familles venues précédemment de Gounguia. C’est à cette époque également que les Oulmidden de la région de Gao durent embrasser l’islamisme, déjà professé par les autres Touareg de la vallée nigérienne.
6o Eléments divers. — Tels sont les éléments principaux,[197] tous berbères, qui contribuèrent à former la partie du peuple touareg occupant de nos jours le Nord de la Boucle du Niger et la rive gauche de ce fleuve dans la région comprise entre Ras-el-ma et Bourem. En outre existent quelques éléments secondaires, dont l’importance du reste ne paraît pas très considérable et qui n’ont pas modifié profondément le type berbère initial.
Tout d’abord il semble probable que le pays actuel des Touareg du Haut-Sénégal-Niger, si l’on en excepte les rives mêmes du fleuve, était à peu près inhabité lorsque s’y montrèrent les premières immigrations berbères. Même sur le Niger, les Songaï ne devaient pas alors s’avancer bien en amont de Gao ; peut-être ne dépassaient-ils pas Bourem ; cependant il est hors de doute que, vassaux des Lemta d’abord, suzerains ensuite de tous les Touareg nigériens, ils ont dû se mêler à eux dans d’assez fortes proportions. Plus tard, les Peuls qui vinrent se fixer dans les régions de Hombori et de Dori apportèrent, au moins sur la lisière de leurs établissements, un élément de métissage qu’on aurait tort de négliger. Dans la région de Tombouctou, des unions eurent lieu certainement entre Arabes et Touareg, mais, les Arabes étant les moins nombreux, ce sont eux qui durent être le plus influencés par ces unions. Quant aux Marocains qui conquirent Tombouctou à la fin du XVIe siècle, c’est surtout sur les Songaï que leur influence se fit sentir, comme nous le verrons dans un instant[120].
1o Le problème de l’origine des Peuls.
La question de l’origine des Peuls a fourni matière à d’amples discussions et cependant elle est loin d’être résolue. Il y a là un problème à plusieurs faces qui demande, pour être traité avec quelque précision, d’être examiné à la fois sous ses divers aspects. Personne ne conteste qu’une bonne partie tout au moins du peuple peul actuel n’appartient pas originairement à la race noire : il suffit pour en être convaincu d’observer les Peuls pasteurs que l’on rencontre un peu partout dans le Soudan et chez lesquels, à côté d’individus manifestement métissés de sang nègre, on remarque des gens dont la couleur et le facies rappellent absolument la couleur et le facies des Bédouins de l’Egypte et surtout de la Palestine. A côté de cela, la langue peule est parlée par un nombre considérable d’individus qui sont, tout aussi incontestablement, des Nègres bien caractérisés.
De là les deux théories dont l’une fait des Peuls un peuple de métis, tandis que l’autre en fait un ensemble de gens, les uns de race blanche, les autres de race noire, n’ayant de commun que la langue. Mais ici encore, il y a divergence d’opinion : les uns veulent que la langue peule ait été la langue originelle de l’élément de race blanche, les autres pensent que ce dernier l’a au contraire empruntée à l’élément de race noire.
Je dirai tout de suite que mon opinion, motivée par de longues et patientes recherches, penche vers la dernière hypothèse : à mon avis, la langue dite peule est une langue nègre, parlée à l’origine par un peuple nègre complètement différent des Peuls, peuple dont les représentants actuels ne sont autres que les Toucouleurs, et cette langue a été adoptée, à la suite de circonstances que je vais retracer, par un peuple de race[199] blanche et d’origine judéo-syrienne dont les représentants actuels sont les Foulbé ou Peuls proprement dits.
Pour être complet, il me faut ajouter qu’une longue cohabitation a produit entre les Toucouleurs et les Peuls des mélanges facilement perceptibles, de même que l’éparpillement des Peuls à travers d’immenses territoires peuplés de Nègres divers a profondément altéré le type sémitique originel des Foulbé. Enfin il ne faut pas oublier que ces derniers ont auprès d’eux de nombreux serfs nègres, les Rimaïbé, qui parlent comme leurs maîtres peuls la langue des Toucouleurs, sans être pour cela ni des Toucouleurs ni des Peuls.
Avant d’exposer les faits qui rendent mon hypothèse vraisemblable, il me paraît opportun de résumer et de discuter brièvement les principales des nombreuses théories émises par mes devanciers.
2o Théories diverses relatives à l’origine des Peuls.
Si l’on identifie les Peuls avec la tribu de Fouth ou Foudh mentionnée dans le Pentateuque et dans les écrits de plusieurs prophètes bibliques (Ezéchiel, Jérémie, Isaïe, Nahoum), tribu dont le nom est d’ailleurs écrit Foul par Isaïe [121], on doit reconnaître que ce peuple a été mentionné dès la plus haute antiquité. Je ne prétends pas que cette identification puisse être présentée comme une certitude, mais en tout cas elle n’est pas absurde. Si on l’admet, cela conduirait, semble-t-il, à attribuer aux Peuls une origine hamitique, puisque Fouth ou Foudh est donné comme l’un des fils de Ham, avec Chous (père des Ethiopiens Kouchites), Mesraïm (père des Egyptiens) et Chanaan[200] (père des Libyens ou Berbères)[122] ; mais il n’y a pas à s’appesantir sur cette indication, la Bible — comme les auteurs arabes — confondant souvent les descendants de Ham avec ceux de Sem[123].
Quoi qu’il en soit, les Prophètes Bibliques représentent constamment la tribu de Fouth, Foudh ou Foul comme voisinant avec les Ethiopiens, les Egyptiens et les Berbères. Ezéchiel dit que des Loudim (fraction issue des Mesraïm ou Egyptiens) et des Fouth servaient dans l’armée de Tyr (XXVII, 10) ; que la ruine de l’Egypte par Nabuchodonosor, roi de Babylone (588 av. J.-C.), entraînera celle de l’Ethiopie, du Fouth, du Loud, etc. (XXX, 5) ; que l’armée de « Gog » — sans doute Alexandre — renferme des Ethiopiens et des Fouth (XXXVIII, 5). Jérémie, parlant aussi de la défaite du pharaon Néchao (Néko I) par Nabuchodonosor, signale parmi les troupes égyptiennes des Ethiopiens, des Fouth armés de boucliers et des archers Loudim (XLVI, 9). Isaïe mentionne le peuple des Foul parmi les nations éloignées du côté du Sud et de l’Occident (LXVI, 19). Enfin Nahoum, dans sa prophétie contre Ninive (III, 9), demande à cette ville si elle se croit plus forte qu’Alexandrie, que n’a pas réussi à protéger l’appui des Ethiopiens, des Egyptiens, des Fouth et des Loubim (Libyens).
On pourrait conclure de là, sans trop de témérité, que les Hébreux considéraient les Fouth, Foudh ou Foul comme un peuple originaire de la Mésopotamie, de la Syrie ou de la Palestine, mais qui, après un long contact avec les Egyptiens et les Ethiopiens, avait élu domicile en Afrique vers le VIe siècle au moins avant J.-C., dans le voisinage de l’Egypte et non loin de la mer — puisqu’il fournissait des contingents aux armées de Tyr et à celle d’Alexandre —, probablement dans la Cyrénaïque.
Si maintenant nous recherchons la trace des Peuls sous leur nom actuel (Foulbé, Foulâni, etc.), nous ne la trouvons — je le[201] crois du moins — qu’à partir du XIVe siècle de notre ère. Makrizi (1364-1442) parle d’une ambassade envoyée vers l’an 1300 par l’empereur de Mali à celui du Bornou et qui comprenait deux personnages parlant le peul (foulânia). Un peu plus tard, vers le milieu du XVe siècle, Cadamosto mentionne la présence d’un roi des Peuls (rey dos Fullos) sur le Sénégal. Au siècle suivant, Joao de Barros nous parle également des Peuls, mais pas plus que Makrizi ni Cadamosto, il ne nous renseigne sur leur origine.
Le premier ouvrage qui parle un peu longuement des Peuls et dise au moins quelques mots de leur origine est, il me semble, le Tarikh-es-Soudân, qui fut écrit durant la première moitié du XVIIe siècle ; son auteur, Abderrahmân-es-Sa’di ou Saïdi, avait lui-même un peu de sang peul dans son ascendance, puisqu’il nous dit que son arrière-grand’mère s’appelait Aïchat-el-Foulânia et appartenait au clan peul des Sonfontir, qui doit vraisemblablement être identifié avec celui des Soumontara ou Dialloubé[124]. Il ne s’étend guère sur l’histoire des Peuls, sauf en ce qui concerne la famille régnante du Massina, qu’il fait venir du Sénégal, mais il semble les apparenter aux Ouolofs, disant que ces derniers sont bien supérieurs, par leur caractère et leurs mœurs, « aux autres Foulâni ». Sans doute il faut entendre simplement par là qu’il considérait les Ouolofs et les Peuls comme formant une seule nation, parce qu’il savait que les Peuls du Massina venaient du Fouta et que le Fouta touchait au pays des Ouolofs et avait fait partie de l’empire du Diolof.
Dans les premières années du XIXe siècle, Grey Jackson, consul anglais à Modagor, apprit des Marocains du Sous qu’une tribu d’Israélites habitait dans le Melli ou pays des Mandé. Bien que Jackson ne mentionne pas le nom de cette tribu, il semble bien que ses informateurs entendaient parler des Peuls[125].
Le sultan de Sokoto Mohammed-Bello-ben-Osmân, dans le[202] manuscrit qu’il remit en 1824 à l’explorateur Clapperton et dont il était l’auteur[126], signale les Peuls comme répandus dans le Songaï et le Mali et dit que le Toro et le Fouta sont peuplés d’autochtones (Toucouleurs) et de Sarankoli (Sarakolé, Soninké). D’après lui, les Peuls — ou tout au moins ceux du clan Tôrodo, auquel il appartenait lui-même, — descendent des Juifs, bien que certains les rattachent aux Chrétiens et d’autres aux Bambara. A mon avis, il conviendrait de traduire ici « Bambara » par « païens » : sans doute Bello a voulu dire que les Peuls descendent soit des Juifs, soit tout au moins d’une population étrangère au domaine de l’islam.
G. d’Eichthal[127] avait pensé trouver dans la Malaisie ou la Polynésie le berceau des Peuls, en se basant sur des affinités qu’il avait cru découvrir entre leur langue et le malais. Si je ne me trompe pas en supposant que la langue parlée aujourd’hui par les Peuls existait au Soudan avant qu’ils y aient fait leur première apparition, comme j’essaierai de le démontrer plus loin, la théorie de d’Eichthal ne prouverait plus rien quant à l’origine des Foulbé, en admettant même que des affinités existassent réellement entre la langue actuelle des Peuls et le malais : elle prouverait seulement l’origine océanienne de certaines langues nègres. Mais ces affinités elles-mêmes ne sont qu’apparentes : d’Eichthal s’est contenté de comparer quelques vocables, qu’il a souvent mal analysés, prenant des radicaux pour des affixes et vice versa. Si l’on étudie méthodiquement les[203] mots peuls qu’il cite, on n’en trouvera pas vingt dont la racine se rapproche réellement d’une racine malaise ou polynésienne correspondante ; la morphologie et la syntaxe des deux langues étant par ailleurs complètement différentes, on peut hardiment avancer qu’il s’agit là de pures coïncidences phonétiques, telles qu’on en pourrait trouver entre deux langues quelconques, prises au hasard parmi les plus dissemblables.
Barth semble supposer que les Peuls seraient venus du Sud marocain et du Touat vers Ghana et de là se seraient répandus au Soudan. Sa théorie se trouve à première vue confirmée par une légende recueillie en 1857 par C.-J. Reichardt et d’après laquelle les Peuls du Fouta-Diallon proviendraient de familles arabes venues de Fez[128] dans le Diaka ou Diaga (Massina), sous la conduite de deux chefs nommés Sidi et Séri ; ceux-ci auraient été accueillis dans le Diaka par un saint personnage nommé El-hadj Salihou Souaré, chef d’une tribu mandingue (ou plus exactement soninké, d’après son nom de clan : Souaré), lequel les aurait dirigés vers le Fouta-Diallon, où ils devinrent les ancêtres des deux familles des Sidianké et des Sérianké. Tout n’est pas à rejeter dans cette légende : l’arrivée des ancêtres des Peuls dans le Diaga déjà occupé par des Soninké, puis leur migration vers le Fouta Sénégalais et de là vers le Fouta-Diallon et ailleurs, sont des faits qui me paraissent bien près d’être historiquement établis. Mais en ce qui concerne l’origine marocaine et surtout l’origine arabe de ces ancêtres des Peuls, je ne puis que la considérer comme fort douteuse ; il n’est pas impossible que quelques familles dont sont issus des Peuls soient venues à Ghana du Maroc et il semble bien prouvé qu’il en est venu du Touat ; mais, à mon avis, ces familles n’étaient pas arabes et le Touat ne fut que l’une des étapes intermédiaires où s’arrêta momentanément une fraction détachée du grand mouvement d’immigration, lequel eut très probablement son point de départ en Syrie ou en Palestine[129].
[204]Parmi les théories sur l’origine des Peuls citées par le Dr Bérenger-Féraud, il me faut rappeler celle les faisant descendre des anciens Egyptiens, non pas tant à cause d’affinités anthropologiques qui restent d’ailleurs à démontrer, qu’à cause de la ressemblance de leur nom (Foulbé, Foulani, Foula, Fellata, etc., selon les idiomes) avec celui des Fellah de la moderne Egypte ; on sait que fellah en arabe veut dire « laboureur » et que ce terme est appliqué, par les citadins, dans tous les pays de langue arabe — mais pas plus en Egypte qu’en Algérie ou en Arabie —, aux gens que nous appellerions en français des « paysans »[130] : je n’ai pas besoin de souligner l’absurdité du rapprochement d’un nom de peuple soudanais avec le nom arabe d’une profession qui n’a rien de particulièrement égyptien et qui n’est aucunement une appellation ethnique, mais il me faut bien avouer que ce calembour inconscient a plus fait pour asseoir la théorie de l’origine égyptienne des Peuls que les travaux des anthropologistes.
Il faut ranger dans la même catégorie — la catégorie gaie — l’étymologie donnée par Bérenger-Féraud du mot Toucouleur, qu’il fait dériver sans hésitation de l’anglais two colours, sous prétexte que les Foutanké seraient issus d’un mélange de peuples de deux couleurs, de Blancs et de Noirs[131].
[205]Bérenger-Féraud cite encore — sans la partager d’ailleurs — l’opinion du Dr Thaly, d’après lequel les Peuls seraient des Indo-Européens ayant la même origine que nos Bohémiens ou Gipsies et qui, chassés de leur pays au XVe siècle par les Mongols, auraient pris la route de l’Egypte par la Syrie pour s’enfoncer plus tard dans le centre de l’Afrique : malheureusement pour cette théorie, la présence des Peuls au Soudan dès le début du XIVe siècle nous est affirmée par Makrizi et, dès le milieu du XVe, Cadamosto les a rencontrés solidement et depuis longtemps établis dans le bassin du Sénégal. Je crois pour ma part qu’il y avait déjà des Peuls sur le bas Sénégal vers le XIe siècle de notre ère au moins et peut-être auparavant ; en tout cas la langue qu’ils parlent actuellement, et que le Dr Thaly rapproche de la langue des Romanichels, était déjà parlée au Sénégal, par les Toucouleurs tout au moins, dès le XIe siècle, ainsi que le prouve un passage de Bekri nous décrivant les hippopotames de la région de Bakel sous le nom de gabou, donné, dit-il, à ces animaux par les indigènes du pays[132].
Le général Faidherbe s’est prononcé pour la théorie faisant venir les Peuls de l’Orient et amenant avec eux en Afrique le bœuf à bosse d’origine asiatique, mais en même temps il a signalé les affinités que présente leur langue avec plusieurs idiomes de l’extrême Ouest-africain et en particulier avec le sérère. Je crois que là, comme en beaucoup d’autres occasions, le général Faidherbe avait vu juste, et, s’il avait eu le temps ou les moyens d’approfondir davantage la question, il l’aurait sans doute résolue de la bonne manière. Sa théorie, si elle est incomplète, me paraît exacte, les Peuls provenant d’une immigration[206] asiatique qui, parvenue au Fouta Sénégalais, y prit la langue des Toucouleurs autochtones et la transporta ensuite, lors de sa contre-migration de l’Ouest vers l’Est, depuis le bas Sénégal jusqu’au bassin du haut Nil.
Grimal de Guiraudon s’est rendu ridicule par sa prétention, ses bizarreries et la grossièreté avec laquelle il a traité ses devanciers, même les plus illustres ; mais, sous ces dehors un peu fantasques, il n’en a pas moins été le premier qui ait vu clair dans la langue peule : son système est parfois mal étayé, il est incomplet, il renferme des inexactitudes, mais nous devons reconnaître toutefois que de Guiraudon a eu, à l’établir, un mérite incontestable. En ce qui concerne l’origine des Peuls, et bien qu’il se soit fondé sur des faits dont plusieurs sont erronés, il me paraît actuellement[133] avoir donné la bonne solution en penchant pour leur rattachement au peuple juif et leur immigration de la Palestine au Soudan par l’Egypte, et surtout en affirmant que les gens de langue peule ne forment pas un peuple de métis mais sont constitués par deux groupements ethniques bien distincts, l’un de race blanche (les Peuls proprement dits) et l’autre de race noire (les Toucouleurs).
Le professeur Verneau a attribué aux Peuls une origine sémitique ou hamito-sémitique ; sa conviction provient de la comparaison de quelques crânes peuls — dont l’origine d’ailleurs n’était que médiocrement sûre, au point de vue de l’ascendance de leurs propriétaires — avec des crânes éthiopiens.
Le Dr Lasnet, lui aussi, est partisan de l’origine sémitique des Peuls, et de même M. E.-D. Morel[134], qui combat la théorie[207] les rattachant aux Berbères ; il les fait descendre des Hyksos, cette nation de pasteurs venue d’Asie en Egypte et fortement « judaïsée », si elle n’était elle-même de souche israélite.
Pour compléter cette sorte de résumé des théories relatives à l’origine des Peuls, je dois dire un mot de l’opinion émise par divers auteurs — Barth entre autres —, d’après laquelle les Peuls seraient les Leucæthiopes ou Ethiopiens Blancs de Pline et de Ptolémée. Ce dernier les place, d’après Hannon, auprès du fleuve Stachir, qu’on a voulu identifier avec la Gambie, comme on a voulu identifier le Darados avec le Sénégal ; on a été conduit ainsi à supposer que, dès le VIe siècle avant J.-C. (époque probable du périple de Hannon), des Peuls de couleur claire — ou tout au moins des ancêtres des Peuls — se trouvaient déjà à proximité des régions du Ferlo, où ils sont encore nombreux de nos jours. Mais il convient de remarquer que, de même que le Darados de Ptolémée correspond vraisemblablement au Dara ou Draa et non au Sénégal, le Stachir doit correspondre à la Saguiet-el-Hamra ou à quelque rivière voisine du cap Bojador bien plutôt qu’à la Gambie. C’est d’ailleurs en plein Sahara, entre les Libyo-Egyptiens et les Ethiopiens Nigrites riverains du Nigris ou Niger, que Pline situe les Leucæthiopes ; le même auteur place à l’Ouest des Gétules Darates ou Gétules du Dara des tribus qu’il appelle Pharusii et Perorsi (peut-être les Phetrusim de la Genèse, ancêtres des Philistins), qu’il donne aussi comme « Ethiopiens » et qui étaient évidemment des Berbères et non des Peuls. Les anciens donnaient le nom d’Ethiopiens à tous les habitants du Sud de la Libye, aux nomades du Sahara méridional aussi bien qu’aux Nègres : seulement ils distinguaient les premiers des seconds par les épithètes de « blancs » et de « noirs ».
3o Les immigrations judéo-syriennes en Afrique.
A différentes époques, et depuis une antiquité fort reculée, il s’est produit de très importants mouvements d’émigration provenant de la Syrie et de la Palestine vers l’Egypte et les contrées africaines voisines. Les populations sémitiques qui se[208] sont ainsi transportées de l’Asie antérieure vers l’Afrique du Nord étaient en majorité de descendance israélite, mais non pas en totalité ; les Israélites eux-mêmes, si nous en croyons les traditions rapportées par le Pentateuque, étaient primitivement originaires de la partie de la Syrie voisine de l’Euphrate, patrie d’Abraham, de Rébecca mère d’Israël et des épouses de ce dernier, et ce ne serait qu’au retour de l’Egypte que les Hébreux se seraient définitivement établis dans la Palestine, après en avoir vaincu et chassé les premiers occupants ou Philistins, peuple hamitique issu de Chanaan dont les descendants émigrés au Maghreb seraient devenus les Libyens ou Berbères. C’est pour ces raisons que je préfère donner à ces diverses immigrations sémitiques, antérieures aux immigrations et invasions arabes du Yémen et du Hidjaz, l’épithète de « judéo-syriennes » plutôt que celle de « juives », laquelle serait de signification trop restreinte.
La première de ces immigrations judéo-syriennes dont le souvenir nous ait été transmis semble s’être accomplie durant le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Certains égyptologues la placent aux environs de l’an 3000, d’autres la croient beaucoup plus récente et la placent seulement vers l’an 2000 avant Jésus-Christ. Cette dernière estimation est la plus généralement adoptée.
La Genèse nous apprend que Joseph, l’un des fils d’Israël ou Jacob, ayant été vendu par ses frères à des marchands arabes, fut emmené par ceux-ci en Egypte[135] et revendu à Putiphar, qui commandait l’armée du pharaon. Devenu par la suite le confident et le ministre tout puissant du roi d’Egypte, Joseph fit venir auprès de lui son père, qui se rendit en Egypte avec ses autres fils, « toute sa race »[136] et tous ses troupeaux. Au bout de quelques générations, les Israélites émigrés en Egypte[209] étaient devenus fort nombreux ; une nouvelle dynastie ayant remplacé sur le trône des pharaons celle qui s’était montrée favorable à Joseph et à sa famille, les Egyptiens persécutèrent les Hébreux qui, sous la conduite de Moïse et 430 ans après la venue d’Israël[137] — soit vers 2570 ou 1570 selon la date que l’on adopte pour l’histoire de Joseph —, passèrent dans le Sinaï au nombre de plus de 600.000[138] sans compter les enfants ni le menu peuple et avec de nombreux troupeaux[139], et, de là, se rendirent en Palestine. La Bible ne mentionne pas que d’autres immigrés hébreux aient pris une autre direction ou soient demeurés en Egypte, mais il est vraisemblable que, si tel était leur nombre, Moïse ne dut pas pouvoir emmener avec lui tous les Israélites ; l’Exode l’insinue d’ailleurs en insistant sur les précautions qu’il dut prendre pour empêcher nombre d’Hébreux de demeurer ou de retourner en Egypte ; enfin on connaît la tradition relative aux « tribus égarées » d’Israël.
Quelle que soit la part de vérité que l’on doive accorder aux récits quelque peu merveilleux et légendaires de la Genèse et de l’Exode, il semble bien certain qu’il y eut à une époque fort ancienne une très considérable immigration judéo-syrienne en Egypte, que les Judéo-Syriens firent en ce pays un séjour prolongé, y acquirent une grande influence et finalement en furent expulsés à la faveur d’un réveil du sentiment nationaliste. Mais il semble difficile d’admettre que tous aient repris le chemin par lequel étaient venus leurs ancêtres et il est au contraire vraisemblable qu’un nombre appréciable d’entre eux se dispersa soit vers le Sud, du côté de l’Ethiopie, soit vers l’Ouest, du côté de la Cyrénaïque. Ces Judéo-Syriens demeurés en Afrique, n’ayant pas reçu les enseignements de Moïse, devaient pratiquer la religion d’Abraham, fortement imprégnée sans doute de croyances et de rites empruntés à la religion égyptienne.
Telles sont les indications que nous pouvons raisonnablement déduire des traditions juives. Les traditions égyptiennes nous[210] en fournissent d’autres dont le parallélisme étroit avec les premières ne fait que confirmer celles-ci : je veux parler des renseignements relatifs aux Hyksos. Presque tous les savants qui se sont occupés de la question des Hyksos penchent pour l’identification de leur invasion en Egypte avec l’immigration israélite, ou tout au moins pensent que cette dernière s’est produite à la faveur de l’arrivée au pouvoir des Hyksos, venus eux aussi de la Mésopotamie, de la Syrie et de la Palestine ; en sorte que l’immigration israélite et l’exode de Moïse ne seraient que des épisodes de l’invasion des Hyksos et de leur dispersion.
Les Hyksos envahirent l’Egypte vers la fin de la XIVe dynastie, c’est-à-dire vers la fin du premier empire thébain. S’étant emparés du pouvoir, ils formèrent les XVe, XVIe et XVIIe dynasties, et furent expulsés par la XVIIIe dynastie, qui constitua le second empire thébain. Lepsius donne comme dates probables de leur arrivée et de leur départ 2136 et 1626 avant Jésus-Christ ; d’autres reportent ces dates de mille ans en arrière : de toutes façons, ces dates correspondent singulièrement avec celles données par les commentateurs de la Bible pour l’arrivée d’Israël et le départ de Moïse (2000 et 1570 selon les uns, 3000 et 2570 selon les autres).
D’après l’historien égyptien Manéthon, les Hyksos — qui étaient, comme les Israélites, des pasteurs — seraient retournés en Asie, leur pays d’origine, lors de leur départ de l’Egypte. Mais, de même qu’il est permis de supposer qu’une partie des Israélites ne suivit pas Moïse, il est loisible également de penser que les Hyksos, d’abord persécutés par leurs vainqueurs thébains, puis laissés libres d’effectuer paisiblement leur retraite — d’après le témoignage de Manéthon —, ne prirent pas tous la même route, et que beaucoup se dispersèrent du côté de la Cyrénaïque ou de la haute Egypte.
Plus tard des Juifs de religion mosaïque auraient émigré au Yémen et de là en Abyssinie, sous le règne de Salomon (Xe siècle av. J.-C.) et auraient été les ancêtres des Falacha. Mais il ne semble pas que cette immigration se soit répandue à l’Ouest du Nil et elle n’offre que peu d’intérêt pour la question qui nous occupe. Il en est de même des immigrations phéniciennes qui[211] se produisirent dans l’Afrique du Nord à partir du XIIe siècle avant J.-C. et qui donnèrent naissance aux colonies puniques de la Tunisie (Sousse, Utique, Tunis, Carthage, Bizerte).
Mais vers 320 avant J.-C., à la suite de la prise de Jérusalem par Ptolémée Soter, de nombreux Juifs furent déportés en Cyrénaïque. Sans doute ils y trouvèrent, plus ou moins mélangés d’éléments berbères, les descendants, devenus nombreux et puissants, des fractions israélites ou hyksos venues d’Egypte longtemps auparavant, et il se forma là une population fort importante, d’origine judéo-syrienne dans son ensemble et pratiquant des religions diverses qui, toutes, devaient dériver plus ou moins du culte des Hébreux primitifs ou culte d’Abraham.
C’est à cette population que je crois pouvoir faire remonter l’origine ethnique des Peuls ou du moins de celles de leurs fractions qui n’ont pas été trop transformées par des unions avec des Noirs.
Avant de rechercher comment les Judéo-Syriens de la Cyrénaïque ont pu devenir les Peuls, je voudrais rapporter quelques traditions légendaires qui ont cours chez les Peuls eux-mêmes et qui viennent en partie légitimer mon hypothèse.
D’après toutes les traditions recueillies à diverses époques chez les Peuls des différentes régions du Soudan, les tribus foulbé échelonnées depuis le bas Sénégal et le Fouta-Diallon à l’Ouest jusqu’aux pays entre Tchad et Nil à l’Est déclarent à l’unanimité être venues du Fouta Sénégalais ou du Mali, c’est-à-dire des contrées situées entre l’Atlantique et le Haut-Niger. Mais toutes aussi prétendent que leurs ancêtres de l’Ouest provenaient eux-mêmes d’ancêtres antérieurs venus du Nord ou de l’Est et surtout du Nord-Est. L’immense majorité de ces traditions assigne à ces ancêtres primitifs, comme patrie d’origine, le pays de Sâm ou Châm, c’est-à-dire la Syrie considérée dans son acception la plus large[140]. De là, toujours d’après les traditions[212] indigènes, ils seraient venus d’abord dans le pays de Tôr (presqu’île du Sinaï)[141], puis du pays de Tôr dans celui de Missira (Egypte) et de l’Egypte dans le pays de Soritou (sans doute Sort ou Syrte, Cyrénaïque), d’où ils auraient, longtemps après, gagné le pays de Diaka, Diaga ou Dia (Massina occidental), où nous les retrouverons un peu plus loin.
Ceux des Peuls qui ont été profondément islamisés ont amalgamé à leurs traditions nationales des souvenirs provenant de l’histoire de l’islamisme. C’est ainsi que beaucoup prétendent que leurs premiers ancêtres se trouvaient encore au Sinaï après la mort de Mahomet lorsque, en 639, le khalife Omar-ben-el-Khattâb (634-644) envoya du Hidjaz, par la mer Rouge, une armée commandée par Amrou-ben-el-Assi, dans le but de convertir les Juifs et les infidèles du Sinaï et de l’Egypte. Amrou aurait débarqué au pays de Tôr (Sinaï) une partie de ses troupes, dirigée par un nommé Okba-ben-Yâsser ; ce dernier aurait converti à l’islamisme la majeure partie des Juifs du Sinaï, tandis que ceux qui refusèrent d’abjurer le mosaïsme auraient été massacrés. Lorsque Amrou, en revenant de son expédition en Egypte, s’arrêta au Sinaï pour se rendre compte des résultats obtenus par Okba, le roi de Tôr pria le général arabe de laisser dans le pays quelqu’un capable de compléter l’instruction religieuse des nouveaux convertis ; Amrou laissa donc Okba au Sinaï et reprit sa route vers Médine, où résidait le khalife Omar. Okba, demeuré ainsi dans le Sinaï, y épousa Tadiouma, fille du roi de Tôr, qui lui donna quatre enfants : trois filles (Daa ou Daadou, Ouoï et Noussou) et un garçon (Raabou ou Raarabou). De Daa serait issu le clan des Dialloubé, de Ouoï celui[213] des Bari ou Daébé, de Noussou celui des Sô ou Férobé et de Raabou celui des Ba ou Ourourbé. C’est ainsi que, d’après les traditions islamisées, les quatre principaux clans peuls descendraient d’une juive du Sinaï et de Okba fils de Yâsser fils de Maadj fils de Maghits fils d’un Foulâni (c’est-à-dire d’un Peul ou Proto-peul) fils de Selîm fils de Saïd fils de Maad fils de Adnân, lequel était issu d’Abraham par Ismaël et qui, par un autre de ses petits-fils (Nizar, frère de Saïd), fut l’ancêtre de Koreïch et de Mahomet[142].
L’interpolation d’origine islamique est visible : les Peuls musulmans ont voulu à toute force rattacher la généalogie de[214] leurs ancêtres à la famille du Prophète et il a fallu pour cela supposer que ces ancêtres étaient encore au Sinaï postérieurement à l’hégire et qu’une de leurs filles y épousa un Arabe dans l’ascendance duquel on a d’ailleurs introduit un Foulâni, afin sans doute de rendre plus certaine la parenté des Peuls avec les Koreïchites. Mais il est bien probable que, lors de l’expédition de Amrou, les ancêtres Judéo-Syriens des Peuls étaient déjà bien loin du Sinaï et devaient être sur le point d’arriver au Fouta Sénégalais, où dut effectivement se produire, un peu plus tard, la naissance des tribus, clans et castes qui existent encore aujourd’hui.
Mais, chez ceux des Peuls qui n’ont été que peu touchés par l’influence islamique et surtout chez ceux qui lui ont totalement échappé, la légende nationale se présente sous un autre aspect et doit s’éloigner moins de la vérité. En voici un échantillon, qui résume diverses traditions recueillies auprès de Peuls du Sahel.
Les premiers ancêtres des Peuls auraient été Yakouba (Jacob), fils d’Issiraïla (Israël)[143] fils d’Issihaka (Isaac) fils d’Ibrahima (Abraham), et un nommé Souleïman. Le premier, parti du pays de Kénana (Chanaan), serait venu par le Tôr (Sinaï) dans le pays de Missira (Egypte), où régnait alors son fils Youssoufou (Joseph) ; celui-ci, venu précédemment en Egypte, avait épousé la fille du roi du pays et lui avait succédé sur le trône. Le second ancêtre, Souleïmân, était venu du pays de Sâm (Syrie) en même temps que Joseph et s’était établi auprès de lui.
Les enfants de Jacob, ainsi que ceux de Souleïmân, auraient formé la souche d’où devait sortir plus tard le peuple peul. On confondit les uns et les autres sous le nom de Banissiraïla (Béni-Israël, Israélites). Après la mort de Joseph[144], les Egyptiens voulurent secouer le joug des Banissiraïla et confièrent le sceptre à un homme du pays nommé Firaouma (Pharaon).[215] Ce dernier, jaloux du nombre, de la puissance et de la richesse en troupeaux des Banissiraïla, les accabla d’impôts de toutes sortes ; les Israélites — ou plutôt les Judéo-Syriens — s’enfuirent alors de l’Egypte. Une partie d’entre eux regagna le Kénana (Chanaan, Palestine) et le Sâm (Syrie) sous la conduite d’un chef nommé Moussa (Moïse). Les autres franchirent le Nil sous la conduite d’un descendant de Joseph et d’un descendant de Souleïmân, se dirigeant vers le soleil couchant. Firaouma les poursuivit, mais, comme il traversait le Nil, la pirogue qui le portait chavira et il se noya ; ses guerriers abandonnèrent alors la poursuite des Judéo-Syriens qui, avec leurs troupeaux, vinrent se fixer dans le pays de Soritou (Cyrénaïque)[145] et prirent dès ce moment, « en souvenir de leur fuite », le nom de Foudh ou Fouth[146].
Plus tard, une fraction d’entre eux, prenant la route du Sud-Ouest, se rendit au Touat ; mais une autre fraction se dirigea vers le Sud et gagna le Bornou (ou plutôt l’Aïr, comme nous le verrons plus loin), sous la conduite de deux chefs nommés Gadia et Gaye, descendant le premier d’Israël et le second de Souleïmân. Kara ou Karaké, fils et successeur de Gadia, et Gama, fils et successeur de Gaye, menèrent leurs compatriotes du Bornou au Diaga ou Massina, où ils furent accueillis favorablement par les Sébé (Soninké)[147].
[216]4o Formation du peuple peul.
Nous avons vu comment des colonies judéo-syriennes fort importantes s’étaient formées en Cyrénaïque, tant lors de la période de Moïse et des Hyksos — les Foudh, parlant vraisemblablement la langue égyptienne ou tout au moins une langue sémitique fortement imprégnée d’égyptien[148] — que vers la fin du IVe siècle avant J.-C. Cette population professait sans doute en partie la religion d’Abraham et en partie la foi mosaïque.
L’an 40 de notre ère, saint Marc, qui était lui-même un Juif de Cyrénaïque, vint évangéliser sa patrie et fut le premier à prêcher le christianisme en Afrique. Il fit un certain nombre de prosélytes parmi ses compatriotes ; mais par contre, au contact de la nouvelle doctrine, la ferveur religieuse redoubla chez les Juifs demeurés fidèles à la religion de leurs ancêtres et de vieilles haines, jusque-là assoupies, se réveillèrent entre pré-mosaïstes, mosaïstes et orthodoxes. Des prêtres juifs imaginèrent d’unifier les différents cultes et prêchèrent une sorte de réforme du judaïsme, cherchant à le ramener à sa pureté primitive. Des guerres intestines s’ensuivirent ; Rome, que le christianisme n’effrayait pas encore, prit ombrage des Juifs réformés et, tant en raison des persécutions dont ils eurent à souffrir de la part des autorités impériales que de l’espèce de réprobation dont ils furent l’objet de la part de leurs compatriotes, ces partisans d’un retour aux anciennes doctrines — qui n’étaient autres sans[217] doute que les Foudh pré-mosaïstes venus d’Egypte lors de la dispersion des Hyksos — commencèrent vers l’an 80 à émigrer vers le Sud.
A cette époque, un officier romain, Julius Maternus, sur l’ordre de l’empereur Domitien, partait à la recherche des fameuses mines d’or du Soudan ; guidé par des Berbères du Djerma ou Fezzân (Garamantes), que Cornélius Balbus avait soumis soixante ans auparavant, il s’enfonça au Sud de la Tripolitaine ; après un voyage fort long et fort pénible, et sans avoir rien rencontré qui ressemblât à une mine d’or, il atteignit un pays où il vit des rhinocéros et dont le nom nous a été transmis par les historiens latins sous la forme Agisymba, puis il revint à la côte. On a pensé, non sans raison, que ce pays devait être l’Aïr et qu’Agisymba correspondait à Asben ou à Agadès.
Selon toute vraisemblance, c’est cette route que suivirent les Foudh ou Judéo-Syriens pré-mosaïstes, soit que leur exode ait devancé de quelques mois l’expédition de Julius Maternus et que ce dernier ait marché sur leurs traces, soit que, l’ayant rencontrée dans la Phazanie, ils aient profité de l’appareil guerrier de cette expédition pour accomplir leur migration en toute sécurité. Quoi qu’il en soit, ils atteignirent sûrement l’Aïr, mais il est peu probable qu’ils aient poussé plus au Sud, et c’est sans doute l’Aïr qui est désigné sous le nom de Bornou dans la légende que j’ai rapportée plus haut[149]. Dans l’Aïr, où ils durent séjourner un certain temps, ils recueillirent sur l’emplacement des fameuses mines d’or du Soudan, ou tout au moins sur les pays où en parvenait le produit, des renseignements plus précis que ceux que possédait Julius Maternus, et continuant, peut-être inconsciemment, la route que celui-ci n’avait fait qu’ébaucher, ils arrivèrent, par Takedda et Tadmekket, aux bords du Niger, dans la région comprise entre Tombouctou — qui n’existait pas encore — et Dia ou Diaga — qui existait déjà au moins en tant que province.
[218]Sans doute ils étaient demeurés par dessus tout les pasteurs par excellence qu’avaient été leurs ancêtres Israélites et traînaient avec eux des troupeaux ; après avoir traversé le Sahara, ils ne pouvaient manquer d’être frappés de l’abondance des pâturages du Massina et, considérant cette région comme la terre éternellement promise à leur mysticisme traditionaliste, ils s’y installèrent. Le pays était habité par des agriculteurs soninké et des pêcheurs bozo, mais le bétail devait y être rare, et les autochtones durent, au moins tout d’abord, faire bon visage à ces pasteurs blancs, d’origine mystérieuse, qui vivaient surtout de laitage, ne semblaient pas nourrir des desseins de conquête et apportaient avec eux un élément de richesse considérable.
L’histoire de Joseph en Egypte recommença sur les bords du Niger, dans de moindres proportions il est vrai. Au bout de peu de temps, les Judéo-Syriens devinrent les conseillers, puis les maîtres des Soninké du Massina, jusqu’à ce que ces derniers, fatigués d’une tutelle qui, à la longue, leur semblait lourde, voulurent prendre leur revanche en dépossédant ces étrangers devenus plus riches que les autochtones, sans s’apercevoir qu’en faisant cela ils tuaient la poule aux œufs d’or. Ce qui était arrivé au temps de Moïse arriva de nouveau : les Judéo-Syriens, qui n’en étaient pas à un exode près, s’éloignèrent des bords du Niger, protégés dans leur migration par un patriarche soninké qui est devenu, dans les légendes modernisées, le religieux musulman El-hadj Salihou Souaré. Gagnant des régions plus désertes mais qui leur devaient être par cela même moins inhospitalières, ils se dirigèrent vers l’extrémité septentrionale du Bagana, du côté de Néma, où sans doute des Soninké avaient fait depuis longtemps déjà des essais clairsemés de colonisation, et s’établirent dans l’Aoukar, vers le milieu du IIe siècle de notre ère. Des Berbères devaient nomadiser dès cette époque dans la région, mais sans doute leur point d’attache était plus à l’Ouest — au Nord-Ouest plutôt —, dans l’Adrar Mauritanien.
Les Foudh devaient être rejoints bientôt dans le Nord du Bagana par un autre groupe de Judéo-Syriens de la Cyrénaïque, venu par une route différente. Le départ des pré-mosaïstes n’avait pas en effet apporté une solution suffisante à la question[219] religieuse ; si le christianisme ne faisait encore que des progrès assez lents en Cyrénaïque et ne se montrait pas hostile aux pouvoirs établis, il n’en était pas de même des différentes sectes judaïques. Celles-ci finirent par mettre un terme à leurs querelles intestines et à s’unir dans une commune haine des Romains. En l’an 115 une révolte générale de toutes les communautés judéo-syriennes menaça gravement l’autorité romaine en Cyrénaïque ; les représentants de l’empereur durent mobiliser toutes leurs troupes et faire appel aux populations berbères pour combattre la rébellion, qui dura deux années entières. Enfin en 117 les Judéo-Syriens, définitivement vaincus par les Romains, émigrèrent en masse, cette fois, au nombre de plusieurs milliers.
Parvenus dans le Sud de la Tripolitaine, ils ne prirent pas comme leurs devanciers la route de l’Aïr, mais, longeant la lisière nord du Sahara, ils se portèrent vers les oasis du Touat. Un grand nombre d’entre eux y demeura[150]. D’autres poussèrent plus loin vers l’Ouest et allèrent fonder, dans le Sud du Maroc, des colonies qui subsistent encore de nos jours. D’autres enfin, et non des moins nombreux, s’en furent rejoindre dans l’Aoukar leurs compatriotes venus là par l’Aïr et le Massina. Ceux-ci oublièrent facilement les querelles religieuses de jadis dans la joie de voir leur arriver ce nouvel élément de force et de richesse ; les nouveaux-venus s’incorporèrent à la fraction déjà installée et tous ensemble formèrent une communauté unique.
Et c’est ainsi, je crois, que, vers la fin du IIe siècle de notre[220] ère, se constitua dans l’Aoukar, au Nord du Bagana, une colonie surtout pastorale de Foudh ou Judéo-Syriens, de religion hébraïque au sens large du mot, d’où devait sortir, un siècle plus tard environ, l’empire de Ghana.
Vers la fin du VIIIe siècle, les Soninké du Diaga ou Massina, attirés par la prospérité qu’avaient acquises leurs colonies de l’Aoukar et notamment Ghana, sous la suzeraineté des Judéo-Syriens, s’y portèrent en masse et dépossédèrent ces derniers de la suprématie politique. Ce fut pour les Foudh le signal d’une nouvelle dispersion et d’un nouvel exode.
Certains d’entre eux, cependant, acceptèrent la domination soninké et demeurèrent dans le pays ; ceux-ci appartenaient surtout à des familles provenant de la première immigration ; ils s’étaient unis à des Soninké durant leur séjour dans le Massina et aussi depuis leur installation dans l’Aoukar et il était assez naturel qu’ils tinssent à demeurer auprès de leurs parents par alliance. Ce sont les descendants de ces Judéo-Syriens, plus ou moins métissés de Soninké, que l’on appela les Massîn ou Ahl-Massina, en souvenir de leur séjour au Massina avant leur arrivée à Ghana ; on les rencontre encore aujourd’hui à Oualata et à Néma ; ils ont adopté la langue arabe et, à cause de cela, on les rattache aux Maures.
Quelques familles de Judéo-Syriens Massîn, accompagnées de Soninké de Ghana, se portèrent vers l’Ouest et allèrent fonder Chétou, dont le nom fut transformé plus tard en Tichit par les Berbères. La tradition rapporte que leur chef était un vieillard aveugle ; Dieu lui avait promis en songe de le conduire dans un pays qu’il lui destinait comme nouvelle patrie et que le vieillard reconnaîtrait à une odeur spéciale émanant du sol ; tous les jours, en arrivant à l’étape, l’aveugle se faisait apporter une poignée de sable et l’approchait de ses narines ; enfin, arrivé à l’endroit où se trouve aujourd’hui Tichit, il reconnut le parfum indicateur et choisit ce lieu pour y installer sa résidence et celle de ses compagnons. Plus tard, des Massîn de Tichit émigrèrent dans le Tagant ; attaqués là par des Berbères, ils furent en partie massacrés ; les survivants se réfugièrent à Diara, près de Nioro, et enfin à Akor, près de Goumbou,[221] et devinrent les Guirganké actuels, qui ont adopté la langue arabe — comme d’ailleurs les Massîn demeurés à Tichit — et qu’on range pour cela parmi les Maures.
Quant aux Judéo-Syriens qui s’étaient conservés à peu près purs de tout mélange avec les Soninké, ils ne consentirent pas à accepter le joug de ces derniers. Les uns émigrèrent vers l’Ouest et, devançant sans doute la fondation de Tichit par leurs cousins les Massîn, se portèrent dans le Tagant et dans l’Adrar Mauritanien[151]. D’autres demeurèrent dans l’Aoukar, mais sans se mêler aux Soninké, et constituèrent une petite peuplade indépendante que Bekri nous a signalée au XIe siècle sous le nom de Honeïhîn ou Nehîn ou Honimîn[152] et qui se rencontre encore dans la région de Oualata et en quelques autres points sous le nom de Nimadi[153].
Enfin le plus grand nombre des Judéo-Syriens de Ghana, emmenant avec eux leurs troupeaux de bœufs à bosse, de moutons et de chèvres, se portèrent sur la rive Nord du Sénégal, dans la province de Mauritanie qui constitue aujourd’hui le cercle du Gorgol et qui alors — fin du VIIIe siècle — formait une[222] dépendance de l’empire toucouleur de Tekrour. Cette importante migration n’eut pas lieu sans doute d’un seul coup et l’exode des Judéo-Syriens dut s’accomplir selon plusieurs itinéraires : certaines familles paraissent être arrivées au Gorgol en passant par le Tagant, d’autres s’y rendirent par le Bakounou[154], le Diafounou, le Diomboko et le Guidimaka[155].
Ce second groupe, arrivé dans le Diomboko ou sur la lisière du Diomboko et du Guidimaka (au Nord et non loin de Kayes), s’arrêta et demeura là un certain temps. Mais il y fut attaqué par l’armée d’un chef mandingue qui voulait s’emparer des troupeaux des émigrants ; un grand nombre de ceux-ci périrent dans la bataille et le chef de l’émigration fut parmi les morts. Lorsque les Mandingues se furent retirés avec leur butin, les Judéo-Syriens ne purent s’entendre pour l’élection d’un nouveau chef et se séparèrent en deux fractions. L’une d’elles demeura dans le Diomboko. L’autre fraction, commandée par un chef que la tradition appelle Mahmoud, traversa le Guidimaka et alla dans le Gorgol se mettre sous la protection du groupe principal d’émigrants, à la tête duquel se trouvait un chef nommé Ismaïl[156].
[223]Celui-ci avait su gagner les bonnes grâces de l’empereur de Tekrour, qui résidait alors à Guédé, sur le marigot de Doué, un peu au Sud-Est de Podor, dans le Fouta Toro. Cet empereur appartenait au clan toucouleur des Sal.
Il invita Ismaïl et Mahmoud à venir s’installer auprès de lui, sur la rive Sud du Sénégal, avec leurs compagnons et leurs troupeaux. Cette arrivée des Judéo-Syriens au Fouta Toro dut s’accomplir vers le début du IXe siècle ou la fin du VIIIe.
Une fois de plus, nous allons voir se dérouler au Fouta, sous une forme et avec des conséquences nouvelles, l’éternelle histoire des Juifs d’Egypte. Ismaïl, devenu le confident et le ministre de l’empereur de Tekrour, épousa sa fille Diouma Sal[157] et, à la mort de son beau-père, il fut choisi comme souverain par les Toucouleurs. A sa mort, il fut remplacé par Mahmoud, et le trône du Tekrour fut ainsi occupé désormais par des membres des deux principales familles judéo-syriennes. Au bout de quelques générations, les immigrants sémites venus de Ghana s’étaient multipliés, sans cependant égaler en nombre les Toucouleurs autochtones, avec lesquels sans doute ils avaient contracté de fréquentes et fécondes unions. Aussi ne tardèrent-ils pas à abandonner leur langue — qui sans doute était, comme nous l’avons vu, soit l’égyptien soit plutôt un mélange d’égyptien et d’araméen ou de quelque dialecte hébraïco-syriaque soit encore le berbère — pour adopter la langue du Fouta, le poular[158]. Peut-être aussi leur religion se modifia-t-elle assez profondément, bien que ce soit moins sûr. D’autre part, ils restèrent fidèles à leurs mœurs et surtout à leur vie pastorale. Cependant, au contact et à l’imitation des Toucouleurs, ils[224] adoptèrent certaines institutions sociales de ces derniers, en particulier celle des clans et celle des castes ; et c’est vraisemblablement au Fouta Toro, alors qu’ils parlaient déjà la langue poular, qu’apparurent pour la première fois, chez les descendants des Judéo-Syriens de Cyrénaïque, ces quatre clans principaux dont la légende islamisée[159] place l’origine dans le Sinaï, au temps des premiers khalifes arabes. Ces clans furent calqués sur les clans toucouleurs qui avaient alors la prééminence : Sal — clan royal — devint Diallo, Ba devint Boli ou Bourouro (ou Bourourdo), Sô devint Pérédio, Bari devint Daédio[160]. Les artisans d’origine judéo-syrienne se partagèrent en castes à l’imitation des artisans toucouleurs et prirent les mêmes appellations : Laobé, Diawambé, etc.[161].
Les pasteurs venus de Ghana durent conserver le pouvoir au Tekrour jusque vers le début du XIe siècle, c’est-à-dire pendant 200 ans environ. Depuis longtemps, les Toucouleurs commençaient à supporter de mauvaise grâce la suzeraineté de ces étrangers et il dut y avoir plus d’une tentative de complot dirigée contre le souverain. La tradition nous rapporte comment les choses finirent par se gâter complètement.
| Delafosse | Planche VIII |

Cliché Fortier
Fig. 15. — Une famille Peule.

Cliché Froment
Fig. 16. — Groupe de femmes Peules et Silmimossi.
Le trône était occupé, vers le début du XIe siècle, par un descendant du Mahmoud venu au Fouta avec Ismaïl, descendant[225] qui portait le même nom que son ancêtre ; ce Mahmoud II, ayant découvert un complot tramé par des Toucouleurs contre sa vie, convoqua les chefs de toutes les familles indigènes du Toro et exigea que chacun lui remit en otage un de ses enfants mâles. Puis il confia ces enfants à la garde de l’un de ses frères, qui se trouvait être son héritier présomptif. Un devin dit à ce dernier que, si Mahmoud, touché par les plaintes des parents, leur rendait un jour les otages, lui, son frère, ne monterait jamais sur le trône. Pour empêcher Mahmoud de rendre les enfants à leurs parents, son frère usa d’un procédé aussi radical que barbare : il les fit tuer tous durant la nuit. Lorsque le jour parut, les pères des otages — ignorant encore ce qui s’était passé — allèrent trouver Mahmoud et le supplièrent de leur rendre leurs enfants, jurant que sa mansuétude lui porterait bonheur ; Mahmoud, se laissant apitoyer, envoya un messager à son frère pour lui réclamer les otages. Son frère lui fit répondre qu’il venait de les mettre à mort. Lorsque la nouvelle fut connue des chefs toucouleurs, ceux-ci la répandirent aussitôt dans le pays, en réclamant une vengeance sanglante : tous les indigènes du Fouta prirent les armes et coururent sus aux pasteurs judéo-syriens dispersés parmi eux, massacrant ceux qu’ils pouvaient atteindre et mettant les autres en fuite. Un Toucouleur nommé Ouâr Diabi, Ouâr Diâdié ou Ouâr Ndiaye s’empara du pouvoir. Mahmoud et tous les membres de sa famille furent tués. Ses serviteurs tentèrent de s’emparer du sabre qu’il portait et qui était l’insigne du commandement des souverains du Tekrour ; mais la famille de Ouar Diâbi le leur arracha et eut ainsi désormais le privilège de fournir l’empereur : ce fut le clan toucouleur des Koliabé. Quant au fourreau, il resta entre les mains d’un autre clan toucouleur qui devait plus tard s’emparer du pouvoir, celui des Dénianké.
Quant aux Judéo-Syriens qui échappèrent au massacre — et qui d’ailleurs étaient certainement très nombreux —, ils furent obligés de quitter le Toro et, ne pouvant s’entendre pour le choix d’un chef unique en remplacement de Mahmoud, ils s’éparpillèrent dans toutes les provinces du Tekrour, sous la conduite de divers ardo ou chefs de migration. Leur ancien nom[226] de Foudh, soumis aux règles de la langue poular qu’ils avaient adoptée, devint — selon les lois phonétiques et morphologiques de cette langue — Poullo au singulier et Foulbé au pluriel et prit la signification d’« éparpillés », son étymologie première étant inconnue des Toucouleurs ; le poular parlé par les Foulbé devint, conformément aux mêmes lois, le foulfouldé.
Les Judéo-Syriens étaient devenus les Peuls.
La fin de leur suprématie au Fouta et leur éparpillement durent avoir lieu vers le début du XIe siècle, puisque Bekri nous apprend que Ouâr Diâbi mourut en 1040. Un peu plus tard se fondait, non loin du Toro, sur le bas Sénégal, la secte berbère des Almoravides. Tout en admettant comme vraisemblable le récit légendaire que je viens de rapporter, je ne serais pas éloigné de croire que la conversion des Toucouleurs à l’islamisme, commencée par Ouâr Diâbi — d’après Bekri — et achevée par les Almoravides, ne fut pas étrangère au revers de fortune des Peuls : ceux-ci durent en effet se montrer dès lors rebelles à l’islamisation puisque, de nos jours encore, un nombre appréciable d’entre eux sont encore infidèles — au sens musulman du mot —, même parmi les fractions demeurées dans le voisinage du Fouta (au Ferlo notamment) et principalement parmi les familles chez lesquelles le type sémitique original est demeuré le plus pur et qui sont les moins métissées de sang nègre.
5o Les migrations peules.
Dès les premières années qui suivirent la mort de Mahmoud II, l’immense majorité des Peuls du Fouta Toro se porta vraisemblablement vers le Sud, dans la région alors inhabitée mais favorable à l’élevage qui est connue aujourd’hui sous le nom de Ferlo et qui devait alors dépendre, plus ou moins théoriquement, de l’empire de Tekrour. Un parti assez considérable continua ensuite son exode vers l’Est, s’établissant non loin de la rive gauche du Sénégal, entre Bakel et Kayes, dans le Nord du Boundou et du Bambouk, c’est-à-dire dans le pays de Galam ou Gadiaga, à cheval sur la basse Falémé. Ce pays était alors (deuxième moitié du XIe siècle) une dépendance du[227] Tekrour, d’après le témoignage de Bekri, et les Soninké qui y possédaient déjà des colonies devaient être vassaux des Toucouleurs. Quelques familles peules durent, dès cette époque, passer sur la rive droite du Sénégal aux environs de Kayes et rejoindre dans le Diomboko les descendants des Judéo-Syriens qui y étaient demeurés en venant de Ghana.
C’est cette colonie peule du Galam, du Khasso et du Diomboko que, très probablement, Bekri nous signale sous le nom d’Al-Fâmân — on pourrait lire à la rigueur Al-Fellân sur l’un des manuscrits — et qu’il localise au Sud-Est du pays des Toronka (Toucouleurs du Toro), dans la région de Silla[162], ajoutant que ces Al-Fâmân appartiennent à la même race que les Honeïhîn de Ghana. Certaines familles de cette colonie s’unirent plus tard à des Mandé (Soninké et Kâgoro principalement) et donnèrent naissance aux Khassonkè actuels.
D’après les traditions indigènes, cette colonie peule du Galam se choisit dans le clan Diallo un roi dont le titre nous a été transmis sous les formes diverses de saltigué, silatigui, fondokoï et ardo[163]. Lorsque les Soninké de Ghana, vaincus et pourchassés par les Berbères Lemtouna à la faveur du mouvement almoravide, commencèrent à venir s’établir en nombre dans le Guidimaka et le Gadiaga ou Galam (fin du XIe siècle), les Peuls, sous la conduite de leur ardo, quittèrent en majorité ces régions et s’avancèrent vers l’Est à travers le Diomboko et le Kaarta, laissant à chacune de leurs étapes des familles qui, en s’unissant[228] à des Mandingues, donnèrent naissance aux Foulanké des cercles de Bafoulabé et de Kita.
Arrivé au Kaniaga[164], province méridionale du Bagana, le gros de la migration y demeura plus longtemps que dans ses lieux d’arrêt précédents. Il semble que, partis du Galam vers la fin du XIe siècle ou le commencement du XIIe, les Peuls n’avaient pas sensiblement dépassé le Kaniaga à la fin du XIVe ; sans doute les efforts des Soninké Sossé ou Sosso pour conquérir Ghana sur les Sissé, ensuite leurs luttes avec les Mandingues et les razzias qui suivirent la victoire finale de ces derniers, avaient entretenu le long de la rive gauche du haut Niger un état d’insécurité qui ne favorisait pas les migrations vers l’Est. Au début du XIVe siècle pourtant, des Peuls Diawambé s’étaient portés dans le Kingui et avaient fondé Nioro.
Mais, au début du XVe siècle, l’exode des Peuls reprit son essor d’une manière décisive, à la suite de circonstances que les traditions indigènes relatent de la manière suivante. Un silatigui ou ardo nommé Yogo, fils de Sadio ou Sadia Diallo, résidant à Kouma ou Toï dans le Kaniaga, mourut vers 1400 en laissant une veuve et deux frères, dont l’aîné s’appelait Diâdié et le plus jeune Maga (ou Maghan) ou Atiba. Diâdié voulut épouser la veuve de Yogo, mais celle-ci refusa ses avances ; Maga se rendit auprès d’elle pour l’engager à accepter la main de son frère : cependant la femme persista dans son refus, et des ennemis de Maga présentèrent à Diâdié la démarche de son frère sous un mauvais jour, prétendant que c’était Maga qui avait poussé la veuve de Yogo à rejeter les propositions de Diâdié dans le but de l’épouser lui-même. Une querelle s’ensuivit entre les deux frères qui, après avoir échangé des paroles blessantes, se séparèrent.
Maga Diallo (ou Maga Sal) quitta le Kaniaga avec ses partisans,[229] marchant droit devant lui dans la direction du Nord. Parvenu dans le centre du Bagana, du côté de Kala (Sokolo), il rencontra un troupeau de bœufs égarés et, le poussant devant lui dans la direction de l’Est, il parvint dans le Diaga ou Massina, auprès d’une mare qui avoisinait un village de Soninké Nono. Maga leur demanda l’hospitalité et établit son campement près de leur village ; il alla ensuite saluer le fonctionnaire qui gouvernait le Bagana au nom de l’empereur de Mali et reçut de lui l’investiture officielle de chef (ardo) des familles peules qui l’avaient suivi, avec l’autorisation de résider dans le Massina. Plus tard, d’autres Peuls du Kaniaga, appartenant au clan Daédio ou Bari, vinrent rejoindre Maga, ainsi que des gens appartenant aux castes des Mabbé ou Maboubé et des Diawambé ; des serfs Rimaïbé[165], issus d’esclaves noirs acquis par les Peuls durant leur traversée du bassin du Sénégal, vinrent encore grossir ce noyau, qui donna naissance au très important groupe des Peuls du Massina et aux fractions secondaires qui en sont issues par la suite.
Quant aux partisans de Diâdié, certains se mêlèrent aux Foulanké du Nord de Kita et de Bafoulabé et aux Khassonkè de la région de Kayes, adoptant peu à peu la langue mandé et transformant leurs noms de clan : Ourourbé en Diakaté ou Diakité (les gens originaires du Diaka ou Diaga), Daébé en Sangaré, Férôbé en Sidibé ; seul, le clan des Dialloubé conserva son nom sous la forme du singulier (Diallo).
Diâdié lui-même s’était dirigé vers le Nord-Ouest et était allé se fixer dans le Bakounou, entre Goumbou et Nioro, avec plusieurs familles appartenant aux clans des Irlâbé, des Yalâbé (ou Alaïbé), des Oualarbé, des Férôbé et des Ourourbé (ou Boli)[166].
[230]Du Massina, les Peuls ne tardèrent pas à se répandre a travers la Boucle du Niger et au delà, bien que le gros de leur nation soit encore aujourd’hui établi dans la région dont le marigot de Dia ou Diaka forme comme le centre. Dès le XVe siècle, des Oualarbé, des Ourourbé, des Salsalbé et des Tôrobé se portèrent vers le Nord, dans le cercle actuel de Niafounké, avec un grand nombre de Diawambé. D’autres franchirent le Niger et le Bani et, s’infiltrant au travers des Tombo et des Mossi, gagnèrent le Liptako (région de Dori), où ils fondèrent une colonie prospère qui put presque rivaliser avec celle du Massina. Ici encore, nous avons de nombreuses traditions indigènes relatives aux différents exodes dont l’ensemble constitua cette importante migration.
Le clan peul des Tôrobé — car il y a des Tôrobé peuls et des Tôrobé toucouleurs —, à la suite de la grande migration du Fouta vers le Massina, s’était installé surtout au Nord du lac Débo, entre Niafounké et Saraféré. La légende dit que l’exode des Tôrobé avait été dirigé par trois frères nommés Sambo, Paté et Yoro. Une partie d’entre eux, quittant la région de Saraféré, s’en alla camper à Gorou, au Nord de Douentza. Là, ils furent rejoints par quatre membres de leur clan (Hamadi, Dembo, Dello et Diobo), tous les quatre descendants d’un nommé Siré qui aurait été le père de Sambo, Paté et Yoro et qui serait demeuré au Fouta avec une partie de sa famille lors de l’exode de ces trois derniers. Les quatre émissaires venaient du Fouta dans le[231] but d’engager leurs compatriotes à retourner au Sénégal. Non seulement ils échouèrent dans leur mission, mais ils demeurèrent avec les Tôrobé de Gorou et devinrent eux-mêmes des chefs de migration : Dello, avec Dembo et ses fils, conduisit une partie de la tribu au Liptako ; Dembo s’arrêta dans le Djilgodi (région de Djibo), d’où ses descendants pénétrèrent dans le Nord-Est du Mossi (canton de Boussouma) ; la plupart des fils de Dembo demeurèrent au Liptako, mais Dello, allant coloniser le Torodi (pays des Tôrobé) et traversant le Niger près de Say, poussa jusqu’à Sokoto ; Hamadi, lui, conduisit dans le Yatenga une autre bande dont le chef actuel, Abdoullahi, prétend descendre de Sambo et de son père Siré, le premier ancêtre des Peuls Tôrobé. Enfin Diobo, qui avait accompagné Hamadi au Yatenga, alla ensuite au Djilgodi rejoindre Dembo, y laissa son fils Pélouna, traversa le Liptako et le Torodi, gagna Sokoto et se porta de là dans l’Adamaoua.
Ila Galâdio, ancêtre du clan des Yalâbé ou Alaïbé, aurait fait partie de la migration qui demeura longtemps du côté de Kayes et qui aurait, en partie, donné naissance aux Khassonkè. Beaucoup de ses descendants cependant avaient suivi le grand mouvement vers le Kaniaga et le Massina, et s’étaient établis, sous la conduite d’un nommé Dama ou Demba, dans le Sébéra, entre Dienné et Sofara. Gao, fils de Dama, poussa vers le Nord jusqu’à Gouméouel, dans le Fitouka, entre Niafounké et Saraféré. La fraction des Yalâbé qui s’établit là aurait pris le nom de Fitôbé ou Fitoubé (du nom du Fitouka). Plus tard, Diâdié, fils de Gao, conduisit les Fitôbé à Sari, sur la route de Bandiagara à Dori, au Nord de Ouahigouya. Moussa, fils de Diâdié, qui vivait vers le milieu du XVIIIe siècle[167], aurait conclu une alliance avec les Tombo de la région pour chasser de Bané (entre Sari et Ouahigouya) les Nioniossé et les Soninké de langue songaï qui s’y trouvaient alors et s’installer à leur place,[232] poussant ainsi vers le Sud. Goré, l’un des compagnons de Moussa, se fixa plus au Sud encore, à Sittiga, dans le Yatenga. Demba, le chef actuel des Fitôbé du Yatenga, dit descendre de Moussa par les nommés Hamadou, Sidiki, Tana et Hamat.
Ce dernier — Hamat —, fils et successeur de Moussa, vivait aux environs de 1780. Un Peul de sa tribu, nommé Paté, se transporta avec ses troupeaux à Téma, dans le Mossi, et y épousa une nommée Siboudou, fille du chef mossi de Téma. Il en eut cinq fils (Mali, Koumbassé, Faéni, Garba et Sambo) et une fille (Sadia). Cette dernière demeura à Téma et s’y maria avec un Mossi ; les cinq fils vinrent s’établir à Kalsaka, dans le Yatenga, et s’y marièrent avec des femmes mossi : ce sont les descendants de ces unions de Peuls avec des Mossi qui sont appelés par les Mossi Silmimossi, tandis que les Peuls purs sont appelés Silmissi. Ces Silmimossi sont rattachés aux Peuls plutôt qu’aux Mossi, mais en réalité ils participent des deux peuples : ils parlent en même temps le peul et le mossi et sont à la fois pasteurs et agriculteurs ; mais ce sont les hommes, chez eux, qui traient les vaches, et non pas les femmes comme chez les vrais Peuls.
Les Dialloubé ont également fourni un assez fort contingent aux migrations peules qui se sont répandues dans la Boucle du Niger. Un de leurs chefs, Hamân, partit du Massina au XVIIe siècle et vint s’établir à Gomboro, dans l’Ouest du Yatenga, en pays samo. Guibril, chef actuel des Dialloubé du Yatenga, serait le quatorzième successeur de Hamân, dont le sépareraient neuf générations.
Revenons maintenant au Ferlo, qui avait été, comme nous l’avons vu, le refuge de la majorité des Peuls chassés du Fouta Toro par les Toucouleurs. Tandis que s’organisaient les grands exodes qui, du Ferlo, devaient aboutir au Massina et au Torodi, une autre migration moins importante prenait la route du Sud et, laissant plusieurs colonies dans le Boundou, allait se fixer dans le Fouta Diallon. Cette migration eut lieu aussi, vraisemblablement, du XIe au XIVe siècles, bien avant la conquête du[233] Fouta Diallon par les Toucouleurs Dénianké, que l’on place généralement vers 1720[168].
Lorsque précisément les Toucouleurs arrivèrent au Fouta Diallon et surtout lorsqu’ils voulurent convertir à l’islamisme les Diallonké et les Peuls, le plus grand nombre de ces derniers émigrèrent vers l’Est, se portant dans le Sangaran et le Ouassoulou, où ils s’unirent à des Mandingues et grossirent le nombre des Foulanké ; d’autres, demeurés à peu près purs, poussèrent plus loin encore et arrivèrent près de la haute Volta Noire, dans le quadrilatère compris entre Sikasso, Koutiala, Koury et Bobo-Dioulasso, s’avançant même jusqu’à Barani, entre Koury et San. Beaucoup de ceux-là, bien qu’ayant conservé l’usage de la langue peule, avaient adopté, durant leur passage dans le Ouassoulou, la forme foulanké des noms de clan (Diallo, Sangaré, Diakité, Sidibé). L’un d’eux, Ouidi Sidibé, fonda à Barani une sorte de royaume éphémère d’où sont parties quelques petites migrations récentes (XIXe siècle), telles que celle de Daba Sangaré du côté de Koutiala, celle d’Ali-Bouri du côté de San, etc. D’autres migrations, anonymes celles-là, traversant vers la fin du XVIIIe siècle le Dafina, le Mossi et une partie du Gourma, rejoignirent au Torodi le grand courant venu du Massina par le Liptako et suivirent la route qu’il avait[234] tracée déjà vers les pays haoussa, l’Adamaoua, le Baguirmi et le Ouadaï.
6o Conclusions. — Résumons en quelques lignes les conclusions à tirer de tout ce qui précède, au sujet des origines et de la formation du peuple peul.
A une époque fort ancienne, nous trouvons une population sémitique, d’origine judéo-syrienne, de langue égypto-araméenne ou bien berbère, de religion pré-mosaïque ou mosaïque, qui, venue de la Cyrénaïque par l’Aïr et par le Touat, s’établit à l’Ouest de Tombouctou, puis émigre en grande partie dans le Fouta Sénégalais. Elle trouve là une population nègre, parlant une langue nègre que nous appelons aujourd’hui le peul, et, sans se mélanger intimement avec cette population nègre, elle en subit cependant l’influence, en adopte la langue à la suite d’un long contact et devient le peuple peul primitif. Par suite de circonstances diverses, ce peuple quitte en majorité le Fouta pour se diriger vers l’Est, avec l’intention, dit la légende, de regagner l’Asie, son pays d’origine ; mais, pour de multiples raisons, il ne va pas aussi loin et se contente de pousser jusqu’au Darfour, faisant donner par les auteurs arabes le nom de Tekrour, par suite d’une extension de sens facile à comprendre, à toute cette vaste région où il avait introduit avec lui la langue tekrourienne. Tout le long de cet immense itinéraire, des groupes de Peuls s’établissent comme bergers au milieu des Noirs ; certains perdent complètement leur type primitif pour devenir des Nègres, tandis que d’autres, s’étant installés dans des pays peu habités, conservent plus pur leur type sémitique original tout en continuant à parler la langue nègre qu’ils tiennent des Toucouleurs. Parfois dominateurs et puissants, ils acceptent le plus souvent la loi des pays qui veulent bien les accueillir et vivent à l’état de demi-vassaux, quelquefois à l’état de parias, au milieu des Noirs. Il semble que leur conversion à l’islamisme est assez récente et ne remonte guère, pour la plupart d’entre eux, au delà des conquêtes toucouleures des XVIIIe et XIXe siècles ; beaucoup d’ailleurs, surtout parmi ceux qui ont conservé le plus purement les caractéristiques de la race[235] blanche, pratiquent aujourd’hui encore une religion qui ne semble pas s’éloigner énormément de ce qui dut être la religion de leurs ancêtres primitifs et conservent pieusement des traditions qui ont une étonnante analogie avec les plus vieilles traditions juives.
L’ampleur que j’ai cru devoir donner à la question de l’origine des Peuls me permettra d’être bref en ce qui concerne celle des Toucouleurs, puisque j’ai déjà exposé que ces derniers, bien que parlant la même langue que les Peuls, ne peuvent à aucun titre leur être rattachés.
Si les Peuls sont incontestablement issus d’une population de race blanche, les Toucouleurs appartiennent tout aussi incontestablement à la race noire. A mon avis, ils sont autochtones de la région qu’ils habitent encore de nos jours — le Fouta Sénégalais, — mais leur pays primitif, lorsqu’il portait encore le nom de Tekrour[169], devait chevaucher sur les deux rives du Sénégal[170] et renfermer, non seulement les ancêtres des Toucouleurs[236] actuels, mais aussi ceux des Sérères. La poussée des Berbères vers le Sud dut contraindre les Sérères, du XIe au XIVe siècles, à s’enfoncer dans le pays des Ouolofs d’abord et ensuite dans le Sine, au Sud de ces derniers ; mais la langue qu’ils parlent encore est une preuve vivante de leur très ancien et très intime contact avec les Toucouleurs.
L’arrivée des Berbères sur la rive droite du Sénégal contraignit également les Toucouleurs à se localiser sur la rive gauche ; les conquêtes des Ouolofs à l’Ouest, celles des Soninké à l’Est, restreignirent encore l’ancien territoire du Tekrour. Mais il semble bien que, si leur domaine diminua petit à petit depuis le XIe siècle environ jusqu’au XVIe, ils ne commencèrent à en sortir pour se répandre au dehors qu’à partir du XVIIIe siècle, durant lequel la conquête les porta au Fouta-Diallon et au Boundou. Au début du XIXe siècle, ils secondèrent puissamment la révolte des Peuls du Gober contre les Haoussa et fournirent, semble-t-il, un contingent fort appréciable au conquérant Osmân-dan-Fodio, fondateur de l’empire de Sokoto. Enfin, dans la seconde moitié du même siècle, sous la conduite d’El-Hadj-Omar, ils se répandirent, toujours par la conquête à main armée, dans les quelques régions du Haut-Sénégal-Niger où l’on en trouve aujourd’hui.
Mais, s’ils constituèrent de tout temps une nation forte et puissante, s’ils sont devenus à une époque récente des conquérants remarquables, ils n’ont jamais été un peuple migrateur et ils n’ont pas eu d’influence sensible sur la formation des groupements ethniques de l’Afrique Occidentale.
N’oublions pas d’autre part que leur influence linguistique et religieuse fut la plus considérable qu’il nous soit permis d’enregistrer dans l’histoire du Soudan Français, puisque d’une part ils ont réussi à faire adopter leur langue par un peuple — le peuple peul — qui l’a répandue ensuite de l’Atlantique jusqu’au delà du Tchad et que, d’autre part, convertis à l’islamisme dès le XIe siècle, avant les autres peuples noirs, avant une bonne partie des Berbères et bien avant les Peuls, ils ont contribué plus que toute autre nation africaine à l’islamisation des Ouolofs, de certaines fractions mandingues, des Soussou,[237] des Peuls, des Haoussa, etc., les Soninké ayant fait le reste sous ce rapport.
Si les Toucouleurs ne sont pas des Peuls, il est infiniment probable néanmoins que, après le départ de ces derniers du Fouta Sénégalais, des relations subsistèrent entre les uns et les autres. Lorsque, beaucoup plus tard, les Toucouleurs commencèrent leurs conquêtes, il est remarquable qu’ils se portèrent toujours vers des contrées où ils savaient trouver des Peuls, pensant sans doute rencontrer en ces derniers, qui parlaient leur langue et sortaient de leur pays, des alliés naturels : les faits du reste ne justifièrent pas toujours leur espérance, notamment au Massina, où les Toucouleurs n’eurent pas d’ennemis plus acharnés que les Peuls.
Le type primitif des Toucouleurs a été certainement très altéré par des mélanges successifs, d’abord et surtout avec les Judéo-Syriens ou Proto-Peuls lors de leur installation au Tekrour, ensuite avec les Peuls proprement dits venus au XVIe siècle sous la conduite de Koli, bien que le résultat des mélanges ait dû être plus sensible chez les Peuls qu’il ne l’a été chez les Toucouleurs.
Un autre élément d’altération, peut-être plus considérable, fut apporté par les Soninké Sossé et par les Ouolofs : non seulement ces derniers ont conquis et gouverné le Tekrour durant une assez longue période, mais ils y ont laissé un grand nombre de familles dont les descendants portent encore aujourd’hui des noms de clan ouolofs (Ndiaye entre autres). Du côté de l’Est, il s’est produit parmi les Toucouleurs des infiltrations soninké qui ne sont pas négligeables ; le contact avec les Berbères et les Arabes de la rive droite du fleuve n’est pas sans avoir exercé également une influence sérieuse. Enfin, les étrangers venus se faire instruire par les marabouts du Fouta — et ils furent nombreux de tout temps — ont été, par le fait même de leur séjour au Fouta et de l’instruction religieuse qu’ils y avaient reçue, naturalisés Tôrobé, en sorte que ce clan renferme une grande quantité de familles qui n’ont avec les Toucouleurs que des liens de parenté tout à fait artificiels.
Jusque vers la fin du siècle dernier, on avait toujours considéré les Songaï comme des nègres authentiques. Mais un ouvrage qui eut un certain retentissement[171], tant en raison du moment où il parut que de la valeur littéraire de son auteur et de l’agrément de son style, vint modifier les idées de plusieurs ethnologues de bonne volonté ; on alla chercher en Egypte, ou tout au moins en Nubie, le berceau des Songaï et il fut beaucoup question de l’empire songaï, de l’époque songaï, de la civilisation songaï, etc. C’était, je crois, faire un peu trop d’honneur à cette population de paysans et de pêcheurs que de lui chercher un passé si éloigné et si glorieux : les malheureux Songaï ont certainement fourni plus d’esclaves que de princes, leur influence sur le développement du Soudan a toujours été de second ordre et leur civilisation n’a eu de relativement brillant que ce qui lui a été apporté de l’extérieur par les Berbères d’abord, les Mandé ensuite et les Marocains en dernier lieu. Quant à l’apport de l’Egypte, il paraît avoir été à peu près nul, au moins en tant qu’apport direct.
Sur quoi s’est-on basé pour attribuer aux Songaï une origine égyptienne ? sur leur type physique affiné, leur degré de culture et le style architectural de leurs constructions. Or, chose au moins singulière, aucun de ces caractères ne se rencontre chez les Songaï, sauf chez ceux de la classe supérieure, et cette classe précisément n’est songaï qu’à moitié. Aucun de ces caractères, de plus, n’est attribuable à une origine ni à une influence égyptiennes, mais bien à une influence maghrébine et surtout marocaine, ainsi que l’histoire et un examen impartial des faits nous le démontrent surabondamment.
D’où vient donc l’erreur commise ? simplement de ce que M. Félix Dubois, d’une part a attribué gratuitement à l’Egypte des influences qui proviennent d’ailleurs et que, d’autre part, il a pris comme champ d’observation la ville de Dienné, laquelle précisément ne renferme pas de Songaï ou en renferme si peu qu’il est en tout cas aussi inexact de la considérer[239] comme un produit de la civilisation songaï qu’il serait inexact de prendre la colonie peule du Liptako comme type de la civilisation toucouleure. M. Ch. Monteil[172] a parfaitement démontré qu’il n’existait à Dienné, au temps où il y résidait, c’est-à-dire il y a environ huit ans, que trois familles ayant, parmi leurs ascendants, quelques individualités d’origine songaï. La langue de Dienné est la langue songaï, il est vrai, comme la langue du Liptako est la langue toucouleure, comme la langue des Marka ou Soninké de Banamba est le banmana : mais c’est là un phénomène dû à des raisons politiques et économiques, et qui n’a rien à voir avec l’origine ethnique des Diennéens.
La population songaï, dans son ensemble, est manifestement une population de race nègre, à laquelle des éléments berbères d’abord, arabes, juifs et peuls ensuite et enfin et surtout marocains sont venus se surajouter, en modifiant assez profondément le type d’un certain nombre de familles ; ces familles d’ailleurs, si leur influence politique et sociale a été et est encore considérable, ne constituent au point de vue numérique qu’une fraction infime de la population ; le peuple, dans son ensemble, est demeuré franchement nègre.
Tout me porte à croire que les Songaï primitifs étaient des autochtones de la basse vallée nigérienne. Je placerais volontiers le berceau de leur peuple sur la rive gauche du bas Niger, dans les régions généralement désignées sous les noms de Kebbi, de Maouri et de Zaberma, entre le Goulbi-n-Kebbi ou Goulbi-n-Sokoto au Sud et le Dallol-Dosso au Nord, le Dallol-Maouri et la frontière franco-anglaise formant à peu près le centre de ce domaine.
L’avancée des Haoussa de Katséna dans le Kebbi[173] dut, dès une époque reculée, inciter une partie des Songaï à traverser le Niger et à s’installer dans le Dendi, sur la limite actuelle de la colonie du Dahomey et du cercle de Say, tandis que d’autres se portaient vers le Nord et occupaient, à l’Est de Niamey[240] et de Tillabéry, la contrée connue sous le nom de Djerma-ganda (pays des Djerma ou Songaï).
Il est probable que, avant le VIIe siècle de notre ère, les Songaï ne dépassaient pas au Nord la latitude approximative de Tillabéry et n’avaient pas encore pénétré sur la rive droite du Niger, sauf toutefois dans le Dendi. Le long du fleuve lui-même, ils avaient dû remonter un peu plus haut, sans doute jusqu’à Bentia. Une partie de la population se consacrait presque exclusivement à la pêche et occupait les rives du fleuve et surtout les îles : c’étaient les Sorko ou Kourteï, appelés actuellement Kourtibé par les Peuls. Grâce à la facilité de communications que leur donnaient leurs pirogues, ils avaient acquis une sorte de prééminence politique dont ils usaient au détriment des Songaï agriculteurs, les Gabibi de nos jours. Ne cultivant pas la terre eux-mêmes, ils allaient, après la récolte, surprendre les villages voisins du Niger, pillaient les greniers et rapportaient les grains volés dans leurs repaires des îles, s’approvisionnant ainsi à peu de frais. Les paisibles agriculteurs les détestaient et les redoutaient, mais ne pouvaient rien contre eux.
Lorsque les Lemta venus de la Tripolitaine firent leur première apparition vers Gounguia ou Koukia, qui devait se trouver, comme je l’ai dit plus haut, dans l’île de Bentia[174], les Songaï agriculteurs les accueillirent avec joie. Leur attribuant une origine quasi-divine, que les nouveaux arrivants firent tout pour accréditer, ils pensaient trouver en eux des alliés qui les protégeraient contre les rapines des Sorko.
Le chef de l’immigration lemta en effet, connu sous le nom de Dia Aliamen, livra bataille aux Sorko de l’île de Gounguia, les chassa de la contrée et s’installa à leur place, à Gounguia,[241] avec ses compagnons (fin du VIIe siècle environ). Les Songaï agriculteurs des bords du Niger, en reconnaissance, firent de Dia Aliamen leur roi et lui prêtèrent serment d’obéissance, et bientôt son autorité s’étendit sur tous les Songaï habitant depuis Bentia jusqu’au Kebbi.
| Delafosse | Planche IX |

Cliché Fortier
Fig. 17. — Jeune fille Peule.
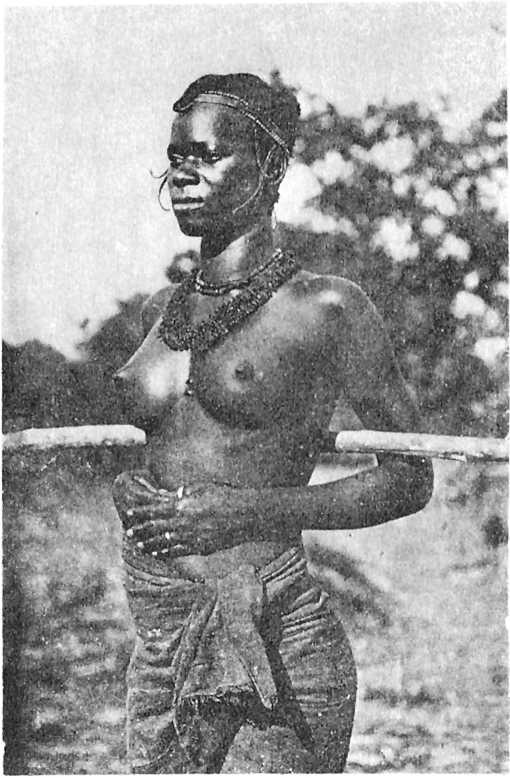
Cliché Fortier
Fig. 18. — Femme Malinké.
Une légende rapportée par Sa’di raconte que, lors de l’arrivée de Dia Aliamen à Koukia, les indigènes subissaient le joug d’un poisson qui, un anneau passé dans les narines, apparaissait au dessus des eaux du fleuve à certaines époques de l’année et dictait au peuple des ordres et des défenses ; Dia Aliamen aurait tué ce poisson d’un coup de harpon et délivré ainsi les habitants de cette tyrannie bizarre. L’auteur du Tarikh essaie d’expliquer cette légende en disant que sans doute Dia Aliamen était musulman et que sa foi religieuse le conduisit à détruire l’idole personnifiée dans cet étrange poisson ; mais il a senti la faiblesse de son explication et a dû émettre la conjecture que, postérieurement, les successeurs de Dia Aliamen auraient abjuré l’islamisme. En réalité, Dia Aliamen et ses compagnons devaient être, non pas musulmans, mais chrétiens, et on pourrait supposer qu’un motif religieux les porta en effet à détruire l’idole des indigènes. Mais il me paraît plus rationnel de penser que la légende a simplement symbolisé, sous la forme d’un poisson tyran, la caste pillarde des pêcheurs Sorko, qui pouvaient très bien porter un anneau dans le nez — coutume fréquente chez les peuples de la vallée nigérienne — et qui en effet apparaissaient en maîtres à l’époque de la moisson, ainsi que je le disais plus haut.
Quoiqu’il en soit, une importante fraction des Sorko remonta vers cette époque le Niger et alla fonder Gao, où un pêcheur nommé Faram-Ber (Faran-le-Grand) créa une sorte de royaume indépendant. Cette fraction des Sorko comprenait deux clans principaux : celui des Faran, qui avait la prééminence et qui s’installa à Gao, et celui des Fono, qui alla s’établir du côté de Bamba, portant ainsi le peuple songaï en amont du coude de Bourem.
Les successeurs de Faram-Ber furent presque continuellement en lutte avec les Lemta de Gounguia ; l’un d’eux, Kobé-Taka,[242] trouva la mort dans une bataille qu’il leur livra sur la rive droite du Niger. Faran-Nabo ou Nabonké, son fils et successeur, voulut aller venger la mort de son père, mais, après quelques victoires heureuses sur les Lemta, — victoires qui étendirent momentanément son autorité au Sud de Gao, — il fut repoussé et vaincu et dut quitter Gao, cédant la place aux successeurs de Dia Aliamen (IXe ou Xe siècle probablement). C’est alors que les Songaï agriculteurs, fidèles sujets des Lemta, s’avancèrent jusqu’à Gao : un peu plus tard, sans doute au début du XIe siècle, sous le règne de Dia Kossoï, la capitale de l’Empire lemta-songaï fut transférée de Gounguia à Gao[175].
Cependant les Sorko, continuant à tracer en éclaireurs le mouvement d’avancée des Songaï le long du Niger, ne tardèrent pas à atteindre le lac Débo.
Les Faran chassés de Gao arrivèrent à Bamba et, en leur qualité de clan royal, s’attribuèrent les meilleurs emplacements de pêche au détriment des Fono. Ceux-ci ne voulurent pas se laisser déposséder ainsi et livrèrent bataille aux Faran ; vaincus, ils remontèrent le fleuve et parvinrent dans la région des lacs, où les Soninké et les Bozo formaient alors le fond de la population. Les Fono furent autorisés par les chefs du pays à s’établir dans l’île de Koura, un peu en amont de Tombouctou, ainsi qu’à Gourao, sur la rive nord du lac Débo.
Ils furent rejoints dans cette région par un autre clan songaï, celui des Goou ou Gow, composé principalement de chasseurs, et qui avait dû émigrer du Djerma-ganda à la suite de difficultés avec les Lemta. Ces Goou s’installèrent dans le Bara, sur la rive droite du Bara-Issa, à mi-chemin à peu près entre le Débo et Niafounké.
Cependant les Bozo, jusqu’alors maîtres de la navigation sur le Débo et les canaux du Niger, ne voyaient pas d’un œil favorable la concurrence que commençaient à leur faire les Sorko[243] Fono. Ceux-ci ayant créé un service de transports entre Mopti et Koura par Gourao, les Bozo cherchèrent à ruiner l’entreprise et construisirent près de Kouna, entre Mopti et le Débo, avec les herbes aquatiques connues sous le nom de borgou, des sortes de barrages qui arrêtaient les embarcations des Fono[176]. Ces derniers, unis aux marchands soninké de Mopti, organisèrent contre les Bozo une expédition qui demeura infructueuse. Ils songèrent alors à appeler à leur aide leurs cousins les Faran, demeurés à Bamba, et leur envoyèrent par eau des messagers pour réclamer leur concours.
A cette époque (fin du XIIe siècle ou commencement du XIIIe), l’autorité des empereurs de Gao s’était notablement accrue et leur territoire, gagnant du terrain vers le Nord, avait atteint Bamba. Les Sorko Faran, irréconciliables ennemis des Lemta, supportaient malaisément le voisinage de ces derniers et ils saisirent avec empressement l’occasion qui s’offrait à eux d’émigrer vers de nouvelles contrées. Ils répondirent donc à l’appel des Fono et partirent tous pour la région des lacs, formant une véritable flottille de pirogues. Lorsqu’ils arrivèrent à proximité du confluent de l’Issa-Ber et du Bara-Issa, en amont de Koura, ils se heurtèrent à une troupe armée composée surtout de Soninké[177], qui voulut s’opposer à leur passage. Les Faran triomphèrent facilement de cet obstacle et ne tardèrent pas à être les maîtres du fleuve. Ils fondèrent leur principal établissement près du pays des Goou, au confluent du Bara-Issa et du Koli, et y construisirent un village qu’ils appelèrent en songaï Faran-Koïra (village des Faran). Les Peuls ont traduit cette expression par Saré-Faran, qui a dans leur langue la même signification et dont nous avons fait à notre tout Saraféré[178].
[244]Une fois solidement établi à Saraféré, le chef des Faran réunit sous son autorité tous les Songaï de la région des lacs, c’est-à-dire les Fono de Koura et de Gourao et les Goou du Bara, et il organisa avec eux une expédition contre les Bozo du lac Débo. Il n’obtint d’abord qu’un succès contestable, mais, au cours d’une deuxième expédition, il défit complètement les Bozo, qu’il obligea à se retirer au Sud du Débo et à respecter la liberté de la navigation sur le Bani.
Donc, vers la fin du XIIIe siècle, au moment où avait commencé l’apogée de l’empire mandingue de Mali au détriment de l’empire soninké des Sossé, d’abord, et de l’empire lemta-songaï de Gao ensuite, la situation des Songaï était la suivante : dans l’Est, sous la domination des Berbères Lemta, ils étaient répandus tout le long du Niger depuis le Dallol-Maouri environ jusqu’à Bamba et occupaient, sur la rive gauche du fleuve, le Zaberma et le Djerma-ganda, et, sur la rive droite, le Dendi ; à l’Ouest, à peu près indépendants mais placés sous la suzeraineté au moins nominale de l’empereur de Mali, ils s’étaient échelonnés le long du Niger et de ses bras principaux depuis Tombouctou jusqu’au lac Débo. La première fraction comprenait des agriculteurs et des pêcheurs (Gabibi et Kourteï) ; la seconde se composait presque exclusivement de pêcheurs (Sorko), avec un petit groupe de chasseurs (Goou).
Vers 1325, Kankan-Moussa, empereur de Mali, établissait sa suzeraineté sur Gao, Tombouctou, le Massina, et englobait par conséquent sous son autorité tous les Songaï. Près d’un siècle et demi plus tard, Sonni Ali-Ber (Ali-le-Grand), l’avant-dernier prince lemta de Gao, s’affranchissait de la tutelle des Mandingues et, poussant les limites de son empire bien au-delà de Bamba, s’emparait de Tombouctou, du Bara et de Dienné (1465 à 1492). Un an après sa mort, un Soninké du clan-tribu des Silla, nommé Mohammed, fils de Aboubakari Touré, arrivait[245] à se faire proclamer empereur de Gao, substituait une dynastie nègre — celle des askia — à la deuxième dynastie berbère des Lemta — celle des sonni, qui avait succédé vers 1335 à celle des dia — et donnait une extension plus considérable encore à l’empire de Gao.
C’est assurément à partir de Sonni Ali-Ber et d’Askia Mohammed Ier, c’est-à-dire à partir des dernières années du XVe siècle, que les Songaï commencèrent à se répandre en plus grand nombre dans la région de Tombouctou et des lacs. Bien que ne formant qu’une minorité dans l’ensemble des peuples soumis à l’empereur de Gao, bien que cet empereur lui-même et ses principaux ministres et officiers ne fussent pas des Songaï en général, ces derniers durent fournir un contingent notable aux armées de Sonni Ali-Ber et des askia. Sa’di nous apprend que, lors d’une expédition que fit Mohammed Ier contre les Bariba, un grand nombre de Songaï du Zaberbanda[179] trouvèrent la mort et que parmi eux étaient les meilleurs soldats de l’armée impériale ; nous savons d’autre part, grâce au même auteur, que l’un des principaux éléments de la puissance des askia fut leur flottille, dont les équipages étaient assurément composés en majorité de Sorko.
Cependant, si l’influence politique de l’empire de Gao fut considérable et si, à la faveur de sa puissance et de son extension, la langue songaï — qui était pour ainsi dire la langue officielle de l’empire, même du temps des Lemta — arriva à se répandre jusqu’à Dienné et à détrôner, là comme en beaucoup d’autres points, les langues indigènes, les Songaï eux-mêmes ne durent pas constituer, en dehors des rives mêmes du Niger, des colonies numériquement importantes ; en tout cas ces colonies ne dépassèrent pas le Débo en remontant le fleuve. Les seules régions où l’immigration songaï en amont de Bamba ait laissé des traces considérables sont celles de Tombouctou, de[246] Koura, du Kissou[180], de Goundam, du Dirma (ou de Tendirma), de Niafounké, du Bara et de Gourao.
Presque exactement un siècle après l’avènement du premier askia, le 30 mars 1591, l’armée marocaine du pacha Djouder, expédiée par le sultan saadien Moulaï Ahmed-ed-Dehebi et comprenant trois mille guerriers, atteignait le Niger à Karabara, un peu à l’Ouest de Bamba. Le 12 avril suivant, l’armée de l’askia Issihak II, forte de 42.500 hommes, était mise en déroute en un clin d’œil, grâce aux mousquets des Marocains, près de Tondibi (la pierre noire), à 50 kilomètres en amont de Gao, sur la rive gauche du fleuve. La domination marocaine sur l’ancien empire de Gao — à l’exception du Dendi qui demeura indépendant — devait durer jusque vers la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle les derniers pachas de Tombouctou virent le peu d’autorité qui leur restait passer aux mains des Touareg dans l’Est et le Nord et aux mains des Peuls et des Banmana dans l’Ouest[181]. Mais, dès 1612, c’est-à-dire vingt ans environ après la victoire de Djouder sur Issihak II, le gouvernement marocain avait cessé de désigner les pachas et n’avait plus exercé aucune action directe sur les pays soudanais[182]. A partir de cette date, les pachas de Tombouctou et leurs caïds furent recrutés sur place, parmi les officiers venus du Maroc avec Djouder et ses premiers successeurs, tant qu’il en resta, puis parmi les descendants de ces officiers. Ces descendants n’étaient plus des Marocains à proprement parler : les caïds et les soldats venus de Fez et de Marrakech avaient pris femme sur les bords du Niger, les uns parmi les Maures, les Touareg[247] ou les Peuls, les autres parmi les Songaï, les Soninké et d’autres populations noires. A mesure que l’on s’éloignait de la date d’arrivée des premiers Marocains, l’élément nègre devenait prépondérant chez ces métis, qui avaient d’ailleurs adopté la langue songaï et qui constituèrent peu à peu la classe noble et dirigeante du peuple songaï, celle des Arma : c’est ainsi que cette classe vint se surajouter au fond primitif purement nègre, constitué par les Gabibi, les Sorko et les Goou.
D’après Ahmed Baba, qui le tenait de Moulaï Zidân, fils du sultan Ahmed-ed-Dehebi, il fut expédié du Maroc au Soudan, depuis le pacha Djouder jusqu’au pacha Slimân, c’est-à-dire de 1590 à 1600, vingt-trois mille soldats, dont la plupart périrent de blessures et surtout de maladies. Parmi les survivants, 500 revinrent à Marrakech et les autres se fixèrent au Soudan. Mahmoud Lonko, qui succéda à Slimân et fut le dernier pacha envoyé du Maroc à Tombouctou, avait amené 300 soldats avec lui : ce furent les derniers renforts expédiés du Maroc.
Cependant un nouvel élément de population marocaine serait arrivé à Tombouctou vers la fin du XVIIe siècle. Vers 1670, Er-Rachid, le premier sultan filalien ou hassanide de Fez, au cours d’une expédition dans le Sous, mit le siège devant la zaouïa d’un religieux musulman nommé Ali-ben-Haïdar, lequel s’enfuit au Soudan et alla se mettre sous la protection de l’empereur banmana de Ségou, Biton Kouloubali, dont l’autorité commençait à s’étendre jusqu’à Tombouctou. Ali offrit à Biton deux belles captives d’origine espagnole ou portugaise qu’il avait amenées avec lui ; le prince banmana, amadoué par ce présent, autorisa Ali à s’établir à Tombouctou avec sa famille et ses disciples et lui promit son assistance. En effet, le sultan Er-Rachid, parti à la poursuite de Ali, se heurta entre Tombouctou et Dienné, dans le Nord du Massina, à l’armée de Ségou et, devant le refus bien net de Biton de lui livrer le fugitif, s’en retourna au Maroc.
Ali-ben-Haïdar résida plusieurs mois à Tombouctou ; il y aurait laissé des descendants, qui seraient les ancêtres du clan arma des Haïdara. La tradition raconte qu’il quitta Tombouctou[248] pour regagner le Sous à la tête d’une armée de plusieurs milliers de Noirs, à l’aide de laquelle il voulait tirer vengeance du sultan Er-Rachid. Mais, lorsqu’il arriva au Maroc, ce dernier venait de mourir à Marrakech (1672). En apprenant cette nouvelle, Ali renvoya sa troupe devenue inutile. Mais le nouveau sultan Ismaïl, frère et successeur d’Er-Rachid, la fit rassembler et en fit le noyau de la fameuse armée noire qui fut le principal soutien de la dynastie hassanide à ses débuts[183].
Dans le dessein d’augmenter l’effectif de cette armée, Ismaïl envoya son neveu Ahmed au Soudan pour y recruter d’autres guerriers. Ahmed se rendit donc à Tombouctou, qu’il occupa au nom du sultan de Fez, à la grande joie — dit-on — des habitants : ceux-ci en effet espéraient que le prince marocain pourrait, mieux que l’empereur de Ségou, les défendre contre les déprédations et les exigences des Bérabich. Après un séjour de plusieurs années à Tombouctou, Ahmed retourna au Maroc. Dès qu’il fut parti, Tombouctou cessa de reconnaître la suzeraineté — bien éphémère — du sultan de Fez et la garnison laissée par Ahmed se dispersa parmi les indigènes et se mélangea avec eux[184].
Tout compte fait, le nombre des Marocains qui se fixèrent[249] dans la région de Tombouctou aux XVIe et XVIIe siècles et qui y firent souche ne dut pas être très considérable, car Sa’di insiste à plusieurs reprises sur la mortalité excessive qui décima, avant même qu’ils fussent parvenus au Niger, les contingents amenés par les premiers pachas. Comme d’autre part les Songaï eux-mêmes n’étaient pas fort nombreux dans cette région, il est certain que leur type primitif a dû être assez profondément modifié par leur mélange avec les Marocains. Mais cette modification n’atteignit guère que les familles nobles et dans les villes seulement : à Gao, Bamba, Koura, Tendirma, Kouna, et surtout à Tombouctou. Les familles soninké de Dienné subirent d’ailleurs, et par le fait d’un mélange analogue, des modifications identiques. Ce sont les résultats de cette infusion de sang blanc, très visibles encore, qui ont pu faire naître chez quelques voyageurs l’idée d’attribuer aux Arma une origine égyptienne.
Mais d’abord beaucoup de ces métis de Blancs et de Nègres ne sont pas rattachables aux Songaï, et c’est en particulier le cas de ceux de Dienné. Ensuite il ne faut pas oublier que, chez les Songaï, les Arma ne forment qu’une partie infime de la population, quelque importance politique et sociale qu’ils puissent détenir dans les villes où on les rencontre : la masse du peuple, composée des Gabibi et des Sorko de la région des lacs et surtout de l’ensemble des habitants du Djerma, du Zaberma et du Dendi, est demeurée nègre, les influences berbères et peules mises à part. Enfin, comme nous l’avons vu, l’élément blanc qui a affecté quelques familles songaï et a produit les Arma venait, non pas de l’Egypte, mais du Maghreb ; il est d’importation récente et postérieur à la période durant laquelle la soi-disant civilisation songaï a atteint son apogée[185].
[250]Il en est de l’architecture comme du métissage : le style dit « de Dienné » n’est en rien spécial aux Songaï et il est d’importation maghrébine et relativement récente. Nous savons par Ibn-Khaldoun et par le Tarikh-es-Soudân que les premières constructions de ce type furent bâties à Gao (une mosquée) et à Tombouctou (un palais et une mosquée) vers 1325, sous le règne et sur l’ordre de l’empereur mandingue Kankan-Moussa, par un poète de Grenade qui s’improvisa architecte, Abou-Ishak-es-Sahéli, lequel mourut à Tombouctou et y fut enterré. Avant cette époque, il n’y avait au Soudan que des huttes cylindriques couvertes en paille ou des abris rappelant les gourbis des Bédouins ou ceux des Touareg ; les « palais » même des empereurs n’étaient pas plus confortables ni plus remarquables que les « cases » de leurs sujets ; peut-être même les maisons à terrasse du type le plus primitif étaient-elles inconnues, car les auteurs arabes antérieurs au XIVe siècle (Ibn-Haoukal — qui avait voyagé au Soudan, — Bekri, Edrissi, Yakout) ne mentionnent pas d’autres habitations que les huttes à toit conique des Malinké et des Mossi d’aujourd’hui.
Ce fut vraisemblablement l’espagnol Abou-Ishak qui fut le premier inspirateur au Soudan occidental de ces maisons à portiques trapézoïdaux et de ces mosquées coiffées de pyramides dont l’aspect fait songer, en effet, mais d’assez loin, à des monuments de l’ancienne Egypte, mais que l’on rencontre partout, de l’Algérie et du Maroc à travers tout le Sahara, jusqu’à la lisière de la forêt tropicale. Cette architecture, motivée par les nécessités du climat et la rareté de certains matériaux ou l’ignorance de certaines techniques, est essentiellement maghrébine et non pas égyptienne[186]. Elle fut propagée au Soudan, non[251] pas par les Songaï, — qui sont loin de l’avoir tous adoptée et qui habitent souvent des abris hémisphériques en nattes copiés sur ceux des Touareg, — mais bien par les Marocains de Tombouctou d’une part et d’autre part par les Soninké de Dienné et leurs cousins-germains les Dioula. Les Diennéens sont passés maîtres en l’art de l’architecture soudanaise, cela n’est pas niable : mais ils ont été initiés à cet art par des Marocains et non par des Songaï et ils n’ont pas été chercher leurs modèles en Egypte.
La conclusion de ce qui précède peut se résumer ainsi : les Songaï actuels — surtout ceux des territoires civils du Haut-Sénégal-Niger — forment un peuple très mélangé, dont le fond primitif et l’élément principal sont constitués par une population nègre originaire sans doute de la région de Tillabéry-Niamey-Dosso, sur la rive gauche du bas Niger ; ils comprennent une caste de pêcheurs — les Sorko —, une caste de chasseurs — les Goou — et une classe ouvrière et paysanne — les Gabibi — qui, toutes les trois, sont demeurées à peu près vierges de tout élément de race blanche, mais dans lesquelles le type primitif a été plus ou moins modifié, chez les Sorko par des mélanges avec les Bozo, chez les Goou par des mélanges avec les Banmana et chez les Gabibi par des mélanges avec les Haoussa, les Gourmantché, les Mossi, les Tombo, les Soninké et les Banmana, selon les régions ; il y a lieu également, en ce qui concerne les Gabibi, de tenir compte de mélanges avec les Touareg et avec les Peuls qui ont parfois altéré le type nègre primitif ; ils comprennent enfin une classe noble — les Arma — dans la composition de laquelle l’élément de race blanche entre pour une part assez considérable : cet élément a été fourni principalement par des Européens de la péninsule ibérique et des Arabo-berbères du Maroc et, dans une proportion moindre, par des Touareg, des Maures et des Peuls. Quant à la classe des lettrés musulmans — les Alfa —, elle se recrute parmi tous les peuples du Soudan[252] et du Sahara, mais les Songaï y sont en infime minorité[187].
Je n’ai parlé, dans les pages qui précèdent, que des grands mouvements de migration ou de conquête qui ont porté les Songaï jusqu’au lac Débo. Il s’est produit en outre un certain nombre de mouvements secondaires en sens divers, dûs à différentes causes : c’est ainsi qu’après la prise de Gao par les Oulmidden en 1770, un certain nombre de Songaï émigrèrent de la région de Gao au Djerma-Ganda et du côté de Niamey (tradition recueillie par M. le Commandant Gaden) ; c’est ainsi encore que, d’après Barth, beaucoup de Songaï de la région de Bourem émigrèrent vers 1843 du côté de Goundam. D’autre part les Songaï ont fourni de tout temps un très fort contingent aux approvisionnements en esclaves du Sahara et du Maghreb : une bonne partie des Bella des Touareg et des Harrâtîn des Maures Kounta et Bérabich sont d’origine songaï ; on trouve des descendants d’esclaves de même provenance en beaucoup de points du Sud algérien et du Sud marocain : le lieutenant Cancel, ayant étudié récemment le langage des Balbali ou habitants de Tebalbalet, a découvert que ce langage est un dialecte à la fois songaï, arabe et berbère, mais avec prédominance marquée de mots songaï dans le vocabulaire et avec introduction des principales règles de la syntaxe songaï (Revue africaine, 1908).
Il semble bien que la famille mandé, dans son ensemble, est autochtone du Soudan Occidental. Son domaine primitif devait s’étendre le long du Niger, et principalement sur la rive gauche, depuis le lac Débo environ au Nord jusque vers les sources du Tinkisso au Sud. Le Diagha, Diaga ou Diaka[188] (du Débo à[253] Sansanding) fut le berceau des Mandé du Nord, le Mandé ou Manding ou Mali (haut Niger à hauteur de Bamako et haut Bakhoy) fut celui des Mandé du Centre et le Diallon ou Fouta-Diallon (du haut Tinkisso à la haute Falémé) fut celui des Mandé du Sud.
Bien avant le début de notre ère, la famille mandé devait être répandue dans toutes ces régions et en former la population à peu près exclusive.
1o Bozo.
Les Bozo devaient, au début, constituer chez les Mandé du Nord une caste de pêcheurs et de navigateurs absolument analogue à celle des Sorko chez les Songaï et à celle des Somono chez les Mandé du Centre. Ils habitaient principalement le lac Débo et le bras du Niger connu sous le nom de marigot de Dia ou Diaka. Ils durent à un moment donné se répandre un peu plus loin vers le Nord et vers le Sud et atteindre le Bani vers l’Est du côté de Mopti et de Dienné. Mais la poussée des Sorko par le Nord du XIIe au XIIIe siècles et celle des Somono par le Sud vers la même époque amenèrent la concentration des Bozo dans la région de leur berceau primitif, dont ils ne sont jamais sortis depuis qu’isolément et où ils sont encore considérés de nos jours comme propriétaires du sol et des eaux.
Tandis qu’ils demeuraient ainsi fixés dans leur patrie d’origine, les populations agricoles de même famille qui les entouraient se dispersaient au contraire dans tout le Soudan, sous le[254] nom de Soninké, et arrivaient, par suite de cette dispersion et de leur mélange avec des peuples très divers, à se différencier assez notablement de leurs congénères pêcheurs que leur métier avait attachés aux rives du fleuve. C’est ainsi qu’aujourd’hui, par le type, les mœurs et la langue, les Soninké se distinguent des Bozo, quoique d’ailleurs les ressemblances entre les deux peuples soient également considérables. Mais leur communauté d’origine ne semble pas douteuse.
Ajoutons à cela que des unions se sont produites depuis des siècles entre les Bozo primitifs et des familles appartenant aux castes de pêcheurs d’autres nationalités, telles que la caste songaï des Sorko, la caste banmana des Somono et la caste peule des Soubalbé. Ces unions eurent comme résultat d’altérer quelque peu le type initial des Bozo et de modifier considérablement sans doute leur parler primitif.
Les Bozo sont actuellement tous musulmans : ils le sont probablement depuis le XIVe siècle, ayant dû se convertir à la même époque que les gens de Dienné.
2o Soninké.
Ainsi que je viens de le dire, les Soninké ont eu, comme les Bozo, pour habitat primitif le Diaga ou Massina[189] et, comme les Bozo aussi, ils formaient à l’origine une population exclusivement nègre et bien plus rapprochée des Mandé du Centre qu’elle ne l’est actuellement[190].
[255]Dès une époque fort ancienne, vers 200 avant J.-C. au plus tard, des Soninké partis du Diaga s’avancèrent vers le Nord-Ouest et allèrent fonder des colonies agricoles dans les régions où se trouvent aujourd’hui Bassikounou, Néma et Oualata. Peut-être même la fondation de Néma remonte-t-elle à cette période lointaine, ainsi que celle de Ghana, qui devait être très voisine de Néma et de l’emplacement où s’éleva plus tard[191] Birou ou Oualata.
Lorsque, au début du IIe siècle de notre ère, les Judéo-Syriens venant de la Cyrénaïque par l’Aïr s’installèrent au Diaga, les Soninké subirent quelque peu leur ascendant et, dès ce moment, des éléments de race blanche commencèrent à s’introduire parmi eux. Nous avons vu comment, vers le milieu du même siècle, ils obligèrent les Judéo-Syriens à quitter le Diaga et comment ces derniers, suivant la même voie qu’avaient tracée les Soninké longtemps auparavant, allèrent se fixer dans l’Aoukar, à côté des colonies soninké de Néma et de Ghana. Quelque cinquante ans plus tard, les Judéo-Syriens du Touat venaient les y rejoindre et vers la fin du IIIe siècle se constituait à Ghana un état assez puissant dont les maîtres étaient ces Judéo-Syriens ou Proto-Peuls.
A ce moment, un certain nombre de Soninké de l’Aoukar, fuyant le joug de ces étrangers, continuèrent leur migration vers le Nord-Ouest et se portèrent jusque dans le Tagant et dans l’Adrar mauritanien, que les Berbères n’occupaient encore qu’incomplètement. Les Azer actuels de Oualata[192], de Tichit, de Chinguetti[193], etc. ne sont que les descendants, sans[256] doute métissés de Berbères, de ces Soninké des premières migrations. Un nouvel élément de même souche leur fut apporté d’ailleurs vers la fin du VIIIe siècle par les Soninké accompagnant les Ahl-Massina d’origine judéo-syrienne qui, venant de Ghana, fondèrent Tichit et gagnèrent l’Adrar.
Cependant le gros de la population soninké était demeuré au Diaga. Vers la fin du VIIe siècle, pour des raisons ignorées, un groupe assez considérable quitta ce pays, tenta un premier essai de colonisation du côté de Dienné[194], puis, rebroussant chemin vers l’Ouest, se porta par le Kaniaga jusqu’au Kingui et au Diafounou, laissant probablement des fractions colonisatrices le long de son itinéraire. Vers 750, la majeure partie des émigrants, quittant le Kingui pour retourner presque sur leurs pas, arrivèrent au Ouagadou, où ils fondèrent, sous la direction de Maghan-Diabé Sissé, le premier état soninké sur lequel les traditions nous aient quelque peu renseignés.
Une légende, encore très vivante chez tous les Soninké du Sahel et rapportée plus d’une fois déjà par des Européens[195], raconte, en l’agrémentant de détails qui tiennent du merveilleux, le récit de cette migration du Diaga au Ouagadou par le Kaniaga et le Kingui. D’après cette légende, le chef de la migration aurait été un nommé Digna ou Dinga, fils de Kiridion-Tagamanké fils de Yougou-Doumbessé (lequel descendait de Job fils de Salomon fils de David !) ; ce Digna, ancêtre du clan royal soninké des Sempré, Soumpara ou Simbara, avait[257] quitté le Diaga avec une bande de 300 hommes armés, accompagné de prêtres, devins et sorciers dont le chef s’appelait Garabara-Diané ou Diadiané et aurait été l’ancêtre du clan des Soudouré. Digna s’arrêta d’abord dans la contrée de Dienné et y épousa une femme nommée Satakoullé Dafé ; étant demeuré là 17 ans[196] sans que cette femme lui eût donné de postérité, il la répudia, quitta le pays de Dienné et revint au Diaga, où il épousa Assakoullé Soudouré. Celle-ci enfanta trois jumeaux, dont l’un mourut à sa naissance ; le second, Dia-Founè, ancêtre du clan des Dikéné ou Dyikéné, alla s’établir dans le pays qui fut appelé à cause de lui Diafounou et le colonisa ; le troisième, Diagabâ-Founè[197], père du clan des Souaré, demeura dans le Diaga.
Lorsque ses deux fils furent devenus des hommes, Digna, — dont la longévité est comparable à celle des patriarches bibliques, — poussa jusqu’au Kingui (province de Nioro) et se fixa à Daraga, près de la mare de Dioka (sur la route de Nioro à Kayes). Arrivé là, il envoya des gens puiser de l’eau ; ces gens aperçurent un génie assis au bord du puits et revinrent en toute hâte prévenir Digna. Celui-ci se rendit au puits et, grâce aux sortilèges dont disposaient ses prêtres, rendit le génie aveugle, sourd et paralytique, ce qui n’empêcha pas toutefois le génie d’en faire autant à Digna. Alors intervint Garabara, le chef des sorciers, dont les procédés magiques rendirent à Digna l’usage de ses sens, tandis que le génie demeurait privé de la vue, de l’ouïe et du mouvement. Sans doute il avait conservé la faculté de parler, car il offrit à Digna, si ce dernier le guérissait, de devenir son allié et de lui donner ses trois filles en mariage ; Digna accepta et rendit au génie le libre usage de ses sens et de ses mouvements. Après quoi il épousa les trois filles du génie.
De la première, nommée Diangana Boro, il eut cinq fils et un serpent, lequel fut appelé Ouagadou Bida et s’enfuit dès qu’il[258] fut sorti du sein de sa mère, sans que l’on sût où il était allé. Nous le retrouverons tout à l’heure. Les cinq fils furent : Téré-Kiné, père des Soma ou Sokhona ; Téré-Kalé, père des Kalé[198] ; Lampakhé-Boundayoré, père des Bérété ; Kara-Guidé, père des Séméga, et Toungamari-Kabida, père des Diâbi ou Diâbira. De la deuxième fille du génie, nommée Katana Boro, il eut aussi cinq fils, pères du clan des Sissé, issu lui-même, comme on le voit, de celui des Sempré : Maghan-Diabé, qui fut le premier roi du Ouagadou ainsi que nous l’allons voir, Maghan-Tané, Maghan-Tané-Fankanté, Maghan-Mamari et Maghan-Kaya[199], qui devait être plus tard le fondateur de l’empire soninké de Ghana. Enfin, de la troisième fille du génie, nommée Sinanguillé Gounékousso, il eut quatre fils : Mamari, père des Touré et des Diabéra ; Fassiré, père des Koumma ou Koumba ; Matam, qui n’eut pas de descendants, et Douissé ou Dowissé, que la légende donne comme ancêtre aux Harrâtîn soninké qui vivent avec les Idao-Aïch de la sous-tribu des Ahl-Soueïd.
Cependant Digna, parvenu à un âge très avancé, était devenu aveugle. Un jour, il dit à Téré-Kiné, l’aîné de ses fils présents au Kingui, d’aller lui tuer du gibier, lui promettant, s’il lui en rapportait, de lui conférer l’insigne du pouvoir royal. Garabara-Diané, chef des sorciers, avait eu à se plaindre de Téré-Kiné et avait au contraire une grande affection pour Maghan-Diabé, l’aîné des enfants de la seconde femme de Digna. Or Téré-Kiné était particulièrement velu. Garabara prit donc une peau de bélier, en revêtit Maghan-Diabé, mit une chèvre entre les mains de ce dernier et l’amena auprès du vieillard, disant : « Voici Téré-Kiné qui revient de la chasse et t’apporte une antilope. » Digna demanda à Maghan-Diabé : « Est-ce bien toi Téré-Kiné ? — C’est bien moi », répondit Maghan-Diabé. L’aveugle passa sa main sur la toison du bélier et dit : « Mon fils, ta voix ressemble à celle de Maghan-Diabé, mais ta peau velue est bien[259] celle de Téré-Kiné. D’ailleurs n’êtes-vous pas tous mes enfants ? » Puis il remit à Maghan-Diabé la chaîne qui était l’insigne de son pouvoir[200].
Sur ces entrefaites, Téré-Kiné revint de la chasse avec un buffle qu’il avait tué et, apprenant la supercherie dont avait usé son frère, il entra dans une violente colère et voulut tuer Maghan-Diabé. Digna l’apaisa en lui donnant un talisman qui assurait à Téré-Kiné et à ses descendants la faculté de faire tomber la pluie à volonté, pouvoir qui est encore attribué de nos jours aux membres du clan des Sokhona.
Peu après, Digna mourut. Garabara, ayant consulté les présages, prédit à Maghan-Diabé qu’il régnerait un jour en un endroit du Sahel appelé Koumbi et situé dans l’Est. En conséquence, laissant au Kingui Téré-Kiné et tous les enfants de la première et de la troisième femme de son père, Maghan-Diabé quitta Daraga avec ses propres frères utérins (les Sissé), Garabara et quarante cavaliers. La petite troupe, marchant vers l’Est, arriva en un pays habité par des hyènes dont le chef s’appelait Tourougoulé Fadiga ; Maghan-Diabé demanda à ce dernier de lui indiquer le chemin de Koumbi : le chef des hyènes lui dit de continuer vers l’Est. Un peu plus loin, la troupe arriva au pays des vautours dont le chef, Douga, exigea quarante cadavres de chevaux pour montrer la route de Koumbi. Maghan-Diabé sacrifia donc ses quarante montures, dont les vautours se régalèrent. Puis Douga se mit à voler en avant de la troupe, pour lui montrer le chemin, et, s’arrêtant enfin sur un arbre, près de l’endroit où se trouve aujourd’hui Goumbou, dit : « C’est ici Koumbi. »
Maghan-Diabé fit abattre cet arbre. L’arbre, en tombant à terre, découvrit l’orifice d’un puits au-dessus duquel il avait poussé et de ce puits sortit un serpent qui dit à Maghan-Diabé : « Je suis Ouagadou Bida, ton frère et le frère de Téré-Kiné dont tu as usurpé le rang ; en sortant du ventre de ma mère, je suis venu résider dans ce puits, et la terre qui entoure ce puits, et qui s’appelle Ouagadou à cause de moi, est ma terre. Je ne[260] veux pas que tu viennes m’y déranger. » Cependant, Maghan-Diabé ayant proposé une transaction au serpent, celui-ci déclara qu’il consentait à laisser son frère s’établir dans le pays et à demeurer lui-même dans son puits sans en jamais sortir, à condition qu’on lui donnât en pâture cent vierges par an. Maghan trouva cette exigence inacceptable et offrit de lui donner seulement, chaque fois qu’aurait lieu la fête annuelle des cultures, la plus jolie fille qui se trouverait à ce moment là dans le pays. Le serpent accepta cet arrangement et rentra dans son puits[201].
De l’arbre qui avait été abattu sortit alors un tambour qui se mit à jouer tout seul ; à l’appel de ce tambour magique, des hommes accoururent, venant de toutes les directions : ils étaient 9.999, tous montés sur des chevaux bais, et divisés en quatre compagnies dont chacune avait un chef. Ces chefs étaient : Ouagané Sakho, père du clan des Sakho ; Diaméra Sogona, père des Diagouraga (fraction des Diawara) ; Makhan Doumbé, père des Silla, et Goumaté Fadé, père des Yaressi (ou Diaressi ou Diarisso).
Lorsque toute cette foule fut réunie, sur le conseil de Garabara, on décida d’élire comme roi celui dont le bras aurait exactement la même longueur que le tambour[202]. Tous les chefs enfoncèrent successivement leur bras à l’intérieur du tambour, mais seul Maghan-Diabé put le remplir exactement avec son bras et, en conséquence, il fut reconnu roi par toute l’assemblée.
Devenu ainsi le souverain du Ouagadou, Maghan-Diabé s’installa à Koumbi et partagea son royaume en cinq provinces, gardant pour lui le Ouagadou proprement dit, et donnant le commandement des quatre autres aux quatre chefs de cavaliers accourus à l’appel du tambour magique : Ouagané Sakho reçut[261] le Nord-Ouest et se fixa à Diara (près et au Nord-Est de Nioro) ; Diaméra Sogona eut l’Est et se fixa à Guesséné dans le Sud du Kaniaga (tout près de Sosso) ; Makhan Doumbé eut le Sud-Ouest et se fixa à Kamatingué (entre Goumbou et Nioro), d’où il se rendit ensuite dans le Kaarta ; enfin Goumaté Fadé reçut le Sud-Est en partage et alla demeurer au Bélédougou (vers l’an 750 environ).
Chaque année, à la fête des cultures qui se célèbre lors des premières pluies, les quatre chefs de province venaient saluer le roi du Ouagadou à Koumbi et une vierge était sacrifiée au serpent.
Lorsque Maghan-Diabé mourut, son frère Maghan-Tané lui succéda ; ensuite régna Maghan-Tané-Fankanté, puis Maghan-Mamari et enfin Maghan-Kaya ou Kaya-Maghan Sissé, le dernier des cinq fils de Katana Boro, sous le règne duquel eut lieu la ruine du Ouagadou et la dispersion de ses habitants (fin du VIIIe siècle).
Voici comment la tradition rapporte le motif et les circonstances de cet événement mémorable. Un nommé Mamari-Sité Dorhoté, originaire du Kaniaga, sorte de magicien remarquable par son caractère silencieux — il ne parlait que deux fois par an —, était venu résider à Diara auprès de Ouagané Sakho, au clan duquel il s’était affilié, changeant son nom primitif en celui de Mamari Sakho. Il était amoureux d’une jeune fille nommée Sia Yatébari qui, cette année-là, fut choisie en raison de sa beauté pour être offerte au serpent. Lorsque le jour du sacrifice fut arrivé, Mamari Sakho se rendit à Koumbi, armé d’un sabre soigneusement aiguisé, et, se glissant parmi la foule, se plaça près du puits sacré. Le serpent, selon la coutume, sortit deux fois sa tête pour regarder la vierge qu’on lui destinait ; au moment où il la dressait une troisième fois et se préparait à s’emparer de Sia, Mamari se précipita sur lui et lui frappa sept fois le cou avec son sabre : au septième coup, la tête du serpent se détacha, mais, au lieu de tomber, elle s’éleva dans les airs en disant : « Mamari Sakho, tu as détruit le Ouagadou ; pendant sept ans, il ne pleuvra plus dans ce pays, car la pluie que je faisais tomber sera désormais transformée en or et le[262] Ouagadou n’en profitera plus. » Et en effet la tête du serpent s’en alla tomber au Sud du Mandé, dans le Bouré, qui devint la contrée du Soudan la plus riche en or.
Les assistants voulurent faire un mauvais parti à Mamari, mais ce dernier, sautant sur son cheval, réussit à s’enfuir ; Ouagané Sakho le rejoignit, mais, parce qu’il appartenait au même clan que lui, il n’osa pas le tuer et le laissa aller.
Cependant les menaces du serpent se réalisèrent ; pas une goutte d’eau ne tomba au Ouagadou durant sept années consécutives ; une grande disette s’ensuivit et les Soninké quittèrent ce pays maudit pour se disperser de tous côtés, à la recherche de régions plus fertiles.
Les uns, sous la conduite d’Alikassa Sempré, fils de Maghan Diabé, se portèrent vers le Tekrour, au Guidimaka et au Galam qu’ils appelèrent Gadiaga ; ils fondèrent là les premières colonies soninké, celles de Yaressi et de Silla, ainsi nommées des clans issus de Goumaté Fadé et de Makhan Doumbé qui les créèrent ; les membres du clan royal des Sempré qui faisaient partie de la même migration fondèrent Galambou[203]. Une tradition recueillie par Mage raconte qu’Alikassa, s’étant baigné un jour dans un affluent de la Falémé appelé Bakili que les autochtones considéraient comme un cours d’eau sacré, et n’ayant éprouvé aucune conséquence fâcheuse de son imprudence, fut regardé comme un grand sorcier par les indigènes et devint roi du Galam. En souvenir de cette circonstance, ses descendants changèrent leur nom de Sempré en Bakili. Le royaume du Galam ou Gadiaga eut pour capitale Galambou, appelée aussi Kounguel ; il comprenait le Goye, le Kaméra et le Guidimaka.
D’autres s’arrêtèrent dans le Bakounou, le Kingui, le Guidioumé[263] et le Diafounou, où ils possédaient déjà des compatriotes. D’autres émigrèrent du côté de Kala (Sokolo) ou retournèrent au Kaniaga et se mêlèrent aux compagnons de Goumaté Fadé établis dans le Nord du Bélédougou, donnant ainsi naissance à ce qui fut plus tard l’empire soninké des Sossé ou du Kaniaga.
D’autres encore, du clan des Kounaté ou Konaté (originaires de Kouna ou Kona, dans l’Est du Massina, au Sud et près du Débo), rebroussèrent chemin jusqu’au Diaga, traversèrent le Niger et allèrent, vers l’an 800, fonder Dienné, ou tout au moins fonder une colonie soninké à l’endroit où devait s’élever plus tard la ville de Dienné proprement dite. D’après la tradition[204], des Bobo étaient alors installés à Kanafa, sur le plateau où se trouve aujourd’hui la ville, et des Bozo demeuraient au Sud du même plateau, en un lieu appelé Dioboro, près du village actuel de Pérou. Les Soninké, commandés par un nommé Adyini Kounaté, se seraient fixés auprès des Bozo de Dioboro et les Bobo, gênés par ce voisinage, auraient peu après émigré du côté de Bandiagara.
Mais le plus grand nombre des Soninké du Ouagadou, sous le commandement de Kaya-Maghan ou Maghan-Kaya, qui régnait au moment de la dispersion, se porta vers le Nord et alla rejoindre les premiers colons soninké de la région de Ghana, dont la prospérité et la richesse attirait les affamés du Ouagadou en excitant leur convoitise. Beaucoup de Soninké demeurés au Diaga lors de la migration de Digna étaient venus depuis directement dans l’Aoukar, en sorte que le nombre total des Soninké répandus à Ghana et dans les environs devait être considérable à la fin du VIIIe siècle. Kaya-Maghan en profita pour renverser la dynastie des Judéo-Syriens, s’emparer du pouvoir et établir la suprématie soninké sur l’empire de Ghana : ce fut, comme nous l’avons vu, le signal de l’exode des Proto-Peuls vers le Fouta-Toro[205].
[264]L’Aoukar et sa capitale Ghana durent constituer le centre principal des Soninké, au moins au point de vue politique, depuis les premières années du IXe siècle jusque vers la fin du XIe. Tour à tour rivaux et suzerains des Berbères Lemtouna d’Aoudaghost, les Soninké de Ghana établirent à la fin du Xe siècle leur suprématie sur tout le Hodh et une partie au moins du Tagant, sur le Massina et le Bagana et sur tous les pays compris entre le Niger et le Tekrour où leurs compatriotes avaient fondé déjà des colonies. Ce fut le moment brillant de leur histoire. Ce fut aussi celui où s’acheva leur formation ethnique, par des mélanges nombreux et répétés avec des Berbères dans le Nord et avec des Toucouleurs dans le Sud-Ouest, mélanges venant s’ajouter à ceux déjà subis du fait du contact avec les Judéo-Syriens dans le Diaga et l’Aoukar : c’est à ces mélanges, où l’élément de race blanche entra pour une part fort appréciable, que les Soninké doivent leurs caractères physiques et moraux actuels, et que leur langue doit également les particularités qui la distinguent nettement des dialectes mandé du Centre.
Mais les migrations et contre-migrations des Soninké étaient loin d’avoir pris fin et leur dispersion à travers tout le Soudan Occidental n’en était encore qu’à ses débuts. En 1076 les Lemtouna, entraînés à la guerre sainte par Abdallah-ben-Yassine,[265] s’emparaient de Ghana, pillaient la ville, massacraient une partie des habitants et convertissaient à l’islamisme ceux qui préférèrent la religion nouvelle à la mort ou à la fuite. Beaucoup de Soninké demeurèrent dans l’Aoukar où, devenus musulmans, ils subirent jusque vers 1090 le joug des Berbères, puis recouvrèrent leur indépendance. Mais beaucoup aussi émigrèrent de Ghana vers le Sud, le Sud-Ouest et le Sud-Est à la fin du XIe siècle, achevant de constituer les états soninké déjà ébauchés dans le Kaniaga, le Bakounou, le Kingui, le Galam, et ramenant au Diaga un nouveau flot de population.
D’après une tradition, les familles soninké qui s’enfuirent de Ghana lors de la conquête almoravide descendaient principalement des premiers colons demeurés dans l’Aoukar au temps de la domination judéo-syrienne et appartenaient surtout aux clans suivants : les Doukouré, descendants d’un nommé Bentigui, qui était au service d’un ministre du dernier empereur judéo-syrien de Ghana et dont le fils aurait assassiné cet empereur, sans doute au moment de l’arrivée de Kaya-Maghan Sissé dans l’Aoukar ; les Soumaré, descendants d’un autre familier du même ministre ; les Diakaté ou Niakaté et les Diarisso, ainsi que les Mangara, les Samoura et les Koussata, descendants de vassaux des empereurs judéo-syriens eux-mêmes ; enfin les Tounkara qui, eux, se composaient des derniers débris de la famille impériale soninké des Sissé, c’est-à-dire des descendants de Kaya-Maghan.
Les Diarisso fondèrent un royaume au Kaniaga, où ils retrouvèrent des gens de leur clan en la personne des descendants de Goumaté-Fadé : ce fut l’origine du fameux empire de Sosso ou des Sossé, qui devait devenir célèbre quelque cent ans plus tard avec la dynastie des Kannté.
Les Doukouré fondèrent au Bakounou d’abord, puis à Goumbou, un royaume qui, en quelque sorte, correspondait à l’ancien royaume du Ouagadou. Leur chef Maré-Diago Doukouré, en quittant Ghana, se porta d’abord dans le Guimbala, sur la rive nord du Débo, alla de là à Dienné, puis à Diongoï dans le Sud du Bakounou, où il se fixa et mourut. Ouari Doukouré, son successeur, transporta sa résidence à Tanganaga, près et à l’Ouest-Nord-Ouest[266] de Goumbou, tandis qu’un de ses frères allait s’installer dans le Diafounou. Toumané Doukouré ayant succédé à Ouari, un berger lui signala un emplacement bien préférable à Tanganaga : c’était Goumbou. Toumané et son frère cadet Boubou, accompagnés de tous les notables du royaume, partirent à cheval pour aller reconnaître l’endroit ; mais un devin avait prédit que le premier des deux frères qui mettrait pied à terre mourrait aussitôt ; aussi, lorsqu’on fut arrivé à Goumbou, Toumané invita Boubou à descendre de cheval le premier. Boubou, pour ne pas désobéir à son aîné, accepta de faire le sacrifice de sa vie ; mais, avant de mettre pied à terre, il fit disposer d’un côté le trésor de la famille royale et fit ranger d’un autre côté les notables du pays, puis il dit à Toumané : « Choisis entre ces deux trésors, les biens ou les hommes ; mes enfants, après ma mort, auront ce que tu auras dédaigné. » Toumané choisit les biens. Boubou, ayant recommandé ses enfants aux notables, descendit alors de cheval et mourut incontinent. Les notables déclarèrent à Toumané que, puisqu’il leur avait préféré la richesse, ils ne dépendaient plus de lui désormais, mais bien du fils aîné de Boubou, Bouyagui-Toumbéli, qui n’était encore qu’un enfant mais auquel échut néanmoins le commandement du royaume. Un vieillard, Diéroumfa Doukouré, fut nommé tuteur du jeune roi ; au bout de sept ans, Bouyagui-Toumbéli Doukouré prit en mains les rênes de l’Etat (fin du XIIe siècle ou commencement du XIIIe). Depuis cette époque jusqu’à présent, les descendants de Boubou Doukouré ont conservé le commandement politique à Goumbou[206], tandis que ceux de Toumané n’ont pas cessé d’être considérés comme les maîtres du sol.
Les Niakaté ou Diakaté s’établirent à Diara, dans le Kingui, et y fondèrent, à la fin du XIe ou au commencement du XIIe siècle, un royaume qui dura environ un siècle et demi et fut renversé[267] par les Diawara vers 1270. Les légendes que j’ai eues à ma disposition ne racontent rien des débuts de ce modeste Etat : seul, son dernier roi, qui vécut probablement entre 1200 et 1250, est mentionné. Ce roi s’appelait Mana-Maghan ; il s’enrichit par le commerce qu’il faisait avec le Tekrour d’une part et le Tagant de l’autre et, grâce à sa fortune, put équiper des bandes nombreuses de guerriers et devenir un chef redoutable[207]. Les Peuls Diawambé alors répandus au Kaarta étaient constamment pillés et rançonnés par les bandes des premiers empereurs mandingues[208] ; ils firent appel à Mana-Maghan Niakaté, qui alla attaquer les Mandingues dans le Kaarta mais qui, trop faible pour s’y maintenir, dut revenir au Kingui, ramenant avec lui un grand nombre de Diawambé qu’il installa auprès de Diara et qui, un peu plus tard, devaient fonder Nioro. Mana-Maghan et sa famille eurent une destinée tragique : lui disparut dans des circonstances mystérieuses que je relaterai un peu plus loin, en parlant des Diawara ; de ses deux fils, l’un, Bemba, fut tué par des Peuls dont il cherchait à dérober le troupeau et l’autre, Mana, se noya dans le Niger — ou dans le Sénégal — au cours d’une razzia dirigée également contre des Peuls. Après la disparition de Mana-Maghan et l’installation des Diawara à Diara (1270), les Niakaté émigrèrent en grand nombre dans le Guidioumé, où ils sont encore.
Parmi les autres familles soninké qui avaient fui Ghana en 1076, les unes allèrent s’installer dans le Guidimaka et le Galam auprès des Yaressi, des Silla et des Bakili, les autres se fixèrent dans le Diaga, leur ancienne patrie. Ces dernières, comprenant principalement des Sissé-Tounkara, des Koussata, des Koumma ou Koumba, des Bérété, des Diâbi et des Koné, passèrent par Bassikounou et Dioura et vinrent s’établir dans la province méridionale du Diaga connue sous le nom de Mîma ou Méma, à[268] Dia, à Diakolo et surtout à Nono, ce qui leur valut le surnom de Soninké-Nono ou, chez les Peuls, de Nononkobé[209].
Passons maintenant aux premières années du XIIIe siècle : en 1203, Soumangourou (ou Soumahoro) Kannté, alors souverain de l’empire soninké des Sossé qui avait sa capitale à Sosso[210] dans le Kaniaga, fait la conquête de Ghana et étend son autorité sur tout le Bagana, sur le Diaga, sur Ségou et sur une partie au moins du Bélédougou et du Kaarta. Onze ans après la prise de Ghana par Soumangourou, en 1224, des Soninké de cette ville, qui sans doute avaient pris parti contre les Sossé et avaient dû fuir la colère du vainqueur, fondèrent dans la même région un modeste village qu’ils appelèrent Birou (les tentes) et qui devait devenir célèbre sous son nom berbère de Oualata ou Ioualaten lorsque, quelque vingt ans plus tard, il allait succéder comme métropole de l’Aoukar à Ghana détruite par Soundiata.
Ce Soundiata était empereur des Mandingues lorsque la puissance des Sossé avait atteint son apogée. En 1235, il réussit à vaincre Soumangourou entre Koulikoro et Niamina[211] et à s’emparer de tous ses Etats. Un grand nombre de Sossé émigrèrent[269] alors vers le Tekrour, le bas Sénégal et la Gambie, où on retrouve encore de nos jours leurs descendants, plus ou moins mélangés aux Toucouleurs, aux Ouolofs, aux Sérères et aux Malinké.
En 1240, Soundiata détruisait définitivement Ghana, établissait sa résidence près de Niamina, fondait là une ville à laquelle on donna le nom de son pays d’origine (Mandé ou Mali) et devenait le maître de tout le haut Niger, depuis ses sources jusqu’à la région des lacs. Les Soninké du Diaga acceptèrent assez malaisément la domination mandingue et ceux de Nono en particulier cherchèrent à s’y soustraire par l’émigration. Certains descendirent la rive gauche du Niger et allèrent fonder, entre Niafounké et Bassikounou, une colonie qui prit aussi le nom de Nono (ou Nounou) et qui a subsisté jusqu’à nos jours ; cette colonie est citée par le Tarikh-es-Soudân, qui y fait régner une femme nommée Bikoun-Kabi et qui parle de la conquête de ce pays par Sonni Ali-Ber vers 1473 ; aujourd’hui, les descendants de ces Soninké-Nono — que Sa’di appelle par erreur « Sanhadja Nono » — parlent songaï et sont appelés Dakouraré ; ils habitent Nounou (près de Niafounké, au Sud du lac Gaouati) et quelques villages voisins de Soumpi aux environs de la route de Niafounké à Bassikounou.
D’autres Soninké du Diaga (les Komma ou Koumba) remontèrent la rive gauche du fleuve et allèrent fonder Sansanding.
Mais le plus grand nombre des Soninké-Nono, traversant le Niger à Diafarabé, occupèrent entre ce fleuve et le Bani le pays compris, d’une façon générale, de Diafarabé à Mopti et à San et choisirent comme centre de leur nouvelle colonie le point de Dienné, où des Soninké s’étaient établis déjà depuis le début du IXe siècle, mais dont la fondation véritable peut être placée à cette époque (1250 environ). Les nouveaux arrivants — qui appartenaient aux clans des Mana, des Sissé, des Touré et des Diâbi — s’établirent d’abord auprès des Kounaté, dans le village bozo de Dioboro ; mais ils étaient nombreux et il devint bientôt manifeste que l’emplacement était trop étroit pour contenir tout le monde. Les Soninké-Nono demandèrent donc aux Bozo, les[270] plus anciens occupants du pays, de leur désigner un autre emplacement, et les Bozo leur indiquèrent le plateau de Kanafa, qu’avaient habité autrefois des Bobo. Les Soninké-Nono s’y transportèrent, comblèrent les mares qui s’y trouvaient et construisirent un village auquel ils donnèrent le nom de Dienné[212]. Les génies du lieu exigèrent, pour assurer la prospérité future du nouveau village, qu’on leur sacrifiât une vierge en holocauste ; une jeune fille fut donc procurée par les Bozo de Dioboro au patriarche des Mana, chef des Soninké-Nono, qui la fit murer vive dans l’enceinte en construction, près de la porte dite aujourd’hui porte de Kanafa. Avant que la jeune fille eut rendu le dernier soupir, on l’entendit, à travers l’argile encore molle dont on venait de la recouvrir, recommander aux Soninké de se souvenir toujours que c’était aux Bozo qu’ils devraient la prospérité de leur ville[213]. Les Soninké de Dienné furent surtout des commerçants : leurs rapports continuels avec Tombouctou et leurs voyages sur le fleuve en aval de Mopti leur firent adopter la langue songaï, à partir du XVIe siècle probablement, au détriment de leur langue propre. Leurs descendants actuels parlent tous le songaï, mais ceux qui habitent le Pondori, entre Dienné et Diafarabé, et qui se livrent surtout à l’agriculture, ont conservé l’usage de la langue soninké. Peu après l’établissement définitif des Soninké à Dienné, vers 1300, Koumboro Mana, vingt-sixième chef de la colonie depuis sa fondation première par les Kounaté, se convertit à l’islamisme ; à partir de cette époque, les Diennenké furent toujours de fervents musulmans.
Vers 1270, c’est-à-dire une trentaine d’années après la construction[271] de Dienné sur son emplacement actuel, une nouvelle fraction du peuple soninké se constituait au Kingui, celle des Diawara, qui prenait à Diara la place de la dynastie Niakaté. L’ancêtre des Diawara aurait été un chasseur d’origine inconnue, Daman-Guilé, fils d’un certain Modi-Moussa Moumini et venu de la direction du Hidjaz — c’est-à-dire du Nord-Est — dans le Manding, en compagnie des nommés Ségui-Khèri, Dimbané et Niagué-Maghan, ce dernier ancêtre du clan des Kamara. Daman-Guilé serait arrivé au Manding à l’époque où régnait Soundiata Keïta, c’est-à-dire dans le deuxième quart du XIIIe siècle. Un homme de la caste des Garankè (cordonniers), nommé Kaké-Kanédyi[214], qui vivait auprès de Soundiata, étant allé dans la brousse afin de chercher de l’écorce de mimosa pour tanner ses cuirs, rencontra Daman et ses compagnons. Il leur demanda qui ils étaient et d’où ils venaient. Daman se contenta de répondre : « Nous sommes des chasseurs venus de l’Est », et pria Kaké d’aller avertir l’empereur de leur arrivée. Soundiata, averti par Kaké, convoqua Daman-Guilé et ses compagnons ; comme il leur demandait quel était leur diamou (nom de clan), Daman répondit : « Dia wara », ce qui, dans la langue de son pays — rapporte la légende —, voulait dire : « Il n’y a pas de clans chez nous »[215]. Mais on prit cette réponse pour l’énonciation de leur nom de clan, et on les appela Diawara,[272] nom qui leur resta. Comme ils avaient été présentés à l’empereur par un cordonnier, on prétendit plus tard que les Diawara étaient des esclaves de cordonniers.
Soundiata autorisa Daman et les siens à résider avec Kaké dans le quartier des cordonniers. Daman se livrait à la chasse ; chaque fois qu’il rapportait du gibier, il en offrait à l’empereur, dont il gagna ainsi l’amitié.
Un jour que Daman était à l’affût, embusqué dans une cachette, un marabout passa, se dirigeant vers l’Est, et vint se reposer près de lui sans le voir. Lorsque cet homme se leva pour reprendre sa route, il oublia à terre un sachet rempli de poudre d’or. Daman, étant sorti de sa cachette, vit ce sachet, le ramassa et le plaça dans le creux d’un arbre dont il boucha avec soin l’ouverture. L’année suivante, le propriétaire de l’or étant repassé dans le pays, Daman le mena à l’arbre, en sortit le sachet d’or et le rendit au marabout, qui lui demanda ce qu’il pouvait faire qui lui fût agréable. Daman lui dit : « Quand tu iras à La Mecque en pèlerinage, demande au grand chérif qu’il te donne pour moi un sabre avec lequel je puisse trancher la tête aux buffles que je rencontrerai à la chasse. » Le marabout alla en effet à La Mecque ; il allait quitter la ville sainte en oubliant la commission dont l’avait chargé Daman — ce marabout avait le caractère oublieux —, lorsque le grand chérif, qui devinait les choses cachées, le fit appeler et lui dit : « Quelqu’un ne t’avait-il pas donné une commission pour moi ? » Le marabout se rappela alors la recommandation de Daman et raconta l’histoire au chérif, qui lui remit pour le chasseur un sabre court doué de vertus merveilleuses. Lorsque le pèlerin fut de retour au Manding, les courtisans de Soundiata lui représentèrent que ce sabre était trop précieux pour un simple esclave de cordonnier et, se laissant faire, il donna l’arme magique à l’empereur, comme un présent du grand chérif de La Mecque.
Quelque temps après, Soundiata voulut récompenser Daman du zèle qu’apportait ce dernier à le fournir de gibier et lui demanda ce qu’il désirait : « Un sabre, répondit Daman, avec lequel je puisse trancher le cou des buffles. » Soundiata dit alors à l’une de ses femmes, nommée Niagalé-Messéni, d’aller[273] prendre un sabre dans son armurerie et de le lui apporter ; la femme alla et revint avec le sabre du grand chérif : « Pas celui-là ! s’écria l’empereur, remporte-le et apportes-en un autre. » Niagalé retourna au magasin d’armes, replaça le sabre du chérif et voulut en prendre un autre, mais, malgré elle, sa main alla se poser de nouveau sur le glaive magique, et il en fut ainsi par trois fois. Soundiata dit alors à Daman : « C’est Dieu qui l’a voulu : prends ce sabre qui t’appartient, mais sors de mes Etats, car le possesseur de cette arme sera un roi puissant que je ne désire pas avoir pour voisin. »
Daman-Guilé, devenu ainsi maître du sabre merveilleux qui devait devenir l’insigne du pouvoir royal chez les Diawara[216], rassembla donc ses compagnons et se rendit près de Ségou, à Nionko, où il se livra de nouveau à son métier de chasseur ; il y eut un fils qu’il appela Diara-Mamadi. Dans ce temps-là, le pays de Ségou était gouverné par un lieutenant de Soundiata nommé Silla-Makamba Keïta, qui résidait sur la rive droite du Niger, en aval de Ségou, à l’endroit où est aujourd’hui le village de Markadougouba. Daman lui apportait constamment du gibier, en sorte que le gouverneur de Ségou prit le chasseur en affection et qu’un jour il lui dit : « J’ai une fille, nommé Koria Keïta, que je ne veux donner en mariage à aucun de mes sujets, parce que des devins m’ont prédit qu’elle enfanterait un grand roi plus puissant que moi ; je te la donne pour que tu l’épouses : mais tu quitteras le pays sans que personne le sache, car beaucoup de gens ici briguent la main de ma fille dans l’espoir d’enfanter un roi. »
Daman accepta et quitta le pays de Ségou à l’insu de tout le monde avec sa femme Koria. Guidé par Dieu, il arriva dans le Kingui, nourrissant les siens tout le long du voyage à l’aide des produits de sa chasse ; en route, il avait laissé au Kaniaga son fils Diara-Mamadi, qui, devenu grand, fonda Mourdia, au Sud de Goumbou, dans le Niamala.
Le roi du Kingui était alors Mana-Maghan Niakaté, qui résidait à Diara. Daman alla le saluer et obtint de lui l’autorisation[274] de s’installer à Toundoungoumé ou Touroungoumbé, tout près et à l’Est de Diara. Comme au Manding et à Ségou, Daman approvisionna le roi de gibier et devint son ami, si bien que Mana-Maghan lui donna en mariage sa fille Assakandé Niakaté. Daman en eut un fils qu’il appela Niagué-Maghan Diawara ; le jour même de la naissance de cet enfant, Koria Keïta lui donnait également un fils qui fut appelé Fié-Mamoudou Diawara.
Lorsque ce dernier fut devenu un garçonnet, il allait souvent à Diara et jouait avec un fils du roi nommé Bemba Niakaté, qui avait à peu près le même âge. Bemba était d’un caractère violent et cherchait constamment dispute à Fié-Mamoudou ; au cours d’une querelle, celui-ci frappa Bemba si violemment sur la mâchoire qu’il lui cassa une dent. Lorsque le roi en fut informé, il envoya dire à Daman que son fils, s’étant mal conduit, devait quitter le pays. Daman fit donc partir Fié-Mamoudou ; il le confia à la garde de trois hommes, appelés Fadé Kanédyi, Hamadi et Bougari Kamissokho, qui le conduisirent dans le Nord jusqu’à un endroit appelé Diagouraga[217], où ils demeurèrent avec lui.
Cependant Daman avait conservé la confiance de Mana-Maghan et était même devenu son ministre de la guerre. Il leva une colonne dont il confia le commandement à son autre fils Niagué-Maghan et l’envoya piller Dienné ; une autre colonne fut dirigée par lui sur Sansanding et une autre encore sur Ségou : toutes furent couronnées de succès et rapportèrent à Mana-Maghan un immense butin[218]. Après la troisième colonne, Daman mourut.
On alla prévenir Fié-Mamoudou, qui était devenu un homme, et qui, apprenant le décès de son père, revint à Toundoungoumé pour recueillir la succession. Un homme de Diara, nommé Fassakoré Bagaka, s’entremit alors pour faire obtenir le pouvoir royal à Fié-Mamoudou, auquel l’unissaient les liens de gratitude qu’il avait contractés envers Daman. Ce Fassakoré[275] en effet, avait été, plusieurs années auparavant, blessé d’une flèche empoisonnée par Bemba Niakaté et était tombé gravement malade ; son père l’avait fait soigner par Daman, qui l’avait complètement guéri. Lorsque Daman fut mort et que Fié-Mamoudou fut revenu à Toundoungoumé, Fassakoré alla trouver ce dernier et lui dit : « Nous ne pouvons plus supporter les Niakaté, qui abusent de leur autorité et maltraitent leurs sujets ; Bemba, le fils du roi, ouvre le ventre des femmes enceintes sous prétexte de constater le sexe de l’enfant qu’elles portent et il met le feu aux meules de mil sous prétexte de se chauffer. Nous ne voulons plus de cette famille à notre tête. Or je sais un talisman qui peut atteindre la puissance des hommes, et je vais t’en indiquer la composition : on l’obtient en mélangeant des larmes humaines avec les os pilés d’un crâne de cheval ; qu’un homme robuste étende cette mixture sur sa paume droite et vienne saluer Mana-Maghan en lui serrant la main, et le pouvoir des Niakaté sera anéanti. »
Une fois muni de ces précieuses indications, Fié-Mamoudou en fit part à son frère Niagué-Maghan et tous deux se pressèrent les yeux jusqu’à en faire sortir des larmes, qu’ils recueillirent dans une calebasse ; puis Niagué-Maghan alla dérober un cheval à Diara, dans les écuries du roi : ils tuèrent ce cheval, exposèrent sa tête au soleil jusqu’à ce qu’elle fût complètement desséchée, broyèrent les os et préparèrent le talisman. Fassakoré ayant demandé : « Où est la main de l’homme robuste ? », Fié-Mamoudou présenta sa propre main, et, Fassakoré lui ayant enduit la paume avec la pâte magique, il s’en fut à Diara, se prosterna devant le roi pour le saluer, prit la main de Mana-Maghan dans les siennes et s’en retourna. Aussitôt le roi sortit de chez lui comme un fou, sella sa jument, partit au galop et ne reparut plus : personne n’a jamais su ce qu’il était devenu. Tous les membres de sa famille se sauvèrent et disparurent également, à l’exception d’un nommé Sodoga qui dormait à ce moment-là et qui devint plus tard l’ancêtre des griots du clan des Daramé, qu’on appela à cause de lui Sodogalé.
Fié-Mamoudou prit alors le commandement du Kingui et[276] fonda à Diara la dynastie des Diawara (1270), dans des circonstances qui seront relatées plus loin[219].
Ces Diawara, dont l’ancêtre, d’origine inconnue, était peut-être un Peul, étaient en tout cas formés d’éléments très divers ; mais il semble que, depuis leur installation au Kingui, c’est l’élément soninké qui a dominé dans leur composition définitive et aujourd’hui, quoique regardés par les Soninké propres comme formant un groupe à part — pour des raisons sans doute purement historiques —, les Diawara doivent être considérés comme une fraction du peuple soninké.
A la fin du XIIIe siècle, les Soninké étaient donc déjà dispersés et établis dans la plupart des provinces du Soudan Occidental où on les trouve aujourd’hui : cependant ce peuple essentiellement mobile, voyageur, migrateur et insinuant, n’avait pas encore terminé ses mouvements secondaires, qu’il n’a d’ailleurs probablement pas terminés complètement à notre époque. Mais, comme il était arrivé à Dienné, presque toutes les colonies soninké qui allèrent s’établir à l’Est du Diaga ou au Sud du Kaniaga et du Gadiaga perdirent peu à peu une partie de leur nationalité et abandonnèrent leur langue pour adopter celles des peuples ou des pays au sein desquels elles se constituèrent : le songaï dans le Diennéri, le dioula dans la Boucle du Niger, le banmana du côté de Ségou et de Bamako, le malinké dans le Ouassoulou, etc.
C’est ainsi que, du XIVe au XIXe siècles, des Soninké venus du Diaga, de Dienné et de Sansanding se répandirent à San et dans les environs, puis de là au Yatenga d’une part et au Dafina de l’autre, essaimant des colonies éparses jusque du côté de Gao et de Say vers l’Est et dans la haute Côte d’Ivoire (Samatiguila et Odienné notamment) vers le Sud[220]. C’est d’une de ces colonies, composée de Silla et de Touré, que devait sortir à la fin[277] du XVe siècle la dynastie des askia de Gao. Au XVIIe siècle, sous le règne de Nabasséré, souverain du Yatenga, trois Soninké de langue songaï, nommés Sana, Sidiki et Marhan, vinrent de Saraféré à Bissigué, près de Ouahigouya, pour s’y livrer à la culture de l’indigo ; leurs descendants s’installèrent en différents points du Yatenga et du Mossi, où ils sont teinturiers et commerçants et sont aujourd’hui considérés comme des Songaï. Dans le Dafina, les Soninké acquirent, vers la fin du XVIIIe et le commencement du XIXe siècles, une importance politique assez considérable, qui favorisa leur rayonnement dans la Boucle de la Volta Noire, et particulièrement dans le pays des Bobo-Niénigué. Tous ces Soninké de la Boucle du Niger sont plus généralement désignés aujourd’hui sous le nom de Marka (Marassé chez les Mossi).
A l’Ouest du haut Niger, une famille soninké du Galam, appartenant au clan royal des Sempré (Soumpara ou Simbara), quitta les rives du Sénégal vers le milieu du XVe siècle pour retourner au Bagana et, s’étant installée à mi-chemin entre Ségala et Bassikounou, y fonda le village de Kala, qui fut plus tard appelé Sokolo. Environ quatre siècles plus tard — vers 1832 d’après Tautain — un certain nombre de Soninké de Sokolo vinrent dans le Nord du Bélédougou, s’y installèrent avec l’autorisation du chef banmana de Toubakoro, qui dépendait lui-même du chef banmana de Gana (près Banamba), et fondèrent là les colonies marka de Touba-koura ou Touba, de Banamba, de Kiba, de Kérouané, de Médina ; quelques-uns allèrent jusqu’au bord même du Niger, à Niamina, où ils se mêlèrent à des Soninké Koumba venus de Sansanding, qui avaient déjà fondé cette ville de Niamina depuis un certain temps, près du lieu où se trouvait autrefois la capitale du Mali.
D’autres familles soninké du Galam (Sakho et Silla notamment) avaient quitté aussi le Sénégal vers le milieu du XVIe siècle (1534 d’après Barros), à la suite d’une guerre avec les Toucouleurs du Fouta dans laquelle ces derniers, sous le commandement de l’empereur de la dynastie peule fondée par Koli Galadio, firent de grands massacres de Soninké et de Mandingues dans le Gadiaga et le Boundou. Ces familles s’enfoncèrent[278] dans le Sud du Boundou et du Bambouk et gagnèrent la haute Gambie, le Fouta-Diallon et le Ouassoulou.
Si nous jetons maintenant un coup d’œil rétrospectif sur les circonstances — un peu embrouillées parfois — qui motivèrent ou accompagnèrent les différentes migrations et la formation du peuple soninké, nous nous apercevrons que ce peuple, dans son état actuel, est l’un des plus mélangés du Soudan Français. Sans doute fort peu différents au début de leurs congénères les Mandé du Centre, ils s’en distinguent aujourd’hui de façon notable par le caractère moral, par le physique et par la langue. Leur long et intime contact avec les Judéo-Syriens, les Berbères, les Peuls et — plus récemment — les Maures Beni-Hassân, a eu suffisamment d’influence sur eux — au moins sur la fraction de leur peuple demeurée au Sahel — pour que Léon l’Africain ait pu les considérer comme se rattachant aux Libyens et pour que Sa’di ait pu confondre certaines de leurs tribus avec les Zenaga. D’autre part, ceux qui ont subi, dans le Diennéri et la région des lacs, l’influence songaï, ont pu être pris pour des Songaï, de même qu’il est assez difficile à première vue de distinguer les Marka de la Boucle des Dioula, ceux du haut Niger des Banmana, ceux du Ouassoulou des Malinké ou des Foulanké. Cependant, même là où ils ont abandonné leur langue, ils forment encore une unité ethnique distincte, où domine le type mandé primitif, mais où l’élément de race blanche (et particulièrement l’élément sémitique) a laissé une trace fortement marquée au moral peut-être plus qu’au physique[221].
[279]3o Dioula.
Les Dioula proviennent assurément de la même souche que les Soninké, mais ils se sont séparés d’eux avant que ces derniers aient été modifiés par leur contact dans le Nord du Sahel avec les Judéo-Syriens et les Maures, et c’est pour cela qu’ils ont mieux conservé le type mandé primitif et que leur langue ne se différencie que très peu de celle des Malinké et est en tout cas beaucoup plus voisine des dialectes mandé du centre qu’elle ne l’est du soninké. Ils l’affirment eux-mêmes implicitement en disant que leur nom, Dioula, signifie « du fond, de la souche primitive ». Mais, au point de vue de leur origine, c’est aux Mandé du Nord qu’il convient de les rattacher, ainsi que l’a très bien démontré celui qui les a étudiés le premier et qui les connaît le mieux, M. Binger.
Sans doute la formation du peuple dioula doit remonter aux premières migrations soninké qui se portèrent vers le Diennéri avant même la fondation de l’éphémère royaume du Ouagadou, migrations dont nous avons relevé la trace dans la légende de Digna, au début du VIIIe siècle. Les Kounaté qui se fixèrent à Dioboro vers la fin du même siècle ou le début du IXe, après la dispersion du Ouagadou, fournirent sans doute un deuxième élément aux origines des Dioula. En tout cas ces derniers, que toutes leurs traditions font venir de Dienné, étaient déjà répandus dans toute la Boucle du Niger et jusque sur la basse Volta avant la fondation définitive de Dienné par les Soninké-Nono en 1240, puisque nous les trouvons fortement installés à Bégho[222], près du coude Sud de la Volta Noire et de la lisière[280] septentrionale de la grande forêt, dès le XIe siècle ; ils étaient même déjà en partie musulmans à cette époque, d’après la tradition, alors que les Berbères soudanais ne l’étaient encore qu’en minorité et que les Soninké de Dienné et du Diaga ne devaient se convertir en masse que vers le début du XIVe siècle.
Grands voyageurs et habiles commerçants plus encore que leurs cousins soninké, les Dioula sont peut-être, de tous les Mandé, ceux qui ont fourni le plus grand nombre de pèlerins ayant visité La Mecque : ce fait peut expliquer leur islamisation ancienne et rapide, islamisation qui s’est ralentie d’ailleurs durant les derniers siècles. Il faut tenir compte aussi d’un autre phénomène : à part de rares exceptions, les Dioula n’ont jamais habité que des villes, isolées au milieu de populations autochtones agricoles et de religion animiste ; cela leur a permis de se sentir davantage les coudes et d’organiser des foyers religieux et économiques qui sont devenus d’autant plus forts qu’ils étaient plus isolés et ne pouvaient se maintenir que par le prestige moral qu’exerçaient les Dioula sur les indigènes les entourant.
A une époque plus récente — à partir des XVe et XVIe siècles sans doute et jusqu’à nos jours — des Soninké de Sansanding, de San et de Ségou vinrent grossir les colonies dioula de la Boucle, qui étaient nombreuses déjà dans le Mossi, le Dafina, les pays bobo et sénoufo et le Nord de la Côte d’Ivoire (Mankono, Kadioha, Bong, Kong, etc.). La plupart des Dioula du pays samo y seraient venus de Ségou vers 1760, sous le règne du nâba Kango ; le chef de cette migration, nommé Mamourou, serait parti de Toubara (cercle actuel de Ségou) pour aller à Louta (cercle actuel de Bandiagara), où il serait mort. Ses quatre fils (Mohammadou, Abdoulkadari, Bakari et Kiba) émigrèrent de Louta à Gomboro (cercle actuel de Ouahigouya), où ils se livrèrent au commerce et vécurent en bonne intelligence avec les[281] Samo ; ceux-ci les protégèrent même contre l’empereur de Ségou Ngolo Diara qui, vers 1780, fit une expédition au Yatenga dans le but de ramener les Dioula à Ségou, but qui ne fut pas atteint.
Vers la fin du XIXe siècle, Kong était une ville de plus de 15.000 âmes, devenue le centre principal des Dioula et la capitale d’un véritable Etat fédéral habité par des populations fort diverses mais dont les Dioula détenaient le gouvernement. La destruction complète de cette ville par Samori en avril 1895 détermina l’exode de la plupart des Dioula, sous la conduite de leurs chefs du clan Ouatara, vers Bobo-Dioulasso, qui était une dépendance de Kong depuis Farama-Oulé (1860) ; ils fondèrent près de Bobo-Dioulasso plusieurs gros villages, entre autres celui de Dassalami ou Dar-es-salam, qui devinrent rapidement florissants. Après l’occupation de la région de Kong par les Français en 1898 et la pacification du pays, quelques familles dioula revinrent s’établir sur les ruines de leur ancienne capitale avec Yamoriba Ouatara, mais la plupart demeurèrent autour de Bobo-Dioulasso avec Pinntièba Ouatara.
Malgré la cohésion de leurs petits groupements et de leurs agglomérations urbaines, les Dioula ne purent manquer d’introduire parmi eux nombre d’étrangers, surtout lorsque, devenus riches, ils acquirent beaucoup d’esclaves. Aussi actuellement les Dioula sont-ils fortement mélangés d’éléments voltaïques au Mossi et d’éléments sénoufo dans les régions de Bobo-Dioulasso et de Sikasso. Cependant certaines familles semblent s’être conservées à peu près pures : ce sont en général celles qui sont entièrement musulmanes et qui n’ont pas adopté la coutume des scarifications du visage ; les autres, plus ou moins métissées d’autochtones, d’un islamisme assez tiède et souvent même professant la religion locale, sont désignées par les Dioula purs sous le nom de Sonongui ou Sorongui, que les interprètes traduisent souvent par « musulmans buveurs de dolo »[223] mais dont l’étymologie exacte ne m’est pas connue.
Les Boron, Bolon ou Blon, qu’on rencontre en certaines[282] régions du Sud-Ouest de la Boucle et qu’on apparente aux Dioula, seraient des descendants d’une caste de chasseurs qui aurait accompagné la plus ancienne migration dioula. Ils n’ont pas en général embrassé l’islamisme et n’ont pas atteint le degré de civilisation auquel sont parvenus les autres Dioula.
1o Kâgoro. — Dans les temps primitifs, les Kâgoro devaient être les autochtones du Bagana : il est fort probable que les sauvages Bagama[224] signalés par Bekri au Sud-Ouest de Ghana et les Baganes des premiers voyageurs portugais n’étaient autres que des Kâgoro. Leur domaine devait s’étendre à l’Ouest et au Sud-Ouest du Diagha ou Diaga, séparant le berceau des Soninké de celui des Malinké. Leur pays fut envahi à de nombreuses reprises par les migrations soninké, il fut le théâtre des luttes que se livrèrent les Soninké Sossé et les Malinké, enfin il devint l’un des centres les plus actifs de la colonisation banmana : tout cela expliquerait pourquoi les Kâgoro actuels, tout en ayant fidèlement conservé le type physique et moral des agriculteurs mandé primitifs et ressemblant par là étroitement aux Banmana, parlent un dialecte qui présente des affinités indéniables avec la langue soninké.
Le plus grand nombre des Kâgoro primitifs s’est d’ailleurs fondu dans le sein des Soninké, des Banmana, des Malinké et des Foulanké, et ceux qui ont gardé leur individualité ethnique ne constituent qu’un groupe fort restreint, éparpillé aujourd’hui dans le Bakounou, le Kaniaga, le Kaarta et le Bélédougou. Mais, précisément parce qu’il a pu conserver son type original et se constituer un dialecte spécial, ce petit groupe n’en est que plus intéressant.
Les légendes racontent qu’à une époque fort reculée, sans doute au moment de la première colonisation du Kaniaga par[283] des Soninké (VIIIe siècle), un grand nombre de Kâgoro avaient émigré au Fouta-Diallon : ce serait leur présence dans ce pays qui aurait, en modifiant le parler des Diallonké, donné à ce dernier et à la langue soussou actuelle les affinités qui s’y rencontrent — principalement au point de vue phonétique — avec les dialectes mandé du Nord et particulièrement le Soninké.
Au XIIIe siècle, Alidiou Makassa ou Magassa, chef des Kâgoro du Fouta-Diallon, eut des démêlés avec Soundiata, empereur du Manding, et lui déclara la guerre ; vaincu et obligé de céder la place aux bandes de son vainqueur, Alidiou Makassa voulut regagner la patrie de ses ancêtres et s’établit dans le Kaarta ; il y fonda un petit Etat qui fut gouverné après sa mort par son fils Maka Makassa, puis par Fioté fils de Maka et par Fodé fils de Fioté. Fodé mourut au commencement du XIVe siècle, laissant deux fils dont l’un, Kossa, demeura au Kaarta, tandis que l’autre, Amadi, émigrait à Ouaharo (Kaniaga). Un descendant de Kossa, nommé Séguéba Makassa, aurait réuni les deux fractions sous son commandement au XVIIIe siècle. Le chef actuel des Kâgoro du cercle de Goumbou, Diara Makassa, serait le neuvième successeur de ce Séguéba[225].
2o Banmana. — Une tradition maintes fois rapportée fait venir les Banmana du Toron, province orientale du Ouassoulou située dans la colonie actuelle de la Côte d’Ivoire, sur la route d’Odienné à Sikasso et non loin de la première de ces deux villes. Il semble en effet que l’habitat primitif des Banmana devait former l’extrême Sud-Est du berceau de la famille mandé et devait s’étendre de la rive droite du haut Niger, à hauteur de Siguiri environ, jusqu’à la rive gauche du haut Bagbê ou Bagoé, où il confinait au territoire des Sénoufo. Les premières[284] conquêtes des empereurs du Manding, dès le début du XIIIe siècle, en installant les Malinké sur la rive droite du haut Niger, durent forcer les Banmana à se cantonner entre le haut Baoulé et le haut Bagbê, là où se trouve précisément le Toron. Leur caractère très marqué d’indépendance en effet et leur attachement à la religion ancestrale ne les disposaient pas à accepter le joug des Mandingues, dont l’empereur et les grands chefs professaient alors l’islamisme, et ce serait à cette circonstance qu’ils devraient leur nom, comme je l’ai dit déjà (ban-ma-na, refus au maître).
Quelques-uns cependant se portèrent sans doute dès le XIIIe siècle le long de la rive droite du Niger jusqu’à Ségou, car les légendes relatives à Soundiata nous parlent de Banmana habitant déjà les bords du fleuve du côté de Koulikoro entre 1225 et 1250. Très probablement ces précurseurs des grandes migrations banmana devaient appartenir à la caste des pêcheurs Somono, qui n’aurait pu, dans le Toron, trouver suffisamment l’emploi de ses aptitudes spéciales et qui préféra accepter le joug des Malinké et embrasser l’islamisme.
La fraction agricole du peuple banmana ne devait pas tarder d’ailleurs à se diriger aussi vers le Nord : elle était déjà fort nombreuse en effet et ne tarda pas à se trouver à l’étroit dans le Toron. On place généralement au XVIIe siècle la migration d’où devait sortir l’empire des Kouloubali, mais cette migration avait en réalité commencé bien auparavant et l’installation de Kaladian Kouloubali près de Ségou en 1600 ne constitue que l’aboutissement de l’un de ses épisodes les plus récents. En fait, depuis la fin du XIIIe siècle au moins et, semble-t-il, sans discontinuité, un flot toujours grossissant de Banmana descendit les vallées du haut Bani, s’avançant progressivement depuis le Toron jusqu’aux environs de Dienné, en peuplant successivement la région de Bougouni, la contrée située entre le Baoulé[226] et Bamako, le Bendougou (sur la rive droite du Bani) et tout le territoire compris entre Dienné et Ségou de la rive gauche du Bani à la rive droite du Niger.
[285]Comme je le disais à l’instant, ce n’est qu’à partir du XVIIe siècle que les légendes se précisent relativement à la poussée des migrations banmana, lesquelles vers cette époque vont prendre une nouvelle direction et, traversant le Niger, se diriger vers l’Ouest et le Nord-Ouest, pour atteindre enfin Nioro en 1754.
Voyons maintenant le détail des principales de ces légendes.
A une époque fort reculée et très vraisemblablement bien antérieure au XVIIe siècle, deux frères banmana nommés l’un Niangolo et l’autre Baramangolo, formant sans doute une fraction égarée d’une grosse migration, arrivèrent sur la rive droite du Baoulé, au Sud de Barouéli (près du confluent du Baoulé avec le Bagbê), fuyant des ennemis qui les poursuivaient en les chassant vers le Nord-Ouest. Ils voulurent traverser la rivière pour échapper à ces ennemis, mais ne purent trouver de pirogues : c’est en souvenir de ce fait que leurs descendants prirent le nom de Kouloubali, mot qui en banmana signifie en effet « sans pirogue » (koulou pirogue, bali suffixe privatif). Un poisson à grosse tête aplatie, de l’espèce appelée mpolio en banmana, eut pitié de leur embarras et leur offrit de leur faire traverser le Baoulé sur son dos ; il passa d’abord le cadet, Baramangolo, qui lui déconseilla de rendre le même service à son frère aîné Niangolo, ce dernier étant ingrat et cruel. Néanmoins le mpolio retourna sur la rive droite, prit Niangolo sur son dos, lui fit passer le fleuve et le déposa sur la rive gauche à côté de son frère. Aussitôt Niangolo saisit le mpolio, le tua et, le coupant en deux tronçons, offrit l’un d’eux à Baramangolo ; mais ce dernier refusa de manger la viande d’un animal qui lui avait sauvé la vie et prononça l’anathème contre tous ceux de ses descendants qui toucheraient à la chair d’un mpolio[227].
Cependant les deux frères s’établirent dans le pays compris entre le Bani et le Niger et ils y eurent des enfants : telle serait[286] l’origine du clan banmana des Kouloubali. L’un des descendants de Baramangolo, nommé Kaladian Kouloubali, s’était installé vers 1600 environ sur la rive droite du Niger, un peu en aval de Ségou, à Markadougouba, village où des lieutenants des empereurs du Mali avaient résidé jusque vers la fin du XVe siècle et qui, depuis, avait été placé sous la suzeraineté au moins nominale de l’empereur de Gao d’abord, du caïd marocain de Dienné ensuite. Son fils Danfassari, quittant Markadougouba où Notémé, autre fils de Kaladian, avait succédé à son père, alla vers 1620 se fixer plus en amont, dans un village qui avait été fondé précédemment par un musulman, soninké probablement, qu’on nommait Siékou ou Sékou (le cheikh) : ce village avait été appelé Ségou du nom de son fondateur[228]. Nous verrons dans la quatrième partie de cet ouvrage comment le petit-fils de Danfassari, Fotigué dit Biton, construisit là une forteresse et en fit vers 1670 le siège de l’empire banmana de Ségou, empire qui ne devait pas tarder à étendre sa suprématie sur tout le cours du Niger de Bamako à Tombouctou inclus et à favoriser ainsi le mouvement de migration des Banmana vers le Nord ainsi que sur la rive droite du Bani.
Cependant des mésintelligences avaient éclaté entre les Kouloubali issus de Baramangolo, auxquels appartenaient Kaladian et ses descendants, et ceux issus de son aîné Niangolo : ces derniers, qui avaient pris l’épithète de Massassi (descendance de roi) parce qu’ils représentaient la branche aînée, s’étaient vus écarter du pouvoir par la branche cadette et supportaient malaisément cette déchéance. Traités plus durement encore par l’empereur Biton que par ses prédécesseurs, ils franchirent le Niger vers 1670 — c’est-à-dire peu après l’avènement de Biton — sous la conduite de Zié Kouloubali-Massassi ou, selon d’autres traditions, sous celle de Sounsa ou Sarhaba son frère, et allèrent s’installer dans le Bélédougou et le Kaarta, fondant, à Sountian près de Mourdia (Kaarta), un second empire banmana qui fut en continuelle rivalité avec l’empire de Ségou.
[287]De nombreuses familles banmana appartenant à d’autres clans (Taraoré, Diara, etc.) quittèrent également la rive droite du Niger sous le règne de Biton, fuyant le joug de ce despote et allant chercher des pays encore inhabités pour s’y livrer à la chasse et y satisfaire leur besoin d’indépendance. C’est ainsi que le Nord du Bélédougou, alors désert, fut colonisé vers le début du XVIIIe siècle par un chasseur nommé Bakoro Taraoré qui avait fui la cour de l’empereur Biton ; ce Bakoro se fixa à quelques kilomètres au Sud-Est du poste actuel de Banamba, dans une forêt inhabitée qu’il fut le premier à défricher et où il fonda le petit village de Gana. Plus tard, d’autres émigrants banmana, venus aussi de la rive droite du Niger, fondèrent dans la même région le village de Touba (la grande forêt)[229], avec l’autorisation de Bakoro Taraoré auquel ses droits de premier occupant conféraient la propriété du sol. Monson ou Mosson Diara, qui régna à Ségou de 1792 à 1808[230], vint razzier ces villages, captura un grand nombre de leurs habitants et les emmena à Ségou. Cependant les colonies banmana de Gana et de Touba parvinrent à se reconstituer et contribuèrent, durant toute la première moitié du XIXe siècle, au peuplement du nord du Bélédougou. Lors des guerres d’El-Hadj Omar (1860), beaucoup de Banmana de la région de Merkoya et de Gana émigrèrent dans le Sud, vers Sanankoro[231], pour revenir ensuite chez eux à partir de 1885 et reconstruire leurs foyers détruits[232].
[288]Dans la région comprise entre le Niger et le Bani, région dont ils semblent avoir été presque les seuls occupants depuis leur première installation, les Banmana se sont conservés à peu près purs de tout mélange ; il n’en est pas de même sur la rive droite du Bani, où ils ont accru leur domaine aux dépens de celui des Bobo et des Sénoufo, ni sur la rive gauche du Niger ainsi que dans le Sahel et le Massina, où ils ont cohabité avec des Malinké, des Kâgoro, des Soninké, des Bozo et des Peuls. Assurément, même dans ces dernières régions, les Banmana des petits villages campagnards doivent être encore très rapprochés du type primitif de leurs ancêtres, mais il n’en est pas de même de ceux qui habitent les villes. Beaucoup de ces derniers ne sont banmana que par la langue qu’ils parlent et par des coutumes qu’ils n’ont adoptées — en les modifiant d’ailleurs — qu’à une date assez récente.
J’en prendrai comme exemple les habitants de Banamba et les Banmana de Bamako. Les premiers sont encore considérés aujourd’hui comme Soninké, mais il est fort possible que, dans une cinquantaine d’années, on les range parmi les Banmana, attendu que pas un d’eux alors ne parlera le soninké, qui n’est plus compris déjà que par quelques vieillards : et cependant leur établissement en pays banmana ne date que de 1832[233] ! Quant aux principales familles banmana de Bamako, celle des Niarè, à laquelle appartient le chef actuel de la ville, et celle des Touré, à laquelle appartiennent les musulmans non Somono, voici leur histoire. A une époque relativement récente et qui, en tout cas, ne peut remonter au delà de la seconde moitié du XVIIe siècle, puisque les Massassi régnaient au Kaarta, un Soninké musulman originaire de Diara près Nioro et nommé Sériba Niarè[234], ayant quitté sa ville natale à la suite d’une querelle de famille, demanda à l’empereur massassi du Kaarta[289] un terrain pour s’y établir ; le souverain le fit conduire vers le Niger, à Moribadougou, à 10 kilomètres environ en aval de Bamako, où habitait alors la famille d’un autre Soninké nommé Bamba ou Bamma Sakho. Sériba s’installa auprès de Bamba, épousa une de ses filles et en eut un fils, Dia-Moussa, qui devint un grand chasseur ; ce Dia-Moussa acquit un renom extraordinaire d’agilité et de souplesse : il sautait le Niger à pieds-joints par dessus les rapides de Sotuba. Un jour, en allant à la chasse, il visita l’emplacement actuel de Bamako, alors désert, le trouva à sa convenance et y fit venir ses parents. Il épousa, ainsi que son père, des femmes banmana de la rive droite, et ils en eurent des descendants qui, ayant adopté la langue, la religion et les coutumes des Banmana, sont devenus les Niarè actuels de Bamako[235]. Quant aux Touré, qui n’arrivèrent à Bamako qu’au début du XIXe siècle, ils proviendraient de la fusion de deux familles : l’une, celle des Touêté, descendrait d’un forgeron juif originaire du Touat, venu se fixer à Bamako, où il se serait marié à des femmes de la caste des forgerons (Noumou) et de celle des pêcheurs (Somono) ; l’autre, celle des Daraoué, descendrait d’un Arabe musulman originaire du Dara (sud marocain) et marié à Bamako à une femme soninké.
| Delafosse | Planche X |

Cliché Fortier
Fig. 19. — Femmes et enfants Malinké.

Cliché Fortier
Fig. 20. — Femme Somono des bords du Niger.
3o Khassonkè.
Nous avons vu, en parlant des migrations peules, comment le peuple khassonkè avait pris naissance, vers la fin du XIe siècle, par suite du mélange de certaines fractions peules avec des autochtones du haut Sénégal. Ces autochtones étaient vraisemblablement des Kâgoro, sur la rive Nord du fleuve, et des Malinké, sur la rive Sud ; les Soninké du Guidimaka et du Galam durent aussi fournir un élément appréciable à la formation des Khassonkè, ainsi que, plus tard, les Maures du Sahel.
[290]D’après les traditions qui ont cours à Kayes, les ancêtres des Khassonkè auraient été un berger peul nommé Amadou Haoua et une femme banmana appartenant à une famille dont Amadou Haoua gardait les troupeaux. Comme l’origine des Khassonkè remonte vraisemblablement au XIe ou XIIe siècle et qu’à cette époque les Banmana ne devaient pas avoir atteint encore la région de Kayes, je remplacerais assez volontiers dans cette légende le mot « banmana » par le mot « kâgoro » ; on arriverait ainsi à une explication s’approchant beaucoup de la vérité, ainsi que le prouve l’examen du dialecte parlé actuellement par les Khassonkè : c’est un dialecte mandé se rapprochant du kâgoro au point de vue phonétique et renfermant un assez grand nombre de radicaux peuls dans son vocabulaire.
Sega Déoua, l’un des descendants d’Amadou Haoua, alla s’établir dans le Diomboko et y bâtit Koniakari ; l’un de ses frères se fixa à Séro, au Nord de Koniakari, et y fonda un petit royaume rival dont le souverain portait le titre de sila-tigui comme l’empereur du Tekrour. Vers la fin du XVIIIe siècle, un conflit éclata entre le silatigui de Séro et le roi de Koniakari, qui s’appelait alors Demba Séga ; après une série de luttes sans grande portée, le silatigui, aidé par les Banmana Massassi du Kingui, eut le dessus et, vers 1810, força Demba Séga à évacuer le Diomboko et à se réfugier dans le Logo, entre Kayes et Bafoulabé. Après une fugue du côté du Boundou, Demba Séga s’établit définitivement près et en amont de Kayes, à Médine, qui devint la capitale des Khassonkè du Sud et de la province du Khasso ou Khasson, dont l’ancêtre Amadou Haoua était d’ailleurs originaire.
L’élément peul qui, au début, contribua à la formation des Khassonkè s’est tellement atténué qu’on peut, sans aucun inconvénient, rattacher aujourd’hui ces derniers à la famille mandé.
4o Malinké ou Mandingues.
Les Malinké, Mandenga ou Mandingues (gens du Mali ou Mandé) ont eu, très vraisemblablement, comme berceau primitif le pays encore appelé de nos jours Mandé ou Manding par eux-mêmes, Mali par les Soninké et Melli ou Mellé par les[291] Peuls du Massina, c’est-à-dire la région comprenant le haut bassin du Bakhoy et le district situé entre le haut Bakhoy et le Niger, au Sud de Kita et au Sud-Ouest de Bamako. Leur première capitale dut être Kangaba, village situé à peu de distance de la rive gauche du Niger, en amont de Bamako, à une cinquantaine de kilomètres du point où la frontière du Haut-Sénégal-Niger traverse le fleuve.
On place généralement en 1213 la fondation de l’empire de Mali ou des Malinké ou Mandingues. En réalité cette date a été conservée par les traditions musulmanes comme étant celle d’un pèlerinage accompli à La Mecque par l’empereur Allakoï Keïta, mais il est bien probable que de nombreux souverains musulmans et infidèles s’étaient succédé déjà avant Allakoï sur le trône du Mandé. En tout cas il semble que, au début du XIIIe siècle, les Malinké étaient déjà répandus, en dehors du Manding proprement dit, dans le Bouré, le Sangaran et le Gangaran, qu’ils formaient la population totale de ces diverses provinces et qu’ils avaient déjà fondé quelques colonies sur la rive droite du haut Niger (dans le Ouassoulou actuel), ainsi que dans le Nord du Fouta-Diallon, le Bambouk, la région de Kita et la partie de la vallée nigérienne comprise entre Bamako et Ségou. C’est l’ensemble de ce domaine primitif des Mandingues qui était connu dans le Nord du Soudan sous le nom de Gangara ou Ouangara et qui était universellement célèbre en raison des mines d’or qu’il renfermait, dans le Bouré et le Bambouk principalement.
Mais c’est à partir de 1230 environ que les conquêtes des Mandingues commencèrent à reculer considérablement les limites de leur territoire vers le Sud, l’Ouest et le Nord et à faire du modeste royaume de Kangaba le point de départ d’un empire véritable. Le fameux Soundiata Keïta, connu des auteurs arabes sous le nom de Mari-Diata[236], soit directement[292] soit par l’intermédiaire de ses fils et de ses lieutenants, étendait vers cette époque son autorité sur les petits royaumes mandingues avoisinant le sien : le Bouré, le Sangaran, le Labé (Fouta Diallon), le Bélédougou. Accompagné d’un Soninké nommé Diouna, originaire du Ouagadou, il passait le Niger vers Siguiri et, repoussant les Banmana au delà du Baoulé dans le Toron, établissait des colonies malinké dans les cantons du Baya et du Siankadougou (cercle actuel de Bougouni). De retour à Kangaba, il récompensa les services que lui avait rendus Diouna en lui donnant le gouvernement des cantons mandingues de la région de Kita ; Diouna se fixa près de la montagne de Kita, où il fonda les deux villages de Sédioussaba (le Kita actuel) et de Linguékoto (le Tounkaréla actuel) et épousa la fille de Siéma Toulaba, chef de la colonie malinké du pays, qui résidait à Tatafing (le Boudofo actuel). Deux fils de Soundiata, Makan et Siétigui, s’établirent dans la même région, le premier à Kayaba et le second à Boko près de Kouroukoto ; Siétigui épousa également une fille de Siéma Toulaba et en eut trois fils : Dando, qui alla prendre le commandement du Birgo (canton de Mourgoula, entre Kita et le Manding propre) ; Massiré et Kouakourou, qui furent se fixer au Nord-Est de Kita, vers la rive gauche du haut Baoulé, dans la région qu’on appela plus tard le Fouladougou-Arbala.
Un des principaux lieutenants de Soundiata, nommé Amari-Sonko, annexait le Gangaran à l’empire de son maître, en laissait le commandement à l’un de ses serviteurs nommé Sané-Nianga Taraoré, s’emparait des mines d’or du Bambouk et poussait ses conquêtes, doublées d’une forte immigration mandingue, à travers le Boundou jusqu’au Niani-Ouli (vallée de la Gambie).
Un peu plus tard, Soundiata battait à Kirina l’empereur sossé Soumangourou (1235), s’emparait du Kaniaga, du Diaga et de tout le Bagana, s’avançait jusque dans la région de Oualata où il prenait et détruisait Ghana (1240) et, trouvant la position de Kangaba trop excentrique par rapport à ses nouvelles conquêtes, venait fonder non loin de Niamina sa nouvelle capitale, à laquelle on donna le nom de Mali ou Mandé, en souvenir du pays d’origine de son fondateur.
[293]A la mort de Soundiata, c’est-à-dire vers le milieu du XIIIe siècle, un de ses meilleurs généraux, Moussa-Son-Koroma Sissoko, venait s’établir à l’Ouest du Bafing, à Koundian (Sud-Est du Bambouk), avec un grand nombre de guerriers et de partisans, et fondait le royaume malinké du Bambougou ou Bambouk qui, d’abord vassal de l’empereur de Mali, se rendit plus tard indépendant.
Vers la même époque, un autre ancien général de Soundiata et parent de l’empereur lui-même, Siriman Keïta, passant au Sud de Koundian, alla se fixer à Dékou, dans les montagnes du Konkodougou. Ce pays était encore occupé alors par les Diallonké, mais il s’y trouvait aussi des colonies mandingues originaires du Bouré et du Sangaran, composées surtout de chercheurs d’or qu’avaient amenés des chefs de migration nommés Kilia-Moussa Sissoko, Tira-Makan Taraoré et Sori Doumbouya, et qui avaient fondé les villages de Dindéra et de Sintédougou. Avec l’aide de ces colonies mandingues, Siriman Keïta conquit le Konkodougou sur les Diallonké et en fit un royaume qui fut, lui aussi, vassal de l’empire de Mali.
C’est au XIVe siècle, avec l’empereur Kankan-Moussa, que l’empire mandingue atteignit son apogée ; monté sur le trône en 1307, Kankan-Moussa s’emparait en 1325 de Gao et de Tombouctou et étendait son autorité jusqu’aux confins de l’Algérie actuelle. Ses successeurs entraient en relations amicales avec les sultans du Maroc et avec les rois du Portugal (XIVe et XVe siècles). Jamais empire indigène en Afrique Occidentale n’obtint pareil renom ni pareille puissance.
Cette fortune singulière devait être d’assez faible durée : dès 1468, l’empereur de Gao Ali-Ber affranchissait la majeure partie de ses états de la suzeraineté mandingue, et l’autorité des empereurs de Mali, déjà amoindrie, devait être réduite à néant vers la fin du XVIIe siècle par les conquêtes des Banmana et la révolte des royaumes vassaux. Il n’en est pas moins vrai que, pendant près de cinq cents ans, les Malinké firent la loi dans la majeure partie des pays situés entre le haut Niger et l’Atlantique.
Nous ne devons donc pas nous étonner de voir qu’ils ont[294] réussi à former l’un des peuples les plus nombreux et les plus fortement caractérisés de toute l’Afrique Occidentale et que ce peuple s’est assimilé quantité de tribus diverses d’une manière si profonde qu’il n’est pas possible aujourd’hui de discerner leurs origines premières ; l’empreinte qu’il a marquée sur nombre de descendants de Peuls a été si forte qu’on ne saurait à l’heure actuelle considérer les Foulanké autrement que comme des Mandingues ; enfin nous constatons que l’ancienne petite tribu du Mandé peuple aujourd’hui, en dehors des pays du Haut-Sénégal-Niger où nous avons signalé sa présence, de vastes régions dans la Côte d’Ivoire (cercles de Touba et de Mankono), dans la Guinée Française (cercles de Siguiri, Dinguiray, Kouroussa, Kankan, Beyla, Farana, Kindia, Timbo, Labé, Kadé), dans le Sénégal (cercles de Bakel, de Kédougou, du Niani-Ouli, du Sine-Saloum, de la Casamance) et enfin dans le Libéria, le Sierra-Leone, la Guinée Portugaise et la Gambie Anglaise.
5o Foulanké.
J’ai suffisamment relaté, en parlant des migrations peules, comment s’étaient formés les divers groupements foulanké pour me permettre d’être bref à leur sujet. Je viens de dire également qu’il était impossible aujourd’hui de ne pas considérer les Foulanké comme des Mandé, bien que l’importance de l’élément peul qui a contribué à leur formation ait été considérable et se fasse sentir de nos jours encore dans leurs diamou spéciaux comme aussi dans certains caractères secondaires de leur type physique et de leurs mœurs.
On attribue aux Foulanké qui habitent le Ganadougou, dans le cercle de Sikasso, une origine un peu spéciale qui remonterait à une date assez éloignée : on prétend que, lorsque les Soninké, avec Kaya-Maghan, s’emparèrent du pouvoir à Ghana (fin du VIIIe siècle), quelques familles judéo-syriennes, se séparant du mouvement qui entraîna leurs congénères vers le Fouta, auraient gagné le Massina, refaisant en sens inverse la route qui les avait amenées à Ghana six siècles auparavant ; sans s’arrêter bien longtemps au Massina, elles auraient franchi le Niger,[295] puis remonté la rive droite du Bani jusque dans la région où se trouve aujourd’hui Sikasso ; des Soninké-Nono et des Dioula y auraient rejoint leurs descendants du XIe au XIVe siècles. Plus tard, au début du XVIIe siècle, des Peuls du Massina conduits par Ménédian Diallo seraient venus se fixer d’abord à Ntina (cercle de Bougouni), puis, franchissant le Bagbê, auraient chassé de Kobougoula les Sénoufo, commandés par Mamourou Diarassouba, et se seraient installés à leur place, se mélangeant aux descendants des Judéo-Syriens, des Soninké et des Dioula, adoptant comme eux la langue mandingue et se livrant surtout à l’élevage. Ce serait du mélange de ces trois immigrations que seraient sortis les Foulanké actuels du cercle de Sikasso, qu’on appelle encore Ganaka (gens de Gana), en souvenir de Ghana, ancienne patrie des premiers venus d’entre eux.
Si nous laissons de côté ces derniers, nous voyons que, parmi les autres Foulanké du Haut-Sénégal-Niger, les premiers en date furent ceux des cercles actuels de Bafoulabé et de Kita, dont l’origine remonte à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe, tandis que ceux du Ouassoulou, que l’on rencontre dans le cercle de Bougouni, sont de formation beaucoup plus récente (XVIIIe siècle). Cependant le mouvement d’émigration des Peuls du Fouta-Diallon, qui donna naissance aux Foulanké du Ouassoulou, amena un très fort regain d’activité dans les colonies foulanké de la région de Kita et détermina leur constitution définitive. Les traditions recueillies en ce dernier point nous apprennent en effet qu’un nommé Sandoufing Diakité, originaire du Fouta-Diallon, s’étant établi dans le Fouladougou du cercle de Bougouni et ayant conquis cette province sur les Banmana, laissa onze fils dont deux, se dirigeant vers le Nord-Ouest, traversèrent le Manding et vinrent se fixer au Nord de Kita, auprès des Foulanké issus des premières migrations peules. L’un d’eux, nommé Sabou, s’établit dans l’Ouest de la boucle du Baoulé et donna son nom au Fouladougou-Saboula ; l’autre, nommé Ouaraba, s’établit dans l’Est de la même boucle et donna son nom au Fouladougou-Ouarabala ou Arbala. Sabou et Ouaraba soumirent à leur autorité les cantons mandingues voisins (Gadougou, Gangaran, Kita et Baniakadougou) et essayèrent même de conquérir le Kaarta sur[296] les Banmana, mais sans pouvoir y parvenir. Un de leurs descendants, Yoro-Dian, vint fonder Kitaba au pied de la montagne de Kita.
Un peu plus tard, une bande de Peuls du Fouta-Diallon, conduite par un nommé Koli Sangaré, traversa le Bouré, passa sur la rive droite du Niger dans le Sendougou (extrême Sud-Est du cercle de Bamako), mit en fuite Tiamakan Taraoré, chef mandingue du Sendougou, puis franchit de nouveau le Niger en sens inverse, traversa le Manding et s’établit au Sud de Kita dans le Birgo, donnant ainsi naissance aux Foulanké du Birgo.
1o Diallonké.
Ainsi que je l’ai dit déjà, le Fouta-Diallon ou plutôt le Diallon[237] semble bien avoir été le berceau primitif des Mandé du Sud. Mais, alors que les Diallonké constituaient l’unique population de ce pays, il s’étendait sans doute bien davantage vers le Nord et englobait probablement toute la région comprise entre le bas Bafing, le Sénégal et la Falémé, touchant à l’Est au territoire propre des Mandingues et au Nord à celui des Kâgoro.
Le premier établissement des Soninké dans le Gadiaga vers la fin du VIIIe siècle et l’invasion du Khasso par les Peuls au XIe siècle déterminèrent un recul des Diallonké vers le Sud. Mais c’est surtout au XIIIe siècle, à la suite de la conquête du Gangaran, du Bambouk, du Konkodougou et du Labé par les Mandingues, que se dessina le gros mouvement de migration des Diallonké : ce mouvement les porta dès cette époque jusque sur les bords de l’Atlantique, du côté de Conakry, au travers des populations côtières (Baga, Landouman, etc.) qu’ils commencèrent à absorber en partie, devenant les Soussou de la basse Guinée. Mais il s’en faut de beaucoup que tous les Diallonké ou Soussou primitifs aient été refoulés par les Malinké au Sud-Ouest du Fouta-Diallon : s’ils évacuèrent à peu près[297] complètement le Gangaran, le Bambouk et le Nord du Konkodougou ou du moins y perdirent leur nationalité pour devenir des Malinké, si beaucoup de familles s’avancèrent du côté de la mer, le gros du peuple demeura dans le centre du Fouta-Diallon jusqu’à la conquête toucouleure du XVIIIe siècle et même certains cantons du Nord ont conservé jusqu’à nos jours leur population diallonké, que nous retrouvons dans le Kolou, le Boké et le Kankoumakania (cercle de Kita), dans le Fontofa et le Mérétembaya (cercle de Satadougou).
D’autre part, les conquêtes des Malinké et notamment celles de Soundiata et de ses lieutenants déterminèrent un grand nombre de Diallonké des régions de Labé et Timbo à émigrer directement vers le Sud et à s’infiltrer entre les Mandingues du haut Niger et les populations forestières de la Côte : ceux-là étaient surtout des cultivateurs de cola et, obligés de quitter leur pays, ils recherchèrent tout naturellement une région où ils pussent continuer à se livrer à leur industrie. C’est ainsi, à mon avis, que se dessina cette très curieuse migration qui a porté les Mandé méridionaux du Fouta-Diallon jusque dans le centre de la colonie actuelle de la Côte d’Ivoire, tout le long de la limite Nord de la forêt dense ; au cours de cette migration, qui dut s’accomplir du XIIIe au XVe siècles environ, les Diallonké perdirent en grande partie leur caractère national en se mêlant aux autochtones de la forêt qui leur donnèrent asile, et ainsi se constituèrent sans doute les peuplades des Mendé, des Toma, des Guerzé, des Dan, des Toura, des Lo ou Gouro, des Mona, des Ngan, etc., qui sont toutes caractérisées par ce fait qu’elles se livrent à la culture des colatiers et par cet autre que leurs langues, malgré la diversité des vocabulaires, se rattachent grammaticalement à la famille des langues mandé.
Après avoir fait du Sud d’abord, puis de l’Est sur une longueur considérable, ce courant migrateur refit ensuite du Nord, et donna naissance aux groupements isolés dans le Sud-Ouest de la Boucle du Niger que nous allons retrouver tout à l’heure.
2o Samo.
D’après les traditions recueillies à Ouahigouya et ailleurs, les[298] Samo seraient d’origine mandé et auraient été formés par le mélange de plusieurs éléments, dont l’un appartenait au groupe des Mandé du Centre et un autre au groupe des Mandé du Sud.
Le premier aurait été fourni principalement par des Banmana de la région de Ségou ; ceux-ci auraient été chassés de leur pays par les Malinké, très vraisemblablement au XIVe siècle, après l’arrivée des premières migrations banmana entre Bani et Niger, mais avant la constitution de l’empire de Ségou ; sous la conduite d’un chef nommé Diyé, ils franchirent le Bani et s’installèrent sur la rive droite de ce cours d’eau, à Ninkiessa, entre San et Dienné. De là, sous les ordres de Diougouri, fils de Diyé, ils gagnèrent Toéré, entre Koury et Ouahigouya, où ils furent rejoints vers le XVIe siècle par des Samorho provenant du courant de migration mandé-sud originaire du Fouta-Diallon ; ces Samorho s’étaient mélangés d’ailleurs à des Sénoufo et à des Bobo en se rendant de la région de Sikasso dans celle de Koury. Du mélange des Banmana et des Samorho seraient sortis les Samo.
Une partie d’entre eux demeura dans le voisinage du coude nord de la Volta Noire (Samo du cercle de Koury) ; les autres gagnèrent le Sud-Ouest du Yatenga, où ils furent rejoints, sous le règne du nâba Kango (vers 1770), par quelques familles d’origine banmana qui, lors de la migration de Diyé, avaient poussé jusqu’à Kaka, près de Sofara, et y étaient restées.
Depuis cette époque les Samo ont été assez profondément influencés par le voisinage des Mossi et des Bobo et, bien qu’ils aient toujours vécu à peu près indépendants, la trace de leurs origines mandé n’est plus très perceptible. Quant à leur langue actuelle, autant que les très médiocres renseignements que nous possédons nous permettent d’en juger, il semble qu’elle appartient, au moins en partie, à la famille des langues voltaïques.
3o Samorho.
Lorsque, vers le XVIe siècle, le courant de migration des Mandé du Sud arriva près de la haute Volta, il s’y heurta contre des autochtones sénoufo et bobo et aussi contre des Dioula et Soninké venus du Nord : le résultat de ce contact multiple aurait donné[299] naissance aux Samorho, qui reçurent ce nom des Dioula en raison de leurs aptitudes agricoles[238].
Une partie d’entre eux s’établit à demeure au Nord de la route de Bobo-Dioulasso à Sikasso ; d’autres poussèrent plus au Nord et allèrent se fixer entre Koutiala et Koury : une fraction de ces derniers, en se mélangeant à des Banmana, donna naissance aux Samo, comme nous venons de le voir ; le reste, ayant eu des difficultés avec les Peuls, retourna dans la région de Sikasso.
Actuellement les Samorho ont adopté la religion et la plupart des coutumes des Sénoufo, mais ils parlent une langue que l’on s’accorde à apparenter aux langues mandé.
4o Sia et tribus diverses.
Les Mandé du Sud, venant de la région de Kong après avoir donné naissance aux Lo du Bandama vers l’Ouest et aux Ngan de la Comoé vers l’Est, se dirigèrent vers le Nord et atteignirent la région de Diébougou. Repoussés par les Bobo, ils se seraient rabattus ensuite vers le Sud jusqu’à Lorhosso, pour se porter enfin vers le Nord-Ouest et atteindre l’emplacement actuel de Bobo-Dioulasso (XVIe siècle vraisemblablement). Tandis que certains d’entre eux continuaient vers l’Ouest et contribuaient à la formation des Samorho, les autres, se fixant à Bobo-Dioulasso — ou plutôt à Sia, qui est le vrai nom de cette ville — et, s’y mêlant à des Bobo, donnèrent naissance aux Sia. D’abord indépendants, ceux-ci ne tardèrent pas à être islamisés et conquis par les Dioula de Kong, dont ils adoptèrent en partie le costume et les mœurs, tout en conservant l’usage d’un dialecte spécial qui, malgré des influences diverses et notamment bobo, semble bien devoir être rattaché à la famille mandé. De là vient le surnom de Bobo-Dioula qui a été donné aux Sia, comme celui de Bobo-Dioulasso (village des Bobo-Dioula) donné à leur centre principal.
Les Sia ont laissé peu de vestiges de leur passage au travers du cercle actuel de Gahoua, sauf peut-être à Diébougou et à Lorhosso ; mais, une fois installés à Bobo-Dioulasso, ils avaient[300] conservé des relations avec ces deux dernières villes ; aussi les Dioula de Kong, lorsqu’ils eurent assis leur domination sur Bobo-Dioulasso, s’occupèrent des affaires intéressant les familles d’origine sia demeurées à Lorhosso et à Diébougou et s’emparèrent de l’autorité sur les Gan et les Dian, fondant parmi eux des colonies musulmanes mélangées de Sia et de Dioula auxquelles on a donné le surnom de Bobo-Dioula comme aux Sia musulmans de Bobo-Dioulasso.
Il est probable que les Blé, les Natioro, les Ouara et les Sembla du cercle de Bobo-Dioulasso, sur lesquels nous n’avons aucun renseignement précis mais qui parleraient des dialectes apparentés à la famille mandé, doivent avoir une origine analogue à celle des Sia.
Les Sénoufo semblent bien être autochtones dans tous les pays où on les rencontre aujourd’hui, tant au Haut-Sénégal-Niger qu’à la Côte d’Ivoire : toutes les traditions recueillies s’accordent pour faire d’eux les plus anciens habitants connus de leur territoire actuel.
Tout au plus est-il permis de supposer que ce territoire s’étendait davantage autrefois dans la direction de l’Ouest et que l’invasion des Banmana de la rive droite du haut Niger dans le Toron et les pays entre Baoulé et Bagbê, sous la poussée des premières conquêtes mandingues, a forcé les Sénoufo qui habitaient alors ces régions à émigrer sur la rive droite du Bagbê et à rejoindre ceux de leurs compatriotes qui s’y trouvaient déjà. Une tradition s’est conservée à Sikasso relatant que des Sénoufo, pour la plupart chasseurs d’éléphants, auraient habité autrefois la province de Massigui, dans le cercle actuel de Bougouni, et, en ayant été chassés par la surpopulation due à l’invasion banmana, se seraient transportés, en quête de nouveaux territoires de chasse, les uns vers Sikasso, les autres vers Tengréla et le Nord de la Côte d’Ivoire. D’autres furent plus ou moins absorbés par les Banmana, tels ceux qui peuplaient autrefois le Sud-Est du cercle de Bougouni et dont, seuls, quelques habitants du Niénédougou[301] ont conservé les mœurs spéciales, l’aspect et la langue du peuple Sénoufo.
Dans le cercle de Koutiala et la circonscription de San au contraire, malgré la forte proportion des immigrants banmana, les Sénoufo appelés Minianka[239] par ces derniers ont conservé très nettement leur type primitif, et c’est seulement l’appellation de Bambara que leur donnent les musulmans et celle de Bamâna qu’ils se donnent eux-mêmes qui ont pu conduire certains voyageurs à les confondre avec les Banmana.
Les Sénoufo passent, auprès des populations mandé qui les avoisinent, pour avoir été anthropophages dans les temps passés ou tout au moins pour avoir pratiqué une sorte de cannibalisme rituel : on prétend qu’ils sacrifiaient leurs prisonniers de guerre dans les bois sacrés et se repaissaient de leur chair ; aujourd’hui des sacrifices analogues ont lieu, suivis également de la manducation des victimes, mais celles-ci sont simplement des chiens. Je ne sais quel crédit il convient d’accorder à ces accusations rétrospectives d’anthropophagie, qui sont fréquentes en Afrique Occidentale de la part des peuples de civilisation supérieure vis-à-vis de leurs voisins plus arriérés ; il se peut fort bien d’ailleurs qu’elles soient fondées en ce qui concerne les Sénoufo[240], mais je ne serais pas éloigné d’admettre qu’elles le seraient aussi bien en ce qui regarde les Banmana, les Diallonké et les Bobo et Gourounsi du temps jadis : cela expliquerait pourquoi tous les auteurs arabes du moyen Age s’accordent pour taxer d’anthropophagie les populations vivant de leur temps dans le Sud du Ouangara et du Mossi, c’est-à-dire, d’une façon générale, toutes[302] celles habitant la partie méridionale du Haut-Sénégal-Niger ; les mêmes auteurs englobaient tous ces cannibales ou soi-disant tels sous l’appellation générique de Lemlem ou Demdem, sans distinction de province ni de nationalité, et les représentaient comme constituant une mine vivante où s’approvisionnaient d’esclaves les populations du Nord. Il semble bien que les Sénoufo ont été l’une des fractions de ces Lemlem, mais ils devaient partager cette qualité avec les ancêtres des Diallonké et des Banmana actuels, peut-être même avec ceux des Kâgoro, d’une partie des Malinké, des Bobo, des Gourounsi et d’autres peuplades encore[241].
Comme les Sénoufo, les peuples dont l’ensemble constitue la famille voltaïque paraissent être, dans leur ensemble, les plus anciens habitants connus du vaste territoire qu’ils occupent actuellement et qui comprend, d’une manière générale, toutes les régions appartenant au bassin de la Volta, depuis les montagnes de Hombori au Nord jusqu’aux approches de la zone forestière au Sud.
Mais il ne serait pas exact de dire que chacun de ces peuples a toujours habité le pays qu’il habite aujourd’hui : certains semblent n’avoir pas sensiblement changé de place depuis les temps les plus reculés, comme les Tombo et les Bobo ; d’autres au contraire, quoique ayant pris naissance dans le territoire actuel de la famille voltaïque, doivent leur formation à des migrations parfois prolongées et à des mélanges quelquefois multipliés, comme[303] les Mossi par exemple. Nous allons donc passer en revue les peuples principaux de cette famille, en relatant ce que la tradition nous apprend sur chacun d’eux.
1o Groupe tombo (Tombo, Dogom et Déforo).
Les Tombo et les Dogom semblent avoir habité de tout temps leur pays actuel, que les auteurs arabes appellent tantôt El-hadjar (le pays des pierres, en arabe) et tantôt Tombola (le pays des Tombo, en mandé) ou encore Hombori (qui a la même signification en peul). Ils ne paraissent pas d’autre part avoir subi de grandes modifications depuis leur origine première, en raison de la nature spéciale de leur habitat géographique, qui les a défendus, mieux encore que leur valeur guerrière, contre les invasions des peuples étrangers et les tentatives de conquête des souverains de Mali, de Gao, du Yatenga, de Ouagadougou, du Massina, et des pachas de Tombouctou. Tout au plus est-il permis de penser que les Dogom de la plaine ont été, dans certaines régions, plus ou moins absorbés par les populations envahissantes et que ceux qui habitaient autrefois dans une partie du Yatenga et du Mossi ont dû se replier vers le Nord sous la poussée de la conquête mossi.
Certaines traditions semblent attribuer aux Tombo une origine mandé ou tout au moins semblent dire que les Tombo — ou une partie d’entre eux — seraient venus des pays mandé et se seraient réfugiés dans les falaises de la Boucle. Je crois que ces traditions ne concernent qu’une faible fraction des Tombo actuels, celle qui habite du côté de Bandiagara et de San entre la montagne et le Bani, et qu’il faut les interpréter en disant que cette fraction est issue d’un mélange de Tombo proprement dits, autochtones de la montagne, avec des Bozo venus, eux, du pays mandé. Une légende rapporte en effet que les Tombo de la falaise de Bandiagara, ayant eu à souffrir de la disette, envoyèrent aux Bozo de Mopti une députation pour implorer leur secours ; les Bozo partirent tous à la pêche, hommes et femmes, dans le but de fournir de poisson les Tombo, laissant leurs enfants à la garde des envoyés de ces derniers. Pendant l’absence des Bozo, un de leurs enfants se plaignit de la faim ; les envoyés[304] tombo n’ayant absolument aucun aliment à leur disposition, leur chef se coupa un morceau de chair et le donna à l’enfant, mais il mourut victime de son dévouement. A la suite de cet événement, les Bozo décidèrent qu’eux-mêmes et les Tombo seraient désormais considérés comme des frères et que, comme conséquence de cette fraternité, ils ne se marieraient pas entre eux. Il est difficile de savoir si cette interdiction de mariages entre Tombo et Bozo fut scrupuleusement observée, mais il semble bien certain que des rapports amicaux s’établirent entre les deux peuples, qu’un certain nombre de Bozo, s’éloignant des rives du fleuve, cohabitèrent avec des Tombo descendus de la montagne et qu’il se forma ainsi une population spéciale, notablement différente des Tombo propres et dont le dialecte actuel semble résulter d’un mélange de la langue tombo avec la langue bozo, mélange accru de l’introduction d’un grand nombre de vocables soninké et banmana. Mais s’il est permis par suite d’attribuer — au moins en partie — une origine mandé aux Tombo et aux Dogom qui avoisinent le Bani, il semble bien difficile d’en faire autant pour l’immense majorité de la population tombo et dogom.
Un manuscrit arabe récolté à Sokoto par Clapperton en 1827, au cours de son second voyage, dit que le « pays des pierres » qui avoisine le Djilgodi est habité dans les vallées par des Peuls et dans les montagnes par des Beni-Ham de la tribu des Sokaï. Plus loin le même manuscrit dit que le chef de Hombori, qu’il appelle Nouhou Galou et auquel il donne le titre de fama (« roi » en mandé) est un Sokaï. Enfin, parlant à nouveau des Beni-Ham, il dit que ces derniers habitent, non seulement les montagnes de la Boucle, mais aussi la rive gauche du Niger du côté de Gao, auprès des Touareg. Il semble bien évident que, par « Beni-Ham » — c’est-à-dire « Hamites » —, l’auteur du manuscrit entendait tout simplement les Nègres, par opposition aux Peuls, aux Arabes et aux Touareg auxquels il attribuait collectivement une origine sémitique : ses Beni-Ham des montagnes de la Boucle étaient évidemment des Tombo, tandis que ses Beni-Ham de la rive gauche étaient des Songaï. Quant au mot que Salame, dans sa traduction, a transcrit par[305] Sokaï, l’absence du texte arabe rend difficile son identification ; peut-être résulte-t-il d’une confusion des Tombo avec les Songaï, ce qui paraît invraisemblable, vu que le nom de ces derniers est écrit différemment dans la traduction du même texte ; peut-être s’agit-il d’un terme usité à Sokoto pour désigner plus spécialement les Tombo.
| Delafosse | Planche XI |
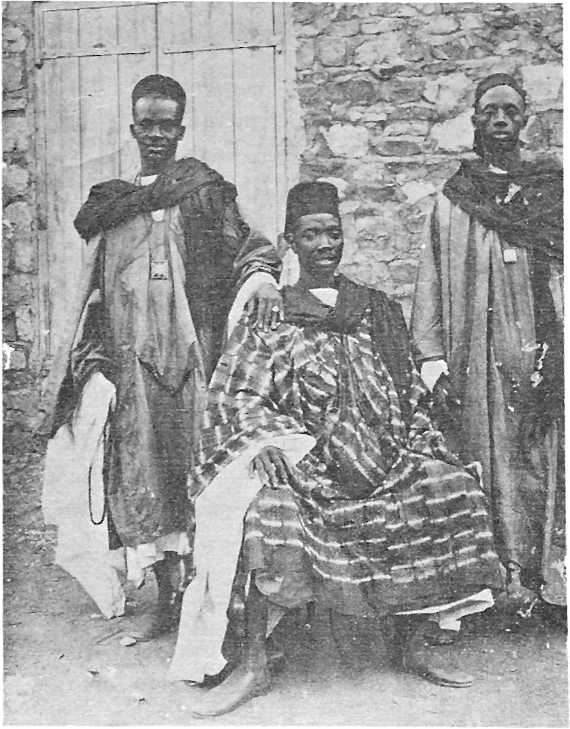
Fig. 21. — Groupe de Ouolofs, à Kayes.
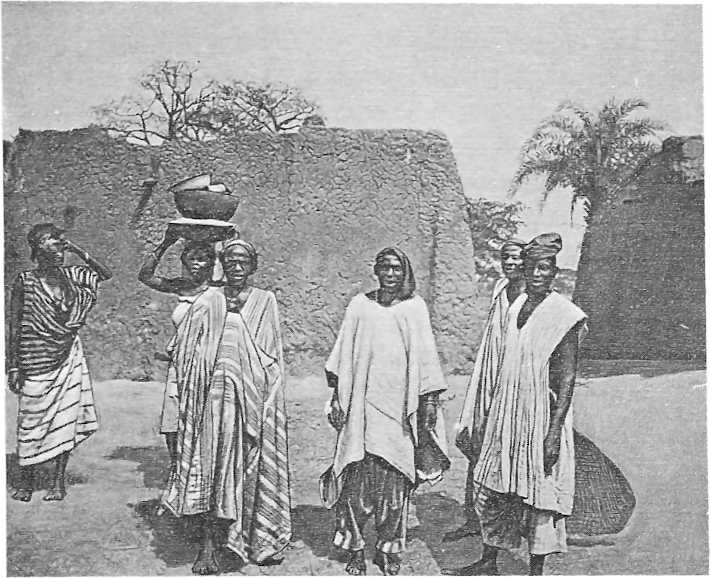
Cliché Delafosse
Fig. 22. — Groupe de Haoussa de la boucle du Niger.
Quant aux Déforo, on a voulu parfois les rattacher aux Gourmantché[242] : si j’en juge d’après le court vocabulaire de leur langue que je dois à l’obligeance de M. le lieutenant Marc, ce rattachement me paraît bien improbable, au moins au point de vue linguistique. Mais il serait possible que les Déforo actuels dussent leur origine à des Dogom répandus autrefois dans le Nord, non seulement du pays Gourmantché, mais aussi du Mossi propre et du Yatenga ; ces Dogom, qui peut-être sont les mêmes que les Suida dont parlent les traditions historiques de Ouagadougou, repoussés vers le Nord par l’invasion mossi, auraient émigré du côté d’Aribinda, entre le Liptako et le Djilgodi, et y seraient devenus les Déforo.
2o Groupe mossi (Mossi, Yansi, Nankana, Gourmantché, Dagari et Birifo).
Le groupe que j’ai appelé mossi renferme un certain nombre de peuples qui ont entre eux des affinités très étroites au point de vue du type physique et de la langue, mais dont les civilisations respectives offrent des différences assez notables selon qu’elles ont subi plus ou moins l’influence politique de l’empire de Ouagadougou ou qu’elles y ont totalement échappé. Je n’ai mentionné dans la nomenclature des peuples de ce groupe que ceux qui habitent le Haut-Sénégal-Niger en totalité (Mossi, Yansi, Gourmantché et Birifo) ou en partie (Nankana et Dagari) ; mais le groupe mossi renferme encore quatre autres peuples dont l’habitat appartient à la colonie anglaise de la Gold Coast : les Gbanian ou Gondja ou Nta (région de Bôlé), les Dagomba ou Dagboma[306] (région de Salaga), les Boura ou Frafra et les Mampoursi (région de Gambaga), ces deux derniers peuples se rattachant d’ailleurs de très près aux Nankana.
C’est le territoire de cette fraction du groupe mossi cantonnée dans la Gold Coast, semble-t-il, — c’est-à-dire le bassin central de la Volta et principalement la vallée de la basse Volta Blanche — qui a dû constituer le berceau primitif du groupe tout entier ; celui-ci ne devait pas s’étendre anciennement bien au Nord du 11e parallèle, les Nankana devaient représenter sa fraction la plus septentrionale, et, entre lui et le groupe tombo, un peu plus avancé vers le Sud qu’il ne l’est aujourd’hui, devait s’intercaler un groupe gourounsi plus étendu, plus compact et plus continu qu’il ne l’est de nos jours.
Si cette hypothèse paraît un peu osée, il est en tout cas à peu près certain que le pays des Dagomba et des Mampoursi fut le point de départ d’invasions qui se portèrent vers le Nord-Est, le Nord, le Nord-Ouest et l’Ouest, constituant des états puissants à Fada-n-Gourma, Ouagadougou et Ouahigouya, et qui, grâce à leurs conquêtes, favorisèrent grandement l’extension du groupe mossi dans la Boucle du Niger et la formation du peuple mossi proprement dit et des peuples gourmantché, yansi, dagari et birifo.
D’après plusieurs traditions recueillies à Ouahigouya, à Ouagadougou et à Tenkodogo, traditions qui présentent entre elles des concordances très remarquables, la plus ancienne invasion dont le souvenir ait été conservé se serait produite au début du XIe siècle de notre ère ; ces traditions en effet comptent toutes 22 générations[243] depuis cette invasion jusqu’à l’époque actuelle : en estimant à quarante ans la durée moyenne de chaque génération, on obtient la date de 1030 pour le premier événement mentionné. Je ne m’illusionne aucunement sur ce que cette supputation[307] peut avoir de chimérique, mais je la tiens néanmoins pour vraisemblable[244].
Donc, tout au début du XIe siècle probablement, régnait à Gambaga un chef dagomba nommé Nédéga, qui avait réuni sous son sceptre les Dagomba, les Mampoursi et les Nankana. L’une de ses filles, appelée par les uns Yennenga et Poko par les autres, était une guerrière remarquable et conduisait au pillage les soldats de son père. Ce dernier, la considérant comme un homme plutôt que comme une femme et estimant d’ailleurs que, si elle devenait mère, elle ne pourrait plus marcher à la tête des armées, ne voulait pas la marier, ce qui ne faisait pas l’affaire de la jeune fille. Un jour que celle-ci avait opéré une razzia chez les Boussansé, entre Bitou et Tenkodogo, son cheval s’emballa et l’emporta loin de ses troupes ; ayant pénétré dans une forêt épaisse, l’animal fut obligé de modérer son allure et finit par s’arrêter devant une hutte de chasseur qui se trouvait là. Cette hutte était habitée par un nommé Riâlé ou Riâré, fils d’un chef malinké, dit la légende ; frustré par son frère de la succession paternelle, ce Riâlé se serait jeté tout seul dans la brousse, à la recherche des éléphants, et, marchant toujours vers l’Est, serait arrivé dans les environs de Bitou, où il s’était fixé provisoirement. Attiré par le galop et les hennissements du cheval de Yennenga, il sortit de sa hutte, maintint l’animal, aida la princesse à mettre pied à terre et lui offrit l’hospitalité dans sa cabane. Yennenga s’éprit des charmes du chasseur, se donna à lui et ne voulut plus le quitter.
Ils eurent un fils ; en souvenir de l’aventure hippique à laquelle elle était redevable de sa maternité, Yennenga appela son enfant Ouidiraogo, c’est-à-dire, en dagomba et en mossi, « cheval mâle ». Lorsque Ouidiraogo fut devenu un jeune homme, Yennenga dépêcha un messager à Gambaga pour aviser Nédéga qu’il était devenu grand-père. Nédéga, en entendant cette nouvelle[308] et en apprenant en même temps que sa fille préférée, qu’il avait vainement fait chercher depuis de longues années et qu’il croyait morte, était encore vivante, pardonna sa fugue à Yennenga et lui fit dire de venir lui présenter son mari et son fils. Yennenga s’en fut donc à Gambaga avec Riâlé et Ouidiraogo ; Nédéga reçut fort bien sa fille, son gendre et son petit-fils et voulut les garder auprès de lui, mais Riâlé refusa, disant qu’il mourrait s’il vivait ailleurs que dans la forêt. Nédéga le laissa partir à regret, avec Yennenga et Ouidiraogo, tout en lui faisant cadeau de quatre chevaux et de cinquante bœufs et en confiant au jeune Ouidiraogo une nombreuse armée de soldats dagomba pour qu’il pût marcher dignement sur les traces de sa mère et de son grand-père.
Riâlé s’en retourna dans la forêt voisine de Bitou, où il continua à partager sa vie entre la chasse à l’éléphant et les plaisirs conjugaux. Après de longues années, Yennenga mourut : son corps fut transporté à Gambaga, où on l’enterra. Sa tombe devint l’objet d’une grande vénération et fut un but de pèlerinage pour les souverains du Mossi jusqu’à une époque récente ; au décès de chaque nâba de Ouagadougou, on envoyait à Gambaga un de ses chevaux et une de ses femmes pour être sacrifiés aux mânes de Yennenga[245].
Quant à Ouidiraogo, à la tête de son armée, il s’empara du pays sur les Boussansé et établit sa résidence en un lieu qu’il appela Tankourou et qui est devenu le Tenkodogo actuel. Des Dagomba, attirés par sa jeune renommée, venaient sans cesse grossir le nombre de ses partisans et accroître la force de ses troupes ; les populations autochtones, peu denses et très divisées, reconnurent bientôt son autorité. Il eut plusieurs fils, dont trois nous sont connus : Zoungourana, Raoua et Diaba. Il confia à chacun d’eux le commandement de l’une des provinces de son empire naissant : Zoungourana reçut le gouvernement de l’Ouest, Raoua celui du Nord et Diaba celui de l’Est, et ce fut là l’origine des[309] trois états de Ouagadougou, de Ouahigouya et de Fada-n-Gourma.
Toutes ces régions, beaucoup moins peuplées qu’aujourd’hui, étaient occupées surtout par des Gourounsi (Boussansé dans la région de Tenkodogo, Nounouma et Nioniossé du côté de Ouagadougou, Nioniossé du côté de Ouahigouya), des Dogom (régions de Ouahigouya, Ponsa et Fada-n-Gourma) et quelques Bariba dans le Sud-Est du cercle actuel de Fada-n-Gourma. Toutes ces populations vivaient à l’état anarchique, séparées en villages ou petits cantons qui se faisaient continuellement la guerre les uns aux autres.
Le chef d’un canton nioniossé situé non loin de Ouagadougou (canton actuel d’Oubritenga), ayant maille à partir avec un chef voisin, envoya une députation à Ouidiraogo pour lui offrir une de ses filles en mariage, afin de gagner son alliance. Ouidiraogo agréa la jeune fille, non pour lui-même, mais pour son fils Zoungourana qui, de cette femme, eut lui-même un fils nommé Oubri. Lors de la naissance d’Oubri, le chef nioniossé allié de Ouidiraogo vint faire hommage de son pays à ce dernier, en l’invitant à venir l’aider dans sa lutte contre son voisin. Ouidiraogo partit dans cette intention, mais mourut à Larabtenga, au cours du voyage, vers l’année 1050.
Zoungourana lui succéda à Tenkodogo et confia à son fils Oubri, encore tout jeune, le commandement des provinces de l’Ouest. Oubri alla s’installer dans le pays du chef nioniossé son beau-père, dans un village qui reçut de lui le nom d’Oubritenga[246]. Devenu homme, il commença une série de conquêtes dont il sera question dans la IVe partie de cet ouvrage, à propos de l’empire de Ouagadougou. Qu’il me suffise de dire ici que les Nounouma et les Nioniossé qui refusèrent d’accepter son autorité durent émigrer sur la Volta Noire et dans le Kipirsi, là où nous les retrouvons actuellement ; les autres furent absorbés par le flot envahisseur venu du Dagomba, adoptèrent la langue des conquérants, et, s’identifiant peu à peu avec[310] ces derniers, formèrent avec eux un seul peuple, celui des Mossi[247].
Pareille chose se passa du côté de Ouahigouya : Raoua, second fils de Ouidiraogo, s’était avancé dans la direction du Nord-Ouest jusqu’à Zandoma, où il avait fixé sa résidence. Il s’y tailla un royaume aux dépens des Nioniossé et des Dogom : les premiers acceptèrent sa domination, comme ils acceptèrent plus tard celle de Ya-Diga, petit-fils d’Oubri et fondateur de l’empire du Yatenga ; les uns conservèrent jusqu’à nos jours leur nationalité et leur langue sous le joug des envahisseurs, les autres furent absorbés par ceux-ci et, de leur mélange avec les conquérants dagomba, naquirent les Mossi du cercle actuel de Ouahigouya. Quant aux Dogom, lors des conquêtes de Raoua, ils se réfugièrent les uns du côté de Bandiagara, les autres du côté du Djilgodi, sous la protection de leurs cousins, les Tombo des montagnes. Un peu plus tard, Ouamtanango, petit-fils d’Oubri, les poursuivit jusque dans la région des falaises : la légende rapporte même qu’une montagne gênant son passage, il la fit scier en deux par des forgerons nioniossé qui accompagnaient son armée et formaient un corps de sapeurs ; ce Ouamtanango fut d’ailleurs assassiné au cours de cette expédition à Bankasso (cercle actuel de Bandiagara).
Cependant, comme nous l’avons vu, Zoungourana, fils aîné de Ouidiraogo, était demeuré à Tenkodogo, qui fut au début le siège d’un empire dont les provinces d’Oubritenga, de Zandoma et de Fada-n-Gourma formaient les royaumes vassaux : au bout de quelque temps, la province d’Oubritenga devint l’empire mossi[311] de Ouagadougou et se rendit indépendante ; un petit-fils d’Oubri, Ya-Diga, fonda au Yatenga, comme je viens de le dire, un autre empire mossi indépendant qui ne tarda pas à absorber Zandoma ; enfin Fada-n-Gourma devint la capitale d’un troisième empire, celui des Gourmantché, comme nous l’allons voir dans un instant. Séré, fils de Zoungourana, ses successeurs et leurs guerriers dagomba durent se contenter du pays des Boussansé et même quitter Tenkodogo pour aller s’établir à Boussouma sous la protection des nâba de Ouagadougou : en se mélangeant avec les Boussansé, ils avaient donné naissance au peuple des Yansi qui, d’une façon générale, suivit la fortune politique de l’empire de Ouagadougou et s’identifia presque avec les Mossi, tandis que les Boussansé habitant au Sud de Tenkodogo, échappant assez vite à la tutelle des conquérants dagomba dont le plus grand nombre s’était porté au Nord-Ouest, au Nord et à l’Est, purent conserver leur nationalité et leur langue jusqu’à l’époque actuelle.
Revenons à Diaba, le troisième fils de Ouidiraogo, que son père avait installé à Fada-n-Gourma ou plutôt à Youngou ou Younga, car ce sont les Haoussa qui donnèrent plus tard à ce village le nom de Fada-n-Gourma, c’est-à-dire dans leur langue « capitale du Gourma ». Des traditions ayant cours chez les Gourmantché prétendent que Diaba, dit Diaba Lompo, descendit du ciel à une époque où la croûte terrestre n’était pas encore solidifiée et que, vêtu de blanc, il prit terre sur un bloc de grès situé près de Tambarga, avec sa femme : on montre même sur ce rocher les empreintes des pieds de Diaba et de sa femme, qui ne sont autres que ces sortes de cavités oblongues creusées par l’eau des pluies dans les roches en état de formation ; Diaba Lompo eut ensuite des enfants, répartit entre eux la terre et la leur fit cultiver. Cette légende, dans laquelle on reconnaît aisément celle du déluge, répandue chez la plupart des populations africaines, n’est pas inconciliable avec la tradition faisant naître Diaba du fils de la princesse dagomba Yennenga : Bantchandé, souverain actuel de Fada-n-Gourma, prétend être le 23e successeur de Diaba Lompo et ce nombre de 22 souverains entre Diaba et Bantchandé s’accorde exactement avec les[312] 22 générations que la tradition mossi place entre Yennenga et l’époque actuelle ; il en faut donc conclure que l’époque de Diaba Lompo correspond à celle de l’invasion dagomba, c’est-à-dire au XIe siècle. Seulement, comme le nom de ce héros légendaire est le plus ancien qu’ait conservé la tradition, on en a fait tout naturellement celui du premier homme qui soit apparu sur la terre habitable.
Lorsque Diaba prit possession de la province de Fada-n-Gourma, elle était vraisemblablement très peu habitée : cependant des Dogom devaient être répandus dans le Nord et des Bariba dans l’Est et le Sud-Est ; les premiers furent chassés en grande partie du côté d’Aribinda et devinrent les Déforo, comme nous l’avons vu précédemment ; les autres furent en partie repoussés vers le Sud mais en partie aussi absorbés par les envahisseurs dagomba et de leur mélange avec ces derniers sortit le peuple des Bimba ou Gourmantché.
Le peuple des Nankana, qui formait la pointe avancée du groupe antérieurement à l’invasion dagomba, ne semble pas avoir changé considérablement de physionomie depuis les temps anciens.
Quant aux Birifo et aux Dagari, ils sont le produit d’une autre poussée des Dagomba, mais dans la direction de l’Ouest cette fois-ci, poussée sans doute bien postérieure à celle dont sortirent les Mossi, les Yansi et les Gourmantché : d’après les traditions recueillies dans le cercle de Gaoua, ce serait seulement au début du XIXe siècle que les Birifo et les Dagari auraient achevé d’occuper leur territoire actuel.
Les Birifo seraient issus du mélange d’une invasion dagomba avec les Lobi, ce qui expliquerait qu’ils se rapprochent étroitement de ces derniers au point de vue du caractère et des mœurs tandis qu’ils parlent une langue presque identique à la langue dagomba et très différente de la langue lobi. Cette invasion dagomba aurait eu sans doute son point de départ sur les bords de la Volta Blanche, dans le Nord de la Gold Coast : arrivant sur la Volta Noire et l’ayant traversée — peut-être vers la fin du XVIIe siècle —, elle s’infiltra au travers des Pougouli et des Dian, dépossédant ces derniers d’une partie de leurs[313] domaines, s’attaquant même aux Dioula installés à Loto (province de Diébougou), et ensuite se dirigea vers le Sud à travers le pays des Lobi et s’établit principalement entre ceux-ci et la rive occidentale de la Volta Noire, poussant une pointe dans le Sud jusque près de Bouna (limite du Haut-Sénégal-Niger et de la Côte d’Ivoire). Des Birifo issus de cette invasion dagomba étaient demeurés sur la rive orientale de la Volta Noire, où on les retrouve encore, mélangés de Dagari : les Anglais les appellent, assez improprement, Lobi-Dagarti.
Les Dagari n’apparurent qu’après les Birifo à l’Ouest de la Volta Noire, mais ils devaient exister depuis longtemps déjà à l’Est du même fleuve et provenaient sans doute d’une migration gbanian plutôt que dagomba, migration due précisément aux conquêtes effectuées par les Dagomba dans l’Est du territoire gbanian. L’invasion dagari en effet ne présenta pas le caractère guerrier et conquérant des diverses invasions dagomba auxquelles nous devons les Mossi, les Yansi, les Gourmantché et les Birifo, et le type actuel des Dagari est remarquablement voisin du type gbanian ; quant à leur langue, elle se distingue à peine du gbanian qui d’ailleurs est lui-même très analogue au dagomba. Quoiqu’il en soit, l’immigration dagari à l’Ouest de la Volta Noire fut pacifique et lente, mais irrésistible ; elle commença sans doute au XVIIIe siècle et elle continue encore de nos jours : se faufilant au travers des Birifo, les Dagari s’établirent partout où ils trouvèrent une place libre, sans cependant s’éloigner beaucoup de la Volta, à l’Est de laquelle est demeuré le gros de leur peuple. Mais une de leurs fractions, celle des Oulé, de caractère plus guerrier que les autres, s’avança à l’Ouest jusque dans la circonscription de Diébougou, repoussant les Pougouli vers le Nord-Ouest, et pénétra même dans les cercles de Koury et de Ouagadougou jusqu’à la rencontre des Nounouma et des Soninké du Dafina. Plus récemment, vers 1850, quelques familles oulé appelées par des Dagari du Sud pour les soutenir contre les Birifo, ont poussé une pointe au Sud le long de la Volta, s’établissant à Goumparé (à hauteur de Gaoua) et dans les environs.
[314]3o Groupe gourounsi (Nioniossé, Nounouma, Sissala et Boussansé).
Ainsi que nous l’avons vu tout à l’heure, il semble que, antérieurement au XIe siècle, les peuples formant le groupe gourounsi occupaient à peu près tout le territoire compris entre celui des Tombo et Dogom au Nord et celui du groupe dagomba (futur groupe mossi) au Sud ; les invasions guerrières venues du Dagomba et la constitution des peuples mossi, yansi et gourmantché, qui en fut la conséquence, restreignirent singulièrement l’étendue du groupe gourounsi et le morcelèrent. Ce morcellement, comme l’absorption par les envahisseurs d’un grand nombre de fractions gourounsi, fut d’autant plus facile que les peuples gourounsi manquaient de cohésion, vivaient en petites tribus dispersées et livrées à l’anarchie et ne présentaient par suite aucune force de résistance.
Les Nioniossé (ou Lilsé, Youlsé, Nimsé, etc.) habitaient le Nord du cercle actuel de Ouagadougou et la majeure partie du cercle actuel de Ouahigouya, ayant comme voisins au Nord les Dogom et au Sud les Nounouma, les Sissala et les Boussansé, trois peuples très voisins du leur. Ils semblent avoir été les premiers habitants du triangle compris entre Koury, Ouagadougou et Ouahigouya. Dès une époque très reculée, ils s’avancèrent en dehors de ce triangle (ancien Kipirsi) vers le Nord-Est : bien avant le XIe siècle, quelques familles nioniossé, sous la conduite d’un chef nommé Ouéto, étaient allées se fixer dans le Djilgodi à Loroum (près Pobé) ; elles n’y demeurèrent pas longtemps et Ouéto vint bientôt s’installer à Bougouré (cercle actuel de Ouahigouya), tandis que son frère Ziguiri s’installait à Gambo et l’un de ses fils à Rounga ou Ronga (au Nord-Est et à l’Est de Ouahigouya). Ces familles, qui étaient les plus septentrionales du peuple nioniossé, s’établirent pacifiquement auprès des Dogom, qui leur donnèrent des terrains et vécurent avec elles en bonne intelligence. C’est ainsi que, peu à peu, les Nioniossé occupèrent la majeure partie du pays que l’on appela plus tard le Yatenga. Nous avons vu que, lors de la constitution des empires mossi, certaines fractions des Nioniossé acceptèrent la domination des envahisseurs tout en conservant leur langue et leur[315] nationalité, que d’autres se mélangèrent avec eux jusqu’à devenir des Mossi et que d’autres enfin, ayant voulu leur résister, furent refoulées dans le Kipirsi actuel, c’est-à-dire dans la partie la plus méridionale de leur domaine. C’est ainsi qu’aujourd’hui on rencontre des Nioniossé éparpillés au milieu des Mossi depuis le Yatenga jusqu’au Kipirsi.
Les Nounouma, avant l’invasion dagomba, s’avançaient probablement plus vers le Nord et vers l’Est que de nos jours : un grand nombre d’entre eux furent absorbés par les conquérants et fournirent leur contingent à la constitution du peuple mossi ; les autres, refoulés ou maintenus dans leur pays actuel, sur les bords de la Volta Noire en aval de Koury, se sont conservés à peu près intacts.
Les Sissala, petit peuple sans grande importance, devaient autrefois rejoindre les Boussansé vers l’Est : une poussée des Nankana vers le Nord, consécutive à l’extension des Dagomba, les a séparés des Boussansé et a restreint leur territoire à une toute petite province.
Enfin les Boussansé, nous l’avons vu, se laissèrent conquérir et assimiler par les envahisseurs dagomba au Nord de Tenkodogo (régions de Koupéla, Béloussa, Boussouma, etc.) pour former les Yansi, tandis qu’au Sud du même point ils réussirent à conserver leur nationalité.
Mais beaucoup de familles nioniossé ou nounouma ne voulurent ni accepter la suzeraineté des Mossi ni se cantonner dans le petit territoire du Kipirsi, qui était trop étroit sans doute pour contenir tous les émigrés venus du Nord : aussi se produisit-il des exodes dont les plus importants donnèrent naissance, comme nous le verrons dans un instant, au groupe lobi et au peuple koulango et dont d’autres, moins considérables, amenèrent la formation de petites tribus isolées, d’origine gourounsi, qu’on rencontre à la Côte d’Ivoire : celle des Siti, entre Bouna et la Volta Noire, et celle des Dégha (ou Mô ou Diammou), entre Bondoukou et la frontière anglaise.
4o Groupe ou peuple bobo.
Les Bobo ont occupé de tout temps, semble-t-il, leur territoire[316] actuel, mais ils s’avançaient autrefois davantage vers le Nord-Ouest, puisque la tradition rapporte qu’ils occupaient avant les Bozo l’emplacement actuel de Dienné. Les immigrations soninké et banmana les éloignèrent peu à peu des rives du Bani et restreignirent leur domaine, mais sans modifier sensiblement leur type primitif et sans les entamer sérieusement. D’autre part, les Bobo-Niénigué, vers le XVIe siècle, auraient agrandi leur territoire du côté du Sud, ce qui aurait contribué à diriger l’immigration sia de Diébougou vers Lorhosso d’abord, puis vers Bobo-Dioulasso.
5o Groupe lobi (Pougouli, Dian, Gan et Lobi).
Les Pougouli disent être venus du Kipirsi. Leurs traditions rapportent qu’ils appartenaient primitivement au même groupe que les Nounouma, c’est-à-dire au groupe gourounsi, et qu’ils auraient émigré du Kipirsi lorsque ce refuge des Gourounsi indépendants devint trop étroit pour les contenir tous, mais postérieurement à l’émigration qui donna naissance aux Koulango (voir plus loin), c’est à dire au plus tôt vers la fin du XIIe siècle. Traversant la Volta Noire près du confluent du Manouan-mâné (fleuve de Manouan), qui fut appelé à cause d’eux par les Dioula Pougouliba ou Bougouriba, ils s’établirent le long des rives de ce cours d’eau. Au XVIIIe siècle, sous la poussée des Dagari et surtout des Oulé, ils remontèrent plus haut et s’éloignèrent de la Volta.
Les Dian, qu’on ne rencontre plus guère aujourd’hui qu’à Diébougou et aux environs de cette ville, vinrent du Kipirsi comme les Pougouli mais postérieurement à ces derniers, sans doute vers la fin du XIIIe siècle. Ils se seraient établis d’abord dans la région de Djifango, puis, sous la conduite d’un chef nommé Konkouné, dans la région de Loto, qu’ils occupent encore ; ils en auraient chassé les Padorho, dont on ne rencontre plus aujourd’hui que quelques représentants dans l’Ouest du cercle de Gaoua et qui étaient peut-être les autochtones du pays[248].[317] Inquiétés au XVIIIe siècle par l’invasion des Oulé, les Dian firent appel aux Dioula de Bobo-Dioulasso qui leur envoyèrent une petite armée commandée par Bé-Bakari Ouatara ; ce dernier occupa Loto ; des Dioula y demeurèrent, firent souche et introduisirent l’islamisme parmi les Dian ; mais leur suzeraineté ne fut effective dans la région que lorsqu’une colonne venait de Bobo-Dioulasso pour razzier le pays. Vers 1820, une famille dian qui était demeurée sur la rive gauche de la Volta, à Lorha, eut à se plaindre des Dagari et vint se réfugier auprès de ses compatriotes de Loto : c’est cette famille qui fonda le Diébougou actuel.
Les Gan auraient fait partie de la même migration que les Dian et se seraient établis au Sud des Pougouli, dans le centre du cercle actuel de Gaoua. L’un de leurs villages principaux était précisément Gaoua, que les indigènes appellent encore aujourd’hui Gan-oura, ce qui signifierait « les Gan sont ici ». Ils furent supplantés dans cette région par les Lobi, à une date qu’il est difficile de préciser, mais qui est certainement postérieure au XIIIe siècle (date probable de l’immigration dian et gan) et antérieure à la formation du peuple birifo (XVIIe siècle) ; ainsi repoussés vers le Sud par les Lobi, les Gan se portèrent vers Lorhosso, qu’ils occupèrent sur les Lorho, ancêtres des Koulango. Ces événements durent se passer au XIVe siècle : cette date concorderait avec les traditions que M. l’administrateur Benquey et moi-même avons recueillies à Bondoukou (Côte d’Ivoire) sur la fondation d’un quartier de cette ville par des Lorho fuyant les Gan, antérieurement à l’arrivée des Dioula de Bégho, laquelle se produisit au XVe siècle. Actuellement le territoire des Gan se réduit à peu près à la ville et au canton de Lorhosso et leur type primitif a été fortement altéré, comme celui des Dian, par des mélanges avec les Dioula de Bobo-Dioulasso.
Les Lobi, comme je viens de le dire, firent sans doute au XIVe siècle leur première apparition dans leur pays actuel, venant, eux aussi, du Kipirsi. D’un caractère plus guerrier que les Pougouli, les Dian et les Gan, c’est à main armée qu’ils occupèrent les régions montagneuses et aurifères qui avoisinent[318] Gaoua. De là, toujours en conquérants, ils se portèrent vers l’Ouest et vers le Sud, débordant jusque dans le Nord de la Côte d’Ivoire à l’Ouest de Bouna. Une fois maîtres de leur territoire, ils s’y sont fortement maintenus, résistant victorieusement aux tentatives dirigées par les Dioula de Bobo-Dioulasso et, plus récemment, aux bandes de Samori.
6o Groupe ou peuple koulango.
C’est la première des migrations gourounsi venues du Kipirsi qui, vers la fin de XIe siècle, donna naissance aux Lorho et par suite au peuple koulango ou pakhalla. Traversant le cercle actuel de Gaoua, les Lorho se seraient dirigés vers le Sud-Ouest de ce cercle et se seraient établis en un point qui reçut d’eux le nom de Lorhosso. Lorsque l’invasion lobi repoussa les Gan vers ce point au XIVe siècle, la plupart des Lorho émigrèrent au Sud et allèrent fonder Bouna et Bondoukou, se répandant dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire depuis la Volta Noire jusqu’à Kong et au Sud jusqu’à la lisière de la forêt dense, s’enfonçant même en certains endroits dans la forêt et constituant le peuple des Koulango. Quelques Lorho cependant sont demeurés dans le Haut-Sénégal-Niger, notamment à Lorhopéni, près et à l’Est de Lorhosso.
7o Groupe bariba.
Ce groupe, qui intéresse surtout le Dahomey, possède cependant quelques représentants dans le cercle de Fada-n-Gourma, représentants qui appartiennent à deux peuples différents : les Bariba proprement dits et les Soumba ; ces derniers sont d’ailleurs fort peu nombreux dans le Haut-Sénégal-Niger.
Il semble que les Bariba étaient les anciens autochtones, non seulement de leur pays actuel, mais aussi d’une bonne partie du cercle actuel de Fada-n-Gourma : beaucoup se sont fondus avec les envahisseurs dagomba pour former le peuple gourmantché ; les autres se sont reportés plus au Sud et ont conservé à peu près leur type primitif, bien que l’influence du groupe mossi sur leur civilisation soit assez perceptible.
Les Soumba au contraire semblent n’avoir été touchés par[319] aucune influence étrangère : aussi, bien qu’appartenant vraisemblablement au même groupe ethnique que les Bariba, ils se distinguent nettement de ceux-ci à l’heure actuelle.
donnant les dates approximatives des principaux événements relatifs aux origines et aux migrations des peuples du Haut-Sénégal-Niger.
? 200 av. J.-C. — Fondation de Néma et Ghana par des Soninké du Diagha.
? 100 av. J.-C. — Premières immigrations berbères dans le Hodh.
80 à 90 après J.-C. — Départ de Cyrénaïque de la première migration judéo-syrienne (vers l’Aïr et le Massina).
117. — Départ de la deuxième migration judéo-syrienne (vers le Touat).
? 150. — Arrivée à Ghana des Judéo-Syriens du Massina.
? 200. — Arrivée à Ghana des Judéo-Syriens du Touat.
? 300. — Fondation de l’empire judéo-syrien de Ghana.
? 600. — Installation des Songaï à Gounguia ou Koukia.
670. — Départ des Lemta et Hoouara de la Tripolitaine vers le Niger.
? 690. — Fondation de l’empire lemta à Gounguia (dynastie des Dia). — Les Songaï (Sorko) à Gao. — Premières migrations des Soninké du Diagha vers Dienné et vers le Diafounou et le Kingui.
? 700. — Arrivée des Messoufa à Teghazza. — Nouvelles immigrations berbères dans le Hodh.
? 750. — Maghan-Diabé Sissé fonde le royaume soninké du Ouagadou.
? 790 à 800. — Arrivée des Bérabich à Teghazza. — Dispersion des Soninké du Ouagadou : Kaya-Maghan Sissé fonde l’empire soninké de Ghana. — Fondation de Tichit. — Arrivée des Judéo-Syriens au Gorgol. — Les Soninké au Galam.
[320]? 800. — Les Bérabich maîtres de Teghazza. — Installation des Soninké dans la région de Dienné. — Arrivée des Judéo-Syriens au Fouta-Toro. — Les Lemtouna à Aoudaghost.
? 890. — Les Lemta à Gao ; les Songaï (Sorko) à Bamba.
? 900. — Les Saghmara (Kel-Tadmekket) au Niger.
930. — Les Lemtouna luttent avec les Soninké de Ghana.
? 990. — Les Soninké de Ghana suzerains des Lemtouna d’Aoudaghost.
? 1000. — Formation des Peuls dans le Fouta et leur dispersion. — Ouâr Diâbi fonde l’empire toucouleur du Tekrour et islamise les Toucouleurs. — Les Peuls au Ferlo. — Les Dioula dans la Boucle du Niger.
1009. — Dia Kossoï se convertit à l’islamisme et transporte la capitale des Lemta de Gounguia à Gao.
? 1030. — Début des invasions dagomba et de la formation des empires mossi et gourmantché.
1042. — Début de l’organisation de la secte berbère des Almoravides.
? 1060. — Les Peuls au Galam.
1076. — Prise de Ghana par les Almoravides et dispersion des Soninké de Ghana. — Première islamisation des Berbères du Hodh. — Arrivée des Goddala dans la région de Tombouctou. — Fondation de l’empire soninké des Sossé au Kaniaga, du royaume soninké des Niakaté au Kingui et du royaume soninké des Doukouré au Bakounou. — Arrivée des Soninké à Nono.
? 1090. — Migration des Peuls du Galam vers le Kaniaga et des Peuls du Ferlo vers le Fouta-Diallon. — Première migration gourounsi du Kipirsi vers la région de Gaoua (Lorho ou Koulango). — Les Soninké de Ghana reconquièrent leur indépendance.
? 1100. — Les Peuls au Kaniaga. — Premières habitations construites sur l’emplacement de Tombouctou.
? 1190. — Les Songaï (Sorko) à Gourao. — Bouyagui-Toumbéli roi de Goumbou. — Formation des Pougouli.
? 1200. — Les Lemta à Bamba. — Les Songaï (Faran) à Saraféré.
1203. — Prise de Ghana sur les Sissé par les Soninké Sossé.
[321]1213. — Fondation de l’empire mandingue par Allakoï Keïta.
? 1220. — Les Banmana se concentrent dans le Toron.
1224. — Fondation de Oualata. — Les Somono dans la région de Bamako-Ségou.
1235. — Soundiata Keïta bat Soumangourou Kannté à Kirina et renverse l’empire sossé du Kaniaga.
1240. — Soundiata prend et détruit Ghana et transporte la capitale de l’empire mandingue de Kangaba à Mali.
1250. — Les Soninké-Nono fondent la ville de Dienné. — Commencement de la migration des Mandé du Sud du Fouta-Diallon vers la Côte d’Ivoire. — Les Sossé s’emparent du Tekrour sur les Toucouleurs.
1270. — Mamoudou Diawara renverse la dynastie des Niakaté et fonde celle des Diawara au Kingui.
? 1290. — Formation des Dian et des Gan.
? 1300. — Développement de Tombouctou et de Dienné. — Fondation de Nioro par des Diawambé. — Conversion de Dienné à l’islamisme.
1307. — Avènement de Kankan-Moussa à Mali.
1325. — Kankan-Moussa s’empare de Gao et de Tombouctou. — Construction des premières maisons à terrasse à Gao, Tombouctou et Dienné.
1333. — Les Mossi prennent et pillent Tombouctou.
1335. — Ali-Kolen fonde la deuxième dynastie des Lemta à Gao (dynastie des Sonni).
? 1350. — Les Ouolofs s’emparent du Tekrour. — Arrivée des Berbères sur la rive Nord du Sénégal ; migration des Sérères dans le Sine. — Invasion des Lobi à Gaoua ; les Gan à Lorhosso ; les Koulango fondent Bouna et se portent à Bondoukou. — Formation première des Samo.
? 1400. — Migrations des Peuls du Kaniaga au Massina et au Bakounou.
1433. — Les Touareg s’emparent de Tombouctou sur les Mandingues.
1450. — Arrivée des Kounta dans l’Azaouad. — Luttes des Sagoné contre les Dabo au Kingui. — Fondation de Sokolo.
1464-65. — Avènement de Sonni Ali-Ber.
[322]1468 à 1473. — Ali-Ber conquiert Tombouctou et Dienné et affranchit l’empire de Gao de la suzeraineté mandingue.
1480. — Pillage de Oualata par les Mossi.
1492. — Mort de Sonni Ali-Ber. — Expulsion des Juifs du Touat.
1493. — Le Soninké Mohammed Touré fonde à Gao la dynastie des Askia. — Arrivée des Oulmidden à Gao et dans la Boucle ; leur conversion à l’islamisme.
? 1495. — Commencement des migrations peules dans la Boucle du Niger.
1512. — Mort de Tindo Galadio au Kingui. Son fils Koli va au Fouta-Toro, qu’il affranchit de la suzeraineté des Ouolofs et où il fonde une dynastie peule.
1534. — Victoires des Peuls et Toucouleurs du Fouta sur les Soninké du Galam et les Mandingues du Boundou.
1585. — Fondation de Taodéni.
1591. — Prise de Gao et de Tombouctou par le pacha marocain Djouder.
1596. — Taodéni remplace Teghazza. — Conquête du Hodh par les Beni-Hassân et islamisation définitive des Berbères du Hodh. — Formation des Sia et des Samorho. — Formation définitive des Samo.
? 1600. — Islamisation des Bérabich par les Kounta. — Formation des Foulanké du Ganadougou. — Installation des Banmana de Kaladian Kouloubali dans la région de Ségou.
1612. — Les pachas de Tombouctou cessent d’être désignés par le sultan du Maroc.
1620. — Danfassari Kouloubali s’installe à Ségou-koro.
1640. — Destruction de Tadmekket par les Oulmidden. — Deuxième immigration des Kel-Tadmekket sur le Niger.
1660. — On cesse à Tombouctou de dire le prône au nom du sultan du Maroc.
1670. — Biton Kouloubali fonde l’empire banmana de Ségou et étend sa domination jusqu’à Tombouctou. — Zié et Sounsa fondent l’empire banmana du Kaarta.
1671. — Expédition du sultan Er-Rachid au Soudan.
1672. — Expédition du marocain Ahmed à Tombouctou.
1680. — Prise de Gao par les Touareg.
[323]? 1690. — Invasion des Birifo dans la région de Gaoua.
? 1700. — Les Peuls sont répandus dans toute la Boucle du Niger et au-delà. — Islamisation des Peuls. — Arrivée des Dagari sur la rive droite de la Volta. — Prise de Lorhosso et de Loto par les Dioula de Bobo-Dioulasso.
1720. — Conquête du Fouta-Diallon par les Toucouleurs. — Migration des Peuls du Fouta-Diallon au Ouassoulou et vers la Boucle du Niger. — Formation définitive des Foulanké.
1754. — Avènement de Ngolo Diara à Ségou et de Sébé Kouloubali à Nioro.
1802. — Conquête du Haoussa par les Peuls.
1810. — Les Peuls du Massina se rendent indépendants de Ségou.
1820. — Fondation de Diébougou.
1826. — Prise de Tombouctou par les Peuls du Massina.
1832. — Les Soninké à Banamba.
1861. — Prise de Ségou par El-hadj-Omar.
[102]Ainsi, au cas où les successeurs d’El-hadj Omar se seraient maintenus à Ségou, on nous dirait très probablement aujourd’hui que les gens de Ségou viennent du Fouta Sénégalais.
[103]Le mot yemen en arabe signifie proprement « la droite ». Comme beaucoup d’Orientaux et comme aussi la plupart des Nègres, les Arabes s’orientent en faisant face au soleil levant : par suite « droite » devient pour eux synonyme de « Sud » et c’est ainsi que les gens du Hidjaz ont donné le nom de Yémen au pays situé au Sud du leur. De même que Gourma désigne le Sud à Bamba et l’Est à Niafounké, de même Yémen — devenu nom de pays après avoir été un simple nom de direction — désigne le Sud à La Mecque et l’Est ou le Nord-Est au Soudan.
[104]L’immigration arabe dont ils faisaient partie comprenait surtout des Oulad-Slimân, qui forment encore la fraction principale des Bérabich ; une partie de ces Oulad-Slimân s’établit dans la Tripolitaine et, de là, se répandit plus tard vers le Tchad.
[105]Sidi Mohammed-el-Kounti (père du premier El-Bekkaï) d’après les uns, mais plutôt Yahia-ben-Osmân-ben-Yassen (grand père de Mohammed-el-Kounti) d’après de plus nombreux témoignages.
[106]Le village même de Mabrouk serait beaucoup plus récent et n’aurait été fondé qu’en 1808 par la sous-tribu kounta des Oulad-el-Ouafi.
[107]Voir à ce sujet le tableau généalogique des Bekkaï dans Littérature arabe saharienne par Ismaël Hamet (Revue du monde musulman, octobre 1910).
[108]On retrouve chez les auteurs grecs et latins des noms de tribus berbères qui subsistent encore de nos jours : c’est ainsi qu’on a pu identifier les Libyens proprement dits (Loubim de la Bible, Lebataï de Procope) avec les Lewwata ou Louata, les Gétules avec les Goddala ou Djedala ou avec les Guezoula, les Serangaï de Ptolémée (placés par lui dans le Sous) avec les Zenaga, les Maxyes d’Hérodote (Mazikes, Masices, Mazices et Mazax de Lucrèce, Suétone, Ptolémée, Ammien Marcellin, Corippus et Cassien) avec les Imazirhen ou Imocharhen, c’est-à-dire avec les Berbères de souche noble. — Voici maintenant un résumé des principales théories arabes concernant l’origine des Berbères. Yakout (XIIe-XIIIe siècles) nous dit que Berber est le nom de nombreuses tribus habitant les montagnes du Maghreb depuis Barka jusqu’à l’Atlantique et s’étendant au Sud jusqu’au pays des Noirs ; il ajoute que les Berbères font en général remonter leur origine à Sem et prétendent que leurs ancêtres auraient émigré d’Arabie en Afrique ; leur langue primitive — qui aurait été une langue sémitique — se serait corrompue au contact de la langue des autochtones du Maghreb — (qui étaient ces autochtones ? Yakout ne nous le dit pas) — et serait devenue le berbère. Certains, précise Yakout, disent que le roi himyarite Ifrîkos, étant venu du Yémen faire une expédition en Ifrîkia (Tunisie), aurait fondé là un établissement de Yéménites dont les descendants seraient les Berbères. Dans sa nomenclature des principales tribus berbères, Yakout en cite plusieurs dont les noms sont portés encore par des sous-tribus maures du Hodh et de l’Azaouad (par exemple les Louata, qu’on rencontre chez les Idao-Aïch, et les Sakhoura, sans doute les mêmes que les Zakhoura vassaux des Kounta). D’après Ibn-Khaldoun (XIVe siècle), qui paraît mieux informé que Yakout et qui surtout est doué d’un véritable esprit critique manquant au précédent, les Berbères descendraient de Ham ou Cham par Chanaan, Mazigh (d’où le nom d’Imazirhen porté de nos jours encore par les familles nobles) et un nommé Berr, dont l’un des fils, Madghis, serait l’ancêtre des Zenata et de leurs cousins les Louata, les Zouaoua, les Maghraoua, etc., et dont l’autre fils, Bernès, serait l’ancêtre des Zenaga (enfants de Zenag, fils de Bernès, comprenant les Messoufa, les Goddala, les Lemtouna, les Maddassa, les Ouareth, etc.) et de leurs cousins les Lemta, les Hoouara, les Guezoula, les Masmouda, les Ketama, les Mesrata, etc. Il ajoute d’ailleurs que beaucoup, principalement parmi les Berbères eux-mêmes, attribuent à cette nation une origine sémitique, dans le but évident de la rattacher à la même souche que les Arabes : c’est ainsi que les uns les font descendre d’un fils d’Abraham nommé Yaksân, d’autres des Amalécites issus d’Esaü, d’autres des Syriens et Yéménites venus en Afrique avec Ifrîkos, d’autres des Egyptiens, etc. Après avoir dit que l’opinion la plus répandue en fait des Hamites ayant vécu longtemps au contact des Sémites (des Israélites surtout), puis ayant été chassés d’Asie par les Juifs et ayant passé en Egypte et de là en Ifrîkia et au Maghreb, à une époque fort reculée et certainement bien avant Ifrîkos, Ibn-Khaldoun conclut fort sagement : « Une nation comme celle des Berbères, formée d’une foule de peuples et remplissant une partie considérable de la terre, n’a pas pu y être transportée d’un autre endroit et surtout d’une région très bornée. Depuis une longue suite de siècles avant l’islamisme, les Berbères ont été connus comme habitants du pays et des régions qui leur appartiennent de nos jours. » (Histoire des Berbères, traduction de Slane, 1er vol., page 183). Procope (VIe siècle) avait soutenu déjà la théorie faisant remonter les Berbères aux Hamites issus de Chanaan qui furent chassés de Palestine par les Hébreux, lorsque ces derniers s’y installèrent en revenant d’Egypte.
[109]Le géographe arabe Ibn-Saïd (XIIIe siècle) place Aoudaghost par 17° de latitude Nord et à une dizaine de degrés de longitude planimétrique à l’Est de l’embouchure du Sénégal, ce qui correspondrait approximativement à 13° de longitude Ouest de Paris et situerait Aoudaghost à une soixantaine de kilomètres au Nord-Est de Kiffa.
[110]Cela résulte tout au moins du témoignage de l’écrivain arabe Zohri (XIIe siècle), d’après lequel les Berbères du Soudan n’auraient abjuré le christianisme et embrassé l’islamisme que vers l’année 1075.
[111]Le chef de la conquête s’appelait, dit la légende, Osmân-ould-Barkani ould Maghfar : son fils Terrouz aurait donné son nom aux Trarza, son frère Haroun ould-Barkani le nom de son père aux Brakna et son autre frère Mbarek son propre nom aux Oulad-Mbarek.
[112]Les ancêtres sémitiques des Guirganké seraient des Judéo-Syriens ou Proto-Peuls, métissés de Soninké, qui auraient fondé Tichit, auraient émigré ensuite dans le Tagant et plus tard, à la suite de luttes sanglantes avec les Zénaga, se seraient refugiés à Diara, non loin de Nioro, auprès des Oulad-Mbarek et se seraient alliés là à des Beni-Hassân. Nous en reparlerons lorsqu’il sera question de la formation des Peuls. Au moment de la conquête de Nioro par El-hadj-Omar, la plupart des Guirganké se réfugièrent dans la région d’Akor, du côté de Goumbou.
[113]Relativement nombreux en Mauritanie, les Maures parlant le zenaga sont excessivement rares dans le Hodh.
[114]En outre des Beni-Hassân, quelques autres familles arabes ont contribué à renforcer l’élément sémitique dans le Hodh : c’est ainsi que des Kounta venus de l’Azaouad s’établirent en plusieurs endroits de cette contrée et notamment à Tichit, lors de leur mouvement vers le Tagant et l’Adrar ; à différentes époques, des Arabes ou Berbères arabisés vinrent du Maroc dans les mêmes régions : c’est le cas des Taleb-Mokhtar, dont les ancêtres, chassés du Sud-marocain à la suite d’événements obscurs, seraient venus s’établir au Massina, d’où, fuyant devant la conquête d’El-hadj-Omar, ils auraient, conduits par Mohammed-Fadel, émigré vers Goumbou et Oualata auprès des Mejdouf, tandis que d’autres fractions de leur famille poussaient jusqu’en Mauritanie avec Saad-Bou et plus tard dans la Saguiet-el-hamra avec Mâ-el-Aïnîn.
[115]On a cru parfois pouvoir identifier Koukia avec Gao, mais, comme nous le verrons dans la IVe partie de cet ouvrage en traitant de l’histoire de l’empire de Gao, une telle identification est matériellement impossible. Je ferai observer que goungui signifie « île » en songaï ; dans la même langue goungui-yo signifierait « les îles », goungui yé « les sept îles » et goungui yaha « les huit îles ».
[116]Voir IVe partie. Je tiens à faire observer que cette théorie de l’origine berbère des fondateurs de l’empire dit « songaï », rejetée par M. René Basset, avait été soutenue par Barth.
[117]Les géographes arabes, amoureux d’étymologies savantes, traduisent Tadmekket par « qui ressemble à La Mecque » et disent que ce nom, qui pourtant semble bien être antérieur à l’islam, aurait été donné à la ville parce qu’elle était, comme La Mecque, située entre deux collines.
[118]On sait que les Arabes ont donné le nom d’Ifrîkia à la région correspondant à peu près à l’ancienne province d’Afrique des Romains, région constituée principalement par la Tunisie actuelle, tout en faisant venir ce nom de la soi-disant colonie fondée dans ces parages par le fameux roi himyarite Ifrîkos.
[119]Les Kel-Antassar sont déjà signalés au XIe siècle par Bekri sous le nom de Beni-Intasser ; mais ils habitaient alors entre le Tagant et Oualata, c’est-à-dire dans le Hodh, et n’avaient pas encore gagné leur pays actuel.
[120]A titre purement documentaire, je crois bon de donner ici la théorie de l’auteur du Houlel el-mouwachia fi dikr el-akhbâr el-marrâkochiya sur l’origine des Touareg. Ils seraient, d’après lui, des Messoufa apparentés aux Zenaga issus de Himyar ; ils ne descendraient des Berbères que par les femmes et seraient originaires du Yémen. Un roi de ce pays (sans doute Harits-er-Raïch, le premier tobba ou roi himyarite, qui vivait un peu avant notre ère) avait eu, à la suite d’enseignements reçus d’un rabbin, la divination de la venue d’un Messie (soit Mahomet, soit plutôt Jésus-Christ) et il invita ses sujets à adopter ses croyances. Après sa mort, ceux qui avaient partagé sa foi furent persécutés et chassés ; ils se voilèrent le visage pour ne pas être reconnus de leurs ennemis et (sans doute sous le règne d’Ifrîkos, le troisième tobba, vers le début de notre ère), ils quittèrent le Yémen et gagnèrent le pays des Berbères, où ils se marièrent et s’installèrent comme dans une nouvelle patrie. Leur voile les ayant protégés contre leurs persécuteurs, ils le conservèrent pieusement sans jamais s’en séparer. Ils oublièrent leur langue (l’arabe) par suite de leur incorporation aux Berbères et adoptèrent celle de ces derniers. Les Touareg seraient les descendants de ces Zenaga voilés, qui auraient été chassés dans le désert par une fraction d’entre eux, celle des Almoravides. Il est à remarquer que la plupart des auteurs arabes attribuent cette origine mi-yéménite mi-berbère à tous les Zenaga et à quelques tribus qui leur sont apparentées de près, les Lemta entre autres.
[121]Le mot Fouth, dans les rédactions de la Bible en langues sémitiques, se termine par un t emphatique ou th (thav des Hébreux, tha des Arabes), lettre qui se rend en peul par un d spécial ou dh se changeant fréquemment en l, en sorte que le Fouth de la Bible peut parfaitement être considéré comme provenant d’une racine identique à celle de la syllabe foul, qui est le radical du nom des Peuls. Au contraire le nom du Fouta s’écrit en arabe par un t ordinaire et semble provenir d’un radical différent. — Ce terme de Fouth ou Foul, dans les traductions européennes de la Bible, a été remplacé souvent par « Afrique » ou par « Libye », mais sans aucune raison.
[122]Genèse, X, 6. L’auteur de la Genèse indique la descendance des trois autres fils de Ham, mais ne donne pas celle de Fouth.
[123]C’est ainsi que les Sabéens ou Yéménites sont donnés tantôt comme descendant de Sem par Heber et Yektân et tantôt comme descendant de Ham par Chous.
[124]Cette femme avait été capturée au cours d’une razzia par Sonni Ali (1464-1492) et donnée par ce prince en mariage à Abdallah-el-Balbali, arrière-grand-père de Sa’di.
[125]An account of the empire of Marocco, 1810, page 212.
[126]Ce manuscrit renfermait un court extrait d’un ouvrage intitulé El-enfak el-maïsour fi tarikh belad et-Tekrour (exposé facilitant l’étude de l’histoire du pays de Tekrour). Clapperton n’en a pas publié le texte et n’en a donné qu’une traduction de A. Salame, qui figure à l’appendice de sa relation de voyage (appendix no XII, pages 158-167, dans l’édition anglaise) ; une carte, dessinée par le sultan Bello, est reproduite dans la IIe partie du volume, face à la page 109. — Par Tekrour, Bello comprend tout le Soudan, depuis le Darfour jusqu’au Fouta ; sa carte place ce dernier pays à l’extrême Ouest. — D’autres manuscrits remis à Clapperton lors de son second voyage à Sokoto (1827) et rapportés par Lander sont plus explicites et accordent aux Peuls une origine nettement judéo-syrienne. (Voir l’appendice de Clapperton’s journal of a second expedition into the interior of Africa, 1829).
[127]Histoire et origine des Foulahs ou Fellans, 1841.
[128]Et non du Fezzan, comme l’écrit de Guiraudon, qui a reproduit cette légende en introduisant dans le texte original un certain nombre de rectifications pour la plupart malheureuses.
[129]D’ailleurs la légende recueillie par Reichardt renferme des inexactitudes flagrantes : Sidi et Séri étaient, non pas les chefs de l’immigration peule au Massina, mais les chefs de la conquête du Fouta-Diallon par les Toucouleurs du Fouta Sénégalais.
[130]Il est à remarquer de plus que le h final de fellah fait partie de la racine du mot, alors que cette lettre — en dépit de l’orthographe anglaise Fulah adoptée par beaucoup de Français — est totalement absente de la racine foul, d’où vient le nom des Peuls.
[131]La manie étymologique, forme d’aspect savant du calembour par à peu près, a trouvé d’ailleurs ample matière à s’exercer aux dépens des Peuls. Le capitaine Figeac ne les fait il pas descendre d’Apollon par l’intermédiaire des Pélasges, parce qu’il a constaté que les trois noms provenaient d’une racine phonétiquement identique ? Et le général Frey, qui rattache les Peuls aux Annamites, tout en les apparentant aux Bretons et en attribuant à leur nom une origine provençale, ne nous a-t-il pas révélé que le Canada était une colonie peule fondée par des Foulbé de Gana ou Ghana ? (Je n’invente rien : voir page 81 de l’Annamite mère des langues, Paris, 1892, in-8). Passons sous silence les élucubrations d’un disciple des deux auteurs précités, qui a trouvé le moyen de surpasser ses maîtres.
[132]En réalité Bekri écrit gafou : mais, comme il substitue plus d’une fois f à b dans la transcription des mots soudanais (mettant par exemple safongo pour sa-bongo ou issa-bongo, l’équivalent songaï de Ras-el-ma), on peut sans hésitation reconnaître dans son gafou le mot peul ou toucouleur gabou. Aucune des autres langues du Sénégal ou du Soudan ne possède de mot analogue pour désigner l’hippopotame : cet animal est appelé zamouli par les Maures Beni-Hassân, neberh par les Berbères Zenaga, lébeur par les Ouolofs, langbâr par les Sérères, ékav par les Diola, khoungamé par les Soninké, mèri ou mali par les Mandé, banga par les Songaï, dorina par les Haoussa, etc.
[133]Je dis « actuellement », car j’ai combattu, il y a huit ans environ, les conclusions de Grimal de Guiraudon ; je croyais alors que les Peuls avaient apporté avec eux en Afrique la langue qu’ils parlent actuellement : constatant l’impossibilité matérielle de rattacher cette langue aux idiomes sémitiques ou hamitiques, je leur cherchais — bien vainement d’ailleurs — une origine hindoue. Une étude plus approfondie de la langue actuelle des Peuls et des autres langues de l’Ouest africain m’a fait revenir de mon erreur première. Je la confesse ici en toute sincérité, invitant à me lapider ceux qui n’ont jamais erré en matière d’ethnologie et de linguistique africaines.
[134]Affairs of West Africa, chap. XV à XVII.
[135]Avant la venue de Joseph en Egypte, il y avait eu déjà des relations entre ses ancêtres et les Egyptiens, puisque Abraham aurait accompli un voyage en Egypte entre ses deux séjours au pays des Chananéens (Genèse, XII).
[136]Genèse, XLVI, 6.
[137]Exode, XII, 40.
[138]603.550 sans compter les Lévites (Nombres, I, 46 et 47).
[139]Exode, XII, 37 et 38.
[140]Un manuscrit arabe encore inédit, recueilli au Sénégal par M. le chef de bataillon Gaden qui me l’a communiqué, localise la patrie de l’ancêtre des Peuls à Akka, c’est-à-dire à Saint-Jean-d’Acre, sur la côte de Galilée, au Sud de Tyr et non loin de Nazareth, au point de jonction de la Palestine, de la Phénicie ou Syrie occidentale (Sour) et de la Syrie orientale (Châm). — Une tradition écrite recueillie à Sokoto en 1827 par Clapperton fait venir les Peuls de la Mésopotamie dans le pays des Juifs, puis de là dans le Sinaï (Tôr) et dans l’Egypte (Missira).
[141]C’est en souvenir de ce passage à travers le Tôr, disent les légendes peules, que le nom de Toro aurait été donné à la province du Fouta où se termina le mouvement d’avancée vers le Sud-Ouest des Judéo-Syriens. Bien entendu cette étymologie ne saurait être acceptée que sous les plus expresses réserves.
[142]Cf. les légendes sur l’origine des Peuls recueillies au Fouta-Diallon par M. Guebhard (Revue des études ethnographiques et sociologiques, avril-juin 1909), dans l’Adamaoua par C. Vicars Boyle (Journal of the African Society, octobre 1910), au Caire, auprès d’un cheikh du Baguirmi, par le comte d’Escayrac de Lauture (Mémoire sur le Soudan, Paris, 1855-56, pages 60 à 62) et à Sokoto par Clapperton (Journal of a second expedition, etc., 1829, pages 399 et suivantes). Le premier de ces travaux renferme deux documents en langue arabe dont le texte, pourtant fort clair, a été complètement déformé par l’interprétation incomplète et souvent erronée qui fut fournie à M. Guebhard : les noms propres en particulier ont été fort mal lus par le traducteur, qui a confondu le Tôr ou Sinaï avec le Fouta Toro, a pris des mots arabes pour des noms de pays soudanais et a commis de nombreuses omissions. Dans la légende recueillie par C. Vicars Boyle, le nom de Okba est devenu Oukouba ; dans le récit de l’informateur du comte de Lauture, il s’est transformé en Yakoub — ce qui pourrait expliquer comment l’ancêtre hébreu Jacob a pu devenir, dans les légendes islamisées, l’ancêtre arabe Okba-ben-Yâsser — et Tadiouma, fille du roi de Tôr, est devenue une femelle de caméléon (dioundougal). Dans une des légendes écrites remises à Clapperton, Okba est appelé Okba-ben-Amir, la fille du roi de Tôr est nommée Gadiouma et les quatre enfants qu’elle eut de Okba portent les noms de Dita, Ouaya, Nasser et Rarabi : la concordance est tout au moins remarquable entre ces traditions recueillies, l’une à Sokoto et l’autre au Fouta-Diallon, à près d’un siècle d’intervalle. Dans une autre légende recueillie par l’administrateur Logeay auprès des Peuls du cercle de Goumbou. Okba est appelé Ougoubata et le Tôr ou Sinaï a été confondu avec le Fouta Toro, comme dans la traduction donnée par M. Guebhard. Dans d’autres légendes enfin, Okba est donné comme le neveu de Amrou et porte le nom de Okba-ben-Amir, qui est en effet le nom de l’un des lieutenants de Amrou, mais on le confond avec Okba-ben-Nafi et on le fait aller, sur l’ordre du khalife Moaouiya, non seulement en Egypte et au Sous, mais jusqu’au Tekrour et à Ghana.
[143]Jacob et Israël, dans la Bible, ne forment qu’un seul et même personnage.
[144]Sans doute plusieurs générations après cette mort.
[145]Une légende dit « dans le pays de Barga », ce qui revient au même (Barga = Barka).
[146]La racine foudh, avec le sens de « s’enfuir », se retrouve en égyptien démotique sous la forme pout (avec un t prononcé d) et en copte sous la forme fôt (avec un t prononcé d au Sud du Delta). Dans les langues sémitiques, on ne rencontre aucune racine analogue ayant le sens de « s’enfuir ». Cela laisserait croire que, durant leur séjour en Egypte, les Judéo-Syriens auraient adopté la langue égyptienne ou tout au moins que leur langue primitive — l’araméen probablement — aurait été fortement influencée par l’égyptien, ce qui n’a rien d’invraisemblable. De même, plus tard, ils devaient, durant leur séjour au Fouta, adopter la langue des Toucouleurs. Quant aux Hébreux qui suivirent Moïse, ils pouvaient très bien aussi parler l’égyptien lors de leur sortie de l’Égypte, mais, revenus en pays sémitique, ils durent reprendre assez vite la langue de leurs ancêtres.
[147]Je ne continue pas plus loin la légende, car, à partir de l’arrivée des Judéo-Syriens au Massina, nous entrons presque dans le domaine de l’histoire ; nous verrons dans la IVe partie de cet ouvrage ce qu’il advint de Kara et de Gama. Je dois faire observer que les Soninké du Sahel se sont approprié cette tradition et la donnent comme expliquant leur propre origine ; ils y ont même introduit des noms de clan à eux, pour rendre la chose plus vraisemblable. Mais, à mon avis, la légende est bien une tradition peule et les Soninké ne peuvent la revendiquer que comme donnant l’origine partielle de celles de leurs familles qui sont issues du mélange des immigrants judéo-syriens avec les autochtones primitifs du Massina.
[148]Bekri, parlant des gens de Sort en Cyrénaïque tels qu’ils étaient de son temps (XIe siècle), dit qu’ils parlent « une espèce de jargon qui n’est ni arabe, ni persan, ni berbère, ni copte, et que personne ne peut comprendre en dehors d’eux-mêmes ». Il serait intéressant de savoir quel était ce « jargon » ; cela pourrait peut-être jeter une lueur nouvelle sur la question traitée ici.
[149]L’Aïr fut à un moment donné une dépendance politique du Bornou, ou tout au moins du Kânem au temps où ce dernier empire englobait le Bornou.
[150]La colonie juive du Touat fut longtemps florissante. En 1492, elle se démembra à la suite des persécutions du réformateur musulman El-Merhili ; un grand nombre de Juifs furent alors massacrés, d’autres se dispersèrent en plusieurs points de l’Algérie, d’autres se réfugièrent auprès des Kounta, du côté de Tombouctou et de Gao. On a trouvé au Touat des inscriptions en caractères hébraïques, dont une datant de 1329. Nous savons par Ibn-Meriem que, vers 1502, El-Merhili se rendit du Touat à Gao, par l’Aïr, Takedda, Kano et Katséna, et chercha à déterminer l’empereur ou askia El-Hadj Mohammed à ordonner le massacre des Juifs réfugiés à Gao ; il semble d’ailleurs que ses conseils demeurèrent sans effet.
[151]D’après les traditions locales, les juifs étaient nombreux dans l’Adrar au XIe siècle ; convertis à l’islamisme par les Almoravides, il se seraient en partie mêlés à ces derniers.
[152]L’orthographe varie selon les manuscrits. Bekri dit que cette peuplade a le teint blanc et une belle figure, qu’elle professait de son temps (XIe siècle) la même religion que les Noirs de Ghana — lesquels n’étaient pas musulmans —, mais ne contractait jamais de mariage avec eux. Il suppose qu’elle a pour ancêtres les soldats « que les Oméïades envoyèrent contre Ghana dans les premiers temps de l’islam », faisant évidemment allusion aux expéditions de Okba-ben-Nafi dans le Maghreb de 570 à 681 ; mais, quoi qu’on en ait dit, les armées de Okba ne dépassèrent jamais l’extrême limite septentrionale du Sahara et il n’est guère admissible qu’une fraction de cette armée ait pu donner naissance à la tribu dont a parlé Bekri. Peut-être ce dernier, ayant entendu conter la légende relative à Okba-ben-Yâsser que j’ai rapportée plus haut, a-t-il fait une confusion entre les deux généraux : cette hypothèse du reste me paraît peu probable, car je crois la légende de Okba-ben-Yâsser bien postérieure à Bekri, étant donné qu’elle n’a pu prendre naissance chez les Peuls qu’après leur islamisation, qui est récente, comme nous le verrons plus loin.
[153]Les Nimadi passent pour être des sauvages vêtus de peaux de bêtes, ayant la chasse comme principal moyen de subsistance et professant une religion qui aurait des rapports avec le judaïsme pré-mosaïque.
[154]On a souvent confondu le Bakounou avec le Bagana : c’est à tort, selon moi. Le Bakounou, qui d’ailleurs a dû faire partie à un moment donné du Bagana, politiquement parlant, est une petite province située entre Nioro et Goumbou ; le Bagana, beaucoup plus vaste, se trouve entre Goumbou et Sokolo, et s’étend depuis le Nord du Kaarta et du Bélédougou jusqu’à la région de Oualata. On y a même parfois compris le Diaga.
[155]La tradition rapportée par M. Guebhard les fait, en parlant de Ghana, passer par le pays des Diawara, le Kaarta et le Manding ; cet itinéraire ne diffère pas sensiblement de celui que je rapporte ici : les Diawara occupent actuellement un pays contigu à l’Ouest du Bakounou, le Kaarta est limité au Nord-Ouest et à l’Ouest par le Bakounou, le Diafounou et le Diomboko, et ce dernier pays fut longtemps une dépendance politique de l’empire mandingue, qui n’en était séparé géographiquement que par le Sénégal.
[156]Cet Ismaïl, dans les légendes islamisées, est devenu le sultan hassanide du Maroc Moulaï Ismaïl, qui cependant ne vécut que huit siècles plus tard, puisqu’il régna de 1672 à 1727. Ces légendes n’hésitent pas à dire que Mahmoud se rendit à Marrakech pour demander aide et protection à Moulai Ismaïl et que ce dernier lui confia une armée à l’aide de laquelle Mahmoud s’empara du Fouta.
[157]Cf. Tadiouma ou Gadiouma, fille du roi de Tôr, dans les légendes islamisées.
[158]Voir dans la IIIe partie de cet ouvrage comment il est, sinon certain, du moins très probable que la langue parlée aujourd’hui par les Peuls et les Toucouleurs n’est chez les premiers qu’une langue d’emprunt tandis qu’elle est la langue nationale des seconds. Dans la légende recueillie par Clapperton en 1827, il est dit que les enfants de Okba et de Gadiouma parlèrent une langue différente de celle de leur père, qui était l’arabe, et aussi de celle de leur mère, qui était la langue ouangara.
[160]Je n’entends pas dire que Diallo soit la traduction de Sal, ni Boli celle de Ba, etc., ni que les termes de la seconde série soient dérivés des termes de la première ; il s’agit de mots différents, d’origines assurément distinctes, appartenant d’ailleurs à une même langue, mais dont les uns sont surtout employés par les Toucouleurs et les autres par les Peuls.
[161]D’après une légende, Diouma Sal aurait eu d’Ismaïl quatre enfants qui auraient été les ancêtres des quatre principaux clans peuls (Dialloubé, Ourourbé, Férôbé et Daébé) — comme les enfants de Tadiouma et de Okba dans la légende islamisée — et, après la mort de son mari, elle aurait eu, d’un esclave de ce dernier, un cinquième enfant qui aurait été l’ancêtre des Diawambé. D’après une autre légende, rapportée par le Dr Lasnet, l’ancêtre des Peuls eut trois fils : l’un hérita du troupeau, ce fut le père des Foulbé ou Peuls propres ; le second inventa la calebasse servant à traire le lait, ce fut le père des Laobé ; le troisième réjouit ses deux frères en fabriquant une guitare à l’aide de la calebasse et de poils pris à la queue d’une vache, ce fut le père des Ouambâbé (musiciens).
[162]Silla, d’après les géographes arabes du Moyen Age, se trouvait sur le Sénégal, entre Tekrour — qui devait correspondre approximativement à Podor — et Galambou (chef-lieu du Galam), qui devait être situé à peu près au confluent de la Falémé et du Sénégal : Silla était beaucoup plus près de Galambou que de Tekrour, puisque Bekri nous dit qu’il n’y avait qu’une journée de marche (ou de navigation) entre Silla et Galambou, en sorte que cette ville (Silla) devait se trouver très près de notre poste actuel de Bakel.
[163]Il s’agit bien d’un titre et non pas d’un nom : en ouolof et en sérère, saltigué désigne un chef de bande ; silatigui, en mandé, veut dire un guide ou un chef de migration (le maître de la route) : c’est le correspondant de fondokoï en songaï et — au moins pour le sens — de ardo en peul (qui veut dire « conducteur »). Les anciens voyageurs européens désignent tous l’empereur de Tekrour par le titre de silatigui, siratiki ou siratique.
[164]Kaniaga est le même mot que Gadiaga ; il n’y a entre les deux vocables qu’une différence locale de prononciation identique à celle existant entre Diakaté et Niakaté. Il est probable que ces deux pays tirent leur nom de celui du Diaga, origine première des colons du Gadiaga comme de ceux du Kaniaga.
[165]Les familles mabbé furent appelées Dyiba par les Soninké et les familles diawambé Bokoum. Quant aux Rimaïbé, les Soninké les appelèrent Komongallou ; ils comprenaient surtout des gens d’origine kâgoro ou banmana, qui formèrent, les premiers, le clan des Kelli et, les seconds, le clan des Tammoura ou Tamboura.
[166]Environ un siècle plus tard, vers 1510, un descendant de Diâdié nommé Tindo-Galâdio, chef des Yalâbé, prêcha la révolte au Bakounou contre l’empereur de Gao El-Hadj Mohammed (le premier askia), qui était devenu maître de la majeure partie des anciennes dépendances du Mali. El-Hadj Mohammed entreprit en 1511-1512 une expédition contre Tindo, qu’il défit et tua à Diara, près et au Nord-Est de Nioro. Koli, fils de Tindo, prit alors le commandement des Peuls du Bakounou réfractaires au souverain de Gao et, accompagné de Goro ou Gara, chef des Oualarbé, de Diko, chef des Férôbé, et de Nima, chef des Ourourbé, il émigra au Fouta Toro qui, ainsi que tout l’ancien Tekrour, obéissait alors à l’empereur du Diolof. Ce Koli, aidé par les Sérères et par le clan toucouleur des Dénianké, aurait réussi à tuer l’empereur du Diolof, à affranchir les Toucouleurs de la suzeraineté des Ouolofs et à fonder au Tekrour un nouvel empire indépendant dont il fut le premier souverain. Ses descendants régnaient encore au Fouta vers le milieu du XVIIe siècle, d’après le témoignage de Sa’di.
[167]Il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre le mot « fils » dans toutes ces légendes : la plupart du temps, il y a plutôt la signification de « descendant » : il est fort probable qu’il s’est écoulé plus de deux générations entre celle de Dama — qui vivait vraisemblablement au XVe ou XVIe siècle — et celle de Moussa.
[168]Les Dénianké étaient ces Toucouleurs qui avaient aidé le Peul Koli Galadio à s’emparer du Tekrour au début du XVIe siècle (voir plus haut, page 229, note [166]). Leur clan était demeuré virtuellement au pouvoir sous les descendants de Koli, et, comme ce dernier, ils étaient restés rebelles à l’islamisme. Au début du XVIIIe siècle, un marabout toucouleur nommé Abdoulkader Tôrodo prêcha la guerre sainte contre les infidèles et renversa la dynastie peule des descendants de Koli ; le pouvoir passa ainsi aux Tôrobé, tous musulmans ; les Dénianké, bien que s’étant alors convertis à l’islamisme, perdirent toute influence au Fouta Toro et ils émigrèrent en partie pour aller, sous la conduite de deux chefs nommés Sidi et Séri (ancêtres des Sidianké et des Sérianké), s’établir au Fouta Diallon auprès des Peuls qui s’y trouvaient depuis plusieurs siècles. Un de leurs marabouts nommé Sori commença peu après, sous prétexte de guerre sainte, la conquête du pays aux dépens des Soussou ou Diallonké autochtones. Actuellement encore, on distingue les Peuls des Toucouleurs au Fouta-Diallon en donnant aux premiers — très peu nombreux — le nom de Poulli et aux seconds — qui sont fortement mélangés de Mandé — le nom de Foula.
[169]Ce nom, qui pourrait bien être d’origine berbère, était donné à la fois à l’empire des Toucouleurs et à sa capitale, laquelle, comme je l’ai avancé plus haut, devait correspondre à peu près à l’emplacement actuel de Podor. Ibn-Saïd (XIIIe siècle) place la ville de Tekrour sur le Sénégal (Nil) par 5° de longitude planimétrique à l’Ouest d’Aoudaghost, ce qui répond très exactement à la position de Podor. Pour Mohammed Bello, Tekrour désigne l’ensemble du Soudan musulman et plus particulièrement les pays soumis à des rois de langue tekrouria (c’est-à-dire de langue peule-toucouleure) ; il y englobe le Darfour, le Ouadaï, le Baguirmi, le Haoussa, etc. Cette acception du mot Tekrour est fréquente chez les Arabes qui ne se sont pas occupés spécialement de l’Afrique occidentale. Le lieutenant Desplagnes a cru pouvoir identifier Tekrour avec une île du marigot de Dia (Massina) qu’il appelle Tekrour-Rundee mais que les cartes désignent en général sous le nom de Togoro-Koumbé : son hypothèse n’est appuyée que sur une vague ressemblance phonétique.
[170]Aboulféda (mort en 1331) nous dit que la plus grande partie du Tekrour se trouve au Nord du Sénégal (Nil), la partie au Sud du fleuve étant bien moins étendue (trad. Reinaud et de Slane, tome II, page 220). Le même auteur avait parfaitement saisi la différence entre les Toucouleurs et les Peuls, puisqu’il divise les peuples du Tekrour en deux fractions : l’une sédentaire et l’autre nomade (Ibid., p. 208).
[171]Tombouctou la mystérieuse, par Félix Dubois, Paris, 1897.
[172]Monographie de Djenné, Tulle 1903.
[173]D’après Mohamed Bello, les habitants actuels du Kebbi descendraient d’une mère haoussa (de Katséna) et d’un père songaï.
[174]Sa’di fait remonter la fondation de Gounguia à une époque très reculée et prétend même que c’est de là que le pharaon contemporain de Moïse fit venir les magiciens à l’aide desquels il chercha à confondre le législateur des Hébreux. Bien entendu, je lui laisse la responsabilité de cette légende ; le fait qu’elle avait cours à Tombouctou au XVIIe siècle prouverait tout au moins que Gounguia existait alors depuis fort longtemps.
[175]Au temps de Bekri (2e moitié du XIe siècle), l’empereur résidait à Gao : il était musulman, mais ses sujets ne l’étaient pas encore, à l’exception d’étrangers qui habitaient un quartier spécial. D’après le même auteur, les Arabes donnaient aux habitants de Gao le nom de Bezerkâni ou Bediergâni.
[176]Cf. la légende des Faran, recueillie par M. Dupuis-Yakouba, dans l’ouvrage du lieutenant Desplagnes intitulé « le Plateau central nigérien », Paris 1907. Cette légende a symbolisé les Bozo et leurs barrages mobiles sous la forme d’une « anguille » (gondo).
[177]Les Soninké venaient à ce moment de perdre leur hégémonie dans le Sahel, après avoir été vaincus par les Malinké.
[178]La légende recueillie par M. Dupuis attribue à Faran-Nabo la fondation de Saraféré ; en réalité, Faran-Nabo était mort depuis longtemps à cette époque, mais on a dû lui faire honneur de tous les actes mémorables accomplis par ses descendants. Il se peut aussi que nabo ou nabonké soit une sorte de titre et que Faran-Nabo signifie simplement « le chef des Faran », sans désigner un individu en particulier.
[179]Sans doute le Zaberma, à moins que ce ne soit le Haribanda ou Aribinda : zaberma signifie « le pays proche du grand fleuve », zaberbanda « le pays au-delà du grand fleuve » et haribanda « le pays au-delà de l’eau ».
[180]La langue songaï est encore appelée de nos jours kouria (langue de Koura) par les Arabes du Touat. René Caillié nous a parlé de cet idiome sous le nom de kissour, sans doute pour Kissouri, nom peul du « pays du Kissou ».
[181]En réalité Tombouctou continua à avoir des pachas soi-disant marocains jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais leur autorité purement nominale et éphémère ne dépassait plus guère alors les environs immédiats de la ville.
[182]Le pacha Ammar fut bien envoyé de Marrakech à Tombouctou — pour la deuxième fois — en 1618, mais sans troupes ; il retourna d’ailleurs au Maroc moins de trois mois après son arrivée au Soudan.
[183]Par la suite, cette armée noire fit et défit les sultans du Maroc et entretint un état d’anarchie qui ne prit fin que vers le milieu du XVIIIe siècle.
[184]Cf. An account of the empire of Marocco, par Jackson, déjà cité. Cette expédition à Tombouctou d’Ahmed, neveu du sultan Ismaïl, est à rapprocher de la légende attribuant au même sultan une intervention armée en faveur de l’établissement des Judéo-Syriens au Fouta et explique la confusion faite par les auteurs de cette légende (voir page 222, note [156]). Le Tedzkiret-en-Nisiân rapporte que, le 16 septembre 1671, arriva à Tombouctou un envoyé du sultan Er-Rachid et que les troupes du pacha lui prêtèrent serment de fidélité : sans doute cet envoyé venait de la part de son maître engager Ali-ben-Haïdar à retourner au Maroc, à moins que ce ne soit Ali lui-même dont le Tedzkiret ait voulu parler. En tout cas cet ouvrage ne mentionne pas le nom de Ali-ben-Haïdar et est muet sur l’arrivée et le séjour à Tombouctou de la troupe envoyée par le sultan Ismaïl, sauf que (page 119 de la traduction) il signale — de façon très sommaire d’ailleurs — la présence à Tombouctou en 1741 des restes de cette troupe ; il dit même qu’ils furent attaqués, sans succès du reste, par des Peuls du Massina.
[185]Sa’di et l’auteur du Tedzkiret-en-Nisiân nous fournissent des renseignements curieux sur l’origine ethnique des « Marocains » que les Arma peuvent revendiquer comme leurs ancêtres : les éléments arabe et berbère n’y apparaissent que comme secondaires ; la plupart des soldats « marocains » qui résistèrent à la traversée du Sahara et au climat du Soudan, comme aussi la plupart des pachas qui se distinguèrent par leurs capacités militaires et administratives, étaient des renégats, originaires d’Espagne en majorité, c’est-à-dire des Européens capturés par les pirates barbaresques, islamisés par leurs maîtres marocains et passés ensuite au service du sultan de Marrakech. Le pacha Djouder lui-même, le conquérant de Gao et de Tombouctou, « petit homme aux yeux bleus », était un chrétien converti.
[186]Il est possible d’ailleurs que l’art égyptien n’ait pas été sans influencer l’art maghrébin et que Abou-Ishak lui-même ait puisé quelques inspirations en Egypte, lorsqu’il la traversa en revenant de La Mecque avec Kankan-Moussa. Mais, au point de vue qui nous occupe, cela n’aurait absolument aucune importance. Si une influence égyptienne existe, ce qui n’est pas prouvé, c’est par le Maroc ou plus généralement par le Maghreb qu’elle est parvenue au Niger.
[187]Dans la liste des docteurs de Tombouctou cités par le Tarikh, on trouve des Berbères, des Arabes, des Mandé, des Peuls, mais pas un seul Songaï.
[188]Ce mot figure sur nos cartes sous les formes Diaka (bras du Niger allant de Diafarabé au Débo) et Dia (village situé sur ce bras entre Diafarabé et Ténenkou) : Diafarabé signifie en banmana « la rencontre du partage de Dia », c’est-à-dire l’endroit où le Niger se divise pour donner naissance au Dia ou marigot de Diaka. Les prononciations Diarha, Diagha, Diaga, Diaka, Diakha, Dia et Niarha, Niagha, Niaga, Niaka, Niakha, Nia ne représentent qu’un seul et même mot, dont elles ne sont que les variantes dialectales ; la prononciation la plus répandue au Soudan est Diaga, avec un g légèrement grasseyé ; les Songaï prononcent souvent Zaga, surtout ceux du Sud-Est, et c’est cette orthographe qui a été adoptée par la plupart des écrivains arabes. Beaucoup de noms de pays, de villages ou de clans dérivent du nom de cette contrée célèbre entre toutes dans le Soudan Occidental : tels sont les noms du Kaniaga (Sud du Bagana) et du Gadiaga ou Galam (entre Bakel et Kayes) — noms qui viendraient de la phrase an kâ niaga fo ou an gâ diaga fo « appelons-le Diaga » —, du village de Diara (près de Nioro), des clans Diara, Diakaté ou Niakaté, Diakité, etc. (ceux du Dia ou Diaga, originaires du Diaga).
[189]On donne souvent le nom de Massina à la région de Bandiagara, mais c’est par erreur ou plutôt cette région n’est que l’extrême limite orientale du Massina ; à l’origine ce nom ne s’appliquait qu’au Diaga proprement dit, c’est-à-dire à la rive gauche du marigot de Dia (Massina occidental ou vrai Massina) ; plus tard le nom a été étendu aussi au pays compris entre le marigot de Dia d’une part et Mopti et Dienné d’autre part (Massina central) ; plus tard encore, on a englobé dans le Massina la région située entre Mopti et Bandiagara (Massina oriental).
[190]Dans les manuscrits rapportés de Sokoto par Clapperton, les Soninké (appelés Sarankoli ou Sarakolé) sont donnés comme d’anciens « Persans » : sans doute il faut entendre par là qu’ils pratiquaient autrefois une religion quelque peu analogue à celle des anciens Persans ou magisme ; les auteurs arabes traitent souvent de madjous les Noirs non musulmans.
[191]Vers 1224 d’après un manuscrit inédit du cheikh Saad Bou.
[192]Marmol appelle Benay les Noirs de Oualata et dit qu’ils parlent le zungay ; j’ignore d’où vient cette appellation de Benay, qui est peut-être d’origine arabe ; quant à zungay, on peut supposer que c’est une altération de « soninké », mais on peut aussi identifier ce mot avec songaï, les relations entre Tombouctou et Oualata ayant certainement introduit dans cette dernière ville l’usage de la langue songaï au moins dès le début du XVIe siècle. En tout cas nous savons par Barth et par des informateurs plus récents que les Noirs indigènes de Oualata sont des Soninké et parlent le soninké, ainsi que ceux de Tichit.
[193]Sa’di rapporte que Chinguetti fut fondée par des Adjer (assurément les Azer de Barth), Tichit par des Ahl-Massina et Birou (Oualata) par des Ahl-Tafrasset ou Taghrasset ; nous avons vu que les Ahl-Massina étaient des Judéo-Syriens mélangés de Soninké ; je ne sais ce qu’il faut entendre par Tafrasset : le mot est évidemment berbère, mais rien n’empêche de supposer que les Soninké fondateurs de Oualata soient venus d’un lieu connu en berbère sous le nom de Tafrasset.
[194]La ville proprement dite de Dienné ne devait cependant être fondée qu’un siècle plus tard, vers 800 environ.
[195]Bérenger-Féraud, Tautain, Adam, etc. M. Chartier, administrateur-adjoint des colonies, m’a communiqué un texte en langue banmana de la même légende, recueilli par lui à Nioro de la bouche des indigènes, en même temps que d’autres traditions relatives à l’empereur du Mali Soundiata, aux Sossé et aux Diawara. J’ai utilisé ces textes, qui sont généralement plus complets et plus précis que les légendes traduites par les interprètes.
[196]D’autres légendes disent 27 ans.
[197]Ces noms ont évidemment un rapport avec celui du Dia ou Diaga : le premier signifie « Founè de Dia » et le second « Founè du fleuve de Diaga ».
[198]D’autres légendes disent que Téré-Kalé n’eut pas de descendants.
[199]Certaines traditions renversent l’ordre de tous ces noms, mettant Maghan en second lieu : c’est ainsi que le dernier est donné souvent sous la forme Kaya-Maghan, qu’a adoptée Sa’di dans le Tarikh-es-Soudân.
[200]Cf. la légende biblique de Jacob et d’Esaü.
[201]La légende ajoute qu’une fois ce pacte conclu, une pluie d’or tomba durant quinze jours : chacun put en ramasser autant qu’il voulut.
[202]Ou dont la grosseur correspondrait exactement au calibre du tambour, selon les traducteurs. Il s’agit de l’un de ces tambours longs, creusés dans un tronc d’arbre, dont l’une des extrémités seulement est revêtue d’une peau.
[203]Ces trois villes de Silla, Galambou et Yaressi sont mentionnées par Bekri (XIe siècle) sur le Sénégal, dans la région comprise entre Matam et Kayes : Silla devait se trouver dans le Goye, un peu à l’Ouest de l’emplacement actuel de Bakel, Galambou dans le Kaméra, très près de l’embouchure de la Falémé, et Yaressi — dont le nom est écrit Barissa dans certains manuscrits — devait être située dans le Guidimaka, sur la rive Nord du Sénégal, à peu près en face d’Ambidédi.
[204]Cf. la Monographie de Djenné, par Ch. Monteil.
[205]C’est pourquoi les traditions soninké, en racontant cet événement, disent que ce fut un roi du Ouagadou qui, le premier des Nègres, remporta une victoire sur des Blancs. Je dois faire remarquer que beaucoup de traditions placent la dispersion des Soninké du Ouagadou au XIVe siècle seulement : cela vient de ce que la plupart des légendes transmises oralement ne conservent le souvenir que des événements principaux et les placent tous les uns à la suite des autres, dans un ordre chronologique exact, mais sans se préoccuper des périodes dépourvues d’histoire — quoique souvent très longues — qui se sont déroulées entre deux faits retenus par la tradition. C’est ainsi que, de la ruine du Ouagadou — qu’il faut assurément placer dès la fin du VIIIe siècle puisqu’elle précéda la conquête de Ghana par les Soninké et en fut l’occasion —, les légendes passent directement aux conquêtes de Soundiata (XIIIe siècle) et à la fondation de Nioro par des Peuls Diawambé (commencement du XIVe). — Le Dr Tautain, en relatant la légende du serpent, a cru pouvoir identifier le Ouagadou avec Ghana, sans d’ailleurs en donner les raisons : en réalité, l’histoire du serpent du Ouagadou fut simplement le point de départ de la main-mise des Soninké sur Ghana.
[206]Moussa-Mohamadou Doukouré, chef actuel de Goumbou, serait le 28e successeur de Bouyagui-Toumbéli et le 31e successeur de Maré-Diago : si l’on fait émigrer ce dernier de Ghana en 1076, cela ferait une durée moyenne de 26 ans pour chacun des règnes, ce qui peut paraître excessif ; mais il est fort possible que plusieurs rois aient été oubliés, surtout parmi les premiers.
[207]Une légende recueillie à Nioro dit qu’il avait armé ses bandes de fusils achetés au Sénégal ; je n’ai pas besoin de faire observer l’anachronisme un peu trop audacieux de ce détail concernant un personnage qui vivait au XIIIe siècle.
[208]La fondation de l’empire du Mandé ou des Mandingues date de 1213 environ.
[209]Il s’agit ici du village de Nono situé près et à l’Ouest de Dia et non d’un autre village du même nom mais appelé aussi Nounou et situé à 15 kilomètres à l’Ouest de Niafounké : ce dernier village fut fondé probablement par des Soninké venant de Nono près Dia, après la destruction de l’empire sossé (vers 1240).
[210]De là le nom de Sosso que donne Ibn-Khaldoun aux sujets de Soumangourou et qui, pendant trop longtemps, a conduit nombre d’auteurs à faire intervenir les Soussou du Fouta-Diallon et de la basse Guinée dans des événements auxquels ils demeurèrent très probablement étrangers. En réalité les sujets de Soumangourou, ou tout au moins ceux de ses sujets qui appartenaient à sa famille et comprenaient ses principaux chefs de bande, étaient des Soninké des clans Diarisso et Kannté qui, par suite des relations de quelqu’un de leurs ancêtres avec des Toucouleurs ou des Peuls du clan des Sô, avaient pris le nom de Sôssé (postérité des Sô) et avaient donné à leur ville principale celui de Sôsso (village des Sô) ; les Peuls les ont appelés Sossobé et leurs descendants sont encore connus sous le nom de Sossé au Sénégal et dans la Gambie et la Casamance ; le clan actuel des Soussokho ou Sissokho, chez les Soninké, semble se rattacher aux Sossé du XIIIe siècle.
[211]D’autres disent près et au Nord de Goumbou.
[212]D’après M. Ch. Monteil, le nom primitif de la ville aurait été Diané (le petit Dia) : ce ne serait que plus tard, lors de l’avancée des Songaï, que le nom se serait corrompu en Dienné et que les musulmans auraient inventé l’étymologie arabe djenna « paradis ». On pourrait également supposer que ce nom ait pu venir de Adyini ou Dyiné Kounaté, qui s’établit vers 800 à Dioboro, comme nous l’avons vu précédemment.
[213]La famille bozo à laquelle appartenait la jeune fille porte encore, en souvenir de cet événement, le nom de Diennépo, ce qui veut dire en bozo « cadavre de Dienné » : c’est également en mémoire de ce fait qu’on donna le nom de Dioboro ou Zoboro à l’un des quartiers de Dienné (Ch. Monteil, op. cit.).
[214]Une légende fait de ce Kaké-Kanédyi un Soninké, ancêtre du clan des Kanédyi ou Kannté : je ferai seulement observer que ce clan était déjà représenté, à la même époque, par la famille régnante de Sosso, dans le Kaniaga.
[215]Dia ou mieux dian veut dire en mandé — entre autres significations — « compagnie, association, clan » et wala en peul est le verbe négatif : on pourrait donc à la rigueur supposer que Daman s’exprimait en peul et disait « il n’y a pas de dia » ; de dia wala, les Mandingues auraient fait diawara, ce qui n’a rien d’impossible. Quelle que soit la valeur de cette étymologie, il y a lieu de remarquer que les noms Diawara en mandé et Diawambé en peul semblent procéder d’un radical identique qui serait diawa ou diaw, et que les Diawara forment, chez les Soninké, un groupe tenant à la fois de la tribu, de la caste et du clan, très analogue à celui que forment les Diawambé chez les Peuls. Il ne serait donc pas absurde de supposer que les uns et les autres ont, sinon au point de vue ethnique, au moins au point de vue social, une origine identique.
[216]Ce sabre reçut le nom de ouali, c’est-à-dire en arabe « protecteur ».
[217]Le Diougouraguiet de nos cartes, au Nord-Est de Nioro, sur la route conduisant de cette ville à Oualata.
[218]Il s’agit vraisemblablement de simples razzias, qui n’atteignirent très probablement pas les points éloignés cités par la légende.
[220]Des Soninké musulmans se transportèrent même, dans la seconde moitié du XIVe siècle, jusqu’au cœur du pays haoussa et fondèrent à l’Est de Kano une colonie qui subsiste encore sous le nom de Ouangara, mais dont les habitants actuels parlent la langue haoussa (Migeod, Languages of West Africa, page 33).
[221]Rien absolument n’autorise à identifier les Soninké avec les Songaï, comme avait cru pouvoir le faire le Dr Quintin : ce dernier se basait sur le simple argument du mot soninké, qu’il faisait dériver de sonni et prétendait avoir été donné comme appellation aux Songaï partisans de Sonni Ali-Ber qui, après l’avènement du premier askia, auraient été chassés vers l’Ouest par les partisans de ce dernier. Nous avons vu précédemment que : 1o le mot soninké semble être bien antérieur à la dynastie des Sonni et n’avoir rien de commun avec le titre de ceux-ci ; 2o les Soninké étaient établis à l’Ouest du Niger et y avaient joué un rôle très considérable bien avant l’époque des Sonni de Gao ; 3o toutes les traditions leur donnent le Massina comme pays d’origine ; 4o Ali-Ber, comme les autres Sonni, était d’origine berbère et non songaï ; 5o enfin le fondateur de la dynastie des Askia était précisément un Soninké et les Songaï n’ont joué en somme qu’un rôle passif dans toute cette période de leur histoire.
[222]Bégho, dont on montre encore les ruines ou tout au moins l’emplacement entre Banda et Fougoula, dans la colonie anglaise actuelle de la Gold Coast, était situé à l’Est-Nord-Est de Bondoukou, près de la rive Sud de la Volta Noire, en amont de Kintampo ; cette ville aurait été détruite à la suite d’une guerre civile vers la fin du XIVe siècle et les Dioula qui l’habitaient seraient allés fonder définitivement Bondoukou (ou Gottogo) et Kong, au début du XVe siècle. A Kong on prétend que les familles Ouatara, Dao, Barho, Kérou et Touré seraient venues directement de Dienné, tandis que les Sissé, Sarha, Kamara ou Kamaya, Dagnorho, Kouroubari, Timité et Taraoré seraient venus plus tard de Bégho ; on donne souvent à cette dernière ville le nom de Ouorodougou (pays des colas), parce qu’elle était située en effet au seuil de l’une des principales régions productrices de cola, mais il faut se garder de la confondre avec le Ouorodougou de Mankono et Séguéla (Ouest de la Côte d’Ivoire).
[223]Le dolo est une boisson fermentée fabriquée avec du mil ou du maïs.
[224]Ne pas confondre ces Bagama, nègres sauvages, avec les Berbères Beggama mentionnés par plusieurs géographes arabes dans l’Azaouad et qui étaient, eux, des Touareg.
[225]D’après une tradition recueillie à Kita, les Kâgoro seraient issus du mélange qui se produisit entre les Malinké et les Soninké, à l’époque où les premiers conquirent le Kaarta et le Kaniaga sur les Soninké Sossé (1235) ; cette tradition, qui s’accorderait malaisément avec celles recueillies auprès des Kâgoro eux-mêmes et des Soninké du cercle de Goumbou, me semble fort sujette à caution.
[226]J’entends naturellement le Baoulé qui forme la branche occidentale du haut Bani et non le Baoulé affluent du Sénégal.
[227]C’est ainsi que le mpolio est aujourd’hui encore le téné ou tana (animal sacré et prohibé) des Kouloubali qui descendent de Baramangolo, tandis que les Kouloubali qui descendent de Niangolo ont un téné différent (lion ou hippopotame).
[228]Ce village n’était pas le chef-lieu du cercle actuel de Ségou (Ségou-Sikoro), mais bien Ségou-koro (le vieux Ségou), situé un peu en amont.
[229]Il s’agit de Touba-koro (le vieux Touba) ; en 1832, des Soninké venus de Sokolo fondèrent à côté Touba-koura (le nouveau Touba), qui est devenu beaucoup plus important et que l’on appelle aujourd’hui Touba tout court.
[230]Mosson Diara régnait au moment des deux voyages de Mungo-Park.
[231]Ce Sanankoro (ou Sananko) est situé au Nord de la ligne du chemin de fer, entre cette ligne et Daba (cercle de Bamako).
[232]C’est ainsi que Niamando Taraoré, descendant de Bakoro Taraoré et chef actuel de Gana, revenant en 1886 sur l’emplacement de son village détruit par El-Hadj Omar, le reconstruisit à quelques centaines de mètres plus loin ; c’est dans les restes modestes et récents de l’ancien hameau de Gana — hameau fondé dans le nord du Bélédougou au début du XVIIIe siècle et détruit en 1860 — que le lieutenant Desplagnes avait cru reconnaître les ruines de l’antique Ghana, fondée dans l’Aoukar peut-être avant le début de notre ère et détruite par Soundiata vers 1240, c’est-à-dire près de cinq siècles avant la fondation du Gana du Bélédougou.
[233]Ceci est un exemple frappant de la facilité avec laquelle les fractions isolées d’un peuple oublient leur langue maternelle pour adopter celle qui se parle dans le pays où ces fractions s’établissent ; c’est également un exemple du danger qu’il y a à se baser sur la langue parlée par une peuplade pour décider de son rattachement ethnique.
[234]Il descendait de l’ancienne famille royale des Niakaté.
[235]Le nom de Bamako (Bammako) fut donné au village fondé par Dia-Moussa soit en souvenir de Bamma Sakho (Bamma-ko, derrière Bamma, au delà du village de Bamma) soit à cause de la coutume du lieu consistant à offrir chaque année, au début de la saison des pluies, une victime aux caïmans du Niger (bamma-ko, l’affaire du caïman). L’étymologie bamma-ko « rivière du caïman », quelquefois proposée, doit être rejetée en raison de la prononciation très fermée de l’o final de Bamako (presque ou), tandis que l’o de ko signifiant « rivière » est au contraire très ouvert.
[236]Il se pourrait que la syllabe soun, placée devant le nom du célèbre empereur malinké, fût un titre analogue à celui de sonni, soun, sin ou tchin donné plus tard aux empereurs de Gao de la deuxième dynastie ; on retrouve cette syllabe dans le nom de Sounsa Kouloubali — alias Sarhaba ou Sa-Massa Kouloubali —, fondateur de l’empire banmana du Kaarta.
[237]L’expression « Fouta-Diallon » est récente ; elle a été imaginée par les Toucouleurs venus du Fouta Sénégalais qui, en souvenir de leur patrie, ont donné au Diallon cette appellation de « Fouta du Diallon » par opposition au « Fouta du Toro » ou vrai Fouta.
[238]Samorho ou mieux San-morho veut dire en effet « hommes du ciel, de la pluie, cultivateurs », et non pas « hommes du serpent » comme on l’a prétendu à tort.
[239]On prétend que ce mot signifierait « les gens du python (minian) », à cause de la fréquence, chez les Sénoufo de cette région, d’un emblème religieux représentant un gros serpent roulé sur lui-même. Sans nier cette étymologie, je me permets d’observer que le suffixe de nationalité ka s’ajoute plutôt à un nom de pays qu’à un mot désignant un animal ou un objet.
[240]Les Sénoufo de notre époque ne sont nulle part anthropophages, mais on rencontre des cannibales dont le territoire est très voisin de celui des Sénoufo du Sud-Ouest : je veux parler des Ouobé et des Dan du haut Sassandra et du haut Cavally, dont les premiers appartiennent à la famille des Kroomen et les seconds au groupe des Mandé du Sud.
[241]Bekri (deuxième moitié du XIe siècle) dit que, si l’on part du pays de Gao en suivant le « bord occidental du fleuve » — c’est-à-dire la rive droite du Niger — et en s’éloignant ensuite vers l’intérieur des terres, « on arrive au royaume appelé le Demdem, dont les habitants mangent tous ceux qui leur tombent entre les mains ; ils ont un grand roi, qui a des vice-rois sous ses ordres ; on voit dans leur pays une énorme forteresse sur laquelle est placée une idole ayant la forme d’une femme ; les Demdem adorent cette idole et vont la visiter en pèlerinage ». On a pensé que ces Demdem de Bekri pouvaient être les Tombo de Hombori, mais peut-être étaient-ils plutôt les Mossi, dont l’empire venait de débuter à cette époque à Tenkodogo et qui rapportent leur origine à une princesse fameuse, enterrée à Gambaga : la tombe de cette femme fut longtemps un but de pèlerinage (voir plus loin).
[242]Cette théorie provient peut-être de l’appellation de Kourouman kobé que les Peuls de la Boucle, selon les régions, appliquent tantôt aux Nioniossé, tantôt aux Dogom, tantôt aux Gourmantché et tantôt aux Déforo.
[243]On compte 33 souverains qui se seraient succédé sur le trône du Mossi depuis Oubri, fondateur de la dynastie et arrière-petit-fils de la princesse dagomba dont cette dynastie descend ; mais, si l’on tient compte de ce que plusieurs empereurs étaient frères les uns des autres, on obtient le chiffre de 22 générations depuis cette princesse jusqu’au nâba actuel de Ouagadougou.
[244]Il semble bien certain en tout cas que l’empire du Mossi était déjà assez fortement constitué au XIVe siècle puisqu’il fut alors de taille à résister à l’empire de Mali parvenu à son apogée et à envoyer une armée piller Tombouctou en 1333, huit ans seulement après la conquête de cette ville par Kankan Moussa.
[245]Si c’est à cette coutume qu’a fait allusion Bekri dans le passage cité plus haut (page 302, note [241]), il est bien évident qu’il faut nécessairement placer l’époque de Yennenga et la fondation de l’empire de Ouagadougou au plus tard au début du XIe siècle.
[246]C’est-à-dire « terre d’Oubri » : tenga est l’équivalent mossi du dougou mandé, qui signifie proprement « terre, sol » et, par spécialisation de sens, « pays » ou « village ».
[247]Le lieutenant Marc semble vouloir attribuer aux Mossi une origine orientale ; à l’appui de son hypothèse, il dit que l’organisation de la cour des Morho-nâba (empereurs du Mossi) est unique en Afrique Occidentale tandis qu’elle a des équivalents au Haoussa, au Bornou, etc. Je me permettrai de faire observer que cet argument a peu de valeur, précisément parce que, contrairement à ce qu’avance le lieutenant Marc, on retrouve dans tous les anciens états de l’Afrique Occidentale (Ghana, Mali, Tekrour, Gao, Ségou, Dahomey, Bénin etc.) une organisation absolument analogue à celle de la cour du Mossi. (Voir la IVe partie de cet ouvrage et se reporter aux récits des géographes arabes et des vieux voyageurs européens).
[248]L’identification des Padorho n’a pu être faite encore : on les rattache généralement aux Dorhossié ; certains en font des Sénoufo, d’autres les considèrent comme des Bobo.
[327]CHAPITRE III
Ethnographie descriptive.
Je me propose, dans ce chapitre, de traiter sommairement des principaux caractères extérieurs et moraux des divers peuples du Haut-Sénégal-Niger, sans avoir aucunement l’intention ni d’épuiser la question ni même d’entrer dans les détails, ce qui demanderait pour chaque peuple une longue monographie. Je voudrais seulement tâcher d’esquisser à grands traits la physionomie spéciale à chaque peuple et les aspects communs à plusieurs, au triple point de vue de l’apparence physique, de l’habitation et du costume et enfin de la mentalité et du genre de vie. Je ne parlerai pas ici des coutumes, qui font l’objet de la cinquième partie de cet ouvrage : « les civilisations ».
I. — Caractères physiques.
1o La coloration de la peau. — La couleur de peau des indigènes du Haut-Sénégal-Niger est excessivement variable, même dans un peuple donné, et ne peut guère fournir d’indications utiles quant au rattachement ethnique des individus. Assurément la coloration blanche ou soi-disant telle ne se rencontre que chez les peuples de race blanche, c’est-à-dire chez les Maures de l’Azaouad et du Hodh, les Touareg et les Peuls, mais il est rare, même chez les individus purs de tout croisement avec des Nègres, que cette coloration présente le même aspect que chez les Européens, ou au moins que chez les Européens du Nord et même du Centre : à part quelques familles maraboutiques[328] qui vivent à l’état sédentaire et habitent des maisons dont elles sortent rarement, les Maures et les Touareg de pure origine arabe ou berbère sont tous plus ou moins basanés, pas plus pourtant que beaucoup de paysans des pays méditerranéens ; mais il est à remarquer que la teinte relativement foncée de leur peau est due surtout à l’action du soleil et du grand air, car les parties de leur corps habituellement recouvertes par des vêtements sont notablement plus claires que celles généralement découvertes. Chez les Peuls que leur pauvreté a empêchés de se procurer des esclaves noires et a préservés ainsi du métissage, la teinte est un peu plus foncée peut-être que chez les Maures et les Touareg de race pure, mais cependant cette teinte ne diffère pas sensiblement de celle de beaucoup d’Italiens du Sud.
Mais le nombre des métis est naturellement considérable chez ces divers peuples, surtout chez les Maures et chez les Peuls, sans parler des Harrâtîn, Bella et Rimaïbé d’origine purement nègre qui vivent au milieu d’eux, en sorte que toutes les colorations se rencontrent, depuis les plus claires jusqu’aux plus foncées, et que beaucoup de Maures, Touareg, Peuls ou soi-disant tels sont aussi noirs que des Banmana ou des Mossi.
Chez les peuples de race nègre, les albinos mis à part comme représentant un cas purement pathologique, la coloration de la peau est également fort variée. Tout d’abord il convient, chez eux comme chez les peuples de race blanche, de tenir compte du métissage : certains Arma de Tombouctou, certains Soninké et Toucouleurs doivent à des ascendants marocains, maures ou peuls une teinte relativement claire qui leur fait donner le même nom d’« hommes rouges » que les indigènes du Soudan appliquent en général aux Maures et même aux Européens. Mais, en dehors de cette circonstance spéciale, la coloration des groupements purement nègres est loin d’être homogène. D’une façon générale, les Nègres du Sahel et de la zone soudanaise, lorsqu’ils n’ont pas été influencés par des populations blanches, sont d’un teint notablement plus foncé que ceux de la zone forestière ; il ne serait pas impossible que cette différence fût due à l’action du soleil, qui doit naturellement se faire plus[329] sentir dans les régions découvertes que sous les ombrages de la forêt dense. Je dois ajouter que, dans la même tribu et souvent dans la même famille, on rencontre des hommes dont la couleur diffère tellement que les épithètes de « blanc », de « rouge » et de « noir » sont couramment employées par les indigènes de l’Afrique Occidentale pour donner le signalement des individus.
Les peuples du Haut-Sénégal-Niger dont la coloration est la plus foncée, les exceptions individuelles et celles dues au métissage mises à part, sont les Songaï demeurés purs, les Kâgoro, les Banmana, les Tombo, les Birifo, la plupart des peuples du groupe gourounsi et ceux du groupe lobi ; on rencontre aussi des pigmentations très accentuées chez les Toucouleurs, les Soninké, les Bozo et les Dioula. Mais il est rare que le degré de coloration atteigne le noir presque pur que l’on constate chez les Ouolofs et l’expression de « brun foncé » est celle qui conviendrait le mieux pour caractériser la teinte la plus répandue chez les peuples que je viens d’énumérer.
Chez les autres, la couleur varie du brun foncé au brun clair : certains Malinké, certains Sénoufo, certains Gourmantché, en général ceux des districts les plus méridionaux, ont parfois le teint simplement bronzé que l’on remarque chez beaucoup de populations du golfe de Guinée et notamment chez les Kroomen de Sassandra.
2o Le facies. — Les Maures, les Touareg et les Peuls proprement dits sont franchement orthognates ; tous ont le nez droit, mais les narines sont souvent plus ouvertes chez les Maures que chez les Touareg et surtout que chez les Peuls ; ces derniers ont aussi les lèvres plus minces que la plupart des Maures. D’une façon générale le facies diffère peu du facies méditerranéen chez les individus de ces trois peuples qui ne sont pas métissés de sang nègre.
Quant aux peuples de race noire, ils ont tous les narines largement ouvertes et les lèvres épaisses qui caractérisent leur race, mais à des degrés très divers. Il en est de même du prognatisme qui, très accentué chez certains (Kâgoro, Banmana,[330] Tombo, Gourmantché, Dagari), est bien moins sensible chez les autres. Il ne semble pas y avoir de relation appréciable entre la coloration de la peau et le degré de prognatisme et, là encore, les différences individuelles sont souvent plus marquées que les différences nationales.
3o Les cheveux. — Les Maures, les Touareg et les Peuls non métissés ont les cheveux lisses, les autres peuples du Haut-Sénégal-Niger ont tous les cheveux crépus : ici la distinction entre populations de race blanche et populations de race noire est très nette, beaucoup plus nette que celle résultant de la pigmentation ou du facies. Je crois que, si l’on rencontre un Noir dont les cheveux sont lisses ou presque lisses, on peut affirmer à coup sûr qu’il a eu des ascendants de race blanche, et qu’inversement tout Blanc ayant les cheveux quelque peu crépus a eu des ascendants de race noire.
C’est surtout dans la façon de porter les cheveux que l’on peut noter des différences, non plus naturelles, mais acquises, entre les divers peuples ou groupements ethniques. En ce qui concerne les hommes, on trouve en général les cheveux rasés ou portés courts chez les Maures de l’Azaouad, les Touareg, les Toucouleurs, les Songaï, les Bozo, les Soninké, les Khassonkè, les Mossi, les Yansi ; les Maures du Hodh — sauf dans quelques familles maraboutiques — portent les cheveux longs et touffus ; les Peuls se nattent en général la chevelure, ainsi que les Malinké et les Foulanké ; parmi les autres peuples du Haut-Sénégal-Niger, les uns (Dioula, Kâgoro, Banmana, Diallonké, Samo, Samorho, Sia) se rasent habituellement le crâne mais souvent aussi portent les cheveux nattés, les autres (Sénoufo, Tombo, Dogom, Déforo, Bobo) tantôt se rasent et tantôt portent les cheveux longs soit libres soit nattés ou tressés en cimier, d’autres encore se les rasent en conservant une touffe au sommet de la tête (Nankana, Gourmantché, Dagari) ou bien se les nattent en tresses minces ou en sillons parallèles adhérents au crâne (Birifo, Gourounsi, Lobi).
Les femmes portent le plus souvent les cheveux longs chez les Maures et les Touareg ; elles se les nattent ou les coiffent[331] en cimier (tantôt allant d’une oreille à l’autre, tantôt et le plus souvent allant de la nuque au front) chez les Peuls, les Songaï, les Dioula, les Malinké, les Foulanké, les Tombo ; elles adoptent presque exclusivement le cimier chez les Toucouleurs, les Bozo, les Soninké, et l’agrémentent de cadenettes ou nattes retombant sur les oreilles chez les Banmana et les Khassonkè ; elles portent en général les cheveux courts chez les Sénoufo, les Mossi, les Gourmantché, les Birifo, les Dagari, les Gourounsi, les Bobo, les Lobi, etc., conservant souvent une touffe plus épaisse et plus longue au sommet de la tête.
Il s’en faut d’ailleurs que la même mode soit observée par tous les individus d’un peuple donné : une grande diversité règne en particulier dans les villes et le long des frontières communes à plusieurs groupements.
4o Mutilations. — L’excision du clytoris chez les femmes est, je crois, absolument universelle dans toutes les populations blanches et noires du Haut-Sénégal-Niger, sauf peut-être chez les Touareg, sur lesquels je ne possède pas de renseignements précis à cet égard, et aussi chez quelques rares fractions peules. L’époque à laquelle elle est pratiquée varie selon les peuples : les filles sont opérées chez les Maures le septième jour après leur naissance, elles le sont vers l’âge de trois ans chez les Peuls et les Soninké, un peu plus tard (vers quatre ans) chez les Toucouleurs et généralement au moment de la puberté (vers dix ou douze ans), ou même seulement au moment de leur mariage, chez les autres peuples.
La circoncision des garçons, quoique très largement répandue, n’est pas universelle comme l’excision des filles ; elle se pratique chez les Maures et les Touareg vers 7 ans ; chez les Peuls, les Soninké, les Toucouleurs, les Songaï, les Bozo, les Dioula, les Kâgoro, les Banmana, les Khassonkè, les Malinké, les Foulanké, les Diallonké, les Samo, les Samorho, les Sia, les Tombo, les Dogom, les Déforo, les Mossi, les Yansi, les Gourmantché, on la pratique entre 8 et 12 ans, à peu près à l’époque de la puberté. Chez les Sénoufo, les Nankana, les Dagari, les Bariba et les Soumba, la circoncision existe mais n’est pas[332] pratiquée dans toutes les tribus ; elle n’est pas du tout en usage chez les Birifo ni chez les peuples des groupes gourounsi, bobo et lobi, à de rares exceptions près concernant les Dian qui professent l’islamisme.
Les tatouages de la face par scarifications sont d’une pratique très répandue au Haut-Sénégal-Niger mais ne se rencontrent pas partout. Certains peuples rejettent complètement ces mutilations : les Maures, les Touareg, les Peuls, les Toucouleurs, les Bozo, les Malinké, les Foulanké, les Birifo, les Lobi, les Pougouli. Chez d’autres, les scarifications n’existent que dans une partie de la population ou dans certaines familles : ainsi, bien que les Songaï en général ne soient pas tatoués, certains portent trois longues cicatrices verticales sur chaque tempe ou bien sur le front une longue incision verticale entourée d’une ligne de points à droite et à gauche ; les Soninké ne sont pas tatoués, à l’exception des Diawara, qui portent trois petites incisions entre les deux sourcils ; les Dioula de pure origine mandé ne sont pas tatoués, mais ceux qui se sont alliés aux Sénoufo portent en général sur chaque joue trois larges cicatrices en éventail partant de la commissure des lèvres ; chez les Kâgoro, la majorité des individus ne porte aucune scarification, mais certains ont adopté le tatouage banmana (trois cicatrices verticales parallèles allant de la tempe au menton) ; les Dagari, ou bien ne sont pas tatoués, ou bien portent sur chaque joue un double éventail de dessin varié ; les Dian et les Gan ont parfois adopté des tatouages bobo ou sénoufo. Les indigènes appartenant aux autres populations du Haut-Sénégal-Niger portent presque tous des scarifications ethniques dont suit le détail ; mais je dois faire observer qu’il n’est pas rare cependant, même chez ces dernières populations, de rencontrer des individus non tatoués et de plus que la marque d’un peuple ou d’une tribu a souvent été adoptée par des membres d’un autre peuple ou d’une autre tribu, ou imposée à des esclaves d’origine étrangère, en sorte que le tatouage d’un individu n’est pas une indication absolument certaine du groupe ethnique auquel il appartient.
Banmana : trois longues cicatrices verticales ou obliques sur chaque côté de la figure ; — Khassonkè : trois petites incisions[333] entre les deux sourcils et sur chaque tempe ; — Diallonké : trois petites incisions au dessous de chaque œil ; — Samorho : trois ou quatre cicatrices verticales sur chaque tempe ; — Samo : deux incisions partant des deux côtés du nez pour se réunir sous la lèvre inférieure par une série de petits points ; — Sia : trois cicatrices formant éventail sur chaque joue ; — Sénoufo : tatouages variés, dont les plus fréquents sont trois cicatrices en éventail ou bien trois longues incisions verticales ou même les deux systèmes réunis, et souvent en plus des entailles de chaque côté du nez ou des yeux ; — Tombo et Dogom : trois petites incisions colorées en bleu entre les deux sourcils, répétées sur chaque tempe ; — Déforo : tatouages divers ; — Mossi et Yansi : trois ou quatre longues cicatrices verticales sur chaque joue, souvent barrées par une incision oblique ; — Nankana : une cicatrice verticale allant du front jusqu’au milieu du nez et une incision oblique commençant au dessous de chaque œil pour se terminer sur la pommette ; — Gourmantché : quatre longues cicatrices verticales sur chaque joue ; — Nioniossé : une, deux ou trois incisions allant de la commissure des lèvres au dessous de chaque pommette, augmentées souvent d’une cicatrice oblique partant de l’angle supérieur du nez ; — Nounouma : trois cicatrices horizontales ou verticales sur chaque joue, plus une virgule sous chaque œil ; — Sissala : deux cicatrices horizontales, barrées par une incision verticale, sur chaque joue ; — Boussansé : tatouages divers, comportant presque toujours une incision oblique sous chaque œil ; — Bobo : cicatrices horizontales, obliques et verticales disposées de manières diverses et couvrant souvent tout le visage ; — Lorho : une virgule sous chaque œil et, chez les femmes, deux cercles concentriques sur chaque joue ; — Bariba : cicatrices linéaires multiples, de dispositions variées ; — Soumba : hachures obliques très serrées sur chaque joue.
II. — Habitation, vêtement, parure et armement.
1o Habitation. — Les divers aspects sous lesquels se présente l’habitation indigène dans le Haut-Sénégal-Niger peuvent se[334] ramener à sept types principaux, que j’appellerai : la tente, la hutte hémisphérique, la hutte cylindrique à toit conique, la hutte bicylindrique à toit ovoïde, la maison rectangulaire à toit plat, la maison ordinaire à terrasse et le château-fort.
La tente, en laine ou en cotonnade, parfois en peaux, est utilisée seulement par les Maures et parfois par les Touareg, mais ces derniers ne l’emploient guère que lorsqu’ils voyagent, comme gîte d’étape.
La hutte hémisphérique, qui n’est qu’un intermédiaire entre la tente et la maison proprement dite, se rencontre chez les Touareg, les Peuls et les Songaï. Chez les premiers, elle est construite à l’aide de peaux ou de nattes reposant sur une armature en branchages ; chez les seconds, elle est faite d’herbes ou de nattes maintenues aussi par des branchages ; chez les troisièmes, elle est faite surtout de nattes, parfois recouvertes de paille à la partie supérieure. Les Peuls tout à fait sédentaires font également usage de huttes cylindriques à toit conique, ainsi que certains Songaï ; la classe noble des villes, chez ces derniers, habite généralement des maisons à terrasse. Il convient d’observer également que la hutte hémisphérique en paille, souvent en forme de ruche, est employée par toutes les populations du Soudan pour construire les villages provisoires édifiés au milieu des plantations lors de la saison des cultures, ainsi que pour servir d’abri aux chasseurs, charbonniers, passeurs, etc. Elle a partout le caractère d’une habitation provisoire. Dans les pays où se trouvent des roniers, la paille est souvent remplacée par des palmes.
La hutte cylindrique, bâtie en argile soit brute soit façonnée en briquettes grossières et coiffée d’une toiture conique en paille à armature de bois, de bambou ou de nervures de raphia, est certainement le type d’habitation le plus répandu dans tout le Soudan Occidental. Elle est adoptée, de façon à peu près exclusive, par les Toucouleurs, les Kâgoro, les Khassonkè, les Malinké, les Foulanké, les Diallonké, les Mossi, les Yansi, les Gourmantché, les Dian, les Gan, les Lorho, et on la rencontre aussi très fréquemment, à côté d’autres modes de construction, chez les Peuls sédentaires, chez certains Songaï, chez beaucoup[335] de Bozo, de Soninké, de Dioula et de Banmana, chez une partie des Samo, des Samorho, des Sia, des Sénoufo, des Nankana, des Bobo. Presque partout où existe la hutte cylindrique, les diverses huttes appartenant à la même famille sont réunies entre elles par des barrières en bois ou en nattes ou par de petits murs en pisé, de façon à former un enclos circulaire à l’intérieur duquel s’ouvrent les portes des huttes.
La hutte bicylindrique à toit ovoïde, composée en réalité de deux huttes cylindriques accolées par leur milieu, ne se rencontre, je crois, que chez les Sénoufo : très fréquente dans la partie de ce peuple qui habite la Côte d’Ivoire, elle est plus rare chez les Sénoufo du Haut-Sénégal-Niger, qui lui préfèrent en général soit la hutte cylindrique ordinaire, soit la maison à terrasse ou la maison rectangulaire à toit plat.
La maison rectangulaire à toit plat se distingue de la maison à terrasse en ce que sa toiture, très souvent légèrement bombée, n’est pas destinée à servir de lieu de résidence même momentanée, quoiqu’elle se compose parfois d’une véritable terrasse supportée par une armature de rondins de bois. Ce type d’habitation varie d’ailleurs énormément selon les lieux et les peuples. On rencontre cette maison chez les Tombo des montagnes, où elle est généralement construite en pierres sèches, supporte souvent un étage, s’orne de portes et fenêtres sculptées et utilise fréquemment une grotte naturelle ou un pan de falaise pour constituer une ou plusieurs de ses faces et parfois sa toiture, ainsi que la chose se pratique chez nous dans certaines régions de la Touraine ; on la rencontre aussi : chez les Dogom, avec des murs faits surtout de briques rectangulaires ; chez les Déforo, dont les villages sont perchés sur des rochers ou des monticules, avec une toiture légèrement bombée ; chez les Bobo et une partie des Sénoufo, avec une toiture composée d’une couche de bois, d’une couche de paille et d’une couche d’argile superposées et avec une sorte de vérandah sur l’une des faces ; chez les Dian, avec une toiture en paille qui parfois n’est plus plate mais présente deux pans.
La maison à terrasse ordinaire, très vraisemblablement d’origine marocaine, se présente sous des aspects très divers quant à[336] sa forme générale, à sa disposition intérieure et à son ornementation ; elle peut avoir, comme à Dienné et en beaucoup d’autres villes, un certain air de palais, comme elle peut aussi n’être qu’un abri misérable et inconfortable. Les murs sont construits en briques séchées au soleil et plus ou moins grossières, parfois en briques demi-cuites, et reposent très fréquemment sur un soubassement en pierres ; la toiture est faite de rondins de bois supportant une épaisse couche d’argile durcie et forme une terrasse que borde de tous côtés un parapet assez bas, indépendamment de clochetons ou ornements éventuels de forme généralement pyramidale. Bien qu’en général on ne vive pas sur la terrasse de ces maisons comme on vit sur la terrasse des châteaux-forts dont il sera question tout à l’heure, on y couche souvent durant la belle saison et on s’y porte lorsque quelque scène curieuse se déroule dans les rues. Ces maisons à terrasse forment le type à peu près exclusif des habitations dans les quelques villes ou villages du Hodh et de l’Azaouad et dans les grandes villes voisines du Niger des régions saharienne et sahélienne, quelle que soit la composition de leur population (Tombouctou, Dienné, etc.) ; elles sont en général plus confortables et plus élégantes dans ces dernières villes que dans le Hodh et l’Azaouad et supportent assez souvent un étage. Elles sont également très fréquentes dans toutes les villes, même modestes, habitées par des Bozo, des Soninké ou des Dioula, et ont été adoptées souvent par les Samorho, les Sia et les Sénoufo ; enfin elles constituent, concurremment avec les huttes cylindriques, le type d’habitation le plus répandu chez les Banmana.
Le château-fort est aussi une construction à terrasse, mais de proportions généralement plus considérables et disposée d’une manière spéciale : tandis que la maison ordinaire à terrasse n’abrite qu’une famille réduite ou même souvent quelques membres seulement d’une famille, le château-fort renferme quelquefois toute la population d’un village ordinaire ; de fait, chaque château-fort, isolé au milieu des champs, forme à lui seul en quelque sorte un village ; même dans les régions où un certain nombre de ces constructions sont groupées ensemble, chacune[337] d’elles se trouve toujours séparée des plus voisines par un espace assez considérable. La maison proprement dite est généralement basse, parfois le sol se trouve au-dessous du niveau du terrain environnant ; elle sert surtout de magasin à vivres, d’étable, de refuge en cas de pluie ou en cas de danger ; la terrasse, souvent pourvue de tourelles à un ou deux étages et protégée par un rempart assez haut, est le lieu où se tiennent d’ordinaire les habitants. Très souvent, le château-fort ne possède qu’une seule porte d’accès, laquelle sert surtout au passage du bétail et est barricadée durant la nuit ; les gens de la maison pénètrent chez eux au moyen d’échelles grossières qui les conduisent de l’extérieur sur la terrasse et ensuite au moyen d’autres échelles grâce auxquelles, à travers des ouvertures étroites pratiquées dans la toiture, ils descendent dans l’intérieur de l’habitation. Certains de ces châteaux-forts se composent de plusieurs corps de bâtiment séparés les uns des autres par des cours intérieures et couvrent une superficie considérable. Ce mode de construction semble localisé chez une partie des peuples de la famille voltaïque, principalement dans les groupes gourounsi (Nioniossé, Nounouma, Sissala et Boussansé), bobo (concurremment avec des huttes cylindriques et des maisons rectangulaires), lobi (Lobi et Pougouli) et bariba (Bariba et Soumba), ainsi que chez certains peuples du groupe mossi (Nankana, Dagari et Birifo). On le rencontre aussi chez les Samo et les Samorho, concurremment avec la hutte cylindrique ou la maison ordinaire à terrasse.
2o Vêtement. — Une grande tendance se manifeste au Haut-Sénégal-Niger vers l’unification du vêtement : la nudité complète chez les jeunes enfants des deux sexes, la bande d’étoffe passée entre les jambes et cachant les parties sexuelles chez les jeunes garçons et les petites filles après la circoncision ou l’excision, la culotte courte et large et la petite blouse à manches courtes chez les hommes adultes, le pagne ceint autour des reins chez les femmes, l’ample et longue chemise ou boubou de coupes variées chez les gens de qualité de l’un et l’autre sexe, le bonnet de cotonnade sur la tête des hommes et le chapeau de paille indigène[338] pour aller en voyage ou aux champs, des sandales aux pieds pour les marches longues, voilà ce que l’on aperçoit le plus souvent au Soudan, chez les populations les plus diverses. Cependant quelques peuples ont conservé des façons de se vêtir qui leur sont spéciales et qui permettent souvent de reconnaître à première vue le pays d’origine de beaucoup d’indigènes. Nous allons passer rapidement en revue les modes de vêtement les plus caractéristiques.
Les Maures de l’Azaouad sont en général reconnaissables à ce qu’ils se couvrent la tête d’une pièce d’étoffe roulée en turban, tandis que les Maures du Hodh vont presque toujours tête nue, à l’exception de certains marabouts ; les uns et les autres, au moins lorsqu’ils voyagent, sont habituellement vêtus d’un boubou assez court, souvent serré à la taille par une ceinture, réduit fréquemment à une simple blouse sans manches, et ne portent pas en général de culotte. — Les Touareg sont caractérisés par le voile que portent les hommes et qui ne laisse apercevoir que les yeux et une partie du nez, et par leur pantalon long se terminant aux chevilles. — Les Peuls portent en général une blouse serrée à la taille, avec ou sans culotte, ou un simple pagne dont un pan est rejeté sur l’épaule gauche ; ils vont tête nue ou sont coiffés d’un bonnet tronconique en cotonnade blanche ; leurs femmes portent le pagne ceint autour des reins. — Les Toucouleurs sont en général très habillés : grand boubou et culotte, bonnet tronconique de couleur blanche ; leurs femmes portent le pagne et en plus une blouse très ample. — Les Songaï portent généralement la culotte et la blouse, et souvent le turban et le voile touareg ; leurs femmes, au moins dans les classes pauvre et moyenne, n’ont que le pagne. — Les Bozo et les Soninké se vêtent à peu près comme les Toucouleurs. — Les Dioula portent la blouse courte ou le boubou, en plus de la culotte ; leur bonnet a généralement la forme d’un bonnet napolitain et leur chapeau a le fond tantôt conique et tantôt hémisphérique ; leurs femmes portent le pagne. — Les Kâgoro, les Banmana, les Khassonkè, les Malinké, les Foulanké, les Diallonké, les Samo, les Samorho et les Sia ont en général la blouse courte, la culotte et le bonnet surmonté ou non d’un[339] chapeau de paille à fond conique ; souvent ils n’ont pas d’autre costume que le bila (pièce d’étoffe passée entre les jambes) ; le bonnet a, tantôt la forme tronconique, tantôt — surtout chez les Banmana — la forme dite « à gueule de caïman » ; les femmes sont vêtues d’un pagne. — Les Sénoufo ont à peu près le même costume que les Banmana, mais se contentent plus fréquemment que ces derniers d’un simple bila ou d’une culotte sans blouse ; leurs femmes portent généralement le pagne, mais n’ont souvent qu’une sorte de mouchoir cachant leur nudité, ou des franges de cuir, ou un paquet de feuilles. — Les Tombo, Dogom, Déforo, Mossi, Yansi, Gourmantché portent la culotte, la blouse et le bonnet, avec ou sans chapeau de paille à fond conique, parfois un simple pagne dont une extrémité est rejetée sur l’épaule ; leurs femmes ont le pagne ceint autour des reins. — Les Nankana et les Dagari sont complètement nus ou portent un petit tablier en cotonnade ou en peau ; leurs femmes ont une ceinture faite de cordons de cuir et ornée de franges qui pendent par devant, ou bien portent le pagne. — Les Birifo tantôt sont complètement nus, maintenant leur verge relevée au moyen d’une ficelle passée autour de la taille, tantôt usent d’une sorte de doigt de gant en cotonnade dans lequel est inséré le membre viril ; ils portent comme coiffure un chapeau de paille à fond conique et à bords plats ou bien une calebasse ; les notables ont une peau de bête suspendue au cou et rejetée sur le dos ; les femmes cachent leur nudité au moyen de deux paquets de feuilles retombant l’un par devant et l’autre par derrière. — Ce costume sommaire est à peu près celui de tous les Gourounsi (Nioniossé, Nounouma, Sissala, Boussansé), sauf que le doigt de gant est en général remplacé par un petit tablier de peau et que beaucoup de notables ont adopté la blouse. — Les Bobo ont, soit le doigt de gant, soit le tablier de peau ou de cotonnade. — Les Lobi et les Pougouli ont le même costume que les Birifo. — Les Dian ont en général adopté la blouse et la culotte. — Les Gan sont nus ou portent un bila. — Les Lorho portent une sorte de tablier très spécial, dit « tablier pakhalla », et leurs femmes portent le pagne. — Les Bariba ont le doigt de gant ou le tablier de peau et les Soumba[340] sont complètement nus ; les femmes des uns et des autres portent des paquets de feuilles.
3o Parure. — La parure, surtout chez les femmes, est plus variée que le vêtement et se spécialise davantage aussi selon les pays et les tribus. Mais le cadre de cet ouvrage ne me permet pas de traiter à fond ce sujet et je dois me contenter de signaler certains usages particulièrement caractéristiques, et relatifs à des tatouages ou mutilations plutôt ornementaux qu’ethniques.
Chez les peuples du Nord (Maures, Touareg, Peuls, Toucouleurs, Songaï, Bozo, Soninké), ainsi que chez les Dioula, les femmes se bleuissent très fréquemment les lèvres et les paupières avec de l’antimoine. — Chez les Songaï, beaucoup d’hommes et de femmes portent des anneaux aux oreilles et à la cloison du nez. — Chez les Banmana, un grand nombre de femmes ont un anneau de cuivre ou d’argent passé dans la cloison du nez, et beaucoup d’hommes ont une oreille percée. — Les mêmes modes existent chez les Sénoufo ; de plus, chez ces derniers, les femmes portent fréquemment dans les oreilles tantôt un simple cordonnet de cuir orné de cauries tantôt toute une série de petits anneaux en cuivre recouvrant tout l’ourlet et le lobe ; souvent aussi elles ont dans chaque narine une petite boucle de cuivre et dans la lèvre inférieure un cône de quartz, enchâssé la pointe en bas. — Chez les Dagari, les femmes s’enfoncent dans la lèvre supérieure et parfois dans les deux un bâtonnet ou un simple brin de paille ; il en est de même chez les Nounouma, les Sissala et la plupart des Bobo. — Chez les Birifo et les Lobi, c’est un disque d’ivoire ou de pierre que les femmes se logent dans chaque lèvre.
Il me faut ajouter que, indépendamment des scarifications de la face dont j’ai parlé plus haut et même chez les peuples qui n’en portent pas, il est excessivement fréquent de rencontrer, sur les individus des deux sexes, de petites cicatrices en forme de points en relief qui décorent soit la nuque, soit la poitrine, soit le ventre, soit les reins, soit les bras ou les cuisses. Certaines femmes surtout ont le corps presque entier couvert de[341] cicatrices de cette sorte, représentant les dessins géométriques les plus variés. Le buste des femmes sénoufo et des femmes nounouma est remarquable à cet égard, mais beaucoup de femmes songaï, soninké et malinké n’ont que peu à leur envier sous ce rapport.
4o Armement. — Le fusil à pierre a été importé en de telles quantités dans l’Afrique Occidentale depuis le XVIIe siècle, soit par le Maroc soit par les côtes, qu’il est actuellement répandu à peu près partout. Les fusils à piston, plus rares, sont cependant en assez grand nombre. Malgré cela, beaucoup de populations, surtout dans la Boucle du Niger, sont demeurées fidèles aux armes de leurs ancêtres. Ces armes sont : la lance, répandue aujourd’hui encore chez les Touareg, les Peuls, les Songaï, les Bariba, et aussi parmi nombre d’autres peuples chez lesquels elle n’est plus guère qu’une parure ou un insigne de commandement ; l’arc et les flèches à pointe de bois dur ou de fer, empoisonnées ou non, encore en usage chez les Banmana, les Sénoufo et les Mossi, mais surtout chez les Samo, les Dagari, les Birifo, les divers peuples gourounsi, les Bobo, les Lobi, les Bariba et les Soumba ; le casse-tête, en usage surtout chez les Sénoufo et les peuples de famille voltaïque ; le couteau de jet en bois, qu’on ne rencontre guère — je le crois du moins — que chez certains Sénoufo du cercle de Bobo-Dioulasso (et du cercle de Korhogo à la Côte d’Ivoire) et des couteaux de jet en fer encore en usage chez les Bariba. Quant aux épées et aux sabres, ils existent à peu près partout, mais ne constituent guère des armes véritables qu’entre les mains des Touareg : chez les autres peuples du Haut-Sénégal-Niger, ils sont surtout des objets de parade, bien qu’un certain nombre de meurtres soient commis à l’aide du sabre, comme aussi d’ailleurs à l’aide de la hache des bûcherons ou de la simple houe des cultivateurs.
III. — Mentalité et genre de vie.
Bien des caractères intellectuels et moraux, de même que bien des caractères physiques et bien des phénomènes extérieurs[342] de la civilisation, sont communs à tous les peuples du Haut-Sénégal-Niger, sans distinction de race ni de pays. Mais beaucoup aussi portent l’empreinte de l’origine ethnique de chaque peuple ou du milieu géographique, économique, politique, social et religieux dans lequel il a évolué et qui a contribué puissamment à sa formation. Et ceci présente une importance considérable, notamment pour ceux qui sont appelés à administrer ces divers peuples.
Je chercherai, dans les lignes qui vont suivre, à résumer en quelques mots les caractères les plus saillants de chacun des groupes ou peuples du Haut-Sénégal-Niger, au double point de vue intellectuel et moral, en indiquant de plus son genre de vie et ses aptitudes spéciales. Je ne me fais aucune illusion sur ce que cette esquisse peut présenter de défectueux et d’incomplet, mais je ne crois pas cependant m’éloigner beaucoup de la vérité dans l’ensemble. Il demeure bien entendu que mes observations ne s’appliquent qu’à la masse de chaque groupe ou peuple et qu’il convient de tenir compte, là comme ailleurs, des exceptions locales, tribales et individuelles.
Les Maures de l’Azaouad, plus nettement sémites que ceux du Hodh, sont aussi plus exclusivement nomades ; surtout pasteurs et marabouts s’il s’agit des Kounta, principalement guides et convoyeurs de caravanes ou marchands de sel s’il s’agit des Bérabich, ils se transforment facilement en guerriers ou en coupeurs de routes lorsque leurs besoins ou les circonstances l’exigent. Les Bérabich, qui passent pour avoir parmi tous les instincts les plus pillards, sont peut-être cependant plus facilement disciplinables et se métamorphoseront plus aisément en gendarmes, au jour prochain où ils y trouveront leur compte, tandis que les Kounta, qui n’ont jamais cessé d’avoir des visées politiques, accepteront plus difficilement de ne plus jouer un rôle actif dans les destinées de la région de Tombouctou.
Les Maures du Hodh forment un amalgame aussi bigarré au point de vue moral qu’au point de vue physique : l’élément arabe, représenté par les Beni-Hassân, semble n’avoir d’autre but que la guerre, guerre sainte contre les infidèles ou simple razzia faite en vue de s’approprier les moissons des sédentaires ou les troupeaux[343] des pasteurs ; l’élément berbère, assurément plus nombreux mais réduit en général à un état plus ou moins accentué de vasselage, se livre surtout à l’élevage et au commerce ; l’élément mixte enfin qui constitue les familles maraboutiques, d’une culture intellectuelle plus élevée souvent qu’on ne serait porté à le croire, s’appuie tantôt sur les guerriers et tantôt sur les pasteurs, selon l’intérêt du moment, contribuant d’ailleurs à la richesse générale par ses nombreux serfs, cultivateurs et artisans. Fervents musulmans pour la plupart, les Maures du Hodh sont cependant en général monogames, par tradition plutôt que par nécessité.
D’un islamisme très mitigé, sauf dans les familles ou sous-tribus maraboutiques, les Touareg se caractérisent surtout par un esprit d’indépendance et d’ombrageuse fierté devenu légendaire ; plus exclusivement monogames encore que les Maures, ils ont pour la femme une déférence dont le résultat est de donner à celle-ci une importance sociale très considérable ; de là sans doute leur réputation de peuple chevaleresque, réputation qui, sous d’autres rapports, ne s’est pas toujours vérifiée dans la pratique. Les Touareg ne sont, semble-t-il, nomades que par nécessité et non par instinct atavique ; il est permis de supposer que, les événements politiques entraînant une modification des conditions économiques, un grand nombre d’entre eux reviendront, dès qu’ils le pourront, à la vie mi-pastorale et mi-agricole qu’ont menée autrefois leurs ancêtres dans le Nord de l’Afrique et qu’y mènent encore leurs cousins de l’Atlas algérien et marocain.
Les Peuls sont également remarquables par leur caractère indépendant, mais leur fierté n’est pas telle qu’elle ne se soit pliée maintes fois jusqu’à leur faire accepter auprès des Nègres une vie de domestiques et presque de parias ; il semble que, pourvu qu’on les laisse vivre à leur guise et qu’on n’intervienne pas dans leurs affaires intérieures, les Peuls acceptent n’importe quelle situation sociale ou politique ; les meilleurs musulmans d’entre eux n’éprouvent aucune répugnance à se louer comme bergers au service d’un propriétaire infidèle ni même à fournir des contingents guerriers à un prince païen[344] contre un prince mahométan, ainsi que le fait s’est produit lors des luttes des Banmana de Ségou contre les Toucouleurs. En dehors des castes spéciales qui les entourent sans se mêler réellement à eux, et bien que se livrant volontiers à la chasse, les Peuls sont avant tout et essentiellement pasteurs ; ils le sont plus et mieux certainement que les Maures et les Touareg et ont pour leurs troupeaux des soins et une affection qu’on ne rencontre chez aucune autre population de l’Afrique Occidentale. Quoique admettant la polygamie en principe lorsqu’ils sont musulmans, ils pratiquent surtout en fait la monogamie ; les femmes peules qui, comme les femmes touareg, jouissent d’une très grosse influence sociale, se montrent d’ailleurs hostiles à la polygamie, contrairement à ce qui a lieu chez les Nègres ; il est constant d’autre part que les Peuls attachent à la fidélité de leurs épouses une importance que les Noirs oublient volontiers en échange d’une indemnité pécuniaire ; à noter en passant que, chez les Peuls, ce sont les femmes qui traient les vaches, tandis que chez les Noirs ce soin est dévolu aux hommes.
Les Toucouleurs, dont on a souvent méconnu le caractère nègre — pourtant très net — en en faisant des métis de Peuls, se distinguent de ces derniers au moral autant qu’au physique. Polygames comme tous les Noirs de l’Afrique Occidentale quelle que soit leur religion, alors que, quelle que soit également leur religion, les peuples de race blanche de la même région ont tous une tendance marquée vers la monogamie, les Toucouleurs sont sédentaires au même titre que leurs voisins mandé ; quoique certains se livrent à l’élevage, ils n’ont pas pour leurs troupeaux le culte que les Peuls ont pour les leurs, et leur occupation principale est l’agriculture, que dédaignent au contraire les Peuls. Ils ont été guerriers et le seraient encore à l’occasion ; de tout temps ils ont été animés de l’esprit de conquête et de domination et, s’ils ont pu être gouvernés momentanément par des dynasties étrangères — peules, sossé et ouoloves —, ce fut parce que certaines de leurs familles avaient trouvé, dans le fait d’attirer des étrangers au Tekrour et de leur confier le sceptre, un moyen détourné de s’emparer[345] pratiquement elles-mêmes du pouvoir. Plus intelligents que les Peuls relativement aux questions matérielles, ils ont par contre le cerveau beaucoup moins développé en ce qui concerne la conception des idées abstraites et ils ne pourraient ni élaborer ni peut-être comprendre certaines rêveries poétiques dont les Peuls sont coutumiers. Indépendants, eux aussi, ils ont de plus un orgueil qui leur est très particulier : ils font d’excellents gradés dans nos troupes soudanaises, mais de déplorables soldats s’ils sont placés sous les ordres de gradés appartenant à un autre peuple que le leur. Presque tous sont musulmans, professent le plus grand mépris pour les « païens » et comptent parmi les plus fanatiques des Noirs islamisés.
Les Songaï, par l’aspect sous lequel ils se présentent aujourd’hui, démentent le rôle brillant que d’aucuns leur ont attribué dans l’histoire du Soudan. A vrai dire cette histoire s’est déroulée chez eux mais presque en dehors d’eux : ils ont peu contribué à la faire et n’y ont guère joué qu’un rôle passif. Si l’on excepte la caste des Sorko et celle, peu nombreuse d’ailleurs, des chasseurs, qui ont toujours eu l’une et l’autre des instincts pillards et conquérants et ont fourni d’utiles contingents aux empereurs de Gao, les Songaï n’ont jamais constitué un peuple guerrier ni dominateur : le soi-disant empire songaï fut tour à tour gouverné par des princes berbères et des princes soninké, sans parler des époques où il paya tribut ou rançon aux Mandingues, aux Mossi et aux Touareg ; les rares souverains puissants qui ont donné quelque prestige à cet empire devaient leur force à une armée recrutée un peu partout, même parmi les Songaï, mais principalement parmi des captifs d’origine mossi, bariba et banmana ; il suffit au pacha Djouder de se présenter avec quelques centaines de mousquets pour voir ce fameux empire songaï se dissiper en fumée, alors que, plus tard, le sultan Er-Rachid n’osa même pas se mesurer avec l’armée de l’empire banmana naissant. La masse du peuple songaï, composée d’agriculteurs sans défense et de médiocre valeur intellectuelle, fut sans cesse le jouet malheureux des invasions, des razzias et des révolutions de palais qui désolèrent les rives du bas et du moyen Niger jusqu’à[346] l’époque de l’intervention européenne ; le nombre des esclaves d’origine songaï qui ont alimenté la population noire du Sahara central et de l’Algérie témoigne de la misérable existence qui fut celle de ce peuple depuis sans doute les débuts de sa formation. Le fait que leur langue est devenue la langue commerciale du moyen Niger, la langue de Tombouctou et de Dienné, n’est aucunement dû à un caractère dominateur ou civilisateur qui ne fut jamais celui des Songaï ; il est dû surtout à l’extraordinaire simplicité de cette langue et aussi à ce qu’elle était l’idiome des bateliers entre les mains desquels devaient nécessairement passer toutes les transactions commerciales de la région.
Les Mandé du Nord forment, au point de vue mental et social, un groupe à peu près homogène, dans lequel les Bozo constituent une fraction spéciale, de peu d’importance numérique d’ailleurs, fraction devenue peuple mais qui n’était sans doute au début qu’une sorte de caste de navigateurs et de pêcheurs analogue à celle des Somono chez les Mandé du Centre. Les caractères généraux des Soninké et des Dioula sont sensiblement les mêmes : intelligents, actifs, s’assimilant facilement les civilisations et les langues étrangères ainsi que les techniques des divers métiers et professions, doués du génie commercial et du goût des voyages, presque tous musulmans, dévots et même fanatiques lorsque leur intérêt l’exige mais pratiquant au contraire la plus large tolérance lorsque c’est nécessaire, guerriers et conquérants à l’occasion quoique d’un caractère plutôt pacifique et ne s’attaquant jamais qu’à plus faible qu’eux-mêmes, établissant du reste plus généralement leur domination par la diplomatie que par la force, moins attachés à leur sol que la généralité des Nègres et s’expatriant avec la plus grande facilité, pratiquant l’agriculture surtout par l’intermédiaire de leurs esclaves et de leurs serfs ou vassaux mais se livrant de préférence eux-mêmes au négoce ou à l’industrie (tissage, teinture, etc.), de caractère assez versatile quoique fier et orgueilleux, naturellement attirés vers les progrès extérieurs de la civilisation et désireux d’acquérir une richesse qui leur permette de tenir un rang brillant dans la société, les[347] Soninké et les Dioula sont appelés plus que d’autres à contribuer à la diffusion des idées nouvelles et, par là même, ils peuvent nous être ou utiles ou nuisibles, selon la nature du courant qu’ils croiront avoir intérêt à répandre.
C’est avec eux que se termine la liste des peuples du Haut-Sénégal-Niger gagnés par l’influence islamique, liste qui ne comprend en réalité que les Maures, les Touareg, les Toucouleurs, les Songaï et la majorité des Peuls et des Mandé du Nord. On rencontre bien encore quelques musulmans chez les Mandé du Centre et, par ci par là, chez les autres populations, mais il ne s’agit plus que d’infimes groupements ou même d’exceptions individuelles et l’on peut dire, d’une façon générale, que la civilisation musulmane n’a jamais touché profondément les peuples que nous allons maintenant passer en revue et que, la plupart du temps, elle ne les a même pas effleurés. Ils représentent donc davantage le type soudanais primitif, au moral comme au physique.
Les Mandé du Centre offrent dans leur ensemble une homogénéité moins parfaite que les Mandé du Nord, peut-être simplement parce qu’ils sont beaucoup plus nombreux et ont dû se séparer, dès les débuts de la période historique, en des courants divers de développement politique et social. Tous cependant ont en commun, avec tous les autres Noirs du Soudan non islamisés d’ailleurs, un très profond attachement au sol natal et, quelles que soient leurs différences de caractère, tous sont avant tout et par dessus tout agriculteurs ; ceux demeurés les plus primitifs et les plus individualistes, comme certains Malinké, sont également chasseurs ; le commerce semble peu en honneur chez eux et ne dépasse pas en général les limites d’échanges purement locaux, nécessités par les besoins journaliers de l’alimentation ; par contre les professions manuelles, soit qu’elles demeurent le privilège de castes spéciales, soit qu’elles soient ouvertes à tous, absorbent une part notable de leur activité. Les Kâgoro et les Banmana se montrent entre tous énergiques et travailleurs ; les Malinké et les Foulanké, plus intelligents peut-être et moins têtus, sont aussi de caractère plus guerrier, quoique les Banmana aient prouvé, dans le passé[348] comme dans le présent, qu’ils peuvent devenir aussi bien que les Malinké, sinon aussi vite, les meilleurs soldats du monde ; le petit peuple des Khassonkè semble être, de tous les Mandé du Centre, le moins doué d’énergie, le plus mou, mais aussi le plus malléable.
Chez les Mandé du Sud, par contre, — au moins chez ceux du Haut-Sénégal-Niger — nous rencontrons la plus grande diversité, ce qui ne doit point nous étonner si nous réfléchissons à la façon dont se sont constituées les petites fractions dispersées de ce groupe mal défini. Les Diallonké ne diffèrent pas très sensiblement des Malinké qui les avoisinent ; les Samo, cultivateurs et chasseurs, rappellent par beaucoup de côtés les Banmana auxquels ils rattachent en partie leur origine, bien que le voisinage des populations voltaïques ait eu sur eux une influence considérable ; de même, les Samorho ne se distinguent pas toujours très aisément des Sénoufo et des Bobo qui les entourent et les Sia se sont souvent presque identifiés avec les Dioula.
Les Sénoufo sont par excellence des hommes de la glèbe ; ils rappellent beaucoup les Banmana, mais apparaissent comme des Banmana demeurés très primitifs. Profondément attachés au sol, travailleurs patients et méthodiques, de goûts simples et frustes, résignés avec fatalisme, se soumettant facilement aux ordres de l’autorité comme aux coups du sort quand ils ne peuvent faire autrement mais s’y soustrayant par la fuite ou la force d’inertie lorsqu’ils en ont la faculté, sujets à des accès de colère sauvage comme il arrive aux gens habituellement froids et calmes, d’une intelligence généralement au-dessous de la moyenne mais cultivable et capable de progresser au contact d’un milieu favorable, très arriérés quant à la civilisation extérieure mais adroits de leurs mains et aptes aux travaux industriels comme aux travaux agricoles, peu idoines par contre aux opérations commerciales, par dessus tout calmes et patients, ils constituent un peuple éminemment propre à fournir la main-d’œuvre sans initiative mais facilement dirigeable dont le développement d’un pays neuf a surtout besoin.
Beaucoup des traits du caractère sénoufo se retrouvent chez[349] les peuples de la famille voltaïque, notamment l’attachement au sol et les aptitudes agricoles et industrielles, mais l’étendue considérable du domaine de cette famille et les conditions d’existence variées qui se présentent sur les différentes parties de ce domaine ont amené des spécialisations dans le caractère moral des divers groupes comme dans les manifestations extérieures de leur civilisation. — Le groupe tombo se distingue entre tous par son amour farouche de l’indépendance, les qualités qu’il a montrées durant des siècles pour la conserver et le succès qui a couronné ses efforts ; on pourrait presque résumer sa politique nationale dans cette phrase : « Nous n’allons pas chez les autres, les autres ne viendront pas chez nous. » — Les peuples du groupe mossi sont loin de présenter tous les mêmes caractères : les Mossi proprement dits, les Yansi et les Gourmantché montrent une énergie guerrière et une faculté dominatrice qui semble manquer souvent aux Nankana et aux Dagari, en même temps qu’ils sont notablement plus avancés en civilisation que ces derniers ; quant aux Birifo, leurs caractères moraux comme leurs caractères physiques sont si analogues à ceux des Lobi qu’on les distinguerait difficilement de ceux-ci, n’était qu’ils parlent la même langue que les Dagari. — Le groupe gourounsi au contraire présente une certaine homogénéité ; plus farouches et plus primitifs que les Mossi, plus jaloux de se garder de tout contact étranger, plus individualistes aussi, les peuples de ce groupe manifestent les mêmes aptitudes agricoles et la même énergie guerrière ; s’ils n’ont pu réussir comme les Mossi à constituer des états forts et puissants et s’ils ont eu souvent à pâtir des razzias de leurs voisins, cela tient, non pas à une apathie individuelle inexistante, mais au contraire à un sentiment d’individualisme trop marqué qui les a toujours empêchés de s’unir en vue de résister à un ennemi commun. — Le groupe bobo présente des analogies morales très étroites avec le peuple sénoufo, mais fait preuve d’une tendance plus accentuée vers l’individualisme et l’isolement. — Les Lobi, comme les Birifo, sont des paysans guerriers : agriculteurs remarquables et chasseurs habiles, ils ne vont aux champs qu’armés de leurs flèches aussi bien que[350] de leurs instruments de labour ; en fait, on ne les conçoit pas sans leurs armes : non contents de vider par la guerre les petites querelles de tribu à tribu ou de village à village, ils en arrivent à s’attaquer de maison à maison et leur vie se passe sur un perpétuel qui-vive ; si étrange que cela puisse paraître, ces conditions d’existence ne semblent pas influer de manière notable sur leur calme insouciance habituelle non plus que sur la prospérité relative de leur pays, qui renferme des champs aussi bien tenus que ceux des Sénoufo. Comme les Mossi et les Dagari, les Lobi possèdent d’assez jolis troupeaux, mais, pas plus que les Mossi ni les Dagari, ils ne peuvent être considérés comme des éleveurs. Les Pougouli, les Dian et les Gan semblent d’un naturel plus paisible que les Lobi et les premiers se livrent volontiers au commerce. — Les Lorho sont trop peu nombreux pour avoir conservé une individualité nationale bien marquée. — Les Bariba allient à l’énergie physique et guerrière des Mossi et des Lobi le caractère individualiste des Gourounsi, moins nettement prononcé peut-être chez eux que chez les Soumba.
Pour nous résumer, nous pouvons dire que la population du Haut-Sénégal-Niger se partage en deux grandes fractions, numériquement très inégales. Dans le Nord, d’une façon générale, habitent des peuples appartenant à la race blanche ou ayant subi plus ou moins l’influence des familles de race blanche, musulmans pour la plupart, les uns nomades ou semi-nomades, les autres sédentaires mais se déplaçant sans difficulté et voyageant beaucoup, adonnés à l’élevage ou au commerce plutôt qu’à l’agriculture, d’un niveau intellectuel relativement élevé et d’une civilisation extérieure relativement avancée ; ces peuples (Maures, Touareg, Peuls, Toucouleurs, Songaï, Mandé du Nord) forment ensemble le quart environ de la population totale de la colonie. Les trois autres quarts, professant à peu près exclusivement la religion animiste et appartenant tous uniquement à la race noire, peuplent d’une manière générale le Sud de la colonie et la plupart des régions où la densité de la population est la plus considérable ; tous agriculteurs et sédentaires, souvent chasseurs, ils ne s’éloignent pas[351] volontiers de leur sol natal, ont peu de contact avec les populations voisines, ne se sont guère laissé pénétrer par elles et sont par suite demeurés plus proches de l’état primitif de la race nègre : ce sont les Mandé du Centre et du Sud, les Sénoufo et les nombreux peuples de la grande famille voltaïque.
[352]
| Delafosse | Planche XII |
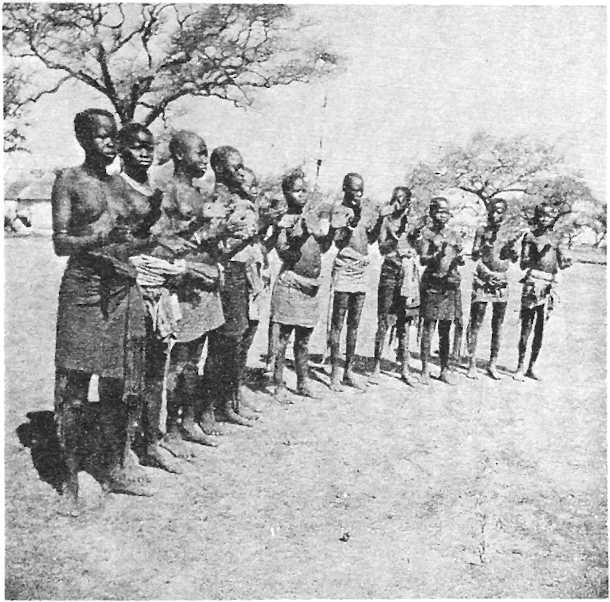
Cliché Froment
Fig. 23. — Groupe de femmes Mossi.
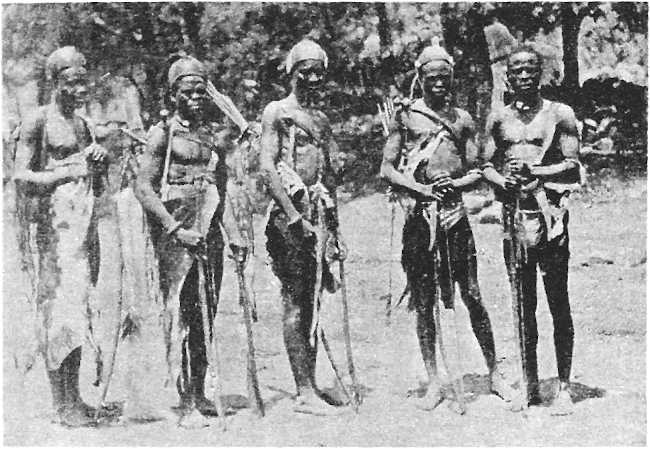
Cliché Bouchot
Fig. 24. — Guerriers Nankana.
[353]TROISIÈME
PARTIE
Les langues.
[357]CHAPITRE PREMIER
Classification et répartition des langues du Haut-Sénégal-Niger
I. — Nomenclature et classification.
J’ai parlé suffisamment, je crois, de la formation historique des diverses langues du Haut-Sénégal-Niger, en traitant des origines des peuples, pour n’avoir pas à y revenir ici et je me contenterai pour l’instant d’examiner ces idiomes, tels qu’ils existent actuellement, et de rechercher comment il convient de les classer.
Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire plus haut, une classification linguistique est beaucoup plus aisée à établir qu’une classification ethnique ; si celle que je vais proposer en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger ne peut être considérée que comme une ébauche provisoire, cela tient seulement à l’état encore trop rudimentaire de notre documentation à l’égard d’un certain nombre de langues et dialectes.
J’ai cru devoir adopter une terminologie qui corresponde, au moins pour la généralité des cas, à celle employée dans ma classification ethnique. J’ai donc réparti les idiomes divers entre plusieurs familles linguistiques qui peuvent se subdiviser en groupes, ces derniers se composant de langues qui, à leur tour, comprennent des dialectes et des sous-dialectes.
J’entends par « famille linguistique » un ensemble de langues[358] qui, quoique souvent très différentes les unes des autres au point de vue grammatical et surtout à celui du vocabulaire, peuvent cependant être rapportées toutes à une origine commune et présentent entre elles des analogies de principe nettement définies. Il peut se faire qu’une famille n’ait pas cessé de conserver une parfaite homogénéité ; il peut se faire aussi que, dans le cours des âges, soit par suite des différences des milieux dans lesquels ont évolué ses diverses fractions, soit en raison d’influences étrangères qui se sont exercées plus ou moins selon les endroits, divers courants se soient formés dans une même famille, dont les aboutissements constituent ce que j’appelle des « groupes » : l’origine initiale des divers groupes d’une famille est commune, mais la formation de chacun s’est accomplie selon un processus spécial.
J’appelle « langue » un idiome qui a des caractéristiques suffisantes pour vivre son existence propre au milieu des langues voisines et former une unité à part ; les différentes langues d’un même groupe, et même celles de deux groupes d’une même famille, sont évidemment parentes, tant par leur vocabulaire que par leur syntaxe et leur morphologie, mais elles constituent cependant des idiomes distincts, à tel point qu’un individu parlant l’une de ces langues ne comprendra pas, à moins d’études spéciales ou d’un contact prolongé, les gens parlant l’une des autres. Mais deux idiomes ne présentant entre eux que des différences toutes superficielles, différences consistant en expressions ou locutions d’une spécialisation toute locale et surtout en variantes phonétiques, ne constituent pas deux langues distinctes : ce ne sont plus que des « dialectes » d’une même langue ; deux individus parlant chacun l’un de ces dialectes pourront, avec plus ou moins de facilité, se comprendre entre eux, au moins en gros, dès leur premier contact. Enfin des différences encore moins profondes, encore plus localisées, n’arrivent à constituer que de simples « sous-dialectes ».
D’une façon générale mais non absolue, une famille linguistique correspond le plus souvent à une famille ethnique, un groupe linguistique à un groupe ethnique, une langue à un peuple, un dialecte à une tribu ou à une fraction géographique[359] d’un peuple, un sous-dialecte à une sous-tribu ou sous-fraction. Mais je ne saurais trop insister sur ce point qu’une telle correspondance est sujette en l’état actuel à de nombreuses exceptions : tel peuple en effet ou telle fraction de peuple, appartenant dans son ensemble à une famille ethnique donnée, peut parfaitement avoir abandonné sa langue propre pour adopter celle d’un peuple appartenant à une autre famille : je citerai seulement deux cas typiques, celui des Peuls d’origine sémitique parlant aujourd’hui une langue nègre et celui des Soninké de Dienné qui ne parlent plus que le songaï. D’autre part, un peuple originellement unique peut s’être subdivisé en plusieurs peuples aujourd’hui distincts, sans pour cela que la langue mère se soit subdivisée en autre chose que de simples dialectes : c’est le cas des Banmana, des Malinké et des Dioula, dont l’ensemble constitue trois peuples différents au point de vue ethnique, bien que les idiomes parlés par eux ne soient que des dialectes d’une même langue. Enfin il peut arriver que deux tribus n’appartenant pas au même peuple parlent deux sous-dialectes d’un même dialecte, tandis que deux tribus d’un même peuple peuvent parler deux dialectes si différents qu’ils mériteraient presque d’être considérés comme deux langues distinctes : certains Malinké du Ouassoulou par exemple parlent, avec des différences à peine perceptibles, le même dialecte que les Dioula, tandis que certains Malinké de la Gambie parlent un dialecte nettement distinct du malinké du haut Niger. Il y a là toute une série de phénomènes assez complexes dans lesquels les raisons d’ordre historique, géographique et surtout économique ont joué un rôle bien plus considérable que les causes d’ordre purement ethnique.
Il me faut rappeler en outre qu’une famille linguistique, comme une famille ethnique, peut très bien ne se composer que d’un groupe unique ; parfois même elle ne comprend qu’une seule langue. D’autres fois, nous rencontrerons des familles qui, quoique riches en groupes et en langues, ne sont représentées dans la région qui nous occupe que par l’un seulement de leurs groupes ou par une de leurs langues.
Divers essais de classification des langues de l’Afrique Occidentale[360] ont été tentés ; jusqu’à ces derniers temps, ils n’étaient guère basés que sur des comparaisons de mots et étaient souvent, ou arbitraires, ou purement géographiques. Tout récemment l’école allemande, représentée notamment par Hartmann, Lippert, Meinhof, Struck et Westermann pour le domaine des langues africaines, a jeté les bases d’une classification plus rationnelle[249]. Les derniers travaux de quelques maîtres de cette école répartissent les langues de l’Afrique — Madagascar et les parlers créoles non compris — en cinq familles : sémitique, hamitique (à laquelle sont rattachées les langues hottentotes), bantoue, soudanaise et buschmann. En ce qui concerne les langues du Haut-Sénégal-Niger, la même école les classe dans les trois familles sémitique, hamitique et soudanaise, en rattachant le peul, comme le touareg, à la famille hamitique. Il y a là un point qui me semble absolument inadmissible, je veux parler du rattachement à la famille hamitique de la langue peule, qui ne présente à peu près aucune des caractéristiques des langues hamitiques et dont au contraire toutes les caractéristiques principales se retrouvent dans les langues proprement nègres, soit soudanaises soit bantoues[250].
D’autre part il me paraît un peu prématuré de ranger dans une famille unique des langues telles que le ouolof, le songaï, le mandingue et le mossi, pour ne parler que de celles se rattachant au sujet du présent ouvrage : assurément ces diverses langues, comme le peul d’ailleurs, offrent ensemble bien des points communs, mais le plus souvent elles n’en offrent pas plus les unes vis-à-vis des autres que chacune d’elles n’en présente vis-à-vis des langues bantoues ; toutes sont des langues nègres, mais c’est là leur seul trait d’union. Si l’on veut tenir compte de ce trait d’union, il faudrait adopter une « famille nègre », dans laquelle le bantou ne constituerait qu’un seul groupe, au même titre que le mandé par exemple. Mais je préfère subdiviser la « famille soudanaise » de MM. Struck et Westermann,[361] qui n’est en somme qu’un groupement surtout géographique, en un certain nombre de familles linguistiques réelles, dont chacune mérite à mon sens ce nom de « famille », au même titre que la famille bantoue ou, dans un autre domaine, la famille sémitique.
Certains membres de l’école allemande ont cru aussi devoir rattacher le haoussa à la famille hamitique : je me permettrai, là encore, de ne pas partager leur manière de voir ; je ne nie aucunement l’empreinte considérable exercée par les langues hamitiques sur le haoussa, empreinte que j’ai signalée moi-même à diverses reprises ; mais je considère le haoussa, non pas comme une langue hamitique influencée par des langues soudanaises — théorie de M. Meinhof —, mais comme une langue nègre influencée par le voisinage des langues hamitiques, ce qui est assez différent.
Quoi qu’il en soit, mes études personnelles m’ont amené à répartir entre sept familles linguistiques distinctes les langues parlées actuellement par les indigènes de la colonie civile du Haut-Sénégal-Niger. Si nous y ajoutons les langues les plus importantes parlées par les étrangers (ouolof et haoussa), nous arrivons au total de neuf familles linguistiques pour un pays peuplé de moins de cinq millions d’habitants : ce total peut paraître énorme, mais il n’étonnera pas ceux qui ont étudié la question sur place et qui savent quelle tour de Babel est l’Afrique Occidentale. Encore la colonie du Haut-Sénégal-Niger est-elle relativement moins richement partagée, sous le rapport de la diversité des langues, que certaines autres colonies voisines ; la Côte d’Ivoire en particulier, à laquelle on n’attribue guère plus de deux millions d’habitants, abrite à elle seule six familles linguistiques distinctes, sans compter les langues étrangères.
Les neuf familles linguistiques du Haut-Sénégal-Niger sont :
1o la famille sémitique, représentée par une seule de ses langues, l’arabe ;
2o la famille hamitique, représentée par deux langues du groupe berbère : le zenaga et le tamacheq ou langue des Touareg ;
3o la famille tekrourienne, qui ne renferme à ma connaissance[362] qu’une seule langue : le foulfouldé ou poular, ou langue des Peuls et des Toucouleurs ;
4o la famille songaï, qui ne renferme elle aussi qu’une seule langue : le songaï ;
5o la famille mandé, représentée par ses trois groupes[251] :
A. groupe mandé-tamou (deux langues : bozo et soninké) ;
B. groupe mandé-tan (deux langues : kâgoro[252] et mandé proprement dit ou mandingue, avec ses quatre dialectes banmana, khassonkè, malinké et dioula)[253] ;
C. groupe mandé-fou (trois langues : soussou ou diallonké, samorho et sia, et quatre dialectes mal définis : le blé, le natioro, le ouara et le sembla)[254] ;
6o la famille sénoufo, qui ne renferme qu’une seule langue, le sénoufo, possédant de nombreux dialectes dont dix au moins parlés au Haut-Sénégal-Niger (le bamâna ou dialecte des Minianka, le siénérhè, le tagba, le mbouin, le karaboro, le komono, le nanergué, le folo, le tourka et le sémou)[255] ;
7o la famille voltaïque, représentée par ses sept groupes :
[363]A. groupe tombo (trois langues : tombo, dogom et déforo) ;
B. groupe mossi (quatre langues parlées au Haut-Sénégal-Niger : le môrhé ou mossi (auquel se rattachent le dialecte mossi parlé par les Samo et le dialecte des Yansi), le gourmantché, le nankana et le dagari (auquel se rattache le dialecte birifo)[256] ;
C. groupe gourounsi (trois langues parlées au Haut-Sénégal-Niger : le nounouma (auquel se rattache sans doute le dialecte des Nioniossé), le sissala et le boussansé)[257] ;
D. groupe bobo, ne renfermant qu’une seule langue, le bobo (quatre dialectes : kian, tara, boua et niénigué) ;
E. groupe lobi : deux langues, le lobi et le dian, plus deux dialectes, le gan et le pougouli, qui se rattachent vraisemblablement à la langue dian ;
F. groupe koulango : une seule langue, le koulango, représentée au Haut-Sénégal-Niger par le dialecte lorho ;
G. groupe bariba : deux langues parlées au Haut-Sénégal-Niger, le bariba et le soumba, ce dernier représenté par le dialecte takamba[258].
8o la famille sénégalaise, représentée par l’un de ses groupes, le groupe ouolof, qui ne comprend lui-même qu’une langue, le ouolof, parlée au Haut-Sénégal-Niger par des colonies ouoloves assez nombreuses[259] ;
9o la famille nigéro-logonaise[260], représentée par la principale[364] de ses langues, le haoussa, parlée par quelques colonies haoussa et de nombreux voyageurs et commerçants.
Il y a lieu d’ajouter à cette liste les cinq dialectes parlés par les Padorho, les Dorhossié, les Tiéfo, les Toussia et les Vigué, dialectes qui sont à rattacher probablement soit à la famille sénoufo soit à la famille voltaïque.
Cela porte le nombre des idiomes parlés dans le Haut-Sénégal-Niger à 31 langues et à 30 dialectes connus, sans compter les dialectes qui restent à découvrir et les nombreux sous-dialectes locaux.
II. — Répartition géographique, ethnique et numérique[261].
Nous allons examiner maintenant de quels groupements ethniques les langues et dialectes énumérés ci-dessus sont les idiomes nationaux et en même temps quel est le domaine géographique propre de chaque famille ou groupe linguistique ; nous chercherons aussi à définir le domaine réel de certaines langues qui sont parlées par d’autres indigènes que ceux dont elles constituent l’idiome maternel.
1o Famille sémitique (arabe). — L’arabe est parlé dans l’Azaouad, le Hodh et le Nord du Sahel : il y est la langue maternelle, non seulement des Maures d’origine arabe (Kounta, Bérabich et Beni-Hassân), mais aussi de la presque totalité des Maures d’origine berbère, qui ont depuis longtemps abandonné l’usage du zenaga, ainsi que de tous les Harrâtîn. De plus l’arabe est parlé, en outre de leur langue propre, par les Soninké Azer habitant les localités sahariennes et par beaucoup de Songaï et de Touareg de Tombouctou et des environs de cette ville ; il est compris en outre par un certain nombre de Songaï, de Soninké, de Peuls, etc., habitant dans le voisinage des Maures et entretenant avec eux des relations commerciales. Toutefois le domaine de l’arabe, en tant que langue parlée tout au moins, est fort restreint dans le Haut-Sénégal-Niger ; si son[365] aire géographique est étendue, il ne faut pas oublier qu’elle couvre surtout des régions à peu près inhabitées, et il convient de se souvenir qu’il est rare de trouver au Soudan des gens parlant l’arabe en dehors des Maures. On peut estimer à 120.000 au maximum le nombre des indigènes de la colonie parlant l’arabe, dont 104.000 Maures et Harrâtîn dont il est la langue maternelle, 10.000 Soninké de la zone saharienne et 6.000 individus de familles ethniques diverses. — Il est à noter que les Maures du Hodh donnent à la langue qu’ils parlent le nom de hassânia ou hassâni (langue des Beni-Hassân) et non pas le nom de arabia (langue arabe) ; ils réservent cette dernière expression pour l’arabe littéral.
2o Famille hamitique (groupe berbère). — Le zenaga est encore parlé par quelques fractions des Maures de la Mauritanie, notamment dans les sous-tribus maraboutiques des Oulad-Daïmân et des Idao-el-hadj, mais, dans la partie du Hodh dépendant du Haut-Sénégal-Niger, bien rares sont les familles ayant conservé l’usage du berbère. Il s’en rencontre cependant quelques-unes chez les Idao-Aïch et peut-être chez d’autres tribus, sans que le nombre des gens parlant le zenaga dans le Haut-Sénégal-Niger dépasse vraisemblablement 3 à 4.000 individus au grand maximum. Mais, si le zenaga a à peu près disparu du Sahara Soudanais en tant que langue vivante, son empreinte y est demeurée profonde : on la retrouve dans les noms de lieux, presque tous berbères, et dans les termes nombreux qu’elle a fait passer dans l’arabe hassânia, ainsi que, bien qu’à un degré moindre, dans quelques langues nègres (le soninké notamment).
Le tamacheq ou tamacherht au contraire n’a pas disparu : il est encore parlé par tous les Touareg et leurs Iklân ou Bella. En dehors des gens dont il constitue la langue maternelle, il semble n’être compris que de très rares individus. On peut donc estimer à 60.000 au maximum (dont 57.000 Touareg et Bella) le nombre des indigènes du Haut-Sénégal-Niger parlant le tamacheq.
3o Famille tekrourienne (peul). — Le peul, qu’il serait peut-être plus logique d’appeler le toucouleur, est parlé à la fois par[366] les quelque 38.000 Toucouleurs qui se sont installés dans le Haut-Sénégal-Niger et par les 404.700 Peuls, Rimaïbé et Silmimossi. Le domaine de cette langue est géographiquement très étendu en raison de l’éparpillement des Peuls à travers le Soudan, mais il est, comme le domaine de ce peuple lui-même, excessivement morcelé. De plus, il est assez rare que le Peul soit compris par des gens dont il n’est pas la langue maternelle : c’est une langue répandue en beaucoup de régions du Soudan parce qu’on rencontre des Peuls un peu partout, mais ce n’est pas une langue d’échange. On peut estimer à 450.000 environ le nombre des individus parlant le peul dans le Haut-Sénégal-Niger, dont 443.000 pour lesquels il constitue la langue maternelle.
Bien que la langue peule soit une, elle renferme, en raison même de la dispersion des gens qui la parlent, un nombre assez considérable de dialectes : le plus pur de tous semble être celui parlé par les Toucouleurs, qui observent beaucoup plus scrupuleusement que la généralité des Peuls les règles morphologiques et syntaxiques les plus caractéristiques de la langue ; parmi les dialectes spéciaux qui se sont créés chez les Peuls du Haut-Sénégal-Niger, on peut citer ceux du Sahel, du Massina, de la haute Volta Noire, des pays mossi, du Liptako, etc. Enfin il convient de mentionner une sorte de dialecte banal, participant un peu de tous les autres, employé par les Peuls et Toucouleurs qui voyagent beaucoup ; ce dialecte banal leur permet de se faire comprendre aisément dans les diverses régions qu’ils traversent.
4o Famille songaï (langue songaï). — Le songaï se présente sous un tout autre aspect que celui du peul : les Songaï proprement dits (Arma, Sorko et Gabibi) ne dépassent guère le nombre de 100.000 au Haut-Sénégal-Niger (101.582 d’après les recensements de 1909). Mais je ne crois pas m’avancer trop en disant qu’ils forment à peine le quart de la population parlant leur langue. Tout d’abord le songaï est devenu la langue maternelle d’un nombre appréciable de Soninké à Dienné et dans la région du Massina ; de plus il est parlé et compris, en outre de leurs[367] langues propres, par presque tous les indigènes habitant à proximité du Niger depuis Mopti jusqu’à Say : Bozo, Soninké, Banmana, Tombo, Peuls, Touareg, etc. Il constitue dans toute cette région une véritable langue internationale, la koïra-kiné ou « langue du pays », dont on use pour toutes les relations commerciales ou politiques. Je croirais volontiers que plus de 400.000 indigènes du Haut-Sénégal-Niger comprennent couramment le songaï.
5o Famille mandé. — Le bozo n’est sans doute guère parlé que par les Bozo eux-mêmes, c’est-à-dire par 15.000 individus environ. Il se divise cependant en plusieurs dialectes, notamment ceux de Dia, du Massina et du Pondori, plus un dialecte mélangé de banmana et de songaï qui est parlé dans la région du Bara et près de Niafounké.
Le soninké, non seulement n’est pour ainsi dire pas parlé en dehors des Soninké, mais n’est même pas parlé par tous les Soninké : sur les 245.392 individus représentant ce peuple dans le Haut-Sénégal-Niger, plus de 40.000 ont abandonné leur langue pour le dioula (ceux de la Boucle du Niger et notamment du Dafina), 10.000 au moins l’ont abandonnée pour le songaï (cercles de Dienné, Mopti, Niafounké), plus de 30.000 pour le banmana (cercles de Koutiala, San, Ségou, Bamako, etc.) et environ 10.000 pour le malinké (Sud du cercle de Kayes notamment) ; en sorte qu’il n’en demeure guère que 135.000 ayant conservé l’usage de leur langue. Chose digne de remarque, ceux qui se trouvent isolés parmi les Maures sont restés plus fidèles à leur idiome national que ceux qui se sont répandus dans le Sud et l’Est du Soudan.
Le kâgoro n’est plus parlé aujourd’hui que par une dizaine de milliers d’individus au maximum ; la plupart des Kâgoro d’ailleurs parlent le dialecte banmana (Kaarta et Kaniaga), et quelques-uns le soninké (Bakounou), en outre de leur langue.
Quant au mandingue, comprenant les quatre dialectes khassonkè, banmana, malinké et dioula, il est la langue maternelle d’environ 1.070.000 indigènes du Haut-Sénégal-Niger : 11.191 Khassonkè, 538.450 Banmana, 146.733 Malinké, 106.066 Foulanké[368] parlant le dialecte malinké, 218.820 Dioula, 8.450 Boron et plus de 40.000 Soninké parlant le dialecte dioula. Mais ce n’est pas tout : dans toutes les régions où les Mandé du Centre ou les Dioula forment la majorité de la population, c’est-à-dire dans les cercles de Sokolo, Ségou, Bamako, Kita, Bafoulabé, Kayes, Satadougou, Bougouni, Sikasso, la langue mandingue s’est propagée avec une telle force qu’elle est comprise et parlée par l’immense majorité, sinon la totalité, des autres habitants, en outre de leurs idiomes respectifs (arabe, peul, soninké, kâgoro, soussou, samorho, sénoufo) ; de plus, le banmana s’est répandu dans de nombreux districts du Sahel et de la rive droite du Bani où cependant les Banmana ne sont qu’en nombre relativement restreint ; le dioula est devenu la langue commerciale de presque toute la moitié occidentale de la Boucle du Niger, au Sud du domaine du songaï ; enfin il s’est constitué dans le Sud-Ouest de la Boucle et dans la vallée du haut Niger une sorte de dialecte banal qu’on appelle kan-gbê « la langue blanche, la bonne langue », sorte de synthèse de la langue mandingue que parlent tous les voyageurs et que tout le monde comprend plus ou moins le long des grandes voies commerciales. Aussi je crois demeurer encore au-dessous de la vérité en estimant à 1.500.000 au minimum le nombre des indigènes du Haut-Sénégal-Niger possédant l’usage de la langue mandingue, c’est-à-dire presque au tiers de la population totale de la colonie.
Le soussou n’est parlé que par les 9.824 Diallonké des cercles de Satadougou et de Kita, le samorho par les 23.705 Samorho des cercles de Sikasso et de Bobo-Dioulasso, le sia par 6.000 individus, le blé par 1.035, le natioro par 2.745, le ouara par 7.000 et le sembla par 8.000 ; ces cinq derniers idiomes sont localisés dans le cercle de Bobo-Dioulasso.
6o Famille sénoufo (langue sénoufo). — Le sénoufo est une de ces langues qui ne se sont pas répandues en dehors de leur domaine national ; il n’est parlé au Haut-Sénégal-Niger que par les Sénoufo eux-mêmes, mais, ces derniers atteignant le chiffre de 343.470, il s’ensuit que leur langue est encore l’une des[369] plus parlées de la colonie. Au point de vue de leur importance numérique, les dialectes sénoufo viennent dans l’ordre suivant : bamâna ou minianka 129.312, siénérhè 81.273, mbouin 31.875, folo 23.790, tourka 21.205, karaboro 18.535, tagba, 17.170, nanergué 11.260, komono 5.605 et sémou 3.445.
| Delafosse | Planche XIII |

Cliché Delafosse
Fig. 25. — Groupe de Dioula.
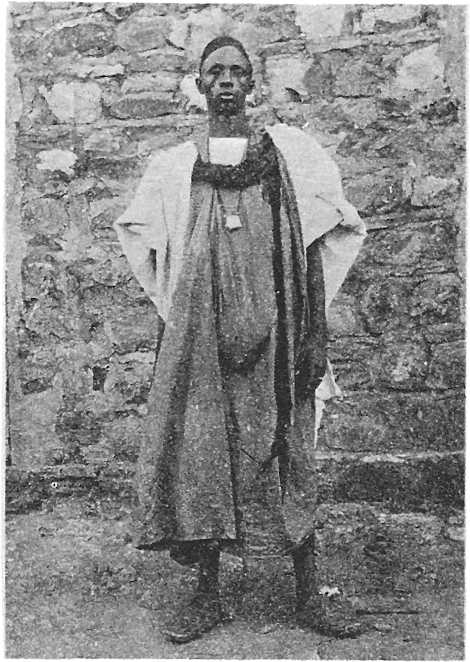
Fig. 26. — Un Khassonkè.
7o Famille voltaïque. — Les langues du groupe tombo sont, semble-t-il, strictement limitées au domaine propre des peuples du groupe ethnique correspondant, c’est-à-dire à la région montagneuse du Nord-Ouest de la Boucle et aux plaines qui l’avoisinent immédiatement. Le tombo y est parlé par 120.000 individus environ, le dogom par 5 à 6.000 et le déforo par 12.000.
Parmi les langues du groupe mossi, le môrhé, ou langue mossi proprement dite, s’est répandu non seulement parmi les 1.262.277 indigènes qui constituent aujourd’hui le peuple mossi, mais encore, avec des variantes dialectales assez peu sensibles, parmi les 48.707 Yansi et le plus grand nombre des 75.232 Samo[262] : il est donc actuellement la langue maternelle de plus de 1.387.000 individus. De plus, il sert de langue courante dans tous les pays où s’est portée l’influence politique des empires du Yatenga et de Ouagadougou et est parlé, en outre de leur langue maternelle, par la presque totalité des Dioula des cercles de Ouahigouya et Ouagadougou (105.000 environ), par les Silmimossi (15.000 au minimum), par un grand nombre de Peuls et de Rimaïbé (20.000 environ), de Nioniossé (20.000 environ) et de Boussansé (25.000 environ). En dehors des zones habitées ou gouvernées par les Mossi eux-mêmes, leur langue est comprise encore par beaucoup de commerçants soninké, dioula et haoussa, et par beaucoup d’indigènes dont les idiomes nationaux sont très voisins du mossi (Gourmantché, Nankana, Dagari). On peut donc évaluer à 1.600.000 environ le nombre des habitants de la colonie parlant le mossi, ce qui place cet idiome, par ordre d’importance numérique, au même rang que le mandingue et même un peu au-dessus de cette dernière[370] langue. Toutefois, au point de vue de l’aire géographique d’extension et de l’importance en tant que langue d’échange international, le mandingue vient incontestablement au premier rang. — Le gourmantché est parlé par 150.000 individus environ, le nankana par 20.000 et le dagari, en y comprenant le dialecte birifo, par plus de 105.000.
Les différents dialectes qui se rattachent à la langue nounouma (dialectes des Nioniossé, des Kipirsi, des Nounouma proprement dits, etc.) sont parlés, à titre de langue nationale, par plus de 150.000 individus et, de plus, en outre de leur langue propre, par un certain nombre de Dagari et de Pougouli : on peut chiffrer à 160.000 le nombre des indigènes parlant cette langue. Le boussansé est la langue maternelle de plus de 105.000 individus ; le sissala n’est guère compris que par 7 à 8.000 indigènes.
Le bobo ne s’est pas répandu beaucoup en dehors des Bobo eux-mêmes ; on peut donc évaluer à 228.000 environ le nombre des individus parlant cette langue. Le dialecte tara vient en tête, parlé par plus de 102.000 Bobo-Oulé ; le boua vient ensuite avec plus de 62.000 Bobo-Fing, puis le kian avec 36.666 Bobo-Gbê et enfin le niénigué avec 24.817 Bobo-Niénigué.
Les langues et les dialectes du groupe lobi ne sont guère compris que des peuples ou tribus dont ils constituent les idiomes nationaux, soit 62.050 individus pour le lobi, 5.950 pour le dian proprement dit, 5.550 pour le pougouli et 1.100 seulement pour le gan (cercle de Gaoua).
Le dialecte lorho de la langue koulango n’est représenté que par les 4.000 Lorho du cercle de Gaoua.
Les langues du groupe bariba ne sont parlées au Haut-Sénégal-Niger que par 5.000 indigènes environ, dont 4.497 Bariba, et 540 Takamba de langue soumba.
Les dialectes des tribus non classées des cercles de Bobo-Dioulasso et Gaoua n’ont qu’une assez médiocre importance : le toussia est parlé par 10.045 individus, le dorhossié par 3.700, le vigué par 2.790, le tiéfo par 2.000 et le padorho par 500.
8o Famille sénégalaise (ouolof). — La langue ouolove n’a[371] qu’une extension très restreinte dans le Haut-Sénégal-Niger : en dehors des 3.205 Ouolofs établis à demeure en divers points de la colonie, elle est comprise par quelques autres étrangers originaires du Sénégal et par un certain nombre de Toucouleurs et Soninké du cercle de Kayes ; elle est surtout en usage parmi les bateliers qui font le service de la navigation entre Kayes et Saint-Louis. Au total, je ne crois pas qu’elle soit comprise par plus de 6 à 7.000 indigènes du Haut-Sénégal-Niger.
9o Famille nigéro-logonaise (haoussa). — Il en est tout autrement du haoussa : les Haoussa établis à demeure dans la colonie ne sont pas nombreux, mais ceux qui y voyagent pour affaires et qu’on appelle généralement Maraba dans la Boucle du Niger le sont bien davantage, qu’ils viennent du Haoussa propre en traversant le Niger du côté de Say ou de leurs très importantes colonies de la Côte d’Or et du haut Togo. Leur langue en tout cas s’est largement répandue dans le Sud-Est de la Boucle, où elle fait suite au mandingue comme langue d’échange, la limite entre les deux zones d’extension passant à peu près par le méridien de Ouagadougou. Le haoussa est la langue des marchés et l’idiome des voyageurs dans une partie du Gourounsi, dans l’Est du Mossi et surtout chez les Boussansé et dans les cercles de Fada-n-Gourma et de Say. L’évaluation du nombre des indigènes du Haut-Sénégal-Niger comprenant le haoussa est assez difficile ; je crois pourtant pouvoir estimer ce nombre à une centaine de milliers d’individus au minimum.
Statistiques comparées. — Si nous voulons maintenant résumer en quelques tableaux comparatifs les données qui viennent d’être exposées, nous trouverons que les neuf familles linguistiques se présentent au Haut-Sénégal-Niger, par rang d’importance, dans l’ordre suivant, en ne tenant compte que des individus, tribus ou peuples dont la langue maternelle appartient à chacune des familles indiquées :
| 1o | famille | voltaïque, | avec environ | 2.385.000 | ressortissants. |
| 2o | — | mandé, | — | 1.290.000 | — |
| 3o | — | tekrourienne, | — | 443.000 | — |
| [372]4o | — | sénoufo, | — | 344.000 | — |
| 5o | — | songaï, | — | 111.000 | — |
| 6o | — | sémitique, | — | 105.000 | — |
| 7o | — | hamitique, | — | 60.000 | — |
| 8o | — | sénégalaise, | — | 4.000 | — |
| 9o | — | nigéro-logonaise, | — | 2.000 | — |
Si maintenant l’on tient compte du nombre total des gens comprenant chaque idiome, que celui-ci soit ou non leur parler maternel, les 31 langues en usage au Haut-Sénégal-Niger se classent comme suit :
| 1o | mossi | 1.600.000 | (dont 1.262.277 Mossi propres). |
| 2o | mandingue | 1.500.000 | (dont 1.029.710 Mandé du Centre et Dioula). |
| 3o | peul | 450.000 | |
| 4o | songaï | 400.000 | (dont 101.582 Songaï seulement). |
| 5o | sénoufo | 344.000 | |
| 6o | bobo | 228.000 | |
| 7o | nounouma | 160.000 | |
| 8o | gourmantché | 150.000 | |
| 9o | soninké | 135.000 | (sur 245.392 Soninké). |
| 10o | arabe | 120.000 | |
| 11o | tombo | 119.000 | |
| 12o | dagari | 106.000 | |
| 13o | boussansé | 105.000 | |
| 14o | haoussa | 100.000 | (dont à peine un millier de Haoussa propres). |
| 15o | lobi | 62.000 | |
| 16o | tamacheq | 60.000 | |
| 17o | sia | 25.000 | (en y comprenant les dialectes connexes). |
| 18o | samorho | 24.000 | |
| 19o | nankana | 20.000 | |
| 20o | bozo | 15.000 | |
| [373]21o | dian | 12.500 | (en y comprenant les dialectes connexes). |
| 22o | déforo | 12.000 | |
| 23o | kâgoro | 10.000 | |
| 24o | soussou | 10.000 | (dialecte des Diallonké). |
| 25o | sissala | 8.000 | |
| 26o | ouolof | 7.000 | |
| 27o | dogom | 6.000 | |
| 28o | bariba | 4.500 | |
| 29o | koulango | 4.000 | (dialecte lorho). |
| 30o | zenaga | 3.500 | |
| 31o | soumba | 500 | (dialecte takamba). |
| Dialectes non classés | 19.000 | ||
Enfin il peut être intéressant de connaître quelles sont les langues dominantes dans chacune des circonscriptions administratives. A cet égard, nous constatons que : l’arabe domine dans la zone saharienne et la résidence de Kiffa ; le soninké et le peul dans le cercle de Nioro, avec une tendance du mandingue vers la prédominance ; le mandingue et le soninké dans le cercle de Goumbou, où le peul tient aussi une place importante ; le mandingue dans le cercle de Sokolo ; le peul dans le cercle de Niafounké, le mandingue et le songaï lui disputant la prééminence ; le songaï dans les cercles de Tombouctou et de Hombori, où le tamacheq tient une place importante ; le peul dans le cercle de Dori, avec le mossi, le tamacheq et le déforo comme langues secondaires ; le tombo dans le cercle de Bandiagara, où le peul tient une place assez importante ; le peul dans les cercles de Mopti et de Dienné, avec le mandingue et le songaï comme langues secondaires ; le mandingue dans les cercles de Ségou, Bamako, Kita, Bafoulabé, Kayes, Satadougou et Bougouni ; le mandingue aussi dans le cercle de Sikasso, avec le sénoufo et le samorho comme langues secondaires ; le sénoufo dans le cercle de Koutiala, avec le mandingue comme langue secondaire ; le bobo dans la circonscription de San, avec le mandingue et le sénoufo comme langues secondaires ; le bobo et le mandingue dans le cercle de Koury, avec le peul et le nounouma[374] comme langues secondaires ; le mossi dans les cercles de Ouahigouya et Ouagadougou, avec le mandingue, le peul et le nounouma comme langues secondaires pour les deux cercles et, en plus, le boussansé, le nankana et le haoussa pour le cercle de Ouagadougou ; le gourmantché dans le cercle de Fada-n-Gourma, avec le mossi et le haoussa comme langues secondaires ; le dagari et le lobi dans le cercle de Gaoua, avec plusieurs langues ou dialectes secondaires ; le sénoufo dans le cercle de Bobo-Dioulasso, avec le mandingue, le bobo et de nombreux idiomes comme langues secondaires.
III. — Langues écrites et langues parlées.
1o L’arabe écrit. — Des 31 langues en usage dans le Haut-Sénégal-Niger, une seule mérite le titre de langue écrite : c’est l’arabe. Et encore il serait peut-être plus exact de dire, quelque paradoxal que cela puisse paraître, qu’aucune des 31 langues parlées dans le Haut-Sénégal-Niger, y compris l’arabe, ne mérite le titre de langue écrite, mais que, en plus et en dehors de ces langues, il en existe une 31e qui s’écrit et ne se parle pas : l’arabe écrit. En effet il serait difficile de prétendre que l’arabe hassânia, que parlent les Maures, s’écrive ; au Soudan comme au Maghreb et ailleurs, il existe en réalité deux types de langue arabe : la langue parlée, qui diffère assez notablement selon les régions, tant au point de vue du vocabulaire qu’au point de vue de la phonétique, et que l’on ne peut rendre par l’écriture, et la langue écrite qui, elle, est la même partout, à quelques idiotismes locaux près, et qui n’est jamais parlée, sauf par quelques docteurs prétentieux dans les leçons qu’ils donnent à leurs disciples. On sait que l’arabe parlé élude presque toutes les voyelles brèves, supprime la plupart des flexions désinencielles et par suite les déclinaisons et presque tous les temps et modes des verbes et n’emploie qu’un nombre restreint de vocables et de formes dérivées, tandis que l’arabe écrit, même sous la plume du vulgaire, demeure fidèle à la plupart des règles morphologiques et syntaxiques de la langue littérale. Au Soudan peut-être plus qu’ailleurs, la différence[375] est profonde entre les deux langues, non seulement au point de vue de la grammaire et de la lexicologie, mais aussi relativement à l’usage spécial qui est fait de chacune d’elles.
Les Maures, les Harrâtîn et les quelques milliers de Soninké que j’ai signalés plus haut comme parlant l’arabe ne font usage dans leur conversation que du hassânia, c’est-à-dire d’un dialecte parlé assez impur, fortement mélangé de vocables berbères, mais ne s’éloignant pas énormément par ailleurs du dialecte en usage dans le sud-oranais. Le plus grand nombre d’entre eux ne savent ni lire ni écrire et l’arabe n’existe pour ceux-là qu’en tant que langue parlée. Quant aux docteurs, aux marabouts et à leurs disciples, ils parlent le même hassânia que les autres, mais ils se servent pour écrire de l’arabe correct, auquel ils réservent, comme je l’ai dit précédemment, le nom de arabia. Il n’est pas rare d’entendre un Maure dire en excellent arabe parlé : La ’âref el-’arâbia « je ne sais pas l’arabe », ce qui dans sa pensée veut dire : « Je ne sais pas écrire l’arabe » ou « je serais incapable de comprendre de l’arabe écrit ».
Quant aux Noirs musulmans répandus un peu partout dans la colonie du Haut-Sénégal-Niger, il en est fort peu parmi eux qui soient capables de soutenir une conversation en arabe, alors qu’un très grand nombre lisent avec facilité l’arabe écrit et écrivent eux-mêmes couramment et correctement ; je ne serais même pas étonné que le nombre des lettrés fût, proportionnellement, plus élevé chez les musulmans noirs — les Soninké et les Dioula en particulier — que chez les Maures. Ceux de ces lettrés noirs qui ont acquis une grande pratique de l’arabe écrit et se sont assimilé un nombre assez considérable de mots et de formes, — et ceux-là, je le répète, sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit couramment, — arrivent à parler arabe, avec quelque difficulté, il est vrai, mais en disant ce qu’ils veulent dire ; seulement l’arabe qu’ils parlent est l’arabe écrit et les gens de langue arabe — les Maures dans l’espèce — ne les comprennent pas, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes des lettrés de profession.
Tandis que l’arabe parlé est localisé à peu près au pays des Maures et n’occupe que le dixième rang sur l’échelle de répartition[376] numérique des langues du Haut-Sénégal-Niger, l’arabe écrit possède au contraire une importance considérable : connu et pratiqué par les lettrés musulmans de toutes races, il est la véritable et la seule langue littéraire du Soudan ; sa connaissance permet à des quantités d’indigènes vivant dans un milieu d’ignorance d’acquérir un degré d’instruction relatif mais fort appréciable ; elle développe d’autant mieux leur mentalité que, pour être acquise, elle a nécessité une gymnastique considérable de l’esprit et des efforts prodigieux de mémoire et d’application : il ne faut pas oublier en effet que les étudiants soudanais ne disposent d’aucun dictionnaire ni d’aucune grammaire et que c’est à force de lectures et d’exercices qu’ils arrivent à amasser leur bagage de connaissances littéraires ; si mince que soit ce bagage, je ne puis pour ma part m’empêcher d’admirer les efforts qui ont dû être déployés pour son acquisition. Il est regrettable seulement que les bibliothèques des lettrés soudanais ne renferment guère que des traités d’exégèse religieuse ou des ouvrages relatifs à des formules de prière, des récits de miracles ou des discussions sur des points insignifiants de droit canonique ; l’histoire n’y occupe qu’une place très secondaire, les sciences et la littérature proprement dite en sont complètement exclues.
Au point de vue pratique, la connaissance de l’arabe écrit permet aux lettrés de langues différentes de correspondre facilement entre eux et de se recommander les uns aux autres, par des sortes de sauf-conduits, ceux de leurs amis qui vont voyager dans des pays lointains. Cette facilité de correspondre entre eux est certainement l’une des principales forces des musulmans du Soudan, vis-à-vis des animistes privés de ce moyen de communication comme aussi vis-à-vis de l’autorité européenne. Il paraît bien établi d’autre part que tous les bienfaits d’ordre intellectuel et moral que l’on attribue parfois à l’influence de la religion musulmane sont dûs, non pas à cette religion en elle-même, mais uniquement au fait qu’elle a été l’occasion de la diffusion parmi les Noirs de la connaissance et de l’usage d’une langue littéraire.
Il ne faudrait pas cependant s’exagérer le nombre des Soudanais[377] sachant lire et écrire l’arabe, j’entends de ceux capables de comprendre ce qu’ils lisent et écrivent et de composer quelque chose d’original, ne fût-ce qu’une simple missive, en arabe. Aucune statistique n’a été faite encore à cet égard, mais je crois que, le jour où il sera possible d’en faire une, on s’apercevra que sur les 1.139.000 et quelques musulmans du Haut-Sénégal-Niger, il n’y a guère plus de 20 à 25.000 individus en état d’écrire une lettre renfermant autre chose que des souhaits et des formules de politesse. Je crois également que les deux tiers au moins de ces lettrés appartiennent à la race noire, l’autre tiers étant fourni par les familles maraboutiques du Hodh et de l’Azaouad.
2o Existe-t-il au Haut-Sénégal-Niger des langues écrites en dehors de l’arabe ? — J’ai par avance répondu négativement à cette question. Cependant il serait inexact de dire que l’arabe soit la seule langue du Haut-Sénégal-Niger qui s’écrive : j’ai dit seulement et je maintiens que l’arabe est la seule langue de la colonie méritant le titre de « langue écrite ». On rencontre bien quelques spécimens écrits de quatre autres langues — le tamacheq, le zenaga, le peul et le haoussa —, mais ils sont en trop petit nombre et d’un caractère trop spécial pour que ces langues puissent revendiquer l’appellation de langues écrites, au moins en ce qui concerne le Haut-Sénégal-Niger.
Le tamacheq possède un alphabet spécial, aujourd’hui bien connu, dont les caractères de forme géométrique (cercles, rectangles, lignes droites et points) portent le nom de tifinarh. La connaissance de ces caractères n’est que très peu généralisée chez les Touareg en général et elle est excessivement rare chez les Touareg du Soudan et du Sahara Soudanais. Quelques femmes seulement en détiennent l’usage et s’en servent pour tracer des devises sur des tambours, des boucliers de cuir ou autres objets ; on rencontre parfois sur des rochers des inscriptions en tifinarh, mais les descendants de ceux qui les ont tracées sont incapables de les lire. Cet alphabet, qui ne possède aucun moyen de rendre la plupart des voyelles et se montre inférieur sous ce rapport à l’alphabet arabe lui-même, est par ailleurs excessivement défectueux. S’il existe quelques lettrés[378] chez les Touareg, au moins dans les familles maraboutiques, ils se servent pour écrire de la langue et de l’alphabet arabes.
Les Maures qui font encore usage du zenaga ont désappris complètement le maniement des caractères libyco-berbères qu’emploient encore, quoique d’une manière restreinte, les Touareg ; comme les tribus de langue berbère d’Algérie et du Maroc, c’est des caractères arabes qu’ils se servent pour transcrire leur langue, mais ce procédé lui-même est à peu près inusité au Haut-Sénégal-Niger. Les quelques Maures parlant le zenaga que l’on rencontre en cette colonie, ou bien sont complètement illettrés, ou bien connaissent l’arabe écrit, et alors c’est de cette dernière langue qu’ils usent lorsqu’ils veulent confier quelque chose au papier.
Quant au peul et au haoussa, il arrive que des lettrés musulmans parlant ces langues les écrivent au moyen de l’alphabet arabe, en donnant à certains caractères de cet alphabet une valeur conventionnelle spéciale ou en modifiant la valeur de tel ou tel caractère au moyen de points diacritiques supplémentaires, de façon à adapter à peu près l’alphabet arabe à la phonétique de ces langues. Ils ont même inventé un signe spécial — un point épais placé au dessous de la ligne d’écriture — pour représenter la voyelle é, qui n’a pas de signe correspondant en arabe et qui est d’un usage fréquent en peul et en haoussa. Mais, même ainsi modifié, l’alphabet arabe est encore bien défectueux pour rendre les sons de langues aussi différentes des langues sémitiques que le sont le peul, le haoussa et toutes les langues nègres d’ailleurs ; la fréquence des voyelles, leur variété, leur importance morphologique, la quantité et la valeur des nasalisations constituent des obstacles qu’il est bien difficile de surmonter avec un instrument aussi peu approprié à l’expression des phonèmes vocaliques et nasaux que le système graphique des Arabes. De plus, il n’existe entre les lettrés peuls ou haoussa des diverses régions du Soudan aucune entente ni aucune possibilité d’entente sur les moyens à employer pour remédier aux inconvénients du système ; en sorte que, à part quelques pratiques qui se sont généralisées à peu près partout — comme la représentation de la voyelle é par un point épais et celle du d spécial[379] des Peuls par un thâ —, les procédés diffèrent selon les pays et même, dans un pays donné, selon les individus, et il n’est pas rare qu’une page écrite en peul ou en haoussa soit à peu près inintelligible pour tout autre que celui qui l’a écrite. Comme d’autre part il est pratiquement nécessaire, pour être capable de transcrire du peul ou du haoussa en caractères arabes, de connaître au préalable l’arabe écrit lui-même, la plupart des lettrés préfèrent se servir tout bonnement de cette dernière langue ; ils y sont d’autant plus portés que, s’ils ont à écrire à un correspondant parlant une autre langue que la leur, la lettre écrite en peul ou en haoussa ne serait pas comprise de ce correspondant tandis que la lettre écrite en arabe le sera toujours. Cependant, comme je le disais, on rencontre quelques spécimens de peul et de haoussa transcrits en caractères arabes : ce sont pour la plupart de petits poèmes imités ou traduits de l’arabe ; ce sont parfois aussi des lettres échangées entre deux Peuls ou deux Haoussa dont l’un réside en un pays où sa langue n’est pas comprise et qui peuvent, en usant de ce système, préserver mieux le secret de leur correspondance qu’en se servant de la langue arabe.
Aucune des autres langues du Haut-Sénégal-Niger, à ma connaissance, n’est écrite même occasionnellement[263]. Ce n’est pas à dire qu’il n’existe pas de lettrés chez les Songaï, les Mandé, les Ouolofs, etc. ; mais, lorsque ces lettrés veulent confier quelque chose au papier, c’est toujours de la langue arabe qu’ils se servent et non pas de leur langue propre. Tout au plus transcrivent-ils, dans le cours d’une lettre rédigée en arabe et au moyen de caractères arabes parfois modifiés à la façon des Peuls et des Haoussa, des mots de leur langue maternelle[380] dont ils ignorent l’équivalent arabe ou encore des titres ou des noms propres. Parfois aussi les instituteurs musulmans, pour se rappeler le sens d’une expression arabe peu usuelle qu’ils auront à expliquer à leurs élèves, transcrivent en marge du texte arabe, ou dans l’interligne, la traduction de cette expression en langue indigène. Mais cela ne peut à aucun titre constituer une littérature.
Les missionnaires chrétiens ont enseigné quelquefois à leurs néophytes un procédé de transcription de leur langue au moyen des caractères de l’alphabet latin : il ne semble pas que l’emploi de ce système ait dépassé les murs des écoles confessionnelles, sauf peut-être en ce qui concerne certains Ouolofs du Sénégal, convertis au christianisme depuis plusieurs générations. Les rares indigènes christianisés que j’ai rencontrés, lorsqu’ils avaient conservé quelque trace de l’instruction que leur avaient donnée les missionnaires, se servaient pour écrire, non pas de leur propre langue, mais de la langue française ; je dois ajouter qu’ils m’ont tous paru avoir besoin d’un effort moindre pour écrire en français que pour transcrire les mots de leur langue maternelle en caractères français.
3o Littérature orale. — Si aucune langue du Soudan en dehors de l’arabe ne mérite l’appellation de « langue écrite », si la littérature arabe soudanaise elle-même n’a guère produit — sauf de trop rares exceptions[264] — d’œuvres vraiment originales en dehors de quelques diaires et obituaires et de correspondances sans grand intérêt, il n’en faudrait pas conclure qu’il n’existe au Soudan aucune littérature. Il existe au contraire en cette partie de l’Afrique une littérature populaire d’une extraordinaire richesse, mais elle est uniquement orale.
Cette littérature n’est pas seulement riche ; elle est variée et aborde tous les sujets. L’histoire et l’épopée y sont représentées par de très curieuses traditions relatives à l’origine des peuples et des tribus, aux faits et gestes des héros ou des guerriers célèbres : les légendes reproduites ou simplement résumées[381] dans la seconde partie du présent ouvrage peuvent donner une idée du genre et de la large part qui y est faite au symbolisme et au merveilleux. Les fables sont légion au Soudan : on en pourrait faire de volumineux recueils qui rappelleraient à la fois nos vieux fabliaux, notre Roman de Renard et le bonhomme La Fontaine ; c’est en général le lièvre qui est le héros de ces fables et qui joue aux autres animaux, à l’hyène notamment, les bons tours qui chez nous sont la spécialité du renard ; la moralité des fables soudanaises n’est pas plus morale que celle des nôtres, mais elle exalte le plus souvent la finesse et la ruse aux dépens de la force. A côté des fables existent des proverbes, plus réellement moraux en général et fréquemment pétris du plus merveilleux bon sens, et aussi des énigmes qui servent à passer les soirées et qui aiguisent l’esprit. La poésie proprement dite est largement représentée, soit par d’interminables chansons épiques, soit par des chansons satiriques ou licencieuses, soit par de simples chansons d’amour : ces dernières sont les plus répandues parmi le commun du peuple et sont chantées surtout par les femmes au cours de leurs danses, tandis que les chansons épiques et satiriques sont plutôt récitées par ces professionnels que nous appelons les griots[265]. Il faudrait encore, pour être complet, ajouter à cette énumération une sorte de littérature religieuse, comprenant des chants liturgiques, des formules de sacrifice, d’incantation et d’initiation, des légendes relatives aux génies et à leur action sur le monde, etc.
Tous les peuples du Soudan ne brillent pas de même au point de vue littéraire. Les Mandé, supérieurs par ailleurs, ne détiennent sous ce rapport qu’un rang assez médiocre et sortent rarement de la banalité ordinaire ; le côté poétique en tout cas leur fait généralement défaut. Les Sénoufo montrent[382] peut-être un peu plus d’imagination, mais ils possèdent mal l’art de la composition. Les peuples voltaïques et notamment les Mossi semblent beaucoup mieux doués[266], ainsi que les Songaï. Mais ce sont surtout les Peuls qui se distinguent par l’allure poétique de leurs chansons. Je me permets, pour en donner quelque idée, de traduire ici deux chansons peules recueillies dans la Boucle du Niger par M. le capitaine Figaret, de l’artillerie coloniale, qui m’en a très obligeamment communiqué le texte. Comme la traduction ne peut leur conserver l’allure élégante et harmonieuse que leur prêtent les assonances de la langue peule, je reproduis ci-dessous le texte lui-même, en le transcrivant de mon mieux selon les lois ordinaires de la prononciation française.
Chanson d’amour
(recueillie chez les Peuls Bari de Boromo, cercle de Koury).
[383]Chanson guerrière
(recueillie chez les Peuls du Djilgodi).[271]
[249]Voir en particulier : Die Sudansprachen, eine sprachvergleichende Studie, par Diedrich Westermann (Hamburg, 1911, gr. in-8) et la carte linguistique de Bernhard Struck.
[250]Voir plus loin les tableaux comparatifs du chapitre II.
[251]J’ai distingué les trois groupes de la famille mandé en donnant à chacun comme nom le mot employé le plus généralement dans les langues du groupe pour exprimer le nombre « dix » ; je ne prétends pas du tout indiquer par là que ces diverses manières de rendre le nombre « dix » soient la caractéristique des différences séparant les trois groupes : il s’agit simplement d’appellations qui m’ont paru commodes et de nature à représenter objectivement la chose qu’elles sont chargées de représenter, de la même manière que les appellations de « langues d’oc » et « langues d’oïl » sont employées chez nous.
[252]Le kâgoro pourrait à la rigueur être considéré comme un simple dialecte intermédiaire entre le soninké et le mandingue ; on ne possède d’ailleurs que fort peu de renseignements sur cet idiome.
[253]Le groupe mandé-tan possède deux autres langues, non représentées au Haut-Sénégal-Niger : le ligbi (dialectes ligbi, huéla et noumou), parlé à la Côte d’Ivoire et à la Côte d’Or, et le vaï, parlé au Libéria.
[254]Le rattachement des langues samorho et sia est encore douteux, ainsi que celui des quatre dialectes mal définis. Le groupe mandé-fou possède beaucoup d’autres langues et dialectes non représentés au Haut-Sénégal-Niger : le mendé et le landorho (Sierra-Leone), le toma et le guerzé (Guinée), le dan, le toura, le lo ou gouro, le mona, le nouan, le ngan et le gbin (Côte d’Ivoire).
[255]De nombreux dialectes de la langue sénoufo sont en outre parlés à la Côte d’Ivoire.
[256]En dehors du Haut-Sénégal-Niger, le groupe mossi possède à la Côte d’Or le dagomba, le gbanian, le boura ou frafra et le mampoursi ; il est probable que les deux premiers de ces quatre idiomes sont des dialectes appartenant à la même langue que le dagari et que les deux autres sont des dialectes appartenant à la même langue que le nankana — J’ai des raisons de croire que les Samo, en outre d’un dialecte de la langue mossi, possèdent un idiome spécial qu’il faudrait peut-être rattacher à la famille mandé.
[257]Appartiennent au même groupe le siti et le dégha de la Côte d’Ivoire.
[258]Ce groupe est surtout représenté au Dahomey et au Togo, tant par le bariba et le soumba que par d’autres langues ou dialectes (kaouri ou kabré, kotokoli, pila-pila, ouindji-ouindji, etc.).
[259]L’autre groupe ou groupe sérère comprend le kéguem ou sérère proprement dit et le none, parlés uniquement au Sénégal.
[260]Je lui donne ce nom parce que son domaine s’étend, d’une manière générale, du bas Niger au Logone, affluent du Tchad.
[262]Sous réserve du fait probable, mais non démontré encore, que les Samo feraient usage d’une langue nationale d’origine mandé et ne parleraient le mossi qu’à titre de langue secondaire.
[263]L’une des langues mandé du groupe mandé-tan, le vaï, est une langue écrite et possède même un alphabet original, du type syllabique, qui lui est propre et a été créé de toutes pièces par les Vaï eux-mêmes. C’est probablement la seule langue nègre qui possède un système graphique non emprunté au dehors et qui en fasse couramment usage, bien qu’on ait signalé récemment un autre exemple de ce phénomène au Cameroun. Je ne cite ce cas que pour mémoire, la langue et l’alphabet vaï étant localisés à une province du Libéria et à une toute petite fraction de la colonie anglaise de Sierra-Leone.
[264]Il convient en particulier de faire état, parmi ces exceptions, d’ouvrages d’histoire tels que le Tarikh-es-Soudân, le Tedzkiret-en-Nisiân et d’autres non publiés encore.
[265]M. Dupuis-Yakouba, adjoint principal des affaires indigènes à Tombouctou, vient de publier chez l’éditeur Leroux le texte et la traduction d’un véritable poème épique songaï célébrant les hauts faits des premiers Gow, qui constituèrent chez les Songaï la caste des chasseurs. Par son sujet, sa manière et ses dimensions, ce spécimen de la littérature orale du Soudan est tout à fait remarquable.
[266]Voir les spécimens de littérature mossi publiés et traduits par M. Froger, adjoint des affaires indigènes, dans son Etude de la langue des Mossi.
[267]Variante : Bâdé sokki tyokkougol birâdam, la brume laisse filer un filet de lait frais.
[268]Il s’agit de ces cotonnades d’un bleu sombre tirant sur le noir, analogue à la teinte que prend le firmament à la tombée de la nuit.
[269]Allusion à la rosée du soir qui prend souvent, à l’obscurité naissante, une teinte laiteuse.
[270]L’aîné de la brousse est l’un des surnoms du lion.
[271]Relative à une incursion que fit Boukari Koutou, empereur mossi de Ouagadougou, dans le Djilgodi vers 1890, incursion au cours de laquelle il fut repoussé par les Peuls près de la mare de Djibo.
[272]Allusion à la cavalerie peule envoyée pour soutenir le choc de l’armée mossi.
[273]D’habitude les rives de l’étang sont couvertes des pagnes que les femmes y ont lavés et qu’elles étendent sur le sable pour les faire sécher.
[274]Allusion aux dispositions stratégiques prises par Boukari Koutou, qui avait envoyé sa cavalerie des deux côtés de l’étang pour faire un mouvement tournant et l’avait appuyée par un demi-cercle de fusilliers garnissant la rive sud.
[275]Formule de salutation en usage chez les Mossi.
[276]Formule de salutation en usage chez les Peuls.
[387]CHAPITRE II
Linguistique comparée
Le cadre et le caractère général de cet ouvrage ne me permettent pas de tenter ici une étude comparative détaillée des nombreuses langues en usage dans le Haut-Sénégal-Niger. Il me serait d’ailleurs difficile de mener à bien une pareille étude, vu l’état encore bien précaire des connaissances aujourd’hui acquises sur beaucoup de ces langues. Je voudrais essayer seulement d’esquisser à grands traits, sous une forme brève et précise, les caractéristiques principales de chaque famille linguistique, en m’en tenant aux généralités. J’ai disposé ces indications par tableaux successifs, afin de faciliter les comparaisons et de permettre de voir, d’un seul coup d’œil, par où les diverses familles diffèrent les unes des autres et par où au contraire certaines ont entre elles des points de contact et des affinités.
Pour les familles sémitique, hamitique, nigéro-logonaise et sénégalaise, j’ai pris comme types de comparaison les seules langues de ces familles représentées au Haut-Sénégal-Niger, c’est-à-dire l’arabe, le tamacheq, le haoussa et le ouolof. Les familles tekrourienne, songaï et sénoufo ne possédant chacune qu’une langue unique, c’est tout naturellement cette langue qui a été prise comme terme de comparaison. En ce qui concerne les familles mandé et voltaïque, les observations s’appliquent à l’ensemble des langues de chacune de ces deux familles.
[388]I. — Composition et formation des mots.
1o Composition habituelle des racines (pronoms et particules mis à part).
Arabe : trois consonnes sans voyelle ; quelquefois quatre consonnes.
Tamacheq : une consonne ; deux consonnes ; deux consonnes avec une voyelle intercalée ; quelques racines sont terminées par une voyelle.
Haoussa : une consonne suivie d’une voyelle ; deux consonnes avec une voyelle intercalée ; une consonne suivie d’une voyelle puis de deux consonnes.
Ouolof : deux consonnes avec une voyelle intercalée (la deuxième consonne pouvant n’être qu’une semi-voyelle) ; parfois une consonne suivie d’une voyelle puis de deux consonnes.
Peul : deux consonnes avec une voyelle intercalée ; une consonne suivie d’une voyelle puis de deux consonnes.
Songaï : une consonne suivie d’une voyelle ; deux consonnes avec une voyelle intercalée ; une consonne suivie d’une voyelle puis de deux consonnes ; peut-être aussi une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle (douteux).
Mandé : une consonne suivie d’une voyelle ; une voyelle entre deux consonnes (rare) ; peut-être aussi une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle (douteux).
Sénoufo : une consonne suivie d’une voyelle ; une voyelle entre deux consonnes (rare) ; peut-être aussi une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle (douteux).
Voltaïque : une voyelle entre deux consonnes ; une voyelle précédée d’une consonne et suivie de deux consonnes ; aussi une consonne suivie d’une voyelle.
2o Emploi des racines isolées.
Arabe : la racine ne peut s’employer seule (certains pronoms et particules mis à part).
[389]Tamacheq : certaines racines peuvent s’employer seules.
Haoussa : la plupart des racines peuvent s’employer seules.
Ouolof : la racine peut s’employer seule.
Peul : la racine ne peut s’employer seule (exception faite de certains pronoms et particules, ainsi que des impératifs et de quelques abréviations usuelles).
Songaï : la racine peut s’employer seule.
Mandé : la racine peut s’employer seule.
Sénoufo : certaines racines peuvent s’employer seules, d’autres ne le peuvent pas.
Voltaïque : les racines ne peuvent s’employer seules que dans certains cas déterminés et seulement lorsqu’elles sont à terminaison vocalique (sauf quelques exceptions d’ailleurs douteuses).
3o Mode de formation des mots.
Arabe : flexion interne et désinencielle ; agglutinisme par préfixes, infixes et suffixes.
Tamacheq : flexion interne et désinencielle ; agglutinisme par préfixes, infixes et suffixes.
Haoussa : flexion interne et désinencielle ; agglutinisme par préfixes et suffixes.
Ouolof : pas de flexion ; agglutinisme par suffixes seulement.
Peul : pas de flexion ; agglutinisme par suffixes seulement.
Songaï : pas de flexion ; agglutinisme par suffixes (avec un exemple unique de préfixe : i devant l’adjectif attribut) ; juxtaposition de racines ou de radicaux.
Mandé : pas de flexion ; agglutinisme par suffixes et très rarement par préfixes (pour former des verbes causatifs ou factitifs) ; juxtaposition de racines ou de radicaux.
Sénoufo : pas de flexion ; agglutinisme par suffixes seulement ; juxtaposition de racines pures placées devant d’autres racines ou des radicaux.
Voltaïque : mêmes modes de formation que pour le sénoufo.
[390]4o Modifications
morphologiques des consonnes radicales
(modifications dialectales ou euphoniques mises à part).
Arabe : aucune modification, sauf par redoublement.
Tamacheq : aucune modification, sauf par redoublement.
Haoussa : aucune modification, sauf par redoublement.
Ouolof : très nombreux cas de modification morphologique de certaines consonnes radicales.
Peul : modification morphologique et syntaxique régulière de certaines consonnes radicales.
Songaï : aucune modification.
Mandé : aucune modification (sauf quelques cas dans le groupe mandé-tamou).
Sénoufo : quelques cas de modification morphologique des consonnes radicales.
Voltaïque : cas nombreux de modification morphologique de certaines consonnes radicales.
II. — Morphologie et syntaxe.
1o Genres et classes.
Arabe : deux genres distingués aux deux nombres dans les pronoms, les noms, les adjectifs, les participes et les verbes (au moyen de suffixes ou flexions désinencielles dans les noms, adjectifs et participes, de préfixes et de suffixes dans les verbes).
Tamacheq : deux genres distingués aux deux nombres dans les pronoms, les noms, les participes et les verbes (au moyen de préfixes et de suffixes dans les noms et les participes comme dans les verbes).
Haoussa : deux genres distingués au singulier seulement dans les pronoms, les noms, les adjectifs et les participes, mais non dans les verbes, à l’exception d’une forme verbale féminine pour le verbe « être » : tché (au moyen de flexions désinencielles dans les noms et les participes, de flexions désinencielles ou de préfixes dans les adjectifs).
[391]Ouolof : pas de genres, mais un grand nombre de classes de noms distinguées par des articles spéciaux ou particules de détermination suffixées.
Peul : pas de genres, mais un grand nombre de classes de noms et de participes distinguées par des suffixes spéciaux, par l’emploi de pronoms différents et par la modification de certaines consonnes radicales.
Songaï : ni genres ni classes.
Mandé : ni genres ni classes.
Sénoufo : pas de genres, mais des classes de noms distinguées par des suffixes spéciaux.
Voltaïque : pas de genres, mais des classes de noms distinguées par des suffixes spéciaux.
2o Nombres.
Arabe : trois nombres distingués dans les pronoms, les noms, les adjectifs, les participes et les verbes (au moyen de flexions, d’infixes et de suffixes dans les noms, les adjectifs et les participes, et de préfixes et suffixes dans les verbes).
Tamacheq : deux nombres distingués dans les pronoms, les noms, les participes et les verbes (au moyen de flexions, de préfixes et de suffixes dans les noms et les participes, et de préfixes et suffixes dans les verbes).
Haoussa : deux nombres distingués dans les pronoms, les noms, les adjectifs et les participes, mais non dans les verbes (au moyen de flexions internes ou désinencielles dans les noms et les participes, de flexions ou préfixes dans les adjectifs).
Ouolof : deux nombres distingués seulement dans les pronoms et dans les articles ou particules de détermination du nom, par des formes spéciales pour chaque nombre.
Peul : deux nombres distingués dans les pronoms, les noms, les participes et certains verbes (dans les noms et les participes au moyen de suffixes spéciaux à chaque nombre et par la modification de certaines consonnes radicales, dans les verbes par une modification analogue et — dans quelques cas — par des suffixes spéciaux).
[392]Songaï : deux nombres distingués dans les pronoms et les noms seulement (dans les noms par l’addition d’un suffixe à la forme du singulier).
Mandé : comme en songaï, avec cette différence que, dans certaines langues ou certains dialectes, le suffixe indiquant le pluriel peut se substituer à la voyelle terminale de la forme du singulier et que, dans le groupe mandé-tamou, on rencontre des cas de modification de la première consonne radicale.
Sénoufo : deux nombres distingués dans les pronoms et les noms (dans les noms par addition d’un suffixe à la forme du singulier ou au moyen de suffixes spéciaux à chaque nombre, et parfois au moyen de la modification de certaines consonnes radicales).
Voltaïque : deux nombres distingués dans les pronoms et les noms (dans les noms au moyen de suffixes spéciaux à chaque nombre et parfois au moyen de la modification de certaines consonnes radicales).
Remarque. — Dans les langues arabe, tamacheq, haoussa, peule et voltaïques, les noms prennent toujours la marque du pluriel, même si la pluralité est indiquée d’autre part à l’aide d’un nom de nombre ou d’un déterminatif ou qualificatif de quantité ; au contraire dans les familles songaï et mandé, la marque du pluriel disparaît si la pluralité est indiquée d’autre part, ne serait-ce que par le contexte ; en sénoufo, les deux phénomènes se rencontrent concurremment.
3o Modifications de l’idée verbale (personnes, temps, modes, voix, formes).
Arabe : personnes, temps, modes, voix passive, formes dérivées indiqués par flexions, préfixes, infixes et suffixes.
Tamacheq : personnes, temps ou modes, formes dérivées indiqués par préfixes, infixes et suffixes ; une seule voix.
Haoussa : personnes indiquées par les pronoms sujets ; temps ou modes indiqués par particules ou auxiliaires préfixés et parfois par suffixes ou flexions désinencielles, ou encore par l’emploi de pronoms sujets spéciaux ; voix passive indiquée[393] par un préfixe (a) et par l’inversion du pronom sujet : assez nombreuses formes dérivées indiquées par suffixes ou flexions désinencielles.
Ouolof : personnes indiquées par les pronoms sujets ; temps ou modes indiqués par suffixes ou par auxiliaires préfixés ou parfois par la place du pronom sujet par rapport au verbe ; une seule voix ; formes dérivées nombreuses, indiquées par des suffixes.
Peul : personnes indiquées par les pronoms sujets et parfois, à l’impératif, par des suffixes ; temps ou modes indiqués par des suffixes et quelquefois par des auxiliaires préfixés ; trois voix (active, passive et moyenne ou réfléchie), indiquées par des suffixes spéciaux ; très nombreuses formes dérivées, indiquées par des suffixes.
Songaï : personnes indiquées par les pronoms sujets ; temps ou modes indiqués par particules ou auxiliaires préfixés ; une seule voix ; deux formes dérivées (l’intensive marquée par simple redoublement, la factitive ou causative indiquée par un suffixe).
Mandé : personnes indiquées par les pronoms sujets ; temps ou modes indiqués par particules ou auxiliaires préfixés ou suffixés ; voix passive indiquée par une particule suffixée ou simplement par l’absence de régime direct ; quelques formes dérivées indiquées par préfixes ou suffixes.
Sénoufo : personnes indiquées par les pronoms sujets ; temps ou modes indiqués par particules ou auxiliaires préfixés (peut-être aussi quelquefois par particules suffixées) ; voix (?) ; formes (?).
Voltaïque : personnes indiquées par les pronoms sujets ; temps ou modes indiqués par suffixes et par particules ou auxiliaires préfixés ; une seule voix (?) ; formes dérivées indiquées par suffixes.
4o Négation.
Arabe : indiquée par une particule préfixée au verbe (particules diverses selon les temps : lâ, mâ, lam).
Tamacheq : même système (une seule particule : our ou ou).
[394]Haoussa : indiquée par la particule ba placée au commencement et à la fin de la proposition (à l’impératif par la particule kada au début de la proposition).
Ouolof : indiquée par un suffixe qui se place entre le radical du verbe et le suffixe de conjugaison ou bien par un auxiliaire négatif préfixé au verbe.
Peul : indiquée par des suffixes de conjugaison spéciaux et, à l’impératif, par un auxiliaire négatif ou une particule négative préfixés au verbe.
Songaï : indiquée par une particule préfixée au verbe (na pour le passé, si pour le futur).
Mandé : indiquée par une particule ou un auxiliaire négatif préfixés au verbe (particules et auxiliaires divers selon les temps, modes ou voix : en mandingue tè pour le présent, ti pour le futur, kana pour l’injonctif, ma pour le passé et le passif).
Sénoufo : indiquée par une particule préfixée au verbe (particules diverses selon les temps ou modes) et souvent précisée par l’addition d’une autre particule suffixée au verbe.
Voltaïque : indiquée par une particule préfixée au verbe ou à l’auxiliaire de conjugaison (particules diverses selon les temps ou modes) et souvent précisée par l’addition d’une autre particule suffixée au verbe.
5o Interrogation (en dehors des cas où la proposition renferme un pronom ou adverbe marquant par lui-même l’interrogation, comme « qui ? quoi ? quand ? où ? comment ? etc. »).
Arabe : particule interrogative au début de la proposition ou (dans la langue vulgaire) mot interrogatif suffixé au verbe, ou encore particule signifiant « ou bien non » (aou-lâ) placée à la fin de la proposition.
Tamacheq : particule interrogative signifiant « ou bien » (mirh) placée à la fin de la proposition.
Haoussa : particule ou formule interrogative signifiant « ou bien » (ko) ou encore « ou bien pas ainsi » (ko ba hakka ba) placée à la fin de la proposition ; emploi de formes spéciales du verbe[395] « être », selon son sens, dans les phrases interrogatives.
Ouolof : particule interrogative au début de la proposition.
Peul : particule interrogative au début de la proposition (yalla) ou plus fréquemment particule interrogative à la fin de la proposition (nâ) ou les deux employées simultanément, ou encore emploi de l’inversion (le sujet se plaçant après le verbe, avec modification morphologique de l’un et de l’autre dans certains cas).
Songaï : particule interrogative signifiant « ou bien » (ouala) placée à la fin de la proposition.
Mandé : même système (particule ouala ou ouâ ou â en mandingue).
Sénoufo : même système.
Voltaïque : même système.
Remarque. — Dans toutes les familles linguistiques, l’intonation seule, sans emploi d’aucune particule spéciale, peut suffire à exprimer l’interrogation.
6o Adjectif.
Arabe : des adjectifs proprement dits existent en dehors des participes.
Tamacheq : pas d’adjectifs ; les participes et les verbes qualificatifs en tiennent lieu.
Haoussa : adjectifs propres, adjectifs composés d’un substantif ou d’un verbe précédé d’un préfixe, participes et infinitifs passifs employés adjectivement.
Ouolof : pas d’adjectifs ni de participes ; les verbes qualificatifs en tiennent lieu, soit conjugués soit précédés d’une sorte de pronom relatif qui n’est en somme qu’une particule spéciale de détermination suffixée au substantif.
Peul : peu d’adjectifs, mais des participes qui en tiennent lieu, ainsi que des verbes qualificatifs soit conjugués soit précédés d’une sorte de démonstratif jouant le rôle de pronom relatif.
Songaï : adjectifs propres et adjectifs-participes formés d’un verbe par l’addition d’un suffixe.
Mandé : pas d’adjectifs propres, mais des verbes qualificatifs[396] en tenant lieu, soit conjugués, soit employés adjectivement à l’infinitif ; il existe de plus des adjectifs-participes formés d’un verbe par l’addition de divers suffixes ; enfin beaucoup de noms sont employés adjectivement.
Sénoufo : adjectifs propres et verbes qualificatifs en tenant lieu, soit conjugués soit employés adjectivement à l’infinitif.
Voltaïque : adjectifs propres, adjectifs-participes formés d’un verbe par l’addition de divers suffixes, noms employés adjectivement, verbes qualificatifs conjugués.
7o Place du régime du nom.
Arabe : régime du nom après ce nom sans particule d’union (le nom déterminé par son régime perd l’article).
Tamacheq : régime du nom après ce nom, avec particule d’union (n ou en) intercalée entre les deux.
Haoussa : régime du nom après ce nom, avec particule d’union (n pour les deux genres ou bien na pour le masculin et ta pour le féminin) intercalée entre les deux.
Ouolof : régime du nom après ce nom sans particule d’union (le nom déterminé par son régime conserve généralement sa particule de détermination).
Peul : régime du nom après ce nom sans particule d’union (le nom déterminé par son régime conserve son suffixe de classe, sauf dans certaines locutions très usuelles jouant le rôle de noms composés).
Songaï : régime du nom avant ce nom sans particule d’union (en général le régime seul peut prendre la particule de détermination)[277].
Mandé : régime du nom avant ce nom sans particule d’union ou avec particule d’union indiquant soit la possession soit la localisation.
Sénoufo : régime du nom avant ce nom sans particule d’union (le nom régime perd fréquemment son suffixe de classe).
[397]Voltaïque : régime du nom avant ce nom sans particule d’union (le nom régime perd le plus généralement son suffixe de classe : ten-ga « pays », sô-ba « maître », ten-sô-ba « le chef du pays » en mossi).
8o Place des régimes du verbe.
Arabe : tous les régimes après le verbe, le régime direct se plaçant en général le premier et le régime indirect le second, (toutefois le régime indirect pronominal se place avant le régime direct nominal).
Tamacheq : tous les régimes après le verbe, le régime indirect se plaçant en général avant le régime direct (sauf si ce dernier est pronominal) et parfois même avant le verbe.
Haoussa : tous les régimes après le verbe, le régime indirect précédant en général le régime direct.
Ouolof : le régime direct suit en général le verbe ; toutefois si ce régime est un pronom et que le pronom sujet soit placé avant le verbe, le pronom régime direct s’intercale entre le pronom sujet et le verbe ; le régime indirect se place toujours après le verbe, tantôt après tantôt avant le régime direct.
Peul : tous les régimes après le verbe, le régime indirect non accompagné d’une préposition précédant toujours le régime direct ; toutefois le régime sur lequel on veut insister se place au début de la proposition et alors le sujet se place après le verbe.
Songaï : tous les régimes après le verbe, le régime indirect précédant en général le régime direct.
Mandé : le régime direct se place toujours immédiatement avant le verbe, entre l’auxiliaire de conjugaison — s’il existe — et le verbe lui-même ; le régime indirect au contraire suit toujours le verbe.
Sénoufo : même règle qu’en mandé.
Voltaïque : le régime direct et le régime indirect suivent en général le verbe, le régime direct se plaçant le plus souvent le premier, parfois intercalé entre le verbe lui-même et la[398] particule de conjugaison suffixée, mais suivant d’ordinaire cette particule ; toutefois le régime direct se place quelquefois avant le verbe, surtout dans les phrases négatives ou interrogatives ; d’autre part le régime indirect pronominal précède le régime direct et parfois même se place avant le verbe ; enfin le régime sur lequel on veut insister se place au début de la proposition, sans amener de modification dans la place du sujet par rapport au verbe.
9o Possessifs.
Arabe : les adjectifs possessifs sont rendus au moyen de suffixes pronominaux qui sont en réalité des pronoms personnels régimes du nom et se plaçant après lui selon la règle générale ; le nom ne prend pas l’article.
Tamacheq : même système, mais avec emploi ordinaire de la particule d’union n ou en entre le nom et le pronom.
Haoussa : même système, avec emploi de la particule d’union n.
Ouolof : pour les première et deuxième personnes du singulier et du pluriel et la troisième personne du pluriel, on a de véritables adjectifs possessifs (formés d’une racine s indiquant la possession et suivie du pronom), qui se placent avant le nom ; (au singulier, le nom ne prend pas de particule de détermination ; au pluriel, la particule de détermination se place soit après le possessif soit après le nom ; le possessif déterminant un nom régime d’un autre nom se place avant celui-ci : les pieds de ton cheval, sa tank-i fas « ton pieds cheval » ;) pour la troisième personne du singulier toujours et exceptionnellement pour les autres personnes, l’adjectif possessif se rend simplement par le pronom suffixé au nom.
Peul : nos adjectifs possessifs sont rendus au moyen du pronom suffixe au nom, avec intercalement entre les deux (sauf à la première personne du singulier) d’une particule ma’ ou m indiquant la possession.
Songaï : nos adjectifs possessifs sont rendus au moyen du pronom[399] préfixé au nom dont il est le régime ; ce nom conserve en général la particule de détermination après lui.
Mandé : nos adjectifs possessifs sont rendus au moyen du pronom préfixé au nom, avec ou sans intercalement d’une particule indiquant la possession.
Sénoufo : nos adjectifs possessifs sont rendus au moyen du pronom préfixé au nom, sans intercalement d’aucune particule.
Voltaïque : même système qu’en sénoufo.
10o Relatif.
Arabe : le relatif existe après un nom déterminé et suit immédiatement son antécédent ; si le relatif est régime, un pronom régime correspondant, dit « de rappel », est exprimé après le verbe ; pas de relatif après un nom indéterminé : on y supplée par le pronom personnel.
Tamacheq : pas de relatif ; on y supplée par le démonstratif, avec emploi fréquent d’un pronom de rappel en cas de relatif régime.
Haoussa : il existe un relatif (nda ou da), qui suit immédiatement son antécédent ; qu’il soit sujet ou régime, il nécessite un pronom de rappel.
Ouolof : pas de relatif ; on y supplée par la particule de détermination du nom, augmentée le cas échéant d’un démonstratif.
Peul : pas de relatif à proprement parler ; on y supplée par une sorte de démonstratif invariable (ko ou no) ou, le plus souvent, par le pronom personnel.
Songaï : il existe un relatif (ka, pluriel ka-yo ou ki), qui suit son antécédent soit immédiatement soit avec intercalement de la particule de détermination ; lorsque le relatif est régime l’emploi du pronom de rappel est nécessaire.
Mandé : pas de relatif ; un démonstratif en tient lieu généralement (mi ou min en mandingue), avec emploi du pronom de rappel si l’on a affaire à un relatif régime.
Sénoufo : ?
[400]Voltaïque : il existe un relatif (au moins en mossi) ; sujet, il suit immédiatement son antécédent ; régime, il se place entre le sujet et le verbe de la proposition relative et exige généralement un pronom de rappel après le verbe.
11o Infinitif suivant un verbe.
Arabe : pas d’infinitif ; les deux verbes se mettent à un mode personnel.
Tamacheq : pas d’infinitif ; les deux verbes se mettent à un mode personnel.
Haoussa : l’infinitif suit immédiatement le verbe dont il est le régime ou bien il est remplacé par un mode personnel.
Ouolof : l’infinitif suit le verbe avec intercalement entre les deux d’une particule de liaison (a).
Peul : l’infinitif peul est un nom et peut, comme tout nom, être régime d’un verbe et le suivre directement ; s’il n’est pas absolument régime du verbe, on le remplace par un mode personnel.
Songaï : l’infinitif suit le verbe, avec intercalement entre les deux d’une particule de liaison (ka) ; mais si le sujet logique de l’infinitif n’est pas le même que celui du verbe précédent, on remplace l’infinitif par un mode personnel.
Mandé : mêmes règles qu’en songaï (la particule de liaison varie selon les langues, elle est ka en mandingue).
Sénoufo : mêmes règles qu’en songaï et en mandé (la particule de liaison est sa en général).
Voltaïque : mêmes règles qu’en songaï, mandé et sénoufo (la particule de liaison varie selon les langues, elle est n en mossi).
Remarque. — En mandé et en sénoufo, l’infinitif employé substantivement précède le verbe dont il est le régime direct, selon la règle générale.
12o Régime des particules remplaçant nos prépositions.
Arabe : régime après la particule.
Tamacheq : régime après la particule.
[401]Haoussa : régime après la particule.
Ouolof : régime après la particule.
Peul : régime après la particule.
Songaï : régime avant la particule.
Mandé : régime avant la particule.
Sénoufo : régime avant la particule.
Voltaïque : régime avant la particule.
13o Place du sujet.
Arabe : avant ou après le verbe.
Tamacheq : avant ou après le verbe.
Haoussa : avant le verbe ; si le sujet est un nom, on le fait suivre généralement d’un pronom de rappel.
Ouolof : avant le verbe si c’est un nom ; après le verbe, sauf à certains temps, si c’est un pronom.
Peul : avant le verbe en général ; toutefois, dans certaines expressions usuelles, en poésie, dans certaines phrases interrogatives et quand on a voulu attirer l’attention sur le régime en le plaçant au début de la proposition, le sujet suit le verbe : à la 1re et à la 2e personnes, le pronom sujet revêt alors une forme spéciale ou s’amalgame avec le suffixe de conjugaison du verbe et ce dernier se comporte, même au singulier, comme s’il était au pluriel.
Songaï : sujet avant le verbe.
Mandé : sujet avant le verbe.
Sénoufo : sujet avant le verbe.
Voltaïque : sujet avant le verbe.
14o Place de l’attribut.
Arabe : après le sujet ou l’expression qui tient lieu du verbe « être », le verbe copulatif n’existant pas.
Tamacheq : le substantif attribut se place après le verbe « être » ou avant le sujet du verbe « être » ; l’adjectif attribut se traduit en général par un participe suivant directement le sujet, sans exprimer le verbe « être ».
Haoussa : l’attribut se place entre le sujet et le verbe né (féminin[402] tché) ou avant le sujet si l’on emploie le verbe ké ; il peut aussi suivre le sujet sans que le verbe « être » soit exprimé.
Ouolof : l’attribut se place entre le sujet et le verbe-particule la ou après le verbe di.
Peul : l’attribut suit directement le sujet, le verbe copulatif n’existant pas ; en général on emploie un verbe qualificatif ou attributif qui tient lieu à la fois du verbe « être » et de l’attribut.
Songaï : l’attribut se place après le verbe copulatif tyi.
Mandé : l’attribut se place après ou avant le verbe copulatif, selon les cas ; (en mandingue, l’attribut substantif se place soit après le verbe bè soit plutôt avant le verbe lo ou do, et l’attribut adjectif après ou avant les verbes bè ou yé, selon la nature morphologique de l’adjectif ;) le plus souvent le verbe « être » suivi d’un attribut adjectif se tourne par un verbe qualificatif.
Sénoufo : l’attribut se place après le verbe copulatif ou entre le sujet et ce verbe, selon les cas.
Voltaïque : comme en sénoufo.
15o Place des adjectifs déterminatifs (possessifs exceptés) et des qualificatifs.
Arabe : les déterminatifs précèdent le nom en général, les qualificatifs le suivent.
Tamacheq : les déterminatifs (sauf ak « chaque ») suivent le nom, ainsi que les participes qualificatifs.
Haoussa : certains déterminatifs précèdent le nom, les autres le suivent ; les qualificatifs le suivent ou bien le précèdent, mais alors ils sont séparés du nom par la particule n.
Ouolof, peul, songaï, mandé, sénoufo, voltaïque : tous les déterminatifs et qualificatifs suivent le nom ; (les quelques exceptions à cette règle, notamment en ce qui concerne les démonstratifs, ne sont qu’apparentes et tiennent à ce que le démonstratif est souvent un pronom ; ainsi en songaï « cet homme » se dit tantôt har ouo et tantôt ouo har, mais en réalité ouo har signifie « l’homme de ceci » ou « l’homme d’ici » ; de même en mandingue[403] o mousso « cette femme » signifie littéralement « la femme de ceci, la femme que voici »).
16o Articles.
Arabe : un article défini invariable (el) précède le nom ; pas d’article indéfini.
Tamacheq : aucun article, mais le démonstratif peut jouer le rôle d’article déterminatif et le numéral peut servir d’article indéfini.
Haoussa : pas d’article défini ; un adjectif spécial joue le rôle d’article indéfini et précède le nom.
Ouolof : pas d’article à proprement parler, mais des particules de détermination variées en jouent le rôle et se placent après le nom : elles se composent toutes d’une consonne ou d’une semi-voyelle suivie d’une voyelle ; la consonne varie selon la classe ou selon la consonne initiale du nom, la voyelle varie selon la nature de la détermination.
Peul : pas d’article ; les pronoms personnels de la troisième personne, employés comme démonstratifs après le nom, ont souvent une valeur analogue à celle de notre article défini ; un participe rendant le nom de nombre « un » joue le rôle d’article indéfini et suit le nom.
Songaï : une particule de détermination (di) suffixée au nom joue exactement le rôle de notre article défini ; le numéral peut jouer le rôle d’article indéfini.
Mandé : pas d’article défini ; un article indéfini existe, distinct du nombre « un » (do en mandingue).
Sénoufo : aucun article.
Voltaïque : aucun article.
17o Verbe de non-existence.
Arabe : il existe plusieurs verbes de non-existence, mais, dans la langue parlée, le verbe d’existence employé négativement est plus fréquent.
Tamacheq : l’idée de non-existence est rendue par la négation du verbe d’existence.
[404]Haoussa : l’idée de non-existence est rendue par la négation du verbe ké ou par une simple négation sans verbe.
Ouolof : le verbe d’existence di a une forme négative dou.
Peul : il existe plusieurs verbes de non-existence, dont un surtout est d’un emploi fréquent (al-dé ou oual-dé) ; on peut aussi employer négativement le verbe d’existence (on-dé ou ouon-dé).
Songaï : pas de verbe de non-existence.
Mandé : il existe un verbe de non-existence (tè en mandingue) ; le verbe d’existence (bè en mandingue) ne s’emploie jamais négativement.
Sénoufo : même chose qu’en mandé.
Voltaïque : même chose qu’en mandé et en sénoufo.
18o Numération.
Arabe : décimale ; le nom de nombre précède le nom, lequel reste au singulier à partir de 11.
Tamacheq : même système et mêmes règles.
Haoussa : décimale ; le nom de nombre suit le nom, lequel peut se mettre au pluriel à partir de 2 ou rester au singulier.
Ouolof : quinaire ; le nom de nombre précède le nom mais prend après lui la particule de détermination du pluriel (i ou yi) à partir de 2, tandis que le nom demeure invariable et ne prend aucune particule de détermination.
Peul : quinaire ; le nom de nombre suit le nom, qui se met au pluriel.
Songaï : décimale ; le nom de nombre suit le nom, qui reste au singulier.
Mandé : décimale ou quinaire, selon les langues ; le nom de nombre suit le nom, qui reste au singulier.
Sénoufo : quinaire ; le nom de nombre suit le nom, qui reste au singulier.
Voltaïque : décimale ou quinaire, selon les langues ; le nom de nombre suit le nom, qui peut se mettre au pluriel ou rester au singulier.
[405]III. — Phonétique.
1o Voyelles (semi-voyelles w et y non comprises, étant rangées parmi les consonnes).
Arabe : voyelles pures seulement (dans la langue parlée tout au moins).
Tamacheq : voyelles pures et voyelles nasalisées[278].
Haoussa : voyelles pures et voyelles nasalisées.
Ouolof : voyelles pures (dont la voyelles eu), voyelles nasalisées et quelques voyelles nasales[279].
Peul : voyelles pures seulement.
Songaï : voyelles pures et voyelles nasalisées ; quelques voyelles nasales, mais pas très nettes.
Mandé : voyelles pures (dont l’u français, assez rare d’ailleurs) ; voyelles nasalisées et nombreuses voyelles nasales.
Sénoufo : voyelles pures (dont eu et u) et voyelles nasales.
Voltaïque : voyelles pures (dont eu et u), voyelles nasalisées et voyelles nasales.
2o Consonnes (présence ou absence de certaines consonnes spéciales).
Arabe : possède les semi-voyelles w et y, le hamza (hiatus), le ’aïn, deux sortes de h, le kh (ou jota), le rh ou gh (r gras), des chuintantes (ch et j), des zézayantes (th dur et doux de l’anglais), et de plus un d, un t, un s, un z et un k spéciaux (emphatiques ou claquants) ; pas de v ni de ñ (gn français dans « dignité »).
Tamacheq : possède les semi-voyelles w et y, le rh ou gh, des chuintantes (ch et j), des zézayantes (th dur et doux), un d,[406] un t et un k spéciaux ; (pas de hamza, de ’aïn, de kh, de v, ni de ñ).
Haoussa : possède les semi-voyelles w et y, des demi-chuintantes (sh et zh), le ñ ; (pas de hamza, de ’aïn, de kh, de rh, de zézayantes, de v ni de lettres emphatiques ou claquantes).
Ouolof : possède les semi-voyelles w et y, le kh, le ñ, le v, un p et un k spéciaux ; (pas de hamza, de ’aïn, de rh, de chuintantes, de zézayantes ni de z).
Peul : possède les semi-voyelles w et y, le hamza, le ñ, l’n vélaire, un b et un d spéciaux ; (pas de ’aïn, de kh, de rh, de chuintantes, de zézayantes ni de z ; le v est rare et seulement dialectal, remplaçant la semi-voyelle w, laquelle est parfois aussi remplacée par une semi-voyelle u).
Songaï : possède les semi-voyelles w et y et le ñ ; (pas de hamza, de ’aïn, de kh, de rh, de chuintantes — sauf un sh très rare et ne se rencontrant que dans quelques mots étrangers —, de zézayantes, de lettres emphatiques ou claquantes ni de v).
Mandé : possède les semi-voyelles w, u et y, le kh (dialectal), le rh ou gh, le ñ, l’n vélaire (rare), le v, la demi-chuintante sh (rare et dialectale), des labiales gutturalisées (gb et kp) ; (pas de hamza, de ’aïn, de chuintantes vraies, de zézayantes ni de lettres emphatiques ou claquantes).
Sénoufo : possède les semi-voyelles w, u et y, le ’aïn, le rh ou gh, le ñ, le v, des demi-chuintantes (sh et zh), des labiales gutturalisées ; (pas de hamza, de kh, de chuintantes vraies, de zézayantes ni de lettres emphatiques ou claquantes).
Voltaïque : possède les semi-voyelles w, u et y, le rh ou gh, le ñ, le v, des consonnes emphatiques ou claquantes (b, p, d et g spéciaux), plus des consonnes aspirées ; (pas de hamza, de ’aïn, de kh, de chuintantes ni de zézayantes).
Remarque. — Les langues arabe, tamacheq et haoussa ne possèdent à proprement parler ni consonnes nasalisées ni consonnes yodisées ; toutes les autres langues du Haut-Sénégal-Niger font au contraire un usage fréquent des consonnes nasalisées (mb, nd, ñg, en particulier) et des consonnes yodisées (dy ou gy, ty ou ky, en particulier).
[407]3o Syllabes terminales des mots.
Arabe : terminaisons vocaliques et consonantiques (terminaisons consonantiques plus fréquentes).
Tamacheq : terminaisons vocaliques et consonantiques (terminaisons consonantiques plus fréquentes).
Haoussa : les terminaisons vocaliques sont les plus fréquentes ; les terminaisons consonantiques sont plus rares et ne se présentent que par une dentale (t, d, s, z, r, l) ou une nasale (n, ñ) ou encore une semi-voyelle.
Ouolof : terminaisons vocaliques et consonantiques.
Peul : terminaisons vocaliques et consonantiques ; en dehors des cas où la racine s’emploie seule, on ne trouve de terminaisons consonantiques que par l, m, n, ñ, ou la semi-voyelle y.
Songaï : terminaisons vocaliques et consonantiques ; ces dernières, moins fréquentes que les premières, ne se présentent que par l, m, n, ñ, r, s ou une semi-voyelle.
Mandé : terminaisons uniquement vocaliques (par voyelles pures ou nasales).
Sénoufo : terminaisons uniquement vocaliques (sauf les cas où la racine s’emploie seule et alors cette racine ne forme en réalité que la première partie d’un mot composé).
Voltaïque : terminaisons vocaliques et consonantiques ; ces dernières, moins fréquentes, ne se présentent que par une labiale ou une dentale (sauf les cas cités pour le sénoufo).
[277]Exemple : boro « homme », bongo « tête », boro di « l’homme », boro di bongo « la tête de l’homme », boro bongo « une tête d’homme ».
[278]J’appelle « voyelles nasalisées » des voyelles pures suivies d’un n sonore ; on donne aussi à ces phonèmes le nom de « nasales-voyelles ».
[279]J’appelle « voyelles nasales » des voyelles terminées par un n non sonore, comme les groupes « on, en » dans les mots français « bon, mien » ; certains donnent à ces phonèmes le nom de voyelles nasalisées, qui me semble moins logique.
[408]CHAPITRE III
Caractères généraux de chacune des quatre langues principales.
1o Mossi. — Ma compétence est fort médiocre en ce qui concerne la langue mossi et, bien qu’elle soit la plus importante de toutes celles parlées au Soudan Français par le nombre des individus qui en font usage, je serai nécessairement fort bref à son sujet. Je ne me serais même pas permis d’en parler ici, si le beau travail de M. Froger, paru l’an dernier, n’était venu à point pour me fournir les indications qui me manquaient.
Il suffit de parcourir son ouvrage pour se convaincre que la langue mossi est remarquablement riche, tant en vocables qu’en formes, et qu’elle est parfaitement adaptée aux besoins de la civilisation soudanaise actuelle et même à ceux d’une civilisation plus développée dont il est permis de prévoir l’avènement. Cependant je doute que cette langue soit appelée à une extension bien considérable et je crois que, à mesure que le centre de la Boucle du Niger s’éloignera davantage de l’état d’isolement où il s’est confiné jusqu’ici, le mandingue, le songaï et le haoussa s’y répandront de plus en plus, tandis que le mossi demeurera à peu près localisé aux pays où il est parlé actuellement et perdra même du terrain au lieu d’en gagner. C’est qu’en effet cette langue présente d’assez grandes difficultés, surtout au point de vue phonétique, pour les étrangers qui seraient tentés de se l’assimiler : si elle est parlée par un aussi grand nombre de gens, cela tient uniquement à la densité de population des pays mossi et à l’hégémonie politique exercée[409] depuis des siècles sur une région vaste et bien peuplée par les nâba de Ouagadougou et du Yatenga. Mais il est facile de constater qu’elle ne s’est pas étendue d’une manière appréciable en dehors de l’habitat propre des Mossi ou des tribus que les Mossi se sont assimilées.
La fréquence des consonnes, qui se suivent souvent à deux ou trois ou même davantage sans voyelle d’appui bien nette, rend très malaisée la prononciation de beaucoup de mots et nécessite une oreille particulièrement exercée pour les entendre et les comprendre ; je me contenterai de citer, à titre d’exemples, des mots comme pabrhdba, sikkdba, et des membres de phrase comme t f kyi, t b yell t b wa t b leb, t m gnangh fo, etc.
La difficulté de donner à une racine le suffixe qui convient selon la classe et le nombre des noms est également un obstacle, très surmontable assurément, mais un peu déroutant et de nature à rendre l’étude du mossi plus malaisée que celle de langues à règles très peu nombreuses et à exceptions plus rares encore, telles que le songaï et le mandingue.
2o Mandingue. — Cette dernière langue se présente sous un aspect bien différent de celui du mossi : aucun phonème difficile à articuler, rien que des syllabes à terminaison vocalique, rarement deux consonnes se suivant sans voyelle intercalée (lorsque le cas se présente, la seconde consonne est presque toujours une liquide ou une semi-voyelle ou bien la première est une nasale) ; une morphologie d’une simplicité extrême, consistant simplement dans l’emploi judicieux d’un nombre limité de suffixes et de particules — une vingtaine — qui servent à former les noms composés, les diminutifs, les augmentatifs, les adjectifs, les participes et substantifs dérivés du verbe, le pluriel dans les noms, le temps ou le mode et la voix dans les verbes, sans qu’aucune modification intervienne jamais dans le radical du mot ; enfin une syntaxe se réduisant à peu près à deux règles : le régime d’un mot se place toujours avant ce mot, l’adjectif se place toujours après le substantif. L’exposé complet de la grammaire mandingue peut tenir en une vingtaine de pages.
Le vocabulaire par contre est d’une richesse généralement[410] insoupçonnée, tant à cause du nombre relativement considérable des racines qu’en raison de la quantité de dérivés qui peuvent être obtenus de chacune par le jeu des suffixes et de deux ou trois mots jouant le rôle de préfixes. La faculté, très généralisée, d’employer le même radical comme substantif, comme adjectif et comme verbe vient encore en aide aux étrangers qui ne possèdent qu’une partie restreinte du vocabulaire.
Tout cela explique suffisamment la force d’extension de cette langue et fait comprendre comment elle tend à se répandre de plus en plus en dehors de son domaine propre, jusqu’à devenir presque, dans le Soudan Occidental, la langue indigène officielle, celle à laquelle on a recours tout d’abord lorsqu’on se trouve en présence d’un individu dont on ignore l’origine.
Pour être impartial, je dois dire cependant que le mandingue présente quelques difficultés. La principale provient du nombre considérable des homonymes et des paronymes : dans une langue où la majorité des racines se composent d’une seule consonne suivie d’une seule voyelle, il n’est pas étonnant que beaucoup de ces racines se ressemblent phonétiquement ou même soient complètement identiques, et ce phénomène ne contribue pas peu à rendre obscures certaines propositions qui, grammaticalement, sont d’ailleurs d’une simplicité limpide. On cite souvent cette phrase a ko a bè fani ko ko ko « elle dit qu’elle lave le linge de l’autre côté de la rivière », dans laquelle la syllabe ko représente quatre mots très différents : dire, laver, rivière, derrière. A vrai dire, lorsque ko signifie « rivière », il se prononce avec un o ouvert, tandis que l’o est fermé dans ko signifiant « dire » et dans ko signifiant « derrière » et à la fois fermé et allongé dans ko signifiant « laver ». Mais combien de sons exactement semblables représentent des significations très distinctes ! Par exemple kan qui veut dire « être égal, cou, langage et dessus », di qui veut dire « donner, être agréable, comment ? et miel », bon qui veut dire « être grand, répandre et maison », sama qui veut dire « tirer, présenter et éléphant », kono ou konon qui veut dire « attendre, ventre, oiseau et perle », etc.
Une autre difficulté consiste dans le nombre relativement considérable des dialectes et sous-dialectes ; assurément les différences[411] entre les divers dialectes, à part de rares exceptions, sont surtout d’ordre phonétique, mais elles sont suffisamment accentuées souvent pour qu’il soit difficile au non initié de reconnaître le même mot sous ses divers aspects dialectaux. Ainsi « main » se dira bourou en dioula, boulou en malinké, bolo ou blo en banmana ; « soleil » se dira téré en dioula, télé en malinké, tlé ou klé en banmana ; « nom » se dira torho en dioula, torho ou togo en malinké, tokho en khassonkè et toua en banmana ; « semblable » se dira nyorhon en dioula, nyorhon ou nyohon en malinké et nyouan en banmana ; « un » se dira kélé en dioula, kélé ou kélen en malinké et en banmana, khélé en khassonkè ; koro « auprès » deviendra koto en malinké et sorho « viande » deviendra soubo ; « blanc » se dira gbê en dioula, gouè ou guè en malinké, dyè en banmana, etc. Certaines modifications dialectales portent aussi sur l’emploi ou la valeur de quelques particules de conjugaison, ka par exemple marquant le passé en dioula et l’injonctif en banmana, etc.
Mais il convient d’observer qu’avec un peu d’étude et d’expérience, on arrive très vite à posséder la clef de ces modifications, qui s’accomplissent en général selon des procédés très réguliers et constants. D’autre part il est très rare que, parmi les différentes formes que revêt un mot donné selon les régions, il ne s’en trouve pas une dont l’emploi se soit généralisé au point qu’elle soit comprise même dans les pays où on ne l’emploie pas d’habitude ; ainsi, bien que « nom » se traduise usuellement par toua en banmana, je crois que neuf Banmana sur dix comprendront sans hésitation celui qui leur dira : i torho bè di ? « quel est ton nom ? » Même pour les formes grammaticales, lorsqu’elles diffèrent selon les dialectes, il est rare que l’une d’elles au moins ne soit pas comprise partout : ainsi les Banmana emploient yé comme particule du passé, certains Malinké emploient de préférence li dans le même cas, tandis que d’autres Malinké et tous les Dioula se servent généralement de ka ; cependant la phrase a ka sô san kounou sera entendue partout avec le sens de « il a acheté un cheval hier ». C’est de cette façon que s’est formée cette « langue blanche », ce kan gbê, qui est le mandingue de tout le monde et que tout[412] le monde comprend sans difficulté, sauf dans les petits villages éloignés des grandes voies de communication et qui sont pour ainsi dire isolés du reste du monde mandingue ; ce dialecte en quelque sorte international a puisé çà et là dans chacun des dialectes proprement dits, adoptant les formes les plus répandues et les faisant siennes ; aussi est-ce celui-là qui tend à se généraliser et qui arrivera un jour à unifier les dialectes régionaux en les remplaçant peu à peu. Actuellement déjà, le kan gbê règne en maître chez les Dioula et les Malinké du Haut-Sénégal-Niger, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée Française ; seul, le dialecte banmana, avec ses élisions de voyelles, ses tendances à l’apocope et son emploi abusif d’un passif incomplet, garde une physionomie à part et un peu rébarbative.
3o Peul. — Le peul a acquis une réputation de langue harmonieuse qui n’est assurément pas surfaite : on l’a appelé « un langage d’oiseaux, l’italien d’Afrique, etc. » et ce n’est pas sans raison. L’absence de tout son rauque, l’extrême abondance des dentales et surtout des liquides douces, la fréquence des voyelles i et é, comme aussi l’intonation musicale si particulière à cette langue, la rendent agréable à entendre, même lorsqu’on ne la comprend pas, surtout si elle est parlée par des femmes.
Quoique sa morphologie et sa syntaxe reposent sur des principes très simples, le nombre considérable de ses suffixes et la délicatesse des modifications que chacun apporte à la valeur d’un radical donné font du peul l’une des langues africaines les plus difficiles à bien posséder et à manier avec précision. Les mêmes causes d’autre part lui assurent une indiscutable supériorité sur les idiomes qui se parlent autour de lui : je ne crois pas qu’il existe une nuance de pensée qui ne puisse être rendue avec exactitude par la langue peule.
Son vocabulaire est l’un des plus riches que je connaisse. Le nombre des racines est d’une abondance extraordinaire et, si l’on songe que, de chaque racine ou presque, on peut tirer de six à dix verbes dérivés, que chacun de ces verbes dérivés peut s’employer à trois voix différentes (active, passive et moyenne ou réfléchie), que chaque voix de chaque verbe peut donner[413] naissance à trois participes au moins de sens différents et à une quantité presque illimitée de substantifs, tout cela d’ailleurs par la simple addition à la racine de suffixes dont chacun a sa valeur propre, on ne sera pas étonné de la faveur en laquelle je tiens cette langue.
L’une des caractéristiques les plus spéciales du peul réside dans le phénomène des classes entre lesquelles sont répartis les substantifs. Elles sont au nombre de onze pour le singulier — ou de dix-sept si l’on tient compte des sous-classes — et de cinq pour le pluriel. Chaque classe ou sous-classe possède un pronom spécial pour représenter les substantifs qu’elle renferme et chacune est caractérisée morphologiquement par un suffixe identique à ce pronom ou dérivant de lui. De plus certaines consonnes radicales subissent, dans certaines classes, une modification ou transformation très spéciale : c’est ainsi que la racine rèw devient dèbb dans six classes du singulier et dans trois du pluriel, tandis qu’elle conserve la forme rèw dans les autres classes. Au point de vue des catégories des êtres ou objets selon les classes, il y a moins de précision ; certaines classes ont une catégorisation très nette : ainsi la classe du singulier à pronom o et la classe du pluriel à pronom bé ne renferment que des noms d’êtres humains[280], la classe du singulier à pronom ngèl (par g dur) et la classe du pluriel à pronom koñ (prononcez comme l’impératif français « cogne ») ne renferment que des[414] noms de diminutifs (diminutifs d’êtres humains, d’animaux ou d’objets quelconques), la classe du singulier à pronom dam ne renferme que des noms de liquides ou de corps facilement liquéfiables, la sous-classe du singulier à pronom ba (nga dans les dialectes parlés à l’est du bas Niger) ne renferme que des noms d’animaux se nourrissant de végétaux ; mais, pour chacune des autres classes et sous-classes, il existe en général un nombre plus ou moins grand de catégories diverses : la classe du singulier à pronom ngal renferme des augmentatifs, des noms d’instruments, des noms d’oiseaux ; la classe du singulier à pronom ngol renferme des noms d’objets allongés, des noms abstraits, etc. Toutefois, même lorsque la spécialisation des catégories n’est pas absolument nette, elle existe cependant.
Le fait que chaque classe ou sous-classe possède son pronom spécial et ses désinences spéciales et que les adjectifs (ou participes qualifiant des substantifs) prennent une désinence analogue à celle de la classe à laquelle appartient le substantif qualifié, le traitement que subissent certaines consonnes radicales selon la classe du mot, donnent à la langue peule une physionomie très particulière qui n’a pas toujours été comprise mais qui a été remarquée par tout le monde.
Ces diverses particularités du peul, en même temps qu’elles en font une langue intéressante, harmonieuse, riche et puissante, en font aussi une langue dont l’assimilation est malaisée. Aussi est-il fort rare de l’entendre parler par d’autres indigènes que ceux dont elle est la langue maternelle et elle n’a aucune chance de devenir une langue d’échange. Par un phénomène inverse, les Peuls qui se trouvent en petit nombre au sein d’une population autre que la leur se voient forcés d’apprendre la langue que l’on parle autour d’eux, et c’est ainsi que l’on rencontre un nombre considérable de Peuls parlant le soninké, le mandingue, le songaï, le mossi, le haoussa, etc., tandis qu’il est excessivement rare de trouver des Mandé, des Songaï, des Mossi, des Haoussa parlant le peul.
Ceux d’ailleurs qui, à la suite de circonstances spéciales, ont réussi à apprendre le peul le parlent en général fort mal. Les Rimaïbé, bien qu’ils ne connaissent souvent pas d’autre langue[415] que le peul, qui est l’idiome de leurs maîtres, ne le parlent que d’une façon incorrecte. La même remarque a été faite en ce qui concerne les gens appartenant aux castes spéciales, et particulièrement les Laobé. Les Peuls proprement dits eux-mêmes sont loin d’observer toujours toutes les règles de la langue et en prennent à leur aise notamment dans l’application des principes relatifs à la distinction des classes et aux modifications des consonnes radicales. Seuls, parmi tous les gens de langue peule, les Toucouleurs parlent d’une façon tout à fait correcte.
Ce fait n’est pas l’un des moindres arguments militant en faveur de la théorie que j’ai soutenue plus haut, théorie d’après laquelle les ancêtres des Peuls auraient, lors de leur séjour au Fouta-Toro du VIIIe au XIe siècles, abandonné leur langue d’origine asiatique ou nord-africaine pour emprunter aux Nègres du Tekrour la langue toucouleure, que nous appelons aujourd’hui la langue peule[281]. Nous avons vu que toutes les traditions indigènes s’accordent pour donner le Fouta-Toro comme point de départ aux diverses migrations qui ont porté les Peuls vers l’Est jusque dans le bassin du Nil ; or il est facile de constater que, à mesure qu’on s’éloigne du Fouta-Toro dans la direction de l’Est, la langue parlée par les Peuls s’écarte de plus en plus des règles fondamentales qui lui donnent sa physionomie propre, tandis que les Toucouleurs, même établis à demeure très loin de leur pays d’origine — par exemple ceux de Ségou, de Bandiagara, de Say — continuent à appliquer scrupuleusement ces mêmes règles. Tout cela tend bien à prouver, il me semble, que le peul n’est vraiment la langue nationale que des seuls Toucouleurs et que sa véritable patrie d’origine doit être placée dans l’ancien Tekrour, c’est-à-dire dans le Fouta Sénégalais.
Un autre phénomène encore vient à l’appui de mon hypothèse. Un examen, même superficiel, de la langue sérère montre qu’un nombre considérable de radicaux de cette langue, et[416] notamment ceux qui expriment les idées les plus communes, comme « laisser, accepter, acheter, vendre, allumer, apporter, avoir, battre, être beau, être blanc, être noir, être brave, cuire, dormir, boire, manger, demander, envoyer, marcher, pouvoir, rire, tomber, tuer, voler, etc. », sont identiques ou analogues aux radicaux peuls correspondants, tandis que l’allure générale de la langue sérère est très différente de l’allure générale de la langue peule et se rapproche plutôt de la physionomie du ouolof. D’autre part on rencontre dans le sérère et — quoique sur une échelle beaucoup plus restreinte — dans le ouolof, des phénomènes de modifications de consonnes radicales et des éléments de dérivation qui rappellent singulièrement les phénomènes et éléments correspondants du peul. Et pourtant le sérère par sa morphologie générale, le ouolof surtout par son vocabulaire et sa grammaire, s’éloignent assez considérablement du peul. On sait que les Sérères n’ont pas toujours habité leur pays actuel, qu’ils étaient autrefois établis plus à l’Est et au Nord et qu’ils ont, durant des siècles, voisiné avec les habitants du Tekrour et fait partie de leur empire ; on sait aussi que les Ouolofs ont été tour à tour sujets et suzerains du même empire : il n’est donc pas étonnant que des emprunts aient été faits par les Sérères et les Ouolofs à la langue du Tekrour et que la trace de ces emprunts soit encore visible aujourd’hui. On pourrait même prétendre, quoique ce soit plus téméraire, que ce serait le sérère qui aurait influencé la langue du Tekrour, ou encore, ce qui serait peut-être plus près de la vérité, qu’une langue du bas Sénégal, aujourd’hui disparue, a contribué à la formation de la langue toucouleure, de la langue sérère, et, pour une part moindre, de la langue ouolove. Quoi qu’il en soit, comme les analogies constatées entre le peul d’une part et d’autre part le sérère et — à un bien moindre degré — le ouolof sont tout aussi visibles dans le dialecte des Peuls du Baguirmi que dans celui des Toucouleurs du Fouta-Toro, il faut bien admettre que les Peuls du Baguirmi et d’ailleurs ont pris leur langue dans le bas Sénégal, étant donné que l’influence des Sérères ne s’est jamais, que je sache, portée jusqu’au lac Tchad. C’est donc là un premier point qui me paraît définitivement acquis :[417] la langue actuelle des Peuls était parlée au Tekrour avant l’époque des premières migrations peules vers le Sud et vers l’Est.
| Delafosse | Planche XIV |
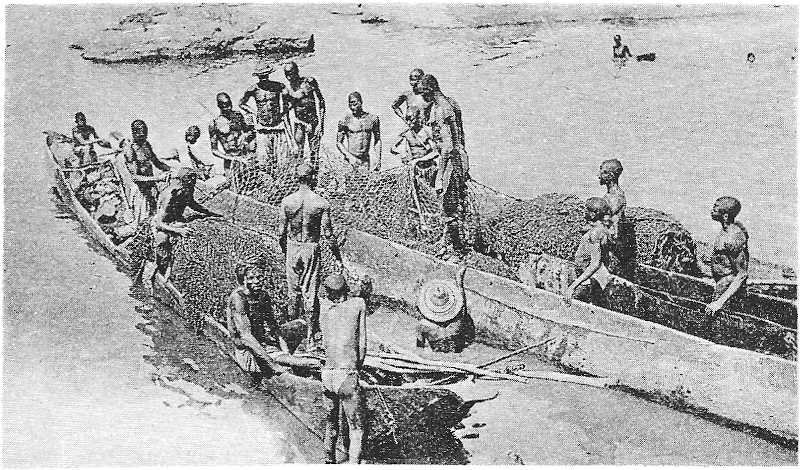
Cliché Fortier
Fig. 27. — Pêcheurs du Niger.

Cliché Fortier
Fig. 28. — Une flottille de pêche sur le Niger.
Mais, pourrait-on dire, cela n’empêcherait pas que les Peuls eussent apporté leur langue actuelle de l’Asie ou du Nord-Est de l’Afrique : ils l’auraient introduite avec eux au Tekrour, où elle aurait passé au sérère une partie de ses radicaux et serait devenue la langue des Toucouleurs, et ensuite ils l’auraient transportée dans tout le Soudan occidental et central.
Assurément une telle hypothèse n’est pas absurde matériellement et elle demeurera même historiquement soutenable tant que nous ne posséderons aucun document nous permettant de savoir quelle langue était parlée au Tekrour avant l’arrivée des Peuls dans ce pays : or il est vraisemblable que nous ne disposerons jamais d’un document de cette nature.
Nous avons bien le nom des « gorilles » : lorsque le navigateur carthaginois Hannon arriva aux côtes de Guinée, il aperçut des sauvages velus qui ne lui paraissaient pas avoir figure humaine et que ses interprètes lui désignèrent d’un nom qui, passé dans notre langue à travers la traduction grecque du texte punique, est devenu « gorille ». Comme il est vraisemblable, d’après le récit de Hannon, que ses interprètes avaient été embarqués à l’embouchure du Sénégal, on pourrait rapprocher le mot « gorille » de l’expression ouolove gôr yi « ce sont des hommes », ce qui permettrait de supposer que, dès le VIe siècle avant J.-C., on parlait déjà ouolof à l’embouchure du Sénégal et que le nom servant à désigner les hommes en ouolof appartenait déjà à une racine qui, précisément, sert aussi à les désigner en peul (gôr-ko, racine gôr ou wôr selon les cas). Mais je ne veux assurément pas faire état d’un argument basé sur un mot unique, transmis par l’intermédiaire d’un texte punique que nous ne possédons pas.
L’argument tiré du fait que le peul est parlé plus correctement par les Toucouleurs que par les Peuls me semble avoir une bien autre valeur. Il en existe d’autres encore à l’appui de ma thèse. Les Peuls ou Proto-Peuls n’ont pas séjourné qu’au Fouta : avant d’y arriver ils ont bien été forcés de passer quelque[418] part et ils ne se sont pas transportés des bords de la Méditerranée aux rives du Sénégal comme un bolide. Si l’on fait quelque crédit aux traditions indigènes, il faut admettre qu’ils ont habité la région de Oualata pendant au moins cinq siècles, c’est-à-dire plus longtemps que n’a duré leur séjour au Tekrour ; lorsque le gros de leur peuple s’est porté au Fouta, un certain nombre d’entre eux sont demeurés dans le Hodh, sont allés fonder Tichit et ont donné naissance aux Guirganké ; d’autres peut-être sont devenus les Nimadi. Il serait très intéressant de savoir si ces derniers, sur lesquels on n’a que de très vagues renseignements, ne possèdent pas un idiome spécial et quel est cet idiome. Mais en tout cas ni à Oualata, ni a Tichit ni chez les Guirganké on ne trouve trace d’une langue ressemblant au peul ; si la langue des Proto-Peuls de Ghana avait été le peul actuel ou quelque chose y ressemblant, il serait bien étonnant que cette langue n’ait pas laissé de traces dans le Hodh alors qu’elle aurait eu assez de force pour s’imposer à toute la population du Fouta, pour influencer si fortement le sérère et pour se perpétuer durant plus de mille ans à travers tout le Soudan. En d’autres termes, comment expliquer que cette langue ne se retrouve nulle part au-delà du Fouta, lorsqu’on suit en sens inverse l’itinéraire le plus probable de l’immigration proto-peule, à moins d’admettre qu’elle est née au Fouta même et que les Proto-Peuls l’y ont trouvée lorsqu’ils y sont arrivés pour la première fois ?
Si nous quittons le domaine de l’histoire pour aborder celui de la linguistique pure, la chose paraîtra plus certaine encore : la langue peule, par son type purement agglutinatif, par ses classes de noms, par ses suffixes de conjugaison, par sa phonétique, par la nature même de ses radicaux et par la forme de ses racines, présente tous les caractères fondamentaux des langues nègres ; elle constitue dans l’Afrique Noire une famille à part, c’est vrai, mais cette famille est à grouper avec les autres familles soudanaises et avec la famille bantoue, dont elle se rapproche à certains égards, tandis que les différences qui séparent le peul des langues sémitiques et hamitiques sont telles que je ne puis arriver à concevoir comment on a pu, même un[419] instant, songer à le rattacher à la famille sémitique ou à la famille hamitique.
Un linguiste anglais très autorisé en matière d’idiomes africains, M. Migeod, a opposé une seule objection à ma théorie : « Comment admettre, m’a-t-il dit, qu’un peuple de race blanche et de mentalité supérieure aurait pu abandonner sa langue pour adopter une langue nègre ? » Cette objection n’est pas de nature à m’effrayer. Tout d’abord il n’est pas démontré que la mentalité des Judéo-Syriens et leur civilisation, au moment de leur arrivée au Fouta, fût notablement supérieure à celle des Noirs du Tekrour ; ensuite il est fort probable, comme je l’ai laissé entrevoir, que la langue qu’ils parlaient alors n’était pas leur langue propre, mais bien une langue d’emprunt récoltée en Egypte ou en Cyrénaïque, peut-être un égyptien bâtard, peut-être tout simplement le berbère : depuis leur départ de Syrie ils avaient sans doute changé de langue plus d’une fois et ils ne devaient pas tenir outre mesure à celle qu’ils parlaient au moment de leur venue sur les rives du Sénégal et qui ne cadrait pas plus avec leur génie national que la langue des Toucouleurs. Enfin, le fait d’un groupement de race blanche adoptant une langue nègre ne me paraît pas autrement surprenant : les raisons tirées de l’orgueil de race n’ont rien à voir avec le développement des langues ; les Touareg Kel-Oui ont à peu près abandonné le tamacheq pour ne plus parler que le haoussa et cependant ce sont leurs serfs, les Bougadié, qui le leur ont appris ; les descendants des conquérants marocains de Tombouctou ne parlent pas d’autre langue que celle des Nègres Songaï, que leurs ancêtres avaient asservis et regardaient comme une race d’esclaves.
4o Songaï. — Je place la langue songaï après la langue peule en raison de sa légère infériorité au point de vue du nombre de ses ressortissants, mais il serait plus logique, dans cette esquisse des caractères généraux des principales langues du Soudan Français, de la placer à côté du mandingue. Elle en a la simplicité et la force d’expansion, en raison précisément de cette simplicité.
Je dirai même que le songaï est plus facile encore à parler[420] que le mandingue : sa prononciation est plus aisée encore, car il n’a ni le rh guttural ni les voyelles nasales un peu spéciales du mandingue ; sa morphologie, très analogue à celle de cette dernière langue quant aux principes appliqués, est plus rudimentaire encore ; quant à sa syntaxe, elle est presque inexistante. Si la grammaire mandingue peut tenir en vingt pages, dix pages suffiraient largement à la grammaire songaï : la partie grammaticale du manuel Hacquard et Dupuis, qui est, je crois, complète, renferme quarante pages, dont plus des trois quarts sont remplis par des exemples. D’autre part les homonymes ne sont qu’en nombre restreint et leur présence n’offre pas la difficulté réelle qu’elle entraîne en mandingue. Les variations dialectales paraissent insignifiantes, si l’on en excepte la différence de prononciation du d mouillé ou yodisé qui distingue le parler de Tombouctou et de Dienné de celui du Djerma ; dans ce dernier pays on le prononce z, on dirait par exemple zenné au lieu de Dienné.
Si le songaï est une langue facile, il est par ailleurs une langue pauvre : son vocabulaire est beaucoup plus restreint que celui du mandingue et le nombre des dérivés que l’on peut former d’un radical donné n’est pas considérable. Aussi a-t-il fait de copieux emprunts aux langues étrangères, à l’arabe, au tamacheq, et surtout au peul et au mandingue. Ces emprunts d’ailleurs ne comportent que des mots, que le songaï a adoptés tels quels, sans se préoccuper de leur formation. Tout naturellement, les mots étrangers ne sont souvent que d’un emploi local : beaucoup d’expressions arabes, couramment usitées à Tombouctou, sont à peu près inconnues à Say ; de nombreux mots mandingues ont cours à Dienné qui ne sont pas compris à Gao ; mais beaucoup aussi ont acquis définitivement et partout droit de cité et font partie aujourd’hui du vocabulaire songaï, dont ils constituent presque le quart.
[280]De là les appellations de « genre hominin » et de « genre commun » (commun aux deux sexes) données respectivement à l’ensemble de ces deux classes par le général Faidherbe et par de Guiraudon. Ces mêmes auteurs rangeaient tous les autres mots dans une seule classe que le premier appelait « genre brute » et le second « genre neutre ». Une telle division est tout à fait défectueuse, car il n’existe aucune raison de réunir ensemble des classes dont chacune est aussi distincte des autres que toutes ensemble sont distinctes de la classe à pronom o. Faidherbe et de Guiraudon prétendaient aussi que les modifications de consonnes radicales se faisaient en sens inverse selon que le mot appartenait au genre hominin ou commun ou au genre brute ou neutre ; cette affirmation n’est pas exacte et beaucoup de noms ne désignant pas des êtres humains subissent, au moins au singulier, les mêmes modifications que les noms d’être humains : il y a là une question de classes multiples et non pas une question de double genre humain et non-humain.
[281]Les indigènes de langue peule font une distinction entre le parler des Toucouleurs et celui des Peuls proprement dits : les premiers appellent leur langue poular, tandis que les seconds donnent à la même langue, telle qu’ils la parlent eux-mêmes, le nom de foulfouldé.
[421]CHAPITRE IV
Bibliographie linguistique.
Je n’ai pas l’intention d’établir ici une liste complète des publications relatives aux langues soudanaises : une telle bibliographie, bien peu fournie en ce qui concerne certains idiomes, serait au contraire fort étendue pour ce qui regarde le mandingue, le peul et surtout le haoussa. Mais parmi tout ce qui a été publié sur ces langues et sur d’autres, beaucoup d’ouvrages ou de mémoires ne présentent plus guère d’intérêt aujourd’hui que pour les collectionneurs et les érudits.
Je voudrais donner seulement l’indication des ouvrages les plus récents et de ceux qui offrent le plus de garanties et de facilités pour l’étude des langues parlées dans le Haut-Sénégal-Niger. Je crois en effet ce renseignement fort utile, si j’en juge par le grand nombre de personnes qui se sont adressées à moi pour savoir où elles pourraient étudier telle ou telle langue de la colonie.
Etudes générales de linguistique soudanaise.
F. W. H. Migeod. — The languages of West-Africa, vol. I. — London (Kegan-Paul), 1911, in-8, 374 pages.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues ou dialectes parlés à la Côte d’Ivoire et dans les régions limitrophes. — Paris (Leroux), 1904, gr. in-8, 284 pages.
Arabe.
O. Houdas. — Précis de grammaire arabe (langue écrite et langue parlée). — Paris (André), 1897, in-8, 264 pages.
[422]R. Basset. — Notes sur le hassânia. — Paris, 1910, in-8 (fasc. 2 du tome XXXIX des Publications de la Faculté des Lettres d’Alger).
A. de Biberstein-Kasimirski. — Dictionnaire arabe-français. — Paris, 1860, 2 vol. gr. in-8.
E. Gasselin. — Dictionnaire français-arabe (arabe vulgaire et arabe grammatical). — Paris (Leroux), 1880-86, 2 vol. gr. in-4, 974 et 860 pages.
Père J. B. Belot. — Vocabulaire arabe-français à l’usage des étudiants. — Beyrouth, 1898, in-8, 1000 pages (nombreuses éditions).
Remarque. — Ces trois dictionnaires s’adressent surtout à ceux qui voudraient étudier l’arabe écrit ; le troisième, assurément moins complet, mais plus portatif et d’un prix plus abordable, peut suffire dans la plupart des cas.
Zenaga.
Général Faidherbe. — Le Zenaga des tribus sénégalaises. — Paris (Leroux), 1877, in-8, 96 pages.
R. Basset. — Etude sur le dialecte zenaga. — Paris, 1910, in-8 (fasc. 1 du tome XXXIX des Publications de la Faculté des Lettres d’Alger).
Tamacheq.
Général Hanoteau. — Essai de grammaire de la langue tamachek, 2e édit. — Alger (Jourdan), 1896, in-8, 300 pages.
H. Barth. — Travels and discoveries in Northern and Central Africa. — London, 1858, 5 vol. in-8 (renferme un vocabulaire et une grammaire du dialecte des Oulmidden).
Cid Kaoui. — Dictionnaire pratique tamâheq-français. — Alger (Jourdan), 1900, gr. in-4, 444 pages.
A. de Motylinski. — Grammaire et dictionnaire français-touareg. — Alger (Jourdan), 1908, in-8, 330 pages.
Haoussa.
M. Delafosse. — Manuel de langue haoussa. — Paris (Maisonneuve), 1901, in-18, 136 pages.
M. Landeroin et J. Tilho. — Grammaire et contes haoussas. — Paris (E. Larose), 1909, in-18, 292 pages.
Les mêmes. — Dictionnaire haoussa comprenant haoussa-français et français-haoussa. — Paris (E. Larose), 1910, in-18, 172 et 164 pages.
Ouolof.
Mgr A. Kobès. — Grammaire de la langue wolofe. — Saint-Joseph de Ngazobil, 1869, in-8.
[423]J. B. Rambaud. — La langue wolof. — Paris (Leroux), 1903, pet. in-8, 106 pages.
Mgr A. Kobès. — Dictionnaire français-wolof. — Dakar, 1855, in-8.
Le même. — Dictionnaire wolof-français, nouv. édit. — Saint-Joseph de Ngazobil, 1875, in-8.
P. H. Greffier. — Guide de la conversation français-volof. — Saint-Joseph de Ngazobil, 1907, in-32.
Peul.
Dr Tautain. — Contribution à l’étude de la langue foule (Revue de linguistique et de philologie comparées, Paris, 1889-90, 82 pages).
T. G. de Guiraudon. — Manuel de la langue foule. Paris (Welter), 1894, in-18, 144 pages.
H. Gaden. — Note sur le dialecte foul parlé par les Foulbé du Baguirmi (Journal asiatique, Paris, janv.-févr. 1908, 70 pages).
D. Westermann. — Handbuch der Ful-Sprache. — Berlin, 1909, in-8, 274 pages.
Songaï.
A. Hacquard et A. Dupuis. — Manuel de la langue songay. — Paris (Maisonneuve), 1897, in-18, 254 pages.
A. Dupuis-Yakouba. — Les Gow, chasseurs du Niger (texte songaï et traduction française). — Paris (Leroux), 1911, in-8, 300 pages environ.
Langues mandé : étude générale.
H. Steinthal. — Die Mande-Neger-Sprachen. — Berlin, 1867, in-8, 344 pages.
M. Delafosse. — Essai de manuel pratique de la langue mandé (IVe partie). — Paris (Leroux), 1901, gr. in-8, 304 pages.
Bozo.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs (le chap. IV renferme un court vocabulaire bozo et quelques notes de grammaire). — Rien autre n’a été publié à ma connaissance sur la langue bozo.
Soninké (aucune étude complète de la langue soninké n’a paru jusqu’à présent).
Général Faidherbe. — Langues sénégalaises. — Paris (Leroux), 1887, in-18, 266 pages (renferme une courte notice grammaticale et un vocabulaire).
Dr Tautain. — Note sur les trois langues soninké, banmana et mallinké (Revue de linguistique et de philologie comparées, Paris, 1887).
[424]G. Bastard. — Essai de lexique pour les idiomes soudanais (Revue Coloniale, Paris, mai 1900. — Renferme un vocabulaire soninké).
M. Delafosse. — Essai de manuel pratique de la langue mandé (IVe partie, chap. VIII).
Le même. — Vocabulaires comparatifs (chap. IV).
Kâgoro : néant.
Mandingue (dialecte banmana).
F. S. (Père Sauvant). — Manuel de la langue bambara. — Maison-Carrée, 1905, in-8, 154 pages.
Mgr H. Bazin. — Dictionnaire bambara-français. — Paris, 1906, gr. in-8, 694 pages.
Moussa Travélé. — Petit manuel français-bambara. — Paris (Geuthner), 1910, in-8, 68 pages.
Mandingue (dialecte khassonkè).
G. Bastard. — Essai de lexique (renferme un vocabulaire khassonkè).
M. Delafosse. — Essai de manuel pratique de la langue mandé (IVe partie, chap. V).
Mandingue (dialecte malinké).
J. B. Rambaud. — La langue mandé. — Paris (Bouillon), 1896, in-8, 132 pages.
Père Abiven. — Grammaire malinké. — Paris, 1900, in-8.
Le même. — Dictionnaire malinké-français. — Paris, 1900, in-8.
Le même. — Dictionnaire français-malinké. — Paris, 1900, in-8.
Missionnaires du Saint-Esprit. — Dictionnaire français-malinké et malinké-français. — Conakry, 1906, in-18, 176 pages.
Mandingue (dialecte dioula).
M. Delafosse. — Essai de manuel pratique de la langue mandé (les trois premières parties concernent spécialement le dialecte dioula).
Soussou (diallonké).
J. H. Dupont. — Outline of a grammar of the Susu language. — London, 1882, in-12.
J. B. Raimbault. — Dictionnaire français-soso et soso-français. — Rio-Pongo, 1885, in-18, 164 pages.
Samorho : néant.
Sia.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs (le chap. IV renferme un court vocabulaire sia et des notes grammaticales). — Rien autre n’a été publié à ma connaissance sur la langue sia.
[425]Sénoufo.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs (chap. V : dialectes des Minianka, des Folo et de plusieurs tribus de la Côte d’Ivoire). — Rien autre n’a été publié à ma connaissance sur la langue sénoufo.
Langues voltaïques : étude générale.
M. Delafosse. — Les langues voltaïques (Boucle du Niger). (Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, tome XVI, fasc. 6, Paris, 1911).
Tombo, Dogom et Déforo : néant.
Mossi.
F. Froger. — Etude de la langue des Mossi, suivie d’un vocabulaire et de textes. — Paris (Leroux), 1910, gr. in-8, 260 pages.
Gourmantché.
F. Dubois. — Vocabulaire gourma (Bulletin du Comité de l’Afrique Française, Paris, juillet 1898). — Rien autre.
Nankana : néant.
Dagari et Birifo.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs (chap. VII). — Rien autre.
Nounouma.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs (chap. VII, gouressi). — Rien autre.
Sissala.
F. W. H. Migeod. — The languages of West-Africa (numération page 144 et quelques phrases page 284 en isala et ajolo).
Boussansé : néant.
Lobi, Dian, Pougouli et Gan.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs (chap. VII). — Rien autre.
Bobo.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs (chap. VII, vocabulaires des dialectes kian et tara et notes grammaticales). — Rien autre.
Koulango.
M. Delafosse. — Vocabulaires comparatifs (chap. VII). — Rien autre.
[426]Bariba.
S. W. Koelle. — Polyglotta africana. — London, 1854, gr. in-fol. (renferme un vocabulaire barba). — Rien autre.
Soumba : néant.
[427]TABLE
DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME
| Pages | |
| Préface par M. le gouverneur Clozel | 1 |
| Documents annexes | 13 |
| Avant-propos | 31 |
| Première partie : le pays | 35 |
| Chapitre premier : limites | 37 |
| Chapitre II : hydrographie | 45 |
| Hydrographie rétrospective | 45 |
| Bassin de la Comoé | 63 |
| Bassin du Sénégal | 64 |
| Bassin de la Volta | 66 |
| Bassin du Niger | 68 |
| Chapitre III : orographie | 75 |
| Chapitre IV : régions naturelles | 79 |
| Chapitre V : climatologie | 90 |
| Chapitre VI : répartition de la population | 96 |
| Chapitre VII : géographie administrative | 103 |
| Deuxième partie : les peuples | 107 |
| Chapitre premier : classification et répartition géographique actuelle des divers groupements ethniques | 109 |
| Nomenclature des familles, groupes et peuples | 113 |
| Différentes appellations données aux peuples | 116 |
| Composition de chaque peuple | 131 |
| Répartition numérique des peuples | 142 |
| Population de chacune des circonscriptions administratives | 157 |
| Chapitre II : origine et formation des groupements ethniques actuels | 175 |
| Généralités | 175 |
| [428]Maures de l’Azaouad | 180 |
| Maures du Hodh | 183 |
| Touareg | 191 |
| Peuls | 198 |
| Toucouleurs | 235 |
| Songaï | 238 |
| Mandé du Nord | 252 |
| Mandé du Centre | 282 |
| Mandé du Sud | 296 |
| Sénoufo | 300 |
| Peuples voltaïques | 302 |
| Tableau chronologique | 319 |
| Chapitre III : ethnographie descriptive | 327 |
| Caractères physiques | 327 |
| Habitation, vêtement, parure et armement | 333 |
| Mentalité et genre de vie | 341 |
| Troisième partie : les langues | 353 |
| Chapitre premier : classification et répartition des langues du Haut-Sénégal-Niger | 357 |
| Nomenclature et classification | 357 |
| Répartition géographique, ethnique et numérique | 364 |
| Langues écrites et langues parlées | 374 |
| Chapitre II : linguistique comparée | 387 |
| Composition et formation des mots | 387 |
| Morphologie et syntaxe | 390 |
| Phonétique | 404 |
| Chapitre III : Caractères généraux de chacune des quatre langues principales | 408 |
| Mossi | 408 |
| Mandingue | 409 |
| Peul | 412 |
| Songaï | 419 |
| Chapitre IV : bibliographie linguistique | 421 |
LAVAL. — IMPRIMERIE L. BARNÉOUD ET Cie.
Note du transcripteur :
- Les changements dans l’ERRATA ont été aportés.
- Page 12, " intestines et de bararie " a été remplacé par " barbarie "
- Page 15, " Colonisatien, main-d’œuvre, crédit " a été remplacé par " Colonisation "
- Page 53, " que peu de renseigements " a été remplacé par " renseignements "
- Page 58, " et n n pas des Berbères " a été remplacé par " et non pas "
- Page 130, note 62, " du la Boucle de Niger " a été remplacé par " de la Boucle du Niger "
- Page 137, " au m ins à l’heure actuelle " a été remplacé par " au moins "
- Page 138, " cercles de Bolo-Dioulasso " a été remplacé par " Bobo-Dioulasso "
- Page 148, " du Niger de Bourem a Niamey " a été remplacé par " Bourem à Niamey "
- Page 162, " les Tombo dans l’ést " a été remplacé par " l’Est "
- Page 165, " Dioula, 1.474 Bannama " a été remplacé par " Banmana "
- Page 179, " du cercle de Satagoudou " a été remplacé par " Satadougou "
- Page 185, note 108, " mieux imformé que Yakout " a été remplacé par " informé "
- Page 239, " Soninké de Banamba est le bannama " a été remplacé par " banmana "
- Page 245, " les meillleurs soldats de l’armée " a été remplacé par " meilleurs "
- Page 247, " se mettre sous la protetcion " a été remplacé par " protection "
- Page 264, " pris fin et leur dipersion " a été remplacé par " dispersion "
- Page 276, " desquels elles se contituèrent " a été remplacé par " constituèrent "
- Page 284, " trouver a l’étroit dans " a été remplacé par " à "
- Page 289, " vraisembleblement des Kâgoro " a été remplacé par " vraisemblablement "
- Page 321, " maisons à terasse à Gao " a été remplacé par " terrasse "
- Page 338, " sont en général reconnaisables " a été remplacé par " reconnaissables "
- Page 346, " devaient nécesrairement passer toutes " a été remplacé par " nécessairement "
- Page 412, " abusif d’un passif imcomplet " a été remplacé par " incomplet "
- Page 415, " dans l’applica-cation des principes " a été remplacé par " l’application "
- De plus, quelques changements mineurs de ponctuation et d’orthographe ont été apportés.